

Du livre-mulet et de Guido Ceronetti
Sienne, Albergo Toscana, ce 26 janvier, soir. - J’ai parlé d’ Une vie divine comme d’un livre-mulet, de ces ouvrages inclassables et multiformes, dans lesquels on n’en finit pas de grappiller, dont les Essais de Montaigne est le plus fameux exemple et qu’un autre livre illustre également: bien cher à mon souvenir, (constellé qu’il se trouve de notes et d’aquarelles du jeune François de Nantes qui partageait mes passions de l’époque), dont le titre est La Patience du brûlé et l’auteur le Toscan Guido Ceronetti, vivant comme un franciscain dans le pays proche et que j'ai retrouvé ce soir à la Trattoria Diana, à deux pas du Campo.
« La vie fait passer à travers notre pauvre chair des projectiles et des poignards », murmure le petit homme à l’imper soigné et au sempiternel béret, qui s’exprime avec un raffinement d’aristocrate ascétique : « On est blessé, mais aussi cela aiguise. Somme toute, j’aurai vécu en curieux. En amateur. Tout ce que j’écris vient de la vie. C’est en feuilletant la vie que j’ai découvert des choses… »
De ces « choses de la vie » dont les journaux sont pleins, Guido Ceronetti s’étonne que ses pairs fassent si peu de cas. « Je ne comprends pas que les écrivains italiens d’aujourd’hui se désintéressent à ce point du monde terrible qui nous entoure. On dirait qu’ils vivent en aveugle. Seul, peut-être, mon ami Guido Piovene avait le sens des problèmes de l’époque. Quant à moi, je me suis toujours passionné pour le crime. Il y a là un tel mystère… Et n’est-ce pas la base, en outre, de toute légende ? »
Est-ce un écrivain « engagé », au sens ordinaire, ou un « témoin de son temps », comme on dit, qui s’exprime ainsi ? Absolument pas. Mais on sait l’implication virulente du chroniqueur de La Stampa dans la réalité italienne. Anticommuniste en un temps où cela valait d’hystériques condamnations, puis s’en prenant aux pollueurs industriels et aux barbares de la décadence culturelle, il s’est fait détester tous azimuts par sa virulence d’imprécateur et sa position de franc-tireur pauvre à la Léon Bloy. Car Ceronetti vit de rien dans un bourg de Toscan, loin des cercles littéraires ou académiques. Il n’écrit point de romans à succès mais des poèmes et des sortes d’essais très concentrés, où les aphorismes déflagrateurs (« Comment une femme enceinte peut-elle lire un journal sans avorter ? » - « L’arme la plus dangereuse qui ait été inventée est l’homme » - « Qui tolère le bruit est déjà un cadavre » - « Si le Mal a créé le monde, la Bien devrait le défaire ») voisinent avec des développements plus amples sur les thèmes du rapport de l’homme avec son corps et avec le Cosmos, impliquant donc la maladie et l’érotisme, l’obsession quasi maniaque pour la diététique et une détestation non moindre de la technique (« un serviteur si parfait, voyez-vous, qu’il va nous anéantir »), la réflexion métaphysique et la méditation sur l’Histoire passée ou présente, entre autres digressions mystiques ou philologiques, émerveillements artistiques, vibrations sensibles enfin d’un médium un peu sorcier qui a recrée la vie à bout de fil en sa qualité de manipulateur de marionnettes, à l’enseigne de son Teatro dei Sensibili très prisé du Maestro Federico Fellini…
Dans sa postface au Silence du corps (Prix Médicis du meilleur livre étranger 1984), Cioran disait que l’impression donnée par Ceronetti était «de quelqu’un de blessé à l’égal de tous ceux à qui fut refusé le don de l’illusion ». Or de son ami roumain, Guido partage en effet la vision gnostique du monde: « C’est vrai. Je suis une sorte de cathare. Peut-être cette vision dualiste est-elle toute fausse ? Je ne sais trop – disons que j’ai besoin de penser ainsi… »
Sombre Ceronetti ? Certes très pessimiste sur l’avenir de l’espèce : « Le monde actuel va devoir affronter un terrorisme de type apocalyptique. Voyez le nouveau nihilisme à caractère religieux qui se développe dans le monde, notamment chez les islamistes et dans les sectes fondamentalistes : il semble qu’il n’y ait aucune possibilité de paix et que l’humanité doive s’enfoncer dans cette vase sanglante »…
La patience du brûlé
Guido Ceronetti ne voyage pas com me moi, tel l’escargot du futur, avec son ordinateur sur le dos. «Une telle peste ne m’aura pas dans son lazaret », note-t-il au terme du travail de « fusion rhapsodique » qu’il a accompli dans La patience du brûlé (La pazienza dell’arrostito) sur la base de carnets annotés à la main au fil de cinq ans de déambulations par les routes d’Italie et les livres, de 1983 à 1987.
me moi, tel l’escargot du futur, avec son ordinateur sur le dos. «Une telle peste ne m’aura pas dans son lazaret », note-t-il au terme du travail de « fusion rhapsodique » qu’il a accompli dans La patience du brûlé (La pazienza dell’arrostito) sur la base de carnets annotés à la main au fil de cinq ans de déambulations par les routes d’Italie et les livres, de 1983 à 1987.
La patience du brûlé n’a rien pour autant du journal de bord ordinaire. C’est un formidable concentré d’impressions visuelles (non du tout pittoresques mais picturales, pourrait-on dire, avec une superbe digression finale sur la distribution des couleurs), d’observations « le long du chemin » et de pensées, d’échos de lectures à n’en plus finir, de relevés de graffiti muraux (source populaire souvent riche d’invention), de souvenirs, d’invectives (contre la hideur des villes dégradées par l’invasion touristique ou l’anarchie industrielle, et plus encore contre la vulgarité généralisée) ou enfin de très délicates petites scènes qui disent, par contraste, ses qualités de cœur et d’esprit.
Bref, La patience du brûlé est de ces livres-gigognes qu’il faut avoir sans cesse à portée de soi pour y revenir comme à une fenêtre ou à l’œil d’un puits au fond de l’eau duquel brillerait encore un peu de ciel…
Guido Ceronnetti, La patience du brûlé. Traduit de l’italien par Diane Ménard, Albin Michel, 453p. Le silence du corps est disponible en livre de poche Biblio.




 que rien d’intéressant ne s’écrit dans ce pays, un reproche plus fondé a souvent été fait, à la littérature romande, de manquer d’attention au monde extérieur et de se cantonner dans un certain nombrilisme spiritualisant, dans la double tradition de l’individualisme protestant et du romantisme panthéiste hérité de Rousseau. Ce qu’on appelait naguère l’« âme romande», les yeux au ciel, a cependant du plomb dans l’aile, tant l’éclatement des frontières et la transformation des mentalités et des mœurs ont marqué le climat social et moral dans lequel nous baignons, et les preuves de rupture ne cessent de se multiplier, comme l’illustrent les deux derniers livres d’Yves Laplace et Frédéric Pajak, tous deux d’ailleurs assez décentrés par rapport à la culture romande, encore que…
que rien d’intéressant ne s’écrit dans ce pays, un reproche plus fondé a souvent été fait, à la littérature romande, de manquer d’attention au monde extérieur et de se cantonner dans un certain nombrilisme spiritualisant, dans la double tradition de l’individualisme protestant et du romantisme panthéiste hérité de Rousseau. Ce qu’on appelait naguère l’« âme romande», les yeux au ciel, a cependant du plomb dans l’aile, tant l’éclatement des frontières et la transformation des mentalités et des mœurs ont marqué le climat social et moral dans lequel nous baignons, et les preuves de rupture ne cessent de se multiplier, comme l’illustrent les deux derniers livres d’Yves Laplace et Frédéric Pajak, tous deux d’ailleurs assez décentrés par rapport à la culture romande, encore que…


 Quatre d’entre elles (2)
Quatre d’entre elles (2)
 Quatre d’entre elles (1)
Quatre d’entre elles (1)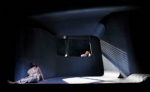 Eloge de la faiblesse à la scène
Eloge de la faiblesse à la scène 








 Niesen, acryl sur toile, 2006.
Niesen, acryl sur toile, 2006.
 Georges Rouault. Bouquet au paysage lunaire. Vers 1940. Huile sur toile, 43/29cm. Collection Rosengart, Lucerne.
Georges Rouault. Bouquet au paysage lunaire. Vers 1940. Huile sur toile, 43/29cm. Collection Rosengart, Lucerne.



