 Paulo Coelho, messie multipack de la littérature de gare et d’aérogare, ex chanteur de rock et futur Nobel de mystique ploutocratique, est apparu ces derniers jours au Salon du Livre de Genève, où je n’étais pas et peux donc en parler plus librement...
Paulo Coelho, messie multipack de la littérature de gare et d’aérogare, ex chanteur de rock et futur Nobel de mystique ploutocratique, est apparu ces derniers jours au Salon du Livre de Genève, où je n’étais pas et peux donc en parler plus librement...
En bonus: retour à La solitude du vainqueur, qui fit date dans le genre démago...
Un critique littéraire est-il censé parler des livres de Paulo Coelho, plus que des romans de feue Barbara Cartland ? La question ne s’est pas posée à la parution de L’Alchimiste, conte initiatique fait de bric et de brocante qui pouvait faire illusion, genre Petit princerelooké New Age. Mais comment défendre ce qui a suivi ? Comment ne pas voir que le présumé auteur inspiré, ex-hippie visité par la Muse, était moins un candide conteur qu’un malin opportuniste jouant avec la crédulité des foules, dont la mythologie pseudo-mystique des Guerriers de la Lumière qu’il bricola en marge de ses écrits ne cédait en rien au marshmallow pseudo-spirituel des sectes multinationales, de Moon à la Scientologie en passant par les fameux adeptes (paix à leurs cendres) du Temple S olaire.
Si le critique littéraire « à l’ancienne » regimbe à l’idée de parler du contenu (?) et de la forme (??) des romans de Paulo Coelho, c’est que l’idée de faire la leçon aux foules, du haut de son «élitisme», ajoute au dégoût de parler pour rien, puisque de toute façon la Machine à faire pisser le dinar tourne à plein régime.
 J’ai rencontré trois fois, réellement puis virtuellement, Paulo Coelho. La première fois, c’était au lancement de L’Alchimiste.Charmant garçon, relax max, un vrai pote. Ce qu’il m’a dit était peu de chose, mais « tout est dans le livre » étions-nous convenus. La deuxième, ce fut dans un cagibi préservé du bruit du Salon du Livre de Genève, dont le Brésil était l’invité d’honneur. Paulo se souvenait très bien de moi, prétendait-il. Comme je suis bonne pâte, j’ai fait celui qui le croyait, tout en notant qu’il n’avait rien de plus à me dire que la première fois. Par ailleurs, comme c’est loin d’être un imbécile, il avait constaté que mes questions trahissaient un esprit critique inapproprié, comme on dit, et la non-conversation tourna court. Audit Salon du Livre, je relevai le fait que les piles des best-sellers de Coelho occupaient le devant des devantures du Pavillon du Brésil, alors que les Jorge Amado et autres plumitifs « élitaires » se trouvaient relégués en second rang - mais quel esprit mesquin me fait noter un tel détail...
J’ai rencontré trois fois, réellement puis virtuellement, Paulo Coelho. La première fois, c’était au lancement de L’Alchimiste.Charmant garçon, relax max, un vrai pote. Ce qu’il m’a dit était peu de chose, mais « tout est dans le livre » étions-nous convenus. La deuxième, ce fut dans un cagibi préservé du bruit du Salon du Livre de Genève, dont le Brésil était l’invité d’honneur. Paulo se souvenait très bien de moi, prétendait-il. Comme je suis bonne pâte, j’ai fait celui qui le croyait, tout en notant qu’il n’avait rien de plus à me dire que la première fois. Par ailleurs, comme c’est loin d’être un imbécile, il avait constaté que mes questions trahissaient un esprit critique inapproprié, comme on dit, et la non-conversation tourna court. Audit Salon du Livre, je relevai le fait que les piles des best-sellers de Coelho occupaient le devant des devantures du Pavillon du Brésil, alors que les Jorge Amado et autres plumitifs « élitaires » se trouvaient relégués en second rang - mais quel esprit mesquin me fait noter un tel détail...
Or je reviens à ma question : l’approche critique des livres de Paulo Coelho a-t-elle le moindre intérêt. Certes : en tant que phénomène typique des simulacres de la culture globalisée, cette approche est intéressante, bien plus que celle d’autres best-sellers mondiaux du type Barbara Cartland. Pourquoi cela ? Parce que la secte virtuelle entretenue par les livres et le site internet (récemment restructuré après avoir atteint des sommets de kitsch New Age) de Paulo Coelho participent à l’évidence du multiculturalisme mou visant au décervelage des populations.
Paulo Coelho est le Messie de cette idéologie anesthésiante, qui ne manque pas un World Economic Forum. C’est d’ailleurs là que je l’ai rencontré la troisième fois, à titre virtuel. Etait-ce à Davos, à Zermatt ou à quelque autre sommet de la Phynance ?
Peu importe à vrai dire, et peu importe si c’était le vrai Paulo Coelho qu’on voyait sur l’écran. A vrai dire, comme il y eut en son temps des Saddam de rechange, il est fort possible que le petit homme en jeans et à bouc grisonnant ne soit qu’un prête-face à l’entreprise Coelho & Coelho, dont Sulitzer pourrait écrire la chronique, à supposer que Loup Durand en ait encore le tonus. Tout cela est passionnant, n’est-il pas ?
Dans les années 20 du XXe siècle, le génial romancier-visionnaire Stanislaw Ignacy Witkiewicz imagina, dans L’Inassouvissement, une secte multimondiale, guidée par le phénoménal Murti Bing, qui avait commercialisé une pilule assurant à chacun la Vision Lumineuse de la Lumière Invisible. On voit que Paulo Coelho n’a rien inventé : belle découverte en vérité, et ça continue aujourd'hui.
Paulo Coelho entre Croisette et Vatican
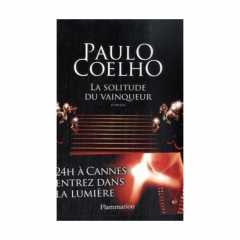 Car, en fait de démagogie spiritalisante, Paulo Coelho n'en manque pas une. Ainsi a-t-il repris, avec La Solitude du vainqueur, le chemin du Bon combat qui le conduit, cette fois, dans les coulisses sordides du Festival de Cannes, lequel, tiens, vient justement d'ouvrir ses portes infernales. La première invocation du Guerrier de la Lumière nous rappelle qu'il fut un enfant de choeur brésilien avant de s'égarer lui-même dans les miasmes sataniques du rock et de la pop: - Ô Marie sans péché, priez pour nous qui faisons appel à Vous - amen. Sur quoi la première phrase de la Préface de ce Thriller de la Vraie Voie pousse le lecteur à s'agenouiller fissa: "L'un des thèmes récurrents de mes livres est qu'il est important de payer le prix de ses rêves." En l'occurrence: 19 Euros, ce qui fait tout de même 40 balles suisses pour qui ne reçoit pas le Service de Presse gratos... Et la Leçon de s'ensuivre qui ne s'achèvera qu'au terme de cette fable édifiante: "Nous vivons depuis ces dernières décennies au sein d'une culture qui a privilégié notoriété, richesse et pouvoir, et la plupart des gens ont été portés à croire que c'étaient là les vraies valeurs auxquelles il fallaait se conformer". Et le gourou christoïde d'enchaîner aussi sec: "Ce que nous ignorons, c'est que, en coulisses, ceux qui tirent les ficelles demezrent anonymes. Ils savent que le véritable pouvoir est celui qui ne se voit pas. Et puis il est trop tard, et on est piégé. Ce livre parle de ce piège".
Car, en fait de démagogie spiritalisante, Paulo Coelho n'en manque pas une. Ainsi a-t-il repris, avec La Solitude du vainqueur, le chemin du Bon combat qui le conduit, cette fois, dans les coulisses sordides du Festival de Cannes, lequel, tiens, vient justement d'ouvrir ses portes infernales. La première invocation du Guerrier de la Lumière nous rappelle qu'il fut un enfant de choeur brésilien avant de s'égarer lui-même dans les miasmes sataniques du rock et de la pop: - Ô Marie sans péché, priez pour nous qui faisons appel à Vous - amen. Sur quoi la première phrase de la Préface de ce Thriller de la Vraie Voie pousse le lecteur à s'agenouiller fissa: "L'un des thèmes récurrents de mes livres est qu'il est important de payer le prix de ses rêves." En l'occurrence: 19 Euros, ce qui fait tout de même 40 balles suisses pour qui ne reçoit pas le Service de Presse gratos... Et la Leçon de s'ensuivre qui ne s'achèvera qu'au terme de cette fable édifiante: "Nous vivons depuis ces dernières décennies au sein d'une culture qui a privilégié notoriété, richesse et pouvoir, et la plupart des gens ont été portés à croire que c'étaient là les vraies valeurs auxquelles il fallaait se conformer". Et le gourou christoïde d'enchaîner aussi sec: "Ce que nous ignorons, c'est que, en coulisses, ceux qui tirent les ficelles demezrent anonymes. Ils savent que le véritable pouvoir est celui qui ne se voit pas. Et puis il est trop tard, et on est piégé. Ce livre parle de ce piège".
Le piège, revisité par un auteur empruntant à la fois à Gérard de Villiers, pour la délicatesse de l'intrigue frottée de sang, et à feue Barbara Cartland (en moins chaste) pour le zeste d'intrigue sentimentale, entre autres modèles impérissables, rappelle un peu le dessin de Sempé figurant, sur un quai de Saint-Trop, le bon père de famille désignant à ses femme et enfants une kyrielle de yachts plus luxueux les uns que les autres et s'exclamant: vous voyez, ces gens-là sont malheureux bien plus que nous !
Or c'est exactement ce que Madame et Monsieur Toulemonde se diront après lecture (car ils lisent) de La solitude du vainqueur: que tout est pourri-gâté à Cannes, de la jeune starlette au produc véreux ou du styliste self made man au top modèle rwandais - non, je n'invente rien ! Paulo Coelho lui non plus n'a rien inventé, on l'en savait incapable depuis L'Alchimiste, où j'avoue qu'il m'a piégé comme tant d'autres, par une fabrication habile, alors que ce livre déjà n'était qu'une compilation de contes orientaux et de resucées de sagesse passe-partout. À plus tard l'analyse littéraire fouillée (sic) de L solitude du vinqueur. J'attends de me trouve dans l'enceinte du Vatican pour faire mon rapport aui vicaire du fils de Marie-conçue-sans-péché...
 À la rencontre de deux faiseurs de best sellers: Paul-Loup Sulitzer et Gérard de Villiers. Anecdote vintage...
À la rencontre de deux faiseurs de best sellers: Paul-Loup Sulitzer et Gérard de Villiers. Anecdote vintage... D’un gredin l’autre, Gérard de Villiers ne pouvait mieux se présenter, en me faisant attendre lui aussi dans son cabinet de travail de l’avenue Foch, que par la statue trônant au milieu de la pièce, d’une femme nue de laiton doré, accroupie et les jambes largement écartées, dans le sexe de laquelle était fichée une kalachnikov certifiée d’origine.
D’un gredin l’autre, Gérard de Villiers ne pouvait mieux se présenter, en me faisant attendre lui aussi dans son cabinet de travail de l’avenue Foch, que par la statue trônant au milieu de la pièce, d’une femme nue de laiton doré, accroupie et les jambes largement écartées, dans le sexe de laquelle était fichée une kalachnikov certifiée d’origine.

 triment des deux auteurs qui l’accusent d’avoir plagié leur ouvrage ? Ceux-ci, qui n’ont vendu « que » 2 millions d’exemplaires de leur titre, se seraient-ils pareillement acharnés s’il n’avait pas dépassé, lui, les 40 millions d’exemplaires ? Et le juge n’a-t-il pas fait une fleur à Dan Brown du seul fait de son mondial succès ? Le verdict de non-plagiat est-il un progrès en matière d’honnêteté intellectuelle ? Pour ma part, je n’en crois rien, mais il faut dire que je me fais une idée très particulière du plagiat. Plus précisément, le plagiat qui compterait à mes yeux est impossible.
triment des deux auteurs qui l’accusent d’avoir plagié leur ouvrage ? Ceux-ci, qui n’ont vendu « que » 2 millions d’exemplaires de leur titre, se seraient-ils pareillement acharnés s’il n’avait pas dépassé, lui, les 40 millions d’exemplaires ? Et le juge n’a-t-il pas fait une fleur à Dan Brown du seul fait de son mondial succès ? Le verdict de non-plagiat est-il un progrès en matière d’honnêteté intellectuelle ? Pour ma part, je n’en crois rien, mais il faut dire que je me fais une idée très particulière du plagiat. Plus précisément, le plagiat qui compterait à mes yeux est impossible.




