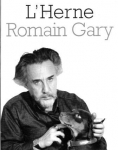Chez les Mahométans disait Grossvater, à celui qui a volé, on coupe la main. Ce qui est juste est juste. Et il faisait le geste, avec une main, de trancher l’autre, supposée avoir fauté.
Au-dessus du poêle de la Stube (la chambre commune) se trouvait une grande photographie montrant Grossvater et Grossmutter au temps du Royal, juchés sur deux chameaux que conduisaient deux personnages vêtus de longues robes noires.
Celui qui va devant, nous avait dit Grossvater, c’est Mustapha, ce qui nous avait fait rire, à cause du maraudeur tigré de nos voisins, à la Rouvraie. Et celui de Grossmutter, c’est Brahim. Le Dieu de Mustapha et de Brahim est Allah. Quand ils vont prier, ils se prosternent ainsi en direction de La Mecque – et Grossvater s’était prosterné devant nous –, et jamais ils n’osent boire une goutte d’alcool, car Allah l’a défendu. Et nous pouvions distinguer, sur la photo sépia, les mains intactes des deux Mahométans.
Ensuite nous passions à table. Durant la prière, je fermais les yeux pour mieux voir Dieu, ainsi que me l’avait recommandé Tante Greta. Et le soir, après qu’il avait rangé sa bécane de colporteur à côté de l’atelier du facteur d’orgues, son plus vieux locataire, Grossvater y allait d’une autre litanie.
On reconnaît l’homme à son travail, disait-il. Lorsque Dieu a chassé Adam et Eve du Jardin, Il savait ce qu’Il faisait. On doit faire son travail comme il faut. Parce que si l’homme ne travaille pas, il va à la taverne et s’enivre pour oublier. Et comme l’argent vient bientôt à lui manquer, car tout se paie, voilà que l’homme est dans les dettes jusqu’au cou.
En outre, convoiter des douceurs, lit-on dans les Proverbes, est un péché, disait Grossvater.
Ainsi, au moment où, rituellement, avant le coucher, Grossmutter faisait passer, autour de la table de la Stube, la grande boîte ornée de vues polychromes des Alpes toujours pleine de choses délectables, les yeux de Grossvater se vrillaient-ils soudain à sa Bible ou à ses glossaires.
De fait, l’Ecriture Sainte et les langues étrangères qu’il avait pratiquées jadis, et dont il se gardait tant bien que mal de perdre l’usage, constituaient l’essentiel de ses lectures vespérales.
Telle année, il nous apprenait ainsi à souper que le fromage, en arabe, se dit ghibne ; et telle autre, que l’expression appropriée à l’infortune du voyageur victime de quelque Italien aux doigts longs se traduit par gli è stato rubato il portafoglio.
Or, dès que Grossvater se mettait à parler d’autres langues que celles de Guillaume Tell ou du Général, son regard s’allumait.
Il disait good night, sleep well en se penchant vers nous, ou bien il disait buenas noches, hasta manana, ou encore, en français pointu de Paris, qu’il connaissait d’un séjour au Ritz, au temps de son apprentissage, il disait bonsoir Froufrou en clignant de l’œil à celle de mes sœurs qui étaient là, et Tante Greta secouait la tête, l’air de trouver que c’étaient là de drôles de manières, cependant que, de son côté, Grossmutter demeurait silencieuse comme à l’accoutumée, les yeux baissés sur son ouvrage.
Puis l’une ou l’autre de nos tantes nous conduisait à la mansarde et, si c’était Tante Greta, nous faisait répéter les versets du jour :
« Dans les cités de la savante Asie
Chez les enfants sauvages du désert
Et jusqu’au sein de la Polynésie
La Vérité marche à front découvert ».
La mansarde exhalait des odeurs d’herbes séchées, de naphtaline et de vieux chapeaux.
Pour échapper aux yeux scrutateurs de l’ours aux parapluies, je n’avais qu’à me tasser sous le duvet, contre la paroi orientée au levant, vers le Mont Righi et La Mecque, pendant qu’on nous faisait la lecture de Pinocchio.
Pinocchio était en bois et il parlait, tandis que l’ours aux parapluies, qu’on avait retiré du hall d’entrée parce qu’il faisait nid à poussière, au dire de tante Greta, ne parlait pas bien qu’il fût lui aussi en bois.
Quant à mon Mâni (ours en peluche), il n’était en bois ni ne parlait, mais c’était mon Mâni que je n’aurais lâché, en de tels instants, pour tout l’or du monde.
 Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.
Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.














 . Rencontre avec David Ayala.
. Rencontre avec David Ayala.
 La folle lucidité d’Artaud
La folle lucidité d’Artaud


 Ce qu’attendant je relève encore ceci, dans le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair : « Cela fut pourtant un jour. Ce qui disparaît du langage disparaîtra aussi un jour. Mais c’est en coulant que l’eau retient le reflet des rives ».
Ce qu’attendant je relève encore ceci, dans le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair : « Cela fut pourtant un jour. Ce qui disparaît du langage disparaîtra aussi un jour. Mais c’est en coulant que l’eau retient le reflet des rives ».