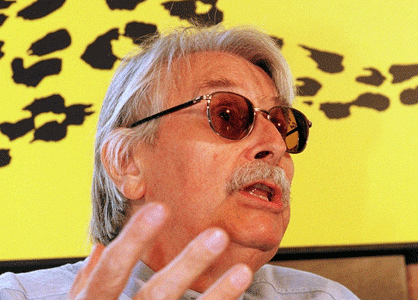De la lumière de Pâques, d'un livre recu d'Yves Leclair, des écrits de Lambert Schlechter, de l'atomisation contemporaine et de la société des êtres.
À La Désirade, ce dimanche 8 avril, jour de Pâques. – Il fait ce matin tout gris et tout bruineux sur nos monts, tout pluvieux et tout neigeux, mais le seul nom de Pâques me fait saluer ce jour lumineux. Cela noté sans qu’un instant je ne cesse d’éprouver et de plus en plus à ces heures le poids du monde, d’un clic je sais que je pourrais accéder à l’instant à toute la saleté du monde, mais à quoi bon y ajouter ? Je traverse la Toile et je passe comme, au même instant, des millions de mes semblables restent scotchés à la Toile ou la traversent et passent.
Et voici que dans cette lumière pascale j’ouvre un petit livre qui m’est arrivé hier de Saumur, que m’envoie le poète Yves Leclair, intitulé Le journal d’Ithaque et dont la dédicace fait allusion à nos « chemins de traverse » respectifs. Je présume que c’est sur mon blog perso qu’Yves Leclair a pris connaissance de ce que j’écris, dans mes Chemins de traverse à paraître bientôt, à propos de son Manuel de contemplation en montagne que j’ai aimé. Autant dire que c’est par la Toile, maudite par d’aucuns, qu’Yves Leclair m’a relancé après un premier échange épistolaire, et par un livre que nos chemins de mots se croisent, comme j’ai croisé ces derniers temps ceux du poète luxembourgeois Lambert Schlechter, ami de Facebook et compagnon de route occulte depuis des années dont je suis en train de lire les épatantes Lettres à Chen Fou.
Tel est l’archipel du monde contemporain où nous sommes tous plus ou moins isolés et reliés à la fois par les liens subtils des affinités sensibles et de passions partagées. Je retrouve ainsi, ce matin, la lumière des mots d’Yves Leclair dont la lecture du Journal d’Ithaque m’enchante aussitôt et d’autant plus que je viens d’entreprendre, de mon côté, un recueil de Pensées en chemin qui prolongeront mes Pensées de l’aube. Je lis ainsi le premier dizain de ces 99 minuscules étapes d’Odyssée, sous-intitulé Sur la route d’Ithaque, 10 août, avec Tour opérateur pour titre, et tout de suite je marche :
Tour opérateur
« Est-on dans une ville ? Où est-
on ? Car ce sont des cabinets
qu’on vous indique – d’expertise
comptable. Vous tombez au fond,
Par hasard, d’une avenue qui
vous conduit de rond-point en rond-
point entre les tours de béton.
Sinon, on vous indique aussi
la direction de l’hôpital
ou du grand centre commercial.
Sur la route d’Ithaque
10 août 2008 .
Juste avant j’avais noté l’exergue à ces Belles Vues, de Constantin Cavafis auquel je pensais l’an dernier à Salonique et que j’ai retrouvé dans le recueil Amérique de William Cliff récemment paru, et du coup la lumière sourde, intime, tendre, trouble un peu que j’aime chez Cavafis m’est revenue par ces mots : « Et même si elle est pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé. Sage comme tu l’es, avec une expérience pareille, tu as sûrement déjà compris ce que les Ithaques signifient ».
Et de fait je les retrouve, mes Ithaques de Toscane ou d’Andalousie, d’Algarve ou de Mazurie, dans les stations de ce petit livre d’Heures d'Yves Leclair où je sens que je vais m’attarder et revenir, avec cette Ordonnance pour la route :
Ordonnance
Attends un peu sur le vieux banc,
au milieu du pré déserté.
Contemple, car rien ne t’attend
sauf la sorcière au noir balai.
Admire la lumière bleue
au soleil d’hiver généreux.
Viens voir en volutes la laine
de la fumée qui se défait
sur les toits des fermes lointaines.
Aime le calme instant de fée.
Le Sappey en Chartreuse
3 novembre 2008
Or il y a des jours et des semaines, des mois et des années que je me promets de parler de Lambert Schlechter, lui aussi évoqué dans mes Chemins de traverse et que j’aime retrouver à tout moment, l’autre jour à Bienne – Ithaque de Robert Walser -, au bord d’un lent canal vert opale, à commencer de lire ses Lettres à Chen Fou, et d’autres fois sur les hauts de Montalcino où se situent précisément des pages à fragments de La Trame des jours, suite de son Murmure du monde.
L’idée d’écrire à un lettré chinois d’un autre siècle est belle, qui convient tout à fait à la nature à la fois stoïque et contemplative de Lambert. Sa façon de décrire les choses du quotidien actuel (que ce soit l’usage d’un poêle à mazout ou d’une ampoule électrique) à un poète d’un autre temps pourrait s’appliquer aussi à l’usage de Facebook ou à la théorie des cordes, sans parler du monde des hommes qui n’est pas plus beau de nos jours que sous les Royaumes Combattants.
« Le livre que j’écris, les livres que j’écris, ce n’est que ça. Juxtaposer sur la même page le visage de Chalamov et l’éclosion des fleurs du pourpier dans la lumière du matin », note Lambert Schlechter dans La Trame des jours.
Ce matin il y avait de la neige sur le jaune de forsythias. J’ai encore copié ce Rimmel d’Yves Leclair comme un écho à ce que je voyais devant la maison :
Rimmel
La route est une agate blanche.
La course humaine ralentit.
Le ciel floconne dans la nuit.
La neige qui tombe en silence
chuchote une étrange élégie.
Comme si tout rimait sans peine,
dessus mon bonnet bleu marine,
mes cils, les pas de la vosine
et même sur les chrysanthèmes
La neige met l’ultime rime.
Retour du boulot
5 janvier 2009
Yves Leclair. Journal d'Ithaque. La Part commune, 127p. 2012
Lambert SChlechter. Lettres à Chen Fou. L'Escampette, 2012.




 Le souffle de la vie est autre chose. Le Verbe est une chose et le souffle de la vie est autre chose. Le vent dans l’herbe ou sur le sable est une chose et les mots pour l’évoquer participent d’autre chose. Notre vie est une chose et les notes que nous prenons pour ne pas oublier ceci ou cela de notre journée est autre chose. Une femme de vingt ans qui se fait agresser à la hache pendant une nuit d’été est un fait divers et c’est une chose, mais ce que cette femme en oubliera pour se protéger et survivre, ou ce qu’elle s’en rappellera et en écrira pour s’en délivrer est une autre chose qui peut nous délivrer aussi dans le même effort de mémoire et d’attention.
Le souffle de la vie est autre chose. Le Verbe est une chose et le souffle de la vie est autre chose. Le vent dans l’herbe ou sur le sable est une chose et les mots pour l’évoquer participent d’autre chose. Notre vie est une chose et les notes que nous prenons pour ne pas oublier ceci ou cela de notre journée est autre chose. Une femme de vingt ans qui se fait agresser à la hache pendant une nuit d’été est un fait divers et c’est une chose, mais ce que cette femme en oubliera pour se protéger et survivre, ou ce qu’elle s’en rappellera et en écrira pour s’en délivrer est une autre chose qui peut nous délivrer aussi dans le même effort de mémoire et d’attention. Or la mémoire n’est pas qu’un stock ou un vrac. La mémoire est un être vivant. La mémoire est une personne et plus encore : la chaîne des personnes et la somme des vivants. La mémoire est universelle et nous traverse, mais le lieu de la mémoire est unique et c’est le Verbe, à tous les sens de l’expression humaine car il y a un Verbe de la parole orale ou écrite comme il y a un verbe des formes et un verbe de la musique, par delà les mots.
Or la mémoire n’est pas qu’un stock ou un vrac. La mémoire est un être vivant. La mémoire est une personne et plus encore : la chaîne des personnes et la somme des vivants. La mémoire est universelle et nous traverse, mais le lieu de la mémoire est unique et c’est le Verbe, à tous les sens de l’expression humaine car il y a un Verbe de la parole orale ou écrite comme il y a un verbe des formes et un verbe de la musique, par delà les mots. Lorsque j’ai commencé de prendre ces notes, vers 1965, donc entre seize et dix-huit ans, j’avais déjà conscience d’accomplir une espèce de rite sacré, sans prendre la pose pour autant. D’ailleurs en ces années la Bible m’ennuyait, dont je ne percevais pas le souffle initial. Le côté sacré du verbe sans majuscule m’atteignait en revanche à la lecture de Cendrars ou d’autres poètes ou romanciers ; vers mes treize ans j’avais commencé de mémoriser des centaines et des milliers de vers, les images de Baudelaire ou de Rimbaud alternaient avec les aventures de Bob Morane ou de San Antonio, la lecture de Vipère au poing d’Hervé Bazin m’avait saisi à quatorze ans, puis me saisit celle d’ Alexis Zorba de Nikos Kazantzaki à seize ans - déjà je me sentais à la fois de plusieurs âges et de plusieurs pays et mon attention éveillée, avivée, affûtée par ce début de lecture du monde, hors de toute autre école que buissonnière, cherchait les mots qui traduiraient mes émois et mes effrois, les peines et les joies de tous.
Lorsque j’ai commencé de prendre ces notes, vers 1965, donc entre seize et dix-huit ans, j’avais déjà conscience d’accomplir une espèce de rite sacré, sans prendre la pose pour autant. D’ailleurs en ces années la Bible m’ennuyait, dont je ne percevais pas le souffle initial. Le côté sacré du verbe sans majuscule m’atteignait en revanche à la lecture de Cendrars ou d’autres poètes ou romanciers ; vers mes treize ans j’avais commencé de mémoriser des centaines et des milliers de vers, les images de Baudelaire ou de Rimbaud alternaient avec les aventures de Bob Morane ou de San Antonio, la lecture de Vipère au poing d’Hervé Bazin m’avait saisi à quatorze ans, puis me saisit celle d’ Alexis Zorba de Nikos Kazantzaki à seize ans - déjà je me sentais à la fois de plusieurs âges et de plusieurs pays et mon attention éveillée, avivée, affûtée par ce début de lecture du monde, hors de toute autre école que buissonnière, cherchait les mots qui traduiraient mes émois et mes effrois, les peines et les joies de tous. Ces notes, qui voudraient capter le souffle de la vie ont été consignées, dès le tournant de ma vingtième année et jusqu’aujourd’hui, dans une centaine de carnets constituant un journal de plus en plus « extime », quand bien même le lieu de l’intimité serait à mes yeux une source inextinguible de poésie. Ces notes, bon an mal an, sont devenues la base continue de ma présence au monde et de mon activité d’écrivain, cristallisant, et de plus en plus consciemment, comme d’un ouvrage concerté dans le temps et « avec le Temps », la substance infiniment variée de la vie vécue au jour le jour. Mon travail s’est déployé dans la narration romanesque et d’autres formes de l’expression littéraire, mais ces « journaliers », pour faire écho à ceux de Marcel Jouhandeau ou aux journaux respectifs de Paul Léautaud, de Jules Renard ou d’Amiel, aux notes de Ludwig Hohl ou plus essentiellement encore aux Feuilles tombées de Vassily Rozanov, correspondent le mieux à l’expression kaléidoscopique de ma perception du monde.
Ces notes, qui voudraient capter le souffle de la vie ont été consignées, dès le tournant de ma vingtième année et jusqu’aujourd’hui, dans une centaine de carnets constituant un journal de plus en plus « extime », quand bien même le lieu de l’intimité serait à mes yeux une source inextinguible de poésie. Ces notes, bon an mal an, sont devenues la base continue de ma présence au monde et de mon activité d’écrivain, cristallisant, et de plus en plus consciemment, comme d’un ouvrage concerté dans le temps et « avec le Temps », la substance infiniment variée de la vie vécue au jour le jour. Mon travail s’est déployé dans la narration romanesque et d’autres formes de l’expression littéraire, mais ces « journaliers », pour faire écho à ceux de Marcel Jouhandeau ou aux journaux respectifs de Paul Léautaud, de Jules Renard ou d’Amiel, aux notes de Ludwig Hohl ou plus essentiellement encore aux Feuilles tombées de Vassily Rozanov, correspondent le mieux à l’expression kaléidoscopique de ma perception du monde. La Vérité avec majuscule est une chose, qui n’appartient pas à l’écrivain, et nos vérités sont autres choses, que le souffle de la vie porte et transforme au fil du Temps.
La Vérité avec majuscule est une chose, qui n’appartient pas à l’écrivain, et nos vérités sont autres choses, que le souffle de la vie porte et transforme au fil du Temps.  Après la publication, en l’an 2000 et aux bons soins de Bernard Campiche, de L’Ambassade du papillon, reprenant mes carnets de 1993 à 1999 sans insertion d’aucune sorte - l’original manuscrit se trouvant juste élagué de quelques centaines de pages -, et celle des Passions partagées, en 2004, remontant trente ans auparavant (de 1973 à 1992) et modulant une forme plus composite nécessitée par le chaos personnel de mes notes de jeunesse et l’apport substantiel de mes lectures, un troisième recueil, intitulé Riches Heures et sous-titré Blog-notes 2005-2008, parut en 2009 à L’Age d’Homme à l’instigation de Jean-Michel Olivier. À ce propos, je soulignerai la considérable stimulation qu’a été, dès juin 2005, l’ouverture d’un blog littéraire intitulé Carnets de JLK, accueillant à la fois une partie de mes notes et d’innombrables articles, proses de toute sorte, essais narratifs ou autres évocations de rencontres et de voyages, dans une forme souvent dictée par ce nouvel appareillage et les liens singuliers qu’il tisse avec une nébuleuse de lecteurs.
Après la publication, en l’an 2000 et aux bons soins de Bernard Campiche, de L’Ambassade du papillon, reprenant mes carnets de 1993 à 1999 sans insertion d’aucune sorte - l’original manuscrit se trouvant juste élagué de quelques centaines de pages -, et celle des Passions partagées, en 2004, remontant trente ans auparavant (de 1973 à 1992) et modulant une forme plus composite nécessitée par le chaos personnel de mes notes de jeunesse et l’apport substantiel de mes lectures, un troisième recueil, intitulé Riches Heures et sous-titré Blog-notes 2005-2008, parut en 2009 à L’Age d’Homme à l’instigation de Jean-Michel Olivier. À ce propos, je soulignerai la considérable stimulation qu’a été, dès juin 2005, l’ouverture d’un blog littéraire intitulé Carnets de JLK, accueillant à la fois une partie de mes notes et d’innombrables articles, proses de toute sorte, essais narratifs ou autres évocations de rencontres et de voyages, dans une forme souvent dictée par ce nouvel appareillage et les liens singuliers qu’il tisse avec une nébuleuse de lecteurs.  Comme il en va des recueils précédents, respectivement dédiés à Bernard Campiche et à Jean-Michel Olivier, ce nouvel ensemble de mes carnets, reprenant en deux tomes la matière des années 2000 à 2011, est le fruit d’une nouvelle collaboration amicale avec Olivier Morattel, dont la sollicitation enthousiaste m’a touché et que je remercie vivement pour son attention.
Comme il en va des recueils précédents, respectivement dédiés à Bernard Campiche et à Jean-Michel Olivier, ce nouvel ensemble de mes carnets, reprenant en deux tomes la matière des années 2000 à 2011, est le fruit d’une nouvelle collaboration amicale avec Olivier Morattel, dont la sollicitation enthousiaste m’a touché et que je remercie vivement pour son attention.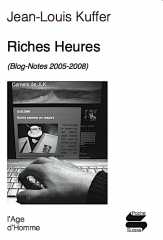 Cette attention, dont le manque représente une grande carence de notre époque, me disait un jour Maurice Chappaz, est à mes yeux le signe d’une qualité majeure, pour l’écrivain comme pour chacun : c’est une modulation de l’amour et de toute relation vraie. «Observer c’est aimer », écrivait encore Charles-Albert Cingria. En notre temps de fausse parole et d’atomisation généralisée, l’attention est une façon, purifiée de tout sentimentalisme et de toute idéologie, de lire le monde et de l’aimer, de refuser l’inacceptable et de dire ce qu’on estime le vrai.
Cette attention, dont le manque représente une grande carence de notre époque, me disait un jour Maurice Chappaz, est à mes yeux le signe d’une qualité majeure, pour l’écrivain comme pour chacun : c’est une modulation de l’amour et de toute relation vraie. «Observer c’est aimer », écrivait encore Charles-Albert Cingria. En notre temps de fausse parole et d’atomisation généralisée, l’attention est une façon, purifiée de tout sentimentalisme et de toute idéologie, de lire le monde et de l’aimer, de refuser l’inacceptable et de dire ce qu’on estime le vrai.  (Ce texte constitue l'introduction de Chemins de traverse, à paraître fin avril aux éditions Olivier Morattel. Vernissage au Salon international du Livre de Genève, le 27 avril, de 17h. à 18h sur la scène de l'Apostrophe. Vernissage personnel au Sycomore, à Lausanne, le 2 mai, de 18h. à 21h.)
(Ce texte constitue l'introduction de Chemins de traverse, à paraître fin avril aux éditions Olivier Morattel. Vernissage au Salon international du Livre de Genève, le 27 avril, de 17h. à 18h sur la scène de l'Apostrophe. Vernissage personnel au Sycomore, à Lausanne, le 2 mai, de 18h. à 21h.) Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.
Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.

 Un cauchemar. - Rêve dantesque la nuit dernière, à la fois plastique et très signifiant, m’évoquant aussi les Délices à la Jérôme Bosch. Nous étions d’abord perdus en campagne, à proximité d’une forêt où l’on nous recommandait de ne pas aller. Nous y allions tout de même et pour découvrir, bientôt, des tombes fraîches par dizaines, puis par centaines, les unes petites et les autres plus grandes, et des voitures aux vitres fumées stationnaient ça et là dans un climat de terrible menace. Nous cherchions donc à fuir, puis nous arrivions dans une espèce de grand parc de jeux où se mêlaient enfants et adultes, la plupart des messieurs à lunettes en costumes d’employés gris dont certains étaient accouplés à des enfants et les besognaient ou mimaient l’acte sexuel - tout restant cependant très «habillé». La scène avait quelque chose de silencieux et de banal, rien de cruel ni de lubrique, mais une sorte de jeu morne effrayant tout de même qui nous poussait à fuir une fois de plus, et nous arrivions au pied d’un bâtiment monumental, évoquant à la fois un palais babylonien et un bunker, dont on ne voyait du bas que les milliers de marches s’élevant vers les hauteurs comme dans un labyrinthe topologique à la Piranèse. Nous étions attirés par la montée de ces marches, mais soudain un petit chariot dévalait la rampe attenante, dans laquelle un nain à face de papier mâché, ou de viande boucanée, nous posait des questions de culture générale genre Trivial Pursuit. Nous comprenions que de bonnes connaissances nous permettraient de nous élever à bord de ce chariot. Mais déjà nous nous retrouvions dans une nuit glaciale et de nouveau très angoissante, peuplée d’ombres longeant de hautes clôtures de barbelés, le long desquelles patrouillaient des soldats aux allures d’escadrons de la mort. A un moment donné, des barrières s’ouvraient et la foule se précipitait vers cette percée, mais bientôt on apprenait qu’il faudrait tuer si l’on voulait passer de l’autre côté, et je ne suis pas sûr que j’y allais, mais je ne suis pas sûr du contraire non plus ; à vrai dire le rêve posait implicitement ce cas de conscience : tuer ou ne pas tuer pour s’en tirer, Il me semble que je n’y allais pas. Ou plus exactement il me semble que j’étais très attiré par la curiosité de tuer, mais que je n’y allais pas.
Un cauchemar. - Rêve dantesque la nuit dernière, à la fois plastique et très signifiant, m’évoquant aussi les Délices à la Jérôme Bosch. Nous étions d’abord perdus en campagne, à proximité d’une forêt où l’on nous recommandait de ne pas aller. Nous y allions tout de même et pour découvrir, bientôt, des tombes fraîches par dizaines, puis par centaines, les unes petites et les autres plus grandes, et des voitures aux vitres fumées stationnaient ça et là dans un climat de terrible menace. Nous cherchions donc à fuir, puis nous arrivions dans une espèce de grand parc de jeux où se mêlaient enfants et adultes, la plupart des messieurs à lunettes en costumes d’employés gris dont certains étaient accouplés à des enfants et les besognaient ou mimaient l’acte sexuel - tout restant cependant très «habillé». La scène avait quelque chose de silencieux et de banal, rien de cruel ni de lubrique, mais une sorte de jeu morne effrayant tout de même qui nous poussait à fuir une fois de plus, et nous arrivions au pied d’un bâtiment monumental, évoquant à la fois un palais babylonien et un bunker, dont on ne voyait du bas que les milliers de marches s’élevant vers les hauteurs comme dans un labyrinthe topologique à la Piranèse. Nous étions attirés par la montée de ces marches, mais soudain un petit chariot dévalait la rampe attenante, dans laquelle un nain à face de papier mâché, ou de viande boucanée, nous posait des questions de culture générale genre Trivial Pursuit. Nous comprenions que de bonnes connaissances nous permettraient de nous élever à bord de ce chariot. Mais déjà nous nous retrouvions dans une nuit glaciale et de nouveau très angoissante, peuplée d’ombres longeant de hautes clôtures de barbelés, le long desquelles patrouillaient des soldats aux allures d’escadrons de la mort. A un moment donné, des barrières s’ouvraient et la foule se précipitait vers cette percée, mais bientôt on apprenait qu’il faudrait tuer si l’on voulait passer de l’autre côté, et je ne suis pas sûr que j’y allais, mais je ne suis pas sûr du contraire non plus ; à vrai dire le rêve posait implicitement ce cas de conscience : tuer ou ne pas tuer pour s’en tirer, Il me semble que je n’y allais pas. Ou plus exactement il me semble que j’étais très attiré par la curiosité de tuer, mais que je n’y allais pas.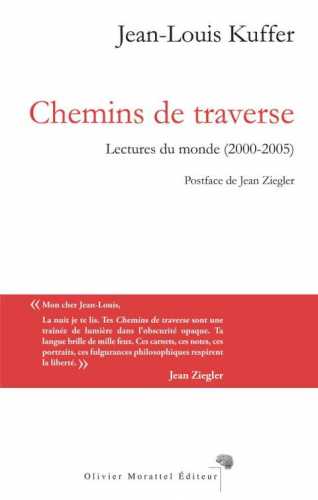


 Vivre, lire et écrire : cela peut être tout un. Ce triple mouvement fonde en tout cas le projet, la démarche et la forme kaléidoscopique de ces Lectures du monde, dont voici le quatrième volume publié après L’Ambassade du papillon, Les passions partagées et Riches Heures.
Vivre, lire et écrire : cela peut être tout un. Ce triple mouvement fonde en tout cas le projet, la démarche et la forme kaléidoscopique de ces Lectures du monde, dont voici le quatrième volume publié après L’Ambassade du papillon, Les passions partagées et Riches Heures.

 Des femmes au travail. - J’ai regardé ce matin plusieurs des Portraits réalisés par Alain Cavalier, qui me plaisent beaucoup. Chaque portrait dure une douzaine de minutes, quasiment en plan-fixe mais cadré et «décoré» avec un soin extrême.
Des femmes au travail. - J’ai regardé ce matin plusieurs des Portraits réalisés par Alain Cavalier, qui me plaisent beaucoup. Chaque portrait dure une douzaine de minutes, quasiment en plan-fixe mais cadré et «décoré» avec un soin extrême. À La Désirade ce 29 mars. — L’aube est toute pure ce matin, et je me sens aussi le coeur léger et l’âme sereine, tout prêt aux bonnes rencontres de cette semaine. En lisant L’exemple de Cézanne, je me dis que ce pèlerinage aux sources du peintre est pour Ramuz un repérage de sa propre situation, de sa solitude et d’une même ambition inaperçue, nimbée de silence. Il y a ceux, d’un côté, qui ont leurs stèles et leurs bustes, et puis il y a Cézanne qui se fond dans le pays de Cézanne, Cézanne qui s’est agrandi par son oeuvre aux dimensions d’un pays, Cézanne que Ramuz retrouve partout dans ce pays qui est lui-même comme un agrandissement de son pays à lui.
À La Désirade ce 29 mars. — L’aube est toute pure ce matin, et je me sens aussi le coeur léger et l’âme sereine, tout prêt aux bonnes rencontres de cette semaine. En lisant L’exemple de Cézanne, je me dis que ce pèlerinage aux sources du peintre est pour Ramuz un repérage de sa propre situation, de sa solitude et d’une même ambition inaperçue, nimbée de silence. Il y a ceux, d’un côté, qui ont leurs stèles et leurs bustes, et puis il y a Cézanne qui se fond dans le pays de Cézanne, Cézanne qui s’est agrandi par son oeuvre aux dimensions d’un pays, Cézanne que Ramuz retrouve partout dans ce pays qui est lui-même comme un agrandissement de son pays à lui. À propos de La Tête des gens, de Jean-François Schwab
À propos de La Tête des gens, de Jean-François Schwab
 Yverdon-les-Bains. Théâtre de l'Echandole, jusqu'au 3 décembre.
Yverdon-les-Bains. Théâtre de l'Echandole, jusqu'au 3 décembre.
 3000 personnes qui ovationnent debout le Vol spécial de Fernand Melgar, 8000 spectateurs touchés au cœur par la projection de Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau sur la Piazza Grande - Prix du public combien prévisible -, ou la même place mythique saisie d’émotion à la découverte du dernier chef-d’oeuvre d’Aki Kaurismäki, Le Havre : trois exemples entre beaucoup d’autres.
3000 personnes qui ovationnent debout le Vol spécial de Fernand Melgar, 8000 spectateurs touchés au cœur par la projection de Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau sur la Piazza Grande - Prix du public combien prévisible -, ou la même place mythique saisie d’émotion à la découverte du dernier chef-d’oeuvre d’Aki Kaurismäki, Le Havre : trois exemples entre beaucoup d’autres. Et ces étoiles du cinéma auxquelles on a déroulé un nouveau tapis rouge, sans trop de flafla mondain pour autant : Leslie Caron saluant en français le génie créateur de Vincente Minelli (sujet de la passionnante rétrospective, à redécouvrir bientôt à Lausanne), Harrison Ford recevant son léopard d’or avant de jouer du colt sur l’écran géant, lsabelle Huppert multipliant les tendres salamalecs à Claude Goretta et Maurice Pialat, Gérard Depardieu faisant son numéro de grand cabot sympa devant un public venu en masse, ou enfin Claudia Cardinale se pointant à la FEVI pour la projection de 8 1/2, chef- d’œuvre de Fellini qu’elle irradie de ses vingt ans - autant d’apparitions « glamoureuses » qu’Olivier Père a su combiner avec son entregent malin sans « singer » le festival de Cannes…
Et ces étoiles du cinéma auxquelles on a déroulé un nouveau tapis rouge, sans trop de flafla mondain pour autant : Leslie Caron saluant en français le génie créateur de Vincente Minelli (sujet de la passionnante rétrospective, à redécouvrir bientôt à Lausanne), Harrison Ford recevant son léopard d’or avant de jouer du colt sur l’écran géant, lsabelle Huppert multipliant les tendres salamalecs à Claude Goretta et Maurice Pialat, Gérard Depardieu faisant son numéro de grand cabot sympa devant un public venu en masse, ou enfin Claudia Cardinale se pointant à la FEVI pour la projection de 8 1/2, chef- d’œuvre de Fellini qu’elle irradie de ses vingt ans - autant d’apparitions « glamoureuses » qu’Olivier Père a su combiner avec son entregent malin sans « singer » le festival de Cannes…  Un vent de renouveau a été salué par la presse, de nos confrères tessinois aux grands journaux parisiens, lesquels ont coqueriqué en constatant la forte représentation française de cette édition, souvent décevante au demeurant. Mais Olivier Père dépasse le chauvinisme français en accueillant aussi généreusement le cinéma suisse (l’étonnant Hell du tout jeune Tim Fehlbaum, sur la Piazza Grande, et trois films en compétition internationale, sans parler des Appellations suisses) que les cinématographies du monde entier et les genres les plus variés.
Un vent de renouveau a été salué par la presse, de nos confrères tessinois aux grands journaux parisiens, lesquels ont coqueriqué en constatant la forte représentation française de cette édition, souvent décevante au demeurant. Mais Olivier Père dépasse le chauvinisme français en accueillant aussi généreusement le cinéma suisse (l’étonnant Hell du tout jeune Tim Fehlbaum, sur la Piazza Grande, et trois films en compétition internationale, sans parler des Appellations suisses) que les cinématographies du monde entier et les genres les plus variés. Le public roi
Le public roi Premier film sensible et vif d’une jeune réalisatrice suisse originaire d’Argentine, le Léopard d’or de cette année, Abrir puertas y ventana, de Milagros Mumenthaler, s’inscrit pourtant mieux dans « l’esprit de Locarno » que les blockbusters hollywoodiens tonitruant cette année sur la Piazza. Or Maire et Père ont voulu cet enfant un peu schizo qu’est devenu le Festival de Locarno. Et le Président Solari boit du petit lait…
Premier film sensible et vif d’une jeune réalisatrice suisse originaire d’Argentine, le Léopard d’or de cette année, Abrir puertas y ventana, de Milagros Mumenthaler, s’inscrit pourtant mieux dans « l’esprit de Locarno » que les blockbusters hollywoodiens tonitruant cette année sur la Piazza. Or Maire et Père ont voulu cet enfant un peu schizo qu’est devenu le Festival de Locarno. Et le Président Solari boit du petit lait… Une polémique indigne
Une polémique indigne





 C’est entendu : le thème du handicap est traité ici de façon si non convenue qu’elle devient presque convenue (le richissime bourgeois cloué sur sa chaise et le beau Black des banlieues sans commisération, ça pourrait même puer la convention dilatoire), et pourtant ce film littéralement tissé de clichés, aux saillies satiriques non moins téléphonées (sur les soignants, l’art contemporain, les goûts musicaux qui se télescopent ou les dérives de la novlangue plus ou moins branchée) ne nous vaut pas moins une formidable pinte de belle humeur et de tendresse, avec une tas d'observations fines dans la foulée - donc merci la compagnie, on ne va pas chipoter sur un tel plaisir...
C’est entendu : le thème du handicap est traité ici de façon si non convenue qu’elle devient presque convenue (le richissime bourgeois cloué sur sa chaise et le beau Black des banlieues sans commisération, ça pourrait même puer la convention dilatoire), et pourtant ce film littéralement tissé de clichés, aux saillies satiriques non moins téléphonées (sur les soignants, l’art contemporain, les goûts musicaux qui se télescopent ou les dérives de la novlangue plus ou moins branchée) ne nous vaut pas moins une formidable pinte de belle humeur et de tendresse, avec une tas d'observations fines dans la foulée - donc merci la compagnie, on ne va pas chipoter sur un tel plaisir... 
 Celui qui s’ennuie à la réception de L’Entreprise dont il a la garde la nuit sans même un chien d’attaque / Celle qui lève des haltères pour rester dans le trend / Ceux qui voient l’ambulance s’éloigner avec un serrement de cœur / Celui qui se détache de lui-même et prétend que c’est sans regret mais son air dit le contraire / Celle qui du Minitel a passé à Meetic et Twitter pour en revenir au Muscadet / Ceux qui hantent les ports embrumés de leurs verres de Brandy / Celui qui n’a jamais supporté les angles de la réalité / Celle qui fuit dans les parenthèses de neige / Ceux qui n’ont pas profité des indépendances pour se faire des empires / Celui qui ne peut plus régater faute d’alizés / Celle qu’on oublie dans la zone tampon / Ceux qui estiment que tout est à repenser en termes générationnels sinon comment comprendre ces Y qui se demandent why ? / Celui qui se dit philosophe sociologue et qui fait pas mal non plus les œufs au plat / Celle qui s’est occupé du linge de corps de plusieurs membres connus de l’Ecole de Francfort / Ceux qui voient Norbert péter un plomb à la salle de musculation et ne s’en étonnent point vu son manque de perfos en affaires / Celui qui affirme donner tout Montaigne pour une page de La Boétie et se fait ainsi remarquer des dames du premier rang qui se demandent si cette Boétie avait du bien / Celui qui explique à ses lycéens que Montaigne et Pascal ne boxaient pas dans la même catégorie / Celle qui s’enquiert de ta santé avec la sollicitude de qui cherche à monter en grade / Ceux qui se reconnaissant dans le bain de vapeur s’ignorent aussitôt / Celui qui n’en peut plus de se contenter de si peu même en comptant ses Bonus / Celle qui dispose des petits numéros à côté de chacun des morceaux du suicidé au plastic / Ceux qui s’étonnent de ne plus s’étonner / Celui qui commence à se demander comment en finir / Celle qui s’allonge sur le piano pour que Chopin la pénètre mieux / Ceux qui sourient d’un air entendu quand la vieille Angélique Python leur propose à la disco de leur faire feuille de rose / Celui qui tombe du septième étage du building et se relève en souplesse ce qui révèle un client fit du Club Silhouette / Celle qui se prend pour sa jumelle et ne se voit donc plus les pieds / Ceux qui ont le cœur en pleurs comme l’oignon pelé de trop près, etc.
Celui qui s’ennuie à la réception de L’Entreprise dont il a la garde la nuit sans même un chien d’attaque / Celle qui lève des haltères pour rester dans le trend / Ceux qui voient l’ambulance s’éloigner avec un serrement de cœur / Celui qui se détache de lui-même et prétend que c’est sans regret mais son air dit le contraire / Celle qui du Minitel a passé à Meetic et Twitter pour en revenir au Muscadet / Ceux qui hantent les ports embrumés de leurs verres de Brandy / Celui qui n’a jamais supporté les angles de la réalité / Celle qui fuit dans les parenthèses de neige / Ceux qui n’ont pas profité des indépendances pour se faire des empires / Celui qui ne peut plus régater faute d’alizés / Celle qu’on oublie dans la zone tampon / Ceux qui estiment que tout est à repenser en termes générationnels sinon comment comprendre ces Y qui se demandent why ? / Celui qui se dit philosophe sociologue et qui fait pas mal non plus les œufs au plat / Celle qui s’est occupé du linge de corps de plusieurs membres connus de l’Ecole de Francfort / Ceux qui voient Norbert péter un plomb à la salle de musculation et ne s’en étonnent point vu son manque de perfos en affaires / Celui qui affirme donner tout Montaigne pour une page de La Boétie et se fait ainsi remarquer des dames du premier rang qui se demandent si cette Boétie avait du bien / Celui qui explique à ses lycéens que Montaigne et Pascal ne boxaient pas dans la même catégorie / Celle qui s’enquiert de ta santé avec la sollicitude de qui cherche à monter en grade / Ceux qui se reconnaissant dans le bain de vapeur s’ignorent aussitôt / Celui qui n’en peut plus de se contenter de si peu même en comptant ses Bonus / Celle qui dispose des petits numéros à côté de chacun des morceaux du suicidé au plastic / Ceux qui s’étonnent de ne plus s’étonner / Celui qui commence à se demander comment en finir / Celle qui s’allonge sur le piano pour que Chopin la pénètre mieux / Ceux qui sourient d’un air entendu quand la vieille Angélique Python leur propose à la disco de leur faire feuille de rose / Celui qui tombe du septième étage du building et se relève en souplesse ce qui révèle un client fit du Club Silhouette / Celle qui se prend pour sa jumelle et ne se voit donc plus les pieds / Ceux qui ont le cœur en pleurs comme l’oignon pelé de trop près, etc. 



 Récits de l'étrange pays, 3.
Récits de l'étrange pays, 3.