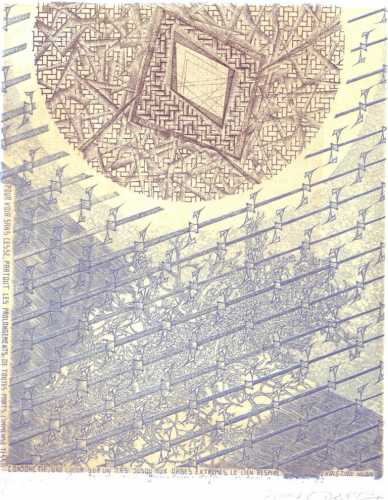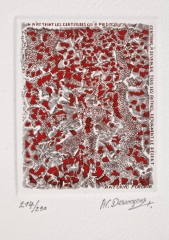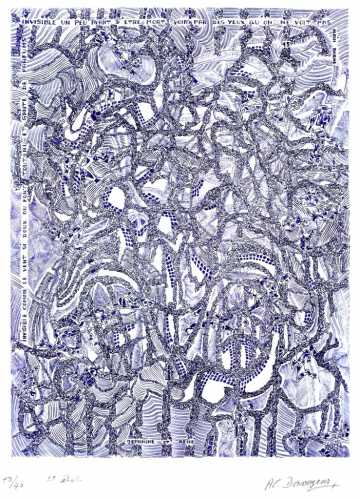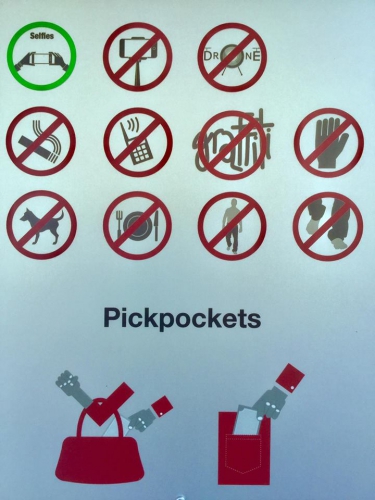La Californie d’Edgar Morin. Retour amont sur un entretien, en 1970, qui prend aujourd’hui un relief singulier.
En 1970, Edgar Morin, sociologue de 49 ans, revient des States et publie son Journal de Californie. Il y évoque les secousses sociales et politiques qui, du Vietnam aux émeutes raciales, en passant par l’explosion de la contre-culture, traversent l’Empire. De tous ces mouvements explosifs, que va-t-il sortir ? Les Etats-Unis vont-ils supporter les cancers qui les rongent ? Ou ces «révolutions » sporadiques seront-elles digérées par le monstre ? Autant de questions qui nous concernent, nous, Européens, auxquelles tente de répondre l’un des sociologues français les plus attentifs aux maux profonds de la société actuelle : Edgar Morin.

- Edgar Morin, qu’entendez-vous par « crise de civilisation » ?
- Ce que j’appelle « crise de civilisation » est en réalité la conjonction de plusieurs crises. Tout d’abord, c’est la crise de la civilisation bourgeoise qui a développé son programme jusqu’au bout et qui avoue son impuissance à donner un bonheur autre que matériel. Et puis, je vois la société américaine déchirée par des tensions internes, d’où pourraient surgir des crises énormes qui, elles, engendreraient un néo-fascisme où, à mon avis, les caractères raciaux et nationalistes, l’hystérie politique en un mot, seraient des traits aussi importants,voire plus, que la nouvelle hiérarchie léviathanesque.
- De quel type seraient alors ces crises ?
- J’en imagine trois : la crise économique semble peu probable, mais elle n’est pas impossible. Beaucoup plus importante me paraît la crise interne, avec le problème de l’émergence de la nation noire, la lutte pour l’émancipation de la femme, les revendications des minorités érotiques, les divers mouvements révolutionnaires et, surtout, le refus d’une partie de la jeunesse américaine, le refus romantique où l’on pourrait voir se dessiner l’avant- garde existentielle du mouvement juvénile international. Enfin, une crise de puissance mondiale, à commencer par la crise de tout le système impérial en Amérique latine.
- Parlons de ce que vous appelez « la croisade des enfants »...
- Oui. A l’origine, on s’en doute, il y a un refus spontané et radical. Les Anglo-Américains se sont voués avec application à l’efficacité et ils y sont bien parvenus. Ce sont eux les leaders de la technicisation du monde, mais ils ne savent pas vivre, et l’art de vivre viendra précisément de ceux qu’ils méprisent.
 — Peut-on évaluer la provenance sociale des jeunes en rupture avec leur milieu ?
— Peut-on évaluer la provenance sociale des jeunes en rupture avec leur milieu ?
— Ce serait évidemment très intéressant de le savoir, mais nous ne disposons pas encore de données suffisantes sur le phénomène. Et puis, les communautés de jeunes ne cessent de se faire et de se défaire. Disons que, en général, ce sont des garçons et des filles venant de la bourgeoisie qu’ils ont donc expérimentée, et avec laquelle ils restent parfois encore en contact par le lien du chèque paternel...
— Vous comparez, dans le « Journal de Californie», les enfants de l’Amérique actuelle aux enfants des sociétés archaïques. Pourquoi cela ?
— Parce que les enfants US ont vécu, depuis la guerre — tant au point de vue de l’environnement qu’au point de vue de l’éducation— dans un univers isolé de l’univers adulte, la chambre individuelle, avec ses objets et décorations, par exemple, favorisant une expérience autonome. Mais, contrairement aux sociétés archaïques, la société moderne ne propose nulle initiation aux adolescents pour leur passage à l’état d’homme...
— Voilà pourquoi ils s’initient eux- mêmes...
 — Exactement. Et comme les jeunes archaïques se retirent du village pour s’isoler quelque temps dans la forêt, les adolescents américains quittent la cellule familiale et vont dans l’« underground », dans les nouveaux ghettos ou dans la nature, sur les plages désertes de Californie.
— Exactement. Et comme les jeunes archaïques se retirent du village pour s’isoler quelque temps dans la forêt, les adolescents américains quittent la cellule familiale et vont dans l’« underground », dans les nouveaux ghettos ou dans la nature, sur les plages désertes de Californie.
— Pourquoi la Californie ?
— La Californie, si vous voulez, c’est la crête de la vague de la civilisation occidentale au moment où elle se retourne sur elle-même et va peut-être s’écraser. Je suis arrivé là-bas au moment de la répression-décadence du phénomène hippie, l’âge d’or ayant été entre 1966 -1967. Ce qui m’intéressait, c’est la mutation dont l’« hippie » était un premier signe et dont les communes et la prolongation du mouvement actuel sont d’autres signes avant- coureurs. Je voulais étudier dans quelle mesure la crise de l’adolescence coïncidait avec la crise de la société et la crise de l’humanité.La Californie, parce que c’est là que la société occidentale est en passe de totale mutation. Après la première lame de fond du « hippie », c’est la floraison des « communes », dans lesquelles on tente de recréer une nouvelle famille fondée sur l’attirance réciproque de ses membres, sur l’amour.Pour la première fois, l’expérience d’un nouveau type de vie n’est plus limitée à une fraction de marginaux isolés, mais peut être considérée comme l’expérience majeure de l’avant-garde d’une génération.
- Et vous pensez que cela va réussir ?
— Il y aura de nombreux échecs, c’est prévisible ; les uns par excès de rigidité, les autres par laisser-aller. Mais ce n’est qu’un début historique, où nous voyons s’amorcer la civilisation post-bourgeoise. Ala différence de la France, où le mouvement est avant tout idéologi-co-politique, le mouvement américain est existentiel et veut révolutionner le mode de vie.
- Pourtant, ce mouvement est extrêmement disparate et, par là-même, affaibli dans son pouvoir d’action. Qu’est-ce qui pourrait catalyser ces« grands micmacs » dont vous parlez ?
— C’est là la question essentielle, car c’est à ce point que s’articule la mutation. L’innocence est la providence du mouvement californien, mais l’ignorance lui sera peut-être fatale...

Qui est Edgar Morin?
Sociologue français travaillant actuellement au Centre européen des communications de masse (organede recherche du CNRS), Edgar Morin a déjà publié de nombreux livres qui lui ont valu autant de détracteurs que de chauds partisans. « L'homme et la mort », «Autocritique », « Le vif du sujet », « La rumeur d'Orléans », tels sont les titres jalonnant l'œuvre d'un des plus brillants intellectuels d'aujourd'hui,qui ne craint pas de s'impliquer dans tout ce qu'il avance en matière scientifique. D'un séjour qu'il fit à la fin de 1969 en Californie, invité par la fondation Salk, il rapporta le « Journal de Californie », où l'homme Morin, l'écrivain aussi bien que l'homme de science, tente de jeter des ponts dans la nuit de notre devenir biologique, sociologique et existentiel. Un livre à lire absolument...
Edgar Morin, Journal de Californie, Seuil 1970.
(Cet entretien a paru dans le magazine dominical de La Tribune-Le Matin, en novembre 1970)





 Céline ramenait le genre à la «lettre à la petite cousine », s’agissant de la romance à quoi se réduit en effet la plupart des romans contemporains et pas seulement de gare ou d’aérogare, mais Céline n’était pas tout à fait romancier lui-même, plutôt chroniqueur et génial, génie de la transposition musicale, mélodie et rythme, le style au corps, malaxeur du verbe comme pas deux, sourcier de langage mais trop entièrement lui-même, trop exclusivement personnel pour faire ce romancier médium que j’entends ici, tel que l’ont été un Tolstoï ou un Henry James, un Dostoïevski et un Kundera dans de plus étroites largeurs mais à un degré de lucidité créatrice rare.
Céline ramenait le genre à la «lettre à la petite cousine », s’agissant de la romance à quoi se réduit en effet la plupart des romans contemporains et pas seulement de gare ou d’aérogare, mais Céline n’était pas tout à fait romancier lui-même, plutôt chroniqueur et génial, génie de la transposition musicale, mélodie et rythme, le style au corps, malaxeur du verbe comme pas deux, sourcier de langage mais trop entièrement lui-même, trop exclusivement personnel pour faire ce romancier médium que j’entends ici, tel que l’ont été un Tolstoï ou un Henry James, un Dostoïevski et un Kundera dans de plus étroites largeurs mais à un degré de lucidité créatrice rare.

 À propos d’un atroce incendie criminel, en terre vaudoise, qui a coûté la vie à vingt-quatre chevaux et poneys. Un drame possiblement révélateur de divers aspects de la folie ordinaire…
À propos d’un atroce incendie criminel, en terre vaudoise, qui a coûté la vie à vingt-quatre chevaux et poneys. Un drame possiblement révélateur de divers aspects de la folie ordinaire…



 Sur le travail
Sur le travail
 Or écrivant « en ce moment précis » je me rappelle alors la première phrase des carnets de mon cher
Or écrivant « en ce moment précis » je me rappelle alors la première phrase des carnets de mon cher  Les Nuits difficiles
Les Nuits difficiles