
Rhapsodies panoptique (22)
Pour Françoise Berclaz
…Là ce que je vais te raconter dans la neige de ce matin, l’Kid, toi qui vois ce que je vois sur l’autre versant de notre val, donc aussi blanc de neige qu’une page vierge et que ce que nous voyons à la fenêtre, avec Lady L., depuis que la neige a recommencé de neiger – ce que je vais te raconter finira dans les larmes ou peu s’en faut, et pas à cause de l’horreur du monde mais à cause de ses beautés puisque je vais te balancer, en seconde main, la plus belle histoire d’amour du monde…
…Tout à l’heure on était encore, avec Lady L, les deux au pieu comme dans une case ou une yourte, elle plutôt case congolaise en train de lire un article affreux sur les damnés de la terre du Nord-Kivu condamnés à gratter des éclats de cassitérite pour survivre et souder nos circuits imprimés, moi plutôt yourte en me pointant au seuil des steppes fleurant le pollen de l’absinthe sauvage où allait se dérouler la plus belle histoire d’amour du monde - tous les deux par conséquent sur le tapis volant des mots alors que l’Taulard, revenu de Paris comme je te l’ai dit, s’emmitouflait pour aller déneiger ce qu’il n’en finissait pas de neiger tant et plus sur ces hauteurs, genre Sisyphe de fin d’année…
…C’est dame Berclaz, tu sais, la fille libraire du vieux Zermatten que tu n’as pas connu en son règne controversé de romancier-colonel conservateur mal vu de nos élites littéraires ; dame Françoise la tenancière de la fameuse bouquinerie La Liseuse, au cœur de Sion la bien-nommée (ô peuple de Sion, ô fille aînée de la catholicité valaisanne, ô sainte Corinna et saint Chappaz, ce genre de couplets…), Françoise Berclaz-Zermatten donc, pour la nommer en toutes lettres et honneur, qui m’a fait cadeau, l’autre jour que je passais par là-bas - et juste après que je lui eus dit merveille de l’opuscule de Quentin qui venait de lâcher son bagou à la radio -, de ce petit Folio guère plus feuillu intitulé Djamilia sous couverture polychrome représentant une espèce d’Asiate à longs cheveux et créoles d’or aux oreilles, robe violette et pleine d’entrain à ce qu’il semblait sur fond de steppe verte et de nuages de bel été – et la dame bouquinière de préciser que c’était la plus belle histoire d’amour du monde qu’oncques il lui avait été bâillé depuis le temps de l’Amour courtois et même avant, non sans préciser qu’Aragon avant elle l’avait claironné…
…Or moi Louis Aragon, Kiddy, tu te doutes que je n’vote pas les yeux fermés pour tous les dits et écrits de sa firme, genre La Femme est l’Avenir de l’Homme et autres simagrées. Mais l’Aragon n’est pas que vidure de démagogie, il y a pire : l’Aragon est aussi la salope rusée de l’idiotie utile stalinienne ; l’Aragon a été l’cafteur autant que Céline le tout mariole a été le provocateur pousse-au-crime. Cependant, minute papillon ! l’Aragon Louis fut aussi Rossignol que son pair Ferdine, et la sœur de Marat, qui disait qu’un peu de sable suffit à effacer les turpitudes humaines des uns et des autres, l’eût répété après moi ce matin devant la mémoire blanchie de la neige – d’ailleurs la préface d’Aragon au jeune Kirghize Tchinghiz sonne juste et vrai, c’est d’un homme de bonne volonté et d’un amoureux que ce coup de cœur, selon l’expression des libraires à la coule et des médias à la masse ; bref j’ai commencé de lire Djamilia et là j’ai ramené mes voiles noires et brûlé mes vaisseaux, comme on dit : je me suis bientôt retrouvé dans les eaux profondes du Sentiment à l’état pur et de la Nature absorbée par tous les pores - oublié le Nord-Kivu le temps de voir se dessiner les figures de Djamilia et de Danïiar sous le crayon pur et sûr de Seït l’adolescent de quinze ans qui raconte cette histoire, laquelle sera double puisque lui aussi, qui se découvre artiste en écoutant le chant bouleversant de Danïiar le secret, vivra son premier amour dans la chaste attention du témoin…
 …Toi qui aimes le nordique plus ou moins sibérien et t’en reviens de la Panonnie, Kiddy, avec ton sens des objets tu kifferais grave, pour parler comme ta tribu, les figures et les objets de Kirghizie : tous les détails captés et réfractés en mots précis par le romancier qu’avait à peu près tes âges quand il a écrit Djamila. Sauf qu’il en savait plus que toi, l’Kid, c’est forcé. Quand son père a été liquidé par un Tyran au nom du peuple et qu’on se retrouve orphelin en Soviétie on apprend un peu forcément, et toute sa vie il apprendra, Tchinghiz Aïtmatov, jusqu’à devenir conseiller ès Perestroïka et mémoire des martyrs du Petit Père des Peuples - mais passons sur la leçon d’histoire parce que là c’est le vent de la steppe qui souffle à pleins poumons en roulant ses chardons, c’est le souffle de la terre et les chevaux fous de la passion longtemps « rentrée »…
…Toi qui aimes le nordique plus ou moins sibérien et t’en reviens de la Panonnie, Kiddy, avec ton sens des objets tu kifferais grave, pour parler comme ta tribu, les figures et les objets de Kirghizie : tous les détails captés et réfractés en mots précis par le romancier qu’avait à peu près tes âges quand il a écrit Djamila. Sauf qu’il en savait plus que toi, l’Kid, c’est forcé. Quand son père a été liquidé par un Tyran au nom du peuple et qu’on se retrouve orphelin en Soviétie on apprend un peu forcément, et toute sa vie il apprendra, Tchinghiz Aïtmatov, jusqu’à devenir conseiller ès Perestroïka et mémoire des martyrs du Petit Père des Peuples - mais passons sur la leçon d’histoire parce que là c’est le vent de la steppe qui souffle à pleins poumons en roulant ses chardons, c’est le souffle de la terre et les chevaux fous de la passion longtemps « rentrée »…
…Plus encore c’est l’histoire de Passage du poète de Ramuz que cette plus belle histoire d’amour du monde, en plus sauvage et en plus terrible puisque la guerre y a sa part, la guerre et les nations, la guerre et les ethnies du bout du monde et leurs prières variées. Mais j’vais pas te priver des surprises du scénar, le Kid. Juste deux ou trois bouts de synopsis pour t’allécher. Donc ce type qui passe, cet orphelin comme le jeune auteur revenu des errances et de la guerre d’où il ramène une patte folle dans ce bled du fin fond des steppes où roule une rivière torrentueuse du nom de Kourkouréou qu’il aime écouter mugir le soir dans le noir. Aussi le type, taiseux, aime se percher sur une hauteur appelée la « butte de sentinelle », et sa façon de rester fermer ne plaît guère mais intrigue, à la longue, le jeune Seït qui raconte et s’enhardit à l’interroger sur son passé. Or le rêveur solitaire ne se livrera que du regard à l’apparition de Djamilia l’indomptable, la grâce et la force incarnée, qui le repousse et le moque avant de le mettre au défi en l’humiliant, dans un jeu qui tout coup se retourne contre elle – et Danïiar de se révéler pour ce qu’il est : à savoir l’amoureux de cette femme, certes, mais dont le sentiment irradie le monde entier par le truchement du chant le plus pur et le plus mélancolique qui soit, et voilà ce que ça donne par écrit, Kiddy : « C’était un homme profondément amoureux. Mais amoureux, il l’était, je le sentais bien, pas seulement d’un autre être humaine : il s’agissait là de je ne sais quel amour tout autre, d’un énorme amour de la vie, de la terre. Oui, il cachait en lui cet amour, sa musique, il en vivait. Un homme indifférent n’eût pas pu chanter ainsi, quelle que fût la voir qu’il possédait ». Et c’est, après le chant de Djamilia qui « cherchait » Danïiar pour se faire pardonner son offense, par le chant de celui-ci qu’elle s’éprend de lui jusqu’à renier son mari aux armées qu’il a épousée pour en faire sa servante et qui se fera fort de remplacer Djamilia après la fuite de celle-ci : « Elle est partie, grand bien lui fasse ! Elle crèvera quelque part. De notre vivant. Nous ne manquerons pas de femmes. Même une femme à cheveux d’or ne vaut pas le dernier des bons à rien »…
… Or ce qu’il y a de si beau là-dedans, Kiddy, c’est que l’Kirghize ne dore pas la pilule. Dans la case jouxtant ma yourte purifiée à la fumée de genévrier, j’entendais Lady L. soupirer, tout à l’heure, en découvrant le destin d’enfer que subissent les damnés mineurs de fond du Nord-Kivu se ruinant la santé pour un dollar par jour, et j’me rappelai les lointains infinis du goulag de naguère et des camps de la misère actuelle de partout, mais partout la chanson de Danïiar ressuscite de loin en loin, à l’instant je me rappelle le prologue des Chroniques tchadiennes de Nétonon Noël, au bord du fleuve Logone, et ce pourrait être le Kourkouréou de Kirghizie : « Ces instants de communion privilégiée avec la nature, ces heures magiques bercées par la paisible rumeur des vagues, le murmure insouciant de la brise dans les buissons et le ramage incertain des rouge-gorge tenaient une place à part dans ses souvenirs :il pouvait y entrée, grand blessé de la vie ; il en ressortirait toujours, pansée en ses plaies les plus intimes »…
… On voit ainsi s’en aller ces deux-là, l’Kid, on pourrait dire que leur histoire finit bien alors qu’elle commence à peine, sur cette terre inhumaine que les hommes ont façonnée à l’image de ce qu’il y a de pire en eux, et ce n’est pas de l’amour à bon marché que celui de Djamilia et de Danïiar, on n’est pas ici dans les romances frelatées à la Marc Levy qui saturent nos marchés de dupes, on est dans le meilleur de l’homme que réfracte la poésie et ça finit comme ça, Kiddy, y a qu’à recopier et, même si mes yeux se brouillent un peu, je recopie ces mots du Kirghiz et te les transmets dans la pleine conscience que la cassitérite y est pour quelques chose : « Où êtes-vous aujourd’hui, sur quelles routes marchez-vous ? Il y a maintenant beaucoup de chemins nouveaux chez nous dans la steppe, par tout le Kazakhstan jusqu’à l’Altaï et la Sibérie ! Beaucoup de gens audacieux travaillent là-bas. Peut-être, vous aussi, êtes vous allés dans ces pays ? Tu es partie, ma Djamilia, par la large steppe, sans regarder en arrière. Peut-être es-tu lasse, peut-être as-tu perdu la foi en toi ? Appuie-toi à Danïiar. Qu’il te chante sa chanson sur l’amour, la terre, la vie ! Que la steppe se mette à bouger et à jouer de toutes ses couleurs ! Que tu te souviennes de cette nuit d'août ! Va, Djamilia, ne te repens point, tu as trouvé ton difficile bonheur ».
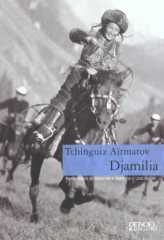 Tchinghiz Aïtmatov. Djamilia. Traduit du kirghiz par A. Dimitrieva et Louis Aragon. Préface de Louis Aragon. Denoël/Folio, 124p.
Tchinghiz Aïtmatov. Djamilia. Traduit du kirghiz par A. Dimitrieva et Louis Aragon. Préface de Louis Aragon. Denoël/Folio, 124p.
 De seize à vingt ans ils ont tous rêvé d’Amérique mais seuls quelques-uns sont partis, et, maintenant que le temps a passé, ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus voient le pays autrement du fait que ceux qui sont revenus parlent de ce qu’ils ont vu là-bas et du pays dont ils se sont langui avant de le retrouver, et le pays est embelli d’avoir été quitté parce que le pays est vu d’Amérique, un garçon tendre encore voit l’homme dur qu’il admire en secret lui dire que les femmes de là-bas ne valent pas celles de la montagne ici quand le printemps fait bander les gars, et celui qui est revenu pose sa main sur l’épaule du plus jeune et lui murmure que nul pays n’est plus beau que les Langhe les soirs d’été, mais ce qu’il raconte est aussi fait pour chasser le plus jeune de l’ennui de ces collines, fous le camp mon garçon, ne reste pas, réponds à l’appel de la rue, ne reste pas seul avec les vieux, va tenter ta chance, va vivre ta vie…
De seize à vingt ans ils ont tous rêvé d’Amérique mais seuls quelques-uns sont partis, et, maintenant que le temps a passé, ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus voient le pays autrement du fait que ceux qui sont revenus parlent de ce qu’ils ont vu là-bas et du pays dont ils se sont langui avant de le retrouver, et le pays est embelli d’avoir été quitté parce que le pays est vu d’Amérique, un garçon tendre encore voit l’homme dur qu’il admire en secret lui dire que les femmes de là-bas ne valent pas celles de la montagne ici quand le printemps fait bander les gars, et celui qui est revenu pose sa main sur l’épaule du plus jeune et lui murmure que nul pays n’est plus beau que les Langhe les soirs d’été, mais ce qu’il raconte est aussi fait pour chasser le plus jeune de l’ennui de ces collines, fous le camp mon garçon, ne reste pas, réponds à l’appel de la rue, ne reste pas seul avec les vieux, va tenter ta chance, va vivre ta vie…







 Aux dernières nouvelles, j’ai constaté qu’Alina Reyes avait fermé son site, après avoir fermé son blog depuis un certain temps déjà. A-t-elle eu raison ? Sans doute, en ce qui la concerne, et son livre l’illustre évidemment. Mais a-t-elle raison de réduire ceux qui pratiquent la blogosphère à des rats morts ? Je ne le crois pas. D’ailleurs les accents qui se veulent prophétiques, dans le genre catastrophiste, de Forêt profonde, sont à mes yeux la partie la plus faible du livre, et qui vieillira vite n’était-ce que par ses lourdeurs d’écriture, alors que le souffle de l’Eros, le souffle de la vie et le souffle de l’amour en traversent mainte pages superbes et qu’on relira demain.
Aux dernières nouvelles, j’ai constaté qu’Alina Reyes avait fermé son site, après avoir fermé son blog depuis un certain temps déjà. A-t-elle eu raison ? Sans doute, en ce qui la concerne, et son livre l’illustre évidemment. Mais a-t-elle raison de réduire ceux qui pratiquent la blogosphère à des rats morts ? Je ne le crois pas. D’ailleurs les accents qui se veulent prophétiques, dans le genre catastrophiste, de Forêt profonde, sont à mes yeux la partie la plus faible du livre, et qui vieillira vite n’était-ce que par ses lourdeurs d’écriture, alors que le souffle de l’Eros, le souffle de la vie et le souffle de l’amour en traversent mainte pages superbes et qu’on relira demain.
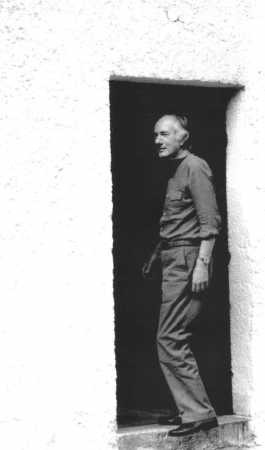

 - Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?
- Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?





 Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…
Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…
 Un paresseux fécond
Un paresseux fécond

 Robert Walser avant-gardiste? Pas du tout au sens d'un chef d'école ou d'un concepteur de manifestes. Et pourtant, qui aura mieux que lui subverti tous les clichés et nettoyé, à sa façon, la langue en la «travaillant» au creux de ses arcanes auriculaires - Peter Utz dégageant mieux que personne son talent d'«écouteur» du bruit du temps.
Robert Walser avant-gardiste? Pas du tout au sens d'un chef d'école ou d'un concepteur de manifestes. Et pourtant, qui aura mieux que lui subverti tous les clichés et nettoyé, à sa façon, la langue en la «travaillant» au creux de ses arcanes auriculaires - Peter Utz dégageant mieux que personne son talent d'«écouteur» du bruit du temps.

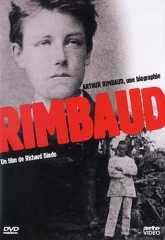





 Après avoir signé La déconfite gigantale du sérieux, entre dix autres titres, Arno Bertina, 37 ans, consacre un peu moins de 500 pages « gigantalement » ludiques, voire délirantes, à celui qu’on a qualifié tantôt de « génie » et d’« extraterrestre », conjuguant « grâce absolue et « magie ». Or ce délire n’est en rien une « déconfite » du vrai sérieux. Pas seulement parce que l’auteur, qui semble tout connaître des moindres « coups » du Maître, parle merveilleusement du tennis, mais parce que son roman va bien au-delà de la célébration sportive ou de la curiosité pipole : du côté de l’humain, du dépassement de soi et des retombées de la réussite, ou de l’échec que le seul terme de « mononucléose » suffirait à évoquer, etre autres envolées philosophiques, artistico-physiologiques ou éthylo-poétiques.
Après avoir signé La déconfite gigantale du sérieux, entre dix autres titres, Arno Bertina, 37 ans, consacre un peu moins de 500 pages « gigantalement » ludiques, voire délirantes, à celui qu’on a qualifié tantôt de « génie » et d’« extraterrestre », conjuguant « grâce absolue et « magie ». Or ce délire n’est en rien une « déconfite » du vrai sérieux. Pas seulement parce que l’auteur, qui semble tout connaître des moindres « coups » du Maître, parle merveilleusement du tennis, mais parce que son roman va bien au-delà de la célébration sportive ou de la curiosité pipole : du côté de l’humain, du dépassement de soi et des retombées de la réussite, ou de l’échec que le seul terme de « mononucléose » suffirait à évoquer, etre autres envolées philosophiques, artistico-physiologiques ou éthylo-poétiques. 


 …L’idée que le geste de faire pût se faire à deux n’avait pas effleuré, cela va sans dire, la pensée créatrice de Basil pour lequel Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure ou Cervantès et sa flopée de personnage ne travaillent pas dans le même rayon - chacun son job. Mais Jula n’est pas moins essentielle que le surnommé Nuage dans la story genre épopée urbaine dont on ne voit pas trop où elle conduira si ce n’est qu’elle m’est un prétexte comme un autre de revoir Basil au café des Abattoirs ou au Buffet de la Gare sous le Cervin mandarine, selon les jours ; et c’est là que nous parlons et reparlons de cette idée éventée visant à l’évacuation de la notion d’Auteur, comme on a renvoyé les personnages de romans aux vestiaires et la notion même de story, avant de replonger dans les avatars de téléfilms et de romans-feuilletons. Tout ça, Tonio, on se l’est dit et répété, pour soulager la vanité chiffonnée des auteurs sans entrailles et des cuistres facultards. Tout ça complètement obsolète et à réviser à l’acéré. Vieilles nippes pseudo-modernistes. Après Bourdieu les bourdieusards et c’est de la même paroisse aigre que celle des bigotes de l’Abbé Brel. Je n’en ferai pas, le Kid, une théorie de plus, mais la notion d’Auteur est une aussi belle fiction que la fiction des personnages se pressant dans sa salle d’attente pour le casting. Tu connais ma vanité totale, Kiddy, qui serait de ne plus signer aucun texte. On y reviendra à l’orgueil suprême du griot homérique parlant comme personne et pour tout le monde – ce qu’attendant tu me cites trois lignes du petit Marcel, trois de l’affreux Ferdine, trois autres de l’ourse noire ou de sainte Flannery et je te signe le certificat d’identification, nulle difficulté en cela, n’est-ce pas, mais pour prouver quoi ? Or ce que j’aime dans votre volée de freluquets est votre dédain croissant des références et des étiquettes, qui vous campe plus nus devant la Chose, plus désarmés peut-être mais peut-être plus vrais, parfois, j’sais pas, y m'semble, je crois…
…L’idée que le geste de faire pût se faire à deux n’avait pas effleuré, cela va sans dire, la pensée créatrice de Basil pour lequel Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure ou Cervantès et sa flopée de personnage ne travaillent pas dans le même rayon - chacun son job. Mais Jula n’est pas moins essentielle que le surnommé Nuage dans la story genre épopée urbaine dont on ne voit pas trop où elle conduira si ce n’est qu’elle m’est un prétexte comme un autre de revoir Basil au café des Abattoirs ou au Buffet de la Gare sous le Cervin mandarine, selon les jours ; et c’est là que nous parlons et reparlons de cette idée éventée visant à l’évacuation de la notion d’Auteur, comme on a renvoyé les personnages de romans aux vestiaires et la notion même de story, avant de replonger dans les avatars de téléfilms et de romans-feuilletons. Tout ça, Tonio, on se l’est dit et répété, pour soulager la vanité chiffonnée des auteurs sans entrailles et des cuistres facultards. Tout ça complètement obsolète et à réviser à l’acéré. Vieilles nippes pseudo-modernistes. Après Bourdieu les bourdieusards et c’est de la même paroisse aigre que celle des bigotes de l’Abbé Brel. Je n’en ferai pas, le Kid, une théorie de plus, mais la notion d’Auteur est une aussi belle fiction que la fiction des personnages se pressant dans sa salle d’attente pour le casting. Tu connais ma vanité totale, Kiddy, qui serait de ne plus signer aucun texte. On y reviendra à l’orgueil suprême du griot homérique parlant comme personne et pour tout le monde – ce qu’attendant tu me cites trois lignes du petit Marcel, trois de l’affreux Ferdine, trois autres de l’ourse noire ou de sainte Flannery et je te signe le certificat d’identification, nulle difficulté en cela, n’est-ce pas, mais pour prouver quoi ? Or ce que j’aime dans votre volée de freluquets est votre dédain croissant des références et des étiquettes, qui vous campe plus nus devant la Chose, plus désarmés peut-être mais peut-être plus vrais, parfois, j’sais pas, y m'semble, je crois…  …Entretemps, après Vanda, j’avais aussi découvert Trona. Un youngster à l’air rilax m’avait fait ce cadeau de me révéler Trona dans son premier roman, après Le cul de Judas du bel Antonio. Les musiciens servent à ça aussi : à te fiche le blues avec un Andante dont tu ne te rappelles plus le nom de l’auteur sauf que tu sens qu’il a vu un peu plus de pays que les autres, celui-là. J’te passe quand tu veux la mort de Didon de Purcell, compère Quentin, ou je te fredonne la Sonate posthume de Schubert ou n’importe quel blues de Lightnin’Hopkins. Et voir la vérité de Trona, autant qu’exprimer l’atroce vérité de Vanda titubant entre seringues et cageots dans le labyrinthe à l’infernal tintamarre, se replonger en Angola guerrier dans la foulée de Lobo Antunes puis suivre ce Don Juan carabiné - le meilleur coup de Benfica selon les femelles de là-bas -, dans les cercles infernaux des malades de Monsieur le psychiatre frotté de lettres, fraternel autant qu’un Carver ou qu’un Tchekhov; et revenir alors à l’inoubliable dépotoir de la Salle 6 de ce dernier – tout ça va nous exonérer, comme après une virée aux pays de Flannery ou de l’affreuse Patty, des salamalecs devant le Génie de l’Auteur ou des arguties méticuleuses visant à nous prouver que rien ne tient que la textualité du texte en son contexte textuel – tout cela ne découlant finalement que de la même chronique immensément amère et tonique, car tout se mêle, que tous ils se mêlent et s’entremêlent à renfort de vocables dans le flux des proses, et l’homme n’en finit pas de tomber…
…Entretemps, après Vanda, j’avais aussi découvert Trona. Un youngster à l’air rilax m’avait fait ce cadeau de me révéler Trona dans son premier roman, après Le cul de Judas du bel Antonio. Les musiciens servent à ça aussi : à te fiche le blues avec un Andante dont tu ne te rappelles plus le nom de l’auteur sauf que tu sens qu’il a vu un peu plus de pays que les autres, celui-là. J’te passe quand tu veux la mort de Didon de Purcell, compère Quentin, ou je te fredonne la Sonate posthume de Schubert ou n’importe quel blues de Lightnin’Hopkins. Et voir la vérité de Trona, autant qu’exprimer l’atroce vérité de Vanda titubant entre seringues et cageots dans le labyrinthe à l’infernal tintamarre, se replonger en Angola guerrier dans la foulée de Lobo Antunes puis suivre ce Don Juan carabiné - le meilleur coup de Benfica selon les femelles de là-bas -, dans les cercles infernaux des malades de Monsieur le psychiatre frotté de lettres, fraternel autant qu’un Carver ou qu’un Tchekhov; et revenir alors à l’inoubliable dépotoir de la Salle 6 de ce dernier – tout ça va nous exonérer, comme après une virée aux pays de Flannery ou de l’affreuse Patty, des salamalecs devant le Génie de l’Auteur ou des arguties méticuleuses visant à nous prouver que rien ne tient que la textualité du texte en son contexte textuel – tout cela ne découlant finalement que de la même chronique immensément amère et tonique, car tout se mêle, que tous ils se mêlent et s’entremêlent à renfort de vocables dans le flux des proses, et l’homme n’en finit pas de tomber…
 Celle qui préfère ceux qui de presque rien font de petits quelque chose / Ceux qui s’approchent à tâtons de la source de lumière légèrement réchauffante / Celui qui évite les bavards sectaires / Celle qui ne sait rien que par la peau / Ceux qui se parlent à demi-mots et à double-sens / Celui que les explications claires dépriment toujours un peu / Celle qui ne se fie qu’aux ardents / Ceux qui ont tout refroidi / Celui qui endure la méchanceté des lascars / Celle qui devine le pourquoi de la méchanceté des lascars à l’endroit des infirmes / Ceux qui se paient sur l’innocence des candides / Celui qui efface ses traces afin d’être mieux suivi /
Celle qui préfère ceux qui de presque rien font de petits quelque chose / Ceux qui s’approchent à tâtons de la source de lumière légèrement réchauffante / Celui qui évite les bavards sectaires / Celle qui ne sait rien que par la peau / Ceux qui se parlent à demi-mots et à double-sens / Celui que les explications claires dépriment toujours un peu / Celle qui ne se fie qu’aux ardents / Ceux qui ont tout refroidi / Celui qui endure la méchanceté des lascars / Celle qui devine le pourquoi de la méchanceté des lascars à l’endroit des infirmes / Ceux qui se paient sur l’innocence des candides / Celui qui efface ses traces afin d’être mieux suivi /  Celle qui se désole de voir tant de garçons renoncer à la Conquête / Ceux qui ont fait le tour de la Question et ne feront donc plus que se la poser / Celui qui s’en met une pour en finir avec cette année soûlante / Celle qui écoute ce qui parle en elle dans une langue qu’elle apprend à mesure / Ceux qui se racontent l’histoire de la rousse qui a jeté son enfant au dévaloir et qu’on a retrouvé vivant et qui a fait une jolie carrière de trader alors qu’elle en chie dans la banlieue de Lisbonne / Celui qu’une malédiction semble poursuivre mais ce n’est qu’une impression / Celle qui voit son taudis fracassé par les promoteurs qui ne respectent rien / Ceux qui se trouvaient bien dans l’immeuble pourri aux squatters amateurs de slam / Celui qui chantonne au milieu des gravats / Celle qui répand de la joie sans le savoir ni le vouloir encore moins / Ceux qui se contentent de ce qu’ils ont sans la moindre envie sauf la secousse qu’on sait ou une tuée le samedi / Celui qui a une tempête dans la tête qu’il affronte avec la détermination de Prospéro sublimant la rage de Caliban et déployant la grâce d’Ariel et de Miranda / Celle qui calme les éléments en élevant simplement la voix juste ce qu’il faut / Ceux qui s’opiniâtrent à l’Ouvroir, etc.
Celle qui se désole de voir tant de garçons renoncer à la Conquête / Ceux qui ont fait le tour de la Question et ne feront donc plus que se la poser / Celui qui s’en met une pour en finir avec cette année soûlante / Celle qui écoute ce qui parle en elle dans une langue qu’elle apprend à mesure / Ceux qui se racontent l’histoire de la rousse qui a jeté son enfant au dévaloir et qu’on a retrouvé vivant et qui a fait une jolie carrière de trader alors qu’elle en chie dans la banlieue de Lisbonne / Celui qu’une malédiction semble poursuivre mais ce n’est qu’une impression / Celle qui voit son taudis fracassé par les promoteurs qui ne respectent rien / Ceux qui se trouvaient bien dans l’immeuble pourri aux squatters amateurs de slam / Celui qui chantonne au milieu des gravats / Celle qui répand de la joie sans le savoir ni le vouloir encore moins / Ceux qui se contentent de ce qu’ils ont sans la moindre envie sauf la secousse qu’on sait ou une tuée le samedi / Celui qui a une tempête dans la tête qu’il affronte avec la détermination de Prospéro sublimant la rage de Caliban et déployant la grâce d’Ariel et de Miranda / Celle qui calme les éléments en élevant simplement la voix juste ce qu’il faut / Ceux qui s’opiniâtrent à l’Ouvroir, etc.

 …Toi qui aimes le nordique plus ou moins sibérien et t’en reviens de la Panonnie, Kiddy, avec ton sens des objets tu kifferais grave, pour parler comme ta tribu, les figures et les objets de Kirghizie : tous les détails captés et réfractés en mots précis par le romancier qu’avait à peu près tes âges quand il a écrit Djamila. Sauf qu’il en savait plus que toi, l’Kid, c’est forcé. Quand son père a été liquidé par un Tyran au nom du peuple et qu’on se retrouve orphelin en Soviétie on apprend un peu forcément, et toute sa vie il apprendra, Tchinghiz Aïtmatov, jusqu’à devenir conseiller ès Perestroïka et mémoire des martyrs du Petit Père des Peuples - mais passons sur la leçon d’histoire parce que là c’est le vent de la steppe qui souffle à pleins poumons en roulant ses chardons, c’est le souffle de la terre et les chevaux fous de la passion longtemps « rentrée »…
…Toi qui aimes le nordique plus ou moins sibérien et t’en reviens de la Panonnie, Kiddy, avec ton sens des objets tu kifferais grave, pour parler comme ta tribu, les figures et les objets de Kirghizie : tous les détails captés et réfractés en mots précis par le romancier qu’avait à peu près tes âges quand il a écrit Djamila. Sauf qu’il en savait plus que toi, l’Kid, c’est forcé. Quand son père a été liquidé par un Tyran au nom du peuple et qu’on se retrouve orphelin en Soviétie on apprend un peu forcément, et toute sa vie il apprendra, Tchinghiz Aïtmatov, jusqu’à devenir conseiller ès Perestroïka et mémoire des martyrs du Petit Père des Peuples - mais passons sur la leçon d’histoire parce que là c’est le vent de la steppe qui souffle à pleins poumons en roulant ses chardons, c’est le souffle de la terre et les chevaux fous de la passion longtemps « rentrée »…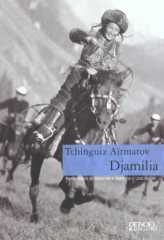 Tchinghiz Aïtmatov. Djamilia. Traduit du kirghiz par A. Dimitrieva et Louis Aragon. Préface de Louis Aragon. Denoël/Folio, 124p.
Tchinghiz Aïtmatov. Djamilia. Traduit du kirghiz par A. Dimitrieva et Louis Aragon. Préface de Louis Aragon. Denoël/Folio, 124p.