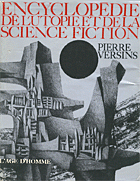La Science Fiction, ou l’homme en éternel projet. En mémoire de Pierre versins (1923-2001).
La Science Fiction, ou l’homme en éternel projet. En mémoire de Pierre versins (1923-2001).
En automne 1972 parut, à Lausanne, aux éditions L’Age d’Homme, un ouvrage monumental portant le titre d’Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction, signé Pierre Versins. Sans être familier de la SF, il s’est trouvé que je participe aux finitions du « monstre » durant les quelques derniers mois, fébriles, de sa composition. J’en avais témoigné sur une pleine page de La Tribune de Lausanne à laquelle je collaborais à l’époque, que je recopie ici à l’attention de François Boetschi, spécialiste de SF en train de préparer, pour les archives de la Maison d'Ailleurs, un film sur l’auteur de cette somme et, accessoirement, de la nouvelle la plus courte jamais écrite dans le genre : « Il venait de Céphée, il s’appelait Dupont »…
 Extraordinaire. Tel est le mot qui vous vient à l’esprit lorsque, ignorant ce qui vous attend, vous débarquez devant la maison de Rovray où habite Pierre Versins. Extraordinaire, d’abord, le décor : dominant les toits du village, les prés et les forêts, c’est, sauf le respect dû à l’anarchiste que prétend être le maître de céans, le lieu d’une paix royale, d’un calme quasi monacal. Ici, le jour se lève quand il lui semble bon, les vaches broutent, les innocentes, et l’on admire un paysage apparemment intouché : le décor même des romans de science fiction à venir, genre contre-utopie bucolique…
Extraordinaire. Tel est le mot qui vous vient à l’esprit lorsque, ignorant ce qui vous attend, vous débarquez devant la maison de Rovray où habite Pierre Versins. Extraordinaire, d’abord, le décor : dominant les toits du village, les prés et les forêts, c’est, sauf le respect dû à l’anarchiste que prétend être le maître de céans, le lieu d’une paix royale, d’un calme quasi monacal. Ici, le jour se lève quand il lui semble bon, les vaches broutent, les innocentes, et l’on admire un paysage apparemment intouché : le décor même des romans de science fiction à venir, genre contre-utopie bucolique…
Extraordinaire, aussi, ce qui se passe à l’intérieur. Car à l’abri des murs de l’ancienne ferme quelque chose se passe, et ce malgré l’indifférence superbe du matou tricolore qui vous toise à l’entre : Versins est en effet à l’œuvre. Il marmonne, il griffonne, il sautille d’un rayon de bibliothèque à l’autre, il attrape un dictionnaire au passage, puis il revient à son fichier titanesque dans lequel il plonge une longue, frémissante aiguille ; ayant pêché ainsi quelque renseignement, il aligne des kilomètres de fiches, annote, corrige des épreuves arrivée le matin par la poste, lit et écrit tout à la fois. Bref, à l’abri des murailles de livres – environ 60.000, des vieilles éditions qui feraient pâlir plus d‘un bibliophile aux collections de bandes dessinées ou de « pulps », il achève la rédaction de « son » encyclopédie.
C’est l’agitation quotidienne du bocal aux idées d’où vont sortir tantôt les plus savantes synthèses et tantôt les jeux de mots les plus désastreux. Cela dure depuis quatre ans, mais le travail initial, els recherches, la lecture, la réflexion et le projet, Versins les poursuit depuis plus de vingt ans. Il vous dit que c’est une passion d’enfance, et vous le croyez, car il ya dans l’enthousiasme avec lequel il vous parle de « son » sujet quelque chose appartenant à l’enfance. Ce quelque chose, d’ailleurs, est un doux mélange que sa raison lui a permis de traiter à sa façon. Pour le saisir, il faut l’entendre raconter, par le menu, toute sa vie ; qu’il dise son enfance provençale, précisément (son vrai nom est Chamson, petit cousin de l’écrivain André Chamson), sa jeunesse, la guerre et la Résistance, la déportation, enfin les épreuves de toute sorte. Pourquoi cela ? En quoi cela peut-il intéresser le lecteur d’un livre aussi « neutre » qu’une encyclopédie ?
Précisément pour ce que Versins y a mis de lui-même. Comme Pierre Larousse, premier du nom – l’un de ses maîtres -, et dans un style qu’il dit lui-même influence par le pamphlétaire Paul-Louis Courier, il rédige une encyclopédie sans doute fondée sur un savoir immense, mais il fait également œuvre polémique. Un pamphlet de mille pages. Un pamphlet dont le thème central est l’utopie, à savoir ce pays de l’impossible infiniment désirable, où l’homme n’arrivera jamais tout en y allant d’un pas décidé – un pamphlet contre tout ce qui empêche l’homme d’y arriver justement et pour tout ce qui l’agrandirait plus que nature.
Mais entrons dans le vif du sujet. Voyez plutôt le beau projet : L’Homme qui peut tout…
Oui, voilà ce dont il va s’agir en ce voyage fabuleux de l’Antiquité à nos jours et de ceux-ci à l’avenir et jusque dans la quatrième dimension, au fond des intestins grêles de notre globe, sur Venus ou dans les micromondes. Tout un programme, comme on voit, et qui élargit considérablement l’idée qu’on pouvait se faire jusque-là de la science fiction.
Soucoupes volantes, Monsieur Versins ? Connais pas. Extraterrestres ? Probabilité statistique… mais référez-vous à mon article ! Et commence alors la lecture en zigzags. On part donc d’ « extraterrestres », on tombe sur les noms plus ou moins connus de Lucien de Samosate, de Wells, de Cyrano de Bergerac, de Jean de la Hire, on y va voir avent de tomber sur le thème « fin du monde », les idées se catapultent, on note les titres de romans que l’auteur, les résumant, a donné envie de lire aussi, et voici Barjavel après Bande dessinées, Batman après Jacques Bergier qui a droit au passage à son coup de griffe…
À propos d’ « utopie », enfin, faites donc le crochet par l’article qui s’y rapporte car c’est alors qu’on peut le mieux, je crois, évaluer le projet de l’auteur ; là aussi qu’on peut en apprécier soudain la valeur intellectuelle entre tant de cabrioles ludiques !
Tels sont en effet Pierre Versins et son Encyclopédie, qui mêlent à tout coup l’accidentel et le permanent, le rire et le tragique, ou le doute et toutes les croyances.
Or cette symbiose étrange, il fallait un écrivain du genre de Pierre Versins, « fou littéraire » à sa façon dont la référence impavide à la «conjecture rationnelle » relève évidemment de l’utopie…

La science fiction selon Pierre Versins
«La science fiction est un univers plus grand que l’univers connu. Elle dépasse, elle déborde, elle n’a pas de limites, elle est sans cesse au-delà d’elle-même, elle se nie en affirmant, elle expose, pose et préfigure, elle extrapole. Elle invente ce qui a peut-être été, ce qui est sans que nul ne le sache, et ce qui sera ou pourrait être. Et, ce faisant, elle découvre. Elle est le plus extraordinaire défoulement que l’on puisse rêver et le meilleur tremplin pour aboutir, sans ouvrir des yeux trop ébaubis, à l’humanité qui viendra. Elle est avertissement et prévision, sombre et éclairante. Elle est le rêve d’une réalité autre et la réalisation des rêves les plus fous, donc les plus probables. Elle est aussi sublime et abjecte que l’homme, elle est l’homme en éternel projet, elle est l’homme inquiet, chercheur, fouineur, insatiable. Qui veut tout et qui l’aura, moins epsilon. Elle est l’homme dans tout ce qu’il a d’instable, de mal défini, de vivant et grommelant sur les chemins tortueux de l’éternité. Et l’épopée de notre espèce indissociable de sa quête. L’absolu… »
(Extrait de l’introduction à l’Encyclopédie de Pierre Versins)
Pierre Versins (1923-2001) par lui-même
Je suis né en 1923 et mourrai centenaire. Je suis un polygraphe français spécialisé dans le recherche et l'étude de ce qui constitue cette Encyclopédie.J’ai par ailleurs écrit des romans et des nouvelles (Les étoiles ne s’en foutent pas, 1954 : Le professeur, 1956 ; La ville du ciel, 1955 ; L’enfant né pour l’espace, 1964), ce qui a fait dire à un lecteur de la revue Fiction que je savais tout sur la science fiction sauf en écrire…
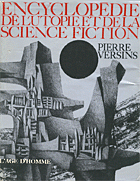



 Je dis occulte car je ne connais Bona que par nos mots et sa peinture, puisque Bona est peintre aussi, et pourtant, après ce nouvel écrit en partage d’une incantation poétique à la vie à la mort, je me sens plus proche de Bona que de beaucoup de gens de mon entourage, comme d’un frère d’esprit et de cœur qui finirait mes phrases et dont je devinerais la fin des siennes.
Je dis occulte car je ne connais Bona que par nos mots et sa peinture, puisque Bona est peintre aussi, et pourtant, après ce nouvel écrit en partage d’une incantation poétique à la vie à la mort, je me sens plus proche de Bona que de beaucoup de gens de mon entourage, comme d’un frère d’esprit et de cœur qui finirait mes phrases et dont je devinerais la fin des siennes. Fusion. – Le miracle de ce livre à la fois bref et très dense tient, je crois, à un mélange à tout moment surprenant de clairvoyance intelligente et de poussées pulsionnelles ou tripales, de pénétration critique pure de tout pédantisme et d’expérience intime de la création, d’un discours qui oscille lui-même entre confession et prône, invective et prière, analyse et effusion, et tout est là en puissance de ce qu’on sait ou qu’on sent du Caravage et de ses œuvres, disons plutôt de Michelangelo Merisi de Caravaggio, dit Le Caravage, en ses œuvres, et tout est là, tout est lié et relié, tout est religieux, tout est filtré par un amour plus fort que la mort dont l’art n’est qu’un résultat, tout sublime qu’il soit, cristal épuré de toute une vie de tourments et de turpitudes, de mouvements désordonnés apparemment mais à travers lesquels court un fil rouge – tout est ressaisi par dedans, puisque c’est lui qui parle, au seuil de ce dernier jour, face à la mer et à la mort, dans un torrent de mots qui résument une vie.
Fusion. – Le miracle de ce livre à la fois bref et très dense tient, je crois, à un mélange à tout moment surprenant de clairvoyance intelligente et de poussées pulsionnelles ou tripales, de pénétration critique pure de tout pédantisme et d’expérience intime de la création, d’un discours qui oscille lui-même entre confession et prône, invective et prière, analyse et effusion, et tout est là en puissance de ce qu’on sait ou qu’on sent du Caravage et de ses œuvres, disons plutôt de Michelangelo Merisi de Caravaggio, dit Le Caravage, en ses œuvres, et tout est là, tout est lié et relié, tout est religieux, tout est filtré par un amour plus fort que la mort dont l’art n’est qu’un résultat, tout sublime qu’il soit, cristal épuré de toute une vie de tourments et de turpitudes, de mouvements désordonnés apparemment mais à travers lesquels court un fil rouge – tout est ressaisi par dedans, puisque c’est lui qui parle, au seuil de ce dernier jour, face à la mer et à la mort, dans un torrent de mots qui résument une vie. Passion. – Je ne sais combien de vies ont été vécues par le compère Bona, ce ne sont pas des choses qui se comptent, mais ce qui est sûr est que c'est comme si ce Congolais aux passions multiples, citant Cendrars comme il évoque Gesualdo ou saint Philippe Neri, poètes et penseurs de partout et de tous les temps, avait tout compris de ce qui compte vraiment. À savoir qu’un grand artiste n’a de comptes à rendre à qui que ce soit n’étaient deux ou trois personnes en une, pour parler chrétien, car c’est en chrétien que nous parle bel et bien ici Le Caravage, si révolté qu’il soit contre les curies et les aigres docteurs de la Loi.
Passion. – Je ne sais combien de vies ont été vécues par le compère Bona, ce ne sont pas des choses qui se comptent, mais ce qui est sûr est que c'est comme si ce Congolais aux passions multiples, citant Cendrars comme il évoque Gesualdo ou saint Philippe Neri, poètes et penseurs de partout et de tous les temps, avait tout compris de ce qui compte vraiment. À savoir qu’un grand artiste n’a de comptes à rendre à qui que ce soit n’étaient deux ou trois personnes en une, pour parler chrétien, car c’est en chrétien que nous parle bel et bien ici Le Caravage, si révolté qu’il soit contre les curies et les aigres docteurs de la Loi. Sa peinture, tissée de ténèbres et de lumière, exprime évidemment les ténèbres et les lumières d’une vie, mais l’intuition baudelairienne de Bona Mangangu lui fait dépasser l’opposition conventionnelle de ténèbres toutes mauvaises dont triompherait la lumière toute bonne, en pétrissant ses ténèbres de lumière et en humanisant celle-ci. La tendresse est un élément, à mi-chemin de l‘amour terrestre et du détachement, qui baigne la parole du Caravage en ce dernier jour, où la mélancolie a sa part aussi, comme la sensualité revisitée sans relents moralisants, alors que le ressouvenir du crime ravive la blessure, au tréfonds de la conscience, d’un acte irréparable.
Sa peinture, tissée de ténèbres et de lumière, exprime évidemment les ténèbres et les lumières d’une vie, mais l’intuition baudelairienne de Bona Mangangu lui fait dépasser l’opposition conventionnelle de ténèbres toutes mauvaises dont triompherait la lumière toute bonne, en pétrissant ses ténèbres de lumière et en humanisant celle-ci. La tendresse est un élément, à mi-chemin de l‘amour terrestre et du détachement, qui baigne la parole du Caravage en ce dernier jour, où la mélancolie a sa part aussi, comme la sensualité revisitée sans relents moralisants, alors que le ressouvenir du crime ravive la blessure, au tréfonds de la conscience, d’un acte irréparable.  Baudelaire rôde dans ces pages, mais aussi Bloy, Barbey, Dante aussi dans la vision claire-obscure et le double recours à l’Elu et à une présence féminine un peu lointaine mais pure, un peu ténue mais d’autant plus présente et apaisante au milieu des beaux garçons fessus que le narcissisme masculin multiplie à l’envi, sans parler des amitiés chastes que le poète chante autant qu'il chante Rome et ses filles de joie.
Baudelaire rôde dans ces pages, mais aussi Bloy, Barbey, Dante aussi dans la vision claire-obscure et le double recours à l’Elu et à une présence féminine un peu lointaine mais pure, un peu ténue mais d’autant plus présente et apaisante au milieu des beaux garçons fessus que le narcissisme masculin multiplie à l’envi, sans parler des amitiés chastes que le poète chante autant qu'il chante Rome et ses filles de joie. Enfin, c’est un livre du recours ultime que ce Dernier jour du Caravage, qui dégage une voix émouvante d’un chaos puissamment évocateur de nos temps actuels.
Enfin, c’est un livre du recours ultime que ce Dernier jour du Caravage, qui dégage une voix émouvante d’un chaos puissamment évocateur de nos temps actuels. 









 Celui qui s’ennuie à la réception de L’Entreprise dont il a la garde la nuit sans même un chien d’attaque / Celle qui lève des haltères pour rester dans le trend / Ceux qui voient l’ambulance s’éloigner avec un serrement de cœur / Celui qui se détache de lui-même et prétend que c’est sans regret mais son air dit le contraire / Celle qui du Minitel a passé à Meetic et Twitter pour en revenir au Muscadet / Ceux qui hantent les ports embrumés de leurs verres de Brandy / Celui qui n’a jamais supporté les angles de la réalité / Celle qui fuit dans les parenthèses de neige / Ceux qui n’ont pas profité des indépendances pour se faire des empires / Celui qui ne peut plus régater faute d’alizés / Celle qu’on oublie dans la zone tampon / Ceux qui estiment que tout est à repenser en termes générationnels sinon comment comprendre ces Y qui se demandent why ? / Celui qui se dit philosophe sociologue et qui fait pas mal non plus les œufs au plat / Celle qui s’est occupé du linge de corps de plusieurs membres connus de l’Ecole de Francfort / Ceux qui voient Norbert péter un plomb à la salle de musculation et ne s’en étonnent point vu son manque de perfos en affaires / Celui qui affirme donner tout Montaigne pour une page de La Boétie et se fait ainsi remarquer des dames du premier rang qui se demandent si cette Boétie avait du bien / Celui qui explique à ses lycéens que Montaigne et Pascal ne boxaient pas dans la même catégorie / Celle qui s’enquiert de ta santé avec la sollicitude de qui cherche à monter en grade / Ceux qui se reconnaissant dans le bain de vapeur s’ignorent aussitôt / Celui qui n’en peut plus de se contenter de si peu même en comptant ses Bonus / Celle qui dispose des petits numéros à côté de chacun des morceaux du suicidé au plastic / Ceux qui s’étonnent de ne plus s’étonner / Celui qui commence à se demander comment en finir / Celle qui s’allonge sur le piano pour que Chopin la pénètre mieux / Ceux qui sourient d’un air entendu quand la vieille Angélique Python leur propose à la disco de leur faire feuille de rose / Celui qui tombe du septième étage du building et se relève en souplesse ce qui révèle un client fit du Club Silhouette / Celle qui se prend pour sa jumelle et ne se voit donc plus les pieds / Ceux qui ont le cœur en pleurs comme l’oignon pelé de trop près, etc.
Celui qui s’ennuie à la réception de L’Entreprise dont il a la garde la nuit sans même un chien d’attaque / Celle qui lève des haltères pour rester dans le trend / Ceux qui voient l’ambulance s’éloigner avec un serrement de cœur / Celui qui se détache de lui-même et prétend que c’est sans regret mais son air dit le contraire / Celle qui du Minitel a passé à Meetic et Twitter pour en revenir au Muscadet / Ceux qui hantent les ports embrumés de leurs verres de Brandy / Celui qui n’a jamais supporté les angles de la réalité / Celle qui fuit dans les parenthèses de neige / Ceux qui n’ont pas profité des indépendances pour se faire des empires / Celui qui ne peut plus régater faute d’alizés / Celle qu’on oublie dans la zone tampon / Ceux qui estiment que tout est à repenser en termes générationnels sinon comment comprendre ces Y qui se demandent why ? / Celui qui se dit philosophe sociologue et qui fait pas mal non plus les œufs au plat / Celle qui s’est occupé du linge de corps de plusieurs membres connus de l’Ecole de Francfort / Ceux qui voient Norbert péter un plomb à la salle de musculation et ne s’en étonnent point vu son manque de perfos en affaires / Celui qui affirme donner tout Montaigne pour une page de La Boétie et se fait ainsi remarquer des dames du premier rang qui se demandent si cette Boétie avait du bien / Celui qui explique à ses lycéens que Montaigne et Pascal ne boxaient pas dans la même catégorie / Celle qui s’enquiert de ta santé avec la sollicitude de qui cherche à monter en grade / Ceux qui se reconnaissant dans le bain de vapeur s’ignorent aussitôt / Celui qui n’en peut plus de se contenter de si peu même en comptant ses Bonus / Celle qui dispose des petits numéros à côté de chacun des morceaux du suicidé au plastic / Ceux qui s’étonnent de ne plus s’étonner / Celui qui commence à se demander comment en finir / Celle qui s’allonge sur le piano pour que Chopin la pénètre mieux / Ceux qui sourient d’un air entendu quand la vieille Angélique Python leur propose à la disco de leur faire feuille de rose / Celui qui tombe du septième étage du building et se relève en souplesse ce qui révèle un client fit du Club Silhouette / Celle qui se prend pour sa jumelle et ne se voit donc plus les pieds / Ceux qui ont le cœur en pleurs comme l’oignon pelé de trop près, etc.  Le 23 juin dernier, au Teatro Gobetti de Turin, Guido Ceronetti faisait ses adieux à la scène, avec les comédiens de son Teatro dei Sensibili, dans un Finale di teatro brassant ses thèmes de toujours et ceux de son dernier livre, Ti saluto mio secolo crudele - je te salue cruel XXe siècle.
Le 23 juin dernier, au Teatro Gobetti de Turin, Guido Ceronetti faisait ses adieux à la scène, avec les comédiens de son Teatro dei Sensibili, dans un Finale di teatro brassant ses thèmes de toujours et ceux de son dernier livre, Ti saluto mio secolo crudele - je te salue cruel XXe siècle. Composé d’une suite de séquences alternant poèmes, fragments monologués ou dialogués tirés du dernier recueil Ti saluto mio secolo crudele, parfois accompagnés de chants ou de guitare, la représentation commence avec un extrait des Ballades du temps jadis de François Villon, qui évoque la mélancolie de celle qui a été aimée et malmenée par son amant, auquel elle garde pourtant tout son amour dolent…
Composé d’une suite de séquences alternant poèmes, fragments monologués ou dialogués tirés du dernier recueil Ti saluto mio secolo crudele, parfois accompagnés de chants ou de guitare, la représentation commence avec un extrait des Ballades du temps jadis de François Villon, qui évoque la mélancolie de celle qui a été aimée et malmenée par son amant, auquel elle garde pourtant tout son amour dolent…  On alterne ainsi les séquences dramatiques, satiriques ou tragiques, avec le dialogue impayable de deux tiffosi qui se disputent pendant qu’une femme se fait violer derrière un bosquet, l’évocation des Lettres de Stalingrad et de l’Umschlagplatz, ou la scène du clown sautillant en sa candeur joyeuse, qu’une sorte d’animatrice de télé invite à prendre place sur un trône majestueux qui n’est autre qu’une chaise électrique...
On alterne ainsi les séquences dramatiques, satiriques ou tragiques, avec le dialogue impayable de deux tiffosi qui se disputent pendant qu’une femme se fait violer derrière un bosquet, l’évocation des Lettres de Stalingrad et de l’Umschlagplatz, ou la scène du clown sautillant en sa candeur joyeuse, qu’une sorte d’animatrice de télé invite à prendre place sur un trône majestueux qui n’est autre qu’une chaise électrique... Avant de quitter Turin, cet après-midi, nous avions encore rendez-vous avec un acteur du Teatro dei Sensibili, Filippo Usellini, qui nous a parlé de son travail avec la petite compagnie et, plus généralement, de son expérience du théâtre de presque quadra aux airs très juvéniles.
Avant de quitter Turin, cet après-midi, nous avions encore rendez-vous avec un acteur du Teatro dei Sensibili, Filippo Usellini, qui nous a parlé de son travail avec la petite compagnie et, plus généralement, de son expérience du théâtre de presque quadra aux airs très juvéniles. La dernière génération des Sensibili (fondée en 1970 par Guido Ceronetti et sa femme) a été recrutée au début des années 2000 à l’occasion d’un stage que Ceronetti donnait à Milan au Piccolo Teatro. Filippo lui-même venait de l’école dirigée par Paolo Grassi. Ce que le jeune comédien a tout de suite apprécié chez le Maestro, c’est le mélange de naïveté et de liberté totale qu’il manifestait à l’égard du théâtre et ses codes, autant que dans sa présence humaine.
La dernière génération des Sensibili (fondée en 1970 par Guido Ceronetti et sa femme) a été recrutée au début des années 2000 à l’occasion d’un stage que Ceronetti donnait à Milan au Piccolo Teatro. Filippo lui-même venait de l’école dirigée par Paolo Grassi. Ce que le jeune comédien a tout de suite apprécié chez le Maestro, c’est le mélange de naïveté et de liberté totale qu’il manifestait à l’égard du théâtre et ses codes, autant que dans sa présence humaine.

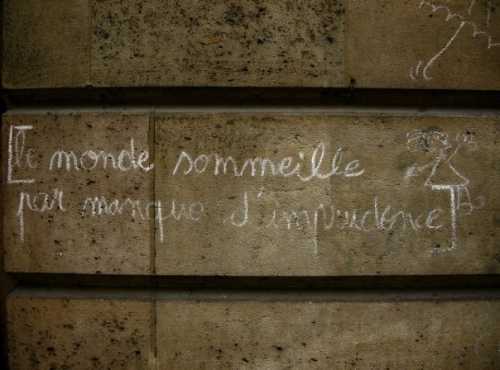 Ce qu’il faut relever cependant, paupières mi-closes, c’est la puissance régénératrice et parfois créatrice du sommeil, ainsi du jeune poète que vous voyez là, tout ébouriffé sur l’herbe tendre, dans son trou de verdure à la douce rumeur de rivière, sa double rose rouge sur le cœur, lâchant comme un murmure entre ses lèvres encore parfumée d’anis - Ah Nature berce-le chaudement dans le cresson bleu, pour que son rêve nous illumine…
Ce qu’il faut relever cependant, paupières mi-closes, c’est la puissance régénératrice et parfois créatrice du sommeil, ainsi du jeune poète que vous voyez là, tout ébouriffé sur l’herbe tendre, dans son trou de verdure à la douce rumeur de rivière, sa double rose rouge sur le cœur, lâchant comme un murmure entre ses lèvres encore parfumée d’anis - Ah Nature berce-le chaudement dans le cresson bleu, pour que son rêve nous illumine…

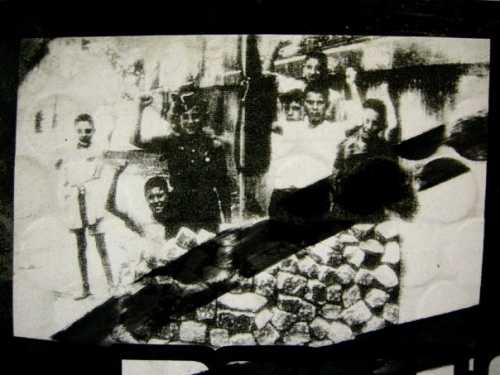





 Rien, au demeurant, de pédagogiquement » ou « politiquement » didactique dans le regard que Basil porte sur ces réalités. De toute évidence, ce qu'il cherche est une présence humaine dans sa nudité et sa crudité, une pâte qu'il puisse travailler au corps avec son âme d'artiste. Ainsi du personnage de Nuvem, Nuage en français: Nuvem le glandeur naïf de ce bidonville créole, qui pourrait être documenté comme un « cas social ». Mais Basil en fait plutôt le sujet d'un conte initiatique doux et dur. Nuvem le minable part en effet pour pêcher un poisson-lune, seul moyen lui a-t-on dit de conquérir le cœur de la belle serveuse noire qui le snobe. Egalement rejeté par les malfrats du bidonville qu'il a provoqués, accablé de reproches par sa mère, moqué par les rappeurs de la zone, Nuvem finira par prendre la mer comme on dit que la mer prend l'eau. D'une première série de plans, toute douceur et dureté mêlées, évoquant son rejet par la belle serveuse dans un subtil mouvement tournant de la caméra (tenue par Basil lui-même), aux images finales du départ de Nuvem vers quel ailleurs marin, une poésie prenante s'ajoute à cette vie de chien errant dans un climat crépusculaire qui fait l'économie de toute profondeur de champ. Mais où Basil Da Cunha a-t-il « pêché » tout ça ? À quelle « école » a-t-il été formé ?
Rien, au demeurant, de pédagogiquement » ou « politiquement » didactique dans le regard que Basil porte sur ces réalités. De toute évidence, ce qu'il cherche est une présence humaine dans sa nudité et sa crudité, une pâte qu'il puisse travailler au corps avec son âme d'artiste. Ainsi du personnage de Nuvem, Nuage en français: Nuvem le glandeur naïf de ce bidonville créole, qui pourrait être documenté comme un « cas social ». Mais Basil en fait plutôt le sujet d'un conte initiatique doux et dur. Nuvem le minable part en effet pour pêcher un poisson-lune, seul moyen lui a-t-on dit de conquérir le cœur de la belle serveuse noire qui le snobe. Egalement rejeté par les malfrats du bidonville qu'il a provoqués, accablé de reproches par sa mère, moqué par les rappeurs de la zone, Nuvem finira par prendre la mer comme on dit que la mer prend l'eau. D'une première série de plans, toute douceur et dureté mêlées, évoquant son rejet par la belle serveuse dans un subtil mouvement tournant de la caméra (tenue par Basil lui-même), aux images finales du départ de Nuvem vers quel ailleurs marin, une poésie prenante s'ajoute à cette vie de chien errant dans un climat crépusculaire qui fait l'économie de toute profondeur de champ. Mais où Basil Da Cunha a-t-il « pêché » tout ça ? À quelle « école » a-t-il été formé ? Basil Da Cunha, Nuvem (Le poisson lune). DVD disponible, édité par Thera Production.
Basil Da Cunha, Nuvem (Le poisson lune). DVD disponible, édité par Thera Production.


 Celle qui n’aimait pas le braillard de fin de soirée / Ceux qui lui ont tout pardonné sans raison précise / Celui qui l’entendait maugréer « intense activité littéraire, intense activité littéraire, intense activité littéraire» en arpentant le dédale de son antre / Ceux qui l’ont mis en demeure de dégager les lieux en sorte de les gérer à meilleur compte / Celui qui affirme que son père est à présent « dans la paix » / Celle qui pleure son papa / Ceux qu’il continuera longtemps de vivifier par la pensée / Celui qui se rappelle la soirée passée à lire le tapuscrit de La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic et l'extrême émotion partagée de la dernière page / Celle qui le houspillait comme un sale fils de cinquante-trois ans / Ceux qui le redoutaient / Celui qui se rappelle leur première visite à Pierre Gripari dans son hôtel pisseux du XIIIe / Celle qui lui tenait tête en public et même en privé / Ceux qui l'ont fui pour rester libre / Celui qui a fait son procès public pour se faire bien voir de son amie croate / Celle qui ne lui a pas pardonné d'avoir défilé avec l'étoile jaune en assimilant la cause serbe au martyre du peuple juif / Ceux qui invoquent l'épaisseur de l'Histoire / Celui qui s'est violemment fâché contre lui quand il a pris la défense de Martin Heidegger au prétexte qu'un philosophe ne peut se juger à ses opinions / Celle qui ne lui en a jamais voulu d'avoir égaré son manuscrit d'un recueil de poèmes ésotériques / Ceux qui le tapaient devant l'église Saint-Sulpice / Celui qui se rappelle ce que lui avait dit le bedeau de Saint-Sulpice à propos du goût de miel de l'hostie / Celle qui l'a vu un soir plus que seul sur un banc de métro / Ceux qui aimaient bien le voir revenir en Belgique avec son côté belge / Celui qui lui a racinté sa vie dans les jardins de la clinique où ils commençaient tous deux de marcher / Celle qui estime que c'était un vampire point barre / Ceux qui appréciaient sa grande pudeur /
Celle qui n’aimait pas le braillard de fin de soirée / Ceux qui lui ont tout pardonné sans raison précise / Celui qui l’entendait maugréer « intense activité littéraire, intense activité littéraire, intense activité littéraire» en arpentant le dédale de son antre / Ceux qui l’ont mis en demeure de dégager les lieux en sorte de les gérer à meilleur compte / Celui qui affirme que son père est à présent « dans la paix » / Celle qui pleure son papa / Ceux qu’il continuera longtemps de vivifier par la pensée / Celui qui se rappelle la soirée passée à lire le tapuscrit de La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic et l'extrême émotion partagée de la dernière page / Celle qui le houspillait comme un sale fils de cinquante-trois ans / Ceux qui le redoutaient / Celui qui se rappelle leur première visite à Pierre Gripari dans son hôtel pisseux du XIIIe / Celle qui lui tenait tête en public et même en privé / Ceux qui l'ont fui pour rester libre / Celui qui a fait son procès public pour se faire bien voir de son amie croate / Celle qui ne lui a pas pardonné d'avoir défilé avec l'étoile jaune en assimilant la cause serbe au martyre du peuple juif / Ceux qui invoquent l'épaisseur de l'Histoire / Celui qui s'est violemment fâché contre lui quand il a pris la défense de Martin Heidegger au prétexte qu'un philosophe ne peut se juger à ses opinions / Celle qui ne lui en a jamais voulu d'avoir égaré son manuscrit d'un recueil de poèmes ésotériques / Ceux qui le tapaient devant l'église Saint-Sulpice / Celui qui se rappelle ce que lui avait dit le bedeau de Saint-Sulpice à propos du goût de miel de l'hostie / Celle qui l'a vu un soir plus que seul sur un banc de métro / Ceux qui aimaient bien le voir revenir en Belgique avec son côté belge / Celui qui lui a racinté sa vie dans les jardins de la clinique où ils commençaient tous deux de marcher / Celle qui estime que c'était un vampire point barre / Ceux qui appréciaient sa grande pudeur /  Celui qui se rappelle son récit du premier jour de sa petite entreprise consacrée à balayer les locaux comme la novice débarquant au couvent de Sainte Thérèse enfin tu vois le genre / Celle qui a préféré parler d'autre chose quand il insultait les Musulmans de Bosnie / Ceux qui se sont éloignés de lui pour se protéger sans espérer le protéger de lui-même / Celui qui ne lui passait rien / Celle qui lui passait tout / Ceux qui changeaient de trottoir à son approche / Celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est vraiment la fidélité en amitié sans conclure à vrai dire / Celle qu'amusait son côté despote dont elle se fichait en le singeant / Ceux qui pensaient "Comédie humaine" en l'observant / Celui que son hybris faisait l'apparenter aux bâtisseurs paranos / Celle qui l'a mise en garde contre l'auto-destruction dostoïevskienne / Ceux qui le croisaient tous les midis au Milk Bar / Celui qu'il a soutenu en dépit (ou à cause) de sa dépendance grave à la dope / Celle qui l'appelait mon petit Oblomov / Ceux qui n'en auront jamais fait le tour et qui n'en demandent d'ailleurs pas tant / Celui qui se méfiait de sa cruauté émotive / Celle qui l'aimait en dépit de sa muflerie / Ceux qui ne toucheront pas au secret de l'ami disparu, etc.
Celui qui se rappelle son récit du premier jour de sa petite entreprise consacrée à balayer les locaux comme la novice débarquant au couvent de Sainte Thérèse enfin tu vois le genre / Celle qui a préféré parler d'autre chose quand il insultait les Musulmans de Bosnie / Ceux qui se sont éloignés de lui pour se protéger sans espérer le protéger de lui-même / Celui qui ne lui passait rien / Celle qui lui passait tout / Ceux qui changeaient de trottoir à son approche / Celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est vraiment la fidélité en amitié sans conclure à vrai dire / Celle qu'amusait son côté despote dont elle se fichait en le singeant / Ceux qui pensaient "Comédie humaine" en l'observant / Celui que son hybris faisait l'apparenter aux bâtisseurs paranos / Celle qui l'a mise en garde contre l'auto-destruction dostoïevskienne / Ceux qui le croisaient tous les midis au Milk Bar / Celui qu'il a soutenu en dépit (ou à cause) de sa dépendance grave à la dope / Celle qui l'appelait mon petit Oblomov / Ceux qui n'en auront jamais fait le tour et qui n'en demandent d'ailleurs pas tant / Celui qui se méfiait de sa cruauté émotive / Celle qui l'aimait en dépit de sa muflerie / Ceux qui ne toucheront pas au secret de l'ami disparu, etc.
 La Science Fiction, ou l’homme en éternel projet. En mémoire de Pierre versins (1923-2001).
La Science Fiction, ou l’homme en éternel projet. En mémoire de Pierre versins (1923-2001). Extraordinaire. Tel est le mot qui vous vient à l’esprit lorsque, ignorant ce qui vous attend, vous débarquez devant la maison de Rovray où habite Pierre Versins. Extraordinaire, d’abord, le décor : dominant les toits du village, les prés et les forêts, c’est, sauf le respect dû à l’anarchiste que prétend être le maître de céans, le lieu d’une paix royale, d’un calme quasi monacal. Ici, le jour se lève quand il lui semble bon, les vaches broutent, les innocentes, et l’on admire un paysage apparemment intouché : le décor même des romans de science fiction à venir, genre contre-utopie bucolique…
Extraordinaire. Tel est le mot qui vous vient à l’esprit lorsque, ignorant ce qui vous attend, vous débarquez devant la maison de Rovray où habite Pierre Versins. Extraordinaire, d’abord, le décor : dominant les toits du village, les prés et les forêts, c’est, sauf le respect dû à l’anarchiste que prétend être le maître de céans, le lieu d’une paix royale, d’un calme quasi monacal. Ici, le jour se lève quand il lui semble bon, les vaches broutent, les innocentes, et l’on admire un paysage apparemment intouché : le décor même des romans de science fiction à venir, genre contre-utopie bucolique…