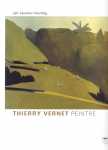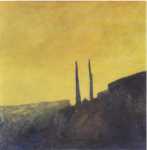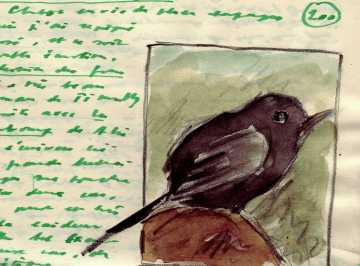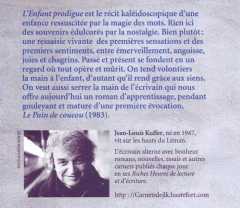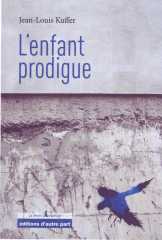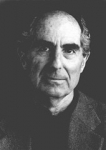
Du romancier et de ses personnages. À propos de L’homme ralenti de J. M. Coetzee et du Complot contre l’Amérique de Philip Roth.
Dès qu’Elizabeth Costello apparaît dans L’homme ralenti, le dernier roman de J.M. Coetzee, quelque chose se passe de mystérieux et d’également incongru, que le lecteur n’ayant pas lu Elizabeth Costello, le précédent ouvrage du même auteur, peinera probablement à comprendre. Elizabeth Costello est en effet romancière, à la fois célèbre et vieillissante, que l’on a vu vivre et se débattre tout au long de ce roman qu’on pourrait dire par excellence le roman du romancier, et la voici qui se repointe tout à coup dans ce nouveau livre dont tout laisse à supposer qu’elle est elle-même en train de l’écrire, dans sa tête ou pour de bon…
Marcel Aymé s’était bien amusé déjà, dans Le romancier Martin, l’une des nouvelles de Derrière chez Martin, à confronter un romancier et ses personnages venus lui présenter leurs doléances, mécontents qu’ils étaient du sort qu’il leur réservait.
Avec J.M. Coetzee, on passe du registre de la malice à celui des reflets retors, voire vertigineux, du réel et de la fiction, avec cette sensation presque physique de voir s’incarner les personnages.
Or qui est le plus réel, du romancier et de ses personnages ? La question paraît académique, mais elle signale pourtant la vraie réalité de l’art et de la littérature, laquelle est à mes yeux plus réelle que ce qu’on dit le réel. Ainsi, après avoir lu cet autre roman plus-que-réel que figure à mes yeux Le complot contre l’Amérique de Philip Roth, je me dis que plusieurs de ses personnages (à commencer par le père et la mère de Philip, son frénétique cousin Alvin, l’écrabouilleur affairiste Steinheim, le journaliste anti-fasciste Walter Winchell ou le rabbin « collabo » Bengelsdorf, entre beaucoup d’autres) me semblent plus réels que nombre de vivants que j’ai fréquentés « en réalité »… De la même façon, je ne regrette pas, en somme, de n'être pas ces jours en Suisse où Coetzee se trouve précisément de passage, convaincu que ses livres nous en disent bien plus que lui-même, ainsi qu'il l'a d'ailleurs dit et répété...
Carnets de JLK - Page 138
-
Un effet de réel
-
Traversée de Kundera
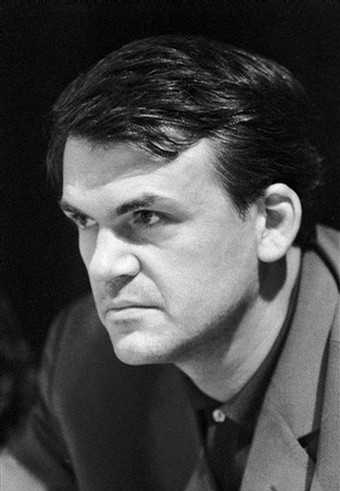 Lecture intégrale de l’Oeuvre. Aujourd'hui: La Plaisanterie...
Lecture intégrale de l’Oeuvre. Aujourd'hui: La Plaisanterie...Préambule
Le titre des deux volumes consacrés à Milan Kundera dans La Pléiade est déjà tout un programme. Simplement : Œuvre. Tout à fait le profil compact du Monumentum à la Flaubert. Quinze livres publiés entre le milieu des années 60 et la fin des années 2000, et cela sans appareil critique ni la moindre biographie de l’auteur. En revanche : une biographie de chaque livre…
François Ricard, maître d’œuvre de l’édition, s’en explique clairement dans sa préface concise et concentrée à souhait, puis dans sa note sur l’édition : voici l’œuvre rendue non pas aux spécialistes mais aux « lecteurs oisifs », aux amateurs (au sens de ceux qui aiment), à tous ceux-là « qui n’ont nul besoin de lunettes empruntées pour comprendre et apprécier une œuvre aussi ouverte et limpide que celle de Milan Kundera ».
Risibles amours. (1970)
1. Personne ne va rire
La première nouvelle concentre des thèmes, des situations et des personnages qui forment un jeu de rôles où la réflexion se combine immédiatement à la matière existentielle, comme si le romancier pratiquait déjà ce qui sera son expérience créatrice typique, d’emblée marquée par l’ironie, voire le sarcasme, je dirai même, s’agissant d’un jeune auteur : de l’auto-sarcasme.
Le narrateur est un assistant de fac spécialiste d’histoire de l’art, boy friend d’une jeune Klara ouvrière dans la couture à qui il a promis de la pousser dans les sphères de la mode, brillant sujet « dissident » sur les bords, à la fois mal vu de l’officialité et reconnu pour son talent, qu’un critique d’art vieillissant vient solliciter afin qu’il fasse une note d’introduction pour une revue influente, sur un écrit qu’il espère y caser. Mais l’assistant se dérobe plus ou moins après avoir lu le texte en question qu’il trouve médiocre. Le vieux profite du « plus ou moins » pour s’accrocher, avec une ténacité de crampon rare. Or le jeune homme joue au chat et à la souris, en menant l’affaire comme une comédie. Puis il aggrave son cas, le vieux l’ayant pisté jusqu’à son domicile, où il s’est trouvé face à Klara nue dans un imperméable, en l’accusant de harcèlement et même d’abus sexuel, au point que la plaisanterie tourne à l’affaire d’Académie et même d’Etat, le faraud étant convoqué par le comité de quartier où son donjuanisme bohème devient LE sujet, et l’objet de l’opprobre collectif tandis que Klara, utilisée à son corps défendant, se retourne contre lui et fait le procès de son cynisme d’intello prétentieux et sans cœur.
Tout ça terriblement bien mené, combinant l’analyse des relations entre jeunes gens de milieux différents et entre personne d’âges différents, l’aperçu relativiste des « positions esthétiques » en jeu dans un environnement social contraignant, la dérision du romantisme sentimental et la modulation de la complexité humaine qui va prendre de plus en plus de place dans les romans à venir. L’écrivain approchait de la trentaine quand il a composé cette nouvelle, justement disposée en tête du recueil alors que ce n’est pas la première qu’il ait écrite. Mais le ton, la manière, le regard, le mélange essai-narration, le jeu sur la fiction et les faux semblants : tout est réellement ou virtuellement déjà là…
2. La pomme d'or de l'éternel désir
Le thème du temps qui fait tomber les cheveux du jeune dragueur est ici modulé sur un ton amical par le narrateur qui se dit d'emblée incapable de faire les choses que fait son ami Martin: à savoir accoster n'importe quelle femme dans n'importe quelle rue. On ne drague plus aujourd'hui comme on le faisait dans les années 50-60, et les jeunes lecteurs souriront de voir les plans tactiques et stratégiques qui se déployaient alors pour circonvenir une blonde. On pense d'ailleurs aux Amours d'une blonde, film de Milos Forman datant de la même époque, lequel Forman apparaît d'ailleurs dans la nouvelle, qui dégage une tendresse malicieuse n'excluant pas les mecs les plus farauds dont le mariage rabat le caquet...
3. Le jeu de l'auto-stop
Dans les années 60-70, des centaines de stoppeurs se postaient chaque jour à la sortie de toutes les villes occidentales, et l'une des jeunes filles de La Plaisanterie fait même de l'auto-stop la marque de la jeunesse de l'époque. Comme on le verra souvent, la mentalité du garçon ne pensant qu'au charme de l'aventure, opposée à celle de la fille affectivement plus engagée et sérieuse, à tout le moins attachée au romantisme amoureux, s'affrontent ici dans ce qu'on pourrait dire un jeu de rôles avant la lettre, que l'écrivain module par la forme même de la narration comme en abyme, jouant sur une fiction dans la fiction. En filigrane, on perçoit déjà, en outre, le thème de la pesanteur sociale et politique avec "l'ombre grisâtre d'une stricte planification". Enfin, les jeux discordants de l'érotisme, vécus dans le tremblement d'attirance-répulsion typique à la fois de l'époque et de sa jeunesse, sont saisis dans leur complexité affective et psychologique que la femme et l'homme vivent chacun à sa façon. Dans les notes de fin de volume, François Ricard explique très en détail la genèse et la réception de chacune de ces nouvelles, dont l'ensemble forme déjà une espèce de corpus romanesque très kunderien de forme et d'esprit.
4. Le Colloque
La rivalité mimétique, observée par René Girard dans le roman occidental, de Don Quichotte à Proust et jusqu'au Camus de La Chute, se retrouve dans toutes ces premières nouvelles et fera également florès dans La Plaisanterie. Elle est omniprésente dans ce Colloque où se confrontent trois générations de séducteurs: le patron de médecine, et son collègue cadet le docteur Havel, des vieux de la vieille qui en ont vu d'autres, et le jeune et bel étudiant Fleischmann propulsé dans le monde des adultes avec la (fausse) candeur de ce que Kundera appelle l'âge lyrique. Entre ces coqs, les femmes tiennent la chandelle et marquent les coups, dont les échos se prolongeront dans les deux nouvelles suivantes sous le signe commun du désir éprouvé par la réalité, et donc du vieillissement.
5. Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts
Les occasions ratées, les illusions d'un pur amour bientôt démenti par la rude réalité, sur fond de monotone grossièreté sociale, l'espoir d'une nouvelle chance et d'une vie moins décevante constituent l'arrière-fond de cette nouvelle marquée par les retrouvailles d'une veuve revenue dans le cimetière où repose son mari évacué des lieux entretemps sous prétexte que les vieux morts doivent céder la place aux jeunes, et d'un homme qu'elle a connu des années auparavant, qui a maintenant trente-cinq ans et la considère, sans qu'elle s'en doute, comme celle qu'il a laissée échapper. Sur fond de désenchantement réciproque, c'est une histoire de vieux amants avant l'âge, ou de jeunes amoureux aux corps un peu flétris, comme on voudra, que l'auteur trentenaire détaille avec un mélange de lucidité lancinante et d'indulgence affectueuse.
6. Le docteur Havel vingt ans plus tard
L'épouse légitime du docteur Havel, dont le nom est chargé d'une "terrible réputation érotique", est terriblement jalouse quand il s'en va faire une cure thermale, alors que lui-même constate que les jolies femmes ne lui prêtent plus guère d'attention. Plus humiliant encore: le fait qu'un jeune journaliste lui tourne autour, en ces lieux, non pour l'interviewer mais pour accéder à sa femme, actrice bien connue de l'époque. Là encore, les jeux mimétiques de la séduction donnent lieu à des scènes qui vont bien au-delà du vaudeville de station thermale: au théâtre de la vie où les miroirs publics et privés se lézardent de concert. La relation père-fils du docteur et du jeune plumitif, le ballet des femelles autour du vieux paon, la vérité des sentiments, la femme convoitée par tous (sur les écrans de cinéma) et qui n'aspire en réalité qu'à un amour paisible et caché, le collectionneur de femmes qui n'est à vrai dire qu'un collectionneur de mots, les relations entre femmes d'âge mûr et jeunes farauds qui masquent de sourdes nostalgies de liens mère-fils: tous ces thèmes s'entremêlent avec grâce dans cette nouvelle ressortissant déjà à la pleine maîtrise du futur romancier.
7. Edouard et Dieu
Comme dans la première nouvelle de ces Risibles amours, cette grinçante histoire d'un jeune homme d'abord tenu à distance par Alice la croyante, qu'il s'impatiente de déflorer, et qui devient pratiquant à outrance pour la séduire, au risque de déplaire aux communistes athées purs et durs, illustre les jeux embrouillés de l'idéologie (ici religieuse) confondue avec la foi, et de la mauvaise foi déjouée par la vie. Edouard semble ici le tricheur par excellence, mais on verra qu'il ne l'est pas plus que ceux qui l'entourent, confits dans leur semblant de foi rationaliste, ni même que la pure Alice bientôt confrontée à la caricature violente de sa croyance, et renvoyée à sa solitude de femme sincèrement aimante et sincèrement sérieuse. Comme dans Personne ne va rire, dont Klara dit le dernier mot en jugeant le cynisme de son amant, la femme est ici aussi garante d'une sorte d'intégrité incarnée, tandis que le jeune homme rieur accouche, dans sa solitude à lui, d'une nouvelle sagesse précaire. Le sourire est finalement de mise, qu'on pourrait dire d'un sceptique humanisé...
La Plaisanterie (1967)
Il est intéressant de lire (ou de relire) La Plaisanterie quarante ans après sa première publication à Prague, en 1967 (l’année de nos vingt ans) où le livre fut acclamé avant d’être interdit, et ceci pour diverses raisons.
D’abord parce que le livre n’a pas pris une ride, comme on dit - comme les « classiques » qui ont l’air d’échapper au temps, et c’est d’ailleurs comme un classique qu’il fut vite considéré dans son pays d’origine puis en France où le début de sa gloire fut particulièrement éclatant ; ensuite du fait que ses dimensions de beauté (en un sens qui n’est pas que d’esthétique littéraire) et de bonté (notion qui paraîtra ringarde à beaucoup mais j’y tiens) se dégagent mieux aujourd’hui, quatre décennies après les événements qui en firent un brûlot de dissidence, de ce livre qui est bien plus qu’un sarcasme d’époque en dépit de son ironie fondamentale, qui ressortit finalement plus à l’humour qu’à l’ironie : un livre d’une profonde bonté et d’une non moins profonde beauté, dont la base extraordinairement ferme appartient encore, cependant, à un monde qu’on pourrait dire d’AVANT, alors que, dès La Vie est ailleurs, on basculera dans un monde de l’APRÈS, immédiatement visible dans ses rebonds formels.
La Plaisanterie, relu après la chute apparente de tous les murs, est probablement le premier grand livre de la désillusion vécue par des individus (je parle des protagonistes, à savoir Ludvik le plaisantin, Helena l’amoureuse sur le retour, Kostka le chrétien de gauche et Jaroslav le nostalgique folkloriste) qui sont ambivalents, comme nous le sommes tous, tout en ayant quelque chose de « types représentatifs », au sens du réalisme socialiste évidemment dévié, et que le montage narratif lui-même, alternant les points de vue, montre sous leurs multiples facettes.
Après ce qu’on a appelé le Nouveau Roman, et avant ce qu’on appelle encore la littérature postmoderne, La Plaisanterie raconte une histoire linéaire (pfff…) portée par des personnages (pfff…), eux-mêmes portant autant de prénoms que le lecteur se rappelle comme ceux de L'éducation sentimentale ou du Rouge et le noir...
Or relire aujourd’hui La Plaisanterie ne revient pas à revenir à de l’ancien dépassé par la modernité, mais nous ramène simplement, par le rire, ou plus exactement par les rires, au sérieux de la littérature qui vous fait du bien en vous faisant mal, qui vous parle de vous en vous parlant d’autre chose. La Plaisanterie est une espèce de roman choral de la solitude. C’est, pour une bonne partie, l’histoire de la jeunesse gâchée de Ludvik, plaisantin qui a cru malin de railler, sur une carte postale ouverte à tout vent qu’il envoie à une jeune fille sérieuse qu’il drague en vain, l’optimisme de l’époque auquel il oppose, non moins railleusement, l’alternative trotskyste ! Or, comme on le voit aujourd’hui dans une autre perspective, où il est recommandé à chacun de positiver sous peine de se faire virer du club des chaussettes immaculées, railler l’optimisme social, au lendemain de la Guerre et alors que se construit l’Avenir, n’est pas qu’une blague : c’est un crime et qu’il faudra payer. Plus précisément, cela vaut à Ludvik d’être chassé du Parti autant que d’être interdit d’études, à peu près comme le sera Kundera lui-même après la parution de ce livre, désigné comme le fauteur de troubles Number One par un Novotny.
Soit dit en passant, cependant : rien d’autobiographique dans cette fiction modulant déjà l’éthique définie des années plus tard dans L'Âge du roman, et pourtant nous retrouvons l’auteur à toute les pages et à chaque ligne, pourrait-on dire, comme nous nous retrouvons nous-mêmes ; et l’erreur de Ludvik est donc l’erreur de Milan autant que la nôtre.
L’erreur de Ludvik est d’avoir cru qu’il pourrait rester libre et que rien ni personne ne l’en empêcherait. L’erreur de Ludvik est de s’être cru malin comme c’est souvent le cas chez les jeunes gens. L’erreur de Ludvik est d’avoir manqué de prudence avec le Groupe et de tact avec les Dames. L’erreur de Ludvik reste aujourd’hui d’être né dans ce monde et de ne pas l’avoir compris avant d’en subir les conséquences. Pourtant il le comprendra, mais ce sera au bout de La Plaisanterie qui finit par l’arrivée d’une ambulance sur laquelle personne ne tirera et sans savoir si le vieux pote qu’elle emporte, retrouvé tant d’années après par Ludvik, s’en tirera lui-même…
À partir de La Plaisanterie relue chacun pourrait écrire une espèce d’autobiographie ou, comme on dit aujourd’hui, une autofiction propre à sa propre génération, au dam de l’Auteur récusant noblement ces genres.
Ce que j’veux dire, c’est que cette fiction avérée me ramène, te ramène, nous ramène, les ramène à notre réalité de ce 1er Mai 2011 qui est un dimanche chômé par ordre du Seigneur non syndiqué – réalité qui n’est pas anecdotique pour autant mais Réalité magnifique et mortelle de ce 2 mai où je recopie ces notes surf mon Mac le Marin…
Telle est l’utopie, mon utopie : ce corps, ce visage dans le miroir réfracté par les images de Ludvik et d’Helena, de Jaroslav et de Kostka, du petit salopard chef de camp et de la pure Lucie mille fois souillée, de Pavel le délateur et d’Alexej le fils d’apparatchik martyr genre taliban, enfin de tous ceux qui sourient de toute leur tristesse dans ce roman qui rit jaune...
Milan Kundera. Oeuvre, vol. I. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade
(À suivre)
Milan Kundera. Oeuvre, vol. I. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade
(À suivre)
-
Ceux qui ne pensent qu'à La Chose
 Celui qui reconnaît le beau travail à l’odeur / Celle qui sait distinguer la Valenciennes de l’Alençon / Ceux qui respectent le Compagnon même manchot / Celui qui trouve le terme de création prétentieux et même inapproprié / Celle qui a horreur du genre artiste / Ceux qui brodent en silence / Celui qui sait que le mauvais poète se reconnaît à sa façon de rater des oeufs brouillés / Celle qui partage la vie de l’Artisan en deux / Ceux qui examinent les nouveaux poèmes comme aux comices agricoles les agneaux / Celui qui ne pense qu’à faire des phrases / Celle qui se demande si Mallarmé se lit encore / Ceux qui n’ont point de génie mais de l’obstination à revendre ce qui les fait dire que Proust (Marcel, pas Robert) a raison / Celui qui a soigné ses trous de mémoire avec Proust (Robert) / Celle qui a connu le père Proust aux eaux (donc le père de Robert et Marcel) et l’a plaint de n’avoir pas de filles qui écrivent parfois des poèmes / Ceux qui ont plus de respect pour les poétesses musulmanes que pour les télévangélistes / Celui qui rêve qu’il écrit qu’il rêve / Celle qui tricote un paysage au fil d’Ariane / Ceux qui aiment les ciels de Corot en dépit de son insatisfaction notoire / Celui qui répond : Maman, quand on lui demande qui a inspiré son grand poème sur la mer / Celle qui écrit des trucs qui marchent mieux que les machins de son mec / Ceux qui écrivent mieux en dormant / Celui qui s’investit complètement dans la marqueterie biodégradable / Celle qui se donne à celui qui se vend à ceux qui ne paient pas de mine / Ceux qui n’écrivent que pour le pognon ce qui se voit tant c’est gratuit / Celui qui se vante de ce que sa vie est un polar et qui se fait buter pour le prouver / Celle qui peint des chevreuils dans des sous-bois et parfois des tulipes / Ceux qui ne savent plus que penser et ne pensent donc plus / Celui qui se replie sur le monde / Celle qui se déploie dans le hennissement primal / Ceux qui ne consomment plus pour mieux se consumer, etc.
Celui qui reconnaît le beau travail à l’odeur / Celle qui sait distinguer la Valenciennes de l’Alençon / Ceux qui respectent le Compagnon même manchot / Celui qui trouve le terme de création prétentieux et même inapproprié / Celle qui a horreur du genre artiste / Ceux qui brodent en silence / Celui qui sait que le mauvais poète se reconnaît à sa façon de rater des oeufs brouillés / Celle qui partage la vie de l’Artisan en deux / Ceux qui examinent les nouveaux poèmes comme aux comices agricoles les agneaux / Celui qui ne pense qu’à faire des phrases / Celle qui se demande si Mallarmé se lit encore / Ceux qui n’ont point de génie mais de l’obstination à revendre ce qui les fait dire que Proust (Marcel, pas Robert) a raison / Celui qui a soigné ses trous de mémoire avec Proust (Robert) / Celle qui a connu le père Proust aux eaux (donc le père de Robert et Marcel) et l’a plaint de n’avoir pas de filles qui écrivent parfois des poèmes / Ceux qui ont plus de respect pour les poétesses musulmanes que pour les télévangélistes / Celui qui rêve qu’il écrit qu’il rêve / Celle qui tricote un paysage au fil d’Ariane / Ceux qui aiment les ciels de Corot en dépit de son insatisfaction notoire / Celui qui répond : Maman, quand on lui demande qui a inspiré son grand poème sur la mer / Celle qui écrit des trucs qui marchent mieux que les machins de son mec / Ceux qui écrivent mieux en dormant / Celui qui s’investit complètement dans la marqueterie biodégradable / Celle qui se donne à celui qui se vend à ceux qui ne paient pas de mine / Ceux qui n’écrivent que pour le pognon ce qui se voit tant c’est gratuit / Celui qui se vante de ce que sa vie est un polar et qui se fait buter pour le prouver / Celle qui peint des chevreuils dans des sous-bois et parfois des tulipes / Ceux qui ne savent plus que penser et ne pensent donc plus / Celui qui se replie sur le monde / Celle qui se déploie dans le hennissement primal / Ceux qui ne consomment plus pour mieux se consumer, etc.Image : Zdravko Mandic
-
Ceux dont la vie est ailleurs

Celui qui entre dans la grande pièce bleue où se trouve la femme aux yeux liquides / Celle qui voit le jeune homme entrer dans son rêve / Ceux qui rêvent qu’ils rêvent / Celui qui chevauche le tigre d’eau / Celle qui mesure la distance la séparant de l’issue fatale / Ceux qui se retrouvent sur le Pont aux Bustes / Celui qui jette une rose dans la fosse de neige et trouve cela si poétique qu’il en écrit un quatrain que sa mère apprécie / Celle qui déjoue les menés du Troll / Ceux qui sont persuadés d’être les seuls dont personne ne sait rien et qui en conçoivent un désir vif de paraître au TJ de Damien Rosebud / Celui qui se fait amputer (en rêve) d’un pied vu qu’il n’a qu’une chaussette / Celle qui raconte à son psy le rêve de la chaussette que fait son fils Adolf dit Dolfi, notoire antisémite de neuf ans / Ceux qui vont voir ailleurs si la vie y est / Celui qui rêve sa vie et se trouve tantôt à Rangoon et tantôt à Malmö selon les disponibilités d’EasyJet / Celle qui se retrouve sur la scène en tailleur strict et sans savoir son rôle alors que le souffleur mate sa gaine Scandale / Ceux qui comparent les baraquements de la nouvelle structure concentrationnaire de Palavas-les-flots et ceux des stalags où leurs grands-parents furent déportés en été 43 / Celui qui s’arrache à son rêve pour se rendre au cimetière où il découvre que la tombe de sa mère a été désaffectée entretemps / Celle qui s’adonne au divertissement sensuel en compagnie du baigneur bègue / Ceux qui ont été traumatisés par l’excessive sollicitude de Maman et sont devenus poètes pour lui échapper / Celui qui commente le Mariage du Siècle en se grattant les roustons qui ne se voient pas à la télé / Celle qui trouve que le voile de la mariée ferait une jolie moustiquaire dans son bidonville / Ceux qui cherchent à se donner un genre canaille dans le miroir de la chambre 13 de l’Hôtel Terminus où ils sont descendus en jumeaux pacsés / Celui qui met au point la théorie des poèmes qu’il écrira plus tard et que personne ne lira hélas même pas lui puisqu’il sera devenu imam entretemps / Celle qui lave les boxers de son fils qu’ont dit élu / Ceux qui savent que la Qualité se mesure avec un étalon de platine dont nul ne sait où le Troll l’a caché / Celui qui explique au jeune poète qu’il y a en lui une Force que seule Maman peut lui révéler à condition qu’il la lui présente / Ceux qui foutent les mères de jeunes poètes pour faire avancer la cause de l’avant-garde / Celui qui possède deux miroirs afin de voir aussi son double / Celle qui écrit une élégie sur le sable de la dune que le vent effacera ce soir ah ah / Ceux qui notent leur bons mots dans un cahier spécial / Celui qui a dit à son cousin qu’il avait un air démoniaque avant de l’emmener au concert d’Elton John qu’il reconnaît à l’instant à Westminster à côté de son mari / Celle qui connaît tous les noms et prénoms et surnoms des reines et des rois actuels qui se retrouvent à la télé ce matin pour le mariage des youngsters / Ceux qui se moquent des rois nègres mais que l’émotion étreint par la voix de Stéphane Bern ce matin historique au niveau mondial / Celui qui écrit un poème sur la mort pour se sentir immortel / Celle qui recopie les poèmes de son fils qu'elle enverra à une revue anglaise vu qu’ils font allusion au Mariage du 29 avril 2011 / Ceux qui reviendront en rêve dans les maisons de leurs amours mortes mais n’y retrouveront personne / Celui qu’on croit cynique parce qu’il montre les choses telles qu’elles sont / Celle qui se rappelle avec tendresse les sauteries avec Reiser tandis que la foule exulte devant Westminster à l’arrivée de la reine sapée en jaune canari / Ceux qui savent que la vie n’est ailleurs qu’ici mon fifi, etc.
Image JLK: Kate today
(Cette liste a été établie en marge de la lecture de La Vie est ailleurs de Milan Kundera, tout en matant l’événement du jour commenté par Stéphane le Blaireau) -
JLK se royaume

La Compagnie des mots reçoit JLK
Vivre, lire et écrire : mes passions partagées
À mes amis et aux amis de la littérature
Ce lundi 2 mai prochain, dès 18h30 et pour une heure environ, j’évoquerai, à l’invitation de La Compagnie des Mots, et en dialogue avec mon confrère Serge Bimpage, mon parcours d’écrivain, de critique littéraire, de journaliste et de passeur de livres. Vincent Aubert, comédien, et Antonin Moeri, écrivain, interviendront aussi par surprise.
Sous le titre de Vivre, lire et écrire, mes passions partagées, je vais m’efforcer de retracer, exemples chantés à l’appui, le parcours de plus de quarante ans d’écriture multiforme, sous les deux instances principales de l’implication poétique et de l’explication critique, ponctué par la publication de 18 livres (dont le dernier, L’Enfant prodigue, sera plus précisément commenté) et de milliers d’articles dont plus de 3000 figurent actuellement sur mon blog des Carnets de JLK. De l’intime à l’extime, du mystère de l’être cristallisé par les mots à la foison panoptique des langages contemporains, en passant par l’évocation de moult lectures, rencontres et pratique d’écriture: tel sera le chemin (raccourci) emprunté pour un soir.
Genève. À La Mère Royaume, dès 18h.30. Entrée libre.
Si vous me détestez, merci de recommander cette soirée à vos ennemis !
-
Abécédaire passionnel

Dès ces prochains jours nous ouvrirons, avec mon ami l'imagier Philip Seelen, un nouveau blog dont les images et les mots, en multiples rubriques, s'attacheront à la défense et à l'illustration de la Suisse des cultures multilingues, petite Europe dans l'Europe. Nous en ouvrons ici l'abécédaire de repérage, auquel chaque lecteur est invité à proposer de nouveaux mots
 En étrange pays, de A à Z
En étrange pays, de A à ZAbsinthe / Aletsch / Aline / Altdorf / Aloyse / Amiel / Ansermet / Aurigeno / Bahnhostrasse / Bakounine / Ballenberg / Bergier / Besson (Benno) / Betty Bossi / Birchermüesli / Blocher/ Böcklin / Bögli / Botta / Bouvier / Budry / Carnaval / Cendrars / Cenovis / Ceresole / CERN/ Cervin / CFF / Chillon / Cingria / Chappaz / Chessex / Cuisses-Dames / Dada / Davos / Dimitri / Dindo / Doyen Bridel / Dürrenmatt / Duttweiler / Eigerwand / Erasme / Erni / Ernst S. / Federer / FipFop / Franches Montagnes / Frisch /Geiger (Hermann) / Gilliard / Général Guisan / Génie helvétique (Le) / Giacometti / Gianadda / Gilles / Godard / Goetheanum / Gothard & Gothard / Gotthelf / Grounding / Grütli / Guillaume Tell / Grock / Güllen / Haldas / Heidi / Hesse / Hingis / Hirschhorn (Thomas) / Hodler / Honegger / Hornuss / Humbert-Droz / Keller / Journaux / Joyce / Jung / Klee / Koblet / Küng (Hans) / Kudelski / Lavater / Lénine / Palais fédéral / Le Parfait / Pipilotti / Landsgemeinde / Longines / Lötschental / Pestalozzi / Maggi / Maison d’Ailleurs / Monte Verita / Morgenstraich / Morisod / Murer (Fredi) / Muzot / Nains de jardin / Nessi (Alberto) / Nabokov / Nestlé / Niederdorf / NPCK / NZZ / Odéon / Opel & Ospel / Orelli & Orelli / Parachutes dorés / Piazza Grande / Pilet-Golaz / Pont du Diable / Ramuz / Rilke / Ritz / Rivaz / Römerholz / Rote Fabrik / Saurer / Schmid (Daniel) / Segantini / Sils-Maria / Soglio / Soutter / Sugus / Stress / Suter (Martin) / Tinguely / Tissot / Töpffer / Tuor (Leo) / Walser / Winkelried / Wölffli / Ziegler / Zoccoli / Zorn / Zouc.

-
Soleil de chair
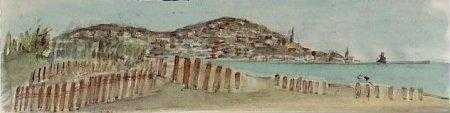
Du sexe moite à l'insoutenable légèreté de nos corps...Au Cap d’Agde, Cité du soleil, ce samedi 20 mai 2006. – La publicité polychrome annonce un intense sentiment de liberté, et sans doute est-ce ce que les gens ressentent en ces lieux de nature naturiste, loin de leurs bureaux et de leurs travaux, en cette Cité du soleil à l’architecture à la fois futuriste et décatie dont l’hémicycle de béton alvéolaire s’ouvre sur la mer fluente, l’anse de sable des dunes de Sète à l'est et à l’ouest la marina.
 Pour ma part, cependant, je ne pense ici qu’à travailler un peu plus, ou plus précisément à ne faire que ce qui me chante, sur le manuscrit en chantier de mon roman et tout ce qui l’alimentera d’une manière ou de l’autre, de lectures en balades avec Lady L. ou de rencontres en séances d’aquarelle. Belle liberté aussi bien, et non moins intense, que celle de disposer de chaque seconde pour en faire quelque chose…
Pour ma part, cependant, je ne pense ici qu’à travailler un peu plus, ou plus précisément à ne faire que ce qui me chante, sur le manuscrit en chantier de mon roman et tout ce qui l’alimentera d’une manière ou de l’autre, de lectures en balades avec Lady L. ou de rencontres en séances d’aquarelle. Belle liberté aussi bien, et non moins intense, que celle de disposer de chaque seconde pour en faire quelque chose… Héliopolis, ce 26 avril 2011. - Dix-sept ans après nous nous retrouvons comme tant de fois en ces lieux avec Lady L., nos filles nous ont appelé ce matin de Phuket et de Bruxelles, j'ai publié dix livres après Le viol de l'ange sur lequel je travaillais à l'époque, et ma bonne amie se repose de travaux autrement sérieux et exténuants que les miens...
Héliopolis, ce 26 avril 2011. - Dix-sept ans après nous nous retrouvons comme tant de fois en ces lieux avec Lady L., nos filles nous ont appelé ce matin de Phuket et de Bruxelles, j'ai publié dix livres après Le viol de l'ange sur lequel je travaillais à l'époque, et ma bonne amie se repose de travaux autrement sérieux et exténuants que les miens...À propos de bonne amie, je lisais l'autre jour, dans le livre récemment paru de Bernard Pivot, Les mots de ma vie, la page qu'il consacre gentiment à l'usage que je fais, dans mes Riches Heures, de cette expression, (à la rubrique Amie, p.27), et j'ai beaucoup aimé aussi sa célébration de l'Admiration, trop peu pratiquée aujourd'hui et que j'éprouve au plus haut degré en me replongeant dans l'oeuvre de Milan Kundera.
 Je viens ainsi d'achever coup sur coup la (re) lecture de Risibles amours et de La Plaisanterie, parus il y a plus de quarante ans de ça. Mais ça nous rajeunit, me dis-je en redécouvrant l'extraordinaire densité existentielle et la beauté de ces livres, dont le caractère politique s'est à la fois estompé (ils parurent au lendemain du printemps de Prague et furent bientôt interdits) et étendu à tout le phénomène qu'on désigne aujourd'hui sous l'appellation de politiquement correct, et à toute forme de conformisme social. Mais bien plus que de sociologie ou de politique, ces romans parlent de la vie tragique et risible, La Plaisanterie est une tragi-comédie aussi déchirante que drôle, et avec la distance sa beauté poétique, la tendresse jamais mielleuse qui se dégage du regard porté par l'auteur sur tous ses personnages se communique plus que jamais au lecteur, et c'est notre propre jeunesse que nous retrouvons aussi bien sans amertume, comme dans une lumière de pardon stoïque.
Je viens ainsi d'achever coup sur coup la (re) lecture de Risibles amours et de La Plaisanterie, parus il y a plus de quarante ans de ça. Mais ça nous rajeunit, me dis-je en redécouvrant l'extraordinaire densité existentielle et la beauté de ces livres, dont le caractère politique s'est à la fois estompé (ils parurent au lendemain du printemps de Prague et furent bientôt interdits) et étendu à tout le phénomène qu'on désigne aujourd'hui sous l'appellation de politiquement correct, et à toute forme de conformisme social. Mais bien plus que de sociologie ou de politique, ces romans parlent de la vie tragique et risible, La Plaisanterie est une tragi-comédie aussi déchirante que drôle, et avec la distance sa beauté poétique, la tendresse jamais mielleuse qui se dégage du regard porté par l'auteur sur tous ses personnages se communique plus que jamais au lecteur, et c'est notre propre jeunesse que nous retrouvons aussi bien sans amertume, comme dans une lumière de pardon stoïque. Or c'est le même regard que nous portons, Lady L. et moi, sur l'environnement de cette splendide et dérisoire Héliopolis où nous revenons depuis trente ans pour la seule mer, et les dunes, et la sensation de s'en foutre en vivant à poil ou sous le textile, comme on veut, mais que de nouvelles hordes bizarres ont investie et qui, avec leur fric fort apprécié on s'en doute, ont imposé un nouveau code de conduite sur les plages, au dam des naturistes de la vieille école plutôt pudique (sic), en pratiquant le sexe de groupe à vue,sur le sable ou dans les clubs plus fermés.
Or c'est le même regard que nous portons, Lady L. et moi, sur l'environnement de cette splendide et dérisoire Héliopolis où nous revenons depuis trente ans pour la seule mer, et les dunes, et la sensation de s'en foutre en vivant à poil ou sous le textile, comme on veut, mais que de nouvelles hordes bizarres ont investie et qui, avec leur fric fort apprécié on s'en doute, ont imposé un nouveau code de conduite sur les plages, au dam des naturistes de la vieille école plutôt pudique (sic), en pratiquant le sexe de groupe à vue,sur le sable ou dans les clubs plus fermés.Cette nouvelle population, genre classe moyenne entre 35 et 75 ans, se désigne elle-même par l'appellation de libertins et a fait se développer, au coeur de la cité solaire, de nouveaux hôtels à murs borgnes et boîtes chaudes, et tout un système de boutiques où se débitent les atours et colifichets dont ces braves gens se parent comme de coquets papous à breloques, piercings et résilles, falbalas et pacotille.
Michel Houellebecq a commencé de décrire cette faune dans Les particules élémentaires, mais le phénomène a pris de l'ampleur et l'on est juste content de se trouver en ces lieux en avril et pas au plus moite de l'été où les corps bandochants et ballottants, tous pommadés d'huiles enrichies de carotène, se multiplient et se collent comme sardines en leur caque...
 Bref, la lecture et l'écriture, ou la sensualité plus délicate et multiforme (ah les délices de l'anchois frais slurpé avec un doigt de Corbières !) nous tiennent heureusement à distance de ce grouillement qui nous semble à vrai dire plus grotesquement rigolo, à la longue, que réellement dégoûtant.
Bref, la lecture et l'écriture, ou la sensualité plus délicate et multiforme (ah les délices de l'anchois frais slurpé avec un doigt de Corbières !) nous tiennent heureusement à distance de ce grouillement qui nous semble à vrai dire plus grotesquement rigolo, à la longue, que réellement dégoûtant.Allons, un Reiser y trouverait un regain d'observations qui ramènerait la chose à sa dimension résumée par l'adage teuton: Jedem Tierchen sein Plaisirchen - à chaque bestiole sa babiole...
-
Dans la farine
J’ai toujours aimé ses bras roses. Roses potelés. De porcelaine humide, genre Sèvres mou. Ses bras roses et ses seins de laitière.
Quand elle me roule dans la farine et qu’elle se penche au-dessus de moi, ses deux seins pressés l’un contre l’autre suffisent à ma paix.
Père lui recommande de ne pas oublier le sel, que je sois un homme nom de Dieu. Mère lui reproche de mettre trop de sa salive, mais elle n’en fera toujours qu’à sa tête et la voici qui tire la langue dès que Mère s’en va voir ailleurs si j’y suis.
Vient alors le jeu des trois nénés, vite en douce, qui me fait tant plaisir. Ma tête entre les deux choses chaudes, nous ne formons plus qu’un, et tout à l’heure le lait me viendra sûrement à la bouche.Dessin de Federico Fellini
-
Le charme de Delerm

Avec Le trottoir au soleil, le pointilliste des sensations laisse filtrer un peu de mélancolie...
Si le nom de Philippe Delerm reste associé au succès phénoménal de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (L’Arpenteur, 1997), qu’une certaine mode minimaliste genre « nouvelle cuisine » a fait dépasser le million d’exemplaires et se voir traduit en plus de trente langues, son retour au genre du morceau de prose impressionniste ne saurait faire suspecter l’auteur d’exploiter un filon. On a pu trouver, certes, une certaine complaisance répétitive dans le recueil de Dickens, barbe à papa et autres nourritures, mais ce nouveau livre va nettement au-delà de la miniature trop joliment ciselée, pour déployer des esquisses de gravures et des ébauches de nouvelles qui ont le charme, voilé de mélancolie, de paysages contemplés à la brune ou de la fenêtre d’un train, frottés d’un peu de mélancolie.
« Rester solaire » avec les mots donne cependant le ton à ce recueil, qui suggère cependant que « l’essentiel est dans l’ombre, le mystère, le cheminement nocturne ». Par ailleurs, se demande l’auteur, « comment être solaire quand l’humanité souffre partout ». Et de répondre que, si « constater, dénoncer sont des tâches essentielles », le fait de « dire qu’autre chose est possible, ici », est également vital pour le couple de l’écrivain et du lecteur.
Comme une suite de fugues à variations, ponctuées de phrases indiquant un nouveau motif musical (Il y a les regardants… Je suis assis sur un banc… On dit de quelqu’un… Je continue à m’approcher), Philip Delerm module une soixantaine de « minutes heureuses » où il est question de « persistants lilas », d’un « espace de nonchalance » à Burano, d’un mariage où l’on se réjouit de n’être pas invité, du « sahara au ras du sol » d’une plage, de la séduction moelleuse du fumeur de pipe ou de l’envie des vieux enfants de « redoubler », qu’une phrase de l’auteur resitue dans le temps qui passe : « À soixante ans, on a franchi depuis longtemps le solstice d’été », et le soleil sur le trottoir n’en est que plus réconfortant…
Philippe Delerm. Le trottoir au soleil. Gallimard, 180p.Image: Philip Seelen
-
Le rêveur éveillé
Thierry Vernet, peintreLe bouquet diurne. Huile sur toile, 65x54cm, 1990.
C’est un nouveau bonheur, après la découverte de la correspondance étincelante de Thierry Vernet, que de se replonger, par le truchement d’un beau texte dense et limpide du poète et historien d’art Jan Laurens Siesling, et un large aperçu des peintures de l’artiste, fort bien reproduites, dans l’espèce de rêve éveillé, et souvent enchanté, de ce peintre si original et si injustement méconnu. Le mérite de Jan Laurens Siesling et d’y introduire sans verbiage, avec modestie et délicatesse, la bonne distance de l'oeil extérieur, la ferveur mais aussi la compécente, en resituant pourtant avec précision l’artiste genevois établi à Paris, de sa formation peu académique à son grand voyage avec Nicolas Bouvier, avant une vie entière consacrée, aux côtés de Floristella Stephani, artiste elle aussi, à la seule peinture. Défendu par quelques galeristes, et surtout, les vingt dernières années de sa vie, par le couple de Plexus, à Chexbres (Vaud, Suisse), Barbara et Richard Aeschlimann, qui ont recueilli l’œuvre, Thierry Vernet aura vécu comme un franciscain, sans jamais en concevoir d’aigreur. Les dernières peintures qu’il eut encore la force de brosser, au stade final du cancer, n’expriment d’ailleurs qu’une sorte de psaume de reconnaissance, avec ce voile de mélancolie rêveuse qui flotte cependant sur toute l’œuvre. Au commentaire souvent éclairant de jan laurens Siesling, je reviendrai sous peu. Dans l’immédiat, cependant, ce sont les toiles de Thierry Vernet qui parleront ici, dont je m’impatiente de partager plus amplement la passion…
Jan Laurens Siesling. Thierry Vernet, peintre. Avant-propos de RichardAeschlimann. Plexus/Editions d’art Somogy, 145p.Jardin nocturne à Savona. Huile sur toile, 59x65cm, 1987.
-
L’alphabet mystérieux
« Je suis ce petit aveugle conduit par une main inconnue, venu contempler un moineau dans les jets d’encre des bambous ».
Yves Leclair, Manuel de contemplation en montagne, La Table Ronde, 2005JLK: L'oiseau petit. Aquarelle, 2006.
-
L'aura de ce jour

Le jour est bien levé et lavé maintenant, ce matin de Pâques et du retour à ce qu’on dit les beaux jours, pleins de fiel et de sang. Un fond de bleus et de bruns terreux, travaillés par les années, un fond de verts et de terres à lents glacis, un fond de litanies en mineur, un fond de douleurs ravalées et d’incompréhensible gaieté tisse la page de plus qui se déploie à l’instant et nous écrit.
La page qui nous écrit, dès cette aube que vous croyez pure, est irradiée et mortellement avariée à ce qu’il semble. La tentation serait alors de conclure qu’il n’y a plus rien : que rien ne vaut plus la peine, que tout est trop gâté et gâché, que tout est trop lourd, que tout est tombé trop bas, que tout est trop encombré.
On cherche quelqu’un à qui parler mais personne à ce qu’il semble, on regarde autour de soi mais personne que la foule, on dit encore quelque chose mais pas un écho, on se tait alors, on se tait tout à fait, on fait le vide, on fait le vide complet et c’est alors, seulement – seulement alors qu’on se trouve prêt, peut-être, à entendre le chant du monde.
Ainsi le prêchi-prêcheur de ce matin le dit-il, en vérité il le leur dit, aux mères du monde dans lequel nous vivons : qu’elles n’aient aucun regret, car ce qui leur reste de meilleur n’est pas que du passé, ce qui les fait vivre est ce qui vit en elles de ce passé qui ne passera jamais tant qu’elles vivront, et quand elles ne vivront plus leurs enfants se rappelleront ce peu d’elles qui fut l’étincelle de leur présent – ce feu d’elles qui nous éclaire à présent, et la lumière de tout ça, la lumière sans nom de tout ça – la lumière témoignera.
Une fois de plus, à l’instant, voici donc l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’été bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage absolument immobile sur le lac bleu soyeux, l’émouvante beauté de ce que voit mieux que nous l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...
Le feu ne cesse pas d’être le feu de très longue mémoire. Bien avant leur naissance ils le portaient de maison en maison, le premier levé en portait le brasero par les hameaux et les villages, de foyer en foyer, tous le recevaient, ceux qu’on aimait et ceux qu’on n’aimait pas, ainsi la vie passait-elle avec la guerre, dans le temps…
Trop souvent, cependant, nous avons négligé le feu. Ce qui nous était naturel, la poésie élémentaire de la vie et la philosophie élémentaire, autant dire : l’art élémentaire de la vie dont le premier geste a toujours été et sera toujours d’allumer le feu et de le garder en vie – cela s’est trop souvent perdu.
Or nous croyons le plus souvent que les silencieux se taisent à jamais. Mais s’ils entendaient encore, ce matin, qu’en savons-nous après tout : s’ils entendaient encore cette polyphonie des matinées qu’ils nous ont fait écouter à travers les années, s’ils entendaient ces voix qui nous restent d’eux ?
Ce matin encore, imaginairement descendu par les villages aux villes, je les entends par les rues vibrantes d’appels et de répons : repasse le vitrier sous les fenêtres de nos aïeux citadins, dans le temps certes, certes il y a bien du temps de ça, mais je l’entends encore par la voix des silencieux et les filles sourient toujours aux sifflets des ouvriers des vieux films du muet – et si leurs tombes restaient ouvertes aux mélodies ?
Tous ils semblent l’avoir oublié, ou peut-être que non, au fond, comme on dit, puisque tous les matins il t’en revient des voix, et de plus en plus claires on dirait, des voix anciennes, autour des fontaines ou au fond des bois, vers les entrepôts ou dans les allées sablées des palmeraies – des voix qui allaient et revenaient, déjà, dans les vallées repliées de ta mémoire et la mémoire de tous te rappelant d’autres histoires, et revenant chaque matin de ces pays au tien – tu le vois bien, que tu n’es pas seul ni loin de tous…
Tout nous échappe de plus en plus, avions-nous pensé, mais c’est aujourd’hui de moins en moins qu’il faut dire puisque tout est plus clair d’approcher le mystère prochain, tout est plus beau d’apparaître pour la dernière fois peut-être – vous vous dites parfois qu’il ne restera de tout ça que des mots sans suite, mais avec les mots les choses vous reviennent et leur murmure d’eau sourde sous les herbes, les mots affluent et refluent comme la foule à la marée des rues du matin et du soir – et les images se déplient et se déploient comme autant de reflets des choses réelles qui viennent et reviennent à chaque déroulé du jour dans son aura.(Ce texte constitue la dernière page de L'Enfant prodigue, achevé à la veille de Pâques 2010)
-
Télévangile
…Frères et sœurs, le Seigneur, dans nos vies, est comme le carburant du véhicule engagé dans la grande montée de chaque jour, le Seigneur est le câble qui tracte le funiculaire de la station Plaine de notre vie quotidienne à la station Ciel, le Seigneur est notre Elevator, frères et sœurs - mais n’oubliez pas de recharger vos batteries nom de Dieu et de payer votre ticket…
Image : Philip Seelen
-
Une visite à Guido Ceronetti
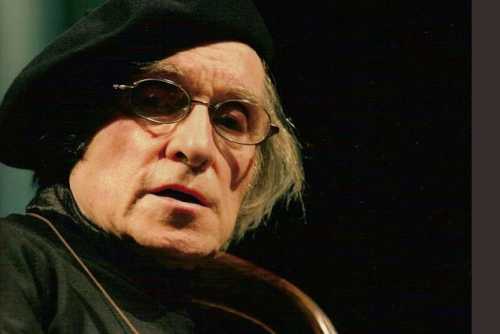
Mezza notte a Chiusi, dopo l’incontro col Ceronetti, il 20 febbraio 2011) – Del Maestro mi rammenterò sempre quella visione del vecchio tutto piegato, perfetta immagine del uomo solo, « senza più carezze », cosi come diceva, assai patetico e ridendo anche quando gli dissi : « La vie est vache, comme disait Céline », e lui : « pauvres vaches, dont on invoque le nom en français, méritent-elle ça ?», et moi : « On peut dire aussi à la vie: vieux chameau », e lui : « Si dice ancora chameau oggi in francese ? », alors moi : « Si, lo dico io alla moglie : vieux chameau », et lui : « Ah, ah, ah… »
Nous venions alors de rentrer d’une balade sous la pluie, sur les dalles glissantes du petit bourg toscan, où il n’avait cessé de pester contre son « corps de chiotte » tout en évoquant un prochain «Festival des désespérés» qui va se tenir à Turin au prochain solstice d’été, selon son exigence précise et où diverses « performances » seront proposées à la seule gloire du Désespoir. Or, comme je lui demandais des nouvelles de son fameux Teatro dei Sensibili, compagnie de marionnettes qu’il fonda avec sa femme, de me laisser entendre qu’il survit, notamment avec une tournée récente des Mystères de Londres, de sa composition, et lui survivrait encore sous sa haute protection posthume, certaines dispositions ayant d’ores et déjà été prises avec quelques instances supérieures, influentes « de l’autre côté »…
Cinq heures plus tôt, nous nous étions pointés, avec la Professorella, mon amie Anne-Marie - parfaite italophone et ferrée en hermétisme, avec laquelle le Maestro était déjà en contact par le truchement de notre ami commun l’assassin érudit Fabio C. -, à la porte de son repaire plus ou moins secret de Cetona, assez vaste logis aux pièces hautes de plafond, tout dévolu aux livres et à l’étude, aux murs ornés de nombreux collages et de gravures, de photos de théâtre et de portraits de belles femmes, où les divers lieux d’écriture (du bureau à l’écritoire pour station debout, en passant par l’établi d’artiste aux centaines de petites bouteilles d’encre de Chine) rappellent assez éloquemment le type de composition simultanéiste et comparatiste du poète-philologue en son savant patchwork philosophique et littéraire…
C’est cependant dans la minuscule cuisine que nous nous sommes repliés pour l’entretien à proprement parler, qui a duré plus d’une heure et demie et au cours duquel l’écrivain m’a dit pas mal de choses intéressantes sans répondre trop précisément à mes questions, mais brodant à sa façon sur les thèmes qui le préoccupent aujourd’hui, à savoir la vieillesse, la déchéance du corps, l’indignité de l’optimisme de commande, ou plus précisément le refus, par les autres, de la réalité de la souffrance et de toute conversation portant sur la mort.
À propos d’Insetti senza frontiere, sur quoi je le lance pour commencer l’entretien, Ceronetti précise immédiatement qu’il s’agit là d’un livre de vieillesse.
« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est en somme un livre de vieillesse, qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»
Comme on s’en doute, le dernier livre de Guido Ceronetti, pas plus que les précédents, ne se réduit à des lamentations personnelles sur le vieillissement. Bien plutôt, c’est un recueil tonique, nourri d’une vie d’expériences multiples et de lectures, d’observations sur le « cruel XXe siècle » et de vues radicales sur le présent où le Mal – figure omniprésente de l’œuvre – ne cesse de courir et de « travailler »…
Ensuite, la conversation s’est poursuivie, au fil de laquelle nous avons parlé de sa vision du monde dualiste, qui l’apparie au catharisme et à sa perception du Mal, il nous a raconté son séjour en clinique et les deux nouveaux livres qu’il en a tirés – dont un roman à paraître, intitulé Dans un amour heureux -, puis nous avons parlé plus en détail des genres divers qu’il a traités , de la chronique polémique au récit de voyage, ou de la poésie et de l’essai fragmentaire, et de son besoin de décrire la réalité plus que de parler de lui-même.
Visiblement fatigué, après une heure et demie de conversation qu’il tenait à mener en français, l’écrivain m’a proposé de faire une pause, après quoi il a parlé encore un bon moment puis il nous a expliqué qu’il ne pourrait pas dîner avec nous, à cause d’une blessure buccale qui le chicane, et aussi du fait de ses restrictions diététiques sévères, tout en nous priant de l’accompagner pour « une bonne marche ». Nous avons donc fait un tour sous la pluie, jusqu’à l’hospice de vieillards où il espère ne pas finir ses jours, nous sommes allés réserver deux places à la trattoria voisine et l’avons raccompagné jusque chez lui, étant entendu qu’il nous rappellerait vers dix heures du soir pour prendre congé de nous et nous faire quelques dédidaces.
De retour auprès de lui, après le repas, nous l’avons retrouvé assez plaintif, s’estimant le plus seul des hommes, il a tenté d’embrigader Anne-Marie pour lui faire faire sa vaisselle, j’ai fini par le convaincre de se laisser photographier - ce qu’il a accepté à condition qu’on ne voie pas sa « courbure » -, enfin il a signé les livres que nous lui avons présentés, me dédiant plus précisément l’aphorisme 67 d’ Insetti senza frontiere, que je recopie à l’instant : « Nulla, nessuna forza può rompere une fragilità infinita »… -
La Suisse à la retirette

Dans la collection Découvertes de Gallimard, François Walter propose d’aller «au-delà du paysage» de notre pays. Un aperçu critique intéressant mais qui reste incroyablement hors-sol, sans Federer, Freysinger, Alinghi, Blocher, Bouvier, le Montreux Jazz Festival, le nouveau cinéma suisse, etc.
À en croire François Walter, professeur d’histoire à l’Université de Genève, la Suisse, souvent réduite par les étrangers à quelques clichés simplistes, n’aurait pas son pareil pour entretenir elle-même les mythes et les images qui lui permettent de se «vendre» tout en consolidant sa prospérité. Le joli petit ouvrage très illustré qu’il vient de publier aux éditions Gallimard, dans la collection Découvertes, entend montrer une Suisse bien plus complexe, et intéressante, en démythifiant son histoire et en exposant ses contradictions persistantes.
- Est-ce vous qui avez eu l’idée de ce livre ?
- Pas exactement. Sans doute, la Suisse me passionne, dont j’enseigne l’histoire à l’Université de Genève et à laquelle j’ai déjà consacré cinq volumes. Or c’est sur la base de ce travail que la directrice de la collection Découvertes, Elisabeth de Farcy, m’a proposé de présenter notre pays qui reste un peu mystérieux et compliqué aux yeux des Français.
- La forme de la collection a-t-elle été une contrainte ?
- Certainement, car je suis habitué à rédiger de longs textes selon mon goût. Ici, il fallait faire court et écrire en fonction de modules rigides. Le travail sur les colonnes explicatives marginales, ou les légendes des images, a donné lieu à maintes négociations. Les éditeurs étaient très demandeurs de mythes suisses dont j’aurais préféré me garder. C’est ainsi que la couverture avec le Cervin, qui ressemble terriblement aux affiches de l’UDC, les images-clichés de l’ouverture exaltant la Suisse touristique, ou l’insistance sur le personnage de Guillaume Tell, répondent à une demande.
- Vous avez insisté, à propos de votre précédent ouvrage, sur l’importance des « acteurs » de l’Histoire, alors que vous évoquez à peine Pestalozzi ou Dunant, et ne dites pas un mot de Christoph Blocher. Est-ce un choix ?
- L’éditeur m’a fait ce reproche en effet, et c’est pourquoi j’ai réintroduit quelques figures, comme celle de Necker. Mais je crois que ma réserve correspond à une certaine « pudeur » très suisse. Et puis, je voulais éviter de parler de personnages actuels qu’on aura peut-être oubliés dans dix ans. Par ailleurs, l’UDC apparaît à plusieurs reprises.
- Est-ce la même « pudeur » qui vous fait ignorer, en matière culturelle, un Nicolas Bouvier, alors que vous enseignez à Genève ? Et Denis de Rougemont ? Et Georges Haldas ? Et l’architecte Bernard Tschumi ?
- J’avais cité Bouvier dans une version antérieure, mais le texte a dû être coupé. Je comprends ce que ces omissions peuvent avoir de frustrant pour quelqu’un qui s’intéresse à la culture, mais j’avoue n’être pas très à l’aise dans ce domaine. J’ai d’ailleurs rajouté la double page sur le Salon du Livre de Genève, et la mention des fondations Paul Klee et Gianadda à la demande de l’éditeur.
- Mais comment ignorer l’écrivain Martin Suter qui vend des millions d’exemplaires dans une vingtaine de langues, ou le jeune cinéaste Jean-Stéphane Bron qui a documenté la politique suisse dans Le Génie helvétique ?
- Je comprends aussi cette objection. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai ajouté des textes critiques comme ceux de Peter Bichsel, Hugo Loetscher, Fritz Zorn ou Jean Starobinski dans les documents relatifs au « modèle suisse ». Je reconnais cependant quelque chose d’ambivalent dans la Suisse que je présente. D’une part, je défends l’image très positive d’un pays qui s’est développé dans un environnement difficile, et j’insiste sur sa réussite économique en évitant de sombrer dans l’auto-flagellation, mais je tiens aussi à montrer le caractère très « construit » des mythes qui, non sans schizophrénie, confortent des positions qui vont tantôt vers l’ouverture mais aussi, souvent, vers le repli frileux…
François Walter. La Suisse. Au-delà du paysage. Gallimard, coll. Découvertes, 127p.
La Suisse d’un prof qui freine à la montée…
Vingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…
La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».
Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.
S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !
 Le déni de la Suisse créative
Le déni de la Suisse créativeVingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…
La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».
Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.
S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !
Par défaut...
Début d'inventaire des créateurs suisses et autres produits du génie helvétique qui n'existent pas aux yeux de l'historien en sa tour d'ivoire: Benjamin Constant, Zep, Georges Haldas, Carl Gustav Jung, Robert Walser, Amiel, Albert Einstein, Louis Soutter, Grock, Zouc, le Cénovis, Bernard Tschumi, Daniel Schmid, Gottfried Duttweiler l'inventeur de la Migros, Nicolas Hayek l'inventeur de la Swatch, la Cinémathèque suisse, Michel Soutter, L'Ame soeur de Fredi M.Murer, les cubes Knorr, Roger Federer, Grounding de Michael Steiner, le Musée de l'art brut, la lutte à la culotte et le hornuss, les Festivals de Locarno, Paléo, Lucerne, Montreux, les recettes de Betty Bossi, etc, etc, etc.
Images: Guillaume Tell vu par Ferdinand Hodler et le Cervin vu par Oscar Kokoschka.
-
Ceux qui attendent leur tour
Celui qui n’aime pas se voir à la télé / Celle qui se noie dans la Marie Brizard / Ceux qui spéculent sur le cancer du pancréas de leur Boss / Celui qui évalue par écrit ceux qu’il fréquente / Celle qui aime se baigner nue / Ceux qui se sont réservé un vol orbital / Celui qui déchire le portrait de son père, et le recolle / Celle qui savoure le goût de son propre sang / Ceux qui rêvent de casser une manif / Celui qui se répète chaque matin devant sa glace qu’il n’est pas une fiote / Celle qui en veut à ceux qui la regardent et plus encore à ceux qui ne la regardent pas / Ceux qui aiment le tonnerre en montagne / Celui qui fume dans la voiture quand il a charge de l’enfant / Celle qui est sûre que Jean-Paul Sartre était un pédérasque / Ceux qui ponctuent leur discours de mots orduriers / Celle qui peint des nuages / Ceux qui se flattent de ne rien lire / Celui qui s’assume à tous les niveaux (dit-il) / Celle qui vit à 100 à l’heure (dit-elle) / Ceux qui sont de vrais battants (disent-ils) / Celui qui finit les verres des autres / Celle qui se targue de tout leur dire / Ceux qui rêvent de se faire un dealer / Celui qui dispose d’un destructeur de documents personnalisé / Celle qui combat les mauvaises odeurs du bureau / Ceux qui endurent tout en silence.
-
Du Violon au Paradis

Lecture en chemin (5). À Bâle avec Hélène Sturm et son premier roman, Pfff. D’un hôtel-couvent-prison à la Fondation Beyeler, de Segantini à Rothko.
Passer la nuit au violon est un épisode diversement apprécié selon les circonstances et selon qu’on parle au propre ou au figuré. Or j’en retiens ce soir l’attrait d’un discret voyeurisme dans cette ancienne cellule de couvent bâlois devenue ensuite cellule de prison et maintenant cellule d’hôtel sobrement chic, à l'enseigne du Violon précisément, d’où la vue plonge sur une cour intérieure aux fenêtres vis-à-vis ménageant de possibles scènes en phase avec la lecture du premier roman de l’Alsacienne Hélène Sturm, ironiquement intitulé Pfff et remarquable par son écriture hypersensible et hypersensuelle aussi.
La position légèrement décalée de Bâle, ville européenne s’il en est, germanique et francophile à la fois, chimiquement industrielle et catholique de mémoire, hautement cultivée et curieusement à la tangente du trend, convient à la lecture d’un roman très français par sa langue mais qui pourrait se vivre à Lisbonne ou à Vienne en Autriche, les relents de nazisme en moins, à Vienne en France ou à Bienne, ville de Robert Walser, enfin partout où la classe moyenne et le peuple cohabitent encore plus ou moins dans un habitus filtrant aujourd’hui toutes les nouveautés ou pseudos…
C’est un roman de rêverie et de circulations alternées, qu’on peut commencer de lire dans une brasserie aux bois lustrés et au silence nacré, comme au Violon l’après-midi, et poursuivre ensuite dans ce tram vert portant le numéro 6 et conduisant à la frontière française de Riehen où se trouve la Fondation d’art Beyeler et où se (re)découvre ces jours l’œuvre à la fois connue et méconnue de Giovanni Segantini mêlée de poésie cosmique et de lyrisme alpin, de symbolisme d’époque succédant à un réalisme de province, dans un climat d’intense vibration métaphysique. Mais j’y reviendrai une autre fois, car cet univers ne touche à celui d’Hélène Sturm que par la bande, et notamment par la muette présence de ce jeune berger dormant au-milieu de ses moutons qui m’a rappelé le touchant Walter Pergamine au « petites mains maigres » qu’on voit chercher sa voie dans le dédale de Pfff…
Hélène Sturm s’étonnera peut-être (peut-être même s’agacera) de me voir la comparer à un Jules Romains, et pourtant je vois une sorte d’unanimisme dans son roman dont tous les personnages communiquent entre eux ou semblent liés, ne serait-ce que par l’air qu’ils respirent en même temps, le macadam que foulent leurs NIKE de couleurs diverses, l’eau qu’ils boivent ou dont ils oignent les divers faces de leurs corps, enfin la lumière qui les caresse de toutes ses mains douces ou dures, les éclaire ou les sculpte, les suit jusqu’aux lieux qu’on appelle les lieux…
°°°
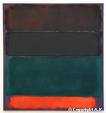 À Riehen, dans les espaces lumineux de la Fondation Beyeler, l’on peut se reposer dans la salle des Rothko où presque personne ne s’attarde de la considérable troupe de retraités en train de « faire Segantini », propice alors à la songerie en compagnie de Walter le turfiste et d’Odile la liseuse à culottes plus ou moins apparentes, de l’homo Chapoutet ressentant l’absence de son ami Jaboulier comme Bouvet souffrirait de celle de son Pécuchard, de l’équivoque Beaufils écoutant un CD de Gesualdo qu’il a gagné en achetant un livre sur Internet, de Yolande qu’on pressent d’emblée à la « place du mort » , enfin des paires possibles de ce casting et de tout ce qui se passe visiblement ou invisiblement dans ce dédale à la Escher où le pfff revêt toutes les nuances d’expression.
À Riehen, dans les espaces lumineux de la Fondation Beyeler, l’on peut se reposer dans la salle des Rothko où presque personne ne s’attarde de la considérable troupe de retraités en train de « faire Segantini », propice alors à la songerie en compagnie de Walter le turfiste et d’Odile la liseuse à culottes plus ou moins apparentes, de l’homo Chapoutet ressentant l’absence de son ami Jaboulier comme Bouvet souffrirait de celle de son Pécuchard, de l’équivoque Beaufils écoutant un CD de Gesualdo qu’il a gagné en achetant un livre sur Internet, de Yolande qu’on pressent d’emblée à la « place du mort » , enfin des paires possibles de ce casting et de tout ce qui se passe visiblement ou invisiblement dans ce dédale à la Escher où le pfff revêt toutes les nuances d’expression.On se rappelle, chemin faisant dans le livre, les phrases belles que module Hélène Sturm, avant de se perdre dans la contemplation d’un rouge Rothko vibrant comme un jaune Vermeer, et c’est par exemple « les mains de Legendre tombent dans un geste d’abandon de tableau ancien », ou bien « un bonheur inquiet rôde dans le square », ou encore « c’est à cause du lendemain matin que Walter a une difficulté certaine à commencer le soir une histoire d’amour », et l’on peut s’attarder au bar du Paradis, se poser des questions sur l’identité d’un tueur de chien, user d’une webcam comme un mouchard de poche : le roman ne se fera pas comme à la télé, par des images resucées et des situations rebattues, mais par les mots qui parlent de silence et de solitude, par les mots dont la musique suit un papier finement réglé.
°°°
De Bâle, et donc du Rhin très allant, à cent mètres du Violon, je me rappelle ce jeune méditant à grands cheveux, assis en lotus sur la fine barrière de fer surplombant le vide et répétant sourdement un OM semblant sourdre des sources du Souffle du monde, qu’on pourrait dire aussi les couilles du Fleuve. Ainsi du petit Walter d’Hélène Sturm se demandant comment un chevalier fait pour bander sous une armure – ceci pour signaler enfin l’omniprésent et très apollinien érotisme de ce délectable premier roman, à savourer tout lentement.
Hélène Sturm. Pfff. Editions Joëlle Losfeld, 233p.
Bâle. Hôtel-brasserie Au Violon. http://www.au-violon.com
Fondation Beyeler, Riehen. Exposition Giovanni Segantini, jusqu'au 25 avril.
-
La pioche

...Elle lui dit qu’il n’est plus tout à fait comme avant tout en piochant, alors il lui dit de ne pas se goinfrer comme ça, mais elle lui répond qu’elle ne prend pas de poids, elle, et lui se sent visé et lui demande ce qu’elle cherche et pour qui c’est ce maquillage voyant, et elle se sourit à elle-même en piochant sans répondre, et quand il lui demande ce qu’elle fait ce soir elle lui dit comme ça qu’elle va au cinéma, et lui: je pourrais savoir ce que tu vas voir ?Alors elle: on pourrait revoir L’Empire des sens, ça t’donnera peut-être des idées grand badadia, laisse-moi juste finir mon pop corn et c’est partout mon toutou…
Image : Philip Seelen -
Le soupçon
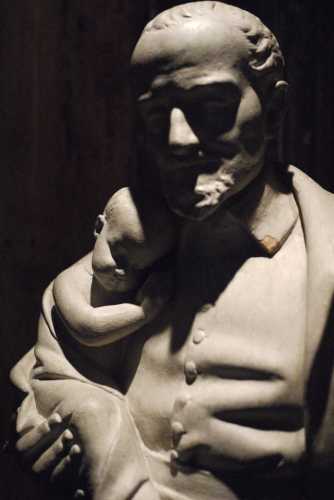
…Vous trouvez pas ça suspect, vous, ce vieux birbe avec le mouflet, ça vous rappelle rien, ça vous fait pas penser aux sorties d’écoles et tout ça, le nom d’Outreau ça vous fait pas froid dans le dos les boulangères, ou le nom de Dutroux, genre laissez venir à moi les petits enfants ça vous glace pas, les ménagères - non mais là je vous sens hésiter, vous, dites, c’est à se demander si vous auriez pas vous aussi des tendances et tout ça…
Image : Philip Seelen -
Narcisse océanique

À propos du crime abominable de masturbation, inventé en 1712. Onania & Co, ou l'exploitation d'une peur attisée aux fins de surveillance sociale et de petit commerce...
L’erreur de Narcisse, pour reprendre le titre d’un bel essai sublimatoire de Louis Lavelle, serait en somme de se concentrer sur son genou. Mais y a-t-il de quoi en faire une affaire ? À vrai dire, la chose fut un détail pendant des siècles et, curieusement, ne devint colossale que sous les Lumières, juste enfumées de smog moral anglais...
Il y a là de quoi réfléchir et réviser quelques préjugés: comment une fantaisie sensuelle devint LE sujet de l’opprobre et de la malédiction, une obsession pour beaucoup et le lieu du châtiment intime, le butoir du surveiller et punir. Michel Foucault a documenté la chose, qui prend aujourd’hui une nouvelle dimension par le truchement d’Internet et des webcams, foyers virtuels d’une sensualité océanique et du nouveau commerce privé de l’exhibition. Or ce qui m’intéresse là-dedans est le travail de la fiction. Pessoa parle des « fictions sociales » qui nous construisent pour ainsi dire en tant qu’individus reliés aux autres, dans un jeu relativiste à variables innombrables.
Pour en revenir au genou de Narcisse, précisément désigné par Caravage, la petite chose devient une vraie folie au début du XVIIIe (plus précisément en 1712, avec la parution d’Onania, écrit longtemps anonyme qui deviendra THE best-seller de l’époque et pour longtemps, avant L’Onanisme du Dr Samuel Auguste David Tissot), la médecine (ou pseudo-médecine) prend le relais pour focaliser la question de la liberté personnelle sur fond de pratique prétendue dangereuse pour la santé.
On croit trop souvent que l’Eglise est à la base de ce délire puritain. Or la vérité est beaucoup plus nuancée et complexe, qui s’articule autour de la démocratisation, pour la femme plus encore que pour l’homme, de la sensualité autonome, et de la crainte panique que cette nouvelle disposition de soi a engendrée.
Fait également très intéressant et significatif : que la montée en épingle du crime de «pollution de soi-même» est allé de pair avec la flambée du commerce des potions, onguents, recette charlatanesques de tout poil qui accompagnait la diffusion européenne de la brochure Onania, dont chaque nouvelle édition était augmentée de témoignages édifiants de victimes de la masturbation, genre: c’est tellement affreux qu’il faut que je vous raconte ça tout en détail, comme le sein de Janet Jackson dont on a fait aux States une affaire d’Etat en s’indignant saintement de son apparition pour l’exhiber à qui mieux-mieux, ainsi de suite.D’une façon plus «sérieuse», L’Onanisme du célébrissime Docteur lausannois, best-seller européen de la fin du XVIIIe, grattera la plaie avec la même délectation scientifique, plus tard devenue «morose» sous la plume de notre cher Amiel qui comptabilisera ses branlées à renfort de petites croix, en marge de son journal, avec la mention supplémentaire de « l’écharde », empruntée sauf erreur à l’apôtre Paul…
(En lisant Le sexe en solitaire; contribution à l'histoire culturelle de la sexualité, de Thomas Laqueur. Gallimard, coll. Essais, 512p.) -
À toute fin sensible

Lectures en chemin (7). À Solalex, pour lire Bref éloge de la fin de Frédéric Mairy.
L’azur de ce matin lustral appelait naturellement à monter vers les hauts gazons, et déjà je savais que ce livre serait accordé à la clarté nette du jour avec les angles vifs de son ironie et ses échappées rêveuses sur d’autres lectures. Aussi, le départ avec un Ramuz du soir qui salue l’aube de sa fille, ce Ramuz de Symétrie que Frédéric Mairy cite en ouverture de son Bref éloge de la fin, ne pouvait que me toucher puisque par deux fois, avec nos filles, j’aurai vécu ce qu’il dit alors même que, né en juin 1947, un mois après sa mort, je me sens un peu l’enfant auquel il s’adresse tout en me rappelant mon père lisant ses livres.
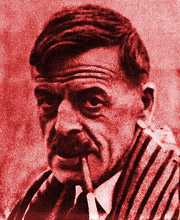 Or voici donc ce que dit Ramuz à sa fille dans Symétrie : « C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu ce grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillée. Et Frédéric Mairy de conclure : « Tenons-nous-le pour dit ». C’est cela : tenons-nous pour dit que tout recommence ce matin de fin d’hiver (la neige toujours là-haut sur l’arête de l’Argentine d’où vient de surgir le soleil éblouissant) alors que le printemps attiédi d’avril sent déjà l’été à mon premier arrêt à cette table de bois brut où j’entame pour de bon ma lecture avec la remarque de Paul Auster sur le baseball qui se joue sans horloge, donc comme hors du temps.
Or voici donc ce que dit Ramuz à sa fille dans Symétrie : « C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu ce grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillée. Et Frédéric Mairy de conclure : « Tenons-nous-le pour dit ». C’est cela : tenons-nous pour dit que tout recommence ce matin de fin d’hiver (la neige toujours là-haut sur l’arête de l’Argentine d’où vient de surgir le soleil éblouissant) alors que le printemps attiédi d’avril sent déjà l’été à mon premier arrêt à cette table de bois brut où j’entame pour de bon ma lecture avec la remarque de Paul Auster sur le baseball qui se joue sans horloge, donc comme hors du temps. °°°
 Tout aussitôt cela me rappelle les empreintes fossiles qu’on peut voir là-haut dans le calcaire, saisies par le temps au sommet de la vague de roche figée dans son élan multimillénaire, le long de la vire du Grand Miroir de l’Argentine dont le gaz nous grisait en crescendo dans l’enchaînement des gestes précis de la grimpe. J’avais alors moins de vingt ans et de la mort une conscience plutôt abstraite, je n’habitais pas encore le temps, j’arrivais toujours en retard, je ne pratiquais pas le football découpé selon l’horaire et je n’avais pas encore lu Paul Auster. Je m’nterrogeais bien un peu, alors, sur le Sens de l’Histoire, sans trop savoir ce que cela signifiait, et bien entendu je décriais absolument le capitalisme, mais c’est comme dans une boucle d’un temps retrouvé que, ce matin, je lis cette page que Frédéric Mairy consacre à Michel Vinaver, le patron et dramaturge anti-capitaliste, et à son mémorable Par-dessus bord, vu à La Chaux-de-Fonds en je ne sais plus quelle année, et que j’en arrive aujourd’hui à la même conclusion que Mairy en découvrant celle qu’il oppose à la prétendue fin de l’Histoire selon Fukuyama : « mon cul » !
Tout aussitôt cela me rappelle les empreintes fossiles qu’on peut voir là-haut dans le calcaire, saisies par le temps au sommet de la vague de roche figée dans son élan multimillénaire, le long de la vire du Grand Miroir de l’Argentine dont le gaz nous grisait en crescendo dans l’enchaînement des gestes précis de la grimpe. J’avais alors moins de vingt ans et de la mort une conscience plutôt abstraite, je n’habitais pas encore le temps, j’arrivais toujours en retard, je ne pratiquais pas le football découpé selon l’horaire et je n’avais pas encore lu Paul Auster. Je m’nterrogeais bien un peu, alors, sur le Sens de l’Histoire, sans trop savoir ce que cela signifiait, et bien entendu je décriais absolument le capitalisme, mais c’est comme dans une boucle d’un temps retrouvé que, ce matin, je lis cette page que Frédéric Mairy consacre à Michel Vinaver, le patron et dramaturge anti-capitaliste, et à son mémorable Par-dessus bord, vu à La Chaux-de-Fonds en je ne sais plus quelle année, et que j’en arrive aujourd’hui à la même conclusion que Mairy en découvrant celle qu’il oppose à la prétendue fin de l’Histoire selon Fukuyama : « mon cul » ! °°°
 De ma première station de tout à l’heure au lieudit Cergnement, où jadis se trouvait un tout petit chalet joli appelé Loin des méchants par ses habitants, jusqu’à l’alpage grand ouvert sous le ciel de Solalex, on suit une route de plus en plus étroite, qui longe la rivière en contrebas, et l’on dira, même si c’est un cliché, que l’alternance de la forêt de montagne et des clairières ou des prairies suspendues n’a rien perdu de l’idylle romantique célébrée par les peintres de, à commencer par les paysagistes genevois ou anglais, disons un Calame ou bien avant lui un Turner. Tout cela bel et bon, qu’on salue de sa plus tendre révérence rousseauiste, tout en se rappelant que Fukushima continue bel et bien l’Histoire au dam de Fukuyama, ou comme le résume un haïku cité par Frédéric Mairy : « Un monde / qui souffre / sous un manteau de fleurs »…
De ma première station de tout à l’heure au lieudit Cergnement, où jadis se trouvait un tout petit chalet joli appelé Loin des méchants par ses habitants, jusqu’à l’alpage grand ouvert sous le ciel de Solalex, on suit une route de plus en plus étroite, qui longe la rivière en contrebas, et l’on dira, même si c’est un cliché, que l’alternance de la forêt de montagne et des clairières ou des prairies suspendues n’a rien perdu de l’idylle romantique célébrée par les peintres de, à commencer par les paysagistes genevois ou anglais, disons un Calame ou bien avant lui un Turner. Tout cela bel et bon, qu’on salue de sa plus tendre révérence rousseauiste, tout en se rappelant que Fukushima continue bel et bien l’Histoire au dam de Fukuyama, ou comme le résume un haïku cité par Frédéric Mairy : « Un monde / qui souffre / sous un manteau de fleurs »… Mais s’il est entendu, Monsieur Schopenhauer, que le monde n’est pas un panorama, souffrez pour l’instant que je vous emmerde en clignant de l’œil au chamois de bois sculpté qui marque l’accès glorieux à l’immense pré de Solalex surmonté par les miroirs tant contemplés en notre narcissique jeunesse.
°°°
 Frédéric Mairy a le sens de la pointe, du double point de vue de la perception et de l’expression : le sens du détail révélateur, et l’on pense à la fois à Philippe Delerm, en plus ténu, et à Nicolas Bouvier, qu’il cite précisément à propos des « Souvenirs, souvenirs » qui nous rappellent à la fois le Johnny de nos quatorze ans et cette solennelle sentence de Michaux qu'il cite: «La mission de l’homme su terre est de se souvenir »… Okay, me dis-je alors à la terrasse déserte de l’auberge de montagne de feu le guide Gollut, survivant aujourd’hui à l’enseigne de «Chez Vera». Okay, Monsieur Perec : je me souviens donc qu'à cette terrasse, un matin de mes seize ans, à l’été 1963, un chef scout parisien me parlait du Problème de la Masturbation en évoquant l’agitation des castors de sa patrouille. Ou je me souviens du vieil Anex, dans sa barbe de paille de fer, qui m’invita à partager son frichti à base de rôti de chamois, de l’autre côté de la rivière, dans son ermitage fameux où il avait reçu le roi des Belges incognito. Au physique, le personnage était la copie conforme, en tout cas à mes yeux, du farouche contrebandier portraituré par notre peintre préalpin Frédéric Rouge.
Frédéric Mairy a le sens de la pointe, du double point de vue de la perception et de l’expression : le sens du détail révélateur, et l’on pense à la fois à Philippe Delerm, en plus ténu, et à Nicolas Bouvier, qu’il cite précisément à propos des « Souvenirs, souvenirs » qui nous rappellent à la fois le Johnny de nos quatorze ans et cette solennelle sentence de Michaux qu'il cite: «La mission de l’homme su terre est de se souvenir »… Okay, me dis-je alors à la terrasse déserte de l’auberge de montagne de feu le guide Gollut, survivant aujourd’hui à l’enseigne de «Chez Vera». Okay, Monsieur Perec : je me souviens donc qu'à cette terrasse, un matin de mes seize ans, à l’été 1963, un chef scout parisien me parlait du Problème de la Masturbation en évoquant l’agitation des castors de sa patrouille. Ou je me souviens du vieil Anex, dans sa barbe de paille de fer, qui m’invita à partager son frichti à base de rôti de chamois, de l’autre côté de la rivière, dans son ermitage fameux où il avait reçu le roi des Belges incognito. Au physique, le personnage était la copie conforme, en tout cas à mes yeux, du farouche contrebandier portraituré par notre peintre préalpin Frédéric Rouge. 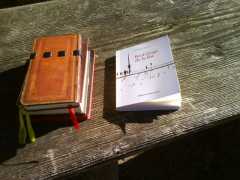 Ou je me souviens encore de cet épique épisode, que nous raconta, jeunes varappeurs, le guide nonagénaire Armand Veillon qui, un jour, sur l’arête du Cervin, vit soudain le chapeau de son client anglais s’envoler sous un coup de vent, puis remonter par un air ascendant et lui permettre ainsi de le restituer à son propriétaire, lequel se l’attacha pour le reste de son séjour…
Ou je me souviens encore de cet épique épisode, que nous raconta, jeunes varappeurs, le guide nonagénaire Armand Veillon qui, un jour, sur l’arête du Cervin, vit soudain le chapeau de son client anglais s’envoler sous un coup de vent, puis remonter par un air ascendant et lui permettre ainsi de le restituer à son propriétaire, lequel se l’attacha pour le reste de son séjour… Comique de ces chutes ! Mais Frédéric Mairy connaît aussi le charmes des temps intermédiaires, ainsi que l’illustre son morceau intitulé Sursis : « Déjà les volets sont fermés,les sols lavés, la voiture chargée. Ce soir on mangera dehors. Et demain, demain. Les vacances se terminent avec la dernière nuit ».
°°°
 Je me retrouve pour ma part à la terrasse de Vera, dont les volets sont encore fermés, où je m’étais dit tout à l’heure : pas un chat ! Juste avant que ne m’effleure celui-là, caresse de velours sous la table où le voici s’étirer dans sa fourrure écaille-de-tortue, lui aussi comme hors du temps dans la lumière de cette fin de matinée qui est déjà de l’après-midi. Tout finit aussi bien pour Anton Pavlovicth Tchékhov que son docteur allemand interroge et qui s’entend répondre, le verre de champagne à la main: « Ich sterbe ». Et de l’épisode, celui qu’on a appelé le Tchékhov américain, alias Raymond Carver, tirera une nouvelle, alors qu’il inspire ces mots à Nathalie Sarraute également cités ici : «Avec ces mots bien affilés, avec cette lame d’excellente fabrication, elle ne m’a jamais servi moi-même, je tranche : ich sterbe ». Et comment le dire en français : ciel je défunte, mon Dieu je m’en vais, diable je canne ?
Je me retrouve pour ma part à la terrasse de Vera, dont les volets sont encore fermés, où je m’étais dit tout à l’heure : pas un chat ! Juste avant que ne m’effleure celui-là, caresse de velours sous la table où le voici s’étirer dans sa fourrure écaille-de-tortue, lui aussi comme hors du temps dans la lumière de cette fin de matinée qui est déjà de l’après-midi. Tout finit aussi bien pour Anton Pavlovicth Tchékhov que son docteur allemand interroge et qui s’entend répondre, le verre de champagne à la main: « Ich sterbe ». Et de l’épisode, celui qu’on a appelé le Tchékhov américain, alias Raymond Carver, tirera une nouvelle, alors qu’il inspire ces mots à Nathalie Sarraute également cités ici : «Avec ces mots bien affilés, avec cette lame d’excellente fabrication, elle ne m’a jamais servi moi-même, je tranche : ich sterbe ». Et comment le dire en français : ciel je défunte, mon Dieu je m’en vais, diable je canne ? °°°
Le petit format de cette série des livres de Pascal Rebetez, est décrit par lui : format bréviaire, ce que la nonne prend aussi pour elle dans un repli secret, et toute dame dans sa poche kangourou, tout ouvrier dans sa poche revolver. Bref éloge de la fin est un livre fait avec d’autres livres, sans rien pour autant de resucé. Telle est la vraie lecture prodigue d’écriture tonique. Tel est le viatique…
Frédéric Mairy. Bref éloge de la fin. Editions d’autre part, 98p.
-
Au miroir de la Princesse de Clèves

Belle découverte au Festival Visions du réel : le premier film de Régis Sauder, à fort potentiel de succès public.
Une rumeur élogieuse précède l’arrivée d’un film effectivement passionnant, par son thème, et de très belle réalisation, signé Régis Sauder et intitulé Nous, Princesse de Clèves. Réalisé avec une dizaine de jeunes filles et garçons préparant leur bac dans un lycée de la banlieue de Marseille, ce premier « long » de Régis Sauder, présenté à Nyon dans la section « Etat d’esprit », impressionne par sa justesse de ton, son intelligence sans pédantisme et la sensibilité avec laquelle l’auteur film les lycéens, leurs profs et aussi les parents de certains d’entre eux.
La lecture en classe de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, présenté aux lycéens comme le premier chef-d’œuvre du roman français (« bof », entend-on d’avance sur le même ton de benêt blasé qui a fait dire à Nicolas Sarkozy que ce livre l'a fait bâiller d'ennui) qui est aussi une histoire d’amour (« ah bon ? ») nous concernant tous (« tiens donc !»), constitue le motif central du film. Mais rien de fastidieux dans cette approche où les jeunes lecteurs deviennent eux-mêmes acteurs de scènes dont ils ont mémorisé des fragments en rapport plus ou moins direct avec leur vie personnelle. Aurore, ainsi, se dit proche de la Princesse de Clèves parce qu’elle aussi a un ami attitré et « des tas de petits Nemours » qui lui tournent autour. Ou c’est Albert, le jeune homo-qui-s’assume, découvrant dans le roman les nuances distinguant la discrétion de l’hypocrisie.
Quoi de commun entre la vie galante à la cour du roi Henri II et la banlieue multiraciale où le film est tourné ? Une scène le suggère : celle où tel père musulman s’identifie à Madame de Chartres chaperonnant sa fille tentée par les plaisirs du monde… et la fille du moraliste de lever les yeux au ciel en avouant sa difficulté de parler de ce qu’elle vit réellement avec ses parents.
Si l’idée de Régis Sauder s’inscrit dans le sillage de L’Esquive, d’Abdellatif Kechiche, sa réalisation se distingue de cette «fiction » d’un Marivaux joué en banlieue parisienne grâce à son aperçu plus pénétrant du milieu social ambiant, l’empathie de son regard, et du fait aussi d’un travail de cinéaste accompli sur la «mise en scène» et le montage.
Dans la foulée, s’agissant de « cinéma du réel », un tel film est égalemnt l’occasion de se rappeler que la meilleure littérature, ou le grand art, sont aussi « réels », voire parfois plus, que notre réalité quotidienne. Cela montré sans peser, et avec beaucoup de tendresse.
Nyon. Festival Visions du réel. Nous, Princesse de Clèves, de Régis Sauder : Mardi 12 avril, au Théâtre de Marens, à 17h, et mercredi 13 avril, à la Salle communale, à 20h -
La glu

…Ce qui est pénible avec la chose, c’est quand elle coïncide non seulement avec l’appréhension de la chose (la perspective prochaine et inéluctable de rencontrer quelqu’un de collant) mais également avec la sensation physique de la chose (poignée de main fatale dans la moiteur de cette journée belge) et l’ennui de la chose (la réunion qui se prolongera à n’en plus finir avec une clim mal réglée), mais également le sentiment humiliant de la chose lié au fait que de cette raseuse ou de ce raseur dépend votre avancement dans les classes de salaires des fonctionnaires suppléants de l’Union Européenne…
Image : Philip Seelen -
Le tueur sans visage
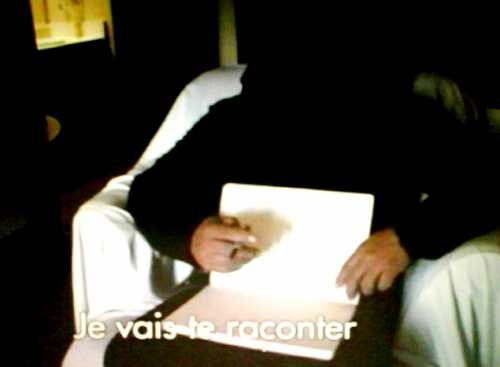
Découvert au festival Visions du réel : El Sicario, de Gianfranco Rosi. Le récit terrifiant d’un exécuteur des « narcos » mexicains.
Le sicaire, dénomination française « littéraire » du tueur à gage ou, antérieurement, de l’assassin (du mot latin sica désignant un poignard à lame recourbée), apparaît ici comme un homme au visage dissimulé par une voile noir, dans une chambre de motel de la zone frontière entre States et Mexique, où il a souvent « opéré », et qui s’y tiendra au fil d’une confession hallucinante durant laquelle il ne cesse d’illustrer ses propos par des dessins schématiques.
El sicario a été, durant une vingtaine d’années, l’exécuteur des basses œuvres de celui qu’il appelle El Padron, le patron qui est à la fois son père et son maître, son Dieu et son Diable et qui règne sur une fraction du cartel de la drogue. Le sicaire a été recruté très jeune, dans un lycée où les gens du cartel l’ont approché avec quatre autres jeunes gens, auxquels, après une fête, ils ont proposé de convoyer des voitures évidemment « chargées », destination El Paso. Trois ans après ces débuts, qui lui ont permis de se payer les seules Reebok du lycée, le garçon s’est retrouvé en fac et soudain confronté à un conseil de famille (treize personnes à la maison) qui a remis en cause son activité illicite subodorée par la mère, laquelle en est devenue malade. On le menace alors de l’envoyer à l’armée, ce qu’il esquive en entrant dans une école de police où ses « contacts » lui permettent d’entrer en dépit du fait qu’il est encore mineur et qu’il se drogue. Comme le lascar « assure » physiquement, il va donc accomplir sa formation de tueur dans le cadre de la police – ce qui n’est pas contradictoire puisqu’il nous a révélé, dès le début de sa confession, qu’un « narco » peut tout se payer : police, douaniers et tutti quanti. Initié de jour au tir, à la chasse aux narcos et à la psychologie criminelle, il fait le mur la nuit pour ses activités poursuivies de criminel aux ordres des narcos…
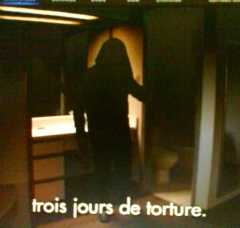 La dramaturgie du Sicario de Gianfranco Rosi est minimaliste, qui s’en tient au récit du sicaire, assis avec son bloc de dessins ou se levant parfois pout mimer une scène d’exécution. Des plans extérieurs alternent avec le récit, comme en contrepoint figurant les lieux évoqués.
La dramaturgie du Sicario de Gianfranco Rosi est minimaliste, qui s’en tient au récit du sicaire, assis avec son bloc de dessins ou se levant parfois pout mimer une scène d’exécution. Des plans extérieurs alternent avec le récit, comme en contrepoint figurant les lieux évoqués.Tout cela pourrait être monotone ou même assommant. Or nous suivons le récit minutieux du sicaire, à tout instant illustré par les dessins compulsifs du personnage, comme une espèce de roman sadien sur l’Obéissance absolue au Crime absolu symbolisé par El Padron. Les détails accumulés au fil du récit sont d’autant plus saisissants qu’ils sont exposés avec une sorte d’objectivité scrupuleuse, en vertu du Scrupule essentiel présidant à l’efficacité du professionnel engagé dans une structure de crime organisé. C’est valable pour les circonstances détaillées de la torture, dont rien ne nous est épargné, autant que pour les lois générales de l’Organisation.
Le récit du sicaire n’est pas, évidemment, une grande nouveauté du genre, mais le ton, la manière, le contraste vertigineux entre la précision toute calme, parfois presque didactique (dessins à l’appui) de son témoignage, et les abominations qu’il rapporte, donne un relief tout particulier à celui-là.
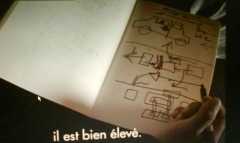 Et puis il y a le côté documentaire du document. Découvrir comment les écoles de police mexicaines forment de grands professionnels, dont une partie est déjà recrutée par les narcotrafiquants, est évidemment intéressant. Tout ce que raconte le sicaire sur les accointances entre le pouvoir, parfois au plus haut niveau, et le crime organisé, est également édifiant. Ainsi apprend-on l’existence d’innombrables maisons « sécurisées », surveillées par des policiers infiltrés, qui contiennent des centaines de séquestrés ou de cadavres…
Et puis il y a le côté documentaire du document. Découvrir comment les écoles de police mexicaines forment de grands professionnels, dont une partie est déjà recrutée par les narcotrafiquants, est évidemment intéressant. Tout ce que raconte le sicaire sur les accointances entre le pouvoir, parfois au plus haut niveau, et le crime organisé, est également édifiant. Ainsi apprend-on l’existence d’innombrables maisons « sécurisées », surveillées par des policiers infiltrés, qui contiennent des centaines de séquestrés ou de cadavres… Il faut préciser alors que le sicaire, quand il s’exprime devant la caméra, est un homme en cavale sur la tête duquel est fixé un contrat de 250.000 dollars. Après une période de doute et de prise de conscience, le tueur, en proie au cauchemar du souvenir, raconte comment il a été amené, après avoir été sauvé de justesse d’une exécution prévisible, à se retrouver dans un groupe d’évangélisation qui lui a fait connaître les transes de la foi partagée et de la prière collective, des larmes et du repentir véhément, préludant à sa rencontre finale avec Dieu, nouveau Patron auquel il s’est entièrement abandonné pour recommencer sa vie à zéro. Depuis 2008, plus de 8000 personnes ont été assassinées à Juarez, la ville la plus violente du monde…
El Sicario. Production France / USA. Gianfranco Rosi, d’après un article de Charles Bowden.
-
Ceux qui ont les pieds sur terre

Celui qui se dit sérieux et qui est en effet toujours à son affaire avec sa raie au milieu / Celle qui ne fera pas vraiment l'affaire vu qu’elle regarde plus souvent le ciel que le chef / Ceux qui pissent avec l’air de tenir le bon bout / Celui qui estime que l’Opel Rekord reste l’Opel Rekord /Celle qui te demande de justifier ton choix pour la fac de philo alors qu’il y a tant d’affamés au Sahel / Ceux qui vous demandent où vous en êtes avec Dieu et si vous retournez au Lavandou cet été / Celui que tu choques en lui avouant que ce que tu préfères est de te balader en forêt avec ton épouse légitime prénommée Fernande / Celle qui te regarde de travers parce que tu parles tout gentiment à son enfant dans le jardin public / Ceux qui affirment violemment que tout est violence / Celui qui se dit un vaurien sans cesser d’honorer son père et sa mère / Celle qui ne peut se déplacer autrement qu’en business class en tant que business battante / Ceux qui ont des business kids / Celui qui te dit comme ça que ses appuis faciaux constituent sa prière du matin / Celle qui veut faire de son fils Hector-Aurèle un battant pour en remontrer à son père le looser / Ceux qui font ostensiblement le signe de croix à la cafète pour bien marquer leur différence / Celui qui va manifester sa différence avec dix-sept mille gays néerlandais centre-gauche / Celle qui entend maintenir des contacts concrets avec la si belle jeunesse du Front / Ceux qui prient debout pour bien montrer à Dieu qu’Il peut compter sur eux / Celui qui prie debout et si possible près de la sortie / Celle qui prie debout pour éviter que ses bas ne filent / Ceux qui assument la réalité en tant que telle point barre (de chocolat) / Celui qui a passé des Thèses de Feueurbach au réveil créationniste en accumulant les pensions alimentaires / Celle qui croit en l’avenir de la BMW si possible avec intérieur tout cuir et quatre airbags / Ceux qui ont jeté leur soutane aux orties pour se lancer dans l’échangisme convivial / Celui qui suit les ordres de son intérêt comme ceux d’un GPS / Celle que son amour de la Vertu a limitée dans son exercice de la Charité avant de devenir l’assistante du curé qui lui a enseigné le lâcher-prise comme elle le confie sur Facebook à ses 233 amis sûrs / Ceux qui se sont cherchés sur Twitter mais se sont trouvés en banlieue de Sedan à un congrès de paléontologues agnostiques / Celui qui a un peu baissé dans l’analyse des situations géopolitiques mais garde un sacré coup d’archet dans l’orchestre des anciens Jeunes Paroissiens des Quartiers de l’Ouest / Celle qui apprécie surtout le côté gastro de la nouvelle culture / Ceux qui trouvent tout super pour éviter d’être remarqués, etc.
Image : Philip Seelen -
L'émotion aux rives de l'autisme


Ramòn Giger, dans son premier film, explore les chemins bordés d'abîmes de la relation avec Roman Dick.
Il n’a pas trente ans, il porte le nom d’un musicien mondialement connu dans le domaine du violon d’avant-garde, mais son premier film n’est en rien d’un « fils de», marqué par l’affirmation d’un regard et d’une qualité d’expression uniques. Nom : Giger, fils de Paul. Prénom : Ramòn. Prénom de l’autiste auquel il a consacré Eine ruhige Jacke : Roman.
Mais qui est donc Ramòn ? C’est ce qu’on se demande en découvrant le portrait en mouvement de Roman. En même temps que chacun se demande devant ce miroir vertigineusement proche et fuyant d’un film qui fait sentir beaucoup plus qu’il n’explique: et toi, Madame, Monsieur, qui es-tu ?
Ramòn Giger est né le 2 décembre 1982 dans un bled du canton d’Appenzell. Il a deux frères plus âgés que lui, d’un autre père, et une sœur adoptive de son âge. L’évocation de son enfance, dans une ferme bohème de la région de Wald, lui inspire un large sourire. Comme l’ « échange » scolaire qui lui a fait passer une année à Los Angeles où, grand diable, il a pu assouvir sa passion du basket. Auparavant, il avait nourri d’autres rêves d’enfant en rupture avec l’univers « artiste » de papa : dès six ans, celui de devenir fermier, ou encore pêcheur…
De retour des States, dont le séjour le mûrit, Ramon poursuivit ses études à Saint-Gall et dès l’an 2000 à Bâle, à l’école d’arts visuels. Voilà pour le cursus apparent, qui ne dit rien de tout un monde qu’on devine entre les lignes, ou plutôt entre les signes, du premier et seul film que Ramòn, fils d’Ursina, a tourné jusque-là. « Mais ce ne sera pas le dernier », sourit-il encore. Et d’évoquer son désir d’achopper à un portrait du père avec lequel, on le sent, les relations n’ont pas toujours été faciles, même s’il se dit très attaché à lui.
Quant à son ralliement au monde « artiste », il s’est opéré quand l’impératif de défendre sa patrie, à vingt ans, s’est transformé en période de service civil durant laquelle il a découvert l’univers de l’autisme dans une institution soleuroise spécialisée, fondée dans les années 60 à Roderis. C’est alors que Ramòn a rencontré Roman et que le thème de son film a germé du même coup.
Or Ramon est lui-même une partie du thème du film consacré à Roman. Et ce que nous découvrons à notre tour, en regardant Eine ruhige Jacke, est bien plus qu’un documentaire «sur l’autisme». Ce film traite en effet, d’une façon beaucoup plus large et profonde, de notre relation avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, avec la nature, avec ce que nous appelons la normalité et ce que beaucoup appellent encore les « anormaux ».
L’autisme pose, évidemment, la question de la communication : Roman, en effet, ne parle pas avec des mots. Et ça fait peur. Tout de suite, beaucoup seront tentés de trouver une explication causale rapide. Naguère on disait : sûrement la faute de la mère…
Tandis que Ramon, illico, pose la question du préjugé. Et ne se contente pas d’une réponse abstraite mais la vit « sur le terrain », en relation avec les autres. Le thérapeute-forestier Xaver Wirth (1953-2009) va jouer, alors, un rôle essentiel dans ce rapport vivant, intense, souvent poignant, avec le jeune autiste extrêmement présent à certains moments, ou semblant l’être. Participant lui-même au film, et filant tout à coup comme un lutin dans la forêt ou vers Dieu sait quel labyrinthe chaotique qu’il filme lui-même avec la caméra de Ramon. Pour aller où ? Et toi, Madame, Monsieur, tu vas où ?
Après les six mois de tournage du film (90 minutes de prises signées Ramon, 30 minutes signées Roman, 74 minutes au final), les deux compères ont fait ensemble un grand voyage. Très forte expérience, selon Ramon, qui commente très prudemment, cependant, la vraie nature de sa relation avec Roman. «Je pourrais appeler notre lien : confiance. Mais c’est un sentiment plus qu’un savoir… »
Un sentiment qui va de pair avec celui qui se dégage du film consacré par Ramon à Roman : que celui-ci n’est pas qu’un autiste mais, comme nous tous, Madame, Monsieur, une « personne totale »…
Dates de Ramon Giger
Naissance. 2 décembre 1982
1997-98 Séjour aux Etats-Unis.
2000 Installation à Bâle, qu’il dit désormais « sa » ville.
2004 Rencontre de Roman Dick
2007-2008 Tournage de Eine ruhige Jacke
Nyon. Visions du réel. Eine ruhige Jacke sera projeté, au Capitole 1, le 8 avril à 16h.30 et le 10 avril à 14h.30 en la même salle. -
Ceux qui chuchotent dans le noir
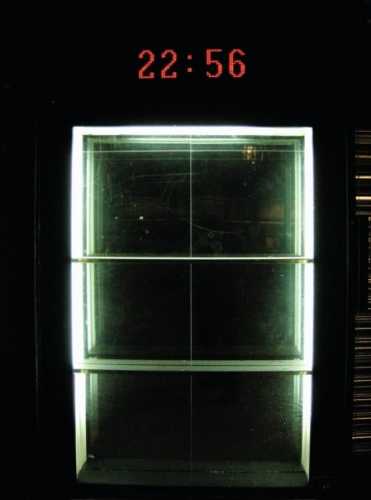
Celui qui n’a pas compris ce qu’elle disait pendant la chose la première fois juste après avoir vu Les Amours d’une blonde de Forman / Celle qui hennissait à cheval sur le facteur / Ceux qui épiaient les voix derrière la cloison du chalet / Celui qui se demande s’il était le même il y a trente-sept ans et comment le voit son fils de trente-sept ans qui lui ressemble si peu / Celle qui est travaillée par le retour d’âge sans savoir qu’y faire / Ceux qui sont toujours restés crispés sous leur air faussement rieur de retraités de la poste votant socialiste / Celui qui n’a jamais surmonté sa gêne au moment de se déshabiller et moins encore à l’époque où il avait une moustache à la Clark Gable censé le rendre irrésistible / Celle qui n’a connu qu’un type à dentier / Ceux qui ont regretté leur impréparation sexuelle alors que la moindre tribu nègre a réglé ce problème une fois pour toutes / Celui que l’activité sexuelle (selon leur expression) n’a jamais détourné de la véritable passion de sa vie pour les cactées / Celle qui pense que l’amour est une infinie variation sur un thème inconnu / Ceux qui sont parfois obsédés et parfois pas du tout ça dépend des saisons / Celui qui échappe aux propositions de son ancienne amante par des propos enthousiastes sur les éoliennes / Celle que le mot coït fait grimacer alors que le mot étreinte la fait soupirer d’aise / Ceux dont les enfants surveillent les ébats et les débats / Celui qui se tance pour ses pensées inappropriées / Celle qui s’abandonne enfin au flûtiste à traversière / Ceux que leur ancienne odeur enivre soudain dans le tea-room banal / Celui qui n’a jamais connu les tourments de la jalousie vu qu’il n’a aimé que son mainate Alfred mort sans descendance hélas / Celle que la jalousie a aidée à rester jeune / Ceux que le beau Docteur Slaughter a fascinés ou exaspérés (on remarque que celles qui ont été fascinées sont masculinisées par la grammaire à papa alors que seule l’infirmière Duflon avait la type virago) ou encore laissés indifférents (on constate que seuls les hommes ont été exaspérés ou sont restés indifférents au charme du Docteur Slaughter en effet dénué de tout attrait féminin en dépit de ses yeux bleu myosotis / Celui qui chuchote à Maman que le pasteur a fait une fausse citation dans son sermon du verset 66 du Psaume 149 alors qu’il s’agit du verset 149 du Psaume 66 / Celle qui conserve sa dignité de Catherine Deneuve norvégienne (selon les journaux) quand le reporter belge évoque sa vie plus campagnarde que celle de la Parisienne / Ceux qui s’étiolent sous les yeux hypocritement sympathisants d’une jeunesse qui va s’éclater ce soir d’été tandis qu’ils feront un scrabble en regardant Drucker, etc.
Image : Philip Seelen -
La pièce
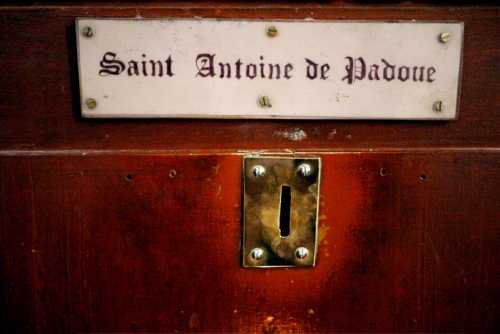 …En somme c’est typique, en public tu débines le marketing du bienheureux, tu prétend que se faire du blé sur une superstition aussi ringarde relève de l’arnaque, sans penser que tu décourages Mimi qu’a perdu ses clefs, mais toi, là, foudre de laïcité, entré dans l’église comme un voleur, qu’est-ce que t’espères en glissant ton euro en douce : tu crois que tu vas retrouver la foi? …
…En somme c’est typique, en public tu débines le marketing du bienheureux, tu prétend que se faire du blé sur une superstition aussi ringarde relève de l’arnaque, sans penser que tu décourages Mimi qu’a perdu ses clefs, mais toi, là, foudre de laïcité, entré dans l’église comme un voleur, qu’est-ce que t’espères en glissant ton euro en douce : tu crois que tu vas retrouver la foi? …
Image : Philip Seelen -
Du réel plein la vue

Dès demain et jusqu’au 13 avril, la 17e édition du festival international du documentaire de Nyon se fait reflet du monde actuel. Luciano Barisone, nouveau directeur, lève le voile.
« Laissez venir l’immensité des choses », écrivait le grand Ramuz, et Luciano Barisone, nouveau directeur de Visions du réel, pourrait dire la même chose à l’instant d’ouvrir, avec son équipe, une fenêtre panoramique sur le monde tel que le perçoit et le transmet le cinéma du réel.
Le cinéma du réél, en avant-première (gratuite) du festival, ce sera par exemple le regard original du jeune réalisateur Nicolas Steiner sur la tradition populaire suisse des combats de reines. Ou ce sera, en ouverture, avec Pequenas voces (Petites voix) de Jairo Carrillo et Oscar Andrade, une chronique inédite de la guerre civile colombienne vue par des enfants. (lire encadré).
On l’a dit et répété : le film documentaire n’est plus le genre mineur qu’il fut souvent, didactique ou simplement illustratif. « L’intérêt du thème n’est qu’un des critères de notre sélection », précise Luciano Barisone qui a vu lui-même plus de 1000 des 3000 films visionnés par ses collaborateurs. « L’originalité du filmage, la qualité cinématographique des films compte aussi pour beaucoup. Ce n’est pas pour rien, d’ailleurs, que les réseaux du cinéma s’intéressent de plus en plus à cette production, autant que la télévision. » Exemple éloquent, annonçant l’apparition d’un nouveau réalisateur suisse du nom de Ramon Giger: le film extrêmement troublant, voire bouleversant, intitulé Eine ruhige Jacke et consacré à un jeune autiste accueilli dans une ferme de montagne par un forestier et les siens. Rappelant le docu-poème du Lausannois Germinal Roaux filmé avec un trisomique, cet ouvrage tient de l’implication plus que de l’explication, où les détails révélateurs saisis par le réalisateur nous font mieux comprendre une situation humaine vertigineuse.
Exemple éloquent, annonçant l’apparition d’un nouveau réalisateur suisse du nom de Ramon Giger: le film extrêmement troublant, voire bouleversant, intitulé Eine ruhige Jacke et consacré à un jeune autiste accueilli dans une ferme de montagne par un forestier et les siens. Rappelant le docu-poème du Lausannois Germinal Roaux filmé avec un trisomique, cet ouvrage tient de l’implication plus que de l’explication, où les détails révélateurs saisis par le réalisateur nous font mieux comprendre une situation humaine vertigineuse.
«On a pu dire que la vérité gît dans le détail », relève encore Luciano Barisone, « mais le détail qui éclaire et signifie ». Et de citer, dans Ivan and Ivana de Jeff Silva, la situation particulière de deux Kosovars qui ont fui les bombardements de l’OTAN en 1999 et se retrouvent aux USA confrontés à un «rêve américain» en déglingue.
Autre travelling urbain violent sur une sorte de ville-monde barattée par le rythme dément de la bande-son : Abendland, long métrage en compétition de l’Autrichien Nikolaus Geyrhalter, exclusivement constitué d’épisodes nocturnes alternant tel affrontement de policiers et d’écologistes anti-nucléaires et telle rave party monstrueuse, tels drames, chantiers titanesques ou scènes de crime…
Entre compétition et nouvelles sections, ateliers (avec José Luis Guerin et Jay Rosenblatt) et rencontres-débats, cette nouvelle édition de Visions du réel promet une quantité de découvertes ou de retrouvailles. On attend impatiemment, ainsi, le retour d’Alexandre Sokourov dans Il nous faut du bonheur, filmé dans la campagne du Kurdistan.
Enfin un souci majeur de Luciano Barisone est la transmission en aval, vers les jeunes générations. À cette enseigne s’inscrit le docu que la rumeur acclame déjà, intitulé Nous, Princesse de Clèves, où Régis Sauder, après la mémorable Esquive d’Abdellatif Kechiche, applique la même recette du classique joué par des lycéens marseillais d’une banlieue « sensible »…
Nyon, Festival Visions du réel, du 7 au 13 avril. Infos : Visionsdureel.ch Reines d’un jour
Reines d’un jour
Rien de lourdement folklorique dans le regard que porte Nicolas Steiner sur les tenants individuels et les aboutissants collectifs est festifs d’un combat des reines, filmé en noir et blanc « chaleureux » avec une patte à la fois leste et marquante. Du petit môme se faisant lécher le museau par la reine que les siens préparent avec un soin jaloux, à l’arène où douze mille aficionados se déchaînent en (plus ou moins) connaissance de cause, en passant par les jeunes débarqués à moto qui expliquent le topo au citadin de passage, ou les vieux armaillis qui en ont vu d’autres, le combat des reines est ici détaillé et magnifié sans esthétisme complaisant, avec une « touche humaine » qui englobe les formidable bêtes aux noms épatants.
Ceux qui y ont assisté le savent : ce genre de spectacle peut être fastidieux pour le non-connaisseur. Or il ne fait pas ici que s’animer par le montage du film alternant ellipses et ralentis : il devient ballet visuel aux images fortes et belles.
Théâtre de Marens, le 6 avril à 19h.30. Entrée libre Les enfants et la guerre
Les enfants et la guerre
L’obscénité de la guerre, ici détaillée par le dessin d’un gosse soudain amputé d’un bras ou d’une jambe, ou d’une village réduit à un tas de ruines par une attaque aérienne, apparaît en crescendo, et voix à l’appui, dans Pequenas Voces de Jairo Carrillo et Oscar Andrade, film d’animation entièrement conçu à base de dessins d’enfants.
La guerre civile en Colombie, qui aboutit au déplacement forcé de plus d’un million d’enfants, et qui fut marquée par l’enrôlement de nombreux ados, se trouve racontée par quelques « petites voix » marquant le contraste entre une certaine idylle paysanne des familles, et la violence des militaires des deux bords. Sous le regard des enfants, cette frise de la vie en Colombie n’a rien pour autant de systématiquement dramatique : au contraire, le film est tissé de malice et de drôlerie, comme si la vie était plus forte que la folie des hommes.
À noter enfin que cette réalisation, d’un haut niveau esthétique et technique, s’inscrit dans la section Focus Colombia qui témoigne, avec cinq autres films récents, du regain de créativité de ce pays après ses années de plomb.
Théâtre de Marens, jeudi 7 avril, à 19h.30. -
Kundera définitif
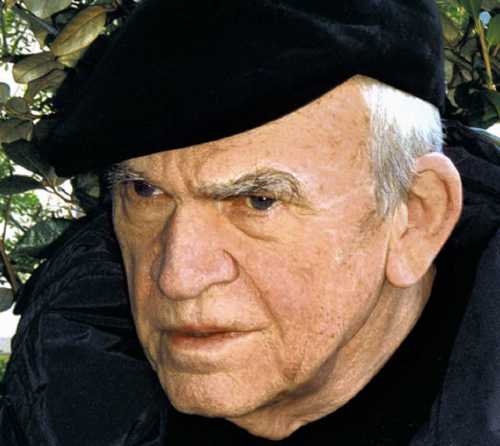
Le grand écrivain d'origine tchèque entre, de son vivant, au panthéon français de la littérature, avec deux volumes de La Pléiade constituant son Oeuvre d'un seul tenant. Edition définitive.
Dimension Nobel ! Voilà ce qu’on se dit en se replongeant dans le romans de Milan Kundera rassemblés, avec ses essais, comme une Oeuvre d’un seul tenant en deux volumes de la prestigieuse Bibliothèque de La Pléiade.
Lorsque François Mitterrand, en 1981, accorda la nationalité française à Kundera et à l’Argentin exilé Julio Cortazar, l’on salua plaisamment les «premières nationalisations» du président socialiste.Or il faut rappeler que l’écrivain tchèque avait été déchu de sa nationalité à l’automne 1978, interdiction lui étant faite d’entrer dans son pays, au point de l'empêcher même d'assister à l’enterrement de sa mère. Non moins lourde pour lui: l’interdiction de ses oeuvres dans son pays natal. Or celui-ci fut le dernier à reconnaître la grandeur d’un écrivain traduit et célébré dans le monde entier, alors même qu’il récusait l’appellation de «dissident».
De fait, bien plus qu’un anticommuniste comparable aux réfractaires de l’Europe de l’Est, Milan Kundera s’est défini comme «un hédoniste perdu dans un monde politisé à l’extrême». Cela valut, à l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être, le reproche d’être frivole. C’était ne pas voir que son engagement, bien plus profond que celui de tant d’écrivains «engagés», opposait une «interrogation existentielle» fondamentale sur la société communiste, qu’il poursuivrait en Occident d’une autre façon. Ses romans sont subversifs en termes artistiques et humains, illustrant, avec une ironie implacable, alliée à une empathie humaine non sentimentale, la bêtise et le conformisme, le faux sérieux et l’arrivisme.
S’il s’est toujours efforcé de dissiper le malentendu faisant de lui un romancier «politique», Milan Kundera, boxeur en ses jeunes années, n’en mena pas moins un formidable combat pour la défense de l’intelligence et de l’art, des qualités humaines et du vrai sérieux. Dès la première nouvelle de Risibles amours, intitulé Personne ne rira, c’est ainsi une femme sensible qui fait le procès d’un jeune intellectuel cynique. Dans la foulée, avec La Plaisanterie, le magnifique Livre du rire et de l’oubli, marquant sa percée aux Etats-Unis, L’Insoutenable légèreté de l’être et L’Immortalité, Kundera développa un art mêlant vie privée et réflexion sociale, qui font du roman un outil d’analyse à l'incomparable plasticité musicale, et une «comédie humaine» inépuisable.
«La bêtise des hommes vient de ce qu’ils ont réponse à tout. La sagesse du roman, c’est d’avoir question à tout», écrit Milan Kundera dans L'Art du roman, et toute son oeuvre en témoigne aussi bien.
Surprise: cette édition de La Pléiade paraît sans appareil critique ni biographie de l’auteur ! Ou plus exactement, François Ricard ajoute, aux romans et aux essais, des «biographies» de chaque livre dont l’ensemble forme un passionnant «roman critique», à tout moment lié à l’époque et à la réception mondiale de l’oeuvre, des très créatives années 60 à l’écrasement du Printemps de Prague, jusqu’ aux lendemains qui chantent et/ou déchantent sur fond de rire et d’oubli…Milan Kundera. Œuvre. Edition définitive. Préface, notes et biographies des oeuvres établies par François Ricard. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2vol.
Volume I: Risibles amours, La Plaisanterie, La Vie est ailleurs, La Valse aux adieux, Le Livre du rire et de l'oubli, L'Insoutenable légèreté de l'être. Biographie de l'oeuvre. 1479p.
Volume II: L'Immortalité, La Lenteur, L'Identité, L'Ignorance, Jacques et son maître - Hommage à Denis Diderot en trois actes, L'Art du roman, Les testaments trahis, Le Rideau, Une Rencontre. Biographie de l'oeuvre. Choix bibliographique.