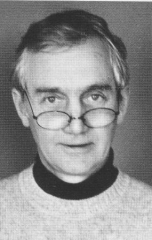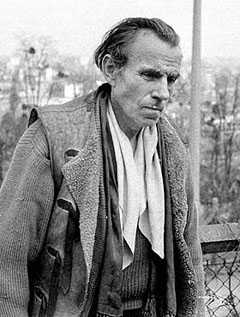- Cette femme me colle, répéta le tout jeune nouveau comptable du service contentieux de l'Entreprise au responsable des ressources humaines, elle ne me lâche pas, elle s’assied sur mon bureau, elle me prend par le cou, elle me touche, elle me zyeute, un jour ça va finir par la main au derche, vraiment ça commence à bien faire...
- Revenez me voir ce soir, dit le beau Tibère au pauvre garçon que sa ressemblance avec Johnny Depp désignait à toutes les convoitises.
Et le même soir:
- Le bouquet c’est cet après-midi. Cette fois elle m’a fait des avances claires et c’est carrément la menace. Elle me dit que ça ne serait pas bien ce soir si je ne venais pas chez elle, elle et un certain ami voudraient m’avoir rien que pour eux, ils me trouvent terriblement à leur goût et voudraient m’associer à leurs jeux, même que ça pourrait influer sur ma carrière. Vous voyez le plan ?
Le pauvre garçon tremblait d’indignation devant le beau Tibère, qui lui fit comprendre d’un seul regard, assorti d’une caresse professionnelle, où était son avenir.
Livre - Page 65
-
Mobbing
-
Ceux qui sont sur un roman
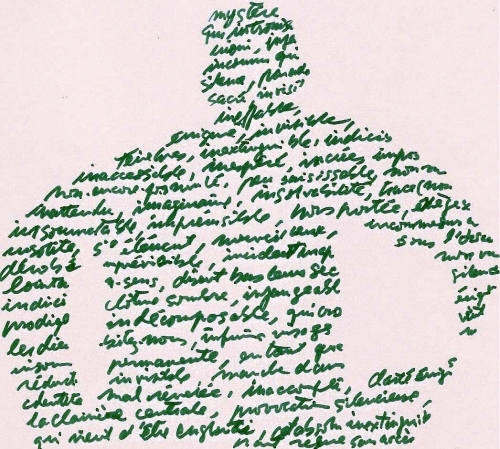
Celui qui a déjà trouvé le sujet de son premier roman mais pas encore le verbe ni le complément / Celle qui se sent proche d’entrer en « ascèse de création » / Ceux qui préparent leur « nouvelle campagne d’écriture » / Celui qui n’a pas de cancer à raconter mais une cousine castratrice et des collègues jaloux au Lycée Malraux / Celle qui ayant lu le dernier Gavalda s’exclame : « Et pourquoi pas moi ?! » / Ceux qui se lancent dans une intrigue échangiste avec les nouveaux voisins qu’ils développeront à quatre mains sur le papier genre sit com / Celui qui a déjà prévu toutes ses réponses à François Busnel / Celle qui a trop à dire pour se taire / Ceux qui estiment qu’un roman sera la meilleure relance de leur succès au karaoké et un plus au niveau de leur estime de soi / Celui qui a rodé son sujet en atelier et va le creuser à Capri / Celle qui a fait l’acquisition d’un IMac à écran 27 pouces pour que son roman explose / Ceux qui croient à la réincarnation du roman animalier / Celui qui est à la masse depuis que sa protagoniste Maud-Adrienne n’en fait qu’à sa tête / Celle qui se dit « sur la ligne » de Christine Angot en plus femen / Ceux qui ont fondé une assoce de jeunes romancières et romanciers afin d’échanger à tous point de vue et de faire front commun à la critique établie des plus de 27 ans / Celui qui a lu tout Balzac et en reste au Chef-d’œuvre inconnu / Celle qui se cherche un agent performant / Ceux qui seront de la Grande Offensive de septembre / Celui qui estime qu’avec un roman de 2666 pages il peut faire aussi bien sinon mieux que Roberto Bolano ce Latino surestimé en Allemagne / Celle qui va river son clou à Jean-Patrick ça c’est sûr / Ceux qui considèrent que le public ne mérite pas leur deuxième roman au vu du piètre accueil qu’il a réservé au premier / Celui qui a passé du roman à la nouvelle sans renoncer au Goncourt à long terme / Celle qui a intitulé Le Mystère d’Angkor son mélo minimaliste « à la Duras » qui se passe entièrement dans une chambre d’hôtel de Vesoul dont le seul ornement est un vieux chromo des fameux temples visiblement découpé dans un illustré des années 1920-30 avant d’être mis sous verre parquelque main inconnue – là gisant le mystère / Ceux qui évitent de surligner le sous-texte de leur roman fonctionnant sur le non-dit du pulsionnel, etc.
-
De brûlants icebergs
Icebergs, premier court métrage de fiction de Germinal Roaux, 2007.
L’art d’un jeune cinéaste ne s’évalue pas souvent en deux plans trois séquences, et c’est pourtant l’évidence d’un grand talent personnel qui saisit à la vision d’Icebergs, premier court métrage de fiction de Germinal Roaux, qui obtint l’an dernier le prix Action Light du meilleur espoir suisse au Festival de Locarno et le prix de la Relève pour le meilleur court métrage 2007 aux journées de Soleure, entre autres distinctions revenues à ce réalisateur romand de 33 ans.
Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...
L’argument est mince et très significatif à la fois, genre fine nouvelle d’Annie Saumont ou du Vincent Ravalec des débuts, mais le film le traite avec une rapidité et une délicatesse de touche sans faille.
Chaque plan dit quelque chose, les jeunes acteurs (Marie Bucheler parfaite en Rosa, Xila de Blasi et Leandro Silva, non moins convaincants dans les rôles de Céline et Kader) sont remarquablement dirigés, l’image est belle sans donner jamais dans l’esthétisme ou la grisaille misérabiliste, le jeu des plans suit un mouvement fluide et « construit » l’espace avec une sorte de grâce naturelle et rigoureuse, le détail des observations sur le milieu est d’une constante justesse et la dialogue aussi, elliptique et codé, rend compte de cet univers aux parents invisibles ou réduits à des voix (un seul voisin fait figure de râleur patenté), sans que rien de plus ne soit dit. En 14 minutes intenses, Germinal Roaux fait bien plus qu’un exercice de style : il signe un vrai film d’une imposante maîtrise. Pour le climat affectif et la "couleur" du noir et blanc, Icebergs rappelle un peu Les coeurs verts d’Edouard Luntz (1965), sans qu’il s’agisse ici de « cinéma vérité ».
 Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…
Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…
CAB Productions, 14min. On peut voir le film sur le site de Germinal Roaux: http://www.germinalroaux.com/ -
Mon pote le trisomique

Le premier film de Germinal Roaux, Des tas de choses, 2004.
On voit d'abord des mains potelées en gros plan, puis c'est un petit bonhomme sur un album de photos qui évoquent l'enfance de Thomas, constatant aujourd'hui les signes « mongoloïdes » distinctifs qui ont marqué sa différence sur ces premiers portraits. Avec une lucidité lancinante, parfois « trouée » par des flous, des dérapages ou de soudaines impossibilités de s'exprimer (un long effort de concentration, face à la caméra, aboutissant à un « ah, putain !» découragé), Thomas raconte et commente sa vie de handicapé, avec le souci d'emblée déclaré de témoigner pour les autres et d'offrir d'eux une « meilleure image ».
Thomas Bouchardy est fier de se présenter en tant que premier trisomique suisse engagé comme serveur dans une auberge, pratique la musique depuis des années (il aime le rock et rêve de faire de la politique pour améliorer la Fanfare de Carouge ...), et collectionne fièrement les médailles de natation. A l'Auberge de Satigny, de vieux habitués, qui ne savent pas trop en quoi consiste son handicap, disent l'apprécier beaucoup. Et lui-même va répéter son plus cher désir, d'être papa et d'avoir des enfants ... comme tout le monde.
Cependant Thomas n'est pas tout à fait comme tout le monde. Son handicap est là, et c'est avec son handicap que Germinal, son pote, 28 ans comme lui, a choisi de le filmer. Ainsi verra-t-on Thomas porter un plateau de verres sans vaciller ou manier les baguettes d'une batterie, mais aussi baver, bégayer, roter et faire le zouave, comme un grand môme. On le verra sourire aux anges, mais parfois une ombre de désarroi troubler son image. On verra notre semblable et notre frère, mais aussi cet être marqué par la différence liée à son chromosome « de trop ». Thomas aussi s'est vu: Des tas de choses lui fut soumis en primeur par Germinal, prêt à gommer tout ce qui le choquerait. Et Thomas s'est reconnu. Comme ses parents l'ont reconnu, un peu effrayés tout de même par l'extrême franchise du portrait. C'est que Thomas s'est livré à Germinal plus qu'à ses propres parents, avec lesquels il a toutes les pudeurs.
Rien d'impudique, au demeurant, dans le premier « court » de Germinal Roaux, né à Lausanne en 1975, sorti de l'Ecole Steiner pour une grande virée en Afrique et de celle-ci passé à la photo, notamment à L'illustré où il signe des portraits de la série « Vécu ». « J'ai toujours été attiré par la différence, explique-t-il plus précisément, et curieux de découvrir ce qu'elle pouvait nous apprendre. Lorsque j'étais enfant, j'avais un peu peur des handicapés. Pourtant, je sentais qu'il y avait chez eux une sensibilité particulière et tout un univers ignoré. »
A Thomas Bouchardy, Germinal Roaux a d'abord consacré un reportage photographique avant de lui proposer cette aventure commune. « Le problème était évidemment de savoir comment le présenter. Finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait tout focaliser sur lui, en écartant parents et éducateurs. Comme les questions trop précises le bloquaient, je me suis efforcé de le laisser me guider. A partir d'une vingtaine d'heures de prises, j'ai ensuite opéré un premier montage, beaucoup trop linéaire, que Fernand Melgar m'a conseillé ensuite de retravailler comme un puzzle. »
A relever alors, et qui annonce un véritable auteur: la « musique » coulée d'un style et la vivacité d'un rythme, ou le noir / blanc sert parfaitement l'approche du jeune cinéaste. Le portrait-témoignage de Thomas devient alors poème, illustrant l'aspiration de Germinal Roaux à opposer, au déferlement chaotique du tout-à-l'égout de l'image, une vision personnelle habitée par l'émotion, l'exigence du sens et la beauté.
Germinal Roaux, Des tas de choses. Court-métrage (28 min.) -
Ceux qui poussent tout au noir
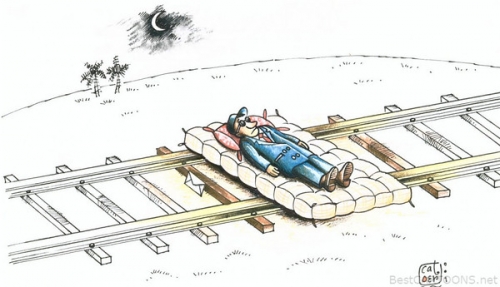 Celui qui noircit tout par plaisir morbide assez puéril en somme / Celle qui gratte ses plaies scrutées à la loupe dans sa salle de bain à double vasque / Ceux qui lisent Détective avec la plus morose délectation / Celui qui prétend que tout est pourri pour avoir moins à réfléchir / Celle qui rêve d’une nouvelle vie sans gluten / Ceux qui citent volontiers Cioran le désespéré dans leurs groupes de parole d’intermittents du suicide / Celui qui ouvre le livre de Cioran intitulé Écartèlement et tombe sur cette phrase : La Mort est ce que la vie a inventé jusqu’ici de plus solide, après quoi il ferme le livre et retourne manger du chocolat / Celle qui ne mange que du chocolat noir ainsi que le lui a recommandé son kinésithérapeute féru de Schopenhauer / Ceux qui hésitent entre la moustache de Nietzsche et les rouflaquettes de Schopenhauer / Celui qui va pour se pendre dans la forêt dont il revient avec un plein panier de chanterelles odorantes et gracieuses / Celle qui remet l’arme dans le tiroir après que Jean-paul s’est tiré une balle à blanc / Ceux qui se saoulent à mort à l’eau-de-vie et s’en vantent à vous faire crever d’ennui / Celui qui sortant de la grande expo de Soulages se réjouit de voir un camion rouge sur fond de ciel vert / Celle qui se peint la bouche en noir et les molaires avec / Ceux qui cherchent un coin de ciel bleu dans le dernier livre de Regis Jauffret qui ne fait même pas rire jaune / Celui qui a toujours vu dans le pessimisme à la française une sorte de pose austro-allemande / Celle qui positive a l’envers et n’en est pas plus attirante qu’une fausse veuve / Ceux qui n’estiment pas plus le pessimisme béat que son contraire béant, etc.(Cette liste fait écho à la lecture, assez consternante à vrai dire, des plus de mille pages des Microfictions de Régis Jauffret)
Celui qui noircit tout par plaisir morbide assez puéril en somme / Celle qui gratte ses plaies scrutées à la loupe dans sa salle de bain à double vasque / Ceux qui lisent Détective avec la plus morose délectation / Celui qui prétend que tout est pourri pour avoir moins à réfléchir / Celle qui rêve d’une nouvelle vie sans gluten / Ceux qui citent volontiers Cioran le désespéré dans leurs groupes de parole d’intermittents du suicide / Celui qui ouvre le livre de Cioran intitulé Écartèlement et tombe sur cette phrase : La Mort est ce que la vie a inventé jusqu’ici de plus solide, après quoi il ferme le livre et retourne manger du chocolat / Celle qui ne mange que du chocolat noir ainsi que le lui a recommandé son kinésithérapeute féru de Schopenhauer / Ceux qui hésitent entre la moustache de Nietzsche et les rouflaquettes de Schopenhauer / Celui qui va pour se pendre dans la forêt dont il revient avec un plein panier de chanterelles odorantes et gracieuses / Celle qui remet l’arme dans le tiroir après que Jean-paul s’est tiré une balle à blanc / Ceux qui se saoulent à mort à l’eau-de-vie et s’en vantent à vous faire crever d’ennui / Celui qui sortant de la grande expo de Soulages se réjouit de voir un camion rouge sur fond de ciel vert / Celle qui se peint la bouche en noir et les molaires avec / Ceux qui cherchent un coin de ciel bleu dans le dernier livre de Regis Jauffret qui ne fait même pas rire jaune / Celui qui a toujours vu dans le pessimisme à la française une sorte de pose austro-allemande / Celle qui positive a l’envers et n’en est pas plus attirante qu’une fausse veuve / Ceux qui n’estiment pas plus le pessimisme béat que son contraire béant, etc.(Cette liste fait écho à la lecture, assez consternante à vrai dire, des plus de mille pages des Microfictions de Régis Jauffret)
-
Ceux qui n'ont rien à cacher

Celui qui est transparent a l’œil de sa webcam en stand by / Celle qui met en ligne un selfie de son sosie / Ceux qui ne se laissent jamais scanner sans string / Celui qui dit tout à sa mère porteuse de bretelles / Celle qui tient les drones du ménage / Ceux qui ont des dossiers sur tous leurs voisins / Celui qui se cache pour penser / Celle qui dénonce la nouvelle Miss Hongrie surprise à lire un livre de Martin Heidegger ce facho notoire / Ceux qui ont trop de fierté pour se montrer leurs poèmes / Celui qui déshabille du regard la dentiste qui lui rhabille une molaire / Celle qu’on a vu à la télé sans préavis au collectif / Ceux qui ne s’expriment qu’après cooptation des camarades formés / Celui qui en sait long sur le Vatican et le dit chez Ruquier sans faire d’amalgame / Celle qui exige de la banque qu’elle lui dise son secret maintenant qu’elle lui a fait un dépôt / Ceux qui avouent qu’ils ont quelque argent non sans manifester la même pudeur que ceux qui n’ont ont pas, etc
-
Mémoire vive (115)

Lambert Schlechter, dans son dernier livre (Monsieur Pinget saisit le râteau et traverse le potager), note ceci sans en préciser ni la date ni l’objet : « J’étais sûr que cela n’arriverait opas.J’étais sûr que cela ne pouvait pas arriver. Il n’tait pas possible que cela arrive. Pas pensable. Pas imaginable. Et maintenant ?? Il va fourrer sa grosse grasse patte sous la robe de la Liberté ».
°°°
Le camarade Michael Wyler se déchaîne, dans sa dernière chronique de Bon Pour La Tête, contre le délire publicitaire et commercial boosté par Halloween, le sinistre Black Friday et les fêtes de Noël. J’abonde évidemment, en prônant l’éradication des marchés de Noël après traitement au napalm, et la chasse à toute effigie de l’odieux pédophile a barbe postiche et pèlerine rouge dont le culte est devenu la plus sinistre mascarade de ce temps de folie consumériste. Jawohl !
 J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.
J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.Il va de soi que le langage des gestes ne se limite pas à la langue des signes des gentils malentendants pas plus qu’aux méchants doigts et autres bras d’honneur des crétin(e)s qui vous dépassent à toute heure sur les autoroutes de la muflerie, appelant autant de gestes réactifs appropriés ou non, etc.
Le premier geste de l’enfant est comme une signature perso, qui rappelle celui de notre ancêtre se hissant sur ses pattes antérieures pour apposer ses mains enduites de sang de bison au plafond de la grotte d’Altamira ou partout ailleurs – aujourd’hui entre tags et graffiti.
Je suis donc je bouge. Je tique donc je toque à l’attention d’autrui. Je me prends la tête pour me la jouer penseur de Rodin mais ça peut aussi signifier un gros chagrin ou une migraine à se damner – geste du revolver sur la tempe. Si Hannibal Lecter se retourne pour vous jeter un regard à la fin de l’épisode, vous savez que ce geste est une menace de plus.

Il y a les gestes polis de nos grands-pères soulevant leur chapeau, comme il y a le geste minable de celui qui fauche une fleur sur une tombe, les gestes élégants ou les gestes de la moquerie, les gestes pour-ne-rien-dire ou les gestes déchirants.
«Superficiels, écrit Charles Dantzig, les gestes sont plus importants que nous ne le pensons, nous qui les laissons sortir de nous et y rentrer comme des coucous, et sans leur accorder plus d’attention; un appui à nos paroles, des éclairs de nous, je ne sais quoi d’autres».
Des éclairs de nous! Des reflets, des aveux involontaires ou conscients, des morceaux de nous qui sont comme des possibilités d’ILS, de VOUS tous et de tous mes MOI. Bref, comme rien de ce qui est humain n’échappe à la chanson de geste des gestes, il y a une anthropologie de la gestuelle, une poétique du beau geste ou de la moche attitude (gestes de la petite emmerdeuse ou du gros con), une typologie du geste cinématographique (le geste de Charlot qui balance son mégot dans le tuba du musicien voisin ou celui de Marilyn retenant l’envol de sa robe-corolle au-dessus de la bouche d’aération du métro, une doxologie (geste du Seigneur bénissant) ou une démonologie (geste du saigneur sévissant) de ce langage plus récemment intégré dans l’investigation psychologique ou policière des profileurs «mentalistes», etc.
Ce jeudi 7 décembre.- Grand bleu sur l’étincelante blancheur des crêtes d’en face. L’imbécile de la Maison blanche continue de faire des siennes en proposant le déplacement de la capitale israélienne à Jérusalem. Le monde commence à réagir mais il n’en a rien à battre, même si cette folie sent la chute de l’Empire.
°°°
L’observation des dits et gestes de la meute, notamment sur Facebook, me fascine ou peu s’en faut, un peu comme la bêtise fascinait Flaubert, qui en a tiré un Dictionnaire et cette espèce de chef-d’oeuvre que représente Bouvard et Pécuchet. Je prends note à distance, sans cesser de sourire. J’évite de participer au moindre débat et me garde de formuler opinions ou professions de foi à la petite semaine. Ma lucidité et mon sens commun, frottés d’un esprit débonnaire, m’empêchent de participer à tout ça…
°°°
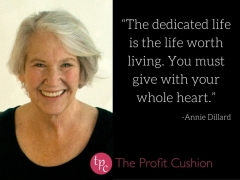 Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »
Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »°°°
 Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.
Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.Ces territoires sont aussi les miens depuis la forêt de mon adolescence ne demandant rien à personne mais répondant à l’injonction de Michel Strogoff et de nos braves parents : «Regardez !»

Affirmer que Dante est l’homme le plus dénué d’esprit de l’histoire de la littérature, comme s’y risque Charles Dantzig dans son Traité des gestes, me semble relever de la même futilité à la française, à vrai dire insignifiante, que lorsque notre censeur conchie Céline ou Dostoïevski, entre autres «gestes judiciaires» expéditifs. Mais on se rappelle qu’au chapitre des énormités célèbres un Nabokov réduisait à rien un Faulkner et que Céline, précisément, fit de Proust un snob à chichis sans intérêt.
Bref, on ne demande pas, au jardin zoologique, à la gazelle de comprendre la psychologie du rhinocéros, ni à celui-ci d’être sensible au chant du rossignol, et l’on passe donc allègrement sur ces agaceries pour achopper à la substance incessamment surprenante et tonique du dernier livre de Dantzig.
°°°
Le délire d’opinion atteint un summum sur les réseaux sociaux et les commentaires de blogs, dont ceux de la République des lettres de Pierre Assouline fournit le plus éloquent exemple. Ainsi, après un article intéressant de celui-ci sur le livre d’Amaury Nauroy, Rondes de nuit, peut-on lire plus de 1000 commentaires dont quasi aucun n’a de rapport pertinent avec le texte initial – l’un d’eux, à propos de Philippe jaccottet, montre au plus une méconnaissance totale du sujet -, chacun y allant de son petit discours sur tel ou tel thème repris par les membres régulier de cette espèce salon en ligne tenant plus du café du commerce.
°°°
 Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.
Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.C’est un sentiment remontant à l’enfance, à la maison de notre enfance et au jardin, au quartier, à la forêt et aux premières échappées de ce premier cercle de notre enfance.
Né sous le signe des Gémeaux, je me suis toujours senti partagé, mais cette nature double à tous égards ne se borne ni à la détermination des astres ni à une typologie psychologique particulière : elle reflète à mes yeux la Nature même, avec son ambivalence que le jour et la nuit ne cessent de rythmer en alternance.
°°°
«Rien ne me paraissait plus beau, enfant, que de voir ma mère s’asseoir. Elle pliait ses belles jambes, descendait vers la galette de la chaise en gardant le torse droit puis, assise, rejetait ses jambes de côté.»
Ainsi s’exprime le Dantzig doux et sensible, dont l’écriture toujours précise nous apprend qu’une chaise a une «galette», avant de durcir le ton sur la même page: «La grossièreté des hommes qui s’asseyent en écartant les jambes dans le métro est un des signes les plus révoltants de l’indifférence à autrui, c’est-à-dire du manque d’imagination».
Et ceci encore qui me ravit décidément : «A l’instar de la parole mes gestes ne sont pas moi seul», lit-on ainsi dans le beau chapitre intitulé Papillons, papillons. «L’homme est une oeuvre d’art qui s’ignore. Cette œuvre se crée par les gestes plus librement que par la parole, aucun tyran n’ayant pensé à inventer une syntaxe des gestes pour nous faire nous mouvoir de la naissance à la mort comme dans un stade maoïste. Être hors de soi ne devrait pas vouloir dire être en colère. Papillons, papillons, sortez de moi, allez vers mes frères, sculpture légère, erronée, vivante».
Et ce bel envoi final: «Dans le jardinage à la française de la vie par le Temps, les gestes font des crocs-en-jambe, des pieds de nez, tirent la langue. Venez, enfants moqueurs! Les gestes contredisent le Temps!»

Tout en restant attentif à l’espèce de cauchemar éveillé que constitue l’actualité, avec ses pantins semant le chaos sous couvert de grimaces policées, je lisais ces jours Le Frère de XX, dernier recueil de brèves proses de Fleur Jaeggy après avoir relu Les Années bienheureuses du châtiment et L’institut Benjamenta de Robert Walser, découvert il y a bien quarante ans de ça, quand le nom de l’auteur oublié ressuscitait avant de devenir culte selon l’expression de notre époque d’idolâtrie à la petite semaine.
Or, à chaque page de Fleur Jaeggy je retrouvai quelque chose du génie de Walser, qui m’évoque à la fois une certaine Suisse sauvage, chrétienne et païenne, terrienne et cosmopolite.
La première page des Années bienheureuses du châtiment, premier joyau scintillant de la constellation poétique de Fleur Jaeggy, fait d'ailleurs référence explicite à la mort de Walser dans la neige, et la jeune Fleur, aussi teigneuse que tendrement amoureuse, aura sans doute retrouvé un frère occulte dans le Jakob von Gunten de L’institut Benjamenta, confronté à la même splendide autorité directoriale qu’elle a connue à l’institut Bausler pour jeunes filles riches tenu par le couple classique de la femme capitaine et de son conjoint falot.
°°°
Il est à noter que cet enfant regardait par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’était en son for intime qu’il avait l’air de sonder tout le temps que durait la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvaient se dérober c’est lui qui scrutait et que tout le reste du temps il épiait, observait : observait la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observait le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on savait des longs intermèdes de sa tournée, observait la salutiste en sempiternel tablier gris, observait et notait tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit jsuque-là mais n’était-il pas à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en serait-il alors de notre tranquillité ? se demandaient les gens du quartier n’aimant guère les histoires …
°°°
L’enfance selon Robert Walser et Fleur Jaeggy n’a rien de sucré ni de rassurant, pas plus que les contes de Grimm où l’ogre et la fée font partie de l’enchantement. Bernanos opposait justement l’infantilisme et l’esprit d’enfance. Or celui-ci, de tous les âges, tire sa force de sa fragilité. La douleur enfantine est source de bonheur, nous suggère Fleur Jaeggy, et ce n’est pas un paradoxe morbide. De son côté, comme l’a bien vu Kafka, qui l’admirait et le continuait à sa façon, Walser poursuivait l’exploration de la forêt magique, mélange d’émerveillement et de terreur, des contes de Grimm transposés dans la réalité quotidienne où l’enfant est supposé faire l’apprentissage de la vie en distinguant – première leçon –, ce qui est important de ce qui ne l’est pas.

Ce qui est important dans la vie, grosso modo, c’est de réussir. Voilà ce qui est recommandé au petit garçon de 8 ans par sa sœur aînée, dans Je suis le frère de XX, alors qu’il a décidé de mourir quand il serait grand. Et c’est le même projet, on dirait aujourd’hui le même plan de carrière qui est proposé aux pensionnaires de l’institut Benjamenta, imaginé par Robert Walser, et aux jeunes filles de la pension Bausler décrite par Fleur Jaeggy.
Or la réponse de Jakob von Gunten, double poétique de Walser dans L’institut Benjamenta, est clairement formulée: «A l’idée que je pourrais avoir du succès dans la vie, je suis épouvanté», à quoi il ajoute: «Je me fous du monde d’en haut, car là, en bas, j’ai tout ce dont on a besoin, les beaux vices et les belles vertus, le sel et le pain». Et la narratrice des Années bienheureuses du châtiment, plus portée aux rêveries solitaires sur les alpages cristallins d’Appenzell qu’à la réalisation des ambitions de sa mère, laquelle lui dicte sa conduite dans ses lettres envoyées du Brésil, manifeste la même résistance douce et têtue au drill et au formatage.
Tout cela par molle paresse ou je m’en foutisme anarchisant? Nullement. Alors pourquoi? La réponse est la même que donnait Blaise Cendrars quand on lui demandait pourquoi il écrivait: parce que. Parce que j’aime chanter. Parce que j’aime dessiner. Parce que j’aime écrire. Parce que j’aime aimer et que ça m’importe plus que de réussir selon vos codes.
Ainsi Jakob von Gunten envisage-t-il la fortune: «Si j’étais riche, je ne voudrais nullement faire le tour de la terre. Sans doute, ce ne serait déjà pas si mal. Mais je ne vois rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol. Je me refuserais à enrichir mes connaissances, comme on dit. Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui m’attirerait. Examiner ce qui tombe sous le sens, je trouverais cela stimulant. D’ailleurs je ne m’achèterais rien du tout. Je n’acquerrais pas de propriétés. Des vêtements élégants, du linge fin, un haut-de-forme, de modestes boutons de manchettes en or, des souliers vernis pointus, ce serait à peu près tout, et avec cela je me mettrais en route. Pas de maison, pas de jardin, pas de valet. Et je pourrais partir. J’irais me promener dans le brouillard fumant de la rue. L’hiver et son froid mélancolique s’accorderaient merveilleusement avec mes pièces d’or»…
Robert Walser considérait le fait d'écrire comme un acte sacré, et de même y a-t-il, dans l'écriture de Fleur Jaeggy, comme une aura de pureté. Mais est-ce à dire, là encore, qu'on flotte dans le vague ou le flou ? Au contraire: la poésie de Walser et de Fleur Jaeggy capte la réalité avec une simplicité et une précision extrêmes. Aussi allergiques l'un que l'autre aux idéologies politiques ou religieuses, ils n'en sont pas moins attentifs au monde, chacun à sa façon.
°°°
 Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…
Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…Le fantastique social, ou plus précisément le réalisme panique, me semble un excellent vecteur critique, qui ne se borne pas à l’humour, trop souvent diluant, mais force le trait ironique sans pour autant donner dans le ricanement stérile. Il y faut une dureté douce, si j’ose l’oxymore, une main de velours dans un gant de fer, et la meilleure modulation en est celle de la poésie. Michaux en a montré le chemin et balisé la piste de décollage, pas toujours avec le même bonheur au demeurant.
°°°
«Il neigeait. On aurait dit depuis des années. Dans un village désolé du Brandebourg, un enfant crie avec un mégaphone un sermon de Noël.»

Ainsi commence le récit de Fleur Jaeggy intitulé L’Ange suspendu, dont la féerie noire est à la fois ancrée dans un temps et un lieu (les souvenirs et lendemains de la DDR), et qui m’a semblé rejoindre, par delà les années, le récit, par Carl Seelig, de la mort de Robert Walser dans la neige du Rosenberg, sur les hauts de Herisau, quand le cœur du poète le lâcha dans la lumière étincelante de ce début d’après-midi de Noël.
Robert Walser, cet original souvent mal luné, était il un ange? Les services administratifs du Ciel, dont il ne parle guère, se tâtent à ce propos, mais ce fragment de L’Ange suspendu de Fleur Jaeggy me parle de lui: «L’enfant est accompagné par un vieillard. Le patron, son maître. D’aspect, il ressemble à un moine et à un joueur de poker, comme ceux que l’on voit dans les films. Il a instruit l’enfant. Il l’a habillé et nourri. Il lui a donné un endroit où dormir. Le vieillard a échappé aux prisons, aux bûchers et aux écoles. En échange, l’enfant doit prêcher et demander l’aumône. L’obole. Une haine fraternelle les unissait. L’enfant sent autour de son cou la corde qui le lie à cet homme. Il sentait dans tous ses os et son sang un besoin primordial de haine. Et c’est ainsi que l’enfant parvenait à émouvoir, quand il lisait ses sermons. «Et maintenant, chante», lui disait le vieillard. L’enfant hurle en suivant le Livre des Hymnes. Les femmes l’entouraient. Chacune d’elles lui donne l’obole. Elles caressent sa tête, le capuchon pointu en laine noire. Elles veulent le toucher. L’enfant les regarde avec amour, comme le vieillard le lui a suggéré. C’est Noël. Le butin est consistant»…
°°°
 Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.
Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.Au début du livre, Annie Dillard échange un regard fulgurant avec une fouine et en tire les conséquences: «J’aimerais vivre comme je le dois, de même que la fouine vit comme elle le doit. Et je soupçonne que ma vie est la sienne: ouverte sans douleur au temps et à la mort, percevant tout, ou liant tout, prenant le pari de ce qui nous échoit avec une volonté féroce et pointue».
Dans le chapitre consacré à l’homme dans la trentaine, prénom Larry, qui vit sur l’île où elle habite, entre autres originaux de son genre, et dont le but vital est d’apprendre à parler à une pierre, Annie Dillard dit simplement que «nous sommes ici pour être témoins». Et d’ajouter: «Nous pouvons mettre en scène notre propre action sur la planète – construire nos villes sur ses plaines, construire des barrages sur ses rivières, ensemencer ses terres fertiles – mais notre activité signifiante couvre bien peu de terrain. Nous n’utilisons pas les oiseaux chanteurs, par exemple. Nous n’en mangeons pas beaucoup; nous n’en faisons pas nos amis; nous ne saurions les persuader de manger plus de moustiques ou de transporter moins de graines de mauvaises herbes. Nous pouvons seulement en être les témoins. Si nous n’étions pas là, ces oiseaux seraient des chanteurs sans public, tombant dans la forêt déserte. Si nous n’étions pas là, des phénomènes tels que le passage des saisons n’auraient pas le moindre de ces sens que nous leur attribuons. Le spectacle se jouerait devant une salle vide, comme celui des étoiles filantes qui tombent pendant la journée. C’est la raison pour laquelle je fais des promenades».
Certains livres vous rendent plus présents, plus poreux, plus sensibles à la pulsation du monde, plus attentifs à la musique du silence, plus résistants à la jactance insensée. Annie Dillard complète en faisant de la tête un monde où les sens et ce qu’on appelle le cœur, ou ce qu’on appelle l’âme, travaillent sous le même chapeau: «J’ai lu des livres de cosmologie comparée. En ce moment, la plupart des cosmologistes penchent pour le tableau de l’univers en évolution décrit par Lemaître et Gamow. Mais je préfère la suggestion faite il y a des années par Valéry – Paul Valéry, qui proposait l’idée d’un univers en «forme de tête»…

Ce dimanche 31 décembre. – Ma dernière lecture de l’année écoulée sera la première de l’an neuf, sous le titre de Bluff, dont le contenu est à l’opposé de ce que ce mot suggère à l’ordinaire. De fait il n’y a pas une once de crânerie vide dans ce nouveau roman de David Fauquemberg, formidable évocation du combat de l’homme en prise avec les éléments déchaînés, chasseur et poète, pêcheur et penseur de la plus noble lignée…
-
Ceux qui hantent le Dédale
 Celui qui va partout sans que ça se sache / Celle qui a les mollets tatoués de fleurs carnivores / Ceux qui font des performances sous le nuage rougeoyant / Celui qui a vu couler le navire amiral de la flotte impériale / Celle qui se reconnaît dans la grande fleur de papier clouée au mur / Ceux qui ont si peu de fantaisie qu’ils ne voient que dalle dans le musées des cloques / Celui dont la vanité blessée flatte l’orgueil / Celle dont l’œil reste coincé dans la serrure indiscrète / Ceux qui ont bien connu Cravan et Crevel les boxeurs à complications sentimentales / Celui qu’on dit le plus beau skater sarde hélas absent des images de Germinal le skatophile / Celle qui ne stresse pas quand le rapeur lui râpe les reins / Ceux qui trouvent au radiateur rouillé la même beauté mélancolique qu’à la Joconde et le même sourire ambigu si tu regardes bien / Celui qui chevauche la machine à coudre à tendances zoophiles / Celle qui reconnaît Madeleine Duras sur le tableau de Flynn dont on sait le goût pour les femmes garagistes / Ceux qui font de la musique bleue dans le salon grenat sans quitter leurs collants genre Mick Jagger déhanché / Celui qui rend leur dignité aux lettres encrées très noir genre Pollock avant les taches / Celle que l’inscription LESS THAN ZERO fait replonger (le plongeoir = das SprungBRET) dans ses souvenirs de Mulholland Drive et ses jeunes gens vagues / Ceux que les collages du capitaine Flynn font décoller / Celui qui balance son boomerang dans le ciel de l’été indien qu’un orage lui ramène entre les dents le printemps suivant / Celle qui vaticine dans l’antichambre papale où soupirent les pédos grondés / Ceux que leurs mots sucent par la racine / Celui qui met les mots en boîtes à bijoux / Celle qui se retrouve partout chez elle sauf à lamaison où son ex ne l’attend plus depuis le transfert de ses fonds sur le compte de l’avide psychiatre Gwendula / Ceux qui ont passé du conceptuel au contextuel sans cesser d’être cons comme des boulets / Celui qui a lancé la mode des veuves empaillées avec bijoux de prix / Celle qui se dit veuve de paille à ses nouveaux gigolos tout feu tout flamme / Ceux qui prétendent que François Hollande s’est fait une Malgache intégriste mais ça reste à prouver par le magazine Valeurs actuelles dont les sources sont parfois toxiques / Celui qui a lancé la mode du Barbie Mec à préférence sexuelle différente et votant social-démocrate / Celle qui n’a peur de rien sauf des plasticiens méchants heureusement rares / Ceux qui vous ont à l’œil genre Minotaure à cam de surveillance, etc.
Celui qui va partout sans que ça se sache / Celle qui a les mollets tatoués de fleurs carnivores / Ceux qui font des performances sous le nuage rougeoyant / Celui qui a vu couler le navire amiral de la flotte impériale / Celle qui se reconnaît dans la grande fleur de papier clouée au mur / Ceux qui ont si peu de fantaisie qu’ils ne voient que dalle dans le musées des cloques / Celui dont la vanité blessée flatte l’orgueil / Celle dont l’œil reste coincé dans la serrure indiscrète / Ceux qui ont bien connu Cravan et Crevel les boxeurs à complications sentimentales / Celui qu’on dit le plus beau skater sarde hélas absent des images de Germinal le skatophile / Celle qui ne stresse pas quand le rapeur lui râpe les reins / Ceux qui trouvent au radiateur rouillé la même beauté mélancolique qu’à la Joconde et le même sourire ambigu si tu regardes bien / Celui qui chevauche la machine à coudre à tendances zoophiles / Celle qui reconnaît Madeleine Duras sur le tableau de Flynn dont on sait le goût pour les femmes garagistes / Ceux qui font de la musique bleue dans le salon grenat sans quitter leurs collants genre Mick Jagger déhanché / Celui qui rend leur dignité aux lettres encrées très noir genre Pollock avant les taches / Celle que l’inscription LESS THAN ZERO fait replonger (le plongeoir = das SprungBRET) dans ses souvenirs de Mulholland Drive et ses jeunes gens vagues / Ceux que les collages du capitaine Flynn font décoller / Celui qui balance son boomerang dans le ciel de l’été indien qu’un orage lui ramène entre les dents le printemps suivant / Celle qui vaticine dans l’antichambre papale où soupirent les pédos grondés / Ceux que leurs mots sucent par la racine / Celui qui met les mots en boîtes à bijoux / Celle qui se retrouve partout chez elle sauf à lamaison où son ex ne l’attend plus depuis le transfert de ses fonds sur le compte de l’avide psychiatre Gwendula / Ceux qui ont passé du conceptuel au contextuel sans cesser d’être cons comme des boulets / Celui qui a lancé la mode des veuves empaillées avec bijoux de prix / Celle qui se dit veuve de paille à ses nouveaux gigolos tout feu tout flamme / Ceux qui prétendent que François Hollande s’est fait une Malgache intégriste mais ça reste à prouver par le magazine Valeurs actuelles dont les sources sont parfois toxiques / Celui qui a lancé la mode du Barbie Mec à préférence sexuelle différente et votant social-démocrate / Celle qui n’a peur de rien sauf des plasticiens méchants heureusement rares / Ceux qui vous ont à l’œil genre Minotaure à cam de surveillance, etc. -
Du chien

Diatribe de Ludwig Hohl contre les chiens supposés nuire à l'esprit; avec un bémol final...
Le plus clair de son temps, à quoi le passe-t-il ? Soit à faire ses besoins, soit à quêter l'odeur d'urine, aboiements à l'appui.
Le gros avantage de Vienne sur la Hollande, et même sur d'autres régions plus agréables: on n'y porte nulle estime à ces créatures sans nom, qui sont tenues au port de la muselière. C'est un début. Moi je rêve d'un Etat futur où les chiens seraient éradiqués. (Comme on fait aujourd'hui pour les sangliers, qui en comparaison ne sont que de braves bêtes innocentes. - Pour tout chien supprimé: une récompense; pour tout chien dissimulé, une amende).
Existe-t-il un seul homme d'esprit qui estime les chiens ?
Ils prétendent en avoir besoin pour garder la maison.- Pourquoi pas des ours, des serpents, des tigres ! Ceux-ci ne tuent que les corps; les chiens, eux, tuent l'esprit.
Et puis, qu'ont-ils donc à garder tellement ! Les voleurs ne sont pas aussi dangereux que les chiens, et de loin. Qu'on s'arrange pour posséder un bien qui ne peut être volé ! L'homme a le devoir d'être riche: la richesse, c'est la productivité, c'est le pouvoir de donner; si l'on est riche en argent, eh bien qu'on le donne.
Les sons émis par les chiens: simplement les sons !Existe-t-il un seul être pensant dont les pensées n'aient pas été tuées par cela ? - Sur mon âme ! Quand cela survient la nuit, quand l'aboiement déchire l'obscurité; quand dans la rue calme, surgi par derrière, un cabot renifle... - n'est-ce pas alors qu'il faudrait tenir, à portée de la main, un revolver chargé ?
Mais regarde donc les mouvements de cette créature accompagnant son "maître": as-tu des yeux ?
Regarde-les, regarde ces pieds plats, ces jambes hautes, ces longs poils et ces poils ras ! Regarde le manège de leur queue, leur démarche louvoyante et oblique ! Leur museau lubrique, leur langue pendante, leurs yeux doucereux et coulants, ou qui leur sortent de la tête comme des belladones; et leur pelage, paradis des puces ! Est-il rien de plus stupide qu'une patte de chien ? Regarde ces petits roquets blancs, ou ces chiens de berger, avec leur faciès de maître d'école ! Et qu'est-ce qui unit toutes ces créatures ? La recherche nasale, incessante et frénétique, de l'urine.
On peut faire une petite exception pour quelques exemplaires de certaines grandes races (à vrai dire je distingue mal des "races" parmi la racaille). Sans rien avoir qui les rapproche de l'homme ou des animaux supérieurs, ces quelques exemplaires évoqueraient plutôt le crapaud; c'est ça: leur comportement s'apparente vaguement à celui du crapaud.
En comparaison du chien, même la punaise est admirable. La punaise et ses entreprises fantastiques: telle un tank, elle accomplit avec peine un voyage infini, semé d'embûches et de complications.Parvenue au bout, elle oeuvre, toute à sa passion, sur le corps d'un homme dont les dimensions, comparées aux siennes, défient notre imagination: une montagne, mais une montagne qui remue, et qui pourrait se renverser sur elle.
Les chiens ! Pour ces créatures qu'on a coutume d'appeler Flora, Fauna, Victoria, je propose les noms suivants: Oeil-de-pute, Sac-à-puces, Innommable !. (*)
(*) On risque de ne pas comprendre qu'il s'agit de poser des principes, et non de haïr quelques pauvres créatures. Au fond, j'exhale surtout ma rage contre certaines caractéristiques humaines. Un certain type humain. S'il est nécessaire, cependant, de faire des exceptions, je citerai en tout premier lieu le petit chien décrit par Konrad Bänninger dans L'Esprit du devenir; et celui du Divan de Goethe, qui, avant d'être admis au paradis, a "si fidèlement accompagné les Sept Dormants" dans leur sommeil.
(...) Je pourrais citer encore d'autres cas. Je m'en tiens à celui-ci: je venais de poser ma plume et je sortais dans la rue. Là, juste au coin, un petit chien inconnu m'attendait; son regard était si plein de reproche que je compris tout de suite: "Il a lu mon texte". Il n'aboyait pas. Son reproche, si calme, confinait à la tristesse. Je lui donne ici l'assurance qu'il n'était pas concerné par ma diatribe.
Ludwig Hohl, Notes ou de la réconciliation non-prématurée. Traduit de l'allemand par Etienne Barilier. L'Age d'Homme, 1989, 535p,
Image: le fox Snoopy, ange gardien de La Désirade. -
Ouverture en beauté
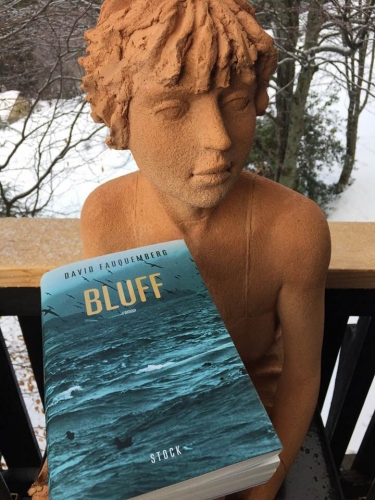
Premier grand livre de l'année 2018: Bluff, de David Fauquemberg, à paraître ces jours chez Stock.
C'est un pur bonheur, en ces premiers jours de l'an, de constater que le nouveau roman de mon socio David Fauquemberg, après les déjà si remarquables Nullarbor (Prix Nicolas Bouvier 2007), Mal tiempo et Manuel El Negro, marque une nouvelle envolée, à la fois épique et lestée de poésie élémentaire, d'un romancier à l'extraordinaire capacité d'évocation fondée sur la meilleure connaissance, concrète et vécue, du thème traité (ici le combat des hommes avec la mer au front sud de la Nouvelle-Zélande - entre le port de Bluff et les fjords propices à la pêche à la langouste - et le brassage des cultures locales à valeur universelle), avec un souffle et une empathie humaine renouvelés - bref, un premier grand livre pour marquer ce début d'année !!!
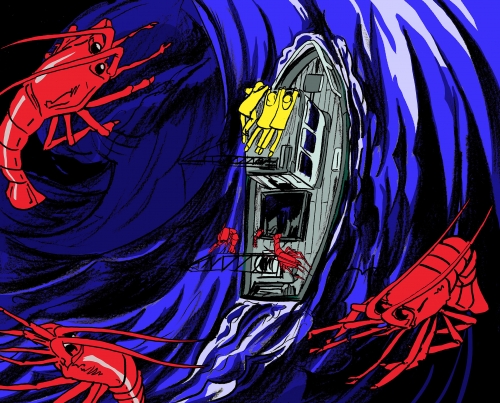
(Dessin original de Matthias Rihs pour la chronique de JLK sur Bluff, à venir...)
-
Appelfeld notre frère humain

En lisant La chambre de Mariana d’Aharon Appelfeld. Modeste révérence à un grand Monsieur qui vient d nous quitter.
Comment répondre aux mots de la haine ? Comment résister à la montée aux extrêmes ? Comment dire la ressemblance humaine ? Comment la capter et la transmettre ?
Ce sont les questions que je me posais en lisant La chambre de Mariana, l’un des plus beaux romans parus ces derniers temps, de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld, dont la voix est de celles qui, précisément, par leur intonation et leur musique, leur aura d’humanité, si l’on peut dire, exprime précisément la ressemblance humaine.Cette voix, que je retrouve chez le poète palestinien Mahmoud Darwich autant que chez le poète libanais Adonis ou chez le romancier français Hubert Haddad auteur de l’admirable Palestine (Zulma, 2007), cette voix module, dans La chambre de Mariana, une histoire qu'on pourrait trouver scabreuse, voire apparemment scandaleuse, qui me rappelle les histoires scabreuses et scandaleuses du grand écrivain serbe Aleksandar Tisma, telle L’Ecole d’impiété (L’Age d’Homme).
Pour le protéger des rafles de plus en plus massives qui sévissent dans le ghetto de leur petite ville des marches de l'Ukraine, après la déportation du père, la mère du petit Hugo, onze ans, le planque chez une sienne amie chrétienne travaillant dans une maison close, qui reçoit le garçon dans un réduit où elle le nourrit et le cajole tout en lui interdisant d’apparaître.
Avec ce mélange de tendresse lancinante et d’implacable netteté qui caractérise l’écriture d’Appelfeld, dans ce no man’s land à la fois précisément localisé et qu’on pourrait imaginer de partout, le romancier nous fait découvrir par le plus intime, donc le plus humainement ressemblant, ce que découvre le jeune garçon des cris des hommes et des parfums de la femmes, des siens qui viennent le visiter dans le rêve éveillé de sa prison et de l’Action inimaginable qui va les engloutir.
N’est-il pas sacrilège d’évoquer l’éveil de la sensualité d’un adolescent dans les bras d’une prostituée ? Pas un instant je ne l’ai pensé en lisant La Chambre d’Ariana, dont l’humanité qui s’en dégage pourrait être le fait d’un auteur palestinien ou tchétchène ou de n’importe quelle terre où vivent des hommes de bonne volonté.Il y a dans ce roman, nullement équivoque ou douteux, quelque chose d’infiniment pur et je dirai même de biblique, notamment dans les déchirantes et merveilleuses dernières pages replaçant ces années d’Hugo dans les années du long récit humain, qui ne tient peut-être, aussi bien, qu’à un sentiment commun à tous les hommes et à cette voix qui le filtre comme une musique – la seule à opposer aux mots de la haine.
 Aharon Appelfeld. La Chambre de Mariana. Traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti, 317p. 2008.
Aharon Appelfeld. La Chambre de Mariana. Traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti, 317p. 2008. -
Carnets volants
Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui refusent de s’asseoir à la table des moqueurs, etc...°°°Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dans quel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.
°°°Aux yeux de certains je fais figure d’extravagant, pour d’autres je suis celui qui a cédé au pouvoir médiatique, mais ma vérité est tout ailleurs, je le sais, n’ayant jamais varié d’un iota, ne m’étant soumis à rien d’autre qu’à mes élans et à mes pulsions, à ce qui m’anime et me fait vibrer depuis mon adolescence, et voilà: je me lève ce matin à six heures, j’ai trop bu hier soir, je n’aurais pas dû, etc. Du moins cela reste-t-il sûr à mes yeux : que je ne me résignerai jamais, contrairement à tant de compagnons de route d’un temps qui se sont arrêtés en chemin ou que la vie a amortis – jamais ne consentirai ni ne m’alignerai pour l’essentiel.°°°Malgré tout je me sens dans la main de Dieu. Ces aubes pures, aux fenêtres de La Désirade, sont autant de cantiques et tout aussitôt je me sens appelé à en témoigner.
Carnets de Thierry Vernet. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…Thierry était un artiste pur, sans rien du cérébral théoricien, ses lettres étaient d’un écrivain mais je trouve, dans ses carnets, qui fait écho à sa vision si singulière, une pensée non moins dense à fulgurances saisissantes, par exemple lorsqu’il note que « c’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie» et quand il constate que «la foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose», ou, sur un autre registre encore, plus obscur et non moins pénétrant, qu’«une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issue personnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».Il y a du protestant Amiel se flagellant dans certaines de ses admonestations, qui me rappellent mes propres repentances: « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais. »
Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».°°°Ma bonne amie ne cesse de m’émouvoir. Elle est essentiellement elle-même. Elle est toujours juste. Toujours elle-même et juste.°°°Celui qui ne s’étonne plus de l’ingéniosité mise par ses semblables à s’empoisonner l’existence / Celle qui est bonne comme le scout mais pas poire / Ceux que le mot de convivialité fait gerber mais qui aiment bien se trouver bien avec ceux qu’ils aiment bien, etc.°°Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts.°°°A qui me dit que je lui manque, jamais je ne manquerai.°°°Jean-Jacques Rousseau: «Seul celui qui marche est apte au réel».°°°En lisant La Suisse dans la tourmente de Jean-Jacques Langendorf, je me dis que je suis à la fois du parti de cet anar de droite et du parti de Niklaus Meienberg l’anar de gauche, ou plus exactement: du parti de ces Suisses à la manière d’Alfred Berchtold, qui envisagent à tout coup la thèse et l’antithèse, mais dans une nouvelle acception moins stable et moins régulière, finalement plus difficile à vivre dans la confusion des temps qui courent.°°° C.F. Ramuz.Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression littéraire, la Suisse n’existe pas en tant que telle, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire. Il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria. Ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée.Ceci cependant, du même Ramuz, que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme».Et ceci de Rousseau: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».°°°
C.F. Ramuz.Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression littéraire, la Suisse n’existe pas en tant que telle, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire. Il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria. Ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée.Ceci cependant, du même Ramuz, que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme».Et ceci de Rousseau: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».°°° Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde bientôt.Or l’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.°°°Ne m’intéresse plus que l’Objet. Cézanne ou l’objectivité sans limite.°°°Cézanne s’ouvre au monde en se coulant dans l’objet.°°°Me vient l’idée ce matin que le renoncement, le choix de ne pas faire ceci ou cela, la permission qu’on se refuse, peut être la plus belle manifestation de liberté. Ce que Soljenitsyne appelle l’autolimitation, si contraire à l’esprit du temps…°°°Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu. Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : Il se fait tard, de plus en plus tard...Au Chemin de la Dame, en Lavaux. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher de Rivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.Cette phrase achève Raison d’être, le bref essai que le jeune écrivain publia par manière de manifeste précédant, après un long séjour à Paris, son retour définitif en terre vaudoise : « Qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous.»°°°Devenir ignorant de soi-même - tendre à cela tout le temps.°°°Sans humilité: rien; sans amour: rien.°°°Il faut reprendre, tous les matins, la chasse aux dieux.°°°Tout devenant festif, il n’y a donc plus de fête.°°°L’obsession craintive de leur différence en a tiré ce bêlement grégaire.
Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde bientôt.Or l’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.°°°Ne m’intéresse plus que l’Objet. Cézanne ou l’objectivité sans limite.°°°Cézanne s’ouvre au monde en se coulant dans l’objet.°°°Me vient l’idée ce matin que le renoncement, le choix de ne pas faire ceci ou cela, la permission qu’on se refuse, peut être la plus belle manifestation de liberté. Ce que Soljenitsyne appelle l’autolimitation, si contraire à l’esprit du temps…°°°Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu. Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : Il se fait tard, de plus en plus tard...Au Chemin de la Dame, en Lavaux. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher de Rivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.Cette phrase achève Raison d’être, le bref essai que le jeune écrivain publia par manière de manifeste précédant, après un long séjour à Paris, son retour définitif en terre vaudoise : « Qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous.»°°°Devenir ignorant de soi-même - tendre à cela tout le temps.°°°Sans humilité: rien; sans amour: rien.°°°Il faut reprendre, tous les matins, la chasse aux dieux.°°°Tout devenant festif, il n’y a donc plus de fête.°°°L’obsession craintive de leur différence en a tiré ce bêlement grégaire. -
Carnets volants
 Nul des nains de jardin du paisible quartier n’a la moindre idée de ce qui a poussé les deux amis de tendre chair d’armer la minable 2 CV bleu clair avant que de la lancer, leur vingtaine de petits communistes à la con approchant, sur les routes défoncées de Pologne où le Parti appelle les foules à vociférer de concert contre l’agression américaine au Vietnam; où les rues sont grises et le ciel bas, mais où le cœur de tous leur semble plus artiste qu’ailleurs, plus flamboyantes les satires du Pouvoir dans les caveaux de Cracovie, plus vitale la révolution corps à corps du théâtre à la Grotowski ou à la Kantor; mais ensuite tout se fêle au parler vrai des gens, tout l’écart entre grands mots et pauvres choses se laisse voir; moi le petit crevé de léniniste à la flan je conseille espérance & patience aux camarades désespérés, mais ça sonne de travers, et nous voici devant l’inscription libératrice d’ARBEIT MACHT FREI, au seuil de l’usine à tuer, et c’est alors que sur un cahier marqué POLSKI je commence à noter tout ça pour me le rappeler…
Nul des nains de jardin du paisible quartier n’a la moindre idée de ce qui a poussé les deux amis de tendre chair d’armer la minable 2 CV bleu clair avant que de la lancer, leur vingtaine de petits communistes à la con approchant, sur les routes défoncées de Pologne où le Parti appelle les foules à vociférer de concert contre l’agression américaine au Vietnam; où les rues sont grises et le ciel bas, mais où le cœur de tous leur semble plus artiste qu’ailleurs, plus flamboyantes les satires du Pouvoir dans les caveaux de Cracovie, plus vitale la révolution corps à corps du théâtre à la Grotowski ou à la Kantor; mais ensuite tout se fêle au parler vrai des gens, tout l’écart entre grands mots et pauvres choses se laisse voir; moi le petit crevé de léniniste à la flan je conseille espérance & patience aux camarades désespérés, mais ça sonne de travers, et nous voici devant l’inscription libératrice d’ARBEIT MACHT FREI, au seuil de l’usine à tuer, et c’est alors que sur un cahier marqué POLSKI je commence à noter tout ça pour me le rappeler… -
Divers savoirs

Le DEDANS de la maison est un savoir du cœur à la vie à la mort, on y revient tôt le matin quand on est jeune et tard le soir quand on a vu tout ce qu’il y a DEHORS et qu’on parle à ceux qui ne sont plus.
Il y a des maisons dans le ciel et dans notre maison s’en cache une autre que j’appelle tantôt mon île au Trésor et ma Garabagne ; c’est une soupente interdite à quiconque en ignore le code secret ; là s’entassent les boîtes de papillons et les herbiers, moult préparations alchimiques en bocaux, mes premiers grimoires et les relevés des records toutes catégories de la Compagnie du Ruisseau dont j’ai repris le commandement depuis que notre grand frère va aux filles.
Les garçons de la Maison de Correction, tout en haut du quartier, en ont appris plus que nous, plus tôt et désormais sans pleurs, la rage au sang d’être nés dans les quartiers mal habités et de faire semblant de garder le rang, mais nos cabanes en forêt font bon accueil aux sinistrés du cœur.
-
Gare à l'espion !

Il est à noter que cet enfant regarde par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’est en son for intime qu’il a l’air de sonder tout le temps que dure la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvent se dérober c’est lui qui scrute et que tout le reste du temps il épie, observe : observe la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observe le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on sait des longs intermèdes de sa tournée, observe la salutiste en sempiternel tablier gris, observe et note tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit pour le moment mais il est à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en sera-t-il alors de notre tranquillité, je vous le demande ?
Image: Philip Seelen.
-
Ceux qui s'attendent à tout
Celui qui n’y est pour personne / Celle qu’on a oubliée dans l’antichambre des viennent ensuite / Ceux qui vivent en autarcie dans le container bio / Celui qui avait de la bouteille et s’est cassé en conséquence / Celle qui n’a plus été utile aux cadres moyens / Ceux qui avaient pourtant lu L’Ecclesiaste / Celui qui a été lâché par ses chiens / Celle qui n’est plus sur l’organigramme pour cause de surpoids / Ceux qu’on a enterrés vivants par souci d’économie / Celui qui est ressuscité à Noël par erreur de timing / Celle qui va foncer dans la nouvelle année équipée de pneus à clous à l’instar des épouses de cadres de la multinationale Nestlé / Ceux qui n’oublieront jamais ce qui a été il y a un siècle à l’époque de Staline le bourreau d’Auschmitz / Celui qu’on a zappé dans le programme spatial / Celle qui a été rejetée de l’hoirie quand son fils est sorti du placard / Ceux qui ne répondent pas à celles qui ne leur demandent rien / Celui qui se sent seul dans l’univers immense aux galaxies pleines de trous noirs / Celle qui a épousé un télescope pour voir plus loin / Ceux qui se ramassent et vont voir dans la quatrième dimension ce qu’il en est du cinquième élément / Celui qui prend toujours de bonnes résolutions à l’approche du 30 décembre alors que le 29 lui reste en travers de la gorge / Celle qui relit toujours un peu de Mauriac en fin d’année / Ceux qui font le plein de leur demi verre vide, etc.Image JLK: le Bouddha Gupta de la Désirade. -
Le blues des heures nues

En mémoire d'Asa Lanova, décédée le 26 décembre 2017 à Lausanne.
Les heures nues, que désigne le titre du dernier récit autobiographique d’Asa Lanova - peut-être l’un de ses plus beaux livres du point de vue de la musique des phrases -, sont celles de la lucidité de plus en plus aiguë qui nous vient, avant l’aube, au fur et à mesure que nous prenons de l’âge. La sourde angoisse, liée au vieillissement, de celle qui a connu la « grande obsession » de l’érotisme, ne trouvera d’exorcisme que par les mots, réunis ici en longs colliers de phrases splendides, dont le déploiement proustien contraste cependant avec l’étroitesse du « théâtre » investi en l’occurrence, entre le lit couvert de chats de la narratrice, le jardin où la porte sa première rêverie matinale, la « chambre aux mots » où la ramène la discipline « quasi militaire » de l’écriture, les allées enfin de ses souvenirs.
À ceux-ci est associé un amour-passion passager vécu dans la prime jeunesse avec Maurice Béjart, visiblement exalté à proportion de l’aura de celui-ci, entre fantasme de l’âge et retour à la cruelle réalité, puisque « Satan » ne répond pas vraiment. La remémoration d’un autre lien, à la fois littéraire et affectif, avec l’éditeur et écrivain Georges Belmont, dégage une bien plus réelle émotion alors que « Maestro », comme la disciple le surnomme, s’approche de sa propre fin.
Une dernière étreinte avec un certain Stanislas de passage, aussi intense que brève, et sans lendemain, marquera-t-elle le terme d’une vie marquée par la hantise du sexe? Ce qui est sûr est que les plus belles pages de ce livre ne sont pas celles que tisse ce remugle d’érotisme solitaire, mais celles qui se vouent à la célébration de la simple vie, des animaux entourant leur sorcière bien-aimée, des oiseaux, des aubes pures et des nuits de solitude de la narratrice tissant sa toile, à l’encre violette, avec une grâce arachnéenne.Asa Lanova, Les heures nues. Campiche, 159p.
-
La Fileuse
En mémoire de notre petite mère, née le 27 décembre 1917.
Ludmila tricota pas mal ces années-là, et peut-être s’y remettra-t-elle ces prochains jours alors que tous les voyants de l’économie sont au rouge, selon l’expression répandue, Ludmila tricotera comme nos mères et les mères de nos mères ont tricoté, et le monde tricoté s’en trouvera conforté en son économie.
Le monde actuel se défaufile, me disait déjà Monsieur Lesage quand j’allais le rejoindre au Rameau d’or. Tout s’effondre de ce qu’on a construit sur la haine et le vent. Tout a été gaspillé pour du vent. Tout a été pillé et part en fumée, disait Monsieur Lesage en tirant sur sa clope ; il en était à sa troisième chimio et ses traits s’étaient émaciés au point de m’évoquer ceux du poète Robert Walser qu’il aimait tant, soit dit en passant, lesquels traits me rappelaient à tous coups les traits de Grossvater et non seulement ses traits mais aussi sa posture et sa façon de se tenir modestement au bord d’une route de campagne, sa façon aussi de traiter des questions d’économie.
Jamais je n’avais vu Monsieur Lesage ailleurs que dans son siège curule du Rameau d’or ou sur le pont roulant de sa librairie, immobile et songeur, à lire en tirant sur sa clope, mais il y avait chez lui quelque chose du promeneur jamais chez lui, tout semblant dire chez lui que la vraie vie est ailleurs, cependant il me criblait à présent de questions sur l’enfant, sans prêter trop d’attention à mes récits de père niaiseux : l’enfant parlait-il déjà ? L’enfant s’était-il mis à lire ? L’enfant écrirait-il bientôt ?
Puis il revenait aux questions qui le préoccupaient à l’époque, alors que progressait sa maladie sans le dissuader pour autant de tirer sur sa clope – ces questions liées à ce qu’il appelait la Guerre des Objets, questions de pure économie à ce qu’il me disait.
Vous verrez, mon ami, me disait Monsieur Lesage en ces années déjà, vous verrez qu’ils iront dans le Mur. Ils auront des voitures toujours plus puissantes et cela les fera jouir de foncer dans le mur. En vérité, en vérité, prophétisait parodiquement Monsieur Lesage, me rappelant les sermons pesamment ingénus de Grossvater en nos enfances, en vérité ce monde est juste bon à s’éclater, et vous verrez qu’il en éclatera.
Monsieur Lesage grimaçait de douleur, tout en me souriant à cause de l’enfant ; et c’est en souriant, sans cesser de tirer sur sa clope, qu’il m’entendit lui évoquer le dernier état de ma Mère à l’enfant et mon autre intention de peindre Ludmila tricotant.
La femme a toujours tricoté, me disait Monsieur Lesage en tirant sur sa clope, je ne dis pas qu’elle ne sait faire que ça, je n’ai jamais dit ça, vous savez combien j’ai aimé les femmes, dont aucune ne tricotait que je sache, mais la femme en tant que femme, la vraie femme, la femme originelle, la fileuse qui s’active dès l’aurore n’est en rien à mes yeux l’image d’une imbécile juste bonne à faire cliqueter ses aiguilles, car c’est avec elle que tout commence, du premier geste de choisir le fil à celui de le couper, suivez mon regard, et Monsieur Lesage allumait sa nouvelle Boyard au mégot de la précédente.
°°°
Ludmila tricotait dans la douce lumière de l’impasse des Philosophes, à longueur d’après-midi, surveillant d’un œil l’enfant à son jeu, et c’était son histoire, et c’était son passé et notre futur qu’elle tricotait de son geste expert, une maille à l’envers puis à l’endroit.
Le fil du Temps courait ainsi sous les doigts experts de Ludmila et nos mères s’en félicitaient et se remettaient elles aussi à tricoter en douce au dam de l’esprit du temps, selon lequel tricoter est indigne de la Femme Actuelle faite pour le secrétariat et le fonctionnariat ; Ludmila tricotait en écoutant La Traviata ou, la fenêtre ouverte dès le retour du printemps, la simple musique des jours à l’impasse des Philosophes, les canards qui passaient en petite procession ou le chat, le docteur, le facteur ou le brocanteur – Ludmila tricotait et le temps passait, Ludmila tricotait les paysages et les paysages changeaient, il y avait des chemins là-bas où des enfants s‘en allaient, enfin une après-midi je m’en fus seul au cimetière jeter une poignée de terre sur le cercueil de Monsieur Lesage, Ludmila venait de couper son fil sur sa dent et je murmurai les derniers mots que mon ami avait murmurés avant son crénom de trépas : J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas, les merveilleux nuages…
(Extrait de L'Enfant prodigue).
Dessin de Richard Aeschlimann
-
Douce dinguerie de Robert Walser
Retour amont sur Le brigand, roman inédit du vivant du grand écrivain alémanique (1878-1956). Une pure musique au bord des gouffres de l'aliénation.
On lit Walser dans un tea-room comme on cheminerait dans une prairie lustrale bordée d'abîmes, avec un mélange de bonheur souriant et d'irrépressible angoisse. C'est que le noir à lèvres de la trop jolie serveuse, là-bas, lui fait une gueule de poupée fatale.On pense aux putes peintes aux auras de saintes de Louis Soutter. C'est à la fois doux et fou, accueillant et vertigineux, gentiment atroce. Il est possible au tea- room, avec son thé crème, de consommer un Weggli, ou bien un Stangeli, un Ringli ou un Gipfeli. Après qu'on a dit: «Merci bien» à la serveuse, elle répond: «Service». On lui donnerait un bec ou on l'étranglerait: c'est la Suisse.
Le poète, en lisant le journal (tuerie en Angola et en Bosnie, légère embellie à Moribundia), songe au réconfort de la nature innocente. «Comme l'ombre des arbres nous fait du bien», remarque-t-il avant de se rappeler tel paysage «hölderlinement clair et beau». S'il était normal il se dirait: «Cette sommiche me zyeute, je me la fais.» Mais son amour est trop grand pour ce cliché de roman-photo. «L'amour est quelque chose d'absolument indépendant», griffonne-t-il. Et à un docteur il s'exclamera: «Ma maladie, si je peux appeler ainsi mon état, consiste peut-être en un excès d'amour.»
Pourtant, cet amour, le poète ne semble capable de le «faire» que par les mots. Bien entendu, les dames du tea-room le pressent de se marier avec telle Fräulein Wanda, ou telle Edith, telle Selma, et qu'il publie enfin un livre positif. Le poète voudrait bien faire plaisir («une jolie conduite nous rend jolis») à cette «foule de manteaux de dame». Hélas il ne peut qu'ironiser: «Le mieux c'est que j'aie un enfant et que je le présente à une maison d'édition, qui ne pourra guère le refuser.»
Or cette indéniable dinguerie n'empêche pas son art de la narration digressive de faire merveille, à l'enseigne d'une lucidité souvent fulgurante et jamais démentie par la suite d'ailleurs, comme l'attestent les propos recueillis par Carl Seelig lors de leurs fameuses promenades.
Publier un enfant, choyer un livre d'un tendre bout decrayon argenté, dérober à mesdames et messieurs leurs beaux pensers et sentiments (le brigand, double du narrateur, pique ses idées aux romans à quatre sous des kiosques) pour les aligner sur papier couché comme une bruissante foule de lilliputiens hiéroglyphique de deux millimètres de haut :c'est à cela que s'emploie Robert Walser à l'été 1925, quand il écrit Le brigand.
Ultime fécondité
Si les dames du tea-room en avaient seulement connaissance, le drôle aurait encore droit à leur considération de forme: son recueil La rose vient de paraître à Berlin chez Rowohlt, et les meilleurs auteurs du moment (de Musil à Hesse, puis de Kafka à Walter Benjamin) lui tressent des couronnes.
En outre il aligne, en ces années, un nombre extravagant de proses (plus de 500 de 1924 à 1928) qu'on lui prend encore un peu partout, de Berlin à Prague, ou de Berne à Vienne. En 1925, il écrit: «Un temps on me tenait pour fou, et disait tout haut quand je passais sous nos arcades: «Il faut le mettre à l'asile», comme si le mal était conjuré. Cependant divers signes préludent à un effondrement que les gens raisonnables (notamment les directeurs de journaux abrutis de nazisme) contribueront à précipiter. La suite est biographique: de nouvelles crises, l'internement à la Waldau de 1929 à 1933, puis à Herisau de 1933 à 1956 où, le jour de Noël, on retrouve le corps du poète sans vie dans la neige, reproduisant la scène d'un sien roman de jeunesse...
Plus que de l'art brut, dont on croit savoir ce qu'il est, Le brigand désorientera les gens par trop raisonnables, mais pour peu que vous ayez en vous de la graine d'enfant ou un soupçon de folie, lisez ce livre tissé de fantaisie et de lyrisme mélancolique. Les vingt-quatre feuillets micrographiés qui le constituent, que Carl Seelig imaginait un objet relevant de l'art brut, se distinguent cependant absolument de celui-ci: il n'est que de comparer sa cohérence formelle et sa pénétration d'esprit au délire autiste d'un Adolf Wöffli, par exemple.
 Sans outrance, l'on peut classer Le brigand, inédit du vivant de l'auteur puisqu'il ne fut déchiffré qu'en 1972, parmi les textes majeurs de Robert Walser. L'on y chemine, en longeant la rumeur noire des gouffres, comme dans un jardin candide où retentirait la plus pure musique.
Sans outrance, l'on peut classer Le brigand, inédit du vivant de l'auteur puisqu'il ne fut déchiffré qu'en 1972, parmi les textes majeurs de Robert Walser. L'on y chemine, en longeant la rumeur noire des gouffres, comme dans un jardin candide où retentirait la plus pure musique. Robert Walser. Le brigand, traduit (excellemment) par Jean Launay, Ed. Gallimard, 158 pages.
Carl Seelig: Promenades avec Robert Walser, Ed. Rivages, 178 pages.
-
Ceux qui entendent des voix

Celui qui dirige la manécanterie sans descendre de selle / Celle dont la voix donne l’idée d’un ciel japonais au-dessus de la neige / Ceux qui luttent contre la saleté de leurs venelles mentales / Celui qui a deux voix mais une seule paire de ciseaux dans son nécessaire de voyage/ Celle qui chante comme la Castafiore en plus andalou / Ceux qui ont entendu grincer Caruso sur les 78 tours de la cousine de Marcel Proust / Celui qui a une voix de tête sous son bonnet d’âne / Celle qu’on dit la Schwarzkopf des têtes blanches / Ceux qui chantent dans la forêt de cèdres du couvent chinois / Celui qui a appris à solfier sous la direction du gros lard à l’âme pure / Celle qui déchiffre la partition de Palestrina les yeux fermés / Ceux qui formatent le goût des petits soldats à la Croix de fer / Celui qui s’est pacsé avec le soprano colorature qui partageait à dix ans son goût pour le baroque italien et les aventures de Pif le chien / Celle qui n’a jamais confondu les styles de Jessye Norman et de Janet Baker au risque de se faire traiter de bêcheuse par les dactylographes de la firme Anyway / Ceux qui se retrouvent en pleine forme après avoir entendu les Kindertitenlieder de Gustave Mahler dont un des enfants aussi n’a pas eu de chance comme tant d’autres à cette époque hygiéniquement peu sûre / Celui qui a baptisé ses braques allemands Ali et Shmuel par manière de geste pacificateur / Celle qui nourrit ses rossignols au ris de veau citronné / Ceux qui chantent sur la même branche de poirier virtuel / Celui qui affirme que sa voix lui permet de mieux entendre ce qu’il ressent / Celle qui en a tant vu qu’elle ne fait plus que boire / Ceux qui vont en colonies surveillées pour chanter la liberté / Celui qui regarde le livre d’art en se demandant ce que valent ces vierges sur le marché / Celle qui a entendu la Bartoli chanter au Qatar / Ceux qui préfèrent le karaoké à Benidorm , etc.
Peinture: Michael Sowa.
-
Ceux qui ont une mémoire vive

Celui qui se rappelle le bleu délavé des cornets dans lesquels était ensaché le sucre d'orge que le père Buttet de l'épicerie du quartier tenait dans son arrière-boutique / Celle qui a commis son premier larcin (un miroir de poche et un tube de rouge) au nouvel Uniprix / Ceux qui louaient des jardins ouvriers sous-gare / Celui qui se retrouve au Café Le Bout du monde pour écrire dans la même ambiance à peu près (à parois de vieux bois et à sièges de cuir grenat) que celle du Barbare à l'époque des premiers Stones et d'Amsterdam de Brel et de la Black and Tan Fantasy par Earl Hines dans le juke-box / Celle qui t'a snobé quand tu lui as proposé le porte-bagages de ton premier Vélosolex / Ceux qui écoutaient la nuit les dernières nouvelles de Hongrie sur le poste à galène du frère aîné / Celui qui en veut (un peu) à sa mère d'avoir bazardé ses collections d'Artima (Tex Bill, Red Canyon, et,) et de Bob Morane durant un de ses à-fonds de printemps / Celle dont les ongles sentaient le Cutex / Ceux qui se rappellent le premier microsillon écouté en famille sur le nouvel électrophone, d'Harry Belafonte chantant Day O / Celui qui se rappelle son premier documentaire au Cinéac avec son grand-père Emile sur les oiseaux des marais précédé d'un Charlot / Celle qui est restée songeuse en découvrant la publicité de la gaine Scandale / Ceux qui ont commandé les fascicules de culture physique dite "sculpture humaine" de Robert Duranton le plus bel athlète de France posant en slip minumum sur la réclame / Celui qui ferme les yeux pour retrouver l'odeur de son premier labo photo dans le cellier familial/ Ceux qui te faisaient marrer comme placeur au cinéma de quartier Le Colisée quand ils revenaient voir dix fois le mêm efilm et partaient après la scène osée / Celui qui revoit le paravent derrière lequel se changer dans la chambre qu'il partagea avec ses parents dans un hôtel miteux de Suresnes lors de leur première escapade parisienne / Celle qui disait: c'est spécial devant toute repro de tableau abstrait ou encore: bah, c'est du Picasso ! / Ceux qui ont chopé la passion des modèles réduits vers 1960 donc avant Kennedy et la conquête de la lune / Celui qui se souvient de la toile genre fleurier qu'on étalait sous le grand pommier pour goûter en été / Celui qui était assez à cheval sur la déco de sa deux-chevaux / Celle qui a demandé à Paulo le mécano de remonter le moteur de son Florett qu'elle avait imprudemment entrepris de nettoyer avec de l'huile de colza / Ceux qui ont dansé le twist à leur première surpatte où certaisn garçons hardis se sont risqués à la langue fourrée / Celui qui a opté pour la mécanique à seize ans déjà et a a engrossé Josyane peu après ce qui a fait dire au pasteur qu'il avait de l'avance à l'allumage ah ah ces pasteurs quel humour n'est-ce pas ? / Celui qui parle d'"évacuation propre et radicale" à propos de la gestion de ses cendres / Celle qui est redevenue aussi seule qu'en son enfance après un veuvage serein et le constat ma foi que les bons maris sont rares / Ceux qui ont eu vent de la femme-canon mais ne l'ont jamais vue de leur vivant pas plus que Grock le clown suisse allemand / Celui qui a meulé pour recevoir le porte-avions Forrestal à Noël mais n'a jamais fini de le monter / Celle qui aimait passer près des vanniers du quartier de Gitania que sa mère lui recommandait d'éviter à cause qu'on sait jamais avec ces gens-là / Ceux qui jouaient le dimanche à la voiture dans la pièce avec deux fauteuils renversés pendant que les parents étaient au culte / Celui qui a retrouvé Dieu sait où cette image de l'école du dimanche protestante représentant un Jésus style beatnik avant la lettre / Celle qui a été la première à s'afficher avec un Italien et ensuite elle est devenue danseuse de cabaret alors tu vois Marlyse où ça mène / Ceux qui ont investi l'épave de la Chrysler au fond du ravin de la route d'en haut et là c'est des sacrées virées qu'ils ont fait en imagination / Celui qui tenait pour les voyous de la maison de redressement quand les costauds du quartier juraient de leur faire la peau et revenaient tout lacérés / Celle qui se rappelle l'arrivée au collège de Johnny Simenon que le chauffeur de la Rolls laissait un peu en contrehaut comme pour ne pas susciter des envies / Ceux qui de toute façon n'iront pas en section latine vu leur origine sociale mal barrée / Celui qui n'en a ajmais voulu à ses parents de n'avoir pas les moyens comme ils disaient / Celle qui a toujours trouvé le moyen de moyenner comme elle disait /Ceux qui ont eu le souci de transmettre sans prescriptions particulières pour autant /Celui qui a de probables souvenirs de sa troisième années mais avant c'est moins sûr / Celle qui a gardé son Hermès Baby dont le ruban est un peu mité à l'heure qu'il est / Ceux qui ont passé à l'ordi vers le mitan des années 80 et certains sur Atari comme bibi et François Bon / Ceux qui ont passé de l'Underwod d'occase genre Hemingway à l'Olivetti portable genre Buzzati puis à la Remington et à la première Adler électrique suivie de la petite Canon et du premier Atari payé trop cher et remplacé finalement par la gamme des Mac's et des PC dont ce dernier ACER professionnaly Tuned sur lequel je recopie cette liste notée dans les marges de l'Autobiographie des objets de François Bon paru en août 2012 aux éditions du Seuil aux bons soins d'un imprimeur labellisé vert supprimant l'utilisation des produits toxiques,etc.
Images: François Bon et la machine à écrire de Patricia Highsmith
-
Les ombres lumineuses

Constellations poétiques de W.G. Sebald.
Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, qu’on retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du dernier recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre : « Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer : un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en célesta clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté »…Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.
Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald. Celui-ci prolonge la tradition des grands promeneurs européens qui va de Thomas Platter, le futur grand érudit descendu pieds nus de sa montagne avec les troupes d’escholiers marchant jusqu’en Pologne, Ulrich Bräker le berger du Toggenburg qui traduira Shakespeare, ou Robert Walser se mettant « pour ainsi dire lui-même sous tutelle », comme l’écrit Sebald, sans cesser de griffonner de son minuscule bout de crayon sous les étoiles…
Une magnifique évocation posthume de W.G. Sebald, par son ami l’artiste Jan Peter Tripp, conclut ces Séjours à la campagne en situant le grand art de l’écrivain dans la tradition des graveurs de la manière noire. « Homme enseveli sous les ténèbres, ce maître du temps et de l’espace dont le regard s’animait au royaume des Ombres, n’était-il pas devenu lui-même, au fil des ans, dans son Royaume mélancolique, une sorte de plante de l’ombre ? D’ailleurs, dans son pays d’adoption, l’Angleterre, la manière noire avait connu au XVIIIe siècle un épanouissement unique, porté par les plus grands artistes. Travailler en partant des ténères pour aller vers la lumière est une question de conscience – ôter de la noirceur au lieu d’apporter la clarté. Aussi l’habitant de l’ombre devait-il ne s’exposer qu’avec précaution à l’éclat de la lumière ».
C’est exactement le processus par lequel Sebald, dans cette suite de plongées dans le temps que constituent ses approches des œuvres de Hebel, Rousseau, Möricke, Keller, Walser ou Tripp lui-même, qui sont à chaque fois des approches de visages engloutis dans la nuit du Temps, révèle progressivement les traits d’une destinée particulière cristallisant les éléments dominants de telle ou telle époque en tel ou tel lieu.
Après la terrifiante traversée de l’Allemagne en flammes, dans Une destruction, Sebald rassemble ici plusieurs avatars de la culture préalpine et du mode de vie propres à l’Allemagne du Sud et à la Suisse, dont un élément commun est cette Weltfrömmigkeit (une sorte de métaphysique naturelle ou de mystique panthéiste assez caractéristique du romantisme allemand) qu’il trouve chez Gottfried Keller, dont le chapitre qu’il lui consacre, autour de Martin Salander et d’Henri le Vert, est une pure merveille.Je n’en retiendrai que cette mise en évidence d’une scène emblématique d’Henri le Vert, aussi profondément poétique que l’évocation proustienne des livres de Bergotte survivant à celui-ci dans une vitrine à la manière d’ailes déployées, où l’on voit Henri ajuster, sur le cercueil de sa cousine Anna, une petite fenêtre de verre sur laquelle, en transparence, il découvre le reflet d’une gravure de petits anges musiciens. Et Sebald de préciser aussitôt : « La consolation qu’Henri trouve dans ce chapitre de l’histoire de sa vie n’a rien à voir avec l’espérance d’une félicité céleste (…) La réconciliation avec la mort n’a lieu pour Keller que dans l’ici-bas, dans le travail bien fait, dans le reflet blanc et neigeux du bois des sapin, dans la calme traversée en barque avec la plaque de verre et dans la perception, au travers du voile d’affliction qui lentement se lève, de la beauté de l’air, de la lumière et de l’eau pure, qu’aucune transcendance ne vient troubler »…
W.G. Sebald. Séjours à la campagne. Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau. Actes Sud, 200p. -
Longue vie aux rêveurs doux !

À la démence collective et chaotique des temps qui courent, le sens commun et l’humanisme sensible opposent le contrepoison du comique grinçant ou de l’exagération poétique révélatrice. Le film apparemment délirant de Yorgos Lanthimos, The Lobster, en est la troublante illustration. Après Orwell et Buzzati, la fiction fantastique éclaire la réalité. Le réalisme panique exorcise la violence par la douceur...
Chronique de JLK

Nos églises progressistes seront-elles bientôt équipées de jacuzzis ? Quand nos médias pluralistes dénonceront-ils enfin la torture des masturbateurs par le supplice du grille-pain ? Et quel nouveau tribunal international va-t-il légiférer à propos du crime contre l’humanité que représente l’humour noir ?
Telles sont les questions qui me sont venues pêle-mêle à l’esprit (mauvais esprit es-tu là ?) en réaction à deux faits récents, entre tant d’autres, me semblant dignes d’attention.

Le premier est l’installation, en l’église protestante de Vennes, dans le quartier de notre enfance des hauts de Lausanne, d’un parterre de fauteuils, divans, bergères et autres poufs confortables remplaçant les rangs quasi militaires de bancs de bois dur de jadis (souvenir de nos derrières meurtris dès l’école du dimanche) de façon conviviale et décontractée, non plus face au choeur obsolète sommé de l’inscription DIEU EST AMOUR, mais aux claires verrières latérales donnant sur les toits des villas Mon Rêve du quartier voisin.

Le second est la découverte d’un film tout à fait stupéfiant à mes yeux, intitulé The Lobster et dont la sortie m’avait échappé en 2015, qui parle d’amour, de sexe, de sentiments personnels profonds et de coercition sociale d’une façon à la fois crue et quasi délirante (en apparence), relevant à la fois du fantastique social et de la poésie tendre.
Si Johnny est un dieu, va pour le karaoké…
La folie ordinaire de notre monde est un thème sérieux, dont je m’étonne qu‘il soit si peu traité par nos jeunes auteur(e)s et cinéastes, à quelque exceptions près, mais l’impatience n’est pas de mise dans un contexte de mutation : il faut juste être attentif.
S’agissant des canapés installés en l’église de Vennes aux fins de relancer l’attractivité du culte dominical en ce lieu jadis si grave, voire froid, je balance entre deux réactions – de rejet viscéral et de compréhension plus débonnaire - liés à mon expérience personnelle.
Parce que j’ai vu, de près, ce qu’est une paroisse protestante. Que j’y ai suivi des sermons plus ou moins assommants et perçu des relents de sourcilleux conformisme social, avant l’apparition d’un formidable pasteur, revêche et bon, dont le verbe cinglant et la présence irradiait ce qu’on peut dire l’intelligence du coeur.
Un premier mouvement naturel m’a fait rejeter cette innovation assez significative, à mes yeux, de la décomposition d’une communauté dont les rites s’étiolent, sur quoi j’ai pensé que ces gens, bien cools au pied de la croix (!) vivaient peut-être la chose de bonne foi, au double sens du terme.

Je ne sais pas, mais je me souviens : je me revois, autour de mes quinze ans plutôt rebelles, en face du pasteur Pierre Volet aux bacchantes à la Brassens. Ce type, qui avait côtoyé les prêtres-ouvriers de Marseille, ne dorait pas la pilule. Quant il parlait à Vennes, l’église était pleine. Mais rien chez lui des artifices propres aux télévangélistes américains ou à leurs émules de partout, et les gens se foutaient pas mal d’être mal assis sur ces bancs punitifs !
Du coup je me dis, aujourd’hui, à propos des divans et des coussins de l’église de nos chers vieux: et pourquoi pas ? Le rabbi Iéshouah a-t-il jamais exigé qu’on l’écoute au garde-à-vous ? Et ne vaudrait-il pas mieux stigmatiser les imposteurs qui se servent des textes sacrés pour dominer leurs semblables, violer les cœurs et les corps ?
Sur quoi je me dis, chrétien mécréant que je suis, que ces nuances me gonflent. Après tout qu’ils vivent l’église comme ils le sentent, ces braves paroissiens, avec des flippers et des scènes de karaoké si ça leur chante, pourvu que passe ce quelque chose que je n’ai pas envie de nommer, crainte d’en dire trop ou pas assez…
Redites-moi des choses tendres…
 Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.
Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.En l’occurrence, le DIEU EST AMOUR du temple de nos enfances n’a plus d’écho que déformé, monstrueusement, falsifié comme celui qui sert de caution aux centaines de prêtres violeurs australiens (le journal de ce matin) rejoignant les milliers et les millions de prédateurs consacrés ou non invoquant dieu sait quel Dieu ou n’obéissant qu’à leur démons - ce qui revient au même.

Il n’est pas question une seule fois, dans The Lobster, de religion au sens habituel, ni de pouvoir ecclésiastique ou politique. Cependant dès les premiers plans du film, quelque chose se passe qui relève du sacré, marqué par la mort absurde d’un animal. Une femme, sortant de sa voiture sous la pluie, en pleine campagne où paissent trois ânes, brandit soudain un revolver et flingue l’un des animaux. Ensuite un homme barbu au regard sombre, prénom David, se pointe avec son chien Bob dans une espèce d’hôtel dont la négresse réceptionniste (on dira plutôt : employée de couleur) lui explique qu’il a 45 jours pour trouver une conjointe (il a perdu la femme qu’il aimait et il est interdit de rester seul en ces lieux) faute de quoi il sera changé en l’animal de son choix – un homard en ce qui le concerne.

La spectatrice et le spectateur (pour parler en langage inclusif rôdé) ont appris entretemps que le chien Bob de David (Colin Farrell qui a dû se laisser pousser la barbe) est son frère réincarné, dont la mort lui tirera des larmes quand la femme sans cœur qu’il a cru bon d’épouser dans l’intervalle le tuera pour l’éprouver…
Parmi les animaux dénaturés
Le sous-titre de The Lobster est Une histoire d’amour, et c’est exactement ça. Ou plus précisément: l’histoire de David fuyant le monde des animaux dénaturés que sont devenus les hommes, en ce lieu de triage collectif où il est strictement interdit de se livrer à l’égoïste masturbation (la main du contrevenant est châtiée par le supplice du grille-pain) et requis de s’exercer au frottage sexuel à l’essai avant l’accouplement marital.
Or, rejeté par la femme sans cœur au visage glacial, David se réfugie dans la forêt des solitaires, proies de chasses quotidiennes pour les aspirants au mariage salvateur, mais eux-mêmes soumis à des règles strictes en matière de relations affectives ou sexuelles.
Terribles humains ! Que n’est-on plutôt marmotte farouche, chat angora ou chien regardant franchement Dieu en face, comme dans la nouvelle de Buzzati !

Les réseaux sociaux ont frémi, à propos de The Lobster, de toute l’indignation des lectrices et lecteurs d’histoires d’amour ordinaires, où le beau garagiste romantique et l’aristocrate mélomane vivent mille tribulations (tendances homo du fier mécanicien, anorexie de la belle, etc.) avant de se trouver «à tous les niveaux».
De fait, rien de cela dans The Lobster. Et pourtant, cette saisissante méditation sur la solitude, la quête d’une relation non violente et vraie, le poids écrasant du conformisme et la sourde virulence de la guerre des sexes, ne multiplie les cruautés apparentes que pour mieux dire notre éternelle aspiration à ce quelque chose que je disais, qui relève (peut-être) du divin ; et le dernier film de Yorgos Lanthimos , Mise à mort du renne sacré, reprend ce thème du pouvoir écrasant et du manque d’amour - avec moins de puissance onirique me semble-t-il, mais une même façon «panique» d’exprimer notre besoin fondamental de douceur.
Et les animaux là-dedans ?
L’humour étrange de Lanthimos est extravagant, à la fois violent et délicat. J’y retrouve l’inquiétante étrangeté commune à Kafka et à Dino Buzzati, dont les œuvres sont elles aussi parcourues par maintes figures animales révélatrices.
 À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.
À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.Longue vie donc aux rêveurs doux, et puisse s’humaniser encore l’animal le plus fou de notre arche « divine »…
Yorgos Lanthimos. The Lobster. Visible en streaming sur le site http://hds.to.
Patricia Highsmith. Le Rat de Venise. Histoires de criminalité animale. Livre de poche.

(Dessin original de Matthias Rihs pour la chronique parue dans le média indocile Bon Pour La Tête)
-
Ceux qui clivent le débat

Celui qui pratique les mariages-éclair à la Schlegel par ses traits d’esprit combinatoires / Celle qui reste binaire en matière de jugements à deux balles / Ceux qui te somment de choisir ton camp de vacances / Celui qui n’est ni à voile ni à vapeur dans son kayak non freudien / Celle qui a mauvais transgenre / Ceux qu’on peut dire métrosexuels aériens mais ce n’est même pas opératoire du point de vue des données phénoménologiques urbaines scientifiquement vérifiables / Celui qui est clivant au niveau de l’odeur corporelle / Celle qui a un regard d’oxymore fuyant / Ceux qui assument leurs contradictions de millionnaires de gauche lisant Les damnés de la terre dans leur jet privé / Celui qui se la joue nouvelle guerre des deux roses dans le conflit des épines noires / Celle qui épouse les idées du tiers exclu par solidarité de classe moyenne / Ceux qui hésitent entre la France binaire et l’Europe poitrinaire / Celui qui gère les affects disruptifs de ses jumelles à problèmes / Celle que la multinationale a engagée pour son art de noyer le poisson du double langage / Ceux qui tendent à l’unité dans la différence symbolisée par la fidélité de Jean d’0 et de Johnny à tous les présidents amateurs de rock littéraire ni de droite ni de gauche / Celui qui se fait assassiner sur les réseaux sociaux au motif qu’il a osé prétendre que Johnny serait incapable de concevoir les derniers quatuors de Beethoven / Celle qui préfère s’adresser au dieu du rock qu’à ses seins d’ailleurs refaits / Ceux qui se tirent une balle avec leur fusil à deux coups, etc.
Peinture: Pierre Omcikous.
-
Céline au pied de la lettre

Comment un grand écrivain s’enferre dans le délire raciste. Ses lettres en disent plus long, qui nourrissent également le nouveau Céline d'Henri Godard, traversée de la vie et de l'oeuvre aussi généreuse que lucide.
En mars 1942, Louis-Ferdinand Céline écrivait une longue lettre d’un antisémitisme forcené au leader fasciste français Jacques Doriot, alors engagé sur le front de l’Est dans la LVF (Légion des volontaires français), sous l'uniforme allemand. Déplorant la division des racistes et des antisémites en France, Céline enrageait : « Si nous étions solidaires, l’antisémitisme déferlerait tout seul à travers la France. On n’en parlerait même plus. Tout se passerait instinctivement dans le calme. Le Juif se trouverait évincé, éliminé, un beau matin, naturellement, comme un caca. »
Quinze ans plus tard, au micro du journaliste suisse Louis-Albert Zbinden, le même Céline justifie ses positions en invoquant son pacifisme foncier, seule raison selon lui qui lui fit s’en prendre à « une certaine secte », les Juifs français étant supposés les fauteurs de guerre principaux. Et de se poser en victime de « la plus grande chasse à courre de l’Histoire », dont il n’a échappé que par miracle. Et d’affirmer, après la vérité faite sur l’extermination des Juifs d’Europe, qu’il ne « regrette rien » et ne retire aucun de ses mots. À défaut de citer Bagatelles pour un massacre, le plus fameux de ses pamphlets, paru en 1937, cette lettre à Doriot, ex-moscoutaire du PCF passé à l’hitlérisme, donne déjà,cependant, un bel aperçu de la dérive assassine du grand auteur de Voyage au bout de la nuit, guère perceptible avant les années 33-35 :«D’où détiennent-ils, ces fameux Juifs, tout leur pouvoir exorbitant ? Leur emprise totale ? Leur tyrannie indiscutée ? De quelque merveilleuse magie ?… de prodigieuse intelligence ? d’effarant bouleversant génie ? »
« Que non, vous le savez bien ! Rien de plus balourd que le Juif, plus emprunté, gaffeur, plus sot, myope, chassieux, panard, imbécile à tous les arts, tous les degrés, tous les états, s’il n’est soutenu par sa clique, choyé, camouflé, conforté, à chaque seconde de sa vie ! Plus disgracieux, cafouilleux, rustre, risible, chaplinien, seul en piste ! Cela crève les yeux ! Oui mais voilà ! et c’est le hic ! Le Juif n’est jamais seul en piste ! Un Juif, c’est toute la juiverie. Un Juif seul n’existe pas. Un termite : toute la termitière. Une punaise, toute la maison ! »
C’est ici le pire Céline, mais il faut se le rappeler. Son éditeur dans La Pléiade, Henri Godard, n’est pas de ceux qui concluent au seul délire d’époque et qui prônent l’ « oubli » des pamphlets à ce titre. Dans un recueil d’essais récents, George Steiner se demande une fois de plus comment un écrivain aussi extraordinaire a pu, « en même temps », défendre l’idéologie génocidaire, comme s’y est employé Lucien Rebatet dans Les Décombres (paru en 1942 et déclaré « livre de l’année »…) alors qu’il signera plus tard Les Deux Etendards, roman des plus remarquables et pur de tout fascisme ? Or, comment en juger sans avoir les pièces en mains ?
En préface, Henri Godard souligne ainsi l’intérêt de cette nouvelle somme épistolaire qui nous permet, dans le flux de la chronologie, de suivre l’évolution de Louis Destouches à tous égards et, pour la seule « question juive », de voir comment ses échecs personnels (le flop cuisant de Mort à crédit, notamment) et les péripéties politiques (l’arrivée de Blum au pouvoir) cristallisent ses préjugés raciaux et portent son écriture à une violence inouïe, d’autant plus meurtrière qu’elle devient plus « célinienne » en crescendo…
Cet affreux Céline, génial novateur de la langue française du XXe siècle, et non moins maudit pour ses pamphlets antisémites, estimait (non sans raison il faut le reconnaître) que le roman contemporain se réduisait à la « lettre à la petite cousine ». Or, se doutait-il que ses lettres, à lui, constitueraient le plus échevelé des « romans » ? Peut-être pas, mais ce n’est même pas sûr, tant il a mis de soin crescendo à ciseler cet ébouriffant ensemble épistolaire qui vit et vibre à l’unisson de sa « palpite » de grand musicien de la langue, en phase aussi avec le bruit du siècle.
Pas tout de suite évidemment, et c’est la première surprise du recueil. Le tout jeune Céline, écrivant à ses parents de ses séjours scolaires en Allemagne ou en Angleterre, est un sage garçon sans rien du héros déluré de Mort à crédit. Le cuirassier Destouches, engagé à dix-huit ans et gravement blessé au front, n’a rien encore du fameux Bardamu de Voyage au bout de la nuit, même si sa gouaille pointe dans ce mot que le blessé écrit à ses parents en novembre 1914 : « De temps à autre un râle de douleur nous rappelle que depuis 4 mois on ne chante plus à l’Opéra »... Et le visionnaire halluciné à venir de décrire « un corps de 5000 nains de l’Himalaya spécialement réservés aux attaques de nuit et qui ne combattent qu’au couteau ». À noter dans la foulée que, pour cette période, les lettres qu’il reçoit sont aussi révélatrices que les siennes dans la mise en place du tableau.
Dans ses lettres d’Afrique, ensuite, puis au fil de ses pérégrinations en Amérique, ses débuts dans la médecine et dans le roman, vers 1930 (« j’ai en moi 1000 pages de cauchemars de réserve »), le futur Céline va se mettre à écrire ses lettres comme les variations d’un roman à multiples personnages, dont chacun aura droit à un ton particulier : toujours respectueux avec les siens, tendrement protecteur ou plus salace avec les femmes, méfiant puis intraitable avec les éditeurs, respectueux avec les auteurs qu’il estime (Lucien Daudet ou Roger Nimier en tête) reconnaissant pour ses critiques de bonne foi, drôle avec ses amis (Albert Paraz,Gen Paul, Le Vigan), acerbe avec les intellectuels, déchaîné avec ceux qui attaqueront Mort à crédit et Bagatelles pour un massacre. Ainsi du communiste Paul Nizan : « Lui le plus décourageant insipide limaçon » et « l’échappé de bidets des Loges ».
Céline antisémite ? Plus encore : nourrissant un ressentiment qui le fait tôt s’affirmer anarchiste ennemi de l’homme. Après le Voyage, Mort à crédit creusera plus profond dans ce terreau nihiliste. Or Elie Faure (et d’autres du même gabarit) aura beau célébrer ce « magnifique bouquin » en déplorant juste « un peu trop de caca », Céline enragera de n'être pas entendu alors qu'il a sorti ses tripes. Blessé dans son orgueil après le triomphe du Voyage, l’hygiéniste de profession commence alors à distinguer deux races : la saine et la malsaine. L’une est la France française, l’autre la France juive. Bagatelles pour un massacre et L’Ecole des cadavres seront retirés de la vente. Mais cet opprobre décuplera la véhémence de l’épistolier sous l’Occupation. Ensuite, le « roman » de son exil forcé au Danemark n’en sera pas moins impressionnant, voire parfois poignant...
Reste que Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, médecin et auteur reconnu d’un des chefs-d’œuvre du XXe siècle, Voyage au bout de la nuit, et bien plus encore en fin de parcours, fut définitivement, pour le meilleur et le pire, le chroniqueur inégalé d’un désastre apocalyptique. À l’envers de la tapisserie dantesque de son œuvre, ses lettres font apparaître l’homme, et l’écrivain, dans ses contrastes exacerbés, où ses ombres sont mieux dégagées d’un long équivoque.
Louis-Ferdinand Céline. Lettres (1907-1961). Editions établie par Henri Godard et Jean-Paul Louis. Préface d’Henri Godard. Bibliothèque de La Pléiade. Editions Gallimard, 2034p.Henri Godard. Céline.Gallimard, 2011.
-
Céline au bout de sa nuit

56 ans après sa mort, le samedi 1er juillet 1961, l’écrivain maudit continue d'attiser les passions. Aux dernières nouvelles, les plus virulentes émanent de ceux qui ne l'ont pas lu...
Louis-Ferdinand Céline, né Louis Destouches à Courbevoie, en 1894, fut l’écrivain français le plus honni du XXe siècle. Lorsqu’il succomba, le samedi 1er juillet 1961, à une rupture d'anévrisme, dans son dernier « exil » de Meudon, auprès de Lucette Almanzor sa dernière femme, l’auteur du Voyage au bout de la nuit restait un pestiféré. Son enterrement se fit en douce, avec quelques proches et amis écrivains ou éditeurs, tels Marcel Aymé et les Gallimard. Son nom, à sa mort, restait synonyme d’indignité. Pourquoi cela ? Pour trois pamphlets racistes et antisémites d’une virulence extrême : Bagatelles pour un massacre (1937), L’école des cadavres (1938) et Les beaux draps (1941).
Et pourtant, malgré sa dérive et son délire racistes, Céline s’impose, avec Proust, comme l’un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Son style le situe dans la lignée des génies créateurs de notre langue, dans le sillage de Villon et Rabelais. Trois romans-chroniques forment le sommet de son œuvre : Voyage au bout de la nuit (1932), Mort à crédit (1936) et D’un château l’autre (1957). Mais l’œuvre entier forme une somme polyphonique incomparable qui fait qu’aujourd’hui, malgré le flop d’une célébration officielle avortée, Céline est devenu un classique français.Céline multiface
Au premier rang de ses défenseurs : Henri Godard, qui a dirigé l’édition de ses œuvres dans La Pléiade, a publié une somme biographique remarquable par son équilibre, qui analyse le glissement des écrits polémiques vers l’abjection tout en ressaisissant toutes les facettes d’un personnage tissant sa propre légende en fabulateur-comédien épique, grand épistolier de surcroît.
Dans un récit prodigieusement documenté, Henri Godard fait revivre Louis Destouches, fils de littérateur raté et de réparatrice de dentelles. Petit employé rêvant de médecine au dam de ses parents, il est marqué à 20 ans par le choc de 1914, qui le convainc à jamais de l’absolue noirceur humaine. Fort d’une expérience acquise en Afrique et aux Etats-Unis, Destouches devient médecin en 1924 avec une thèse sur l’hygiéniste Semmelweiss qui annonce une « patte » hors norme. Devenu Louis- Ferdinand Céline (prénom de sa grand-mère), l’écrivain fait sensation dès Voyage au bout de la nuit (1934) dont le style inouï, mimant la musique du langage verbal le plus direct, exprime le monde dans sa chair vive: l’horreur de la guerre, le scandale des colonies, l’abrutissement des sociétés massifiées capitalistes ou communistes. Des sentences devenues fameuses ponctuent cette première chronique: «Quand on n’a pas d’imagination, mourir c’est peu de chose, quand on en a, c’est trop ». Ou encore : « L’amour c’est l’infini mis à la portée des caniches »…
Sous des dehors parfois cyniques se révèle un grand poète sensible à la beauté des choses, à la grâce féminine que la danse symbolise, à l’innocence des animaux qui compense la vacherie humaine. Succès et scandale saluent Voyage que l’Académie Goncourt « loupe » piteusement, au bénéfice du Prix Renaudot. En 1936 suit Mort à crédit, nouveau chef-d’œuvre évoquant une enfance et une jeunesse avec une liberté qui effarouche la critique. Or cet insuccès terrasse l’écrivain, bourreau de travail qui a mis dans ce livre plus que dans Voyage. Et d’autres mécomptes, personnels et professionnels, un voyage en URSS dont il revient atterré, et l’arrivée au pouvoir de Léon Blum et du Front populaire, vont pousser l’hygiéniste-prophète à charger le Juif, mais aussi l’Aryen dégénéré, voire le genre humain de tous les maux.
Comme le montre très bien Henri Godard, ce grand « médium » de la condition humaine s’aigrit et se braque jusqu’à l’inhumanité abjecte. Sans être un vrai « collabo », comme l’écrivain Robert Brasillach (fusillé en 1945), il se montre plus frénétique que celui-ci dans ses propos. En marge de la propagande fasciste, il se démène en son seul nom et de manière souvent contradictoire. Mais le plus énorme est ailleurs, que Godard illustre sans coup férir: c’est que ce « salaud » n’aura cessé de composer une œuvre prodigieuse.
Or comment aborder Céline au bout de sa nuit ? Faut-il distinguer un « bon » d’un « mauvais » Céline, un Céline admissible de l’ « infréquentable » ? À cette alternative, Henri Godard oppose la prise en compte de l’œuvre dans son ensemble, jusque dans les pamphlets, sans se tortiller. De fait, lire Céline sans tricher, c’est constater en somme que le meilleur et le pire peuvent cohabiter dans la littérature, comme dans tout homme.
Céline antisémite et raciste
Comment Céline en est-il arrivé à écrire, à côté de romans d’une profonde humanité, des pamphlets suant la haine raciale tels que Bagatelles pour un massacre. L’école des cadavres et Les Beaux draps ? C’est une des questions auxquelles répond Henri Godard avec une honnêteté et un équilibre de jugement sans faille.
À l’origine, Louis Destouches accuse un léger antisémitisme familial, très présent dans la France de son époque. Cela ne l’empêche pas d’avoir de bonnes relations avec de nombreux Juifs, notamment à la S.D.N. Dès sa jeunesse, il voit cependant en le Juif un être différent, voire inférieur, en tout cas dangereux pour la civilisation occidentale. Mais dans les pamphlets, ce danger s’étend à tout ce qui n’est pas au goût de Céline : Picasso, Cézanne, Racine même deviennent ainsi aussi nocifs que les Juifs !
En 1957, dans une interview radiophonique du journaliste suisse Louis-Albert Zbinden restée mythique, l’imprécateur justifiait son antisémitisme au nom de son pacifisme de héros blessé de 14-18, convaincu que les Juifs poussaient à la guerre et que l’Allemagne serait le gendarme de l’Europe face au communisme. Comme le montre Henri Godard, cette justification reste insuffisante au regard du déchaînement haineux des pamphlets faisant du grand écrivain un propagandiste de la plus basse espèce, quoique toujours ambigu dans ses rapports avec les collaborateurs et les Allemands, qui se méfieront également de lui…
Pour lire Céline et ses commentateurs
De Céline.Les œuvres principales de Louis-Ferdinand Céline sont accessibles en livre de poche et dans les 4 tomes des Romans, à la Bibliothèque de La Pléiade. L’extraordinaire correspondance fait l’objet d’un volume séparé, à La Pléiade.
Semmelweiss. À découvrir absolument : la thèse médicale de Céline, essai scientifique et littéraire saisissant, significatif quant aux présupposés de l’hygiéniste. Gallimard, collection L’Imaginaire, 2011, 121p.
Céline en verve. Réunies par David Alliot, des citations de mots, propos et aphorismes réunis par thèmes. Horay, 2011, 111p.
Sur Céline
Céline. Dernière parue des biographies, par Henri Godard. Une somme qui décape la vie et l’œuvre de leurs mythes, très nourrie par l’apport essentiel de la correspondance. Gallimard 2011, 593p.D’un Céline l’autre. Sous la direction de David Alliot avec une préface de François Gibault : un recueil de témoignages, journaux intimes, mémoires, entretiens, qui contrinue aussi de manière décisive à la meilleure connaissance de Céline. Laffont, coll. Bouquins, 2011, 1172p.
Céline l’infréquentable ? Réunies par Joseph Vebret, cette série de « causeries littéraires » avec Emile Brami, Bruno de Cessole, Philippe Sollers, notamment, est également à recommander pour ses apports contrastés, avec une préface significativement « gênée » de l’académicien Jean-Marie Rouart. Editions Picollec, 2011, 205p.
Céline même pas mort ! Comédien, réalisateur et metteur en scène, Christophe Malavoy est aussi un célinien féru, comme le prouve ce dialogue imaginaire en forme de plaidoyer. À voir de plus près... Balland, 2011, 308p.
Céline's band. Un jeune loulou de 17 ans, en 1981, trois mois avant son bac, se fait virer de son lycée et quitte ses vieux pour gagner Paris où, par son parrain, il découvre la bande montmartroise de Céline. Marcel Aymé, Gen Paul et compagnie. Il en résulte un récit très bien documenté et très vivant, dont l'un des thèmes est la relation particulière, et nullement peinarde, de Marcel Aymé et de Ferdine. Très allant et très savoureux, sans trop donner dans le mimétisme. Alexis Salatko est non seulement célinien mais romancier et ça ne gâte rien ! Laffont, 2011, 201p.(À compléter...)
-
Voyage au bout de Céline
Le Dictionnaire Céline de Philippe Alméras
Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, qui rata de peu le Goncourt en 1938, et le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefsd'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Nord, Féerie pour une autre fois ou Guignol's band.
Alors même que l'écrivain, rescapé d'une exécution probable (un Brasillach n'y coupa pas, qui fut moins violent que lui et bien plus digne humainement parlant), s'ingéniait à réécrire son histoire avec autant de mauvaise foi que de rouerie inventive, les céliniens en nombre croissant se voyaient soupçonnés d'antisémitisme larvé s' ils ne se dédouanaient pas en invoquant le « délire » ou la « folie » de l'intempestif, comme s'y employait sa veuve Lucette Almanzor, accréditant elle-même la thèse de la folie de son cher Louis et bloquant la réédition des pamphlets.
Or, au fil des années, la publication de divers documents plus ou moins révélateurs ou accablants auront contribué à dévoiler le personnage dans sa complexité tordue, dont la créativité est inséparable de la paranoïa, la verve souvent nourrie par l'abjection, la lucidité aiguisée par une angoisse pascalienne ou une plus triviale trouille de couard. Oui, ce merveilleux orfèvre de la langue était à la fois un sale type, un ingrat mordant la main qui le nourrissait, un rapiat obsédé par son or, un délateur et un faux jeton en amitié, notamment. On peut certes, alors, choisir de ne pas le lire en se fondant sur ces jugements moraux, mais le lisant il faut tout lire de lui, n'était-ce que pour saisir d'où il vient et où il va.
C'est du moins le parti de Philippe Alméras qui, travaillant sur Céline depuis quarante ans, comme un Henri Godard (responsable de l'édition en Pléiade) estime que Céline et son œuvre sont indivisibles et doivent être pris pour tels sans souci constant de les excuser ou de s' excuser d'y prendre de l'intérêt. Loin de s' en laisser conter par Céline, Alméras, auteur de la seule biographie de Céline non autorisée (Céline entre haines et passion, Laffont 1994) est d'autant plus crédible qu' il récuse autant la fascination mimétique des uns (très fréquente avec cet auteur, comme avec un Thomas Bernhard) que l'inquisition réductrice des autres.
Le bon usage de ce Dictionnaire Céline, précisons-le d'emblée, suppose une certaine connaissance préalable de l'œuvre et du parcours de l'écrivain, auxquels chaque article se rattache comme la digression d'un immense roman fourmillant de personnages historiques ou imaginés par l'écrivain.
A la lettre A, par exemple, sont traités notamment Abetz (célèbre ambassadeur allemand
à Paris chargé des relations avec les écrivains), Afrique (le périple de 1916 qui le dégoûte du vin et l'accroche à l'écriture), A l'agité du bocal (son règlement de comptes légendaire avec Sartre), Allemagne (« pays maudit funeste »… en 1948), Amour (« c'est l'infini à la portée des caniches », Animaux (qu' il aura préféré à la plupart des humains), Arletty (sa chère amie), Arrestation (un récit héroïque mais démenti par Alméras), Audiard (qui rêvait d'adapter le Voyage avec Belmondo en Bardamu), Avocats (« rigolos au salon, sinistres à l'aube, inutiles à
l'audience »), etc.
Ainsi se déploie une sorte de tapisserie-palimpseste aux multiples fils et ramifications, relevant à la fois de la chronique individuelle et du tableau d'époque.
Au fil d'un prodigieux travail de recoupement, assorti de commentaires toujours vivants, souvent piquants, combinant témoignages et compilations, extraits de lettres ou coupures de presse, éléments de reportages ou extraits d'études, citations innombrables donnant au livre sa palpitation, Philippe Alméras nous propose à la fois une cartographie de l'univers célinien et un jeu de piste sur les traces du Dr Destouches (dont toutes les adresses sont répertoriées !), une analyse éclatée de l'œuvre, un « Who's who » de l'Occupation et de l'E puration, un portrait en mouvement de l'homme en prise avec son époque et ses semblables. Y voisinent en outre un aperçu passionnant de l'accueil critique réservé à un auteur jouant toujours les victimes et dénigrant tout autre que lui ou presque, une exploration du laboratoire de l'écrivain au travail, un aperçu du méli-mélo de ses jugements balancés à tout-va et de ses positions plus ancrées de Celte, d'hygiéniste, de païen conchiant la décadence, de prophète vitupérant la religion, de dynamiteur du langage obsédé par la palpite du verbe réduit à sa seule musique: « Vous me prenez pour une femme ? avec des opinions ? Je n'ai pas d'opinions. L'eau n'a pas d'opinions »…
Philippe Alméras. Dictionnaire Céline. Plon, 879 pp.
Abécédaire célinien
CITATIONS Extraits de textes et de lettres grappillés par Philippe Alméras.
AU-DELÀ « Je ne voudrais pas te désobliger mais je t' avoue ne point donner de pensées aux problèmes d'au-delà. L'humanité que j'ai soufferte et que je souffre me dégoûte trop, je l'ai trop en haine pour lui désirer autre chose que des asticots et éternellement. » (Au Dr Camus, 7 juin 1948)
ARYEN « Quel est l'animal, je vous demande, de nos jours, plus sot ? plus épais qu'un Aryen ?»
CHINOIS « Quand les Chinois vont venir, ils vont être bien étonnés de voir ces êtres partout à la fois en meme temps, à l'hôpital, au bordel, sur les Alpes, au fond de la mer et sur les nuages. » (A Roger Nimier)
ÉCRIRE « Je trouve d'abord la posture grotesque — ce type accroupi comme un chiot. Quelle stupidité ! Ignoble. Je ne m'en excepte pas. Loin de se presser le ciboulot, d'en faire sortir ses « chères pensées »! Quelle vanité !»
JUIFS « Les juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides loupés, tiraillés, qui doivent disparaître. »
(L'Ecole des cadavres)
MEIN KAMPF« Aucune gêne à vous avouer que je n'ai jamais lu Mein Kampf ! Tout ce que pensent ou racontent ou écrivent les Allemands m'assomme. » (A Milton Hindus, en 1947) Mais Philippe Alméras précise: « S'agissant de celui qui avait tenté d'établir le Reich millénaire et avec lequel il avait tant de points communs et quelques convictions, Céline a parcouru toute la gamme des positions possibles. Il est passé de la révérence au suprême mépris. »
RACE « La race, ce que t' appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France et puis c'est ça les Français. » (Voyage au bout de la nuit)
RAMUZ « Que lira-t-on en l'an 2000 ? Plus guère que Barbusse, Paul Morand, Ramuz et moi-même il me semble. » (Lettre au Magot solitaire, 1949)
SEXE « L'intromission d'un bout de barbaque dans un pertuis de barbaque, j'ai jamais vu là que du grotesque — et cette gymnastique d'amour, cette minuscule épilepsie. Quels flaflas !» (A Albert Paraz, 1951)
VIEILLIR « Il faut vieillir tôt ou mourir jeune. » -
Longue vie aux rêveurs doux
À la démence collective et chaotique des temps qui courent, le sens commun et l’humanisme sensible opposent le contrepoison du comique grinçant ou de l’exagération poétique révélatrice. Le film apparemment délirant de Yorgos Lanthimos, The Lobster, en est la troublante illustration. Après Orwell et Buzzati, la fiction fantastique éclaire la réalité…
Chronique de JLK

Nos églises progressistes seront-elles bientôt équipées de jacuzzis ? Quand nos médias pluralistes dénonceront-ils enfin la torture des masturbateurs par le supplice du grille-pain ? Et quel nouveau tribunal international va-t-il légiférer à propos du crime contre l’humanité que représente l’humour noir ?
Telles sont les questions qui me sont venues pêle-mêle à l’esprit (mauvais esprit es-tu là ?) en réaction à deux faits récents, entre tant d’autres, me semblant dignes d’attention
Le premier est l’installation, en l’église protestante de Vennes, dans le quartier de notre enfance des hauts de Lausanne, d’un parterre de fauteuils, divans, bergères et autres poufs confortables remplaçant les rangs quasi militaires de bancs de bois dur de jadis (souvenir de nos derrières meurtris dès l’école du dimanche) de façon conviviale et décontractée, non plus face au choeur obsolète sommé de l’inscription DIEU EST AMOUR, mais aux claires verrières latérales donnant sur les toits des villas Mon Rêve du quartier voisin.
Le second est la découverte d’un film tout à fait stupéfiant à mes yeux, intitulé The Lobster et dont la sortie m’avait échappé en 2015, qui parle d’amour, de sexe, de sentiments personnels profonds et de coercition sociale d’une façon à la fois crue et quasi délirante (en apparence), relevant à la fois du fantastique social et de la poésie tendre.
Si Johnny est un dieu, va pour le karaoké…
La folie ordinaire de notre monde est un thème sérieux, dont je m’étonne qu‘il soit si peu traité par nos jeunes auteur(e)s et cinéastes, à quelque exceptions près, mais l’impatience n’est pas de mise dans un contexte de mutation : il faut juste être attentif.
S’agissant des canapés installés en l’église de Vennes aux fins de relancer l’attractivité du culte dominical en ce lieu jadis si grave, voire froid, je balance entre deux réactions – de rejet viscéral et de compréhension plus débonnaire - liés à mon expérience personnelle.
Parce que j’ai vu, de près, ce qu’est une paroisse protestante. Que j’y ai suivi des sermons plus ou moins assommants et perçu des relents de sourcilleux conformisme social, avant l’apparition d’un formidable pasteur, revêche et bon, dont le verbe cinglant et la présence irradiait ce qu’on peut dire l’intelligence du coeur.
Un premier mouvement naturel m’a fait rejeter cette innovation assez significative, à mes yeux, de la décomposition d’une communauté dont les rites s’étiolent, sur quoi j’ai pensé que ces gens, bien cools au pied de la croix (!) vivaient peut-être la chose de bonne foi, au double sens du terme.
Je ne sais pas, mais je me souviens : je me revois, autour de mes quinze ans plutôt rebelles, en face du pasteur Pierre Volet aux bacchantes à la Brassens. Ce type, qui avait côtoyé les prêtres-ouvriers de Marseille, ne dorait pas la pilule. Quant il parlait à Vennes, l’église était pleine. Mais rien chez lui des artifices propres aux télévangélistes américains ou à leurs émules de partout, et les gens se foutaient pas mal d’être mal assis sur ces bancs punitifs !
Du coup je me dis, aujourd’hui, à propos des divans et des coussins de l’église de nos chers vieux: et pourquoi pas ? Le rabbi Iéshouah a-t-il jamais exigé qu’on l’écoute au garde-à-vous ? Et ne vaudrait-il pas mieux stigmatiser les imposteurs qui se servent des textes sacrés pour dominer leurs semblables, violer les cœurs et les corps ?
Sur quoi je me dis, chrétien mécréant que je suis, que ces nuances me gonflent. Après tout qu’ils vivent l’église comme ils le sentent, ces braves paroissiens, avec des flippers et des scènes de karaoké si ça leur chante, pourvu que passe ce quelque chose que je n’ai pas envie de nommer, crainte d’en dire trop ou pas assez…
Redites-moi des choses tendres…
Ce qui est sûr, aussi bien, c’est que le manque de ce quelque chose, lui, n’est pas cool, et que c’est loin de tout confort matériel ou même spirituel que nous transporte ce rêve éveillé que déploie le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, intitulé The Lobster et dont l’humour panique bouscule tous nos repères.
En l’occurrence, le DIEU EST AMOUR du temple de nos enfances n’a plus d’écho que déformé, monstrueusement, falsifié comme celui qui sert de caution aux centaines de prêtres violeurs australiens (le journal de ce matin) rejoignant les milliers et les millions de prédateurs consacrés ou non invoquant dieu sait quel Dieu ou n’obéissant qu’à leur démons - ce qui revient au même.
Il n’est pas question une seule fois, dans The Lobster, de religion au sens habituel, ni de pouvoir ecclésiastique ou politique. Cependant dès les premiers plans du film, quelque chose se passe qui relève du sacré, marqué par la mort absurde d’un animal. Une femme, sortant de sa voiture sous la pluie, en pleine campagne où paissent trois ânes, brandit soudain un revolver et flingue l’un des animaux. Ensuite un homme barbu au regard sombre, prénom David, se pointe avec son chien Bob dans une espèce d’hôtel dont la négresse réceptionniste (on dira plutôt : employée de couleur) lui explique qu’il a 45 jours pour trouver une conjointe (il a perdu la femme qu’il aimait et il est interdit de rester seul en ces lieux) faute de quoi il sera changé en l’animal de son choix – un homard en ce qui le concerne.
La spectatrice et le spectateur (pour parler en langage inclusif rôdé) ont appris entretemps que le chien Bob de David (Colin Farrell qui a dû se laisser pousser la barbe) est son frère réincarné, dont la mort lui tirera des larmes quand la femme sans cœur qu’il a cru bon d’épouser dans l’intervalle le tuera pour l’éprouver…
Parmi les animaux dénaturés
Le sous-titre de The Lobster est Une histoire d’amour, et c’est exactement ça. Ou plus précisément: l’histoire de David fuyant le monde des animaux dénaturés que sont devenus les hommes, en ce lieu de triage collectif où il est strictement interdit de se livrer à l’égoïste masturbation (la main du contrevenant est châtiée par le supplice du grille-pain) et requis de s’exercer au frottage sexuel à l’essai avant l’accouplement marital.
Or, rejeté par la femme sans cœur au visage glacial, David se réfugie dans la forêt des solitaires, proies de chasses quotidiennes pour les aspirants au mariage salvateur, mais eux-mêmes soumis à des règles strictes en matière de relations affectives ou sexuelles.
Terribles humains ! Que n’est-on plutôt marmotte farouche, chat angora ou chien regardant franchement Dieu en face, comme dans la nouvelle de Buzzati !
Les réseaux sociaux ont frémi, à propos de The Lobster, de toute l’indignation des lectrices et lecteurs d’histoires d’amour ordinaires, où le beau garagiste romantique et l’aristocrate mélomane vivent mille tribulations (tendances homo du fier mécanicien, anorexie de la belle, etc.) avant de se trouver «à tous les niveaux».
De fait, rien de cela dans The Lobster. Et pourtant, cette saisissante méditation sur la solitude, la quête d’une relation non violente et vraie, le poids écrasant du conformisme et la sourde virulence de la guerre des sexes, ne multiplie les cruautés apparentes que pour mieux dire notre éternelle aspiration à ce quelque chose que je disais, qui relève (peut-être) du divin ; et le dernier film de Yorgos Lanthimos , Mise à mort du renne sacré, reprend ce thème du pouvoir écrasant et du manque d’amour - avec moins de puissance onirique me semble-t-il, mais une même façon «panique» d’exprimer notre besoin fondamental de douceur.
Et les animaux là-dedans ?
L’humour étrange de Lanthimos est extravagant, à la fois violent et délicat. J’y retrouve l’inquiétante étrangeté commune à Kafka et à Dino Buzzati, dont les œuvres sont elles aussi parcourues par maintes figures animales révélatrices.
À l’occasion de nombreuses interviews d’écrivains contemporains, j’ai souvent demandé à mes interlocuteurs en quel animal ils souhaitaient se réincarner. L’auteure (auteuse, autrice, autoresse ?) de récits «paniques» Patricia Highsmith, dont l’humour noir fait merveille dans Le rat de Venise, me répondit qu’elle hésitait entre l’éléphant (à cause de son intelligence et de sa longue vie) et le petit poisson dans un banc de corail, avec une préférence finale pour celui-là, qui l’apparente au homard lui aussi promis à une longue vie.
Longue vie donc aux rêveurs doux, et puisse s’humaniser encore l’animal le plus fou de notre arche « divine »…
Yorgos Lanthimos. The Lobster. Visible en streaming sur le site http://hds.to.
Patricia Highsmith. Le Rat de Venise. Histoires de criminalité animale. Livre de poche.
-
Mémoire vive (114)

Thierry Vernet : « L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser ».
Ce 1er novembre. - La littérature, en deçà ou au-delà de la philosophie et des sciences humaines, via la poésie ou le théâtre - de Dante à Shakespeare par exemple - peuvent-ils nourrir une réflexion actuelle sur notre rapport au Terrestre, et les romanciers contemporains, ou les poètes, méritent-ils la moindre attention des experts en la matière ? Inversement, une nouvelle orientation de notre perception du Global et du Local peut-elle enrichir la littérature ?
Ces questions ne se poseront peut-être pas pour les mâles Alpha à la Donald Trump, mais la lecture du dernier essai de Bruno Latour, en phase avec son ami allemand Peter Sloterdijk, leur donne une nouvelle base et un possible élan à venir avec l’effort de l’auteur de répondre, en Européen non aligné, à cette question d’Où atterrir ?

«Est-ce que je dois me lancer dans la permaculture, prendre la tête des manifs, marcher sur le Palais d’Hiver, suivre les leçons de saint François, devenir hacker, organiser des fêtes de voisins, réinventer des rituels de sorcières, investir dans la photosynthèse artificielle, à moins que vous ne vouliez que j’apprenne à pister les loups ?».
Voilà ce que chacune et chacun se demandent peut-être en toute bonne foi en se posant la sempiternelle question du Que faire ? Sur quoi Bruno Latour esquisse le début d’une suggestion : « D’abord décrire. Comment pourrons-nous agir politiquement sans avoir inventorié, arpenté, mesuré, centimètre par centimètre, animé par animé, tête de pipe après tête de pipe, de quoi se compose le terrestre pour nous ?»
°°°
Parlant d’«élites obscurcissantes », Bruno Latour reprend «la métaphore éculée du Titanic : les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré ; s’approprient les canots de sauvetage, demandent à l’orchestre de jouer assez longtemps des berceuses afin qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes ! »
°°°

Ce qu’il y a de formidable avec les bonnes femmes, quand elles se mettent à écrire et à décrire, c’est leur sens de la réalité terre à terre. Du moins est-ce ce que je me dis, en nos contrées, en lisant Alice Rivaz ou Janine Massard, aux States en lisant Alice Munro ou Annie Dillard, ou en France en lisant Maylis de Kérangal et, ces derniers jours, le nouveau roman de Marie-Hélène Lafon, Nos vies, dont le regard d’une terrienne de souche sur une immigrée farouche nous ancre littéralement dans le plus-que-réel avec des mots et des formules frappées au coin du cœur-à-corps.
°°°
Amaury Nauroy a 35 ans de moins que moi. Czapski en avait 51 de plus. Cela fixe des repères. Ma mère est née en 1917, moi en 1947. Lucy, l’australopithèque arboricole, va sur ses 30 millions d’années. Ainsi de suite…
°°°
L’amour de la littérature est un phénomène tout à fait particulier, qui ne se limite pas plus à un goût esthétique qu’à une passion intellectuelle, mais touche à tous les points de la sphère sensible et filtre les expériences les plus diverses.

Certains individus ont la foi, comme on dit, et d’autres pas ; certains entendent la musique ou voient la peinture mieux que d’autres ; et puis il y a ceux qui aiment la littérature, s’en nourrissent et se plaisent à la partager. Amaury Nauroy est de ceux-ci, qui semble vivre pour et par la littérature, à la fois en lecteur, en passeur et en écrivain se révélant superbement dans ce premier livre intitulé Rondes de nuit.
«La littérature romande ? Mais c’est la rose bleue !», s’exclamait Friedrich Dürrenmatt quand on l’interrogeait à ce propos, visant le mélange de spiritualisme diaphane et certaine préciosité de vieille fille du Grand Poète célébré par les Welches (on est censé penser à un Gustave Roud ou à un Philippe Jaccottet, même si le tonitruant Bernois n’avait probablement lu ni l’un l’autre) mêlant culte de la nature, déisme délicat et prose sublime.
Cliché pour cliché, le fluvial Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel, qui fascinait Léon Tolstoï et que Dimitri a publié dans son intégralité en douze volumes de plus de 1000 pages, a pu être taxé de «noix creuse» et devenir le symbole d’un certain nombrilisme romand, et la réception critique d’un Ramuz, en France, ne réserve pas moins de formules expéditives, voire débiles, l’assimilant à peu près à un auteur régional, sinon rural, plus ou moins traduit de l’allemand…
°°°
Le langage de l’époque est binaire, et débilitant par exclusion, alors que la littérature est inclusive et ramasse tout. Ramuz l’écrivait dans son plus beau roman : «Laissez venir l’immensité des choses». Et Charles-Albert Cingria de nuancer à sa façon: «Ça a beau être immense, comme on dit: on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue».

Ce qui suggère qu’il y a place, dans la littérature romande «et environs», pour la bourlingueur Cendrars autant que pour Maurice Chappaz le chantre du «Valais de bois», pour dame Anne Perrier la poétesse hypersensitive autant que pour l’intempestif Maître Jacques, pour Nicolas Bouvier nomadisant au Japon autant que pour Philippe Jaccottet dans sa lumière de Grignan, et toute la jeune bande récente dans la foulée, même si l’âme romande s’est mondialisée et que l’identité de la vieille fille se métisse avec le Roumain Popescu et le Camerounais Max Lobe, les uns «échangeant» sur Facebook et les autres tâtant de l’avenir radieux entre véganisme et permaculture.
Tout ça pour dire que la vieille fille présumée, réputée sortir de la 5e promenade du Rêveur solitaire de Rousseau, jadis chaperonnée par le couple du Pasteur et du Professeur, n’a pas encore dit son dernier mot pour autant qu’on lui prête une oreille attentive et même peut-être amicale.
°°°
Ce qu’il y a de beau dans le livre d’Amaury Nauroy, c’est l’espèce d’affection filiale courant entre l’auteur et ses personnages disparus ou vivants, qu’il s’agisse de Mermod ou de Jaccottet, de la petite-fille de l’éditeur ou de son fils flambeur à dégaine de raté à la Simenon, en passant par le peintre Jean-Claude Hesselbarth (voisin des Jaccottet à Grignan) et jusqu’au fils du poète, Antoine Jaccottet, devenu éditeur à son tour à l’enseigne du Bruit du temps avec autant d’extrême soin dans la réalisation de ses livres que Mermod.
Ces liens de filiation pourraient faire clan ou chapelle, et pourtant non : la ferveur joyeuse de l’auteur le préserve de ce travers, et le courant passe, la transmission se fait en beauté.
Ce mardi 7 novembre. – Départ ce matin à 8h.37 de Montreux, après un dernier café avec L. et P. Tout est sous contrôle, me semble-t-il. Je dormirai ce soir à Chiusi et demain soir à Cetona. Ciel couvert.
Neige sur le Grammont. Grisaille sur les collines de Sion. Le ciel se dégage aux abords de la Noble Contrée, qui me rappelle Rilke et ma visite à Jeanne de Sépibus, il y a plus de quarante ans de ça…
Après le Simplon, le Pendolino débouche dans le grand bleu du sud, passant sous des pentes forestières encore noires d’incendies passés.

Dans le train de Florence, je reprends la lecture des brefs textes de Philippe Jaccottet rassemblés (au Temps qu’il fait) sous le titre de Tout n’est pas dit. Comme je suis un peu fatigué par les quatre premières heures de mon voyage, cette lecture aimablement mesurée me convient. Jaccottet observe les premiers dégâts de la télévision à la fin des années 50, en Provence, il observe de jeunes voyageurs snobs et arrogants dans un train, il fait l’éloge de l’art discret du conteur André Dhôtel, il rend hommage à Gustave Roud en le dégageant de la tradition rousseauiste pour le situer plutôt dans la filiation des romantiques allemands, avec de lointains échos égyptiens ( !), il évoque (superbement) l’automne dont il préfère la lumière mélancolique aux sonneries trop flamboyantes des feuillages, il parle du haïku dont il est proche à certains égards, et l’ensemble du livre, tissé de petites chroniques, forme un ensemble équilibré traversé par une douce musique, parfois un peu trop posée, voire évanescente, à mes yeux, mais enfin c’est l’un des aspects de Jaccottet que je préfère.
Sur quoi, passé Bologne, je repique en lisant Couilles de velours de Corinne Desarzens, et là ça redevient du plus vif et du plus corsé - du plus coruscant dirait Charles-Albert -, avec des saillies parfois saisissantes. Cela qui va de soi : «Le grand âge assure l’illusion de pouvoir tout dire. Sur le bâtiment qu’est le corps. Sur la fusée qu’est le destin. Sur la moutarde après dîner qu’il faut éviter parce qu’elle veut dire trop tard ». Et tout ce qui, de fait, aujourd’hui, me souffle de sa voix insidieuse voire cruelle : « trop tard »…
Du coup je revois la Comtesse, un certain jour chez Francis, à Paris, qui nous avait pris en affection durant un repas de midi et qui, au moment des desserts, nous a recommandé de prendre bien soin l’un de l’autre, etc.

À Chiusi, ce même soir. – Bien arrivé et très content d’être descendu dans un modeste hôtel jouxtant la gare dont la petite chambre (hélas sans table) me coûte 35 euros ! Dieu sait que je ne suis pas rapiat, mais un prix normal est si rare par les temps qui courent...
°°°
Je me régale à la trattoria toscane Al Punto, réalisant la bonne tradition populaire italienne, où j’observe cependant tout un parterre de jeunes gens littéralement scotchés à leurs smartphones, ne discontinuant de les consulter sans cesser pourtant de parler entre eux et ensuite de se régaler à leur tour. Nulle part, ni à Paris ni en Suisse, ni non plus aux States, je n’ai vu un tel spectacle à l’italienne, et qui me rappelle la délirante télé vue par Fellini…
À la table voisine, j’observe une enfant (quatre ou cinq ans) et son père tatoué à casquette d’équipe de football américain, qui n’en finit pas de rappeler sa présence en réclamant ceci ou cela, crisant, trépignant, avalant trois bouchées et en refusant trois autres, filant à une autre table où diverses jeunes femmes jacassent, puis revenant au père qui se lève pour faire quelques pas avec elle jusqu’à une autre table de mecs, avant de caser enfin la môme devant un jeu vidéo sur sa mini-tablette, etc.
L’aliénation de l’Italie, pointée par Guido Ceronetti dans Un Voyage en Italie, La Patience du brûlé et Albergo Italia, atteint ces jours des proportions martiennes, comme je le constate ce soir au Punto, et pourtant il y a toujours quelque chose d’un vieux fonds populaire et joyeux qui résiste au nivellement total et à la crétinisation massive, chez ces chers Ritals, qui incite à leur appliquer un « jugement » à deux poids deux mesures, découlant finalement d’une légèreté et d’une démesure particulière, etc.

Cetona, ce mercredi 8 novembre. – Le sommeil un peu perturbé par le vin d’hier soir, mais j’ai fini par me rendormir et me trouve à l’instant dans les meilleures dispositions de corps et d’esprit à une table de l’ancien Caffè dello Sport de Cetona, rebaptisé Da Nilo, après une première brève escale au Poggiosecco dont j’ai pu apprécier la parfaite situation, sur une éminence boisée à deux kilomètres du bourg, et la bonhommie sympathique du colosse barbu venu me répondre en robe de chambre…
Coïncidence plaisante : Paolo est un ancien journaliste de rubrique économique, dans la soixantaine, qui s’est retiré en ces lieux avec la belle Paola pour tenir cette maison d’hôtes - belle paire de Romains civilisés et d’emblée très avenants, qui m’ont attribué une ravissante petite maison rose attenant à la vieille ferme restaurée dans les règles de l’art.

San Quirico d’Orcia, ce 9 novembre. - Toute l’âme italienne, ou plus précisément toscane, se trouve comme rassemblée et résumée en ces lieux où nature et culture se fondent, me dis-je en savourant de grandes ravioles à la truffe noire arrosées de Brunello. L’établissement rappelle, par son enseigne, l’infernal gourmand Ciacco de la Commedia, et ce giron de l’Inferno, à l’abri de la pluie dantesque, me convient tout à fait à l’instant.

°°°
J’envoie ce soir ce courriel indicatif à mon illustrateur préféré : « Cher Matthias, ma 15e chronique sera donc consacrée au monde vue de Toscane en automne, autour d’un lutin génial du nom de Guido Ceronetti, qui a écrit sur l’Italie des choses terribles (il voit le champignon atomique blanc derrière la truffe) et magnifiques. C’est à la fois un chroniqueur percutant (dans La Stampa durant des années) et le fondateur du Teatro dei Sensibili, des marionnettes qui transmettent sa vision du monde, actuellement manipulées par une bande de jeunes gens, en complicité avec le Maestro autant qu’avec les mânes de Fellini. L’Italie populaire et délirante de Fellini et celle de Ceronetti font en effet bon ménage. Les livres de Guido (Voyage en Italie, Albergo italia, La patience du brûlé, Ce n’est pas l’homme qui boit le thé mais le thé qui boit l’homme, etc.) alternent à tout moment le poids du monde et le chant du monde, la hideur massive et la beauté des animaux (c’est un écolo anti-nucléaire anti-poulet en batterie, anti-chasse et anti-guerre enragé de la première heure), ce sont des sortes de patchworks de tags et de pensées chinoises, de sentences profondes et de titres de tabloïds, etc. Hier dans un parc sur une cahute de chiottes il y a avait une tête de loup et des citations de la Divine comédie au feutre noir: du pur Ceronetti.
À l’instant je vous écris dans une sorte de paradis sur terre, au milieu des biches et des renards, dans le flamboiement de l’automne, après une soirée passée avec la belle Paola et Paolo le titan barbu qui avait fait ses tagliatelle al ragù et me racontait ses années de journaliste d’investigation entre Rome et Milan au coin du feu en même temps que passait un épisode de Montalbano à la télé. C’est ça l’Italie à mes yeux : le chant du monde et le poids du monde. Ma basta così. Je vous filerai l’adresse de la Casa Poggiosecco où il vaut la peine de faire étape, et vous souhaite monts et merveilles ».
°°°
Je suis Romain je suis humain, disait je ne sais plus quel idéologue droit dans ses bottes, et c’est avec malice que je détournerai cette crâne sentence au crédit des deux Romains - elle d’une délicate finesse d’esprit au visage de madone profane, et lui grandgousier barbu - tenant maison d’hôtes en ces hauteurs forestières de la Toscane , combien humains en leur façon de vous recevoir comme un ami de longue date mais impatients de refaire connaissance sans une once d’indiscrétion pour autant...
La belle Paola me rappelle les douces personnes des films de Comencini, tandis que le géant Paolo m’évoque illico les cuisiniers premiers couteaux de Fellini, très avisé des finesses de la poésie culinaire. Ainsi, lorsque je lui demande, au coin du grand âtre de l’ancienne ferme, s’il fait aussi sa pâtisserie in casa, comme son pain et les tagliatelle au ragù dont nous nous régalons, me répond-il que non: que la pâtisserie est un art en soi relevant de l’alchimie apprise la plus précise: si la recette t’impose 13 grammes de blanc d’œuf tu n’en mettras ni 14 ni 18 même si c’est la guerre !
L’art de vivre s’apprend entre l’enfance et l’exercice actif du métier de vivre, mais il découle, dans toutes les cultures et civilisations, de siècles de savoir transmis et mémorisé dont j’aime déchiffrer le palimpseste partout où je vais, et à cet égard le grand livre toscan est un trésor. Je n’irai pas au Festival de la truffe annoncé sur les affiches de Montepulciano, mais à San Quirico d’Orcia où la mémoire remonte aux Étrusques, un modeste primo piatto de ravioli al tartufo (la truffe en italien) me fait sourire à l’évocation d’un Tartufe qui invoque le ramadan pour les autres sans cesser de s’en mettre plein la truffe...
°°°
Pour ma part je trouve autant de saveur à trois morceaux de fromage de brebis servis avec trois lamelles de poire qu’à un grand festin, mais chacun son goût et nul hasard si je tombe, au coin de la prochaine rue, sur un tout petit livre du Maestro Ceronetti que je retrouverai demain à Cetona, intitulé Per non dimenticare la memoria...

« S’il est des paysages qui sont des états d’âme, ce sont les plus vulgaires », écrivait sentencieusement le cher Albert Camus dans son évocation de la Toscane de Noces, si je ne fais erreur, mais Camus pour une fois s’est montré obtus dans sa perception d’une haute terre et de ses gens.
En Toscane les états d’âme sont évidemment des sous-produits, comme un peu partout, mais ce jugement réduisant une émotion devant tel ou tel paysage me semble bien académique au moment où importe surtout la première sensation et la joie très pure qui en découle.
Les collines de Toscane et plus particulièrement les lunaires crêtes siennoises, n’ont point de mer pour horizon, au contraire de Tipasa ou de Djemila, mais leur mélange de beauté naturelle roulant à l’infini, et d’ordonnance ajoutée à main humaine ne me font pas me demander s’il n’y a là que de l’état d’âme suspect de vulgarité vu que je n’aspire qu’à une muette reconnaissance.
°°°
Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.

De Florence а Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent а leur façon dualiste
Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches а ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique.

Souvenir perso remontant а l’an 2012: à Turin, а l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes…
°°°
 Quant à Fabio Ciaralli, il a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené а plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.
Quant à Fabio Ciaralli, il a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené а plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami ; et Cioran, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie. Cioran «a nourri mes veilles», écrit-il, «il m’a tenu en vie»…

Enfin, ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accrochés aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée а Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.
D’ailleurs le monde actuel lui-même est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...
Or ça nous arrive а tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Iéshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...

Je me sens en Italie, ou plus précisément en Toscane, auprès de gens aimables, comme chez moi. Je vais tâcher de dire ce que j’apprécie dans cette Italie-là, qui relève à mes yeux de la civilisation, même s’il y a en elle aussi du pasticcio païen ou barbare.
Avec mes hôtes de l’Albergo Toscana Podereso Poggiosecco, nous avons eu hier soir une dernière conversation où nous avons parlé d’un peut tout, sur la même longueur d’ondes.
Ce mercredi 15 novembre. – Invité ce midi par l’abbé Vincent. Très bonne conversation d’abord arrosée d’absinthe chez lui, ensuite au restau voisin où il m’a régalé. Nous avons bien ri. Parfois même nous nous sommes gondolés. Comme lorsqu’il cite sa grand-mère : « Au fond il n’y a pas de milieu, quand on devient très vieux : soit on devient tout bon, soit tout mauvais ». Ce qui m’encourage in petto à devenir tout bon et de plus en plus.
Autre saillie tordante, comme il évoque une conférence donné par Tariq Ramadan à l’Octogone, après laquelle avec quelques amis, ils avaient mangé et bu pas mal, assez pour délier la langue de l’abbé qui lança au (faux) frère musulman: « J’ai trouvé, Monsieur, votre discours brillantissime, mais je n’en crois pas un mot ! ».
°°°
 Très surpris en bien par les romans d’Antonin Moeri et de Jean-Yves Dubath que j’ai trouvés dans mon courrier de ces derniers jours, à mon retour de Toscane. Achevé le Dubath ce soir. Très étonnant petit roman proustien, tenu et tendu, cristallisant un vrai chagrin et une vraie petite tragédie illustrant le choc des cultures, comme on dit. L’histoire d’un esthète artiste (Julius), considéré comme un « Leonor Fini helvète », qui s’entiche d’un jeune Roumain faisant le trafic d’objets de toute sorte entre la Suisse et la Roumanie. Parfaite illustration de la montée aux extrêmes du mimétisme destructeur. Julius est prêt à renoncer à ses dessins « à chair » de nus masculins, qu’il n’ose montrer à Basile, pour envisager la peinture de tableautins alpestres que celui-ci pourrait revendre en Moldavie, une affaire à deux qui se concrétise d’abord par un prêt d’argent important de Julius, destiné à l’achat d’un terrain où pourrait s’établir une galerie d’art-hangar à ferraille, et que le Roumain détourne à son profit pour construire une COOP. Cette histoire sordide, qui me rappelle un fait divers criminel, est élevée au rang d’une sorte de fable et d’une façon de poème rappelant les thèmes de Cavafy, du subtil esthète convoitant de belles brutes, etc.
Très surpris en bien par les romans d’Antonin Moeri et de Jean-Yves Dubath que j’ai trouvés dans mon courrier de ces derniers jours, à mon retour de Toscane. Achevé le Dubath ce soir. Très étonnant petit roman proustien, tenu et tendu, cristallisant un vrai chagrin et une vraie petite tragédie illustrant le choc des cultures, comme on dit. L’histoire d’un esthète artiste (Julius), considéré comme un « Leonor Fini helvète », qui s’entiche d’un jeune Roumain faisant le trafic d’objets de toute sorte entre la Suisse et la Roumanie. Parfaite illustration de la montée aux extrêmes du mimétisme destructeur. Julius est prêt à renoncer à ses dessins « à chair » de nus masculins, qu’il n’ose montrer à Basile, pour envisager la peinture de tableautins alpestres que celui-ci pourrait revendre en Moldavie, une affaire à deux qui se concrétise d’abord par un prêt d’argent important de Julius, destiné à l’achat d’un terrain où pourrait s’établir une galerie d’art-hangar à ferraille, et que le Roumain détourne à son profit pour construire une COOP. Cette histoire sordide, qui me rappelle un fait divers criminel, est élevée au rang d’une sorte de fable et d’une façon de poème rappelant les thèmes de Cavafy, du subtil esthète convoitant de belles brutes, etc.°°°
Quant au livre d’Antonin, qui me semble son premier vrai roman, il marque lui aussi une étonnante extension des qualités de perception et d’expression de l’écrivain, dont les influences littéraires multiples (de Robert Walser, de Thomas Bernhard ou de Peter Handke, notamment) tendent à se fondre dans une écriture plus personnelle.
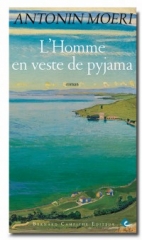
Après un premier regard traversant un peu sceptique, c’est avec un intérêt croissant, et même plus vif que pour ses derniers livres, que j’ai continué de lire L’Homme en veste de pyjama, qui me semble maîtriser sa matière (romanesque en l’occurrence) avec plus de verve et d’originalité, de qualités inventives dans l’écriture et de pénétration, quant au thème, que dans ses ouvrages précédents. Il y va ! Il s’en donne !
Ce vendredi 17 novembre. – Encore un peu secoué ce soir, et la jambe droite très douloureuses, après avoir failli m’écraser moi-même contre le mur de pierre de taille avec notre transporteur à chenilles que je manipulais en marche arrière et que je n’ai pu arrêter après avoir été déséquilibré.
On imagine le tableau : JLK crevant de s’écraser lui-même ! Mais Sophie, attirée par mes cris, a juste eu le temps de retenir la machine qui n’a fait, de sa chenille gauche, que me remonter le long de la jambe droite, avant de lâcher un soupir de résignation…
°°°
L’alcool est à la fois aiguiseur de couteaux et démon décréateur, agent de dilution et de dispersion à la funeste façon de la drogue, comme il en va de l’obsession sexuelle. Une dose de trop et c’est la vague, puis la noyade dans le vague de l’indétermination. Une fois de plus : question d’équilibre et d’énergie résistante – de refus de sombrer
°°°
Autant la positivité béate m’insupporte, autant j’en viens à me défier de la négativité à tout crin de certains, dont on dirait que le pire les réjouit. Je suis décidément un réaliste, et la réalité n’est pas si noire et désespérée que le prétendent ceux-là, ni aussi mornement merveilleuse que le prétendent les euphoriques.

En fait, il me suffit de revenir à nos fenêtre grand ouvertes, puis de faire un tour dans mes bibliothèques pour retrouver le sens commun qui m’est propre, hérité des miens et de ceux en qui j’ai reconnu mes bons conseillers, de Tchékhov à Annie Dillard, en passant par le Bon Will et René Girard, entre tant d’autres.
°°°
Un rêve m’a permis cette nuit de m’entretenir bien amicalement avec un maître à voir qui dessinait comme personne : que des choses justes et belles. Il m’a rappelé notre maître de dessin du collège, un Monsieur Gauthey aux cheveux assez longs mais toujours cravaté de laine, qui m’a aidé à mieux voir la peinture et m’a encouragé dans mes premiers tâtons. C’est lui, je crois qui m’a fait aimer Utrillo, le premier de mes peintres préférés. Son souvenir m’est plus tendre que celui d’aucun(e) de nos profs de l’époque.
°°°
Ensuite j’ai repris la lecture de Fleur Jaeggy. Ensuite j’ai composé un poème sur le thème de l’enfant au toton :
L’enfant au toton
Quand le temps est fini,
nous continuons de veiller;
les objets restés seuls
se sentent un peu à l’abandon,
mais qui peut en parler ?
Nul ne l’a appris à l’enfant.
Nul ne sait ce que dit la chaise
à la lampe allumée,
dans la pièce d’en haut,
où le silence paraît régner.
L’enfant seul contredit
ce que tous ont l’air de penser:
tous enterrés vivants,
tous satisfaits d’on ne sait quoi,
tous repus de néant,
- aveuglés de leurs seuls regards.
L’enfant seul fait tourner la table
tandis que nous veillons...
°°°
Le jeune écrivain est assez naturellement con. Puisse-t-il rester jeune.
Ce jeudi 23 novembre. – La visite de nos jeunes Américains nous a permis, une fois de plus, d’évaluer la qualité de nos liens familiaux, sans la moindre ombre ni le moindre trouble, non plus qu’aucune sentimentalité excessive. Nous sommes justes, me semble-t-il. Toutes nos relations, autant avec S. et F. qu’avec J. et G., sont équilibrées et justes.
Ce mardi 28 novembre. – J’ai repris et achevé ce matin ce poème qu’on peut dire tranquillement métaphysique, n’est-ce pas, à la fois tout limpide et obscur, mélange de jour blanc et de trou noir, qui suscite aussitôt de bonnes réactions dès que je le mets en ligne – comme quoi…
Au bord du ciel
On sort afin de prendre l’air.
Le cosmos est tout près :
il suffit de lever les yeux.
Quatrième dimension:
le temps se verra conjugué
à son corps défendant.
De l’abîme inversé
s’étoilent les cosmogonies.
Tu ne t’es pas vu naître,
toi qui prétends tout expliquer
mais on t’a raconté
le dais du ciel à neuf étages,
le Seigneur à l’attique
et les atomes inquiets -
on parle de carnage...
On chine dans le savoir,
et par le ciel au ralenti
les bolides vont clignotant
dans la lumière noire.
On croit voir l’infini,
et nos atomes, nos étoiles
ajoutent au récit
du grand livre des vents.
Le ciel n’est peut-être qu’un mot,
mais en est-on capable ?
(À La Désirade, cette nuit de novembre 2017.)
À l’atelier de la ruelle du Lac. – Chaque fois que je passe en ce lieu, qui m’est un autre territoire d’immunité, je me dis que je pourrais vivre une autre vie au milieu de tous ces livres, comme je l’ai vécue, seul, au Grand Chemin puis à la Malmeneur, dans les années 70, ou dans mon antre des escaliers du Marché, jusqu’en 1982, avec un peu de whisky et quelques biscuits, à l’écart, tout ça comme nous le sommes en harmonie à La Désirade ou comme je le suis, seul là encore, à l’isba. À chaque fois, cependant, que j’y reviens, me prend comme une paradoxale nostalgie du présent, si j’ose dire – thème possible d’un autre poème.
Le hasard, à l’atelier, me fait tomber sur Ariel de Sylvia Plath, qui me parle aussitôt. Comme Fleur Jaeggy et Laura Kasischke, Plath est une espèce de fée-sorcière - autre thème de poème.
°°°
Annie Dillard écrit que les poètes lisent de la poésie et que les romanciers lisent des romans, mais ça se discute. Et j’aime assez cette formule : «ça se discute ». Non pas « ça dépend», que je trouve mol et presque lâche, et surtout pas «des goûts et de couleurs », mais « ça se discute », qui va vers l’éclaircie - et décidément je me sens éclaireur.
°°°
Au contraire de Guido Ceronetti, je pondère, et le relativisme féminin de Lady L. n’est certes pas étranger à cette façon de ne pas tout pousser au noir et à la catastrophe, qui ajoute finalement à l’irrespirable et à l’invivable.

-
Ceux qui s'étonnent encore
 Celui qui évite les parcours fléchés aux processions fébriles de Russes sincèrement enthousiastes au demeurant / Celle qui découvrant le pont du Rialto pour la première fois s'exclame en japonais: stupendo ! / Ceux qui arrosent de spritz leur piattino de ciccheti / Celui qui s'émerveille de ce qu'il y ait quelque chose plutôt que rien sur le Campo San Barnaba / Celle qui commente l'édito de Paola Severino (dans le Gazettino de ce matin) consacré au rôle des nanas et aux choix à faire pour le bien du pays / Ceux qui draguent Daniela sans savoir lequel l'emmènera au Danieli / Celui qui traite de bonne pâte son amie abusant juste un peu des lasagnes / Celle qui se demande où était le peuple de Venise avec tous ces palais comme on en voit pas un en Alsace / Ceux qui se demandent si c'est un bon choix tactique pour l'UIL de se rapprocher de la CGIL sous la pression de la CISL / Celui qui prétend écrire un roman sur cette terrase du Campo Santa Margherita où l'on a déjà tourné des films qu'il n'a même pas vus / Celle qui va sur les traces de Corto Maltese dans l'ancien ghetto dont les chats ne pissent pas casher à ce que je sache / Ceux qui se pointent au bar branché que recommande le Routard sans y trouver si bon le tiramisù donc ça aussi sera noté sur le rapport / Celui qui en est resté au Guide Baedeker dont la couverture vieux rose lui rappelle le temps du Baron Corvo où la connection ne merdait pas encore comme aujourd'hui / Celle qui achète des artichauts au joli marchand du marché flottant qui n'a sûrement jamais tâté du Cynar d'une cougar / Ceux qui te rappellent gravement que Venise s'enfonce et auxquels tu réponds qu'eux aussi / Celui qui te recommande les vitrines d'anatomie comparée du Musée d'histoire naturelle de Santa Croce / Celle qui te manque ce matin au Dorsoduro et te rassure en te jurant que tu lui manques aussi donc tout est bien et le chien aussi va bien / Ceux qui font des découvertes à la librairie La Toletta où ils tombent ce matin sur le dernier recueil de nouvelles de Fleur Jaeggy / Celui qui lit le papier du Gazettino sur Les amoureux de Goldoni dont l'auteur prétend que c'est un opéra d'une indéniable modernité vu qu'on est encore amoureux aujourd'hui n'est-ce pas / Celle qui te recommande de faire un selfie de toi sur le pont des Soupirs afin de l'envoyer à ta soupirante / Ceux qui ont appris plus tard que Daniela s'était promise à l'abbé Daniélou, etc.
Celui qui évite les parcours fléchés aux processions fébriles de Russes sincèrement enthousiastes au demeurant / Celle qui découvrant le pont du Rialto pour la première fois s'exclame en japonais: stupendo ! / Ceux qui arrosent de spritz leur piattino de ciccheti / Celui qui s'émerveille de ce qu'il y ait quelque chose plutôt que rien sur le Campo San Barnaba / Celle qui commente l'édito de Paola Severino (dans le Gazettino de ce matin) consacré au rôle des nanas et aux choix à faire pour le bien du pays / Ceux qui draguent Daniela sans savoir lequel l'emmènera au Danieli / Celui qui traite de bonne pâte son amie abusant juste un peu des lasagnes / Celle qui se demande où était le peuple de Venise avec tous ces palais comme on en voit pas un en Alsace / Ceux qui se demandent si c'est un bon choix tactique pour l'UIL de se rapprocher de la CGIL sous la pression de la CISL / Celui qui prétend écrire un roman sur cette terrase du Campo Santa Margherita où l'on a déjà tourné des films qu'il n'a même pas vus / Celle qui va sur les traces de Corto Maltese dans l'ancien ghetto dont les chats ne pissent pas casher à ce que je sache / Ceux qui se pointent au bar branché que recommande le Routard sans y trouver si bon le tiramisù donc ça aussi sera noté sur le rapport / Celui qui en est resté au Guide Baedeker dont la couverture vieux rose lui rappelle le temps du Baron Corvo où la connection ne merdait pas encore comme aujourd'hui / Celle qui achète des artichauts au joli marchand du marché flottant qui n'a sûrement jamais tâté du Cynar d'une cougar / Ceux qui te rappellent gravement que Venise s'enfonce et auxquels tu réponds qu'eux aussi / Celui qui te recommande les vitrines d'anatomie comparée du Musée d'histoire naturelle de Santa Croce / Celle qui te manque ce matin au Dorsoduro et te rassure en te jurant que tu lui manques aussi donc tout est bien et le chien aussi va bien / Ceux qui font des découvertes à la librairie La Toletta où ils tombent ce matin sur le dernier recueil de nouvelles de Fleur Jaeggy / Celui qui lit le papier du Gazettino sur Les amoureux de Goldoni dont l'auteur prétend que c'est un opéra d'une indéniable modernité vu qu'on est encore amoureux aujourd'hui n'est-ce pas / Celle qui te recommande de faire un selfie de toi sur le pont des Soupirs afin de l'envoyer à ta soupirante / Ceux qui ont appris plus tard que Daniela s'était promise à l'abbé Daniélou, etc.Images: JLK