 Dialogue schizo
Dialogue schizo
Moi l'autre: - Et après ça ?
Moi l'un: - Après ça, quoi ?
Moi l'autre: - Après l'Afrique, qu'est-ce qu'on en a de plus ?
Moi l'un: - Après quelle Afrique ? Tu trouves qu'on a vu l'Afrique, toi ?
 Moi l'autre: - Enfin si quand même, un peu. Que de loin, c'est vrai, comme en passant, mais on a vu des bouts de pays du haut du ciel, des bouts de bords de routes, des bouts de buttes à termites et des bouts de marchés populeux ... Et puis des gens, on a vu quelques gens, qu'on reverra peut-être plus tard. Quand même sympas, non ? La Bestine, l'Ana et la Domi, le Fabrice et le Mwanza Fiston, le Bofane et le Vincent au béret vert, plus quelques autres. On a vu le Gouverneur Moïse Kitumba dans ses meubles. On a vu un bout de la moquette de son stade. On a vu un bout de jardin du Consul de Belgique. On a vu quelques groupes de rumba congolaise et de rap de Lubumbashi à la Halle de l'étoile dont on a vu le complet blanc du directeur genre personnage à la Simenon à belle épouse et enfant noirs. On a vu là un bout de pièce de théâtre assez cocasse. On a vu divers profs distingués de diverses facultés de lettres parlant comme Bourdieu mais d'autres qui avaient des choses à dire aussi sans parler des écrivains venus d'un peu partout. On a vu les nids-de-poule des parkings de l'université. On a vu les chiottes côté mecs délabrées de la faculté des Lettres. On a vu les étudiants fêtant leurs diplômes en grandes tenues. On a vu moi l'un et l'autre se fagotant de chemise et de cravate dans une boutique de fringues du fond d'une cour avant de se pointer chez le Gouverneur. On a vu des ombres rôder le long des rues nocturnes comme dans les alentours du MAD à Lausanne. On a vu...
Moi l'autre: - Enfin si quand même, un peu. Que de loin, c'est vrai, comme en passant, mais on a vu des bouts de pays du haut du ciel, des bouts de bords de routes, des bouts de buttes à termites et des bouts de marchés populeux ... Et puis des gens, on a vu quelques gens, qu'on reverra peut-être plus tard. Quand même sympas, non ? La Bestine, l'Ana et la Domi, le Fabrice et le Mwanza Fiston, le Bofane et le Vincent au béret vert, plus quelques autres. On a vu le Gouverneur Moïse Kitumba dans ses meubles. On a vu un bout de la moquette de son stade. On a vu un bout de jardin du Consul de Belgique. On a vu quelques groupes de rumba congolaise et de rap de Lubumbashi à la Halle de l'étoile dont on a vu le complet blanc du directeur genre personnage à la Simenon à belle épouse et enfant noirs. On a vu là un bout de pièce de théâtre assez cocasse. On a vu divers profs distingués de diverses facultés de lettres parlant comme Bourdieu mais d'autres qui avaient des choses à dire aussi sans parler des écrivains venus d'un peu partout. On a vu les nids-de-poule des parkings de l'université. On a vu les chiottes côté mecs délabrées de la faculté des Lettres. On a vu les étudiants fêtant leurs diplômes en grandes tenues. On a vu moi l'un et l'autre se fagotant de chemise et de cravate dans une boutique de fringues du fond d'une cour avant de se pointer chez le Gouverneur. On a vu des ombres rôder le long des rues nocturnes comme dans les alentours du MAD à Lausanne. On a vu...
Moi l'un: - Et tu trouves que c'est voir l'Afrique, ça ? Une paire de touristes lambdas n'en aurait-elle pas vu plus en voyage organisé ou au Club Med ?
Moi l'autre: - Non, je ne crois pas, à part le gnou, l'okapi et quelques beaux paysages. Et d'ailleurs toi non plus...
 Moi l'un: - T'as raison, mais c'est pas facile à démêler, ce qu'on ramène d'un voyage, surtout ce genre de trips journalistiques ou culturo-littéraires. Tu te rappelles la Tunisie en 1972, le Texas et la Côte Est en 1981, le Japon et la Californie en 1987, Le Canada plusieurs fois, la Pologne trois fois, et l'Italie, la Suède, le congrès du P.E.N. à Dubrovnik en pleine guerre, Vienne en 2005, Toronto et Montréal en 2003, Vienne en 2005, l'an dernier la Grèce et la Slovaquie, après la Tunisie...
Moi l'un: - T'as raison, mais c'est pas facile à démêler, ce qu'on ramène d'un voyage, surtout ce genre de trips journalistiques ou culturo-littéraires. Tu te rappelles la Tunisie en 1972, le Texas et la Côte Est en 1981, le Japon et la Californie en 1987, Le Canada plusieurs fois, la Pologne trois fois, et l'Italie, la Suède, le congrès du P.E.N. à Dubrovnik en pleine guerre, Vienne en 2005, Toronto et Montréal en 2003, Vienne en 2005, l'an dernier la Grèce et la Slovaquie, après la Tunisie...
Moi l'autre: - La Tunisie, c'était un voyage perso avec Rafik Ben Salah qui nous a fait rencontrer sa famille et des gens de sa connaissance: du coup c'était différent de ces "missions" et autres colloques.
Moi l'un: - C'est vrai qu'en dix jours de Tunisie on a vu cent fois plus de choses qu'au Congo où finalement on est restés trois jours coincés entre deux immenses voyages et des travaux auxquels on ne pouvait pas couper - d'ailleurs parfois intéressants, je ne dis pas...
Moi l'autre: - Fabrice Sprimont, l'un des organisateurs belges, avait l'air content qu'on soit là avec Max Lobe...
 Moi l'un: - Mais tout le monde il était content ! Même sans trop savoir comment se goupille ce "machin" de la Francophonie, pour reprendre l'expression du général De Gaulle à propos de l'ONU, on a joué le jeu sans trop se poser de questions sur les occurrences politiques de l'affaire. Etions-nous en train de cautionner indirectement le régime de Joseph Kabila ? Je ne le crois pas. Et remettre en cause le fait qu'on parle de littérature alors que la population a des besoins plus urgents n'a pas de sens non plus. Nous n'étions pas là que pour papoter mais pour nous frotter, même de loin, à un bout de réalité, et la légitimité académique et officielle reconnue à ces débats peut être le début de quelque chose - disons qu'on fait confiance aux gens de bonne volonté qui y ont travaillé. Et puis, et même avant tout, c'est bel et bien par l'écriture et la lecture qu'on se libère de la dépendance en général et des tyrans en particulier. Enfin c'est par ses écrivains que l'Afrique a commencé de nous parler et de vivre en nous...
Moi l'un: - Mais tout le monde il était content ! Même sans trop savoir comment se goupille ce "machin" de la Francophonie, pour reprendre l'expression du général De Gaulle à propos de l'ONU, on a joué le jeu sans trop se poser de questions sur les occurrences politiques de l'affaire. Etions-nous en train de cautionner indirectement le régime de Joseph Kabila ? Je ne le crois pas. Et remettre en cause le fait qu'on parle de littérature alors que la population a des besoins plus urgents n'a pas de sens non plus. Nous n'étions pas là que pour papoter mais pour nous frotter, même de loin, à un bout de réalité, et la légitimité académique et officielle reconnue à ces débats peut être le début de quelque chose - disons qu'on fait confiance aux gens de bonne volonté qui y ont travaillé. Et puis, et même avant tout, c'est bel et bien par l'écriture et la lecture qu'on se libère de la dépendance en général et des tyrans en particulier. Enfin c'est par ses écrivains que l'Afrique a commencé de nous parler et de vivre en nous...
Moi l'autre: - On a lu Les Damnés de la terre de Frantz Fanon à vingt ans, et le Discours sur le colonialisme de Césaire qui est un fabuleux morceau de prose française, mais quad tu dis écrivains tu penses, plutôt qu'idéologie: pleine pâte du roman ou profération du théâtre.
 Moi l'un: - Je pense à l'Afrique de Conrad et au Congo de Gide avant celle d'Amadou Hampaté Bâ ou de Mongo Beti, de Sony Labou Tansi ou de Tchicaya U'Tamsi. Et rencontrer les écrivains, aussi. Parce que rencontrer le géant Kourouma à Paris, rue Jacob, dans un troquet où il peinait à caser ses jambes, rencontrer Wole Soyinka de passage en Suisse après son Nobel, rencontrer Henri Lopes ou Boniface Mongo-Mboussa et parler de leurs livres a été la prolongation "physique" de ce début d'impérgnation par la lecture, comme de fouler la terre du Katanga. Quand, deux jours après avoir commencé la lecture de Mathématiques congolaise, on est tombé avec le Maxou sur Jean Bofane à Lubumbashi, ç'a été du vif même si ça n'aura pas de suite. Je n'en sais rien: je m'en fous un peu, les écrivains sont ce qu'ils sont et j'aime bien que chacun conserve sa liberté. Je me rappellerai la voix grave de Bofane et je l'ai vu danser, après quoi je lirai d'un autre oeil son prochain roman sur les Pygmées et la mondialisation qu'il nous a annncé...
Moi l'un: - Je pense à l'Afrique de Conrad et au Congo de Gide avant celle d'Amadou Hampaté Bâ ou de Mongo Beti, de Sony Labou Tansi ou de Tchicaya U'Tamsi. Et rencontrer les écrivains, aussi. Parce que rencontrer le géant Kourouma à Paris, rue Jacob, dans un troquet où il peinait à caser ses jambes, rencontrer Wole Soyinka de passage en Suisse après son Nobel, rencontrer Henri Lopes ou Boniface Mongo-Mboussa et parler de leurs livres a été la prolongation "physique" de ce début d'impérgnation par la lecture, comme de fouler la terre du Katanga. Quand, deux jours après avoir commencé la lecture de Mathématiques congolaise, on est tombé avec le Maxou sur Jean Bofane à Lubumbashi, ç'a été du vif même si ça n'aura pas de suite. Je n'en sais rien: je m'en fous un peu, les écrivains sont ce qu'ils sont et j'aime bien que chacun conserve sa liberté. Je me rappellerai la voix grave de Bofane et je l'ai vu danser, après quoi je lirai d'un autre oeil son prochain roman sur les Pygmées et la mondialisation qu'il nous a annncé...
Moi l'autre: - Et les deux fistons...
 Moi l'un: - Le Maxou, alias Max le Bantou, c'est une Afrique que j'aime dans son mélange de vitalité et d'inquiétude, de gaîté juvénile et de tristesse ravalée. Sans lui, ce voyage n'aurait pas été ce qu'il a pu être, avec autant de rencontres naturelles et d'échanges. L'ami Jean-Philipe Jutzi, à Présence Suisse, l'a choisi pour ses compétences particulières et son entregent, mais ce que j'aime surtout chez lui est sa façon,par l'écriture, de traduire la réalité la plus cuisante avec une espèce de clarté rieuse. J'y retrouve le pleurer-rire d'Henri Lopes...
Moi l'un: - Le Maxou, alias Max le Bantou, c'est une Afrique que j'aime dans son mélange de vitalité et d'inquiétude, de gaîté juvénile et de tristesse ravalée. Sans lui, ce voyage n'aurait pas été ce qu'il a pu être, avec autant de rencontres naturelles et d'échanges. L'ami Jean-Philipe Jutzi, à Présence Suisse, l'a choisi pour ses compétences particulières et son entregent, mais ce que j'aime surtout chez lui est sa façon,par l'écriture, de traduire la réalité la plus cuisante avec une espèce de clarté rieuse. J'y retrouve le pleurer-rire d'Henri Lopes...
Moi l'autre: - Quant à l'autre Fiston, Mwanza Mujila, c'est aussi l'Afrique de demain...
Moi l'un: - C'est du plus âpre et du plus lyrique que Maxou. Son Tram 83 dont il nous a envoyé le tapuscrit après le Congrès est une espèce de rhapsodie free jazzée. Cela me touche assez de penser que ce lascar est écrivain-résident à Graz, en Autriche, et qu'il ressaisit le bordel congolais dans ce roman-poème en quête d'éditeur. On a suivi l'aventure de la mise en forme de 39, rue de Berne, qui paraîtra enjanvier chez Zoé sous le nom de Max Lobe, et j'espère bien que Fiston Mwanza trouvera lui aussi un interlocuteur de cette qualité...
Moi l'autre: - Sans oublier le manuscrit du bon Bona !
 Moi l'un:- Ca va de soi ! Mais ça aussi c'est l'Afrique: cette indolence fataliste. Le bon Bona Mangangu nous fait un roman épatant sur la dernière nuit du génial Caravage. On voit paraître des tas de livres "possibles" mais pas indispensables, et voilà un tapuscrit que trois éditeurs m'ont refusé jusque-là tandis que Bona se tourne les pouces dans son hamac. Mais on va le secouer, allez. Dès qu'on aura fini de lire Congo. Une histoire de David Van Broucker, cette fabuleuse épopée d'un pays aussi fascinant que martyrisé, on saute dans l'Easy Jet de Manchester et sus au bon Bona pour qu'il se sorte enfin les pouces...
Moi l'un:- Ca va de soi ! Mais ça aussi c'est l'Afrique: cette indolence fataliste. Le bon Bona Mangangu nous fait un roman épatant sur la dernière nuit du génial Caravage. On voit paraître des tas de livres "possibles" mais pas indispensables, et voilà un tapuscrit que trois éditeurs m'ont refusé jusque-là tandis que Bona se tourne les pouces dans son hamac. Mais on va le secouer, allez. Dès qu'on aura fini de lire Congo. Une histoire de David Van Broucker, cette fabuleuse épopée d'un pays aussi fascinant que martyrisé, on saute dans l'Easy Jet de Manchester et sus au bon Bona pour qu'il se sorte enfin les pouces...
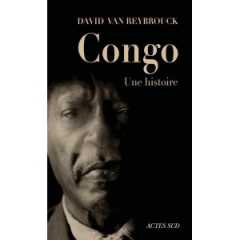 Moi l'autre: - Donc l'Afrique ne fait que commencer !
Moi l'autre: - Donc l'Afrique ne fait que commencer !
Moi l'un: - Et comment ! Moi je la vois de plus en plus partout, pour le pire et le meilleur. En Suisse je la vois aussi comme un retour à nos sources, mais ce qui m'intéresse n'est pas le méli-mélo sentimental genre sanglot de l'homme blanc. Bien plutôt la confrontation avec le réel qui va de maux en mots et pour ce qu'on aimerait bien le bien de tous, ou tout au moins le moins pire...







 Celui qui se souvient nettement d'un Monsieur Bureau et d'une dame Frelon rencontrés dans un rêve fait en la chambre 219 du Park Hotel de Lubumbashi / Celle qui portait une coiffe d'intérieur à bordure de dentelle sur l'autochrome photographique rappelant son souvenir à ses hôtes de la rue de Seine tous enterrés depuis longtemps eux aussi /
Celui qui se souvient nettement d'un Monsieur Bureau et d'une dame Frelon rencontrés dans un rêve fait en la chambre 219 du Park Hotel de Lubumbashi / Celle qui portait une coiffe d'intérieur à bordure de dentelle sur l'autochrome photographique rappelant son souvenir à ses hôtes de la rue de Seine tous enterrés depuis longtemps eux aussi / Ceux qui aiment entendre dialoguer Gerry Mulligan et Chet Baker en se rappelant le dernier concert de celui-ci dans une cave parisienne dont j'oublie le nom qui n'est pas le Blue Note mais la mélancolie n'en est pas moins là même le jour dédié à Sainte Thérèse d'Avila / Celui qui reste pensif devant cette pensée de Paul Morand selon lequel "la honte n'est pas toujours la conscience du mal que nous faisons, elle est souvent la consciece du mal qu'on nous a fait" / Celle qui se rappelle que Thérèse d'Avila commençait ses instructions spirituelles aux novices en les faisant récurer les salles communes du couvent / Ceux qui font un pas de côté pour mieux avancer / Celui qui aura vite fait le tour du petit cynique genre monte-en-selle / Celle qui selle la jument Céleste / Ceux qui n'en finissent pas de se rafraîchir au torrent des matinées passées ou présentes ou à venir tant qu'ils y sont , etc.
Ceux qui aiment entendre dialoguer Gerry Mulligan et Chet Baker en se rappelant le dernier concert de celui-ci dans une cave parisienne dont j'oublie le nom qui n'est pas le Blue Note mais la mélancolie n'en est pas moins là même le jour dédié à Sainte Thérèse d'Avila / Celui qui reste pensif devant cette pensée de Paul Morand selon lequel "la honte n'est pas toujours la conscience du mal que nous faisons, elle est souvent la consciece du mal qu'on nous a fait" / Celle qui se rappelle que Thérèse d'Avila commençait ses instructions spirituelles aux novices en les faisant récurer les salles communes du couvent / Ceux qui font un pas de côté pour mieux avancer / Celui qui aura vite fait le tour du petit cynique genre monte-en-selle / Celle qui selle la jument Céleste / Ceux qui n'en finissent pas de se rafraîchir au torrent des matinées passées ou présentes ou à venir tant qu'ils y sont , etc.  Dialogue schizo
Dialogue schizo Moi l'autre: - Enfin si quand même, un peu. Que de loin, c'est vrai, comme en passant, mais on a vu des bouts de pays du haut du ciel, des bouts de bords de routes, des bouts de buttes à termites et des bouts de marchés populeux ... Et puis des gens, on a vu quelques gens, qu'on reverra peut-être plus tard. Quand même sympas, non ? La Bestine, l'Ana et la Domi, le Fabrice et le Mwanza Fiston, le Bofane et le Vincent au béret vert, plus quelques autres. On a vu le Gouverneur Moïse Kitumba dans ses meubles. On a vu un bout de la moquette de son stade. On a vu un bout de jardin du Consul de Belgique. On a vu quelques groupes de rumba congolaise et de rap de Lubumbashi à la Halle de l'étoile dont on a vu le complet blanc du directeur genre personnage à la Simenon à belle épouse et enfant noirs. On a vu là un bout de pièce de théâtre assez cocasse. On a vu divers profs distingués de diverses facultés de lettres parlant comme Bourdieu mais d'autres qui avaient des choses à dire aussi sans parler des écrivains venus d'un peu partout. On a vu les nids-de-poule des parkings de l'université. On a vu les chiottes côté mecs délabrées de la faculté des Lettres. On a vu les étudiants fêtant leurs diplômes en grandes tenues. On a vu moi l'un et l'autre se fagotant de chemise et de cravate dans une boutique de fringues du fond d'une cour avant de se pointer chez le Gouverneur. On a vu des ombres rôder le long des rues nocturnes comme dans les alentours du MAD à Lausanne. On a vu...
Moi l'autre: - Enfin si quand même, un peu. Que de loin, c'est vrai, comme en passant, mais on a vu des bouts de pays du haut du ciel, des bouts de bords de routes, des bouts de buttes à termites et des bouts de marchés populeux ... Et puis des gens, on a vu quelques gens, qu'on reverra peut-être plus tard. Quand même sympas, non ? La Bestine, l'Ana et la Domi, le Fabrice et le Mwanza Fiston, le Bofane et le Vincent au béret vert, plus quelques autres. On a vu le Gouverneur Moïse Kitumba dans ses meubles. On a vu un bout de la moquette de son stade. On a vu un bout de jardin du Consul de Belgique. On a vu quelques groupes de rumba congolaise et de rap de Lubumbashi à la Halle de l'étoile dont on a vu le complet blanc du directeur genre personnage à la Simenon à belle épouse et enfant noirs. On a vu là un bout de pièce de théâtre assez cocasse. On a vu divers profs distingués de diverses facultés de lettres parlant comme Bourdieu mais d'autres qui avaient des choses à dire aussi sans parler des écrivains venus d'un peu partout. On a vu les nids-de-poule des parkings de l'université. On a vu les chiottes côté mecs délabrées de la faculté des Lettres. On a vu les étudiants fêtant leurs diplômes en grandes tenues. On a vu moi l'un et l'autre se fagotant de chemise et de cravate dans une boutique de fringues du fond d'une cour avant de se pointer chez le Gouverneur. On a vu des ombres rôder le long des rues nocturnes comme dans les alentours du MAD à Lausanne. On a vu...  Moi l'un: - T'as raison, mais c'est pas facile à démêler, ce qu'on ramène d'un voyage, surtout ce genre de trips journalistiques ou culturo-littéraires. Tu te rappelles la Tunisie en 1972, le Texas et la Côte Est en 1981, le Japon et la Californie en 1987, Le Canada plusieurs fois, la Pologne trois fois, et l'Italie, la Suède, le congrès du P.E.N. à Dubrovnik en pleine guerre, Vienne en 2005, Toronto et Montréal en 2003, Vienne en 2005, l'an dernier la Grèce et la Slovaquie, après la Tunisie...
Moi l'un: - T'as raison, mais c'est pas facile à démêler, ce qu'on ramène d'un voyage, surtout ce genre de trips journalistiques ou culturo-littéraires. Tu te rappelles la Tunisie en 1972, le Texas et la Côte Est en 1981, le Japon et la Californie en 1987, Le Canada plusieurs fois, la Pologne trois fois, et l'Italie, la Suède, le congrès du P.E.N. à Dubrovnik en pleine guerre, Vienne en 2005, Toronto et Montréal en 2003, Vienne en 2005, l'an dernier la Grèce et la Slovaquie, après la Tunisie...  Moi l'un: - Mais tout le monde il était content ! Même sans trop savoir comment se goupille ce "machin" de la Francophonie, pour reprendre l'expression du général De Gaulle à propos de l'ONU, on a joué le jeu sans trop se poser de questions sur les occurrences politiques de l'affaire. Etions-nous en train de cautionner indirectement le régime de Joseph Kabila ? Je ne le crois pas. Et remettre en cause le fait qu'on parle de littérature alors que la population a des besoins plus urgents n'a pas de sens non plus. Nous n'étions pas là que pour papoter mais pour nous frotter, même de loin, à un bout de réalité, et la légitimité académique et officielle reconnue à ces débats peut être le début de quelque chose - disons qu'on fait confiance aux gens de bonne volonté qui y ont travaillé. Et puis, et même avant tout, c'est bel et bien par l'écriture et la lecture qu'on se libère de la dépendance en général et des tyrans en particulier. Enfin c'est par ses écrivains que l'Afrique a commencé de nous parler et de vivre en nous...
Moi l'un: - Mais tout le monde il était content ! Même sans trop savoir comment se goupille ce "machin" de la Francophonie, pour reprendre l'expression du général De Gaulle à propos de l'ONU, on a joué le jeu sans trop se poser de questions sur les occurrences politiques de l'affaire. Etions-nous en train de cautionner indirectement le régime de Joseph Kabila ? Je ne le crois pas. Et remettre en cause le fait qu'on parle de littérature alors que la population a des besoins plus urgents n'a pas de sens non plus. Nous n'étions pas là que pour papoter mais pour nous frotter, même de loin, à un bout de réalité, et la légitimité académique et officielle reconnue à ces débats peut être le début de quelque chose - disons qu'on fait confiance aux gens de bonne volonté qui y ont travaillé. Et puis, et même avant tout, c'est bel et bien par l'écriture et la lecture qu'on se libère de la dépendance en général et des tyrans en particulier. Enfin c'est par ses écrivains que l'Afrique a commencé de nous parler et de vivre en nous...  Moi l'un: - Je pense à l'Afrique de Conrad et au Congo de Gide avant celle d'Amadou Hampaté Bâ ou de Mongo Beti, de Sony Labou Tansi ou de Tchicaya U'Tamsi. Et rencontrer les écrivains, aussi. Parce que rencontrer le géant Kourouma à Paris, rue Jacob, dans un troquet où il peinait à caser ses jambes, rencontrer Wole Soyinka de passage en Suisse après son Nobel, rencontrer Henri Lopes ou Boniface Mongo-Mboussa et parler de leurs livres a été la prolongation "physique" de ce début d'impérgnation par la lecture, comme de fouler la terre du Katanga. Quand, deux jours après avoir commencé la lecture de Mathématiques congolaise, on est tombé avec le Maxou sur Jean Bofane à Lubumbashi, ç'a été du vif même si ça n'aura pas de suite. Je n'en sais rien: je m'en fous un peu, les écrivains sont ce qu'ils sont et j'aime bien que chacun conserve sa liberté. Je me rappellerai la voix grave de Bofane et je l'ai vu danser, après quoi je lirai d'un autre oeil son prochain roman sur les Pygmées et la mondialisation qu'il nous a annncé...
Moi l'un: - Je pense à l'Afrique de Conrad et au Congo de Gide avant celle d'Amadou Hampaté Bâ ou de Mongo Beti, de Sony Labou Tansi ou de Tchicaya U'Tamsi. Et rencontrer les écrivains, aussi. Parce que rencontrer le géant Kourouma à Paris, rue Jacob, dans un troquet où il peinait à caser ses jambes, rencontrer Wole Soyinka de passage en Suisse après son Nobel, rencontrer Henri Lopes ou Boniface Mongo-Mboussa et parler de leurs livres a été la prolongation "physique" de ce début d'impérgnation par la lecture, comme de fouler la terre du Katanga. Quand, deux jours après avoir commencé la lecture de Mathématiques congolaise, on est tombé avec le Maxou sur Jean Bofane à Lubumbashi, ç'a été du vif même si ça n'aura pas de suite. Je n'en sais rien: je m'en fous un peu, les écrivains sont ce qu'ils sont et j'aime bien que chacun conserve sa liberté. Je me rappellerai la voix grave de Bofane et je l'ai vu danser, après quoi je lirai d'un autre oeil son prochain roman sur les Pygmées et la mondialisation qu'il nous a annncé... Moi l'un: - Le Maxou, alias Max le Bantou, c'est une Afrique que j'aime dans son mélange de vitalité et d'inquiétude, de gaîté juvénile et de tristesse ravalée. Sans lui, ce voyage n'aurait pas été ce qu'il a pu être, avec autant de rencontres naturelles et d'échanges. L'ami Jean-Philipe Jutzi, à Présence Suisse, l'a choisi pour ses compétences particulières et son entregent, mais ce que j'aime surtout chez lui est sa façon,par l'écriture, de traduire la réalité la plus cuisante avec une espèce de clarté rieuse. J'y retrouve le pleurer-rire d'Henri Lopes...
Moi l'un: - Le Maxou, alias Max le Bantou, c'est une Afrique que j'aime dans son mélange de vitalité et d'inquiétude, de gaîté juvénile et de tristesse ravalée. Sans lui, ce voyage n'aurait pas été ce qu'il a pu être, avec autant de rencontres naturelles et d'échanges. L'ami Jean-Philipe Jutzi, à Présence Suisse, l'a choisi pour ses compétences particulières et son entregent, mais ce que j'aime surtout chez lui est sa façon,par l'écriture, de traduire la réalité la plus cuisante avec une espèce de clarté rieuse. J'y retrouve le pleurer-rire d'Henri Lopes...  Moi l'un:- Ca va de soi ! Mais ça aussi c'est l'Afrique: cette indolence fataliste. Le bon Bona Mangangu nous fait un roman épatant sur la dernière nuit du génial Caravage. On voit paraître des tas de livres "possibles" mais pas indispensables, et voilà un tapuscrit que trois éditeurs m'ont refusé jusque-là tandis que Bona se tourne les pouces dans son hamac. Mais on va le secouer, allez. Dès qu'on aura fini de lire Congo. Une histoire de David Van Broucker, cette fabuleuse épopée d'un pays aussi fascinant que martyrisé, on saute dans l'Easy Jet de Manchester et sus au bon Bona pour qu'il se sorte enfin les pouces...
Moi l'un:- Ca va de soi ! Mais ça aussi c'est l'Afrique: cette indolence fataliste. Le bon Bona Mangangu nous fait un roman épatant sur la dernière nuit du génial Caravage. On voit paraître des tas de livres "possibles" mais pas indispensables, et voilà un tapuscrit que trois éditeurs m'ont refusé jusque-là tandis que Bona se tourne les pouces dans son hamac. Mais on va le secouer, allez. Dès qu'on aura fini de lire Congo. Une histoire de David Van Broucker, cette fabuleuse épopée d'un pays aussi fascinant que martyrisé, on saute dans l'Easy Jet de Manchester et sus au bon Bona pour qu'il se sorte enfin les pouces...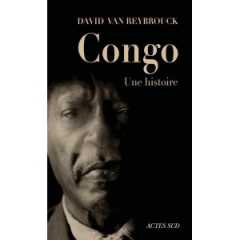 Moi l'autre: - Donc l'Afrique ne fait que commencer !
Moi l'autre: - Donc l'Afrique ne fait que commencer !


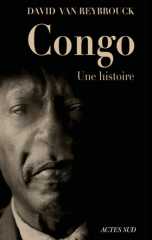





 chemin (32) Premiers débats ardents avant la pluie battante, le 24 septembre.
chemin (32) Premiers débats ardents avant la pluie battante, le 24 septembre. 




 - J'aurais volontiers fait la valise dans La fille à la valise, ce bijou de Valerio Zurlini.
- J'aurais volontiers fait la valise dans La fille à la valise, ce bijou de Valerio Zurlini. 10) Quelle est votre apparition préférée d’un personnage historique dans un rôle de fiction ?
10) Quelle est votre apparition préférée d’un personnage historique dans un rôle de fiction ? 23) Qu’est-ce qui pour vous, dans un film, marque la supériorité du 7e art ?
23) Qu’est-ce qui pour vous, dans un film, marque la supériorité du 7e art ?

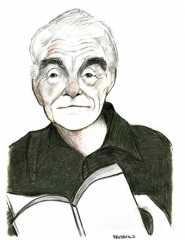 Les étapes marquantes de son oeuvre kaléidoscopique seront le récit d’Alma Mater (1971) bien ancré dans nos régions, les nouvelles du Gour noir (1972), le roman plus ambitieux - peut-être son chef-d’œuvre - que représente Le Collier de Schanz (1972), suivi de nombreux autres livres frappés au même sceau d’un style sans pareil, à la fois puissant et chantourné. Or ce qui nous semble caractériser la démarche et l’écriture de Gaston Cherpillod est cette «manipulation alchimique» consistant à transmuter son expérience vécue en légende, au fil d’une opération qui engage à la fois la porosité sensible du poète et les tours de mains de l’infatigable artisan des lettres. Il y avait du mystique inspiré et du croisé rouscailleur chez cet empêcheur de lénifier en rond, de l’aristocrate chez ce fils de prolos jamais guéri des humiliations subies par les siens - du contemplatif et du juste aussi.
Les étapes marquantes de son oeuvre kaléidoscopique seront le récit d’Alma Mater (1971) bien ancré dans nos régions, les nouvelles du Gour noir (1972), le roman plus ambitieux - peut-être son chef-d’œuvre - que représente Le Collier de Schanz (1972), suivi de nombreux autres livres frappés au même sceau d’un style sans pareil, à la fois puissant et chantourné. Or ce qui nous semble caractériser la démarche et l’écriture de Gaston Cherpillod est cette «manipulation alchimique» consistant à transmuter son expérience vécue en légende, au fil d’une opération qui engage à la fois la porosité sensible du poète et les tours de mains de l’infatigable artisan des lettres. Il y avait du mystique inspiré et du croisé rouscailleur chez cet empêcheur de lénifier en rond, de l’aristocrate chez ce fils de prolos jamais guéri des humiliations subies par les siens - du contemplatif et du juste aussi. 

 d'Afrique au Lötschental / Celle qui sent en elle une ascendance princière / Ceux qui rampent à contre-courant pour rejoindre leurs pères qui les ont jetés-là / Celui qui se demande ce que signifie le sourire-là de Kabila à Kagamé / Celle qui se rappelle l'éclair de la hache des Basakata / Ceux en qui frémit la fierté d'être soi / Celui qui se trouve au point où les aïeux pâlissent / Celle qui accueille le ciel de Kinshasa le soir dans son regard bleu à reflets flammés de pourpre et d'or / Ceux qui ne lèvent plus les yeux vers le ciel qu'ils disent ingrat / Celui qui s'est senti trahi par sa ville natale / Celle qui souffre de la beauté frelatée de la ville-lupanar / Ceux qui ferment les yeux dans le métro de New York à la seule évocation de la pulpe juteuse de la mangue / Celui qui trouve ce soir un goût amer au vin du désir / Celle qui reste fidèle au dieu Loba au dam de l'évangéliste à Mercedes / Ceux qui ont entendu dire que Paul Kagamé avait deux ou trois choses à se reprocher mais les gens sont médisants n'est-ce pas /
d'Afrique au Lötschental / Celle qui sent en elle une ascendance princière / Ceux qui rampent à contre-courant pour rejoindre leurs pères qui les ont jetés-là / Celui qui se demande ce que signifie le sourire-là de Kabila à Kagamé / Celle qui se rappelle l'éclair de la hache des Basakata / Ceux en qui frémit la fierté d'être soi / Celui qui se trouve au point où les aïeux pâlissent / Celle qui accueille le ciel de Kinshasa le soir dans son regard bleu à reflets flammés de pourpre et d'or / Ceux qui ne lèvent plus les yeux vers le ciel qu'ils disent ingrat / Celui qui s'est senti trahi par sa ville natale / Celle qui souffre de la beauté frelatée de la ville-lupanar / Ceux qui ferment les yeux dans le métro de New York à la seule évocation de la pulpe juteuse de la mangue / Celui qui trouve ce soir un goût amer au vin du désir / Celle qui reste fidèle au dieu Loba au dam de l'évangéliste à Mercedes / Ceux qui ont entendu dire que Paul Kagamé avait deux ou trois choses à se reprocher mais les gens sont médisants n'est-ce pas /  Celui qui s'est souvent interrogé sur la fonction d'idiot utile de l'écrivain / Celle qui pionce au fond de l'église du réveil / Ceux qui vont à la bringue sous la surveillance des milices / Celui qui a vu les hommes-léopards en rêve et se contente de brasser les couleurs dans son atelier d'artiste sans même lire le dernier numéro de Jeune Afrique et autres magazines-là / Celle qu'on appelait la demeurée du Gabon dans le quartier des Bleuets / Ceux qui avaient des sagaies à leurs murs évoquant leurs années aux missions / Celui qui a toujours respecté les Pygmées / Celle qui a vu son neveu Paul ingérer un bol d'iboga après avoir lu Carnages de Pierre Péan /
Celui qui s'est souvent interrogé sur la fonction d'idiot utile de l'écrivain / Celle qui pionce au fond de l'église du réveil / Ceux qui vont à la bringue sous la surveillance des milices / Celui qui a vu les hommes-léopards en rêve et se contente de brasser les couleurs dans son atelier d'artiste sans même lire le dernier numéro de Jeune Afrique et autres magazines-là / Celle qu'on appelait la demeurée du Gabon dans le quartier des Bleuets / Ceux qui avaient des sagaies à leurs murs évoquant leurs années aux missions / Celui qui a toujours respecté les Pygmées / Celle qui a vu son neveu Paul ingérer un bol d'iboga après avoir lu Carnages de Pierre Péan /  Ceux qui voient un lien entre les peintures du schizophrène alémanique Adolf Wölfli et l'art dit primitif / Celui qui pose au défenseur des droits de l'homme alors qu'il ne fait qu'effacer le passé colonial de ses parents planteurs d'hévéas / Celle qui observe les petits sorciers de la rue de Kin la belle devenue Kin la poubelle / Ceux qui s'en remettent aux dieux païens faute de mieux / Celui qui a vu Les Hommes arrivent de la mer sur la scène de la Halle de l'étoile / Celle que le pillage de son pays incite au silence / Ceux qui parlent de projet de société dans laville-désastre / Celui qui tient la Vérité en laisse en passant ses ministres en revue / Celle qui milite pour un monde pluriel ouvert à la poésie en espéranto et à la défense des pandas / Ceux qui ne pourront voir les gracieux gorilles du parc des Virunga au motif que la guerre y fait rage entre les bipèdes à cerveaux surdéveloppés, etc.
Ceux qui voient un lien entre les peintures du schizophrène alémanique Adolf Wölfli et l'art dit primitif / Celui qui pose au défenseur des droits de l'homme alors qu'il ne fait qu'effacer le passé colonial de ses parents planteurs d'hévéas / Celle qui observe les petits sorciers de la rue de Kin la belle devenue Kin la poubelle / Ceux qui s'en remettent aux dieux païens faute de mieux / Celui qui a vu Les Hommes arrivent de la mer sur la scène de la Halle de l'étoile / Celle que le pillage de son pays incite au silence / Ceux qui parlent de projet de société dans laville-désastre / Celui qui tient la Vérité en laisse en passant ses ministres en revue / Celle qui milite pour un monde pluriel ouvert à la poésie en espéranto et à la défense des pandas / Ceux qui ne pourront voir les gracieux gorilles du parc des Virunga au motif que la guerre y fait rage entre les bipèdes à cerveaux surdéveloppés, etc.





 Lumière bleue pour commencer. Tout repose encore et tout est dans la musique que vous connaissez sûrement: La Mer de Richard Clayderman.
Lumière bleue pour commencer. Tout repose encore et tout est dans la musique que vous connaissez sûrement: La Mer de Richard Clayderman.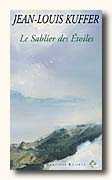 Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le Sablier des étoiles, composé à l'instigation d'Henri Ronse.
Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le Sablier des étoiles, composé à l'instigation d'Henri Ronse.







