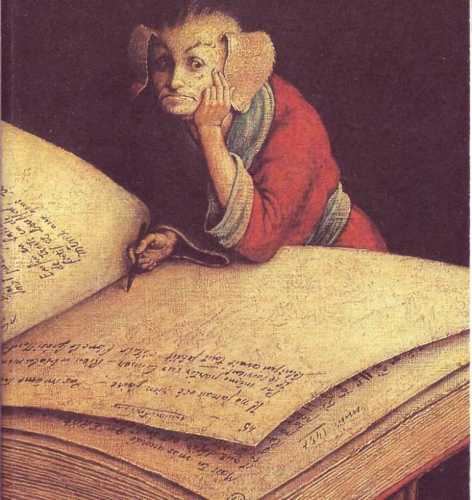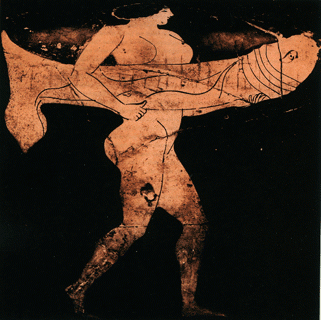Retour à un grand écrivain du XXe siècle, qu'on retrouve ces jours dans une incomparable correspondance avec Jean Paulhan, parfait honnête homme et ami sans complaisance. De 1921 à 1968 (mort de Paulhan), 1148 pages de propos éclairant la vie littéraire française et ses figures majeures. Excellente présentation de Jacques Roussilla, chez Gallimard.
À chaque fois que j’ai remis de l’ordre dans ma chambre envahie de livres et de papiers, je ne sais pourquoi j’en reviens à penser à Marcel Jouhandeau – peut-être parce que son œuvre est elle-même une constante mise en ordre ? Plus qu’aucun autre écrivain de ce temps, auquel il ne prêtait plus qu’un peu de sa personne, Jouhandeau savait restituer de tels instants dans ses épiphanies familières, naturellement porté à glorifier les choses les plus ordinaires de la vie, que son regard suffisait à grouper dans le nimbe d’une lumière d’éternité, son regard et son écriture relevant d’un quotidien Magnificat. « Quand je mourrai, écrivait-il, la mort sera surtout pour moi un adieu aux mots. Ils ont été mes meilleurs amis, ma société quotidienne, fidèle et intime. » Et de même revient-on à son œuvre comme dans une maison de mots dont chacun serait le signe vibrant du mystère de nos origines et de nos fins, dans le voisinage comme enchanté du parc de la Malmaison aux oiseaux musiciens, avec le clair-obscur des pièces hantées de souvenirs sensuels ou féroces, en bas les éclats de voix stridents d’Élise et en haut les répons jubilatoires de l’harmonium de Marcel, enfin les mots de toute une existence dont ses livres disent autant les faiblesses que les échappées vers l’azur, mais tous venus de la même source, leur eau fût-elle tantôt lustrale et tantôt trouble, tantôt savoureuse et tantôt écœurante. Il y avait chez lui du paysan et du comédien, du franciscain et du sybarite, du moraliste de la plus haute tradition classique et du Narcisse lettré s’oubliant parfois jusqu’à diluer le meilleur de son style dans un mélange d’encens et de vieille tisane. Cependant il y a, dans son œuvre, un homme tout entier qui se livre sans détours, et c’est tout entier que seulement on peut le comprendre, avec son enfance à Chaminadour et son adolescence tourmentée et mystique, sous le regard de parents qui furent des sages mesurant leurs paroles, sa bienveillante rigueur de professeur et son émancipation parallèle de jouisseur charnel, sa vénération de tous les aspects de la vie lui accordant d’anoblir jusqu’à ses vices, qu’il reconnaissait pour tels, et son allégresse, sa rouerie de croyant de mauvaise foi, son dandysme frottant d’humilité non feinte son orgueil non moins royal, et tous ces mots qui nous le masquent et nous le révèlent en même temps. « Une phrase heureuse parfois, où affleure le sacré, peut tenir lieu de ce qu’on a vainement cherché ailleurs, de ce que l’Univers trop souvent refuse », écrivait-il encore. On pourrait n’y voir qu’une formule de littérateur, ce qu’il était aussi. Au demeurant, le mandarin dans sa thébaïde avait vécu plus intensément que maints aventuriers, écouté avec la même puissance d’accueil les dits de sa tribu de Creuse, observé avec une malice plus distante les intrigues des salons parisiens où il retrouvait Léautaud et Cingria, Gide ou Paulhan, beaucoup lu les Anciens et beaucoup chanté le grégorien, beaucoup prié l’Éternel qu’il consentait à trouver plus grand que lui, et beaucoup fréquenté les mauvais lieux dont il prétendait qu’il ne sortait pas plus sali que le soleil des latrines, avec la même mauvaise foi catholique qui lui tirait des soupirs de repentance – tout cela que charrie et détaille son œuvre, des inoubliables chroniques provinciales de Chaminadour, des Pincengrain ou du Journal du coiffeur, à ses vingt volumes de Journaliers dont l’ensemble forme à la fois un visage et le plus vaste paysage. Or, voici comment écrivait Jouhandeau : « Le langage des êtres vrais n’a autant de grandeur que parce qu’il est plus près du silence. Ce qui fait l’attrait du style, c’est l’imprévu, l’absence d’apprêt, la rigueur ou le soupçon de quelque mystère. Le plus grand mérite de l’écrivain, c’est peut-être de se tenir à la limite de l’obscurité qui avoisine et accompagne toujours les secrets, de savoir être inédit, d’approcher l’ineffable, sans renoncer à la clarté. Quand il s’agit de l’inintelligible, de l’indicible, c’est alors que le langage est le plus troublant, s’il sait suggérer ce qu’il ne lui est pas permis d’avouer ou de formuler. On recourt à l’analogie. On laisse affleurer sous les mots ce qu’on ne saurait, à aucun prix, ni décrire ni nommer. Rien de plus conventionnel apparemment. Il arrive cependant que dans un tournemain ou grâce à une faille quelque chose passe. Passe-passe. Il court, il court, le furet. »
Marcel Jouhandeau / Jean Paulhan. Correspondance 1921-1968. Gallimard. Les Cahiers de la NRF, 1148p.




 Sous une noire peinture à l'encre de Chine représentant une forêt genre selva oscura, Frédéric Pajak cite un dicton hassidim qui dit que "là-bas, dans le monde à venir, tout sera disposé comme ici. Comme est notre maison ,elle sera dans le monde à venir; où notre enfant dort maintenant, il dormira aussi dans le monde à venir. Les vêtements que nous portons nous les porterons aussi. Tout sera comme ici..."
Sous une noire peinture à l'encre de Chine représentant une forêt genre selva oscura, Frédéric Pajak cite un dicton hassidim qui dit que "là-bas, dans le monde à venir, tout sera disposé comme ici. Comme est notre maison ,elle sera dans le monde à venir; où notre enfant dort maintenant, il dormira aussi dans le monde à venir. Les vêtements que nous portons nous les porterons aussi. Tout sera comme ici..." Je recopie le premier texte qui figure sous un dessin représentant de grosses bottes de foin brûlé: "Les Esprits, enfouis au plus profond de la terre, décident de revenir au monde. Ils ne sont ni des immortels ni des fantômes,mais simplement des Esprits. Ils forment une espèce de cohorte, portent chacun le nom d'un sentiment puissant. Il y a là le Bonheur, le Désespoir, l'Appétit. Et puis la Fatigue, longue femme amaigrie, les yeux rougis de larmes, la coiffure comme une botte de foin brûlé. Dans la cohorte, il y a encore la Douleur, la Joie, la Peur,le Chagrin et d'autres encore".
Je recopie le premier texte qui figure sous un dessin représentant de grosses bottes de foin brûlé: "Les Esprits, enfouis au plus profond de la terre, décident de revenir au monde. Ils ne sont ni des immortels ni des fantômes,mais simplement des Esprits. Ils forment une espèce de cohorte, portent chacun le nom d'un sentiment puissant. Il y a là le Bonheur, le Désespoir, l'Appétit. Et puis la Fatigue, longue femme amaigrie, les yeux rougis de larmes, la coiffure comme une botte de foin brûlé. Dans la cohorte, il y a encore la Douleur, la Joie, la Peur,le Chagrin et d'autres encore".  Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Noir sur Blanc, 2012, 186p.
Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Noir sur Blanc, 2012, 186p.

 Bona Mangangu. Sheffield, nov. 2012
Bona Mangangu. Sheffield, nov. 2012






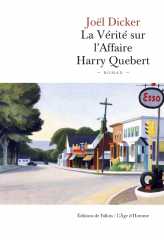 Joël Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Editions Bernard de Fallois / L’Age d’homme, 653p.
Joël Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Editions Bernard de Fallois / L’Age d’homme, 653p. 
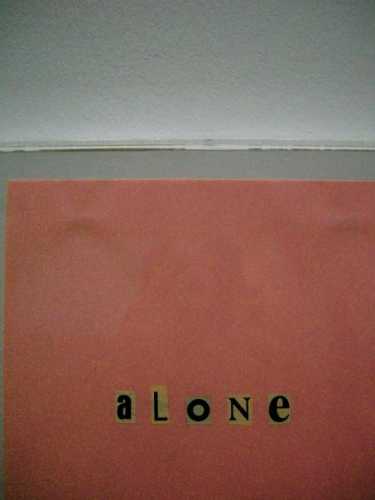



 À propos du Prix Goncourt 2012 et de la "littérature littéraire". Dialogue schizo.
À propos du Prix Goncourt 2012 et de la "littérature littéraire". Dialogue schizo.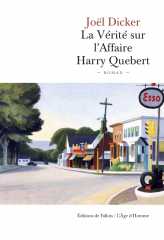



 Dialogue schizo
Dialogue schizo