
Je m’en suis tenu, maman, à ta règle de ne pas s’en laisser conter. J’ai résolu, en me rappelant ce que tu m’as appris, de ne suivre que mon instinct, sans m’occuper de ce que les autres pensaient ou disaient. Je ne me suis pas laissé piétiner, et c’est à cause de ça que nous nous sommes trouvés finalement elle et moi, je te parle de Marie-Ange.
Mon projet c’était d’assumer, comme ils disaient. J’avais été ébranlé par le départ de Vera. Je ne m’étais pas rappelé tes préventions à son égard. Je m’étais dit que peut-être elle avait raison - que c’était moi qui déraillais. J’ai donc hésité, puis je me suis ressaisi.
Elle m’a dit que j’étais un taré. Elle m’a dit: tu dois être un pervers, oui c’est cela tu es un pervers, tu me fais gerber. Elle a dit ça. Elle voulait me faire mal. Elle ne supportait pas l’idée que j’aie mes propres goûts. C’était comme en musique: elle n’admettait pas que j’apprécie Frankie Laine et Dolly Parton. Elle aurait voulu que je m’en remette entièrement à elle: elle prétendait que la country était barjo et qu’elle, Vera, ne pouvait simplement pas tolérer qu’on joue de la country ou du folk sous son toit. Par rapport à mon goût particulier, elle m’a dit que j’étais un vicieux, mais là je me suis défendu en lui rappelant que c’était elle qui m’avait conseillé de me libérer quand on s’était rencontrés, puis que c’était elle qui me l’avait fait la première fois.
A part ça, même si ma tendance n’était pas tellement revendiquée alors en tant que telle, j’avais pour moi toute le nouveau trend de l’époque. Partout, à ce moment-là, tout le monde ne faisait que répéter: vivez votre fantasme, affirmez votre désir, affichez votre différence. Tout le monde s’assumait en long et en large. Il n’y en avait partout que pour la différence et c’est ce qui m’a poussé à sortir du bois à mon tour.
Mais là-dessus, pour y parvenir, il est vrai qu’il m’aura fallu du temps et du cran. C’est qu’il faut dire, et là vraiment je ne vais rien te cacher, que ma différence à moi était un peu spéciale.
La réaction de Vera m’avait mis sur mes gardes. Alors même que c’était elle qui m’avait fait flasher là-dessus, je m’étais aperçu que ce jeu amoureux que j’avais redécouvert en sa compagnie, et qui me semblait tout ce qu’il y a d’innocent, ne lui était apparu comme ça que le temps d’une séance alors qu’il deviendrait, d’après ce qu’elle disait, un vice ou une perversion à se répéter.
Quant à moi, je ne voyais pas du tout les choses ainsi. J’avais découvert un truc hyperfort et je m’y tenais. J’avais retrouvé une sensation géniale et je ne vois pas pourquoi j’aurais culpabilisé. D’une certaine manière, aussi, je t’avais retrouvée. Peut-être que je n’aurais pas osé te le dire comme ça, quand tu étais encore là. Peut-être que ça t’aurait choquée, comme quand je t’ai avoué que j’avais bu un verre de notre urine avec Timothée, autour de nos sept ans, mais à présent je te dois cette vérité, c’est une question entre nous, maman, puisque ces moments-là me restent aussi comme mes plus anciens souvenirs de toi, je crois bien.
Je me les suis rappelés surtout à l’odeur. Tout n’était plus alors qu’une affaire de sensation, mais c’est sacrément important: les psychologues le répètent tant et plus. En tout cas moi ça restait le lien le plus fort entre nous.
Tout de suite, quand Vera me l’a fait, je me suis retrouvé tant d’années en arrière, dans une lumière qui devait être celle de la salle de bain aux vitres dépolies de la maison des Oiseaux, je me suis rappelé le dur et le doux de la planche à langer que tu avais installée en travers de la baignoire à pieds de fonte, je me suis rappelé la petite flamme bleutée de la veilleuse du chauffage à gaz que je distinguais d’en dessous et je me suis rappelé des sons lointains qui devaient être ceux de la vie dans le quartier, je me suis rappelé l’odeur de la grosse commission, comme tu l’appelais avec une sorte de reconnaissance, comme si ça te prouvait que j’existais, et peu après je me suis rappelé l’odeur de la crème Nivea qu’on pourrait simplement dire l’odeur de propre en ordre et de sécurité que j’associe aussi à ta présence à chaque fois que j’avais transpiré au cours de mes chères maladies d’enfant et que tu me changeais avant de m’apporter ma tisane, je me suis rappelé tout ça mais je n’en ai pas parlé à Vera, et je me le suis parfois reproché, mais c’était avant de rencontrer Marie-Ange.
Ensuite, par l’imagination, ça a été encore plus géant. Au fur et à mesure que je revivais cette première séance, je retrouvais d’autres sensations et d’autres détails qui me rappelaient notre vie tout au début aux Oiseaux.
Et c’est ça, peut-être, c’est sûrement ça qui a fait paniquer Vera, avec cette intuition que vous avez toutes.
Elle a dû se dire, probablement, que ce que je lui demandais de me faire, là, nous ramenait à autre chose qu’à notre histoire.
Ce qui est certain c’est que c’est à cause de ça que cela s’est gâté entre nous et qu’elle m’a jeté, mais c’est aussi vrai qu’après m’être posé des questions j’en ai eu marre de tout prendre sur moi et que j’ai décidé, avec l’aide de Jean-Yves, d’assumer mon fantasme.
J’avais alors plus de trente ans, mais je me sentais un peu flottant à quelque part. Je n’estimais pas avoir encore trouvé la voie particulière dont tu disais que j’étais digne - toi qui me rêvais plus ou moins soliste dans un orchestre de danse parce que tu m’avais payé des leçons de piano toutes ces années et que ma façon de jouer du Richard Clayderman te semblait fantastique -, mais je sentais que je devais faire quelque chose qui tranche avec la routine de l’agence où je travaillais en intérimaire.
Déjà, d’avoir rompu avec Vera m’a fait du bien, contrairement à ce que j’avais craint. Plus j’y pensais et plus je me disais que cette femme m’aurait empêché de respirer à la longue. Notre collage durait depuis plus de trois ans, avec deux ou trois crises qui t’avaient plutôt réjouie, puis ça a été ton attaque foudroyante qui m’a tellement secoué que je me suis rendu compte que sans Vera je me serais effondré, mais j’avais aussi remarqué, durant cette période où je commençais mon travail de deuil, comme l’appelait Jean-Yves, que Vera était hyperdure et combien aussi, matériellement parlant, elle se montrait calculatrice.
Jean-Yves m’a aidé à me faire à la solitude, c’est lui qui a commencé à me donner à lire des trucs en psycho, il m’a écouté et je lui en ai raconté de plus en plus, un jour que je lui ai dit ma terreur de voir papa débarquer dans son cabinet j’ai fondu en larmes comme un môme et il m’a pris dans ses bras, après quoi les vannes se sont ouvertes et je lui ai tout déballé, toutes nos années, toutes les fois où papa se pointait et finissait par te menacer, d’une séance à l’autre je descendais le courant selon son expression et puis j’ai commencé de le remonter et c’est tout à la fin que j’ai cassé le morceau, un jour j’allais tellement mal qu’il m’a dit que j’avais besoin de quelqu’un et qu’il m’a posé la main sur la cuisse, mais moi je me suis retiré tout de suite en me veillant de ne pas le blesser, il ne l’a d’ailleurs pas du tout mal pris, il m’a même dit que c’était mieux comme ça et c’est alors qu’en toute confiance je lui avoué mon fantasme.
Quand Jean-Yves m’a dit qu’on allait travailler ce sujet-là, je me suis dit, surtout après le coup de la main sur la cuisse, que je devais une fière chandelle à ce type et d’autant plus qu’il avait lui-même une vie à problèmes à ce qu’il semblait.
Pourtant j’étais encore bien loin, à l’époque, d’envisager un coming out que Jean-Yves lui-même ne me conseillait pas. Ensuite de quoi, et ça aussi m’a salement secoué, mais peut-être aussi libéré d’une certaine façon, Jean-Yves a disparu sans crier gare. Comme nous avions espacé les séances, il se passait parfois deux ou trois semaines sans que nous ne nous rencontrions, puis il m’a parlé d’un autre poste qu’il pourrait peut-être décrocher au sud de la France, et finalement c’est par une lettre un peu distante, sur un ton qui m’a plutôt déçu, qu’il m’a expliqué que nous ne nous reverrions pas et que je pouvais continuer la thérapie avec Glenda, après quoi ses adieux étaient plus affectueux et il me laissait son adresse, mais jamais je ne lui ai récrit et d’ailleurs je n’avais plus tellement besoin d’une aide de ce côté, je venais de vendre les Oiseaux, j’avais de quoi survivre quelques années sans travailler, puis j’ai eu envie de revoir du monde et j’ai passé d’un job à l’autre par l’agence et je me suis mis à chercher une partenaire qui me comprendait sans même que j’aie forcément besoin de lui confier mon secret.
Plus précisément, lorsque j’ai commencé de fréquenter les minorités, un sentiment compliqué, joint à ma timidité naturelle, m’empêcha de me livrer.
Un samedi matin que ces groupes défilaient dans les rues du centre ville, je leur avais emboîté le pas, je m’étais mis à manifester avec eux en faveur de la différence, puis un type qui distribuait des tracts m’en a filé quelques-uns à remettre aux passants, et le soir je me suis retrouvé à ce qu’ils appelaient une prise de parole dans le cadre du Collectif Fusion.
Je dois te le dire alors sans détour: tout de suite ça m’a plu. Tout de suite, ces filles et ces garçons qui disaient ce qu’ils vivaient sans tricher, ça m’a vraiment superplu. Je me suis dit: là, Roland, tu vas pouvoir t’assumer.
Cela se passait dans un loft: moi je n’avais rien contre a priori, tu sais, malgré le joli cadre dans lequel nous avons vécu aux Oiseaux. J’étais sûrement le plus vieux du groupe, mais je m’étais fait un look western, j’avais les cheveux longs et je m’étais mis au banjo. On était tous assis à des étages différents, il y avait de la musique qui tournait toute seule et des filles aux pieds nus distribuaient des tasses de thé de menthe. Ensuite de quoi s’est déroulée la prise de parole.
Il y avait un garçon aux cheveux décolorés et aux lèvres noires (je ne te mens pas), appuyé contre un type baraqué en veste de cuir, qui racontait ce qu’il avait enduré en milieu ouvrier, et j’étais touché de voir que tous avaient le même air concerné en l’écoutant.
Il y avait une fille chauve à la voix rauque qui racontait l’abus qu’elle avait subi: elle disait que tout venait de là, mais qu’en somme elle ne le regrettait pas vu qu’elle préférait être comme ça que pareille aux blaireaux, et tout à coup je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment plusieurs façons d’être différent.
Enfin, après deux ou trois autres, un certain Brahim a expliqué ce que ça représentait de voir dans le regard de l’autre le mot bougnoule, et je me suis alors demandé si je pourrais, avec ma différence, être aussi bien accepté que lui et les autres.
En tout cas je n’étais plus tellement à l’aise. J’étais content de m’être rapproché de ces gens que je pouvais écouter et auxquels je montrais ma propre compréhension, mais je les ai observés aussi et j’ai vu comment cela se passait entre eux, et j’ai noté que, très vite, les uns et les autres se rapprochaient ou s’éloignaient au contraire les uns des autres, s’attiraient ou se rejetaient carrément.
Bientôt, en plus, certains ont voulu savoir où je me situais, intrigués qu’ils étaient par mon allure et mes silences. Sans faire trop de mystère je me disais plutôt en recherche et déviais la conversation en promettant de m’expliquer lorsque je m’y sentirais disposé. Comme je ne répondais aux avances ni des uns ni des autres, et que je répandais autour de moi ce fluide que la première tu as identifié chez moi, chacun des camarades se figurait que ma différence s’apparentait plus ou moins à la sienne et que de toute façon je finirais bien par m’exprimer.
Mais comment passer à l’acte ? Comment m’expliquer sans me faire exclure comme je l’avais été par Vera ? Comment leur dire ma différence ?
Toi tu l’aurais compris, ça ne faisait pas un pli, que j’aimais plus que tout être langé, que j’aimais faire dans mes couches et que rien ne me plaisait autant que d’être torché et changé: tu aurais accepté mon fantasme qui, d’une certaine manière, me rapprochait de toi par delà les années; surtout tu aurais apprécié la probité avec laquelle j’étais résolu à l’exposer et à la défendre - mais comment la leur faire accepter si moi-même je m’en gênais encore ?
Eh bien, mon intuition ne m’a pas trompé, puisqu’à la première prise de parole où, enfin, je m’exprimai dans un groupe de conscience du Collectif Fusion, je remarquai aussitôt comme un courant de réprobation passer, ainsi que je l’avais éprouvé avec Vera. Dès que les gens eurent compris de quelle nature était ma différence, je constatai qu’ils se regardaient, puis ils commencèrent de murmurer et il fallut que Régis rappelle que dans le groupe on respectait l’outing de chacun pour que cela se calme.
Depuis ce soir-là, pourtant, j’ai remarqué qu’un fossé s’était creusé entre nous.
Après mon intervention, déjà, les gens m’ont tous plus ou moins évité à la fin de la séance et l’ami de Régis, me prenant à part, m’a parlé de psycho-réparation sur ce même ton de bienveillance accablée qui avait été celui de Vera.
C’est ainsi que je m’éloignai du Collectif Fusion et que, malgré le soutien passé de Jean-Yves et la possibilité de recourir à sa collègue, j’entrai peu après, en dépression.
Je n’ai pas besoin de te faire un dessin: tu as connu cela des années durant. Même si ce n’est qu’aujourd’hui que je commence d’imaginer ta propre dérive, je n’en reviens pas encore de l’avoir supportée moi-même: ça a vraiment été la totale, mais j’ai toujours pensé que tu reçois ce que tu donnes et c’est exactement ce que nous nous disons à présent que nous sommes installés aux Mésanges, Marie-Ange et moi.
Bref, des mois ont passé, et l’internement, les médics et tout ça, mais une fois encore j’avais mon idée et, dès que je m’en suis tiré, je n’ai plus pensé qu’à vivre mon obsession jusqu’au bout non sans avoir remis mes compteurs à zéro.
J’avais d’abord cru, stupide que j’étais, ce que disaient les gens, puis j’avais vu ce qu’ils faisaient; et maintenant je me rappellais que tu m’avais toujours dit de ne jamais me fier qu’à ce que les gens font, et là je peux dire que tu avais raison: j’ai vu que ce qu’ils font n’a rien à voir avec ce qu’ils disent mais je me suis obstiné et désormais, avec Marie-Ange, nous n’avons plus à rendre de compte à personne.
Si je me suis assumé finalement en pratiquant publiquement mon coming out, et si j’ai rencontré Marie-Ange par la même occasion, je ne regrette pas d’y être arrivé par un moyen qui t’aurait déplu de ton vivant, toi qui voyais en l’exhibition la pire calamité de l’époque. J’ai bien mis quelque temps à te l’avouer, mais je ne saurais m’y soustraire. Toi-même me disais que jamais je ne pourrais rien te cacher, même après, et c’est pourquoi je n’ai jamais douté que je finirais par te l’avouer.
C’est pourtant vrai, maman: je me suis exhibé, nous nous sommes exhibés Marie-Ange et moi, nous nous sommes pliés tous deux à la règle du jeu de l’émission télévisée Fantasmes fous, consistant à jouer sur le plateau, en présence de l’animateur et de la psy, la scène de son goût assumé, et probablement cela t’aurait-il contrariée de me voir ainsi langé par Marie-Ange devant des millions de téléspectateurs, comme de me voir ensuite téter Marie-Ange pour accomplir sa propre fantaisie.
Souvent je me suis pris à t’imaginer au milieu du public de ce soir-là. Or, qu’aurais-tu vraiment pensé de tout ça ? Je ne sais pas: je n’en suis pas sûr mais je te demande de le comprendre où tu es à présent.
Ce qu’il y a de sûr, c’est que c’est bel et bien pour m’être assumé que j’ai rencontré Marie-Ange et que c’est notre différence revendiquée qui nous a permis de participer, ensemble, à la finale de Fantasmes fous, au Lavandou, où nous avons gagné Les Mésanges.
Nous avons choisi le nom de notre pavillon avec vue sur la mer en mémoire du quartier des Oiseaux où nous avons passé tant d’années, ce qui nous fait, toi et moi, nous retrouver d’une autre façon encore.
Te souviens-tu, à ce propos, de ce que tu m’avais raconté du premier poste de télévision du quartier ? Les enfants, vous aviez été invités chez des voisins qui avaient les moyens afin d’y voir un épisode de Lassie chien fidèle que tu m’as raconté vingt ans après.
Or, il y a déjà sept ans que nous nous sommes rencontrés, moi et Marie-Ange. Si questions rapports nous en sommes encore au top, nos fameux fantasmes fous nous ont bientôt lassés, et nous savons à présent que nous ne pourrons avoir d’enfant. Un temps, j’ai pensé que nous pourrions prendre un Lassie en mémoire de toi, mais Marie-Ange m’a fait remarquer que le collie laissait trop de poils dans la maison, et tu sais que ce que femme veut...
Ce que je regrette un peu aujourd’hui, c’est que l’extension du lotissement fait que nous ne voyons plus la mer depuis le printemps dernier. Mais rassure-toi: nous sommes très occupés tous les deux par la petite boutique de produits bios que le père de Marie-Ange nous a permis d’ouvrir au Lavandou, et nous avons choisi de renoncer à la télévision pour être encore plus près de la nature, ce qui doit te faire plaisir. Enfin, la maxinouvelle que tu attends sûrement, c’est que je me suis remis au pianola. Où tu es, d’ailleurs, tu dois te réjouir de mes progrès...
Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le maître des couleurs, paru en 2001 aux éditions Bernard Campiche.

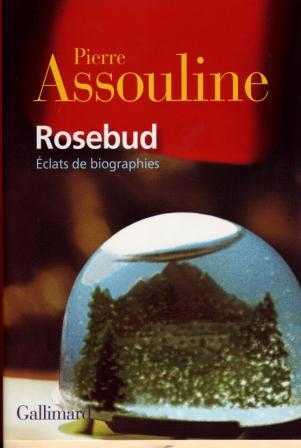
 Je sais que je retrouverai mon premier exemplaire de Rosebud, probablement égaré dans les strates de la bibliothèque de notre vieille dame aimée. En revanche jamais je ne retrouverai le Rosebud de Vladimir Nabokov, ce petit Argus bleu dans sa pochette de papier transparent que le grand écrivain, en reconnaissance de ses soins, offrit à mon ami médecin R., qui me le donna à son tour pour me remercier de tous les livres que je lui avait fait découvrir. Le petit papillon s'est perdu au fil de mes déménagements; il a dû s'envoler alors que je déballai ma bibliothèque, une fois ou l'autre, mais son souvenir me restera tant que je vivrai et que vivra en moi le souvenir de mon ami de jeunesse tombé dans la face Nord du Mont Dolent, il y a tant d'années déjà...
Je sais que je retrouverai mon premier exemplaire de Rosebud, probablement égaré dans les strates de la bibliothèque de notre vieille dame aimée. En revanche jamais je ne retrouverai le Rosebud de Vladimir Nabokov, ce petit Argus bleu dans sa pochette de papier transparent que le grand écrivain, en reconnaissance de ses soins, offrit à mon ami médecin R., qui me le donna à son tour pour me remercier de tous les livres que je lui avait fait découvrir. Le petit papillon s'est perdu au fil de mes déménagements; il a dû s'envoler alors que je déballai ma bibliothèque, une fois ou l'autre, mais son souvenir me restera tant que je vivrai et que vivra en moi le souvenir de mon ami de jeunesse tombé dans la face Nord du Mont Dolent, il y a tant d'années déjà...


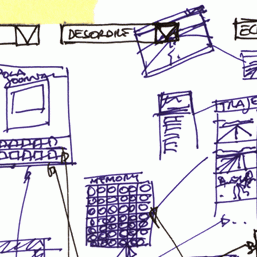







 Ensuite il y a 93 autres fragments de cette eau, puisque l’ensemble s’intitule 100 Raisons.
Ensuite il y a 93 autres fragments de cette eau, puisque l’ensemble s’intitule 100 Raisons. Ah mais ceci encore : que, dans un contrepoint heureux, les textes de 100 Raisons sont accompagnés de vignettes d’artiste signées Emmanuelle Anquetil, d’une poésie elliptique qui s’apparie parfaitement à celle d’Hervé Chesnais. Dernière piste enfin: le site d'Hervé Chesnais himself, à l'enseigne de La position du scribe.
Ah mais ceci encore : que, dans un contrepoint heureux, les textes de 100 Raisons sont accompagnés de vignettes d’artiste signées Emmanuelle Anquetil, d’une poésie elliptique qui s’apparie parfaitement à celle d’Hervé Chesnais. Dernière piste enfin: le site d'Hervé Chesnais himself, à l'enseigne de La position du scribe.








