Celui qui a été retenu parmi les 777 candidats au Reality Show / Celle qui ne manquera pas un épisode des Aventuriers du Désert / Ceux qui espèrent gagner le séjour à Marbella / Celui que le désir de vaincre fait surmonter sa phobie des épineux / Celle qui admire le couple de Danois dormant pour la première fois à la belle étoile / Ceux qui constatent que le désert du Nord Mexique mérite sa réputation / Celui qui se fait appeler El Macho pour gommer ce qu’il lui reste de l’employé d’assurances milanais / Celle qui porte une créole de femme pirate / Ceux qui espèrent restaurer leur estime d’eux-mêmes grâce au bivouac en zone peu sûre / Celui qui affirmera plus tard qu’il y eut un AVANT et un APRES dans son existence, dont l’épreuve de l’Anaconda fut le pivot / Celle qui fait un clin d’œil au public chaque fois qu’elle chie de trac / Ceux des techniciens balèzes qui se sont tapé la concurrente boulotte éliminée à la septième étape pour des propos inadéquats incriminant son collègue brésilien affligé de strabisme / Celui qui s’est découvert une nature de gagneur en surmontant l’épreuve des piranhas et de la chèvre naine / Celle qui n’a jamais pensé qu’un corps de femme ruisselant de boue tiède pût lui inspirer un désir physique aussi soudain que sauvage / Ceux qui ont répandu dans les médias la rumeur selon laquelle deux des animateurs entretenaient de certaines relations avec la représentante du sponsor principal / Celui qui a tenté de faire croire aux téléspectateurs que son élimination le soulageait quelque part / Celle qui revient de l’Aventure du Désert avec un nouvel amant néerlandais qui lui a tapé dans l'oeil sur le tarmac d’Amsterdam / Ceux qu’on désignera désormais comme ceux de la grande famille des Aventuriers, etc.
Livre - Page 152
-
Ceux qui ont vécu l'Aventure
-
Défense de Pierre Etaix

A quatre-vingts ans, Pierre Etaix, clown, dessinateur et cinéaste ne peut plus montrer ses films.
Les cinq longs métrages (dont quatre co-écrits avec Jean-Claude Carrière) sont aujourd'hui totalement invisibles, victimes d'un imbroglio juridique scandaleux qui prive les auteurs de leurs droits et interdit toute diffusion (même gratuite)de leurs films.
Si vous souhaitez comprendre les raisons de ce rapt culturel et signer la pétition pour la ressortie des films de Pierre Etaix, visitez ces liens: http://sites.google.com/site/petitionetaix/
Faites passer le message à tous vos contacts et amis avant le 10 mai 2009, date de remise de la pétition à Madame Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication.L'appel de Serge Toubiana, Directeur général de la Cinémathèque française
Pierre Etaix
 est connu du public et des cinéphiles, en France comme à l’étranger, pour avoir réalisé cinq films. Cinq films, ce n’est pas beaucoup dans une vie de cinéaste. Mais ces cinq films-là ont été marquants, nous ont fait rire et avaient du style ; ils appartiennent à la veine burlesque du cinéma, dans la tradition de Buster Keaton et de Jacques Tati. Cette espèce trop rare est en voie de disparition - hélas ! Le Soupirant (1962), Yoyo (1964), Tant qu’on a la santé (1965), Le Grand amour (1968) et Pays de cocagne (1969). Pierre Etaix a souvent travaillé avec son ami et complice Jean-Claude Carrière, lequel avait aussi travaillé aux côtés de Tati (et de Luis Bunuel, bien sûr). Pierre Etaix n’a pas fait que ces cinq films, ce qui serait déjà bien. Il a aussi réalisé des courts métrages, été le collaborateur artistique de Tati comme dessinateur et gagman, puis assistant-réalisateur sur Mon Oncle. Il a fait du cirque, du music-hall, joué et écrit pour le théâtre, fait des ouvrages à la main à partir de ses dessins humoristiques. Il a créé en 1973 l’Ecole nationale du Cirque, avec sa femme Annie Fratellini. Il est aussi l’ami fidèle de Jerry Lewis, ce qui pour moi veut dire beaucoup… Et puis, Monsieur Etaix est un homme charmant et délicat, d’une grande courtoisie. Clown timide, trop timide. Pour qu’il se mette en colère et se jette dans la bagarre, il lui en faut beaucoup. Et c’est ce qui est train de se passer…
est connu du public et des cinéphiles, en France comme à l’étranger, pour avoir réalisé cinq films. Cinq films, ce n’est pas beaucoup dans une vie de cinéaste. Mais ces cinq films-là ont été marquants, nous ont fait rire et avaient du style ; ils appartiennent à la veine burlesque du cinéma, dans la tradition de Buster Keaton et de Jacques Tati. Cette espèce trop rare est en voie de disparition - hélas ! Le Soupirant (1962), Yoyo (1964), Tant qu’on a la santé (1965), Le Grand amour (1968) et Pays de cocagne (1969). Pierre Etaix a souvent travaillé avec son ami et complice Jean-Claude Carrière, lequel avait aussi travaillé aux côtés de Tati (et de Luis Bunuel, bien sûr). Pierre Etaix n’a pas fait que ces cinq films, ce qui serait déjà bien. Il a aussi réalisé des courts métrages, été le collaborateur artistique de Tati comme dessinateur et gagman, puis assistant-réalisateur sur Mon Oncle. Il a fait du cirque, du music-hall, joué et écrit pour le théâtre, fait des ouvrages à la main à partir de ses dessins humoristiques. Il a créé en 1973 l’Ecole nationale du Cirque, avec sa femme Annie Fratellini. Il est aussi l’ami fidèle de Jerry Lewis, ce qui pour moi veut dire beaucoup… Et puis, Monsieur Etaix est un homme charmant et délicat, d’une grande courtoisie. Clown timide, trop timide. Pour qu’il se mette en colère et se jette dans la bagarre, il lui en faut beaucoup. Et c’est ce qui est train de se passer…
Yoyo a été restauré il y a quelques mois grâce à la Fondation Groupama Gan pour le cinéma. François Ede, directeur de la photo et bon technicien, s’est occupé de cette restauration - c’est lui qui avait retrouvé, il y a plusieurs années, la version en couleur de Jour de fête de Tati. Restauré et flambant neuf, Yoyo avait été montré en mai à Cannes (dans la section Cannes Classics), puis début juillet à la Cinémathèque française, dans le cadre du festival Paris-Cinéma. Pierre Etaix était tout heureux, très ému de voir le public d’aujourd’hui rire et s’émouvoir en (re)découvrant son film. Mais cette résurrection de Yoyo tenait en fait du miracle. Car la situation juridique des films d’Etaix était complexe.
(...) Actuellement, les 5 films réalisés par Pierre Etaix sont bloqués : aucune diffusion possible, aucune ressortie commerciale, aucune édition DVD. Une véritable chape de plomb. A cause d’un imbroglio juridique dont les conséquences sont tragi-comiques. Ce qui est en jeu dans cette affaire, c’est évidemment le droit de l’auteur : comment se fait-il qu’un cinéaste, plus de 30 ans après qu’il a réalisé ses films, ne puisse avoir accès aux négatifs dans le but de les restaurer ? Qu’est-ce qui fait qu’une société cessionnaire des droits d’auteur à titre exclusif et pour le monde entier, refuse toute initiative, ne se préoccupe pas de valoriser ces films ? Qu’est-ce qui fait que l’on puisse faire main-basse sur des films, sans se soucier de la volonté légitime d’un auteur de les faire renaître ?
Pierre Etaix se bat comme un diable, pour que son œuvre soit respectée, montrée, programmée, éditée. Comment lui donner tort ? Et pourtant, rien n’est simple. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette triste affaire, consultez le site internet : www.lesfilmsdetaix.fr
Et si vous souhaitez, comme moi, signer la pétition pour aider à la ressortie des films de Pierre Etaix, allez au : www.ipetitions.com/petition/lesfilmsdetaix/index.html
S.T. -
Chienne de belle vie
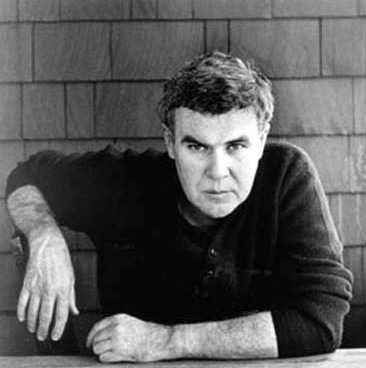
Deux recueils posthumes de Raymond Carver. Et deux nouvelles adaptées au théâtre par Jacques Lassalle, ces jours au Théâtre de Vidy.
«Cette fois, c'est vraiment la fin», écrivait Tess Gallagher à un ami à l'époque où elle préparait la publication de ces cinq nouvelles de Raymond Carver. Ainsi qu'elle le raconte plus en détail dans sa postface, la compagne de «Ray» fut très occupée, après la mort prématurée de l'écrivain (terrassé par un cancer du poumon en 1988), par la supervision de trois recueils posthumes, ajoutée à ses propres travaux (elle est enseignante et poétesse), qui l'empêchèrent de s'occuper d'éventuels inédits de Carver, avant qu'un des responsables de la revue Esquire, Jay Woodruff, ne vienne à sa rescousse pour la préparation de ces cinq nouvelles inédites et plus ou moins achevées - on sait que Carver rédigeait jusqu'à trente versions d'une de ses histoires avant de l'estimer parfaite.
Or, loin de constituer des ébauches, et moins encore des fonds de tiroir, les nouvelles parues en traduction sous le titre de la dernière, Qu'est-ce que vous voulez voir?, sont dignes du meilleur Carver, à quelques détails formels près que les éditeurs ont d'ailleurs eu raison de ne pas gommer. Pour l'essentiel en revanche, touchant à la résonance émotionnelle et à la beauté limpide de ces tranches de vies meurtries, le lecteur retrouvera dans ce livre tout ce qui fait le charme et la profonde poésie de l'auteur des Vitamines du bonheur ou de Parlez-moi d'amour.
La première de ces nouvelles (Appelle si tu as besoin de moi) est à la fois la plus simple et la plus touchante. Un couple, au bord du divorce, loue une maison dans la campagne d'Eureka (sur la côte nord de la Californie) pour tâcher de se retrouver. Or, tout semble aller bien, mais ça ne va quand même pas, jusqu'au moment où l'apparition de deux chevaux blancs, dans le jardin, leur fait revivre ensemble un instant de magie et reparler et se retrouver bel et bien... avant de repartir chacun de son côté. Plus douloureuse, la nouvelle intitulée Rêves relate la mort, dans un incendie, des deux enfants d'une femme dont le mariage s'est effondré, tandis que le thème de l'homme brisé repartant de zéro, fréquent chez Carver (qui l'a vécu lui-même à plusieurs reprises), se trouve magnifiquement traité dans Du bois pour l'hiver.
Tels des contes de la douce déglingue que ses personnages affrontent comme autant d'enfants perdus, les nouvelles de Carver diffusent une tendresse lancinante et jamais démonstrative, comme d'un Tchékhov américain, et, souvent puisée dans la nature, une lumière et une beauté régénératrices.
 Un Tchékhov américain
Un Tchékhov américain
Le titre de la nouvelle Intimité, tirée du beau recueil posthume Les Trois roses jaunes (Rivages poche, 1999) dont la dernière évoque la mort d’Anton Tchékhov, situe exactement le lieu où se déroulent les histoires tendres et déchirantes de Raymond Carver: au cœur du cœur de la vie des gens. Plus exactement : des gens de l’Amérique populaire ou bohème, souvent paumés ou dérivant dans l’alcoolisme, comme l’auteur. Si Carver rend si bien les bleus au cœur de ceux qui s’aiment et se griffent, c’est d’ailleurs qu’il l’a vécu lui-même avec ses deux femmes successives : Maryann la violente, mère de ses enfants dont il divorça, et la poétesse Tess Gallagher qui s’occupa très activement de son œuvre après sa mort, à 50 ans, en 1988. Loin cependant de se borner à un inferno conjugal, le monde de Carver, plein de vitalité et de poésie, se situe très loin des complications psychanalytiques d’un Woody Allen ou d’un Philip Roth. C’est que Carver, de Parlez-moi d’amour aux Vitamines du bonheur ou aux Short cuts adaptés au cinéma par Robert Altman, est plus direct, plus brut et plus lyrique surtout, même si ses « fans » ignorent souvent sa magnifique poésie tissée de ballades où le quotidien se trouve comme enluminé…
Raymond Carver, Les Trois rose jeunes. Rivages Poche, 1999.
Qu'est-ce que vous voulez voir? Traduit de l'anglais par François Lasquin. Postface de Tess Gallagher. L'Olivier, 134 pp.Le grand metteur en scène français Jacques Lassalle présente, ces jours, un spectacle en création à Vidy, intitulé Parlez moi d'amour et fondé sur deux nouvelles de Raymond Carver, Intimité et Le bout des doigts. La Passerelle, du 25 avril au 17 mai.
Infos: http://www.vidy.ch -
Pensées de l’aube (72)

Du tout positif. – Chaque retour du jour lui pèse, puis il se remonte la pendule en pensant à tous ceux qui en chient vraiment dans le monde, sans oublier tout à fait ses rhumatismes articulaires et la sourde douleur au moignon de sa jambe gauche amputée en 1977, après quoi les gueules sinistres des voyageurs de la ligne 5 l’incitent à chantonner en sourdine zut-merde-pine-et-boxon, et c’est ainsi qu’il arrive bon pied bon œil à l’agence générale des Assurances Tous Risques où sa bonne humeur matinale fait enrager une fois de plus le fondé de pouvoir Sauerkraut…
De l’aléatoire. – Il me disait comme ça, dans nos conversations essentielles de catéchumènes de quinze ans découvrant par ailleurs le cha-cha-cha, que le hasard n’existe pas et que la mort même n’est qu’une question de représentation culturelle, c’était un futur nouveau philosophe brillantissime qui fit carrière à la télévision, et comme j’étais un ancien amant de sa dernière femme, qu’il aima passionnément, je fus touché d’apprendre, aux funérailles de Léa, que c’était fortuitement qu’il l’avait rencontrée à Seattle et que son décès accidentel remettait tout en question pour lui…
De la déception. – Certains, dont vous êtes, semblent avoir la vocation de tomber de haut, naïfs et candides imbéciles, mais de cela vous pouvez tirer une force douce en apparence et plus résolue qu’est irrésolue la question du mensonge et de la duplicité de ces prétendus amis-pour-la-vie, qui vous disent infidèles faute de pouvoir vous associer aux trahisons de l’amitié…
Image : Philip Seelen -
Ceux qui dénigrent

Celui qui ne supporte pas de voir les nouveaux joueurs de bugle de l’Harmonie Patriote exécuter mieux que lui le fameux hymne Dieu nous chérit plus que nos ennemis / Celle qui se rebiffe quand on complimente les poèmes de sa cousine Aurélie Cresson dans le journal de la paroisse / Ceux qui épient les faits et gestes du fondé de pouvoir Bicandier pour en faire rapport au patron de l’Agence Longue Vie / Celui qui crache sur tout ce qu’il lit qu’il n’a pas écrit de sa main valide / Celle qui cesse d’applaudir dès qu’elle sent qu’un véritable enthousiasme soulève le public de la salle polyvalente dont on lui a retiré la gestion de la caisse pour question d’âge / Ceux qui font courir le bruit que le ténor du Chœur de la société de curling serait de l’autre bord / Celui qui se venge des humiliations que lui fait subir la cheffe de rang en glissant des boulettes de mie de pain dans son casier perso / Celle qui émet des doutes sur la fiabilité de la croyance en Jésus-Christ-Notre-Seigneur du nouveau pasteur rwandais Balouba dont elle se demande d’ailleurs ce qu’il faisait pendant les massacres / Ceux qui insinuent que l’apiculteur Dutilleul désormais connu dans tout le canton pour sa parfaite anatomie de Mister Jura ne va pas pouvoir s’occuper plus longtemps de ses abeilles avec toutes ses séances de pose publicitaire et d’essayage de costumes onéreux dont on a parlé dans les journaux gratuits et même à la Télé / Celui qui fait courir le bruit que le succès de librairie de son ancien camarade de lycée Marc Levy n’est imputable qu’au réseau de la juiverie internationale et peut-être même homo quand on sait ce qu'on sait/ Celle qui persifle les tenues fantaisie de Madame Lévy alias Dombasle / Ceux qui constatent avec une sourde satisfaction que l’état du poète sidéen Django Lourie s’aggrave depuis quelque temps / Celui qui crache sur tout ce qui fait de l’ombre à son Institut de Thérapie par le Détachement Serein / Celle qui décrie tous ceux qui l’ont fait jouir dans le local des archives du journal Le Semeur / Ceux qui dénigrent tout ce qui n’est pas l’émanation exclusive de leur inventivité en matière de marketing funéraire, etc.
Image : Philip Seelen
-
Et Vian passe pas l'éponge

EXPO Première suisse à Palexpo pour Le vrai Boris, rassemblant 700 documents avec la bénédiction d’Ursula Vian…
Il y aura 50 ans pile, le 23 juin prochain, que Boris Vian (1920-1959) s’effondrait en assistant, dans un cinéma du Quartier latin, à l’adaptation cinématographique de son roman noir J’irai cracher sur vos tombes, succombant à un œdème pulmonaire. A 39 ans, le Transcendant Satrape du Collège de pataphysique était moins connu comme écrivain qu’en tant que figure de la bohème de Saint-Germain-des-Prés, homme-orchestre aux multiple casquettes d’ingénieur et de critique de jazz inspiré, de romancier et de poète, de scénariste-traducteur et d’auteur-interprète d’inoubliables chansons revisitées par Serge Reggiani, du Déserteur à J’suis snob.
Cinquante ans après sa mort, Boris Vian pourrait faire (ce n’est pas encore sûr) son entrée à la prestigieuse Pléiade après l’édition de ses Oeuvres complètes en 14 forts volumes. L’écume des jours, son roman le plus connu, figure dans les programmes scolaires. Sa fantaisie persifleuse et sa façon zizanique de jouer avec le langage au dam des académismes n’exclut pas une vraie poésie sur fond de révolte, qui se retrouve dans L’Automne à Pékin ou de L’Arrache-cœur, l’un de ses plus beaux livres. Pasticheur en diable, pour le double régal des profs et des têtes blondes, inventeur de néologismes à foison, très sensible aussi à l’injustice et au mal inhérent à la vie (le fatal nénuphar de L’Ecume des jours), Boris Vian se défendait autant des pouvoirs établis que de tout embrigadement politique « au pas camarade », réservant ses piques les plus acérées au bon Dieu des méchants. Entre comique grinçant (L’Equarissage pour tous), érotisme provocateur (J’irai cracher sur vos tombes fit scandale en 1946) pacifisme anarchisant (La Java des bombes atomiques) et scepticisme voltairien, cet écrivain cristallisant l’esprit d’une époque, qui se prolonge dans le désarroi contemporain, conserve sa fraîcheur au même titre que son ami Queneau.
A preuve : sa vitalité posthume avérée en crescendo par le livre et le disque, la scène, la radio, la télévision, et par l’impact de l’écrivain sur les jeunes générations, bien après Mai 68. Garante du titre de l’exposition à voir à Palexpo, Le vrai Boris, Ursula Vian Kübler (sa deuxième épouse) ne fera pas le déplacement à Palexpo pour cause de grand âge. En revanche, c’est en compagnie de Michel Piccoli, Jean-Claude Darnal, Arthur H, le pataphysicien vaudois Freddy Buache, l’écrivain-chansonnier Jean-Pierre Moulin, la biographe Valère-Marie Marchand (dont paraît Boris Vian le sourire créateur en coédition Ecriture-Neige avec le CD inclus Vian chante Vian), les vestales de la Fondation Vian (Nicole Bertolt et Christelle Gonzalo) et l’éditeur Michel Sandoz, notamment, que se dérouleront moult débats et autre hommages en mémoire du cher Équarisseur de première classe…
Genève. Palexpo. Salon international du Livre et de la presse, du 22 au 26 avril 2009.
-
Pensées de l’aube (71)
De l’opprobre. – La nuit vous a porté conseil : vous ne répondrez pas ce matin à la haine par la haine, car la haine que vous suscitez, mon frère, n’est que l’effet du scandale : la lumière est par nature un scandale, l’amour est un scandale, tout ce qui aspire à combattre le scandale du monde est un scandale pour ceux qui vivent du scandale du monde.
De la foi. – Ils vous disent comme ça, avec l’air d’en savoir tellement plus long que le long récit de votre vie dans la vie, que l’unique vrai dieu qu’ils appellent Dieu a créé le monde en 7777 avant notre ère, un 7 juillet à 7 heures du matin et que c’est pourquoi, sœurs et frères, le Seigneur leur commande d’éliminer tous ceux qui ne croivent pas comme eux ou qui croillent n’importe quoi…
De l’exclusive. – Non merci, je ne veux pas de ton Paradis, ni de votre Enfer méchant, ma vie n’est qu’un Purgatoire mais j’y suis bien avec ceux que j’aime bien, l’Enfer j’ai compris : ce n’est rien, c’est juste un jacuzzi, et le Paradis je ne sais pas, vraiment je ne sais pas si ça vaut la peine d’en parler si ce n’est pas ce qu’on vit quand on aime bien et qu’on est bien aimé…
Image : aquarelle JLK -
Le temps de la vraie lecture
 Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !
Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !
Le sentiment dominant de l’époque est à l’égarement et au désarroi sous l’effet de ce qu’Amin Maalouf appelle Le dérèglement du monde dans son bel essai où il se demande avec lucidité «si notre espèce n’a pas atteint, en quelque sorte, son seuil d’incompétence morale, si elle va encore de l’avant, si elle ne vient pas d’entamer un mouvement de régression qui menace de remettre en cause ce que tant de générations successives s’étaient employées à bâtir».
 Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.
Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.
 Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.
Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.
 Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)
Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)La nouvelle livraison du Passe-Muraille, No77, d'avril 2009, vient de paraître. Commandes: Passemuraille.admin@gmail.com
Le Passe-Muraille est présent Salon du Livre et de la presse de Genève, à Palexpo, du 22 au 26 avril. Rue Kafka, tout au fond de la halle où PERSONNE ne va...
Retrouvez Jalel El Gharbi sur son site: http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com/
-
Les mains pleines d'orage

par Alain Gerber
Elles vous brûlent les doigts
les années couvées dans les nids de mitrailleuses
c‘est un argent facile
que la monnaie de ce temps-là
Les belles années de l’ambition
fauchées au pied des sémaphores
la sueur et l’encre
la brume de craie
l’œil vert de la radio
le chagrin des fées
la peur léthargique du hanneton
dans sa boîte
la perplexité du doryphore
l’écho des voix sous les préaux
un ancien dimanche
en automne
jonché de marrons cirés
dans la buée des candélabres
le goût des robinets
de cuivre
les soirs qui jouent avec les allumettes
Ce sourire gourmé
le sourire du chat
sur le visage d’un cadavre ironique
allongé sous la glace
de l’étang des Forges
où l’on se confie
un pied après l’autre
au balancier de ses bras
un après-midi de Noël
prodigue en illusions concrètes
Les sentiers de mâchefer
la brume brune
le campement dissolu des cabanes à outils
leurs ailes de goudron battant leurs flancs
vermineux
à flanc de colline
les verres épais avec leurs yeux de verre
à ras bord la crasse du temps qui passe
payé rubis sur l’ongle dans les fabriques
la gloriette de guingois
au toit de zinc dépoli
on y respire encore les clafoutis
du temps des cerises
aucunement prophétique
Rester là
ne rien savoir d’aucun avenir pour personne sur la Terre
on voit si bien les montagnes
on pourrait les toucher du doigt
un vol de martinets
l’écho du silence
l’ombre sur le mur quand les gens sont partis
Les troupeaux frileux
les bœufs éberlués
entre les grilles des préfectures
ripant sur le pavé
grimpés sur le trottoir au grand scandale des assassins
armés d’un bâton
buveurs de café bouillu
l’odeur du sang des bêtes
à l’emplacement de futurs cinémas
derrière le brouillard et le pâle
du faubourg des argentés
sur le chemin des Perches
que le vent repousse au fond de ses ornières
un vent de fer et de dimanche raté
loin des désirs absolus
La rue des jeudis héroïques
de sabres et d’arbalètes
traversée par un mur
que couronnent
des tessons d’existence
le haut des plus hautes tombes
les chapeaux noirs des affligés
les plumets noirs des chevaux de corbillard
arborant le monogramme d’un défunt présomptueux
à qui en pénitence
on n’a même pas laissé son alliance et sa montre
sa tabatière son culbutot
et par-dessus la voix du bronze
absente
monocorde
qui ne connaît pas un mort d’un autre
ni celui qu’on regrette
ni celui qui voulut qu’on épinglât
sa médaille sur un coussin violet
(…)
Rue de Châteaudun
dans le jus de lanterne
sourde
où piétine le gros chien boréal
qui garde les saucisses
ébouriffé de fourrure orange
on charrie un fardeau sans poids de grammaires
de sapience
de plumier d’astrolabe
avec un chiffon doux aussi
sans doute quelques bons points
et un cahier couvert de papier bleu
étiqueté à l’anglaise dans un coin
on traverse les fumées charcutières
l’haleine des soupiraux
rosée de toutes les défaites
l’odeur grenue de la pluie de la veille
la poudre des petits matins
crissante comme du sel et
la queue d’un nuage
qui n’a pas fait sa nuit
et couche sur le trottoir
la tête reposant dans les bois de l’Arsot
(…)
Mon père enfile son casque
garnit de vieux journaux
sa veste de cuir
range dans sa serviette
ses crayons sa gomme son stylo
son décamètre
et les plans énigmatiques
de la Reconstruction nationale
sur du papier violet
il réveille avec précaution
sa motocyclette
il fonce vers Champagney Ronchamp Lepuis-Gy
naviguant sur le verglas
dans la purée d’aurore
(…) et parfois il achète un buffet ancien
délogeant une basse-cour
ou un tas de charbon
j’y songeais à ses funérailles
nous étions trois ou quatre
sous les branches nues
sous le ciel déserté
à quelques pas seulement de ses fenêtres
- et donc
tout ce temps
toutes ces années du cristal de l’or vieux et des cendres
tout ce long temps sans prix
tout ce temps compté
il avait pu
contempler à loisir
le décor de son trou…
(…) il n’est de lettres que d’exil
et confiées aux bouteilles
on écrit sur le mur de l’usine
les choses qu’on a perdues
on use son crayon
son rare son tout petit
dressé dans les décombres
la grosse affaire des vagabonds
et c’est toujours
merde à celui qui le lira
car personne ne lit plus
justement
les jours passent
plus ou moins
dans la cohue du portillon
l’air du temps
change de propriétaire mais
la vente continue durant les travaux
la braderie aux prix sacrifiés
où tout doit disparaître
et le reste est détruit
un beau matin
les temps avaient changé
si elles avaient pu se voir nos vies nos villes
ne se seraient pas reconnues
depuis des mois et des semaines
je ne dormais plus tranquille
pourtant je n’ai rien suspecté
l’enfrance s’est lassée de nos mauvais traitements
elle a déménagé à la cloche de bois
en oubliant de m’emporter
Bournazel n’est plus là pour personne
j’ai rangé
toute ma famille sous les arbres
des promesses de l’ancien régime
rien ne s’est accompli
sinon ce qu’on a pu
bricoler soi-même
c’est-à-dire un amour et aussi
une gaieté passagère
qui fut sainte et féroce
il y a bien longtemps
pieds nus sur les tommettes de titane
à tâtons je fais mon sac dans la cuisine obscure
des gamelles melles-melles
des bidons dons-dons
on est lundi matin d’une autre galaxie
la semaine sera longue
vivement dimanche !
des gamelles des gamelles des bidons
Envoi
Les graveurs de vent
les graves célibataires de leur propre créance
au lexique équivoque
aux gestes somnambules
aux maigres fournitures
aux barques trop fragiles
précaires gardiens des écuelles
se marient une année
sont quand même pendus l’autre
aux espagnolettes
de l’hôtel Algonquin
ayant renié leurs fraîches phrases d’avril
lovées dans les violoncelles
disposées en travers
des tickets de rationnement
leurs cous s’allongent pour voir
par-dessus la rampe
le côté du mur
qui n’en eut jamais aucun
mars 2008
(Ces séquences sont extraites d'un vaste poème intitulé Enfrance, encore inédit. Elles constituent l'ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille, d'avril 2009, No77, qui vient de paraître, incluant un entretien avec Alain Gerber et un aperçu de son oeuvre romanesque.)
-
Pensées de l'aube (70)
 De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…
De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…
De la folie ordinaire. – Ils te disent qu’ils n’ont pas le temps, et toi tu te dis que c’est cela la barbarie, ou bien ils te disent qu’il faut bien tuer le temps, et tu te dis que c’est cela aussi la barbarie, et quand tu leur demandes quel sens à tout ça pour eux, ils te répondent qu’ils n’ont pas que ça à faire, se poser des questions, et si tu leur dis de prendre leur temps alors là c’est colère, ça les rend fous, ou plutôt c’est toi qu’ils regardent comme un fou – s’ils pouvaient te faire enfermer, oui ça aussi c’est le début de la barbarie…
De la modestie. – Certains jours sont plus discrets, qui se pointent avec l’air de s’excuser - pardon de n’être que ce jour gris, ont-ils l’air de vous dire, mais vous les accueillez d’autant plus tendrement que vous avez reconnu vos vieux parents tout humbles devant le monde bruyant, et d’ailleurs les revoici dans le gris bleuté de ce matin, comme s’ils étaient vivants…Peinture: Thierry Vernet.
-
Le roman qui refait le monde ailleurs
 ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER
ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBERAlain Gerber est un écrivain fluvial. À poser quelques questions à un romancier fluvial, on s’expose à recevoir de fluviales réponses, dont voici le partiel delta…
- Vers quel ailleurs votre écriture est-elle repartie ce matin ?
— Il n’y a plus de pays qui m’attire. Ils se sont banalisés et standardisés en même temps que leurs trop désinvoltes visiteurs. Quand je partais voir ailleurs, j’avais besoin de ne plus me sentir chez moi : maintenant, je m’y sens chez les autres. Pas ceux qui habitent là : ceux qui descendent en rangs serrés des avions et des autobus. En conséquence, la réalité à laquelle il m’importe de croire encore, les climats, les lumières, un certain style de relations entre les personnes, je ne la trouve que dans des œuvres — des livres, des films, des tableaux, et comme je ne suis pas d’un naturel assez contemplatif pour me contenter de les admirer, je mets la main à la pâte. Ca me permet d’imaginer que je suis réel, moi aussi, à un moment de mon existence où, dirais-je,… tout ne porte pas à le croire !
- Comment, en vous retournant, voyez-vous votre œuvre ?
— Pas comme un ensemble structuré : plutôt une série de tentatives abandonnées un jour par lassitude ou, plus exactement, parce que je me sentais appelé ailleurs. J’insiste sur ce mot, ailleurs, parce que chacune de mes « périodes » fut un territoire, avec son passé, ses coutumes, sa culture, sa langue, ses codes sociaux, son climat, voire ses spécialités culinaires lorsqu’il s’agissait de l’espace vaguement balkanique où j’ai logé mes Citadelles de sable. Tel ou tel de mes territoires peut coïncider avec une zone géographique bien délimitée (les Etats-Unis, en particulier), mais les deux ne sont jamais superposables. Je m’attache à ce qu’ils ne puissent pas l’être. Je ne suis toujours considéré comme un cinéaste de la plume : un cinéaste américain des années 50. Un de ces types à qui les producteurs confiaient un jour un western, l’année suivante un péplum ou un film intimiste...
- Un fil rouge relie-t-il vos livres ?
- S’il y a une unité à ce patchwork, elle ne réside pas dans l’écriture, mais dans le principe qui préside à celle-ci. Elle n’est pas dans la thématique proprement dite mais dans le retour obsessionnel de thèmes que je ne peux pas ne pas traiter, jusque dans ma poésie: la fuite du temps, l’inévitable métamorphose des choses que nous aurions voulues éternelles, l’échec ou, très spécifiquement, les relations avec les pères (de 1975 à 1999), puis avec les mères (à partir de 2000). Je suis le type qui revient sans cesse sur quelques images fondatrices, plongées dans une lumière très précise, environnées d’odeurs qui ne ressemblent pas à d’autres et qui, autour de ces scènes primitives (la seule chose qui lui importe, pour être franc), tente par politesse envers son lecteur de construire une intrigue de roman.
- D’où vient La couleur orange, votre premier livre ?
— C’était un bilan des années mortes — déjà ! Je l’ai écrit pour me dire, dans une période matériellement difficile : « Elles n’ont pas été tenues, mais voilà toutes les promesses que la vie t’avait faites. » J’ai raconté, avec des scrupules rabbiniques, trois mois de ma vie dont il m’avait semblé qu’ils étaient le début de quelque chose et qui, dix ans après, n’avaient débouché sur rien d’autre qu’une inconsolable nostalgie.
Pour le reste, l’ouvrage reflète deux fascinations littéraires assez incompatibles : le roman naturaliste-behavioriste américain (Hemingway, Chandler, etc.) et la recherche formaliste, qu’elle soit du Nouveau Roman ou d’ailleurs. Trois fées se sont penchées sur ce berceau : le Hemingway de Paris est une fête, le Perec de Les Choses et le Butor de Passage de Milan. J’étais aussi fasciné à l’époque (et le suis toujours), par les grandes littératures mystico-lyriques de l’Amérique : celle du Sud avec Faulkner, de la Nouvelle-Angleterre avec Melville et Hawthorne — sans parler bien sûr du new-yorkais Thomas Wolfe dans lequel je me suis plongé au début des années 70 avec la sensation de retrouver le liquide amniotique.
—Comment avez-vous vécu l’expansion de vos territoires romanesques ?
—Comme un type lancé dans la recherche éperdue d’une terre promise où ses graines germeraient, où il récolterait enfin le genre de beaux fruits qu’il voyait pendre aux arbres des autres. La question de l’exil s’est posée après Le Plaisir des sens. Je me garderai bien de dire si ce texte est ou non réussi. Ce que je sais, c’est qu’il fut le premier (et le seul) où l’écriture m’a offert bien davantage que ce que j’avais espéré d’elle. Il y avait un livre dont je n’étais pas du tout capable, ni techniquement ni sur aucun autre plan, et cependant, je l’ai écrit. Même si ce n’était que moi qui me le décernais, c’était comme de recevoir son bâton de maréchal sur le théâtre des opérations. À part le succès (pas immodéré en l’occurrence), il ne me restait – en ce qui me concernait — rien de mieux à attendre de la littérature. Je ne pouvais que répéter Le Plaisir à l’infini, ou bien creuser un autre sillon, sachant que la grâce ne me tomberait pas dessus une deuxième fois. Ce fut le seul moment de ma carrière où, pendant deux ans, je suis resté incapable d’écrire. Je ne m’en suis sorti qu’en décidant d’accomplir ce qui, au départ, n’était pour moi qu’une parodie, et pas du tout le projet humaniste que d’aucuns ont célébré : ce Faubourg des Coups-de-trique qui était pour moi, contrairement à ce que nombre de ses lecteurs ont cru, une façon de déréaliser Belfort et d’en faire un espace strictement littéraire, une attitude à la Fellini, en quelque sorte, le Fellini d’avant La Dolce vita qui m’a toujours beaucoup inspiré.
—Qu’est-ce pour vous qu’un roman ?
—A-t-on encore le droit d’écrire des romans : j’aimerais avoir l’assurance d’en avoir déjà écrit un, après une quarantaine d’années d’écritoire ! Faute de m’être posé la question, un roman, je ne sais pas ce que c’est. Mais je sais que, pour moi, c’est la vie elle-même — je veux dire une vie avec quoi « la vraie vie » a les plus grandes peines à rivaliser. Je crois qu’un bon roman refait le monde, mieux peut-être et en tout cas de manière plus tangible que beaucoup de philosophies. L’imitation du réel, certes, n’a pas grand intérêt, mais ce que propose la littérature, avec une arrogance qui me réjouit, c’est tout le contraire: c’est que le réel devienne le toc et la contrefaçon du romanesque.
—Faites-vous une distinction entre vos romans-romans et vos romans du jazz ?
— Il y en a au moins une qui est énorme : les romans-romans, j’attends qu’ils veuillent bien frapper à ma porte ; les autres, je vais les chercher manu militari. Avec eux, je ne m’embarque pas sans biscuits. Le travail romanesque consiste essentiellement à aller chercher la vérité des personnages. En revanche, je touche peu à la matérialité des faits. Quand j’introduis des scènes et des dialogues de fiction, c’est toujours parce que les scènes et les dialogues de la réalité sont trompeurs ou équivoques. J’ai au départ, très précisément, quelque chose à dire, ce qui est très rarement le cas lorsque j’aborde mes autres livres. Là, en règle générale, je ne pars ni d’un personnage, ni d’une ébauche d’histoire, mais d’une sensation forte, d’une émotion tenace liée à une image très particulière (mon magasin d’images : essentiellement la télévision – où je consomme énormément de films). Je finis toujours par oublier ces visions fondatrices, mais je crois pouvoir dire que presque tous mes livres sont nés d’une photographie transformée en hologramme, de manière que je puisse tourner autour, accompagnée de conditions climatiques extrêmement précises et, surtout, d’une odeur qui ne ressemble exactement à aucune autre. Je peux passer des mois sans être visité par une de ces images au spectacle desquelles j’ai soudain envie de planter ma tente. Mais envie n’est pas le mot… C’est plutôt que j’ai l’impression que, dans ce lieu-là, je parviendrai à me sédentariser assez longtemps pour parvenir jusqu’au terme du livre (lequel, deux fois sur trois, m’est révélé à ce moment-là, c’est-à-dire avant que j’aie rédigé la première phrase). Pour le reste, je vais à l’aventure : je pose un décor, puis un premier personnage dans le décor et j’attends de voir ce qui va se passer. Tout dernièrement, le décor s’est révélé bosniaque, grâce à un documentaire diffusé à la télévision. J’ai décrit ce décor (au début de Si le roi savait ça). En quelques phrases, j’ai dépeint l’atmosphère qui s’en dégageait plus exactement. Tout le reste est venu de là, et d’une vague idée que j’avais d’introduire un charnier dans l’intrigue. Ma « documentation » s’est limitée à la consultation du Petit Robert des noms propres, à l’article Bosnie.
— Comment êtes-vous retombé en Enfrance, si j’ose dire ?
— On m’a poussé ! Le grand saxophoniste Jean-Louis Chautemps, un ami de longue date, et un poète au quotidien, un poète de fait, qui n’a même pas besoin d’écrire, m’a lancé ce défi, en forme de boutade, il y a déjà trois ou quatre ans. Je n’en ai tenu aucun compte, ne me sentant pas plus apte à la poésie qu’à la pratique du jazz. Et puis, en avril de l’an dernier, je ne sais trop pourquoi, au cours d’une insomnie me sont venus les deux premiers vers d’Enfrance. Je les ai notés sur un bout de papier. Le lendemain, j’ai creusé ce sillon et, à mon grand étonnement, j’ai vu que le sol se fendait sous l’étrave. Pendant trois mois, je n’ai plus écrit que de la poésie, presque à marche forcée. C’aura été l’une des expériences les plus exaltantes de toute ma vie. Cette péripétie était assez inattendue : à part celle de Jacques Réda, qui me touche profondément, je n’avais pour ainsi dire plus lu de poésie depuis le lycée. Je commence seulement à me rattraper un peu : je me découvre quelques affinités avec le Transsibérien de Cendrars, ou Zone d’Apollinaire, singulièrement. Je constate en revanche que les poètes qui me fascinent le plus (Breton, par exemple, ou le Rimbaud des Illuminations) évoluent dans un cercle qui me restera fermé à jamais. Ces auteurs sont initiés à un mystère dont je n’aperçois même pas les contours.
—Et la lecture là-dedans ?
—J’ai dévoré des livres depuis l’âge de cinq ans, en commençant par Fenimore Cooper, Jack London, Dumas et L’Ile au trésor. Vers 1985, j’ai renoncé à ce bonheur-là. J’aimais à la fois trop d’auteurs trop différents les uns des autres, après avoir découvert, entre autres les Latino-américains, les Asiatiques, les Français de l’entre-deux-guerres (Fargue, Morand, Larbaud : j’avais longtemps voulu les ignorer, alors qu’ils écrivaient spécialement pour moi !). J’avais tendance à vouloir les intégrer tous ensemble à ma propre écriture. J’étais menacé, non seulement d’écartèlement, mais de perdre mon diapason personnel. J’ai pris en catastrophe la seule mesure qui s’imposait, ne lisant plus dès lors que les livres d’amis. L’été dernier, condamné à la retraite à mon corps défendant, je m’y suis remis. J’ai lu ou relu des auteurs dont les œuvres sont inscrites au catalogue de la Pléiade : Stevenson, Melville, Simenon, Ramuz, Rimbaud. Je crois que je peux maintenant avancer le doigt sans me faire happer par la machine. Mais certains romans de Simenon n’ont pas été loin de me décourager d’écrire, comme jadis Au Cœur des ténèbres…
— Votre avant-dernier roman fait retour au Belfort de vos débuts…
— Je me demandais, n’ayant plus à écrire pour la radio, si je devais m’accrocher encore à la musique, devenue mon terreau le plus fertile depuis la fin du siècle dernier, et, accessoirement, si j’étais encore capable de parler d’autre chose que de la création et des créateurs. J’avais peur que non, aussi ai-je voulu mettre toutes les chances de mon côté pour tenter cette escapade. Les noms des rues belfortaines ont le pouvoir de me mettre en confiance. Là, je n’ai même pas besoin d’image originelle : il me suffit de ces sonorités. Ce sont en quelque sorte mes sésames intimes.
— L’envoi sera-t-il pour Marie Joséphine ?
— « Pour qui écrivez-vous ? » Le savoir est un rare privilège. Une façon de se forger un style homogène est de s’adresser à un auditoire spécifique (grâce à mon émission de radio Le jazz est un roman, j’ai eu dix ans ce privilège). Je crois cependant que la vraie question est « À qui écrivez-vous ? » Ecrivant à la personne que je connais et qui me connaît le mieux au monde, je sais d’emblée quoi ne pas dire, ce qui est l’essentiel du métier d’écrivain. Je sens quand je triche ; je me surprends quand je me regarde écrire et j’ai honte de moi… Sans elle, ou bien je parlerais tout seul, ou bien j’enverrais des bouteilles à la mer. On s’en lasse vite… Quand on mène ce genre d’entreprise, bien sûr on n’échappe pas à la solitude. Il est capital que quelqu’un vous attende à la sortie du désert. Que quelqu’un vienne vous chercher, comme à l’école, vous tire de là et entretienne autour de vous, ne serait que par sa façon d’être, le climat grâce auquel vous trouverez le courage de retourner casser les cailloux le lendemain. Je dois bien plus à Marie Joséphine qu’elle-même ne l’imagine, plus sans doute que je n’en ai moi-même conscience et bien plus en tout cas qu’une série de dédicaces ne peut le laisser entendre…
Cet entretien avec JLK a paru dans Le Passe-Muraille, No77.
-
Katyn, de Czapski à Wajda
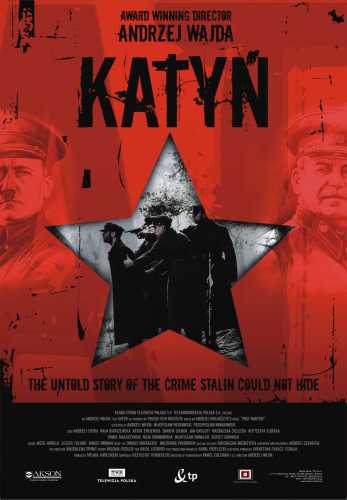 A propos de L’Art et la vie
A propos de L’Art et la vie
Et sur le film Katyn d'Andrzej Wajda, vu par Philip Seelen.
Il y a seize ans que Joseph Czapski s’est éteint à Paris à l’âge de 97 ans, au terme d’une vie étroitement mêlée aux tragédies du XXe siècle, et notamment au massacre de Katyn dont il fut l’un des rares rescapés et des grands témoins (son livre Terre inhumaine fut l'un des premiers ouvrages documentant le Goulag), finalement justifiés. Sous les dehors de cette figure “historique”, qui resta une conscience de la Pologne tout au long de son exil parisien (tant par ses articles dans la revue Kultura que par ses liens personnels avec les meilleurs esprits, de Gabriel Marcel à Czeslaw Milosz), Czapski apparaissait, au naturel, comme le plus simple et le plus libre des hommes, et son oeuvre de peintre témoigne le mieux de son aspiration constante à traduire ses émotions devant la beauté mêlée de douleur qui émane des êtres et des choses en ce bas monde.
Aussi sensible aux lumières du paradis perdu qu’à la tragédie de tous les jours, l’artiste vivait à la fois l’effusion de Bonnard et la tension de Soutine, qu’il rapproche d’ailleurs au sommet de ses admirations dans l’un des magnifiques articles réunis ici sous un titre qui dit bien l’enracinement de son oeuvre et de sa réflexion “dans la vie”. Bien plus qu’un livre “sur” la peinture ou “sur” les peintres, L’Art et la vie nous immerge aussitôt “dans” ce bonheur irradiant que la peinture nous vaut de loin en loin, dont Czapski ressaisit les tenants et les secrets avec une merveilleuse pénétration. Qu’il rende hommage à Nicolas de Staël, revienne sur l’héritage de Cézanne, s’oppose au despotisme ravageur de Picasso (avec d’éventuels repentirs), se rappelle une rencontre avec Anna Akhmatova, détaille l’art de son cher Proust, rende un hommage inattendu à Dufy ou célèbre l’“âme” de Corot, parle travail ou “paresse féconde”, Joseph Czapski nous sollicite avec passion et nous est, autant que dans sa peinture, plus présent que jamais.
Joseph Czapski. L’Art et la vie. Textes choisis et préfacés par Wojciech Karpinski. Traduit du polonais par Thérèse Douchy, Julia Jurys et Lieba Hauben. L’Age d’Homme, 244p.
A lire absolument: la lettre magnifique que notre ami Philip Seelen a envoyée à Bertrand Redonnet près avoir vu Katyn, le dernier film du grand réalisateur polonais Andrzej Wajda: http://lexildesmots.hautetfort.com/ -
Des petits rien inestimables

Le roman d’Anne Brécart, Le monde d’Archibald, écarte des rideaux de vieille soie et montre, au beau milieu de notre rapide et bruyant quotidien, une barque et une pêcheuse de souvenirs, là-bas, au loin.
Derrière nous, le plus souvent à notre insu, des bâtiments, des objets, des tableaux, des marches de pierre grimpant on ne sait vers quel terrain d’envol, continuent à exister dans ce que nous croyions définitvement éteint. Mais pour peu que les morts de ce monde-là se mettent à exiger un rien d’attention et d’amour de la part de leurs descendants – par exemple en leur soufflant à l’esprit d’étranges inquiétudes – voilà que tout ce qui semblait à jamais achevé se réveille et s’empare d’une mémoire. C’est ainsi que la narratrice de ce roman, une narratrice adulte, retrouve les êtres, les lieux et les objets qui ont marqué les étés de son enfance et de son adolescence.
C’était à la maison du lac, sous le règne enchanteur de l’oncle Archibald.
Enchanteur, parce qu’Archibald, dont la faillire commerciale est vue comme une fatalité, se consacre désormais à la survie de la belle demeure familiale et de ses terres, à l’âme de tout ce qui, poudré de vieillesse ou triomphalement refleuri chaque été, confère sens et dignité à ce lieu. Certes, Archibald confie à sa nièce, entre deux portes, que rater sa vie est le but de l’existence. « Non pas que j’ai choisi ce but, mais c’est vers l’échec que toute vie coule naturellement. (…) Accepter ce destin avec élégance est tout ce que l’on peut faire dans la vie »(…) Et, en signe de résistance, il met son chapeau, boutonne son manteau gris mastic et sort sous le soleil éclatant du mois d’août, vêtu comme si l’on était en novembre». Mais ces deux mots, élégance et résistance, métamorphosent dans les faits ce prétendu ratage en comportement héroïque. La jeune narratrice ne cesse de s’en émerveiller, de s’en effrayer parfois car bien des choses lui échappent, les non-dits, la bienséance quoi qu’il arrive, la rigueur protestante, le respect des morts et de leurs biens obligeant Archibald à des acrobaties incompréhensibles à une petite fille. Il doit vendre ses terres… mais il réussit à racheter quelques vaches et à engager un fermier (le Kosovar Idriss, futur initiateur sexuel de sa nièce), son neveu François, seize ans, meurt pendant ses vacances à la maison du lac… mais il organise peu après un pique-nique de prince dans la forêt crépusculaire et consolatrice; sa femme Olympe se meurt de tristesse et de folie… mais il continue de prendre le thé avec elle sous un petit parasol rose, dans le parfum des roses ; la parentèle le pousse à vendre, tout liquider… mais lui, Archibald, continue à dessiner les armoiries des ancêtres. Jusqu’au jour où… non, que le lecteur découvre seul la façon dont Archibald d’abord, la maison ensuite, quitteront le monde des vivants.
Par son besoin de regarder en arrière et de donner, pour ainsi dire, une musique personnelle, célébratrice, à ce qui est révolu, ce troisième roman de l’écrivain s’inscrit dans le même monde que les précédents.
Ici, l’écriture d’Anne Brécart décrit minutieusement le monde d’Archibald, objets et végétaux portant leur nom enchanteur ; mais surtout, dans le jeu des images et des souvenirs, cette écriture fait briller ce monde archibaldien dans ce qu’il a de contradictoire, de mystérieux et d’irréel. Ainsi l’imaginaire de l’enfant et de l’adolescente peuvent-ils peindre avec une candide chaleur les illusions, les pieux mensonges, tout ce théâtre de fantômes dont le reflet paraît à chaque changement de scène prêt à s’évanouir dans le silence de la maison, « doux comme un pelage d’animal », ou dans le monde nouveau du Stöckli (petite maison jouxtant la ferme, où vivent les domestiques. NDLR) qu’Idriss l’étranger utilise pour cacher des choses… des choses sans rapport avec le raffinement ambiant !
Style fluide, merveilleusement suggestif, lumineux, qui exulte dans ce « gigantesque parachute noir » que déploie (dans ce qui est pour moi la véritable fin du roman) un inquiétant cortège de morts se fondant dans la nuit.
Rose-Marie Pagnard
 Anne Brécart, Le monde d’Archibald, Zoé, 171p.
Anne Brécart, Le monde d’Archibald, Zoé, 171p.Pour mémoire : Les années de verre, et Angle mort, chez Zoé.
Cet article a paru dans la nouvelle livraison du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Commandes et abonnements : Passemuraille.admin@gmail.com
-
Notre tumulte en vrai

 À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.
À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.
Trois niveaux d’écriture
 Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…
Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…Pratiques éprouvées
Pratiquant, en alternance ou simultanément, ces trois niveaux d’écriture depuis que je me mêle de journalisme (j’’ai écrit mon premier papier à quatorze ans, dans le journal d’un mouvement de jeunesse, sur le thème du pacifisme), de critique littéraire (ma première chronique a paru en 1969 dans La Tribune de Lausanne, portant sur Les Courtisanes de Michel Bernard) et de littérature pure, je n’en mesure pas moins à l’expression ou à l’inflexion près ce qui ressortit à l’un ou à l’autre. D’aucuns, notamment dans les cercles académiques du milieu littéraire romand, m’ont reproché ce côté touche-à-tout indigne d’un Véritable Écrivain ne se consacrant qu’à Son Œuvre, n’est-ce pas ? mais ils n’ont pas idée, ces chers bonnets de nuit, de ce que ce type d’absorption peut représenter d'enrichissant aussi pour l’élaboration d’un travail littéraire.Nouveaux tumultes
Il en va de même, aujourd’hui, pour l’usage de nos blogs et autres vecteurs virtuels. C’est par ceux-ci que j’ai rencontré François Bon et une kyrielle de gens intéressants, auteurs ou lecteurs, qui m’ont plus ou moins accompagné dans une nouvelle pratique de l’écriture qui, loin d’exclure l’expérience accumulée, la revivifie parfois de manière stupéfiante, dont le meilleur exemple à ce jour est Tumulte de François Bon, précisément.
Dix ans avant Tumulte, j’ai composé un roman que j’ai longtemps intitulé Roman virtuel, ensuite devenu Le viol de l’ange, alors que j’ignorais tout des virtualités réelles de la Toile. Mais depuis ma quatorzième année, lorsque des barres d’habitation sont sorties de terre dans l’immédiate proximité du quartier de notre enfance au bord des champs et des bois, le choc provoqué par la vision, la nuit, de ces milliers de fenêtres scintillant d'autant de vies, m’a fait basculer dans cet univers tumultueux d’une nouvelle perception simultanéiste de l’espace/temps : tout à coup la ville était là, le Grand Labyrinthe dont la Toile est un autre avatar, et qui bouscule tous nos codes de réception et d’émission, si j’ose parler en machine...
Hic et nunc on the blog
Nous sommes le samedi 18 avril 2009. Je viens de prendre ces notes provoquées par une expression de François Bon, l’autre jour au téléphone, remarquant que nous nous parlions « en vrai ». J’ai rencontré François le temps d’un soir, à Lausanne, et nous nous sommes un peu observés, tous deux à la fois ouverts et un peu timides, comme des ours au coin d’un bois. De le rencontrer « en vrai » ne m’a pas révélé un autre François qu’en lisant Tumulte ou en découvrant sa dernière note sur Andrzej Stasiuk, que je venais pour ma part de découvrir et d’aimer dès les première pages de Fado. Mais c'est vrai que la vie en vrai nous importe... Voilà pour le tissage de la toile…
 Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.
Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.
E la nave va… va falloir ramasser les feuilles mortes d’après la neige… va falloir vivre « en vrai » avant de se reconnecter pour tâcher de dire mieux que tout ça procède à vrai dire du réel et du vrai… salut le Tumulte de la vie qui s’écrit…Image: Philip Seelen
-
Ceux de la photo sépia
Ils seraient tous là dans les maisons communicantes des diverses villes où ils sont venus, des villages, s’établir plus sûrement au début du siècle, attirés par les lumières et l’idée nouvelle d’une Amérique prochaine; ils se retrouveraient là comme naguère et jadis, timides ou conquérants, posant crânement ou paraissant s’excuser d’être sur la photo.
Voici l’objet : c’est la photo sépia, le grand portrait de groupe des vingt ans de la mère de notre mère : notre vénérée Grossmutter, qui occupe ici le centre du premier rang assis des onze frères et sœurs entourant le père et la mère, lesquels siègent de part et d’autre de la claire et nette jeune femme au beau visage ovale mis en valeur par sa chevelure relevée, les mêmes yeux précis et pressants que ceux de sa mère et de la nôtre, l’air aussi résolu que ses deux frères aînés debout au dernier rang alors que le plus jeune – le futur oncle Fabelhaft de notre enfance – sourit de côté, et que Theo, l’immense jeune homme d’une sombre beauté qui se tient un peu incliné, tout à droite, semble faire peser sur tous son irrépressible désir de partance.
Le ton dominant de la photo sépia est solennel, imitant la façon des grands bourgeois à automobiles du nouveau siècle, voire des familles nobles d’une autre époque finissante, princes européens ou russes, peut-être même arabes, avec le décor de palmes et de fleurs exotiques typique de ces années suivant l’Exposition Universelle, que le photographe Emil Goetz a disposé dans son grand atelier de Berg am See, vers le pont aux Cerfs.
La photo sépia est datée 1911. Trente ans plus tôt, le père de Grossmutter, qui siège ici dignement au premier rang, la moustache fournie et torsadée, comme en paille de fer, évoquant celle du missionnaire musicien Albert Schweitzer, officiait au titre de chef de train de la première équipe qui franchit la barrière des Alpes par le tunnel du Saint-Gothard – mais l’homme a su garder cet air discret, dans sa calme dignité, que montreront tous les pères de ce temps-là en cette tribu-là : dignes et discrets. De fait, notre père et les pères de nos mère et père ne nous auront jamais montré que cet aspect digne et discret de l’honnête père de famille en ce pays-là, cravatés dès leur lever, incarnant ceux que je qualifierai toujours de Réguliers et que je respecte en tant que tels, tout en me distinguant d’eux, comme je distingue à présent deux de mes grands-oncles de la photo sépia : le plus jeune assis au premier rang, l’air enjoué, le regard vif, prénommé Leopold, dit aussi Leo ou Poldi, et que nous connaîtrons des lustres plus tard sous le surnom d’oncle Fabelhaft, et derrière lui cet oncle Theo dont la destinée de chercheur d’or nourrira la légende à multiples rebondissements.
Nous sommes en septembre 1911 et le Premier ministre russe, Pierre Stolypine, vient de se faire assassiner par l’anarchiste Bogrov dans une salle de théâtre, quelques mois près avoir posé lui aussi au milieu de sa famille, sur un cuirassé de la marine impériale, ainsi que l’illustre une coupure de journal retrouvée dans les papiers de Grossvater. Or je crois savoir que notre bisaïeul de Berg am See attendait quelque chose de ce Stolypine. Je ne sais trop comment cela m’est parvenu, mais je me rappelle une de ses observations, rapportée par Grossvater à propos de la Russie, selon lequel seul un type capable du genre de Piotr Arkadiévitch Stolypine aurait pu infléchir les événements de sorte à empêcher la calamiteuse Révolution russe, selon l’expression de Grossvater - tout cela qui me revient inopinément en me penchant sur la photo sépia pour mieux voir mon bisaïeul, si digne et discret et songeant peut-être précisément, à l’instant, au sort des grands ce monde incessamment exposés à la menace de l’anarchie.
Or rien n’est plus vraisemblable, à y réfléchir, que ce fait que le beau-père de Grossvater ait eu son idée à propos du sort de la Russie tsariste en voie de se réformer sous l’impulsion de Stolypine. S’il a vraiment dit, une fois, que Stolypine était un type capable, ce ne peut être sans avoir lui-même réfléchi à la question. Car Grossvater, qui connaissait la Russie pour y avoir travaillé, n’aurait pas rapporté la chose si le jugement de son beau-père, qu’il respectait, n’avait pas été tant soit peu fondé et réfléchi. Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, selon l’expression, j’en arrive à imaginer maintenant que, la photo prise, le chef de famille se lève et se tourne vers son grand fils au regard farouche, pour lequel il a toujours eu un faible, Theo n’ayant jamais juré que de trains en partance et de départ aux Amériques, et lui demande à brûle-pourpoint ce qu’il pense des révolutionnaires russes – cette digression imaginaire me venant du fait de la saisissante ressemblance, que je viens de constater, entre la ténébreuse aura de Theo et celle du poète révolutionnaire Vladimir Maïakovski, né la même année que lui…
C’est d’ailleurs tout un roman qu’on pourrait imaginer à l’observation des personnages de la photo sépia, dont la fixité des sujets n’est pas telle qu’elle exclue maintes nuances frémissantes, cela n’empêchant pas non plus les équivoques de l’oubli. Deux sœurs seules sourient sur la solennelle photographie, mais l’une d’entre elles d’un sourire un peu narquois qu’elle s’adresse à elle-même, elle qui se pendra plus tard sans qu’on en démêle le pourquoi, et de l’autre qu’elle identifie sous le nom de Violetta, ma chère Lena, qui m’évoque aujourd’hui ces destinées, ne se rappelle pas bien ce qu’elle est devenue – mis de toute façon, conclut-elle, c’est du passé…
Or je proteste, moi, que c’est notre passé, tout ça : je veux savoir qui est qui, je veux pouvoir dire à nos enfants d’où nous venons, au moins ça, fais un effort ! Et je vais pour gronder un peu Lena, qui aime d’ailleurs ça, qu’on la gourmande - je vois aussi bien que ça la touche que je la pousse à se rappeler son passé à elle, cependant nous restons tous deux un peu embarrassés : comment en effet les faire parler, ceux de la photo sépia, à l’instant de dévisager, même attentivement ces supposés proches dont elle-même ne se rappelle plus bien, et de moins en moins, ce que chacun d’entre eux est devenu au juste…
Mais quel air imposant, pour ainsi dire d’un autre temps, ont donc ceux-là, me dis-je ensuite en scrutant les deux fils les plus âgés - Albrecht le plus sévère, en son amplitude physique de marchand de primeurs en gros, et Conrad, tout massif lui aussi mais au visage plus ovale et spirituel d’ingénieur - que la mine plus enjouée de notre grand-tante Violetta, moins de vingt ans sur la photo sépia et gracieusement assise au premier rang, dans sa robe de tournure Art Nouveau, pondère et radoucit heureusement. Et cette autre qu’elle, debout à côté de l’imposant Albrecht, n’est pas moins jolie elle aussi, mais c’est elle qui se pendra à la stupéfaction des siens, m’a rappelé Lena ; et celle-là qui semble égarée, comment se prénommait-elle encore, et cette autre qui semble comme prise en faute, et cette autre encore qui détourne carrément le regard ? Mystère : Lena donne sa langue au chat.
Cependant la voix de l’Oncle Fabelhaft me revient - sa voix haut perchée nous saluant, les enfants, du fond de son inénarrable arrière-boutique de marchand d’orviétan brocanteur aux allures de cabinet de curiosités dont chaque objet singulier, peau de serpent ou tête réduite de Jivaro, fera l’objet d’une nouvelle histoire.
Or je n’en reviens pas ce matin, et pour la première fois peut-être, tant d’années après l’avoir écouté bouche bée des heures durant, de voir là, sur la photo, quel garçon a été l’affabulateur mirifique autour de ses vingt ans, siégeant bien droit et bien mis, coiffé à la gomina, l’air posé mais fringant, sûrement bon athlète et bon nageur, le visage régulier du jeune Européen bien disposé et bien parti pour la vie – la vie qui lui appartient, comme on dit et comme paraît le dire ce même œil pétillant qui, maintes fois, tant d’années plus tard, nous aura pris à témoins, les enfants.
Voici donc Leo et Theo, le Conteur et l’Aventurier, figures de mes songeries légendaires, parangons s’il en fût des Irréguliers de ma planète imaginaire, et me voilà guetter la moindre de leur parole, comme j’aimerais aussi que se déboutonnent leurs frères ainés, les Réguliers, à commencer par le grand-oncle Albrecht au front buté, mais que je sais un passionné d’aéronautique nouvelle, et par Conrad qui s’est établi à Berlin pour y diriger de grand travaux urbains - tous deux à la fois présents et pas vraiment là, étant entendu que leurs affaires les attendent et que ça n’attend pas, selon l’expression - pas que ça à faire, comme on dit encore, même si cela se fait en ces années, dans un pays civilisé, de poser pour la postérité en famille de sorte que celle-ci apparaisse dans son établissement, en cette année 1911, dans le décor vaguement colonial du photographe Emil Goetz, 8 Hisrchmattstrasse, tel. 689.
Et que nous disent-ils donc tous, tant qu’ils sont ? Que nous disent les Réguliers et les Régulières ? Que nous dit, au premier rang, l’air de quelqu’un qui en sait long sur les choses de la vie, comme on dit - que nous dit la mère de Grossmutter, siégeant bien droite, mais sereine aussi, tenant un magazine, nous regardant en face comme nous la regardons à près d’un siècle de distance – que nous dit-elle et que pourrions-nous lui dire à l’instant ? Que signifie l’air comme effrayé de la fragile Milena, tout à gauche de la photo sépia, juste derrière Leo, la main posée sur la solide épaule de celui-ci, qui porte une minerve et sourit encore moins que quatre autres de ses sœurs ? Que voudraient peut-être dire les trois autres, ensuite, du milieu du deuxième rang, dont les regards nous regardent eux aussi bien en face et fixement à presque un siècle de distance, modestes ou plus insistants ? Et que ne dira sûrement pas, tout à droite au second rang, comme écrasée par la masse du beau Theo, avec quelque chose de russe elle aussi, la sombre Marta au regard qu’on pourrait dire carrément refusé, et dont Lena ne se rappelle plus ce qu’elle est devenue ?
Enfin les regards de nos deux Irréguliers, que nous chantent-ils donc au primesaut de cet autre matin d’hiver ? Que nous raconte le regard du dernier né de la famille rassemblée, ce fringant jeune homme du premier rang, prénom Leopold, que nous connaîtrons sous les traits d’un personnage hirsute et gesticulant revenu des comptoirs orientaux et des jungles, et que nous dit le long regard ombrageux de son frère Theo, élégant plus que les autres, avec son col cassé, et qui paraît déjà désigné par la destinée pour quelque aventure hors du commun ?
D’autres heures d’avant l’aube, en ces veillées de ce long hiver, je serai resté à quêter le moindre mot de nos silencieux, revenant et revenant à la photo sépia ou compulsant les albums des autres branches de notre généalogie, sans entendre rien ni rien oser leur dire ou rien dire d’eux, jusqu’à ces jours de fin décembre et de janvier de l’année suivante, puis des mois suivants où, la neige cédant le pas au jour et au printemps, CELA recommença de parler à travers les années.
On aurait donc hiberné, se dira-t-on ensuite, sans se rappeler à l’instant tant d’hivers passés à ne rien entendre ou dire, faute d’écouter. On se reprocherait alors d’avoir manqué à la vie. On serait tenté de déplorer le temps perdu, tout en se sachant passé par l’épreuve d’un temps d’imprégnation et de maturation et de descente et d’immersion et de remontée des eaux mêlées de nos mémoires dont on ressortirait tout frais et neuf comme les deux jeunes Irréguliers de la fameuse photo sépia, le Conteur et l’Aventurier, et ces matinées des temps d’avant Pâques tout revivrait et rebondirait en flots de mots par les prairies des premières heures, et le récit reprendrait, des maisons retrouvées...(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en finition)
-
Remember Bashung
 En classant mon courriel, je tombe sur cette lettre de Pascal Janovjak, en mai 2008. Il répondait à une évocation que je lui avais faite d'un essayage de jeans à 10 euros que nous avions fait, mon ami il Gentiliomo et moi, dans un marché aux puces de Marina di Carrara, en Toscane marine. Un an déjà...
En classant mon courriel, je tombe sur cette lettre de Pascal Janovjak, en mai 2008. Il répondait à une évocation que je lui avais faite d'un essayage de jeans à 10 euros que nous avions fait, mon ami il Gentiliomo et moi, dans un marché aux puces de Marina di Carrara, en Toscane marine. Un an déjà...Ramallah, le 6 mai 2008.
Cher JLs,
J'ai moi aussi quelques souvenirs d'essayages derrière des bâches trouées, des pieds qui se prennent dans le pantalon, entre deux murs de boîtes à chaussures, voir au milieu d'un supermarché sans cabines. Ceci dit je préfère quand même les salons de Dolce & Gabana, Via Montenapoleone à Milano, que tu connais aussi bien que moi : climatisés et parfumés, avec canapés de cuir rose dans chaque cabine, où vient s'affaler la petite amie ou le petit copain du mec qui essaye son futal, regards gourmands qui se démultiplient dans les grandes glaces qui couvrent les parois, et d'accortes hôtesses qui viennent apporter des Martini rossi on the rocks, ou donner un coup de main, quand on a coincé sa fermeture éclair. L'idée n'est pas désagréable mais pour tout te dire je me passerais volontiers des essayages, en cabine ou en camionnette, d'ailleurs je m'arrête là, parce qu'en tapant « d'accortes hôtesses » quelque chose a fait tilt, d'où me viennent ces mots-là, et bien ils viennent d'ici, d'une chanson de Bashung,En Ecosse des gosses écossent
Des chimères en chair et en os
D'accortes soubrettes les escortent
En Ecosse des gosses précoces
Chopent des crampes
A faire l'amour à tue-tête
A bâtons rompus
et donc j'ai envie de te dire deux mots sur Alain Bashung, et de lui dire deux mots aussi, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il fait en ce moment, son dernier album vient de sortir, c'est moins bon, il a changé de parolier le bougre, ou bien le parolier s'est barré je n'en sais rien, Jean Fauque fait un disque solo maintenant, les paroles sont grandioses, mais du coup c'est la musique qui est tristoune. Alors que les deux ensembles, Fauque à la plume et Bashung à la basse, ça c'est du grand art, des allitérations scintillantes sur des sons inouïs, on touchait les étoiles. Bien sûr on a le droit de ne pas aimer la voix nasillarde de Bashung, mais franchement de tous les droits civiques celui-ci me semble le plus discutable. Si par malheur tu ne connaissais pas L'Imprudence, leur dernière œuvre commune, il te faut sans tarder appareiller montgolfière et te laisser porter en direction du disquaire le plus proche, on y trouve des perles de poésie, des pépites issues de leur rare alchimie :Dans ma cornue
J'y ai versé
Une pincée d'orgueil
Mal placé
Un peu de gâchis
En souvenir de ton corps
Ou bien ce vers, tiré d'un précédent album, dont la musique intrinsèque me semble se suffire à elle-même,
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine
mais c'est peut-être parce que j'y entends l'accompagnement, les violons et la batterie, comme celle qui claque à la fin de
Un jour au cirque / un autre a cherché à te plaire / dresseur de loulous / dynamiteur d'aqueducs
J'apprends à l'instant, au hasard du web, que Bashung souffre d'un cancer. Ca me fait de la peine, pour toutes les extases que je lui dois, mais surtout parce qu'à force de l'entendre je le connais bien, les chanteurs qu'on aime font partie de la maison, ils hantent nos murs, ils sont un peu de la famille, bien plus que les écrivains condamnés au silence des livres clos. Leurs voix ont accompagné trop de rêves et de mélancolies… Cancer du poumon, dit le web, pas tellement étonnant, à force de côtoyer Brel, de respirer le même air que Gainsbourg.Le dimanche à Tchernobyl j'empile torchons, vinyles, évangiles
mes paupières sont lourdes
mon corps s'engourdit
c'est pas le chlore
c'est pas la chlorophylle
tu m'irradieras encore longtemps
bien après la fin
tu m'irradieras encore longtemps
au-delà des portes closes -
CELA

CELA serait le grand mystère de ce que je vois sans le voir, et j’y associe ce matin mon frère mystérieux. Dans ce paysage immense qu’on dirait à l’instant de monts de Chine encrés à rehauts de bleu sombre, mon frère est ce personnage à manteau noir qui s’en va seul, là-bas, sur la rive du lac semblant un fleuve, mon frère n’est aujourd’hui plus que cendres sans mystère et telle est ma question : qui est cet homme que je vois là-bas qui me fait signe ?
Tu me disais, tas de cendres, que CELA ne nous regarde pas, mais ton prénom me rend un corps et c’est le tien : ton corps d’Indien de nos étés, ton corps tatoué de grand Ivan que je regarde et qui me regarde, oui CELA me regarde, tas de cendres, CELA nous regarde, mais où s’arrête ton corps, ce matin, comment ne pas entendre ta voix de garçon petit et tout blond dans le silence de CELA ?
Mais qu’est-ce diable que CELA? Où commence le corps de notre premier enfant ? Tiens, l’odeur de la première merveille n’est pas la même que celle de la seconde. Celle-ci sent plutôt le jasmin, celle-là plutôt l’abricot, comme leur mère sent le matin le jardin et leur père le sanglier.
Le mot CELA est le sempiternel entonnoir de tous mes vertiges de vieil enfant et d’adolescent prolongé: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.
Dieu tu ne l’as jamais vu. Dieu n’est pas CELA, mais CELA te ramène à ce Nom sans nom. Dieu t’a toujours tenu dans sa main, te dis-tu parfois, mais que diable en sais-tu ? Eux le savent qui en ont fait le Tout-Puissant, Seigneur des armées, mais de celui-là tu ne veux rien savoir. Eux le savent qui en ont fait le Verbe ou l’Absent, le Vengeur ou le Sacrifié, le Glorieux ou le Mendiant, mais de tous ceux-là tu ne sais que dire ce matin alors que le mot CELA t’engloutit, seul et muet, comme si tu te voyais toi-même sans miroir, de dos ou du dedans, seulement visible les yeux fermés.
Le ciel est ce matin de cendre et je m’en couvre le front. Ce seraient comme des mains aimées sur le front de l’enfant. Dans la maison sous la neige il y aurait encore des braises cependant, comme autant de noms retrouvés.Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chaantier.
Image: Philip Seelen
-
Dylan à travers la vie

COME BACK. Le 28 avril sort Together through Life, son nouveau disque, alors que sa tournée se poursuit : le 20 avril à l’Arena de Genève. Vient en outre de paraître : la réédition en poche de Bob Dylan – une biographie, de François Bon. Qui évoque sa passion.
Le voile du secret flotte avant la sortie du nouvel album de Bob Dylan, 68 ans et «ressuscité» depuis un bout de temps. Seul le titre de l’opus est déjà connu, qui évoque la traversée partagée d’une vie, alors que le site officiel du Maître diffusait récemment l’un de ses morceaux, Beyond there lies nothin’, « au-delà plus rien». Et François Bon, qui relaie ces dernières nouvelles sur son site internet personnel www.tierslivre.net) de relever : « avec cette inimitable connotation de mort et de route éternelle qui signe ses textes »…
Bob Dylan héritier de Rimbaud et pair du poète beatnik Allen Ginsberg, plus que « star »de la contre-culture américaine : tel est le créateur génial, nourri de Poe et de Brecht (son maître revendiqué en matière d’écriture) dont François Bon, dans son ouvrage, reconstruit l’image claire-obscure et à facettes, pas loin du portrait kaléidoscopique d’ I’m not there, le film de Todd Haynes (2007) fragmentant le personnage par le truchement de six acteurs…
« A l’origine, confie François Bon, c’est la passion d’un môme de quinze ans du fin fond du Poitou qui se sent vibrer à l’unisson de l’Amérique nouvelle, comme toute une génération de la fin des sixties, à l’écoute de cette drôle de voix nasillarde…». Romancier plus que reconnu, et pas vraiment du genre à bricoler des bios de stars vite faites pour le dinar, François Bon avait déjà brossé une premier portrait de groupe-et-d’époque dédié aux Stones (Fayard, 2002), avant d’aborder Dylan. « Je m’y suis mis après avoir découvert ses fascinantes Chronicles, où l’on découvre mieux son jeu avec l’autofiction et son génie d’écrivain, et j’ai eu envie de combler certaines zones restées obscures au moyen d’une nouvelle masse documentaire que n’avaient pas utilisé les biographes incontournables du moment, notamment Howard Sounes. »
Plus qu’à des faits nouveaux à caractère saillant, le biographe éclaire des moments-charnières de la vie de Dylan, comme l’année 1962 où, après une année de fac, le jeune homme de 19 ans va chanter des chansons de cow-boy dans un bled perdu où défilent les retraités amateur de décors pseudo-western, avant de s’inventer un nom et un personnage, qu’il disjoindra prudemment de sa personne privée dès le milieu des années 60. Autre épisode significatif : lorsque sa compagne Joan Baez lui offre un beau piano tout neuf, alors qu’il n’en a, lui, qu’à sa machine à écrire… »
Tour à tour attachant ou insupportablement égocentrique, fragile ou implacable quand il s’agit de son art, le Dylan de François Bon est approché par un connaisseur accompli des artisanats très exigeants de la musique et de l’écriture, autant que des embrouilles psychologiques et sociales d’un univers souvent redoutable. Certes beaucoup moins exposé que les lascars de Led Zeppelin (dernier sujet documenté par l’écrivain) mais en proie à ses propres démons, entre éclipses alcooliques et fuites dans la religiosité, le vrai Dylan est à rechercher dans ses avancées créatrices plus que dans ses tribulations «trop humaines». Sans l’idéaliser pour autant, François Bon parie pour le meilleur de l’artiste, fût-il souvent insaisissable…
François Bon. Bob Dylan – une biographie. Le Livre de poche, en librairie le 15 avril.
Bob Dylan, Together through Life, dès le 28 avril. Dossier Dylan sur www.Tierslivre.net avec une belle évocation d'un des derniers concerts de la tournée actuelle, par Arnaud Maaïsetti.
 Le top 3 de François Bon
Le top 3 de François Bon
Blonde on blonde. Sony.
Le premier double album de l'histoire du rock et peut-être le meilleur de Dylan. Courant 1966, il quitte New York pour Nashville, quelques brouillons en poche. Les pros de Music City découvrent alors un poète halluciné, gavé d'amphétamines. « Avant la chute, c’est un des miracles qu’il faut retenir, entre autres. Les disques de Dylan sont les témoins de leur exacte période, des techniques d’enregistrement et de la façon dont il les détourne. Celui-ci, enregistré en deux fois trois jours en 1966, est un monument définitif. »
Live at the Gaslight. Columbia, 2005.
En réédition chez Columbia, revit ici le fabuleux concert d’avril 1962 au Gaslight, un café-concert au beau milieu des rues froides du Village. Sur la scène, un gringalet chante de sa voix nasillarde des airs hérités de Woody Guthrie et des traditionnels folk. De la pure poésie, évoquant l'actualité avec ironie et lyrisme (A Hard Rain's A-Gonna fall). On se laisse porter par la pure beauté de Moonshiner, par la douce mélodie injectée de venin de Don't Think Twice (It's Allright). On retrouve la même magie que sur son premier album, sorti la même année.
Tell Tale Signs. Rare and unreleased 1989-2006. Vol 8. Columbia/Legacy.
Dans la série des Bootleg, les deux CD de cet « album de l’année » (aux Etats-Unis) revisite les moments que Bob Dylan évoque dans ses Chroniques où, au plus bas, avec Daniel Lanois, il va renouer avec la grâce. En témoignent des chansons miraculeuses comme Political World, Dignity. Entre autres premières prises avec Lanois, deux guitares sèches et le pied qui racle le plancher : l’étrange Series of Dreams ou A hard rain gonna fall en écho à la guerre froide et la menace nucléaire…Cet article à paru dans les éditions de 24 Heures et de la Tribune de Genève du 15 avril 2009.
-
Pensées de l'aube (69)

De l’admiration. – Ils craignent d’être influencés, disent-ils, ils ne sont pas dupes de ce qu’ils croient des révérences convenues, ils ne voient pas que cela les agrandirait de reconnaître la beauté pour ce qu’elle est, autant dire qu’ils ne veulent pas la voir, même celle qui est en eux…
De l’indulgence. – Ils ont tendance à se flageller, ils t’embêtent avec leurs faces d’enterrement et voilà qu’ils te poussent à te couvrir toi aussi le front de cendre, rien ne va plus ici bas voudraient-ils t’entendre te lamenter, mais ça t’embête ce cinéma, et tu vois bien qu’ils ont besoin d’entendre autre chose, donc tu leur dis que tu les aimes bien tels qu’ils sont et de fait ça a l’air de les retourner…
De la bonté – Plus ils sont vertueux et plus je les trouve impolis et finalement assez méchants, sous leurs airs de vouloir notre bien, assez indifférents à ce que nous sommes en réalité, et finalement tout froids, le cœur congelé, desséché sûrement à traquer et débusquer ce vice qui les obsède jusqu’à les faire jouir de leur vertu préservée, les malheureux…
Image : Philip Seelen
-
Soliloque de Karim

… Et là pour 8 euros 50 t’as vraiment tout, mais tout, bon je laisse les caches pour pas choquer Nasma quand elle vient demander un petite aide à son oncle Karim, parce que tu vois, tu me connais, j’aimerais pas qu’elle dise à ma sœur ou la mère que je me suis mis à la porno - mais viens donc voir ça là derrière, si c’est pas beau la femme, je veux dire pas la femme que tu respectes, toi et moi, mais enfin on se comprend : on reste un homme toi et moi, on n'est pas encore de ces générés, pas vrai Karim, on en a encore un peu là dans le boxer, toi et moi…
Image: Philip Seelen.
-
Nos amis de Medellin
…Okay darling, je voulais juste voir à quoi ils ressemblaient, ne sois pas nerveux, je leur prépare un cocktail d’accueil et nous les installons dans le loft de la Laguna, tu leur dis que je ne les ai jamais vus et que la clim de la piscine sera réparée demain - en ce qui te concerne je sais juste qu’ils t’ont relâché sous condition et pour le reste les avocats de ton père se chargent de tout…
Image : Philip Seelen

-
Sentiments délicats

… Je ne dirais pas que Daena m’a largué ni que je l’ai jetée : à vrai dire nous nous sommes un peu éloignés l’un de l’autre, nous avons pris quelque distance sans nous quitter vraiment, il est vrai que l’appart du Roule est un peu étroit pour ma vie avec une compagne à demeure et c’est ainsi aussi que Mara et moi nous sommes un peu éloignés l'un de l’autre et que Verena ne fait que passer sans rester la nuit – mais avec chacune je garde une relation privilégiée, je crois, il me semble que je les gère très bien, elles et les autres…
Image : Philip Seelen -
Ceux qui se demandent ce qu’ils font là

Celui qui ne se rappelle plus où il doit descendre sur la ligne de Cuernavaca / Celle qui se retrouve terriblement ivre derrière la porte fermée d’un hôtel de Sofia sans se douter que ce n’est pas le bon / Ceux qui se sont croisés dans un rêve de Borges qui les en a avertis respectivement sans préciser qui était l’autre / Celui qui est venu écrire à la terrasse du Café des Amis devenu le Holy Meetic / Celle qui s’est endormie dans le tunnel et se réveille sur le quai désert une heure auparavant / Ceux qui récusent le jugement de certain snob argentin selon lequel Jules Verne ne serait qu’un modeste boutiquier des lettres alors qu’ils continuent de se réveiller dans la bibliothèque du capitaine Nemo / Celui qui relève la «douceur veloutée» des argumentations de l’humaniste Erasme / Celle qui retirait l’encre de l’écritoire postal quand elle voyait le peintre génial Louis Soutter (un triste sire à ses yeux à elle) s’y pointer avec ses cahiers de dessin / Ceux qui laissent le jeune homme aux yeux verts s’allonger de tout son long sur le sol de salle d’attente du vétérinaire en attendant que son pitbull unijambiste lui soit rendu / Celui qui renonce à toute espèce de pouvoir à l’instant de constater que le viagra n’est d’aucun effet sur sa libido de chef de rayon récemment licencié / Celle qui découvre la géographie souterraine de la rivière traversant sa ville natale de part en part sous les arches de laquelle elle s’est réfugiée au terme de la nuit dite du Grand Effroi dans son Journal d’une âme attentive / Ceux qui s’affilient à l’Internationale du Temps Ralenti / Celui qui exerce sa verve corrosive au détriment de la buraliste à bec de casoar / Celle qui croise tous les matins cette passante en se demandant si ce n’est pas Sophie Calle qui lui sourit avec la conviction d’être reconnue alors qu’il ne s’agit pas de Sophie Calle mais de Jeanne Flocon la linguiste belge de la villa Les Lauriers / Ceux qui ne savent plus où ils en sont sans se rappeler qu’ils ont cru qu’ils le savaient à la grande époque où ils chantaient par cœur Bella Cio et autres hymnes entraînants de leur belle jeunesse de noceurs, etc.
Image: Philip Seelen.
-
Une quête d’absolu

Into the Wild, de Sean Penn
C’est un bien grand beau film généreux et limpide qu’Into the Wild de Sean Penn, dont l’empreinte qu’il laisse au cœur est toute pure. L’histoire en est prenante, les personnages principaux sont également de belles personnes, comme on dit, les images et la musique ne sont pas moins superbes et, surtout, il s’en dégage un sentiment général d’autant plus bienfaisant et tonique qu’il n’a rien de complaisant ou d’édulcoré, voire de frelaté, comme pourrait le faire redouter le thème rebattu du retour à la nature. De fait, les rudes lois de celle-ci ne sont pas ignorées ni sous-estimées. Une scène terrible, marquée par le sacrifice « inutile » d’un élan, souligne le caractère très problématique d’une immersion « naturelle », même si la quête du solitaire reste fondée. Le titre d’ En pleine nature ne rend d’ailleurs pas compte du piège que celle-ci représente bel et bien dans le film, alors que l’original Into the Wild en désigne mieux l’ambivalence, qui renvoie aux obstacles et au combat du héros de Construire un feu de Jack London.
 L’esprit des Jack, London et Kerouac, mais aussi de Thoreau et de Tolstoï, préside à ce parcours initiatique d’un tout jeune homme déçu par ses parents, dont la mésentente tourne à la haine sous les dehors du mensonge et de l’hypocrisie.
L’esprit des Jack, London et Kerouac, mais aussi de Thoreau et de Tolstoï, préside à ce parcours initiatique d’un tout jeune homme déçu par ses parents, dont la mésentente tourne à la haine sous les dehors du mensonge et de l’hypocrisie.Deux grandes lignes narratives traversent le film et se relancent l’une l’autre en contrepoint, modulant en outre le passage des années et scandant l'avancée de chaque nouveau chapitre: d’une part, c’est le récit du Magic Bus, la carcasse d’autocar perdue en plein Alaska où Alex Supertramp (c’est le pseudo glorieusement naïf qu’il s’est choisi) va vivre cent jours de solitude absolue ; et, de l’autre, la chronique tenue par sa sœur au fil de ses années de fugue, qui témoigne des conséquences de celle-ci sur les parents restés sans nouvelles, reconnaissant leurs responsabilités et se rapprochant peu à peu l'un de l'autre.
On le sait, Sean Penn revient de loin : de toutes les défonces et de tous les dégoûts. Or ce qui sidère en l'occurrence est la complète fraîcheur de son regard sur le monde et sur les gens, tous abordés avec tendresse et jusqu’à l’indulgence, s’agissant du père égoïste et violent qui se prend pour Dieu au point, une année, de décider, le con, que Noël n’aura pas lieu…
L’Amérique d’Into the Wild est à la fois celle de L’Attrape-cœur de Salinger et de Sur la route de Kerouac, des anciens hippies dans les déserts et de Bush Senior justifiant la guerre du Golfe ou des paumés down & out crevant dans les grandes villes; et l’on se rappelle aussi la dernière page de La Route de Cormac McCarthy dont on pourrait dire que Sean Penn la réinvestit avant la catastrophe ou au moment d’en renaître…
Si la « théologie » de McCarthy est plus profonde dans son aperception tragique et sa visée rédemptrice, que la religiosité tolstoïenne qui se dégage d’Into the Wild, ce film ne représente pas moins, aujourd’hui, un geste de résistance aux forces obscures et destructrices de l’empire du fric, à la violence, au fanatisme, au cynisme ou à la décadence. Le fait qu’Alex, prodigieusement vécu, plus encore qu’interprété, par Emile Hirsch, soit à la fois un fou de lecture et un pèlerin de l’absolu, dont l’apprentissage passe par une nouvelle naissance et une filiation restaurée (avec une femme, puis un vieil homme qui l’adoptent pour ainsi dire en le poussant au pardon des siens), avant la révélation finale de ce que le bonheur n’a de sens que partagé – tout cela élève le film au-dessus des rêveries New Age à base de marshmallow spiritualisant.
La grande générosité d’Into the Wild va de pair avec une forme lyrique n’excluant pas ici et là quelque pompe ni quelques clichés, mais c’est aussi la loi du romantisme à l’américaine (on est bien dans la lignée de Twain, London ou Thomas Wolfe), dans un ample mouvement et un grand souffle. Si la scène de l’empoisonnement « naturel » du protagoniste rappelle La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic, c’est à Tolstoï qu’on pense à la fin poignante d'Alex, rappelant la mort « cosmique » du prince André...
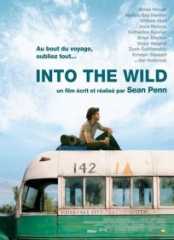 Sean Penn, Into the Wild. Sur DVD et en salles.
Sean Penn, Into the Wild. Sur DVD et en salles. -
Pensées de l'aube (68)

De ce dimanche. – Pour nous, les enfants, Pâques, c’était le dimanche des dimanches - un dimanche vraiment plus dimanche que les autres où le ciel était plein de cloches et le jardin plein d’œufs que le Lapin avait peinturlurés et planqués Dieu sait où - donc deux jours après la Croix, le Lapin : tu avoueras que ce n'est qu’un dimanche que ça peut se passer, et ça nous réjouissait plutôt, les enfants, qu’il y ait un dimanche comme ça qui ressuscite chaque année…
De la foi. – Notre ami le théologien me dit qu’il n’y croit pas vraiment : que son intelligence l’en empêche, puis il me dit : toi non plus tu n’y crois pas, rassure-moi, aussi lui dis-je : non mon ami, je ne vais pas te rassurer, je ne sais pas si je crois, je sais de moins en moins ce que c’est que croire au sens où tu crois que tu ne crois pas, mais surtout (et cela je ne le lui dis pas) je ne sais comment je pourrais l’expliquer à quelqu’un que son intelligence empêche de comprendre rien…
De la charité . – Vous connaissez le mendigot du Sacré-Cœur : il sort de chez ce pouilleux d’abbé Zundel qui le régale déjà plus qu’il n’en faut, et le voilà qui nous lance à la sortie de l’office, son : Christ est vraiment ressuscité ! que moi ça me fait honte, mais j’ai beau savoir qu’il ira les boire ce soir, je lui donne quand même ses deux euros - ce n’est quand même pas tous les jours Pâques…
Image : Philip Seelen -
Riches Heures. Blog-notes 2005-2008
Vient de paraître
aux éditions L'Âge d'Homme.
Du blog au livre...
Au lecteur
Ce recueil, établi à la demande de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, aux éditions L'Age d'Homme, rassemble une partie de mes Carnets de JLK, blog littéraire ouvert sur la plateforme HautEtFort en juin 2005. Proposant aujourd’hui quelque 2000 textes, dans les domaines variés de la littérature et des arts, de l’observation quotidienne et de la réflexion personnelle, entre autres balades et rencontres, ces Riches heures de lecture et d’écriture s’inscrivent dans le droit fil des carnets manuscrits que je tiens depuis une quarantaine d’années, qui ont déjà fait l’objet de deux publications : Les Passions partagées (1973-1992) et L’Ambassade du papillon (1993-1999), chez Bernard Campiche.
En outre, ces Carnets de JLK illustrent les virtualités nouvelles, et notamment par le truchement de l’échange quotidien avec plusieurs centaines de lecteurs, de cette forme de publication spontanée sur l’Internet, qu’on appelle weblog ou blog.
Dans l’univers chaotique qui est le nôtre, où le clabaudage et la fausse parole surabondent, ces carnets se veulent, au-delà de tous les sursauts de méfiance ou de mépris, la preuve qu’une résistance personnelle est possible à tout instant et en tout lieu pour quiconque reste à la fois attentif à la rumeur du monde et à l’écoute de sa voix intérieure. À l’inattention générale, ils aimeraient opposer un effort de concentration et de réflexion au jour le jour, ouvrant une fenêtre sur le monde.
SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.
J’écris cependant, tous les jours, «sous le regard de Dieu», et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.
Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».
A LA DESIRADE. – Nous entrons dans la nouvelle année par temps radieux et la reconnaissance au cœur alors que tant de nos semblables, de par les monde, se trouvent en proie à la détresse, à commencer par les victimes des terribles tsunamis qui viennent de dévaster les côtes de l’Asie du Sud-est.
A La Désirade, la vision de ma bonne amie qui fait les vitres, comme on dit, me semble la plus belle image de la vie qui continue…
(1er janvier 2005)
ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.
Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.
Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.
Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…
Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.
La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors repose et fructifie.
 En librairie ces prochains jours. Commandes directes : http://www.lagedhomme.com/
En librairie ces prochains jours. Commandes directes : http://www.lagedhomme.com/ -
Pensées de l'aube (67)

De la veillée. – Cette fin de nuit de pleine lune te fixait de son monocle opalescent qui s’est bientôt orangé dans les bleus s’éclaircissant, le jour ne semblait pas se rappeler les cruautés de la créature pensante, tu n’avais en toi nulle autre pensée que de remerciement d’être en vie sur cette terre tremblante et souffrante qui souffrirait encore et tremblerait - mais qui t’apparaît si jolie en ce matin du monde…
De ce vendredi – Tous les saints du calendrier sont à la peine et ça ne va pas s’arranger au fil des heures, vous me dites que vous n’en avez rien à scier mais ça ne s’est pas fait pas sans vous, rien ne se fera sans nous, le premier crachat, la première épine, le premier clou, rien ne vous sera épargné, les mal barrés, croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer…
Du bonus pascal. – Vos agenouillements de vieilles peaux et de nigauds jeunets les font ricaner, mais après le père Noël, le lapin fait pisser le dinar et ça c’est du solide, on y croit dur comme fer, et puis la pierre qui roule, ma poule, ça fait toujours se déplacer les foules et cartonner les nuitées romaines - enfin ce dieu qui va pour prendre l’ascenseur nous vaut un break super et ça ne mange pas de pain, thank you rabbin...ImageJLK: Grammont à l'aube, huile sur toile, 2006.
-
Pensées de l’aube (66)

De ce qui n’est qu’allusion. - A l’éveil des ces jours inclinant au redoux on ne trouve pas de mots assez légers, assez transparents mais qui évoqueraient aussi le poids des montagnes millénaires et la densité de l’air qui les relie aux galaxies, tout ce lien de temps imaginaire et d’atomes de brume un peu chinoise ce matin - des mots qui dévoilent en voilant et qui parlent sans prétendre rien dire que ce qui est…
Du trait de l’oiseau. – Cependant m’impatientent les chichis du minimalisme et les pâmoisons de toute une anorexie esthétique, car le coup de cisaille de la fauvette dans l’azur du matin, au pic de son coup d’aile sur les champs purinés de frais - ce pur salut à personne et tout le monde dans l’odeur merdoyante du printemps, ne sera jamais couché sur grand papier à la cuve – il fuse de la sauvage et nul ne sait ce que ça veut dire…
De l’hérésie. – Vous avez raison de nous reprocher d’acclimater la Croix et le Tao, jardins et précipices, Ibn Arabi et Miss Dickinson aux oiseaux illuminés, vous êtes les réguliers de la Règle bien convaincus d’avoir trouvé et qu’en conséquence le Salut vous est dû, tandis que nous autres cherchons un peu partout sans attendre rien, juste émerveillés sans savoir diable pourquoi…
Image : Philip Seelen -
Ceux qu’inspire la rumeur de la mer
Celui qui porte un bouquet de jonquilles dans la poche arrière de son jean / Celle qui s’en va tout doucement dans la lumière plombée du fjord / Ceux qui se sont retrouvés pour accueillir la mort ensemble / Celui qui évite de penser à tout ce qu’il sait essentiel / Celle qui trouve les mots trop grands pour ses émotions d e demoiselle / Ceux qui n’osent pas dire qu’ils s’aiment / Celui qui décapite des tortues dans un film javanais / Celle qui a perdu sa sœur dans une manif d’Athènes / Ceux qui se rappellent le jour et l’heure de la mort de Lady Diana / Celui qui estime que The Queen is dead est le meilleur album des Smiths / Celle qui ne veut écouter que Strangeways en mâchant de la rhubarbe / Ceux qui se demandent à quoi l’on rêve quand on a perdu le sens des couleurs / Celui qui se promet de s’engager dans la Légion étrangère s’il échoue à l’examen d’admission à la fonction de Palefrenier Chef du haras de la Comtesse Bouleboule / Celle qui reproche à son fils de ne pas porter de bretelles / Ceux qui se séparent pour survivre / Celui qui a découvert la leçon de sagesse subliminale du roman à succès Jody et le faon / Celle qui ment à en avoir la face bleue / Ceux qui prétendent aimer la pluie en banlieue et les politiciens de seconde zone / Celui qui estime que la vie ne fait que prendre sans rien donner / Celle qui dort toujours dans le sac de couchage de son premier prétendant explorateur / Ceux qui considèrent que le bonheur ne vaut rien sans matelas bancaire conséquent / Celui qui se juge indigne des compliments du vice-président de son club de tango / Celle qui pense que tout désormais est trop tard / Ceux qui sont morts dans le même fauteuil à oreilles de l’institution Le Clair Matin / Celui qui trouve un réconfort au Hamburger Heaven / Celle qui spécule sur le fait que la fille d’un premier mariage de sa bru va se retrouver dans le même lycée que Louis Sarkozy et que son fils Tibère pourrait en profiter d’une manière ou de l’autre en dépit de son penchant récent pour la religion musulmane / Celle qui pense qu’un gros aurait plus de chance avec elle qu’un aveugle malgré la tendance inverse / Ceux qui aiment l’odeur mêlée des clopes et des fish’n’chips / Celui qui a la nostalgie des jardins ouvriers de la Banlieue Ouest / Celle qui passé de la passion pour Sissi impératrice à celle des tailleurs ton sur ton / Ceux qui prétendent avoir assisté au dernier concert de Chet Baker au New Morning, etc.Aquarelle JLK: dunes de Sète, 2007.
-
Pensées de l'aube (65)

De l’herbe. – Parfois le paysage t’en met trop plein la vue, au point que tu éprouves un manque ou une gêne, le besoin de voir des gens ou de n’entendre les yeux fermés que le merle du matin, et tu te rappelles alors l’herbe première, au bord du désert, l’herbe seule et têtue d’avant les cavaliers, l’herbe foulée et oubliée de partout avant la touffe en gloire de Monsieur Dürer…
Del cammin di nostra vita. – Il y a tant encore en nous de chemin dans notre forêt obscure, tant de chemin à poursuivre ou à tracer sans savoir où l’on va, mais tu as dû voir une fois une clairière quelque part, peut-être la musique que votre père se passait le dimanche, peut-être vos mères ou vos enfants, peut-être la réminiscence d’un cours d’italien sur la Divine Comédie, enfin Dieu sait quoi nous fait, bœufs et cons, continuer à cheminer dans l’obscurité du jour…
De l’attention . – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…
Image : Philip Seelen




