
J’étais sous la table et je captais des bribes de ce que disaient les grandes personnes, selon l’expression de notre grand-mère paternelle, qui leur intimait de tenir leur langue eu égard aux jeunes oreilles qu’il y avait là-dessous ; j’étais sous la table et c’est comme si je m’y trouvais encore à l’instant, imaginant notre mère-grand qui nous désignait à voix basse, jeunes oreilles aux aguets que nous étions - je me revois là-dessous avec l’un ou l’autre de mes frère et sœurs ou de mes cousins et cousines, à capter plus ou moins ce que disent les grandes personnes et si possible ce que nos jeunes oreilles ne sont pas censées entendre ; et chaque mot que j’ai retenu, chaque expression qui me revient me ramènent à la fois un visage ou un personnage avec son intonation de voix propre et ses traits particuliers.
J’entends ainsi cette voix plaintive - ce doit être celle de la cousine Pauline, dont l’obésité commence à peser sur ses mouvements et son moral -, qui égrène son chapelet de lamentations sur ces années où l’on a tant lutté, selon son expression, et c’est sur le même ton que notre mère aussi nous rappellera, parfois avec un accent frisant le reproche, combien nous autres, qui n’avons pas connu la guerre, avons de la chance de n’avoir pas dû tant lutter. Et Pauline de rappeler qu’en ce temps-là tout était rationné et qu’on a même parfois manqué, selon l’expression, surtout vers la fin, et qu’un seul œuf par mois a constitué une épreuve, et que les biscuits à la pomme de terre en ont été une autre, et que la soupe du boucher ne valait guère mieux sans doute que celle de ces camps allemands où l’on affamait les gens.
Mais le ton soupirant de la tante Pauline a le don d’exaspérer notre oncle Victor, son conjoint, protestant que ces jérémiades de bonnes femmes, selon son expression, ne doivent pas nous faire oublier la chance que nous avons eue grâce au Général, et notre grand-père aussi réagit aux plaintes de sa fille qui se rebiffe et va pour faire la tête, selon l’expression, et notre oncle Norbert et son frère, notre père, s’entremettent alors en conciliateurs tandis qu’à la voix plaintive de la tante Pauline se joignent les voix plaintives de notre mère et d’une cousine dont j’oublie le nom, mais notre grand-mère rallie l’autre camp de son conjoint à elle et de son gendre, et bientôt on ne s’entend plus, là-haut, quand une voix d’homme posé à l’accent américain, qui ne peut être que celle du professeur Barker, l’ami du Président, relève que, même s’ils ont enduré quelques privations, les habitants de ce pays préservé de la guerre ne sauraient comparer leurs conditions de vie à celles des populations envahies ou déportées, bombardées ou massacrées, après quoi l’on entend un long silence froid que notre mère-grand interrompt en annonçant le café et les pousse-café.
 De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un livre illustré plein de maigres corps nus qui me troublent et de visages épouvantés, intitulé Plus jamais ça, mais sous la table tout cela ne signifie rien à mes yeux et quand j’entends, un autre jour, le mot JUIF, cela ne me dit rien non plus, mais je me rappelle distinctement cette voix qui dit là-haut : Juifs et Arabes, c’est le même nez crochu, sans trop savoir si je dois rire ou pas…
De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un livre illustré plein de maigres corps nus qui me troublent et de visages épouvantés, intitulé Plus jamais ça, mais sous la table tout cela ne signifie rien à mes yeux et quand j’entends, un autre jour, le mot JUIF, cela ne me dit rien non plus, mais je me rappelle distinctement cette voix qui dit là-haut : Juifs et Arabes, c’est le même nez crochu, sans trop savoir si je dois rire ou pas…
Mon père et son frère ne se querellent jamais, notre tante Pauline se lamente, comme se lamentent parfois, aussi, notre mère et sa sœur Greta, et Victor qui ne parle que de sport automobile les charrie, selon l’expression de notre mère-grand, qui le gourmande volontiers comme s’il n’était qu’un vaurien alors qu’elle le dit capable dans sa partie, de même qu’ elle le dit de notre grand-oncle Cédric, conjoint de la demi-sœur de notre grand-mère, et de ses deux fils, chacun reconnu capable dans sa partie, et n’est-ce pas ce qui compte pour se faire une place au soleil, selon l’expression ?
À leur voix, de mon poste d’observation de dessous la table, je m’exerce à reconnaître les prénoms de mes tantes et de mes oncles à chacun du repas du dimanche à la villa la Pensée, et lors des fêtes c’est à tout un monde que je m’efforce de rendre son prénom comme, dans l’antichambre, les enfants, nous nous amusons à identifier les manteaux de chacun et de nous en déguiser en imitant la voix de chacun.
Pourtant ce ne sont pas que des traits personnels que je m’efforce de me remémorer : c’est plutôt une façon de parler mais aussi de se taire, une façon de se tenir et d’écouter les autres, telle ou telle façon de se retenir ou de se protéger tout en regrettant peut-être de se trouver pareillement empêché par ce qu’on pourrait dire de ce qu’on dit - c’est tout cela que j’entends bouronner et bourdonner, à l’instant, dans le silence revenu de ceux que je dirai les miens – de notre smala que je dirai comme d’un pays entier ou d’une entière humanité de gens ordinaires, dans ces maisons et dans les autres.
Car il y a d’autres maisons, et dans la même maison, dès qu’il y a deux frères il y a conflit possible entre le grand et le petit Ivan ; dès qu’il y a frères et sœurs, cousins et alliés, mariages puis héritages, royaumes et dominations, toute maison, fût-elle bien habitée, selon l’expression de notre mère-grand, devient possible Maison de l’Araignée, comme dans la terrible légende que nous ont racontée maintes fois nos bonnes tantes Greta et Lena. On a beau former ainsi comme une tribu, quoique déjà subdivisée en deux parties : il y a encore d’autres lits, selon l’expression de notre mère-grand, et c’est là que tout se complique : là que je rapplique aussi, mauvais esprit que je suis, en sorte de faire parler les silencieux, quand bien même il y aurait des choses qui ne se disent pas, selon l’expression de notre grand-mère paternelle.
Du côté, précisément, de notre mère-grand ne peut s’ignorer, depuis toujours, la question du second lit, selon son expression, avec ces gens-là dont on parle le plus souvent à voix basse, crainte que rumeurs et ragots ne parviennent aux jeunes oreilles qu’il y a sous la table, qu’on envoie d’ailleurs bientôt jouer ailleurs…
En tout cas, pendant la guerre on se portait mieux parce qu’on mangeait moins, remarque notre grand-père en ne refusant point un petit supplément du dessert de mère-grand, qui remarque comme ça, au vol, qu’il y avait quand même des privations. Et d’ajouter aussitôt : sauf que certains se sont arrangés, faisant allusion à ceux du second lit, selon son expression, qui étaient de mèche avec ceux du marché noir et qui ont même fait des affaires tandis que les honnêtes gens en étaient réduits, ou peu s’en fallait, à manger leur propre main, comme on dit.
Ceux du second lit, cependant, conformément à la Parole selon laquelle les premiers seront les derniers, sont bel et bien devenus les derniers après la guerre, mais on n’en saura pas plus, on n’en dira pas plus, on sait simplement ce qu’on sait sur ceux du second lit, étant entendu qu’il n’y a pas de fumée sans feu, et ce qui a été dit et répété, même s’il est convenu qu’il n’est pas joli de colporter des bruits, ce qui a été rapporté d’une maison à l’autre et d’année en année fait que les maisons se sont éloignées les unes des autres - mais comment dire ce qui s’est passé vraiment ?
La page noire de la nuit de neige d’avant l’aube aura creusé, devant moi, tout ce temps d’invoquer les disparus, qui me sont à vrai dire chaque jour plus présents, cette étendue de silence dans laquelle ils se sont perdus les uns après les autres, comme dans un désert ou dans une forêt, se fuyant les uns les autres ou s’ignorant les uns les autres pour des motifs de plus en plus anodins - puis la neige a fondu et les jours ont recommencé de grandir.
(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

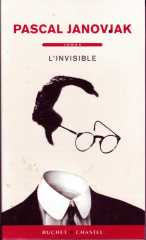
 Nous serons de retour la semaine prochaine à Locarno où, à neuf ou dix ans, j’ai passé avec ma sœur L. deux semaines édénique en compagnie de notre chère tante aussi friande de baignades que de balades, entre palmiers et châtaigniers, lagons d'Ascona et vasques du val Maggia. Or je me réjouis d’y retrouver Richard Dindo dont le journal intime pléthorique, mais interdit de lecture, s’intitule Le Livre des coïncidences, si j’ai bonne mémoire (et j’ai très bonne mémoire), et qui présentera au Festival son dernier film consacré aux dingues de Mars qu’il a rencontré aux States, qu’ils soient « platoniquement » passionnés par la planète rouge ou qu’ils se préparent effectivement au grand voyage interstellaire. Après Rimbaud et Kafka, Max Frisch et Jean Genet, entre tant d’autres sujets qu’il a documentés avec autant de sensibilité que de féroce rigueur, je suis impatient de me retrouver dans les faubourgs de Mars avec cet éternel rebelle au regard si décapant…
Nous serons de retour la semaine prochaine à Locarno où, à neuf ou dix ans, j’ai passé avec ma sœur L. deux semaines édénique en compagnie de notre chère tante aussi friande de baignades que de balades, entre palmiers et châtaigniers, lagons d'Ascona et vasques du val Maggia. Or je me réjouis d’y retrouver Richard Dindo dont le journal intime pléthorique, mais interdit de lecture, s’intitule Le Livre des coïncidences, si j’ai bonne mémoire (et j’ai très bonne mémoire), et qui présentera au Festival son dernier film consacré aux dingues de Mars qu’il a rencontré aux States, qu’ils soient « platoniquement » passionnés par la planète rouge ou qu’ils se préparent effectivement au grand voyage interstellaire. Après Rimbaud et Kafka, Max Frisch et Jean Genet, entre tant d’autres sujets qu’il a documentés avec autant de sensibilité que de féroce rigueur, je suis impatient de me retrouver dans les faubourgs de Mars avec cet éternel rebelle au regard si décapant… 

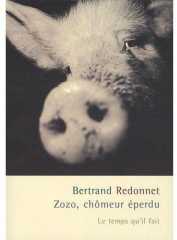 Bertrand Redonnet. Zozo, chômeur éperdu. Le Temps qu’il fait, 107 p. Du même auteur : Brassens, poète érudit (chez Arthémus, 2001) et Chez Bonclou et autres toponymes, à l’enseigne de Publie.net, 2008.
Bertrand Redonnet. Zozo, chômeur éperdu. Le Temps qu’il fait, 107 p. Du même auteur : Brassens, poète érudit (chez Arthémus, 2001) et Chez Bonclou et autres toponymes, à l’enseigne de Publie.net, 2008.





 ...Moi je dirais plutôt : Élodie, je sais bien que c’est un peu arbitraire, que ça tient à des riens, mais tu la vois sourire de profil: c’est pas Melody mais Élodie, ensuite tu la vois se cacher de face : c’est tout à fait Élodie star à la montée des marches de Cannes, enfin tu la vois, là, mutine à craquer: y a qu’une Élodie pour se la jouer comme ça femme enfant - note que j'ai jamais rencontré d’Élodie, mais tu la vois s’appeler Marcelle ou Raymonde ?...
...Moi je dirais plutôt : Élodie, je sais bien que c’est un peu arbitraire, que ça tient à des riens, mais tu la vois sourire de profil: c’est pas Melody mais Élodie, ensuite tu la vois se cacher de face : c’est tout à fait Élodie star à la montée des marches de Cannes, enfin tu la vois, là, mutine à craquer: y a qu’une Élodie pour se la jouer comme ça femme enfant - note que j'ai jamais rencontré d’Élodie, mais tu la vois s’appeler Marcelle ou Raymonde ?...
 - Votre première île lointaine est Ascension. Le contraire d’une île de rêve...
- Votre première île lointaine est Ascension. Le contraire d’une île de rêve... - En est-il une où vous avez eu envie de vous établir ?
- En est-il une où vous avez eu envie de vous établir ? La lumière et les ombres
La lumière et les ombres


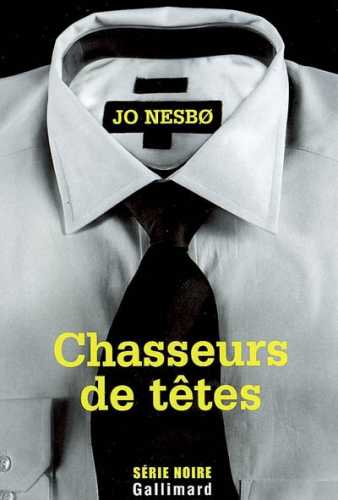


 Notes Panoptiques (5)
Notes Panoptiques (5) La lecture de Mal tiempo m’a rappelé, par contraste avec la classe de ses protagonistes, nullement angélisés au demeurant, l’abjection de ceux qui se débattent, comme des coqs camés au combat dans ce film amer et puissant du réalisateur tessinois Fulvio Bernasconi, que représente Fuori dalle corde, plongée terrifiante dans l’univers de la boxe clandestine - entre Trieste, la Croatie et la Suisse - où bascule un jeune champion qui a refusé de se soumettre au jeu truqué de son coach alors même qu’il survit difficilement. Comme dans Mal tiempo, les implications sociales et politiques de la boxe comptent dans le film, sur un arrière-fond de déliquescence et de corruption généralisée que symbolise le dernier combat à mort mené, dans la piscine vide d’un Suisse friqué, entre le « héros » à bout de course et son plus proche ami. Or, combien ils restent dignes et vaillants, malgré le poids de la dictature, les boxeurs de Mal tiempo, et combien la tristesse qui se dégage du roman reste pure, et si souillée celle du film de Fulvio Bernasconi, dont les cinéphiles distingués ont jugé le regard décidément trop noir…
La lecture de Mal tiempo m’a rappelé, par contraste avec la classe de ses protagonistes, nullement angélisés au demeurant, l’abjection de ceux qui se débattent, comme des coqs camés au combat dans ce film amer et puissant du réalisateur tessinois Fulvio Bernasconi, que représente Fuori dalle corde, plongée terrifiante dans l’univers de la boxe clandestine - entre Trieste, la Croatie et la Suisse - où bascule un jeune champion qui a refusé de se soumettre au jeu truqué de son coach alors même qu’il survit difficilement. Comme dans Mal tiempo, les implications sociales et politiques de la boxe comptent dans le film, sur un arrière-fond de déliquescence et de corruption généralisée que symbolise le dernier combat à mort mené, dans la piscine vide d’un Suisse friqué, entre le « héros » à bout de course et son plus proche ami. Or, combien ils restent dignes et vaillants, malgré le poids de la dictature, les boxeurs de Mal tiempo, et combien la tristesse qui se dégage du roman reste pure, et si souillée celle du film de Fulvio Bernasconi, dont les cinéphiles distingués ont jugé le regard décidément trop noir… Et le nouveau récit de Lieve Joris, Les Hauts Plateaux, n’est-il pas trop noir non plus s'il vous plaît ? Est-il bien indiqué, en ces premiers jours de vacances, d’évoquer la marche solitaire, au milieu de tous les dangers de celle qui, depuis Mon oncle du Congo , avec l’inoubliable Danse du léopard, puis L’Heure des rebelles, n’a cessé de revenir en cette Afrique aimée et déchirée qui aura subi, entretemps, les massacres que nous savons et dont elle a constaté les séquelles et les rebondissements ? Hélas, ce qui nous reste d’humanité cohabite de plus en plus mal avec notre confort et notre besoin estival d’évasion. Mais la vraie vie est aussi à ce prix, qui vaut bien un mojito... La vraie vie, dès la première page des Hauts Plateaux, serait celle d'André, boy de la paroisse de Minembwe, qui part un matin avec un poulet sous le bras. Pour revendre ce poulet que le curé de la paroisse lui a offert, et qui vaut trois dollars à Uvira, où il se rend précisément, André devra franchir des collines, des vallées et des marécages, des rivières et des forêts, sur une distance de quatre-vingt-dix kilomètres à vol d'oiseau. Mais André est content puisque le poulet, à Uvira, vaut un demi-dollar de plus qu'au village. Et Lieve Joris d'enchaîner: "Voilà l'économie dans laquelle je me retrouvais et, bientôt, j'entreprendrais le même voyage. Pas en quatre jours comme André, non; chemin faisant, je regarderais autour de moi et visiterais les marchés des hauts plateaux, tout en essayant de comprendre comment vivaient les gens dans cette partie inhospitalière du Congo - une région sans routes ni électricité, où la population était si réfractaire à la bureaucratie que mes ancêtres belges n'avaient pas réussi à la soumettre"...
Et le nouveau récit de Lieve Joris, Les Hauts Plateaux, n’est-il pas trop noir non plus s'il vous plaît ? Est-il bien indiqué, en ces premiers jours de vacances, d’évoquer la marche solitaire, au milieu de tous les dangers de celle qui, depuis Mon oncle du Congo , avec l’inoubliable Danse du léopard, puis L’Heure des rebelles, n’a cessé de revenir en cette Afrique aimée et déchirée qui aura subi, entretemps, les massacres que nous savons et dont elle a constaté les séquelles et les rebondissements ? Hélas, ce qui nous reste d’humanité cohabite de plus en plus mal avec notre confort et notre besoin estival d’évasion. Mais la vraie vie est aussi à ce prix, qui vaut bien un mojito... La vraie vie, dès la première page des Hauts Plateaux, serait celle d'André, boy de la paroisse de Minembwe, qui part un matin avec un poulet sous le bras. Pour revendre ce poulet que le curé de la paroisse lui a offert, et qui vaut trois dollars à Uvira, où il se rend précisément, André devra franchir des collines, des vallées et des marécages, des rivières et des forêts, sur une distance de quatre-vingt-dix kilomètres à vol d'oiseau. Mais André est content puisque le poulet, à Uvira, vaut un demi-dollar de plus qu'au village. Et Lieve Joris d'enchaîner: "Voilà l'économie dans laquelle je me retrouvais et, bientôt, j'entreprendrais le même voyage. Pas en quatre jours comme André, non; chemin faisant, je regarderais autour de moi et visiterais les marchés des hauts plateaux, tout en essayant de comprendre comment vivaient les gens dans cette partie inhospitalière du Congo - une région sans routes ni électricité, où la population était si réfractaire à la bureaucratie que mes ancêtres belges n'avaient pas réussi à la soumettre"...  Lieve Joris, Les Hauts plateaux. Actes Sud, 132p.
Lieve Joris, Les Hauts plateaux. Actes Sud, 132p.

 Un vrai goût du faux
Un vrai goût du faux 
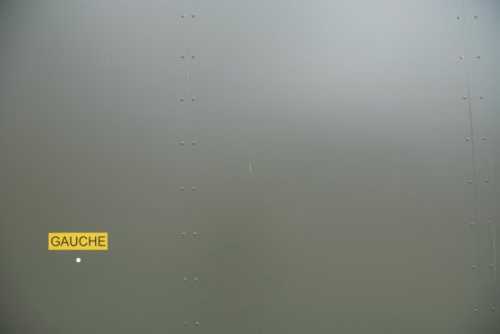
 …Little Fury tu es un amour, je ferme les yeux pour-être plus près de toi, tu as raison mon chéri, mon Schubert est un blaireau à côté du nouveau CD de Rob Zombie que tu m’as offert, il y a là-dedans un rythme revitalisant, c’est fou, surtout quand il se la pète, comme tu dis si joliment, je me sens rajeunir, tu n’as pas idée, et la prochaine fois, promis, tu me répètes ça : je vais t’en mettre une pile sur Black Sabbath - oh oui mon tout petit…
…Little Fury tu es un amour, je ferme les yeux pour-être plus près de toi, tu as raison mon chéri, mon Schubert est un blaireau à côté du nouveau CD de Rob Zombie que tu m’as offert, il y a là-dedans un rythme revitalisant, c’est fou, surtout quand il se la pète, comme tu dis si joliment, je me sens rajeunir, tu n’as pas idée, et la prochaine fois, promis, tu me répètes ça : je vais t’en mettre une pile sur Black Sabbath - oh oui mon tout petit…
 Les livres traduits en français de Vassili Axionov sont disponibles aux éditions Gallimard (L’oiseau d’acier ou Une Saga moscovite) et Actes Sud (À la Voltaire ou Terres rares), notamment.
Les livres traduits en français de Vassili Axionov sont disponibles aux éditions Gallimard (L’oiseau d’acier ou Une Saga moscovite) et Actes Sud (À la Voltaire ou Terres rares), notamment. De Michel Le Bris à Gilles Lapouge, en passant par Jean-Paul Kauffmann et Mariusz Wilk, Marguerite Yourcenar et Blaise Hofmann...
De Michel Le Bris à Gilles Lapouge, en passant par Jean-Paul Kauffmann et Mariusz Wilk, Marguerite Yourcenar et Blaise Hofmann... Michel Le Bris. Nous ne sommes pas d’ici. Grasset, 420p.
Michel Le Bris. Nous ne sommes pas d’ici. Grasset, 420p.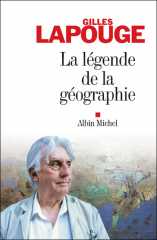 Au jardin du monde
Au jardin du monde  Rêver à la Courlande
Rêver à la Courlande Marguerite Yourcenar
Marguerite Yourcenar Blaise Hofmann
Blaise Hofmann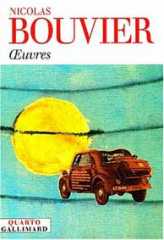 Les oeuvres de Nicolas Bouvier, richement documentées, ont fait l'objet d'un volume de la collection Quarto, chez Gallimard.
Les oeuvres de Nicolas Bouvier, richement documentées, ont fait l'objet d'un volume de la collection Quarto, chez Gallimard.







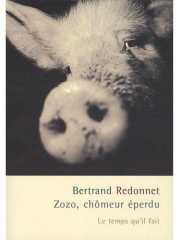


 De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un
De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un
 Pierre Michon met plus de temps, avec Les Douze, à nous ensorceler, si j’ose dire. Le soleil levant est chez lui peint au plafond et de la manière la plus baroque, dans un tourbillon d’escaliers et de personnages s’envolant vers un ciel en trompe-l’œil à la Tiepolo, on ne sait pas où en en est, on met au moins vingt pages avant de savoir qui est qui, on est en Allemagne puis au Limousin, bref on ne sait pas où on va mais on y va et voici ce qu’on lit vers les pages 47 à 49 à propos du changement de nid de Dieu, passé de la Foi aux Lettres, avec des écrivains commençant de penser (même s’il y en eut une tripotée qui pensaient comme ça bien avant eux) que la littérature n’est pas qu’une « exquise superfluité » dans la Cour des Grands, mais peut-être « un esprit – un fort conglomérat de sensibilité et de raison à jeter dans la pâte universelle pour la faire lever, un multiplicateur de l’homme, une puissance d’accroissement de l’homme comme les cornues le sont de l’or et les alambics du vin, une puissante machine à augmenter le bonheur des hommes ».
Pierre Michon met plus de temps, avec Les Douze, à nous ensorceler, si j’ose dire. Le soleil levant est chez lui peint au plafond et de la manière la plus baroque, dans un tourbillon d’escaliers et de personnages s’envolant vers un ciel en trompe-l’œil à la Tiepolo, on ne sait pas où en en est, on met au moins vingt pages avant de savoir qui est qui, on est en Allemagne puis au Limousin, bref on ne sait pas où on va mais on y va et voici ce qu’on lit vers les pages 47 à 49 à propos du changement de nid de Dieu, passé de la Foi aux Lettres, avec des écrivains commençant de penser (même s’il y en eut une tripotée qui pensaient comme ça bien avant eux) que la littérature n’est pas qu’une « exquise superfluité » dans la Cour des Grands, mais peut-être « un esprit – un fort conglomérat de sensibilité et de raison à jeter dans la pâte universelle pour la faire lever, un multiplicateur de l’homme, une puissance d’accroissement de l’homme comme les cornues le sont de l’or et les alambics du vin, une puissante machine à augmenter le bonheur des hommes ».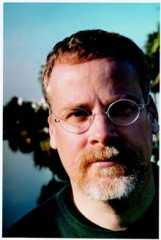 Un écrivain très sot – très feignant et très sot de nos régions, dont le nom se réduit à un prénom, a cru malin de réduire la fabrication d’un best-seller à une phrase composée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément; et de décider alors d’en composer un… qu’on attend toujours. Or j’ai plus de respect, quant à moi, pour un bon pro que pour un mauvais littérateur prétentieux. J’y repense d’ailleurs en lisant le dernier roman de Michael Connelly, Le verdict du plomb, qui est d’un écrivain de forte trempe, immense enquêteur socio-politique et bon observateur de la canaille humaine – très grand pro en un mot. Cela étant, je ne suis pas sûr que je pourrais, à fleur de peau de page, distinguer sa phrase de celle d’un autre grand pro du thriller ou du roman noir, tels un James Ellroy ou un James Lee Burke, pour citer les meilleurs, alors que trois pages de Cormac Mc Carthy (je relis ces jours L’enfant de Dieu, noir chef-d’œuvre préfigurant la désolation absolue de La Route) me suffisent à identifier cet écrivain dont tous les points de la circonférence de l’œuvre se relient incessamment au même noyau, tout à fait comme l’entendait WB…
Un écrivain très sot – très feignant et très sot de nos régions, dont le nom se réduit à un prénom, a cru malin de réduire la fabrication d’un best-seller à une phrase composée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément; et de décider alors d’en composer un… qu’on attend toujours. Or j’ai plus de respect, quant à moi, pour un bon pro que pour un mauvais littérateur prétentieux. J’y repense d’ailleurs en lisant le dernier roman de Michael Connelly, Le verdict du plomb, qui est d’un écrivain de forte trempe, immense enquêteur socio-politique et bon observateur de la canaille humaine – très grand pro en un mot. Cela étant, je ne suis pas sûr que je pourrais, à fleur de peau de page, distinguer sa phrase de celle d’un autre grand pro du thriller ou du roman noir, tels un James Ellroy ou un James Lee Burke, pour citer les meilleurs, alors que trois pages de Cormac Mc Carthy (je relis ces jours L’enfant de Dieu, noir chef-d’œuvre préfigurant la désolation absolue de La Route) me suffisent à identifier cet écrivain dont tous les points de la circonférence de l’œuvre se relient incessamment au même noyau, tout à fait comme l’entendait WB…


 AU SOMMAIRE DU No 78. Juin 2009: Claude Frochaux (ouverture inédite + entretien avec JLK + présentation de ses ouvrages) - Andrzej Stasiuk, par Bertrand Redonnet - La Bibliothèque nomédienne, par Jean-François Thomas - Cesare Pavese, par Jean Perrenoud - Owen Sheers , par Bruno Pellegrino - Alice Tawhai, par Claire julier - Matthias Zschokke, par Laurence de Coulon - Abu El Qasim Chebbi, par Jalel El Gharbi - Julien Burri, par Bruno Pellegrino - Blaise Hofmann par Jean-Michel Olivier - Jean-François Sonnay, par René Zahnd - Jil Silberstein, par Patrick Vallon - François Ascal, par JLK. Textes inédits de Miroslav Fismeister, traduit par Petr Kral, et de Françoise Ascal.
AU SOMMAIRE DU No 78. Juin 2009: Claude Frochaux (ouverture inédite + entretien avec JLK + présentation de ses ouvrages) - Andrzej Stasiuk, par Bertrand Redonnet - La Bibliothèque nomédienne, par Jean-François Thomas - Cesare Pavese, par Jean Perrenoud - Owen Sheers , par Bruno Pellegrino - Alice Tawhai, par Claire julier - Matthias Zschokke, par Laurence de Coulon - Abu El Qasim Chebbi, par Jalel El Gharbi - Julien Burri, par Bruno Pellegrino - Blaise Hofmann par Jean-Michel Olivier - Jean-François Sonnay, par René Zahnd - Jil Silberstein, par Patrick Vallon - François Ascal, par JLK. Textes inédits de Miroslav Fismeister, traduit par Petr Kral, et de Françoise Ascal.