
Marcel Aymé connaissait bien les hommes, dont il se méfiait avec tendresse.
Avant le mémorable affrontement entre la nation poldève et le peuple molleton dont chacun se souvient de la guerre meurtrière qui en découla, il avait relevé que les deux grands Etats «avaient d’autant moins de chances de s’entendre qu’ils avaient raison tous les deux».
Les lecteurs attentifs (il en reste au fond de l’avion) se rappellent évidemment cette nouvelle, intitulée Légende poldève, où l’on voyait une vieille demoiselle de grande piété et virginité, dépitée par l’inconduite de son vaurien de neveu orphelin, qu’elle avait pourtant chaperonné tant et plus, se faire sauver par lui au paradis, lorsqu’ils y arrivaient ensemble, elle de mort naturelle et lui en tant que jeune hussard crevé au champ d’honneur. Tandis que piétinaient les milliers de troufions à la porte du saint lieu, le jeune Bobislas, avisant sa chère «vioque» dans la foule bloquée, la prenait en effet en croupe et la faisait passer devant saint Pierre au titre de «catin du régiment». Or, cette céleste entourloupe consommait, en un geste généreux, l’antimilitarisme naturel et l’anticléricalisme familial d’un écrivain rétif à vrai dire à tous les «ismes» et si peu soucieux de reconnaissance officielle qu’il pria, lorsque le président de la République Vincent Auriol le menaça de lui décerner la Légion d’honneur, de se la «carrer dans le train».
Longtemps Marcel Aymé passa, surtout aux yeux des mandarins littéraires, pour un littérateur charmant, mais en somme de seconde zone, dont le succès public devait beaucoup à ses contes pour enfants ou aux gauloiseries d’une certaine jument verte. Le bon peuple de ses lecteurs, quant à lui, n’a pas attendu la publication de ses oeuvres sous reliure «pleine peau dorée à l’or fin 23 carats», à l’enseigne de la Pléiade, pour se reconnaître dans la cohorte de braves gens et de coquins divers en lequel le professeur Michel Lecureur, grand ordonnateur de ladite édition, voit justement une «Comédie humaine du XXe siècle». De fait, sous couleur de fantaisie et d’humour, sur fond plutôt noir, l’oeuvre de Marcel Aymé est non seulement d’un grand conteur et d’un moraliste que Jean Anouilh eut raison de dire un moderne La Fontaine: il est aussi d’un observateur inlassable de l’humanité des champs (rappelons que ses premiers livres plongent leurs racines dans l’âpre et magique terre jurassienne de Brûlebois et de La vouivre) et des villes (il élut domicile à Montmartre, comme se le rappellent les descendants de poulbots du XVIIIe arrondissement), et rien de ce qui est humain ne fut étranger à ce franc-tireur aussi courageux que fragile de santé, qui défendit la liberté d’expression comme personne (ainsi lutta-t-il indifféremment pour sauver des confrères d’extrême-droite ou d’extrême gauche de la peine de mort ou de l’épuration et autres chasses aux sorcières) et modula par écrit toutes les nuances du comportement humain, de l’abjection à la sainteté.
On parle aujourd’hui de Marcel Aymé comme d’un «classique» du XXe siècle, son style suivant en effet ce qu’on peut dire la «ligne claire» de notre langue, en ceci tout à fait différent de son compère Céline, refondateur d’une langue à grand brassage et musique inouïe. Pourtant on ne voudrait pas oublier les inventions constantes et les trouvailles à chaque page, de formulation ou d’imagination, d’un écrivain dont le bon sens terrien n’excluait pas le génie artiste. Ses nouvelles, aujourd’hui réunies selon l’ordre chronologique de leur composition, dans un pavé de 1366 pages, en témoignent plus encore que ses romans.
Du jeune auteur encore tâtonnant (la première nouvelle, Et le monde continua, datée de 1927, relate l’étonnant plaidoyer du Fils «espoir des hommes» auprès de Dieu tout décidé à en finir avec Satan, donc avec le monde...), au conteur plus sûr du Puits aux images (1932) et du Nain (1934) ou des Contes du chat perché (1934), nous voyons l’art du conteur s’affiner et se diversifier avec le superbe recueil trop peu connu de Derrière chez Martin (1938), le fameux Passe-Muraille (1943) et le plus sombre Vin de Paris (1947), ou enfin le décapant En arrière (1950), dans lequel la critique du conformisme de l’anticonformisme fait écho à l’essai intitulé Le confort intellectuel (1949), dont la (re)lecture fera ressentir à quel point Marcel Aymé nous manque à l’heure du politiquement correct et de la traque anti-fumeurs...
Marcel Aymé. Nouvelles complètes. Gallimard, coll. Quarto, 1366pp.
A lire aussi: Michel Lecureur. La comédie humaine de Marcel Aymé. La Manufacture, 1985.






 Les fruits amers de la puissance
Les fruits amers de la puissance

 « Quand je serai moins bête
« Quand je serai moins bête

 La mémoire tragique du XXe siècle revit à travers la figure lumineuse d’Alexandre Soljenitsyne. La fondation Martin Bodmer, à Genève, patronne une exposition et un livre admirables, sous la direction de Natalia Soljenitsyne et Georges Nivat.
La mémoire tragique du XXe siècle revit à travers la figure lumineuse d’Alexandre Soljenitsyne. La fondation Martin Bodmer, à Genève, patronne une exposition et un livre admirables, sous la direction de Natalia Soljenitsyne et Georges Nivat. La présence de cette bonne fée, mère de trois fils dignes de leur paternel, est particulièrement visible dans les corrections successives des feuillets préparatoires
La présence de cette bonne fée, mère de trois fils dignes de leur paternel, est particulièrement visible dans les corrections successives des feuillets préparatoires
 …Elle a toujours tiré à droite et son chien à gauche : je veux dire : ses chiens, ses chiens et ses hommes, depuis son premier chien et son premier homme ç’a été la tendance, mais ça peut évoluer, on est surpris dans la vie, des fois qu’elle épouserait un homme de droite et qu’elle tombe sur un chien pas comme les autres, chiche qu’elle pourrait tirer « à gauche »…
…Elle a toujours tiré à droite et son chien à gauche : je veux dire : ses chiens, ses chiens et ses hommes, depuis son premier chien et son premier homme ç’a été la tendance, mais ça peut évoluer, on est surpris dans la vie, des fois qu’elle épouserait un homme de droite et qu’elle tombe sur un chien pas comme les autres, chiche qu’elle pourrait tirer « à gauche »…


 À propos de La Tête des gens, de Jean-François Schwab
À propos de La Tête des gens, de Jean-François Schwab



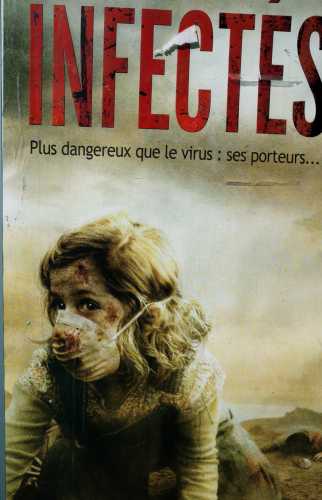

 La vraie peinture, comme la vraie littérature, se font à la fois par le travail continu et par le désir intense que celui-ci entretient quand on ne travaille pas, les yeux fermés…
La vraie peinture, comme la vraie littérature, se font à la fois par le travail continu et par le désir intense que celui-ci entretient quand on ne travaille pas, les yeux fermés… La grande question que nous pose le Céline des pamphlets, souligne justement Henri Godard dans sa nouvelle somme (parue ces jours chez Gallimard), bien au-delà de son antisémitisme d’époque, est celle que nous pose sa haine, qui recoupe la haine actuelle se déployant tous azimuts dans tous les rejets de tous les racismes, et qui fait cet homme tellement humain et fraternel basculer dans l’abjection. Or, Henri Godard a mille fois raison de ne pas séparer les pamphlets du reste de l’œuvre. Ils sont là et ils doivent y rester. Le ressentiment de Céline a une histoire et Godard la suit pas à pas de l’enfance à la guerre et de l’Afrique aux prisons du Danemark, sans cesser d’interroger les romans et les lettres de l’écrivain, non seulement ses contradictions fameuses mais cette espèce de fascination vertigineuse qui le fait augmenter son mal par un mal plus grand et que nul ne saurait juger sans le prendre tout entier, par delà la jouissance du texte et les plus troubles plaisirs de la haine relancée par le lecteur lui-même…
La grande question que nous pose le Céline des pamphlets, souligne justement Henri Godard dans sa nouvelle somme (parue ces jours chez Gallimard), bien au-delà de son antisémitisme d’époque, est celle que nous pose sa haine, qui recoupe la haine actuelle se déployant tous azimuts dans tous les rejets de tous les racismes, et qui fait cet homme tellement humain et fraternel basculer dans l’abjection. Or, Henri Godard a mille fois raison de ne pas séparer les pamphlets du reste de l’œuvre. Ils sont là et ils doivent y rester. Le ressentiment de Céline a une histoire et Godard la suit pas à pas de l’enfance à la guerre et de l’Afrique aux prisons du Danemark, sans cesser d’interroger les romans et les lettres de l’écrivain, non seulement ses contradictions fameuses mais cette espèce de fascination vertigineuse qui le fait augmenter son mal par un mal plus grand et que nul ne saurait juger sans le prendre tout entier, par delà la jouissance du texte et les plus troubles plaisirs de la haine relancée par le lecteur lui-même… Jean Dutourd me disait un jour qu’une idée notée est une idée perdue, mais je l’entends tout autrement pour ma part, à savoir qu’une idée notée est une idée en passe d’être travaillée et qu’elle procède donc d’une transmutation féconde, comme une journée notée peut être dite (c’est Paul Léautaud qui le disait) vécue deux fois. Cela n’invalide pas pour autant l’opinion de Jean Dutourd, qui s’exprimait en romancier ou en chroniqueur pressé craignant d’être freiné par la note, mais après tout chacun ses pratiques et formules, d’ailleurs amovibles ou à géométrie variable. Tout noter, à mes yeux, n’est pas tout figer mais tout sensibiliser.
Jean Dutourd me disait un jour qu’une idée notée est une idée perdue, mais je l’entends tout autrement pour ma part, à savoir qu’une idée notée est une idée en passe d’être travaillée et qu’elle procède donc d’une transmutation féconde, comme une journée notée peut être dite (c’est Paul Léautaud qui le disait) vécue deux fois. Cela n’invalide pas pour autant l’opinion de Jean Dutourd, qui s’exprimait en romancier ou en chroniqueur pressé craignant d’être freiné par la note, mais après tout chacun ses pratiques et formules, d’ailleurs amovibles ou à géométrie variable. Tout noter, à mes yeux, n’est pas tout figer mais tout sensibiliser.  Milan Kundera s’est efforcé de couper court à tout aveu personnel dans son œuvre, comme à tout investissement de type autobiographique, ce qui ne me dérange pas plus que ça ne m’en impose. Mais l’homme Kundera n’en est pas moins sûrement omniprésent dans ses romans autant que dans ses essais. À ce propos, les auteurs qui voient une supériorité dans le genre même du roman, par rapport aux écrits autobiographiques et autres autofictions (terme actuel plus chic) me font sourire, car nombre d’entre eux, incapables de composer de vrais romans (ce que fait à l’évidence un Kundera) se contentent en somme d’appeler romans des récits dont ils sont les protagonistes (je pense autant à Philippe Sollers qu’à Jacques Chessex, entre bien d’autres), quand ce ne sont pas des carnets et autres journaux « extimes »…
Milan Kundera s’est efforcé de couper court à tout aveu personnel dans son œuvre, comme à tout investissement de type autobiographique, ce qui ne me dérange pas plus que ça ne m’en impose. Mais l’homme Kundera n’en est pas moins sûrement omniprésent dans ses romans autant que dans ses essais. À ce propos, les auteurs qui voient une supériorité dans le genre même du roman, par rapport aux écrits autobiographiques et autres autofictions (terme actuel plus chic) me font sourire, car nombre d’entre eux, incapables de composer de vrais romans (ce que fait à l’évidence un Kundera) se contentent en somme d’appeler romans des récits dont ils sont les protagonistes (je pense autant à Philippe Sollers qu’à Jacques Chessex, entre bien d’autres), quand ce ne sont pas des carnets et autres journaux « extimes »…

 La photo n’a rien à voir avec la peinture, j’entends : même la vraie photo, avec la vraie peinture. La peinture qui reste de la photo ne m’intéresse pas, moins même que la photo, qui en dit souvent plus que la peinture en terme d’image, mais il me semble que la peinture, j’entends la vraie peinture (disons jusqu’à Nicolas de Staël et ensuite celle de quelques-uns seulement de plus en plus rares) surpassera toujours la photo en terme de perception totale, par tout ce qui fait notre corps physique et spirituel, et de diffusion par la forme dépassant les formes…
La photo n’a rien à voir avec la peinture, j’entends : même la vraie photo, avec la vraie peinture. La peinture qui reste de la photo ne m’intéresse pas, moins même que la photo, qui en dit souvent plus que la peinture en terme d’image, mais il me semble que la peinture, j’entends la vraie peinture (disons jusqu’à Nicolas de Staël et ensuite celle de quelques-uns seulement de plus en plus rares) surpassera toujours la photo en terme de perception totale, par tout ce qui fait notre corps physique et spirituel, et de diffusion par la forme dépassant les formes…  Ce film, ce livre relève-t-il de l’érotisme ou de la pornographie ?
Ce film, ce livre relève-t-il de l’érotisme ou de la pornographie ?



 - Mais qui êtes-vous donc, jeune fille ?
- Mais qui êtes-vous donc, jeune fille ? - Qu’est-ce que cet «être de langage» que vous dites être ?
- Qu’est-ce que cet «être de langage» que vous dites être ?  Aude Seigne. Chroniques de l’Occident nomade. Editions Paulette, 133p.
Aude Seigne. Chroniques de l’Occident nomade. Editions Paulette, 133p. 