 On entre dans le dernier roman de David Grossman, Une femme fuyant l'annonce, comme dans un labyrinthe nocturne dans lequel s'entrecroisent les voix de trois jeunes gens menacés par la maladie et la guerre. Ces séquences d'une sorte de théâtre de la mémoire sont datées 1967, où apparaissent les protagonistes du roman: Ora, Avram et Ilan.
On entre dans le dernier roman de David Grossman, Une femme fuyant l'annonce, comme dans un labyrinthe nocturne dans lequel s'entrecroisent les voix de trois jeunes gens menacés par la maladie et la guerre. Ces séquences d'une sorte de théâtre de la mémoire sont datées 1967, où apparaissent les protagonistes du roman: Ora, Avram et Ilan.
Or, m'engageant dans cette lecture lente et fascinante par son imprégnation intime, je viens de retrouver cette lettre bouleversante adressée par l'écrivain à son fils défunt, tué en août 2006 sur le front de la sale guerre au Liban.
"Notre famille a perdu la guerre"
par David Grossman
 Mon cher Uri,
Mon cher Uri,
Voilà trois jours que presque chacune de nos pensées commence par une
négation. Il ne viendra plus, nous ne parlerons plus, nous ne rirons plus.
Il ne sera plus là, ce garçon au regard ironique et à l'extraordinaire sens
de l'humour. Il ne sera plus là, le jeune homme à la sagesse bien plus
profonde qu'elle ne l'est à cet âge, au sourire chaleureux, à l'appétit
plein de santé. Elle ne sera plus, cette rare combinaison de détermination
et de délicatesse. Absents désormais, son bon sens et son bon coeur.
Nous n'aurons plus l'infinie tendresse d'Uri, et la tranquillité avec
laquelle il apaisait toutes les tempêtes. Nous ne regarderons plus ensemble
les Simpson ou Seinfeld, nous n'écouterons plus avec toi Johnny Cash et nous
ne sentirons plus ton étreinte forte. Nous ne te verrons plus marcher et
parler avec ton frère aîné Yonatan en gesticulant avec fougue, et nous ne te
verrons plus embrasser ta petite soeur Ruti que tu aimais tant.
Uri, mon amour, pendant toute ta brève existence, nous avons tous appris de
toi. De ta force et de ta détermination à suivre ta voie, même sans
possibilité de réussite. Nous avons suivi, stupéfaits, ta lutte pour être
admis à la formation des chefs de char. Tu n'as pas cédé à l'avis de tes
supérieurs, car tu savais pouvoir faire un bon chef et tu n'étais pas
disposé à donner moins que ce dont tu étais capable. Et quand tu y es
arrivé, j'ai pensé : voilà un garçon qui connaît de manière si simple et si
lucide ses possibilités. Sans prétention, sans arrogance. Qui ne se laisse
pas influencer par ce que les autres disent de lui. Qui trouve la force en
lui-même.
Depuis ton enfance, tu étais déjà comme ça. Tu vivais en harmonie avec
toi-même et avec ceux qui t'entouraient. Tu savais quelle était ta place, tu
étais conscient d'être aimé, tu connaissais tes limites et tes vertus. Et en
vérité, après avoir fait plier toute l'armée et avoir été nommé chef de
char, il est apparu clairement quel type de chef et d'homme tu étais. Et
aujourd'hui, nous écoutons tes amis et tes soldats parler du chef et de
l'ami, celui qui se levait le premier pour tout organiser et qui n'allait se
coucher que quand les autres dormaient déjà.
Et hier, à minuit, j'ai contemplé la maison, qui était plutôt en désordre
après que des centaines de personnes étaient venues nous rendre visite pour
nous consoler, et j'ai dit : il faudrait qu'Uri soit là pour nous aider à
ranger.
Tu étais le gauchiste de ton bataillon, mais tu étais respecté, parce que tu
restais sur tes positions sans renoncer à aucun de tes devoirs militaires.
Je me souviens que tu m'avais expliqué ta "politique des barrages
militaires", parce que toi aussi, tu y avais passé pas mal de temps, sur ces
barrages. Tu disais que s'il y avait un enfant dans la voiture que tu venais
d'arrêter, tu cherchais avant tout à le tranquilliser et à le faire rire. Et
tu te rappelais ce garçonnet plus ou moins de l'âge de Ruti, et la peur que
tu lui faisais, et combien il te détestait, avec raison. Pourtant tu faisais
ton possible pour lui rendre plus facile ce moment terrible, tout en
accomplissant ton devoir, sans compromis.
Quand tu es parti pour le Liban, ta mère a dit que la chose qu'elle
redoutait le plus c'était ton "syndrome d'Elifelet". Nous avions très peur
que, comme l'Elifelet de la chanson, tu te précipites au milieu de la
mitraille pour sauver un blessé, que tu sois le premier à te porter
volontaire pour le
réapprovisionnement-des-munitions-épuisées-depuis-longtemps. Et que là-haut,
au Liban, dans cette guerre si dure, tu ne te comportes comme tu l'avais
fait toute ta vie, à la maison, à l'école et au service militaire, proposant
de renoncer à une permission parce qu'un autre soldat en avait plus besoin
que toi, ou parce que tel autre avait chez lui une situation plus difficile.
Tu étais pour moi un fils et un ami. Et c'était la même chose pour ta maman.
Notre âme est liée à la tienne. Tu vivais en paix avec toi-même, tu étais de
ces personnes auprès de qui il fait bon être. Je ne suis même pas capable de
dire à haute voix à quel point tu étais pour moi "quelqu'un avec qui courir"
(titre d'un des derniers romans de ).
Chaque fois que tu rentrais en permission, tu disais : viens, papa, qu'on
parle. Habituellement, nous allions nous asseoir et discuter dans un
restaurant. Tu me racontais tellement de choses, Uri, et j'étais fier
d'avoir l'honneur d'être ton confident, que quelqu'un comme toi m'ait
choisi.
Je me souviens de ton incertitude, une fois, à l'idée de punir un soldat qui
avait enfreint la discipline. Combien tu as souffert parce que cette
décision allait mettre en rage ceux qui étaient sous tes ordres et les
autres chefs, bien plus indulgents que toi devant certaines infractions.
Punir ce soldat t'a effectivement coûté beaucoup du point de vue des
rapports humains, mais cet épisode précis s'est ensuite transformé en l'une
des histoires cardinales de l'ensemble du bataillon, établissant certaines
normes de comportement et de respect des règles. Et lors de ta dernière
permission, tu m'as raconté, avec une fierté timide, que le commandant du
bataillon, pendant une conversation avec quelques officiers nouvellement
arrivés, avait cité ta décision en exemple de comportement juste de la part
d'un chef.
Tu as illuminé notre vie, Uri. Ta mère et moi, nous t'avons élevé avec
amour. C'était si facile de t'aimer de tout notre coeur, et je sais que toi
aussi tu étais bien. Que ta courte vie a été belle. J'espère avoir été un
père digne d'un fils tel que toi. Mais je sais qu'être le fils de Michal
l'épouse de veut dire grandir avec une générosité, une grâce et un amour
infini, et tu as reçu tout cela. Tu l'as reçu en abondance et tu as su
l'apprécier, tu as su remercier, et rien de ce que tu as reçu n'était un dû
à tes yeux.
En ces moments, je ne dirai rien de la guerre dans laquelle tu as été tué.
Nous, notre famille, nous l'avons déjà perdue. Israël, à présent, va faire
son examen de conscience, et nous nous renfermerons dans notre douleur,
entourés de nos bons amis, abrités par l'amour immense de tant de gens que
pour la plupart nous ne connaissons pas, et que je remercie pour leur
soutien illimité.
Je voudrais tant que nous sachions nous donner les uns aux autres cet amour
et cette solidarité à d'autres moments aussi. Telle est peut-être notre
ressource nationale la plus particulière. C'est là notre grande richesse
naturelle. Je voudrais tant que nous puissions nous montrer plus sensibles
les uns envers les autres. Que nous puissions nous délivrer de la violence
et de l'inimitié qui se sont infiltrées si profondément dans tous les
aspects de nos vies. Que nous sachions nous raviser et nous sauver
maintenant, juste au dernier moment, car des temps très durs nous attendent.
Je voudrais dire encore quelques mots. Uri était un garçon très israélien.
Son nom même est très israélien et hébreu. Uri était un condensé de
l'israélianité telle que j'aimerais la voir. Celle qui est désormais presque
oubliée. Qui est souvent considérée comme une sorte de curiosité.
Parfois, en le regardant, je pensais que c'était un jeune homme un peu
anachronique. Lui, Yonatan et Ruti. Des enfants des années 1950. Uri, avec
son honnêteté totale et sa façon d'assumer la responsabilité de tout ce qui
se passait autour de lui. Uri, toujours "en première ligne", sur qui on
pouvait compter. Uri avec sa profonde sensibilité envers toutes les
souffrances, tous les torts. Et capable de compassion. Ce mot me faisait
penser à lui chaque fois qu'il me venait à l'esprit.
C'était un garçon qui avait des valeurs, terme tant galvaudé et tourné en
dérision ces dernières années. Car dans notre monde dément, cruel et
cynique, il n'est pas "cool" d'avoir des valeurs. Ou d'être humaniste. Ou
sensible à la détresse d'autrui, même si autrui est ton ennemi sur le champ
de bataille.
Mais j'ai appris d'Uri que l'on peut et l'on doit être tout cela à la fois.
Que nous devons certes nous défendre. Mais ceci dans les deux sens :
défendre nos vies, mais aussi s'obstiner à protéger notre âme, s'obstiner à
la préserver de la tentation de la force et des pensées simplistes, de la
défiguration du cynisme, de la contamination du coeur et du mépris de
l'individu qui sont la vraie, grande malédiction de ceux qui vivent dans une
zone de tragédie comme la nôtre.
Uri avait simplement le courage d'être lui-même, toujours, quelle que soit
la situation, de trouver sa voix précise en tout ce qu'il disait et faisait,
et c'est ce qui le protégeait de la contamination, de la défiguration et de
la dégradation de l'âme.
Uri était aussi un garçon amusant, d'une drôlerie et d'une sagacité
incroyables, et il est impossible de parler de lui sans raconter certaines
de ses "trouvailles". Par exemple, quand il avait 13 ans, je lui dis :
imagine que toi et tes enfants puissiez un jour aller dans l'espace comme
aujourd'hui nous allons en Europe. Il me répondit en souriant : "L'espace ne
m'attire pas tellement, on trouve tout sur la Terre."
Une autre fois, en voiture, Michal et moi parlions d'un nouveau livre qui
avait suscité un grand intérêt et nous citions des écrivains et des
critiques. Uri, qui devait avoir neuf ans, nous interpella de la banquette
arrière : "Eh les élitistes, je vous prie de noter que vous avez derrière
vous un simplet qui ne comprend rien à ce que vous dites !"
Ou par exemple, Uri qui aimait beaucoup les figues, tenant une figue sèche à
la main : "Dis papa, les figues sèches c'est celles qui ont commis un péché
dans leur vie antérieure ?"
Ou encore, une fois que j'hésitais à accepter une invitation au Japon :
"Comment pourrais-tu refuser ? Tu sais ce que ça veut dire d'habiter le seul
pays où il n'y a pas de touristes japonais ?"
Chers amis, dans la nuit de samedi à dimanche à trois heures moins vingt, on
a sonné à notre porte et dans l'interphone et un officier s'est annoncé. Je
suis allé ouvrir et j'ai pensé ça y est : la vie est finie.
Mais cinq heures après, quand Michal et moi sommes rentrés dans la chambre
de Ruti et l'avons réveillée pour lui donner la terrible nouvelle, Ruti,
après les premières larmes, a dit : "Mais nous vivrons n'est-ce pas ? Nous
vivrons et nous nous promènerons comme avant. Je veux continuer à chanter
dans la chorale, à rire comme toujours, à apprendre à jouer de la guitare."
Nous l'avons étreinte et nous lui avons dit que nous allions vivre et Ruti a
dit aussi : "Quel trio extraordinaire nous étions Yonatan, Uri et moi."
Et c'est vrai que vous êtes extraordinaires. Yonatan, toi et Uri vous
n'étiez pas seulement frères, mais amis de coeur et d'âme. Vous aviez un
monde à vous, un langage à vous et un humour à vous. Ruti, Uri t'aimait de
toute son âme. Avec quelle tendresse il s'adressait à toi. Je me rappelle
son dernier coup de téléphone, après avoir exprimé son bonheur qu'un
cessez-le-feu ait été proclamé par l'ONU, il a insisté pour te parler. Et tu
as pleuré, après. Comme si tu savais déjà.
Notre vie n'est pas finie. Nous avons seulement subi un coup très dur. Nous
trouverons la force pour le supporter, en nous-mêmes, dans le fait d'être
ensemble, moi, Michal et nos enfants et aussi le grand-père et les
grands-mères qui aimaient Uri de tout leur coeur - ils l'appelaient Neshumeh
(ma petite âme) - et les oncles, tantes et cousins, et ses nombreux amis de
l'école et de l'armée qui nous suivent avec appréhension et affection.
Et nous trouverons la force aussi dans Uri. Il possédait des forces qui nous
suffiront pour de nombreuses années. La lumière qu'il projetait - de vie, de
vigueur, d'innocence et d'amour - était si intense qu'elle continuera à nous
éclairer même après que l'astre qui la produisait s'est éteint. Notre amour,
nous avons eu le grand privilège d'être avec toi, merci pour chaque moment
où tu as été avec nous.
Papa, maman, Yonatan et Ruti.
Auteur d'une douzaine de romans traduits dans le monde entier, David
Grossman est l'une des figures les plus marquantes de la littérature
israélienne.
Né à Jérusalem en 1954, David Grossman s'est rendu célèbre avec sa première oeuvre, Le Vent jaune, dans laquelle il décrivait les souffrances imposées par l'occupation militaire israélienne aux Palestiniens.
Quelques jours avant la mort de son fils, il avait lancé, avec les écrivains Amos Oz et A. B. Yehoshua, d'abord dans une tribune publiée par Haaretz,puis lors d'une conférence de presse, un appel au gouvernement israélien pour qu'il mette fin aux opérations militaires au Liban. Les trois hommes de lettres, considérés comme proches du "camp de la paix", avaient soutenu la riposte à l'attaque du Hezbollah, mais estimaient inutile l'extension de l'offensive décidée le 9 août.
Principaux ouvrages de David Grossman en français (tous publiés au Seuil) : J'écoute mon corps (2005) ; L'Enfant zigzag (2004) ; Quelqu'un avec qui courir (2003) ; Chroniques d'une paix différée (avec Jean-Luc Allouche, 2003) ; Tu seras mon couteau (2000) ; Voir ci-dessous amour (1991) ; Le Vent jaune (1988).





 Rien, au demeurant, de pédagogiquement » ou « politiquement » didactique dans le regard que Basil porte sur ces réalités. De toute évidence, ce qu'il cherche est une présence humaine dans sa nudité et sa crudité, une pâte qu'il puisse travailler au corps avec son âme d'artiste. Ainsi du personnage de Nuvem, Nuage en français: Nuvem le glandeur naïf de ce bidonville créole, qui pourrait être documenté comme un « cas social ». Mais Basil en fait plutôt le sujet d'un conte initiatique doux et dur. Nuvem le minable part en effet pour pêcher un poisson-lune, seul moyen lui a-t-on dit de conquérir le cœur de la belle serveuse noire qui le snobe. Egalement rejeté par les malfrats du bidonville qu'il a provoqués, accablé de reproches par sa mère, moqué par les rappeurs de la zone, Nuvem finira par prendre la mer comme on dit que la mer prend l'eau. D'une première série de plans, toute douceur et dureté mêlées, évoquant son rejet par la belle serveuse dans un subtil mouvement tournant de la caméra (tenue par Basil lui-même), aux images finales du départ de Nuvem vers quel ailleurs marin, une poésie prenante s'ajoute à cette vie de chien errant dans un climat crépusculaire qui fait l'économie de toute profondeur de champ. Mais où Basil Da Cunha a-t-il « pêché » tout ça ? À quelle « école » a-t-il été formé ?
Rien, au demeurant, de pédagogiquement » ou « politiquement » didactique dans le regard que Basil porte sur ces réalités. De toute évidence, ce qu'il cherche est une présence humaine dans sa nudité et sa crudité, une pâte qu'il puisse travailler au corps avec son âme d'artiste. Ainsi du personnage de Nuvem, Nuage en français: Nuvem le glandeur naïf de ce bidonville créole, qui pourrait être documenté comme un « cas social ». Mais Basil en fait plutôt le sujet d'un conte initiatique doux et dur. Nuvem le minable part en effet pour pêcher un poisson-lune, seul moyen lui a-t-on dit de conquérir le cœur de la belle serveuse noire qui le snobe. Egalement rejeté par les malfrats du bidonville qu'il a provoqués, accablé de reproches par sa mère, moqué par les rappeurs de la zone, Nuvem finira par prendre la mer comme on dit que la mer prend l'eau. D'une première série de plans, toute douceur et dureté mêlées, évoquant son rejet par la belle serveuse dans un subtil mouvement tournant de la caméra (tenue par Basil lui-même), aux images finales du départ de Nuvem vers quel ailleurs marin, une poésie prenante s'ajoute à cette vie de chien errant dans un climat crépusculaire qui fait l'économie de toute profondeur de champ. Mais où Basil Da Cunha a-t-il « pêché » tout ça ? À quelle « école » a-t-il été formé ? Basil Da Cunha, Nuvem (Le poisson lune). DVD disponible, édité par Thera Production.
Basil Da Cunha, Nuvem (Le poisson lune). DVD disponible, édité par Thera Production.


 Celle qui n’aimait pas le braillard de fin de soirée / Ceux qui lui ont tout pardonné sans raison précise / Celui qui l’entendait maugréer « intense activité littéraire, intense activité littéraire, intense activité littéraire» en arpentant le dédale de son antre / Ceux qui l’ont mis en demeure de dégager les lieux en sorte de les gérer à meilleur compte / Celui qui affirme que son père est à présent « dans la paix » / Celle qui pleure son papa / Ceux qu’il continuera longtemps de vivifier par la pensée / Celui qui se rappelle la soirée passée à lire le tapuscrit de La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic et l'extrême émotion partagée de la dernière page / Celle qui le houspillait comme un sale fils de cinquante-trois ans / Ceux qui le redoutaient / Celui qui se rappelle leur première visite à Pierre Gripari dans son hôtel pisseux du XIIIe / Celle qui lui tenait tête en public et même en privé / Ceux qui l'ont fui pour rester libre / Celui qui a fait son procès public pour se faire bien voir de son amie croate / Celle qui ne lui a pas pardonné d'avoir défilé avec l'étoile jaune en assimilant la cause serbe au martyre du peuple juif / Ceux qui invoquent l'épaisseur de l'Histoire / Celui qui s'est violemment fâché contre lui quand il a pris la défense de Martin Heidegger au prétexte qu'un philosophe ne peut se juger à ses opinions / Celle qui ne lui en a jamais voulu d'avoir égaré son manuscrit d'un recueil de poèmes ésotériques / Ceux qui le tapaient devant l'église Saint-Sulpice / Celui qui se rappelle ce que lui avait dit le bedeau de Saint-Sulpice à propos du goût de miel de l'hostie / Celle qui l'a vu un soir plus que seul sur un banc de métro / Ceux qui aimaient bien le voir revenir en Belgique avec son côté belge / Celui qui lui a racinté sa vie dans les jardins de la clinique où ils commençaient tous deux de marcher / Celle qui estime que c'était un vampire point barre / Ceux qui appréciaient sa grande pudeur /
Celle qui n’aimait pas le braillard de fin de soirée / Ceux qui lui ont tout pardonné sans raison précise / Celui qui l’entendait maugréer « intense activité littéraire, intense activité littéraire, intense activité littéraire» en arpentant le dédale de son antre / Ceux qui l’ont mis en demeure de dégager les lieux en sorte de les gérer à meilleur compte / Celui qui affirme que son père est à présent « dans la paix » / Celle qui pleure son papa / Ceux qu’il continuera longtemps de vivifier par la pensée / Celui qui se rappelle la soirée passée à lire le tapuscrit de La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic et l'extrême émotion partagée de la dernière page / Celle qui le houspillait comme un sale fils de cinquante-trois ans / Ceux qui le redoutaient / Celui qui se rappelle leur première visite à Pierre Gripari dans son hôtel pisseux du XIIIe / Celle qui lui tenait tête en public et même en privé / Ceux qui l'ont fui pour rester libre / Celui qui a fait son procès public pour se faire bien voir de son amie croate / Celle qui ne lui a pas pardonné d'avoir défilé avec l'étoile jaune en assimilant la cause serbe au martyre du peuple juif / Ceux qui invoquent l'épaisseur de l'Histoire / Celui qui s'est violemment fâché contre lui quand il a pris la défense de Martin Heidegger au prétexte qu'un philosophe ne peut se juger à ses opinions / Celle qui ne lui en a jamais voulu d'avoir égaré son manuscrit d'un recueil de poèmes ésotériques / Ceux qui le tapaient devant l'église Saint-Sulpice / Celui qui se rappelle ce que lui avait dit le bedeau de Saint-Sulpice à propos du goût de miel de l'hostie / Celle qui l'a vu un soir plus que seul sur un banc de métro / Ceux qui aimaient bien le voir revenir en Belgique avec son côté belge / Celui qui lui a racinté sa vie dans les jardins de la clinique où ils commençaient tous deux de marcher / Celle qui estime que c'était un vampire point barre / Ceux qui appréciaient sa grande pudeur /  Celui qui se rappelle son récit du premier jour de sa petite entreprise consacrée à balayer les locaux comme la novice débarquant au couvent de Sainte Thérèse enfin tu vois le genre / Celle qui a préféré parler d'autre chose quand il insultait les Musulmans de Bosnie / Ceux qui se sont éloignés de lui pour se protéger sans espérer le protéger de lui-même / Celui qui ne lui passait rien / Celle qui lui passait tout / Ceux qui changeaient de trottoir à son approche / Celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est vraiment la fidélité en amitié sans conclure à vrai dire / Celle qu'amusait son côté despote dont elle se fichait en le singeant / Ceux qui pensaient "Comédie humaine" en l'observant / Celui que son hybris faisait l'apparenter aux bâtisseurs paranos / Celle qui l'a mise en garde contre l'auto-destruction dostoïevskienne / Ceux qui le croisaient tous les midis au Milk Bar / Celui qu'il a soutenu en dépit (ou à cause) de sa dépendance grave à la dope / Celle qui l'appelait mon petit Oblomov / Ceux qui n'en auront jamais fait le tour et qui n'en demandent d'ailleurs pas tant / Celui qui se méfiait de sa cruauté émotive / Celle qui l'aimait en dépit de sa muflerie / Ceux qui ne toucheront pas au secret de l'ami disparu, etc.
Celui qui se rappelle son récit du premier jour de sa petite entreprise consacrée à balayer les locaux comme la novice débarquant au couvent de Sainte Thérèse enfin tu vois le genre / Celle qui a préféré parler d'autre chose quand il insultait les Musulmans de Bosnie / Ceux qui se sont éloignés de lui pour se protéger sans espérer le protéger de lui-même / Celui qui ne lui passait rien / Celle qui lui passait tout / Ceux qui changeaient de trottoir à son approche / Celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est vraiment la fidélité en amitié sans conclure à vrai dire / Celle qu'amusait son côté despote dont elle se fichait en le singeant / Ceux qui pensaient "Comédie humaine" en l'observant / Celui que son hybris faisait l'apparenter aux bâtisseurs paranos / Celle qui l'a mise en garde contre l'auto-destruction dostoïevskienne / Ceux qui le croisaient tous les midis au Milk Bar / Celui qu'il a soutenu en dépit (ou à cause) de sa dépendance grave à la dope / Celle qui l'appelait mon petit Oblomov / Ceux qui n'en auront jamais fait le tour et qui n'en demandent d'ailleurs pas tant / Celui qui se méfiait de sa cruauté émotive / Celle qui l'aimait en dépit de sa muflerie / Ceux qui ne toucheront pas au secret de l'ami disparu, etc.
 La Science Fiction, ou l’homme en éternel projet. En mémoire de Pierre versins (1923-2001).
La Science Fiction, ou l’homme en éternel projet. En mémoire de Pierre versins (1923-2001). Extraordinaire. Tel est le mot qui vous vient à l’esprit lorsque, ignorant ce qui vous attend, vous débarquez devant la maison de Rovray où habite Pierre Versins. Extraordinaire, d’abord, le décor : dominant les toits du village, les prés et les forêts, c’est, sauf le respect dû à l’anarchiste que prétend être le maître de céans, le lieu d’une paix royale, d’un calme quasi monacal. Ici, le jour se lève quand il lui semble bon, les vaches broutent, les innocentes, et l’on admire un paysage apparemment intouché : le décor même des romans de science fiction à venir, genre contre-utopie bucolique…
Extraordinaire. Tel est le mot qui vous vient à l’esprit lorsque, ignorant ce qui vous attend, vous débarquez devant la maison de Rovray où habite Pierre Versins. Extraordinaire, d’abord, le décor : dominant les toits du village, les prés et les forêts, c’est, sauf le respect dû à l’anarchiste que prétend être le maître de céans, le lieu d’une paix royale, d’un calme quasi monacal. Ici, le jour se lève quand il lui semble bon, les vaches broutent, les innocentes, et l’on admire un paysage apparemment intouché : le décor même des romans de science fiction à venir, genre contre-utopie bucolique…
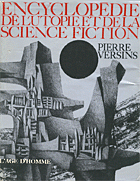

 Celle qui le voit toujours vu en petit roi que Dieu (le père, le fils, le frère ou la mère polonaise) avait plaisir à voir régner sur la terre et environs / Ceux qui reviennent à lui comme à la source claire de la forêt métropolitaine / Celui qui le sait à la fois Romain et Chinois par l’alcool / Celle qui sourit doucement à ceux qui se disent ses spécialistes / Ceux que le froid saisit à l’écoute de sa basse continue de laquelle jaillit soudain le chant de l’alouette spirituelle dite Lulu / Celui qui partage son horreur du nordisme genre aujourd’hui Wellness Design Fitness et autres saloperies lisses / Celle qui n’a pas reçu de plus beau cadeau que ses soliloques d’impérial pique-assiette toujours un peu pompette / Ceux qui annotent ses textes et en seront heureusement contaminés en tout cas on l’espère pour ces enfarinés de poussière / Celui qui se rappelle les sept petits moines vietnamiens surpris dans le vallon du Gottéron à pépier comme dans une de ses digressions de Musiques de Fribourg / Celle qui lui vendait à Cully des boîtes de cachous / Ceux enfants qui le poursuivaient dans les ruelles de Saint-Saphorin en lui criant Cachou ! Cachou ! / Celui qui la vu pioncer seul et saoul comme un tas sur les sacs de sucre empilés derrière la gare de Cornavin / Celle qui a conservé son clavier secret dont sa belle-mère bernoise a fait du petit bois / Ceux qui l’ont blessé ce jour-là en finissant sans lui la bouteille de Gigondas que son ami Wayland avait ouverte pour lui comme il disait / Celui qui pense que l’humiliation a été l’un de ses moteurs puissants / Celle qui a incendié sa cousine femme de notaire qui lui recommandait de ne pas le laisser seul avec les enfants avec ce qu’on sait / Ceux qui évoquaient sa « sexualité » avec le ton bassement «à l’écoute» des diplômés en psychologie et autre cafards concernés / Celui qui s’est déconsidéré aux yeux de l’Eternel en parlant de l’aspect compulsif de son écriture /
Celle qui le voit toujours vu en petit roi que Dieu (le père, le fils, le frère ou la mère polonaise) avait plaisir à voir régner sur la terre et environs / Ceux qui reviennent à lui comme à la source claire de la forêt métropolitaine / Celui qui le sait à la fois Romain et Chinois par l’alcool / Celle qui sourit doucement à ceux qui se disent ses spécialistes / Ceux que le froid saisit à l’écoute de sa basse continue de laquelle jaillit soudain le chant de l’alouette spirituelle dite Lulu / Celui qui partage son horreur du nordisme genre aujourd’hui Wellness Design Fitness et autres saloperies lisses / Celle qui n’a pas reçu de plus beau cadeau que ses soliloques d’impérial pique-assiette toujours un peu pompette / Ceux qui annotent ses textes et en seront heureusement contaminés en tout cas on l’espère pour ces enfarinés de poussière / Celui qui se rappelle les sept petits moines vietnamiens surpris dans le vallon du Gottéron à pépier comme dans une de ses digressions de Musiques de Fribourg / Celle qui lui vendait à Cully des boîtes de cachous / Ceux enfants qui le poursuivaient dans les ruelles de Saint-Saphorin en lui criant Cachou ! Cachou ! / Celui qui la vu pioncer seul et saoul comme un tas sur les sacs de sucre empilés derrière la gare de Cornavin / Celle qui a conservé son clavier secret dont sa belle-mère bernoise a fait du petit bois / Ceux qui l’ont blessé ce jour-là en finissant sans lui la bouteille de Gigondas que son ami Wayland avait ouverte pour lui comme il disait / Celui qui pense que l’humiliation a été l’un de ses moteurs puissants / Celle qui a incendié sa cousine femme de notaire qui lui recommandait de ne pas le laisser seul avec les enfants avec ce qu’on sait / Ceux qui évoquaient sa « sexualité » avec le ton bassement «à l’écoute» des diplômés en psychologie et autre cafards concernés / Celui qui s’est déconsidéré aux yeux de l’Eternel en parlant de l’aspect compulsif de son écriture /  Celle qui relit Enveloppes avec la satisfaction plus-que-réelle d’être physiquement et métaphysiquement bien baisée / Ceux qui savent qu’avec un tel corps on boit plus facilement qu’on ne baise mais qu’est-ce qu’on sait au juste de ces choses-là non mais des fois / Celui qui a toujours estimé que les critères de gauche ou de droite lui allaient aussi difficilement qu’à Pétrarque ou Virgile ou Tchouang-tseu sans parler de Little Nemo / Celle qui suçait son pouce à lui pour s’endormir mais il faudrait un collège d’experts pour conclure à la pédophilie n’est-ce pas / Ceux qui retrouvent son évidence mystérieuse en revenant au Canal exutoire où ils lisent par exemple ceci : « Il est odieux que le monde appartienne aux virtuistes – à des dames aux ombrelles fanées par les climats qui indiquent ce qu’il faut faire ou ne pas faire -, car vertu, au premier sens, signifie courage. C’est le contraire du virtuisme. La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine », ou ceci qu’ils entendent comme un ordre de marche permanent quoique secret : « L’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. Mais déjà ce domicile est attrayant ; il doit le fuir. À peine rentré, il peut s’asseoir sur son lit. Mais, tout de suite, repartir. L’univers, de grands mâts, des démolitions à perte de vue, des usines et des villes qui n’existent pas puisqu’on s’en va, tout cela est à lui pour qu’il en fasse quelque chose dans l’œuvre qu’il ne doit jamais oublier de sa récupération », ou cela encore et enfin : « L’être ne peut se mouvoir sans illusion, mais il a cette secousse : il est de toute autre nature et il est éternel. Je crois même qu’une fille de basse-cour pense ça : tout d’un coup elle pense ça. Après elle oublie. Tous, du reste, continuellement, nous ne faisons qu’oublier », etc.
Celle qui relit Enveloppes avec la satisfaction plus-que-réelle d’être physiquement et métaphysiquement bien baisée / Ceux qui savent qu’avec un tel corps on boit plus facilement qu’on ne baise mais qu’est-ce qu’on sait au juste de ces choses-là non mais des fois / Celui qui a toujours estimé que les critères de gauche ou de droite lui allaient aussi difficilement qu’à Pétrarque ou Virgile ou Tchouang-tseu sans parler de Little Nemo / Celle qui suçait son pouce à lui pour s’endormir mais il faudrait un collège d’experts pour conclure à la pédophilie n’est-ce pas / Ceux qui retrouvent son évidence mystérieuse en revenant au Canal exutoire où ils lisent par exemple ceci : « Il est odieux que le monde appartienne aux virtuistes – à des dames aux ombrelles fanées par les climats qui indiquent ce qu’il faut faire ou ne pas faire -, car vertu, au premier sens, signifie courage. C’est le contraire du virtuisme. La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine », ou ceci qu’ils entendent comme un ordre de marche permanent quoique secret : « L’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. Mais déjà ce domicile est attrayant ; il doit le fuir. À peine rentré, il peut s’asseoir sur son lit. Mais, tout de suite, repartir. L’univers, de grands mâts, des démolitions à perte de vue, des usines et des villes qui n’existent pas puisqu’on s’en va, tout cela est à lui pour qu’il en fasse quelque chose dans l’œuvre qu’il ne doit jamais oublier de sa récupération », ou cela encore et enfin : « L’être ne peut se mouvoir sans illusion, mais il a cette secousse : il est de toute autre nature et il est éternel. Je crois même qu’une fille de basse-cour pense ça : tout d’un coup elle pense ça. Après elle oublie. Tous, du reste, continuellement, nous ne faisons qu’oublier », etc. (Cette liste a été jetée ce matin tôt l'aube en prévision de l’établissement d’une livraison spéciale du journal Le Persil consacrée à Charles-Albert Cingria, aux bons soins de Daniel Vuataz et Marius Daniel Popescu.)
(Cette liste a été jetée ce matin tôt l'aube en prévision de l’établissement d’une livraison spéciale du journal Le Persil consacrée à Charles-Albert Cingria, aux bons soins de Daniel Vuataz et Marius Daniel Popescu.) 

 On entre dans le dernier roman de David Grossman, Une femme fuyant l'annonce, comme dans un labyrinthe nocturne dans lequel s'entrecroisent les voix de trois jeunes gens menacés par la maladie et la guerre. Ces séquences d'une sorte de théâtre de la mémoire sont datées 1967, où apparaissent les protagonistes du roman: Ora, Avram et Ilan.
On entre dans le dernier roman de David Grossman, Une femme fuyant l'annonce, comme dans un labyrinthe nocturne dans lequel s'entrecroisent les voix de trois jeunes gens menacés par la maladie et la guerre. Ces séquences d'une sorte de théâtre de la mémoire sont datées 1967, où apparaissent les protagonistes du roman: Ora, Avram et Ilan.  Mon cher Uri,
Mon cher Uri,


 Enfin, l’excellente Corinne Desarzens, avec Un roi, paru ce printemps chez Grasset, complètera le joli carré de cette table ronde.
Enfin, l’excellente Corinne Desarzens, avec Un roi, paru ce printemps chez Grasset, complètera le joli carré de cette table ronde.


 Mais quand nous nous voyons c’est la fête, on rit beaucoup pour rien, on se regarde et on rit. Cela ne m’était plus arrivé depuis belle lurette, de regarder un ami au fond des yeux et de rire d’un fou rire à s’étouffer. Or, avec Doumia, c’est toujours ainsi. On rit et on pleure, la frontière entre les deux émotions n’est pas palpable et c’est bien ainsi.
Mais quand nous nous voyons c’est la fête, on rit beaucoup pour rien, on se regarde et on rit. Cela ne m’était plus arrivé depuis belle lurette, de regarder un ami au fond des yeux et de rire d’un fou rire à s’étouffer. Or, avec Doumia, c’est toujours ainsi. On rit et on pleure, la frontière entre les deux émotions n’est pas palpable et c’est bien ainsi.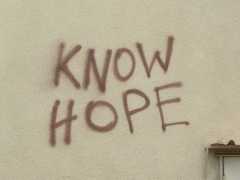 Ces immigrés africains en France, entassés ici dans cet immeuble ingrat, par des contractants se prétendant abusivement thuriféraires des droits de l’homme, ces immigrés, souvent humiliés, sont ce soir emplis de la fierté d’assister à cet événement mondial, abasourdis qu’ils sont par l’audace de ce premier président américain noir qui ose rappeler à la face du monde, qu’il n’y a pas cinquante ans, les noirs ne pouvaient pas boire une bière dans le même bar que les blancs et étudier dans les mêmes universités.
Ces immigrés africains en France, entassés ici dans cet immeuble ingrat, par des contractants se prétendant abusivement thuriféraires des droits de l’homme, ces immigrés, souvent humiliés, sont ce soir emplis de la fierté d’assister à cet événement mondial, abasourdis qu’ils sont par l’audace de ce premier président américain noir qui ose rappeler à la face du monde, qu’il n’y a pas cinquante ans, les noirs ne pouvaient pas boire une bière dans le même bar que les blancs et étudier dans les mêmes universités.

 C’est le miracle de la lecture que de se faire de nouveaux amis en moins de deux, ou de se rappeler, soudain, ceux qu’on avait oubliés. Car je connaissais Pierre et Odile depuis de longues années, pour avoir déjà lu Baleine, cette nouvelle de Paul Gadenne comptant à peine trente pages, rééditée il y a quelque temps par Hubert Nyssen et que j’ai relue avec l’impression de la redécouvrir plus physiquement que la première fois, par le seul fait qu’on ne lit pas, à la soixantaine, un texte évoquant la mort comme on le lit à vingt ans. De fait Baleine, décrivant le cadavre d’une baleine en train de se décomposer sur une grève, est plus qu’un texte symbolique : une espèce de poème métaphysique que vivent deux jeunes gens élégants, juste un peu moins frivoles que les autres, Pierre et Odile qui étaient donc avec moi cet après-midi dans les rhododendrons des abords du refuge Bel-Lachat quand j’ai ressorti l’opuscule.
C’est le miracle de la lecture que de se faire de nouveaux amis en moins de deux, ou de se rappeler, soudain, ceux qu’on avait oubliés. Car je connaissais Pierre et Odile depuis de longues années, pour avoir déjà lu Baleine, cette nouvelle de Paul Gadenne comptant à peine trente pages, rééditée il y a quelque temps par Hubert Nyssen et que j’ai relue avec l’impression de la redécouvrir plus physiquement que la première fois, par le seul fait qu’on ne lit pas, à la soixantaine, un texte évoquant la mort comme on le lit à vingt ans. De fait Baleine, décrivant le cadavre d’une baleine en train de se décomposer sur une grève, est plus qu’un texte symbolique : une espèce de poème métaphysique que vivent deux jeunes gens élégants, juste un peu moins frivoles que les autres, Pierre et Odile qui étaient donc avec moi cet après-midi dans les rhododendrons des abords du refuge Bel-Lachat quand j’ai ressorti l’opuscule. Tandis qu’une baleine contient le monde et en décline tous les aspects. Moby Dick, évidemment présent en filigrane de la nouvelle de Gadenne, fut une montagne blanche et un monstre biblique, mais je me rappelle soudain qu’aucun de nos écrivain alpins n’a produit trente pages de cette densité qui puissent suggérer des montagnes ce que certains peintres en revanche ont saisi, le mystère, l’odeur de la vie et de la mort, ce contraste de notre légèreté et du poids des choses, la chair d’un chamois qui se décompose dans un pierrier et la grâce d’un enfant sautant de pierre en pierre, le ciel d’été roulant ses myriades de saphirs au-dessus des parois lugubres, tout ce chaos, et là-haut ces papillons multicolores des parapentes, et sur le sable blanc du torrent aux eaux laiteuses: ce lecteur divaguant…
Tandis qu’une baleine contient le monde et en décline tous les aspects. Moby Dick, évidemment présent en filigrane de la nouvelle de Gadenne, fut une montagne blanche et un monstre biblique, mais je me rappelle soudain qu’aucun de nos écrivain alpins n’a produit trente pages de cette densité qui puissent suggérer des montagnes ce que certains peintres en revanche ont saisi, le mystère, l’odeur de la vie et de la mort, ce contraste de notre légèreté et du poids des choses, la chair d’un chamois qui se décompose dans un pierrier et la grâce d’un enfant sautant de pierre en pierre, le ciel d’été roulant ses myriades de saphirs au-dessus des parois lugubres, tout ce chaos, et là-haut ces papillons multicolores des parapentes, et sur le sable blanc du torrent aux eaux laiteuses: ce lecteur divaguant…




 Trois ans après La Forteresse, Léopard d’or en 2008, le Lausannois Fernand Melgar revient à Locarno avec Vol spécial. Un documentaire très attendu sur les sans-papiers « jetés » de notre pays. Entretien.
Trois ans après La Forteresse, Léopard d’or en 2008, le Lausannois Fernand Melgar revient à Locarno avec Vol spécial. Un documentaire très attendu sur les sans-papiers « jetés » de notre pays. Entretien.


 3000 personnes qui ovationnent debout le Vol spécial de Fernand Melgar, 8000 spectateurs touchés au cœur par la projection de Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau sur la Piazza Grande - Prix du public combien prévisible -, ou la même place mythique saisie d’émotion à la découverte du dernier chef-d’oeuvre d’Aki Kaurismäki, Le Havre : trois exemples entre beaucoup d’autres.
3000 personnes qui ovationnent debout le Vol spécial de Fernand Melgar, 8000 spectateurs touchés au cœur par la projection de Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau sur la Piazza Grande - Prix du public combien prévisible -, ou la même place mythique saisie d’émotion à la découverte du dernier chef-d’oeuvre d’Aki Kaurismäki, Le Havre : trois exemples entre beaucoup d’autres. Et ces étoiles du cinéma auxquelles on a déroulé un nouveau tapis rouge, sans trop de flafla mondain pour autant : Leslie Caron saluant en français le génie créateur de Vincente Minelli (sujet de la passionnante rétrospective, à redécouvrir bientôt à Lausanne), Harrison Ford recevant son léopard d’or avant de jouer du colt sur l’écran géant, lsabelle Huppert multipliant les tendres salamalecs à Claude Goretta et Maurice Pialat, Gérard Depardieu faisant son numéro de grand cabot sympa devant un public venu en masse, ou enfin Claudia Cardinale se pointant à la FEVI pour la projection de 8 1/2, chef- d’œuvre de Fellini qu’elle irradie de ses vingt ans - autant d’apparitions « glamoureuses » qu’Olivier Père a su combiner avec son entregent malin sans « singer » le festival de Cannes…
Et ces étoiles du cinéma auxquelles on a déroulé un nouveau tapis rouge, sans trop de flafla mondain pour autant : Leslie Caron saluant en français le génie créateur de Vincente Minelli (sujet de la passionnante rétrospective, à redécouvrir bientôt à Lausanne), Harrison Ford recevant son léopard d’or avant de jouer du colt sur l’écran géant, lsabelle Huppert multipliant les tendres salamalecs à Claude Goretta et Maurice Pialat, Gérard Depardieu faisant son numéro de grand cabot sympa devant un public venu en masse, ou enfin Claudia Cardinale se pointant à la FEVI pour la projection de 8 1/2, chef- d’œuvre de Fellini qu’elle irradie de ses vingt ans - autant d’apparitions « glamoureuses » qu’Olivier Père a su combiner avec son entregent malin sans « singer » le festival de Cannes…  Un vent de renouveau a été salué par la presse, de nos confrères tessinois aux grands journaux parisiens, lesquels ont coqueriqué en constatant la forte représentation française de cette édition, souvent décevante au demeurant. Mais Olivier Père dépasse le chauvinisme français en accueillant aussi généreusement le cinéma suisse (l’étonnant Hell du tout jeune Tim Fehlbaum, sur la Piazza Grande, et trois films en compétition internationale, sans parler des Appellations suisses) que les cinématographies du monde entier et les genres les plus variés.
Un vent de renouveau a été salué par la presse, de nos confrères tessinois aux grands journaux parisiens, lesquels ont coqueriqué en constatant la forte représentation française de cette édition, souvent décevante au demeurant. Mais Olivier Père dépasse le chauvinisme français en accueillant aussi généreusement le cinéma suisse (l’étonnant Hell du tout jeune Tim Fehlbaum, sur la Piazza Grande, et trois films en compétition internationale, sans parler des Appellations suisses) que les cinématographies du monde entier et les genres les plus variés. Le public roi
Le public roi Premier film sensible et vif d’une jeune réalisatrice suisse originaire d’Argentine, le Léopard d’or de cette année, Abrir puertas y ventana, de Milagros Mumenthaler, s’inscrit pourtant mieux dans « l’esprit de Locarno » que les blockbusters hollywoodiens tonitruant cette année sur la Piazza. Or Maire et Père ont voulu cet enfant un peu schizo qu’est devenu le Festival de Locarno. Et le Président Solari boit du petit lait…
Premier film sensible et vif d’une jeune réalisatrice suisse originaire d’Argentine, le Léopard d’or de cette année, Abrir puertas y ventana, de Milagros Mumenthaler, s’inscrit pourtant mieux dans « l’esprit de Locarno » que les blockbusters hollywoodiens tonitruant cette année sur la Piazza. Or Maire et Père ont voulu cet enfant un peu schizo qu’est devenu le Festival de Locarno. Et le Président Solari boit du petit lait… Une polémique indigne
Une polémique indigne



 Une montagne : telle est l’impression qu’aura fait l’apparition, lundi soir, de Gérard Depardieu sur l’immense écran du Festival de Locarno. Une montagne au sourire d’enfant et aux paluches faites pour étreindre le monde, avec cette irrésistile chaleur humaine que dégage celui qu’Olivier Père qualifie de «plus grand acteur français vivant», ovationné par les milliers de spectateurs présents.
Une montagne : telle est l’impression qu’aura fait l’apparition, lundi soir, de Gérard Depardieu sur l’immense écran du Festival de Locarno. Une montagne au sourire d’enfant et aux paluches faites pour étreindre le monde, avec cette irrésistile chaleur humaine que dégage celui qu’Olivier Père qualifie de «plus grand acteur français vivant», ovationné par les milliers de spectateurs présents.  C’est en effet sous l’égide de l’amour du cinéma, et par amitié pour Maurice Pialat, que le comédien a accepté l’invitation du festival. Lequel consacre un hommage au cinéaste français disparu avec quatre films marquants, à commencer par Loulou (1980). Rappelons alors que cette première collaboration fut explosive et que Depardieu ne revit jamais le film… jusqu’en 1984, à la TV, après quoi Daniel Toscan du Plantier ménagea une réconciliation débouchant sur une grande amitié. De celle-ci découla Police (1985), repris à Locarno, comme Le Garçu (1995) et Sous le soleil de Satan, dont une séquence projetée a réuni sur l’écran les deux amis en soutanes…
C’est en effet sous l’égide de l’amour du cinéma, et par amitié pour Maurice Pialat, que le comédien a accepté l’invitation du festival. Lequel consacre un hommage au cinéaste français disparu avec quatre films marquants, à commencer par Loulou (1980). Rappelons alors que cette première collaboration fut explosive et que Depardieu ne revit jamais le film… jusqu’en 1984, à la TV, après quoi Daniel Toscan du Plantier ménagea une réconciliation débouchant sur une grande amitié. De celle-ci découla Police (1985), repris à Locarno, comme Le Garçu (1995) et Sous le soleil de Satan, dont une séquence projetée a réuni sur l’écran les deux amis en soutanes…  Or l’amitié et l’amour étaient aussi au rendez-vous lundi soir avec la première mondiale de Bachir Lazhar, film de grande émotion du Québeois Philipe Falardeau, très applaudi pour ses qualités humaines. Double thème délicat : le suicide et l’intégration. Ou comment une classe d’enfants, traumatisés par la pendaison de leur instite, partage sa détresse avec celle de l’enseignant remplaçant, réfugié politique algérien en quête d’intégration.
Or l’amitié et l’amour étaient aussi au rendez-vous lundi soir avec la première mondiale de Bachir Lazhar, film de grande émotion du Québeois Philipe Falardeau, très applaudi pour ses qualités humaines. Double thème délicat : le suicide et l’intégration. Ou comment une classe d’enfants, traumatisés par la pendaison de leur instite, partage sa détresse avec celle de l’enseignant remplaçant, réfugié politique algérien en quête d’intégration.