Une lettre retrouvée. Ce que mon ami Philip écrivait, ce première jour de l'ère Obama, à mon ami Bona.
Paris, mercredi 21 janvier 2009.
Cher Nègre de l’aube,
Hier matin Paris avait revêtu sa doudoune. Les néons noués en croix vertes, enseignes clignotantes qui annoncent, sur la rue, les officines à suppositoires, affichaient à peine deux degrés celsius au dessus du néant. Courbé sur ma bécane, congelé sur ma selle qui l’était tout autant, j’écrasais le pédalier en haut de la rue Monge, dans ce style qui fit la fortune de Joop Zoetemelk, surnommé le Hollandais du Tour, lorsqu’ un citoyen black, profitant de mon allure de candidat à la voiture ballet, se planta, sans risque, sur ma trajectoire, son sourire tout en ivoire me barrant la route.
Le voir c’était le reconnaître, et ceci dans la même seconde, tant ce visage rayonnant m’est si cher et si familier, même camouflé dans une espèce de passe-montagne bricolé, sorte de choucroute inspirée des étoffes habilement nouées sur le sommet de leur chef par les chasseurs malinkés sillonnant les plateaux toujours giboyeux de la Haute Guinée. C’est Doumbia, dit Doumdoum pour les intimes. Mon vendeur de Monde à la sauvette, mon ami depuis deux ans.
Sa peau, son visage et ses lèvres, sa tête nue, un ensemble fin et élégant, plutôt habitué aux longues heures de pasteur passées au soleil de la savane, à surveiller les troupeaux, à l’ombre tiède d’un manguier, n’apprécie pas du tout ces journées sombres et ingrates de l’hiver parisien, battues par ce petit noroît aigrelet qui vous traverse les meilleures des jaquettes.
Devant ma surprise de le trouver ici , à cette heure avancée de la matinée, dans le Vème, alors qu’il aurait déjà dû prendre livraison de sa pile de Monde, pour l’écouler aux lecteurs du XVIème, tout engoncés dans leur respectabilité, et aussi de sa poussette pleine d’exemplaires plastifiés qu’il doit glisser dans des boîtes aussi accueillantes que les rombières restées planquées dans leurs étages, il me confirme son arrêt de travail volontaire qu’il a décrété, unilatéralement, chômage technique. Ce froid n’est pas pour lui, il a appelé son chef, Le Monde peut l’oublier ce jour.
Tout heureux de tomber sur moi, il me propose de passer au kiosque, chez Fathi avec qui il traficote quelques améliorations de revenus, très cachottier. Nous partons pour faire le chemin ensemble et en cour de route nous débusquons un PMU où Doumbia pourra faire son tiercé. Nous stoppons à la Corniche d’Oran, bar tabac où les joueurs maghrébins et de toute l’Afrique se pressent au comptoir et à la caisse débordée par vagues, au rythme des annonces des courses, tout en pataugeant dans plusieurs couches de quittances, de billets de loterie, de formules de tiercés déjà jouées, déjà perdues, larguées par dépit spontané à même le sol.
Tout fébrile, Doumbia le Malinké, originaire de Kankan, ville des rives vertes du fleuve Milo, cour d’eau paresseux, qui coule sans se soucier vraiment de rien, selon la formule de mon ami, échange quelques pronostics tout en feignant de s’intéresser aux propos d’un tuyauteur algérien. Ali, originaire de Boumerdès, a tout perdu dans le tremblement de Terre de 2003, qui frappa sa ville natale et détruisit la maison pour laquelle il avait travaillé toute sa vie et dans laquelle il venait d’emménager. Et le voilà de retour en France, dépouillé de toutes ses richesses. Ali que tous ici surnomment affectueusement « Ali Les Bons Tuyaux », en hommage à un personnage des «Nouveaux Chevaliers au grand cœur, qui n’ont peur de rien…mais qui gagnent toujours à la fin ». Ali, toujours en costard, élégant, et en chaussures blanches pur cuir, le visage complètement vérolé et envahi de cicatrices, suite à un accident de chantier qui lui fit frôler la fin, Ali au dentier neuf et si éclatant, dernier signe de sa richesse perdue, mais qui rappelle à tous, sans qu’il s’en doute lui-même, le sosie d’un Frankenstein échappé d’une série b.
Doumbia, grand seigneur des Hauts Plateaux de l’Est, lui file une pièce de deux euros, toujours préparée à cet effet, pour ce tuyau déjà percé de part en part. Mais Ali - et c’est pour cela qu’ils continuent tous à le payer, chacun avec une moue de léger dédain, un peu feinte - fait partie des jeux, il fait l’ambiance, comme les écrans qui tapissent le bar et comme les serveurs moroses, mal payés eux aussi, mais qui excellent dans l’art de se glisser entre les joueurs, attentifs à ne pas faire chavirer les demis agrippés à leurs plateaux volant au-dessus des têtes. Doumdoum sort en saluant à la cantonade et en gratifiant tout cet entourage qui lui est familier de grands rires sonores et chantants. Quand il ressort, le silence des joueurs retombe sur le bar.
C’est qu’il ne joue pas pour gagner, ce fils de petit éleveur de bétail de la savane ouest soudanienne. Il joue simplement quelques euros pour vivre autre chose que la vente du Monde, pour vivre autre chose que traîner pendant son temps libre sur un lit au milieu des quatre gosses de la famille guinéenne, mélinké comme lui, qui l’héberge de bon cœur dans son trois-pièces. C’est qu’il a perdu sa toute petite, mais si confortable, chambre de bonne...
Il l’a perdue dans le grand incendie du Boulevard Vincent Auriol, dans le XIIIème, qui faucha vingt-cinq vies, dont onze enfants en bas âge. Sa petite chambre était sous les toits. Il découvrit l’horreur en rentrant du travail, comme un père, de ses amis, découvrit les corps carbonisés de ses cinq petits et de son épouse. C’est au cours du rassemblement à la mémoire de toutes ces victimes africaines que je fis la connaissance de Doumbia. Ces larmes sur ce visage, si gris ce jour là, et pourtant si doux, m’avaient arraché les miennes. Nous étions restés bien longtemps les yeux brûlants, après la fin de la cérémonie, à nous raconter des bouts de nos vies, assis à même la rue, au milieu du rond point de la Place d’Italie, devant des ribambelles de canettes de bières pour apaiser les chagrins, pendant que les agents, partageant cette fois-ci l’émotion des manifestants qu’ils avaient la charge de surveiller, détournaient la circulation pour nous laisser le temps de reprendre nos esprits.
.
Sa paie de vendeur de baveux et ses gains d’activités éparses, il les envoie fissa fissa chaque mois, par la Western Union du coin de la rue de la Goutte d’Or, à sa famille, à sa fille de 17 ans qui commence des études à l’université Anta Diop de Kankan. De sa famille , de son ou de ses épouses, Doumbia ne m’en parle qu’en silence, une tristesse grise et tendre envahit alors à nouveau ce visage si expressif, il s’éteint et se tait. Mais quand nous nous voyons c’est la fête, on rit beaucoup pour rien, on se regarde et on rit. Cela ne m’était plus arrivé depuis belle lurette, de regarder un ami au fond des yeux et de rire d’un fou rire à s’étouffer. Or, avec Doumia, c’est toujours ainsi. On rit et on pleure, la frontière entre les deux émotions n’est pas palpable et c’est bien ainsi.
Mais quand nous nous voyons c’est la fête, on rit beaucoup pour rien, on se regarde et on rit. Cela ne m’était plus arrivé depuis belle lurette, de regarder un ami au fond des yeux et de rire d’un fou rire à s’étouffer. Or, avec Doumia, c’est toujours ainsi. On rit et on pleure, la frontière entre les deux émotions n’est pas palpable et c’est bien ainsi.
Hier en fin d’après-midi, à la fin de ma garde du kiosque, Fathi, de retour de la mosquée, me souffle à l’oreille qu’il a prié pour les enfants morts à Gaza, son geste délicat est empreint de discrétion pour ne pas se faire entendre des clients, on ne sait jamais, il pourrait il y avoir un pro-Israélien parmi eux. Mon ami djerbien reste toujours discret même dans ses joies et ses chagrins, est-ce dû à la légendaire pudeur de l’insulaire ou au jeu supposé imposé par les lois coutumières du pays d’accueil auxquelles se soumettent en apparence, sans rechigner, mes amis immigrés. Je ne saurais le dire.
Me voyant libéré de mes obligations auprès de Fathi, mon tribut à l’amitié et aux échanges, Doumbia me propose de faire un tour avec lui au Foyer Africain de la rue du Château des Rentiers qui se trouve tout près de chez moi, pour y retrouver un de ses cousins. Ce Foyer, je le connais déjà pour y avoir fricoté avec des militants de la cause des Sans-Papiers. Mais mes amis d’alors se sont fait chartérisés depuis par le Ministère de l’Identité Nationale. Lorsque nous y pénétrons en échappant avec succès au contrôle du vigilant concierge blanc de l’entrée, chargé de veiller à protéger ses pensionnaires des influences néfastes des idées républicaines, nous parcourons, à la recherche du cousin Diallo, les coursives de ce bâtiment étroit de cinq étages, authentique navire négrier moderne, restant à quai, mais aux cabines surpeuplées de travailleurs en attente de régulation.
Nous visitons les chambres une à une, la chaleur y est étouffante, les odeurs des mâles travailleurs exhalent acidités et senteurs de gels douche extra doux. Indifférence polie et cris d’amitiés se succèdent à nos passages dans chaque chambre. Les hommes mangent, boivent, discutent avec passion dans leurs diverses langues chatoyantes que je suis totalement incapables de décrypter. Dans toutes les chambres une ou deux ou trois télévisions sont allumées, et toutes diffusent l’investiture et le visage d’Obama.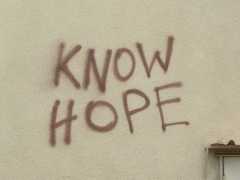 Ces immigrés africains en France, entassés ici dans cet immeuble ingrat, par des contractants se prétendant abusivement thuriféraires des droits de l’homme, ces immigrés, souvent humiliés, sont ce soir emplis de la fierté d’assister à cet événement mondial, abasourdis qu’ils sont par l’audace de ce premier président américain noir qui ose rappeler à la face du monde, qu’il n’y a pas cinquante ans, les noirs ne pouvaient pas boire une bière dans le même bar que les blancs et étudier dans les mêmes universités.
Ces immigrés africains en France, entassés ici dans cet immeuble ingrat, par des contractants se prétendant abusivement thuriféraires des droits de l’homme, ces immigrés, souvent humiliés, sont ce soir emplis de la fierté d’assister à cet événement mondial, abasourdis qu’ils sont par l’audace de ce premier président américain noir qui ose rappeler à la face du monde, qu’il n’y a pas cinquante ans, les noirs ne pouvaient pas boire une bière dans le même bar que les blancs et étudier dans les mêmes universités.
Les bières circulent et s’entrechoquent, les plaisanteries circulent vite. Celle qui nous fait tous rire est reprise par un grand Sénégalais élégant dans son boubou bleu roi. « Vous avez vu ces tordus de blancs, ils ont encore trouvé un nègre pour faire leur sale boulot : prendre la présidence d’une Amérique en crise et au bord de la faillite. » La soirée avance, nous restons coincés chez des guinéens amis de Doumbia. Le cousin est introuvable. Doumdoum a déjà oublié que nous étions venus lui parler. Il a trouvé pleins d’autres cousins pour l’occasion.
Je suis au milieu d’eux, seul blanc, comme si j’étais des leurs. Les plats et les bières n’en finissent plus de circuler. Les discours d’Obama ont fait place aux musiques et aux déclamations. La fête sera longue. Ce soir le Maître du monde est noir. L’Afrique se sent un peu Maître du monde, elle aussi. On ne va pas bouder notre plaisir.
Il est deux heures du mat. Je n’ai pas sommeil. Je suis de retour chez moi. Jean-Louis je commence cette lettre ci-dessus, pour te l’envoyer avant tes prochaines pensées de l’aube.
Salut frère Négro des neiges,
Philip
Images: Fleur de volcan. Encres et techniques mixtes de Bona Mangangu.
Photos de Philip Seelen et Pascal Janovjak.


 Condamné sans sursis à subir les rincées, en fuite sur mon vélo, poursuivant des moinelles aux virevoltes culbutées et chahutées par les rafales, je cherche refuge dans l’abri de mes amis Sans-logis situé au dessous des structures lourdes et inquiétantes de l’A 4. Longeant à contresens le flux régulier des huit pistes bouchonnées par les multiples candidats aux Castorama et Mammouth du coin, je surgis à bout de souffle et trempé dans le trou béant, sous le courant incessant des bagnoles.
Condamné sans sursis à subir les rincées, en fuite sur mon vélo, poursuivant des moinelles aux virevoltes culbutées et chahutées par les rafales, je cherche refuge dans l’abri de mes amis Sans-logis situé au dessous des structures lourdes et inquiétantes de l’A 4. Longeant à contresens le flux régulier des huit pistes bouchonnées par les multiples candidats aux Castorama et Mammouth du coin, je surgis à bout de souffle et trempé dans le trou béant, sous le courant incessant des bagnoles. Le départ de ses voisins de cloche l’a laissé face à face avec une solitude trop ample à vivre pour lui seul. Ces jours ici, avec cette météo plus personne ne passe sur le quai. Pour la manche c’est comme pour le mercure proche du dessous de zéro.
Le départ de ses voisins de cloche l’a laissé face à face avec une solitude trop ample à vivre pour lui seul. Ces jours ici, avec cette météo plus personne ne passe sur le quai. Pour la manche c’est comme pour le mercure proche du dessous de zéro. Il est debout. Parfois un cartable sous le bras contenant une bibine d’alcool fort. Il est debout. Il sourit quand on le salue ou qu’on lui adresse une pièce ou la parole. Il est debout. Il répond dans un sabir indéchiffrable rappelant un anglais lointain. Il est debout. Au milieu de la nuit il disparaît. Le matin on peut le retrouver à l’entrée ouest de l’Allée Marc Chagall. Il est debout. Et ainsi de suite années après années. Il est debout. Nul ne peut dire s’il se souvient quand il est apparu dans notre entourage pour la première fois. Il est debout. Sans doute il y a longtemps. Il ne manque jamais un jour. Toujours debout. Sentinelle de lui même.
Il est debout. Parfois un cartable sous le bras contenant une bibine d’alcool fort. Il est debout. Il sourit quand on le salue ou qu’on lui adresse une pièce ou la parole. Il est debout. Il répond dans un sabir indéchiffrable rappelant un anglais lointain. Il est debout. Au milieu de la nuit il disparaît. Le matin on peut le retrouver à l’entrée ouest de l’Allée Marc Chagall. Il est debout. Et ainsi de suite années après années. Il est debout. Nul ne peut dire s’il se souvient quand il est apparu dans notre entourage pour la première fois. Il est debout. Sans doute il y a longtemps. Il ne manque jamais un jour. Toujours debout. Sentinelle de lui même.
 Après 20 ans d'épicerie, Fathi saisit l'opportunité d'investir ses économies dans l'achat du fond de commerce d'un kiosque à journaux de la chaîne des NMPP. Gagnant à peine l'équivalent d'un salaire minimum avec revues de cul, peoples et quotidiens, il améliore l'ordinaire pour payer les études des gosses avec des activités dont il cache subtilement l'existence et la nature.
Après 20 ans d'épicerie, Fathi saisit l'opportunité d'investir ses économies dans l'achat du fond de commerce d'un kiosque à journaux de la chaîne des NMPP. Gagnant à peine l'équivalent d'un salaire minimum avec revues de cul, peoples et quotidiens, il améliore l'ordinaire pour payer les études des gosses avec des activités dont il cache subtilement l'existence et la nature. C'est Fathi qui m'a fait connaître ces trois compères, en exil de Méditerranée eux aussi. Fathi leur fait confiance pour respecter les règles de l'abattage rituel, confiance qu'il n'accorde guère aux poulets rôtis des boucheries Halâl de l'avenue qu'il soupçonne de tricher sur la provenance, en toute complicité avec les autorités françaises de contrôle.
C'est Fathi qui m'a fait connaître ces trois compères, en exil de Méditerranée eux aussi. Fathi leur fait confiance pour respecter les règles de l'abattage rituel, confiance qu'il n'accorde guère aux poulets rôtis des boucheries Halâl de l'avenue qu'il soupçonne de tricher sur la provenance, en toute complicité avec les autorités françaises de contrôle. De retour à l'Allée Marc Chagall j'ai découvert sur mon ordinateur toutes ces images témoignant du supplice des enfants de Gaza. J'ai regardé longtemps couler mes larmes devant le miroir de la salle de bain, avant de me décider à faire un choix parmi des centaines d'icônes plus terribles les unes que les autres.
De retour à l'Allée Marc Chagall j'ai découvert sur mon ordinateur toutes ces images témoignant du supplice des enfants de Gaza. J'ai regardé longtemps couler mes larmes devant le miroir de la salle de bain, avant de me décider à faire un choix parmi des centaines d'icônes plus terribles les unes que les autres.
