

Affects du paon. - Flannery O’Connor avait 27 paons, dont elle observait le choix des postures et des positions dans la poussière, sur un arbre ou sur un tas de fumier. « Un paon n’est accessible qu’à deux types d’émotion », écrit-elle à une correspondante qui s’apitoie à propos du handicap de l’un d’eux. Et de préciser: « Où trouver quelque chose à se mettre sous la dent et comment éviter ce qui pourrait le tuer tout en tuant lui-même ce dont il a besoin ».
À La Désirade, ce 25 septembre 2003. - Il me semble trouver, chez DonDelillo, le dosage de réflexion et de sensation, d’observation et de conjecture, d’intelligence et de sensibilité que j’ai vainement cherché dans la littérature française contemporaine. Il y a chez lui un dynamisme et une générosité, enfin une poésie urbaine qui me semble peu répandus par les temps qui courent.
Don DeLillo et les lycéens. - «Je voulais raconter l'histoire d'un homme qui traverse Manhattan en une journée », lance l'écrivain. « Le type en question serait richissime et très cultivé. Il habiterait au sommet du plus haut building du monde, dans un appartement de 48 pièces qui lui aurait coûté plus de 100 millions de dollars, avec bassin à requins et nursery pour barzoïs. Il souffrirait d'une asymétrie de la prostate mais disposerait, dans son avion personnel, de la bombe atomique. Il apparaîtrait comme le maître de l'univers et vivrait pourtant, ce jour-là, l'effondrement d'une utopie. »
Devant plusieurs centaines de lycéens lyonnais, en l'institution très catholique des Chartreux, Don DeLillo présente ainsi son percutant Cosmopolis, dernier paru d'une dizaine de romans visionnaires sur notre époque. La soixantaine plus qu'entamée mais fringante, d'une discrète ironie qui renvoie à la fois à son parcours de franc-tireur peu soucieux de tapage publicitaire et à son inflexible lucidité, l’écrivain éclaire quelques aspects de Cosmopolis après en avoir lu en anglais les premières pages superbes de musicalité et lancinantes en leur rythme - toutes choses que la version française ne rend évidemment qu'en partie.
« Quelque chose de curieux s'est passé dans les années 1990 aux Etats-Unis », poursuit-il. « On y a vu les entreprises devenir des puissances, et les plus grands managers rivaliser avec les chefs d'Etat et les stars des médias. L'obsession de l'argent a gagné les particuliers, scotchés devant les nouvelles de la Bourse défilant sur leurs computers. Tous se sont mis à vivre dans une sorte de futur immédiat, rythmé par le flux financier. Jusqu'alors, on disait que « le temps est de l'argent » alors que l'argent a commencé de fabriquer un temps accéléré. Mais voici que soudain, au printemps 2000, cette euphorie a été stoppée net par le chaos financier. Le 11 septembre a fait le reste ... »
Si l'action de Cosmopolis se déroule un an avant la tragédie, l'ombre de celle-ci plane déjà comme une menace diffuse sur le roman dont le protagoniste dispose lui-même d'un service de sécurité digne d'un chef d'Etat alors qu'il assiste, dans sa limousine de 12 mètres tapissée de liège et connectée par écrans au monde entier, à l'assassinat en direct du directeur du FMI, en Corée du Nord, et à une émeute altermondialiste en plein Manhattan. Une fois de plus, la fiction du romancier se sera trouvée rattrapée par la réalité.
« Jusqu'au 11 septembre, précise alors l’écrivain, les Américains se croyaient inatteignables et maîtres du futur, et voilà qu'un petit groupe de terroristes a suffi à ruiner cet optimisme «cosmique». A l'époque de la guerre froide, nous étions conscients que de terribles destructions pouvaient toucher l'Amérique, mais à présent, à commencer par les habitants de Manhattan, chaque individu se sent menacé sans savoir où le prochain coup va porter. »
A la question d'un lycéen l'interrogeant sur l'avenir du roman réduit, selon l'expression de Mallarmé, à un « universel reportage », Don DeLillo répond en insistant sur l'importance de la langue, base irremplaçable de la poétique romanesque, et de l'intuition non planifiable visant à la ressaisie de la complexité humaine…
Celui qui annonce le tsunami éditorial de son prochain roman à clefs / Celle qui se fait un brushing ébouriffé genre après le viol sauvage de la Bête / Ceux qui ne parlent qu’en termes de goût pluriel, etc.
De la pacification. - Absolument nécessaire que je pacifie tous mes rapports avec autrui, à commencer par mes camarades de travail et mon terrible ami. Désamorcer tout conflit inutile lié à quelque forme de pouvoir ou de supériorité que ce soit. Ne jamais faire sentir aucun dédain. Combattre en moi toute forme de mépris
De Dieu et du sexe. - Je n’aime pas parler de Dieu ou du sexe avec autrui, et pourtant ce sont les deux questions qui m’obsèdent entre toutes. « Je n’aime pas ne pas croire. Je ne suis pas à l’aise avec l’athéisme », ai-je lu à l’instant dans Mao II de Don DeLillo. Et ça me parle immédiatement. Ma conviction de toujours: que Dieu est partout, et que c’est une chaleur. Don DeLillo suggère l’idée, par le truchement d’un de ses personnages, que sans la foi des croyants la planète refroidirait. J’aime cette image, sans même me prononcer sur ladite foi. Quant au sexe je le distingue de plus en plus de l’amour. Il devient langage pur ou plus exactement: sensation pure. Ainsi de la femme de la nouvelle de Kureishi qui se fait conduire incognito dans une maison, y baise la nuit durant et rentre chez elle sans avoir prononcé un mot. Du genre partouze mystique. Rien à voir avec la rencontre de personnes. Rien que des corps en fusion. Pure effusion des peaux. La sensualité adonnée à elle-même plus que ce qu’on appelle la sexualité.
De la survie. – J’ai mal au monde, se dit le dormeur éveillé, sans savoir à qui il le dit, mais la pensée se répand et suscite des échos, des mains se trouvent dans la nuit, les médias parlent de trêve et déjà s’inquiètent de savoir qui a battu qui dans l’odieux combat, les morts ne sont pas encore arrachés aux gravats, les morts ne sont pas encore pleurés et rendus à la terre que les analystes analysent qui a gagné dans l’odieux combat, et le froid s’ajoute au froid, mais le dormeur éveillé dit à la nuit que les morts survivent…
À La Désirade, ce 2 octobre. - Levé à 5 heures du matin. Solitude et presque folie de cette situation, mais elle me convient de mieux en mieux. Etre écrivain n’est pas autre chose que cette obsession et cette présence constante. Aussi ce plaisir de retrouver ses outils et de poursuivre une phrase. De construire des phrases. De se construire phrase à phrase.
 Porosité de Pascale Kramer. - Il est certains livres qui vous laissent, en mémoire, une marque unique, et tel est ce Retour d'Uruguay de Pascale Kramer, qui a cela de particulier qu'il nous touche et nous trouble sans qu'il ne s'y passe grand-chose, ni que ses personnages soient particulièrement remarquables.
Porosité de Pascale Kramer. - Il est certains livres qui vous laissent, en mémoire, une marque unique, et tel est ce Retour d'Uruguay de Pascale Kramer, qui a cela de particulier qu'il nous touche et nous trouble sans qu'il ne s'y passe grand-chose, ni que ses personnages soient particulièrement remarquables.
On y resonge un peu comme à un souvenir acide et tendre d'adolescence, aux postures à la fois péremptoires et ondoyantes de l'enfance, à la naissante sensualité zigzaguant entre les âges, au besoin de reconnaissance qu'un jeune homme peut éprouver de la part d'un homme fait, enfin à ces sentiments-sensations qui fondent les corps individuels dans celui de la famille ou du clan.
Dans un climat d'intimité presque animale, où s'opposent une sorte d'innocence frisant la perversité et des ombres plus lourdement inquiétantes, Pascale Kramer observe le jeu des relations entre enfants, adolescents et adultes avec une sorte de lucidité sourdement affectueuse.
Celui qui dit présent en s’esquivant / Celle qui s’y met sans crier gare / Ceux que la diversion ne distrait plus, etc.
 À La Désirade, ce 11 octobre. - Repris ce matin Le sourire de Mickey d’Antonin Moeri, que j’ai entrepris d’annoter sérieusement. La première nouvelle est excellente, qui évoque la préparation d’un avortement réduit, pour un couple typique de nos jours, à une « bagatelle » ou dite telle alors qu’on sent que la chose travaille l’homme et la femme. Excellente analyse de l’égoïsme masculin et de la nouvelle hypocrisie, qui fait qu’on ne « parle pas de ces choses » alors même qu’on joue les libérés. Ensuite, la nouvelle intitulée Christian est également remarquable, qui met en scène la vengeance d’une femme frustrée dans l’entreprise où elle a charge de « remodeler les comportements ». La narration manque encore parfois de clarté, mais la matière est excellente et j’ai comme l’impression qu’Antonin, dans le sillage de Michel Houellebecq, est en train de faire un bon pas en direction d’une littérature plus ouverte que naguère, moins confinée dans la compulsion névrotique.
À La Désirade, ce 11 octobre. - Repris ce matin Le sourire de Mickey d’Antonin Moeri, que j’ai entrepris d’annoter sérieusement. La première nouvelle est excellente, qui évoque la préparation d’un avortement réduit, pour un couple typique de nos jours, à une « bagatelle » ou dite telle alors qu’on sent que la chose travaille l’homme et la femme. Excellente analyse de l’égoïsme masculin et de la nouvelle hypocrisie, qui fait qu’on ne « parle pas de ces choses » alors même qu’on joue les libérés. Ensuite, la nouvelle intitulée Christian est également remarquable, qui met en scène la vengeance d’une femme frustrée dans l’entreprise où elle a charge de « remodeler les comportements ». La narration manque encore parfois de clarté, mais la matière est excellente et j’ai comme l’impression qu’Antonin, dans le sillage de Michel Houellebecq, est en train de faire un bon pas en direction d’une littérature plus ouverte que naguère, moins confinée dans la compulsion névrotique.
Regarder. – C’est l’injonction essentielle que je retiens de nos enfances : « Regardez ! » Et si je m’intéresse aujourd’hui à l’étymologie du mot regard je constate ceci que je pressentais : qu’il ne s’agit pas simplement de voir, au sens de zyeuter, mais de garder, de prendre et de conserver, de garder au sens de veiller et de protéger, de préserver en soi et pour le transmettre ; tout à l’opposé vivant du voyeurisme qui n’est que morne consommation : contemplation active et consumation.
(Ces note sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître chez Olivier Morattel en avril 2012).

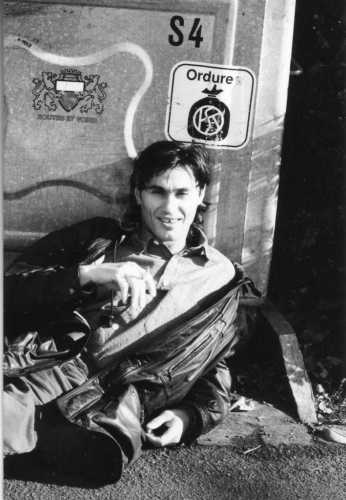
 À La Désirade, ce samedi 2 août. - Rentré à quatre pattes, vers deux heures du matin, après une soirée bien amicale et bien arrosée chez nos voisins. C’est donc un peu vaseux que je me suis rendu à Aubonne pour y assister à la projection du Génie helvétique, le nouveau film du jeune Jean-Stéphane Bron, que j’ai beaucoup apprécié. C’est, de fait, un remarquable aperçu du fonctionnement de la démocratie suisse, où cinq parlementaires de tendances différentes sont suivis de très près durant la discussion, en commission, d’une loi sur le génie génétique. Ce qui me frappe chez Bron, comme chez les gens de son âge, est son absence totale de préjugés idéologiques et, cependant, l’acuité de son regard sur le monde social et politique.
À La Désirade, ce samedi 2 août. - Rentré à quatre pattes, vers deux heures du matin, après une soirée bien amicale et bien arrosée chez nos voisins. C’est donc un peu vaseux que je me suis rendu à Aubonne pour y assister à la projection du Génie helvétique, le nouveau film du jeune Jean-Stéphane Bron, que j’ai beaucoup apprécié. C’est, de fait, un remarquable aperçu du fonctionnement de la démocratie suisse, où cinq parlementaires de tendances différentes sont suivis de très près durant la discussion, en commission, d’une loi sur le génie génétique. Ce qui me frappe chez Bron, comme chez les gens de son âge, est son absence totale de préjugés idéologiques et, cependant, l’acuité de son regard sur le monde social et politique. De l’âge. - Ma bonne amie me dit sa panique à l’idée de se trouver plus près de soixante ans que de cinquante, alors que sa mère évoque de plus en plus sa propre fin. Du coup je la rassure en lui faisant valoir que nous sommes encore des jeunes gens et avons des tas de choses à faire, avec plus de compétences qu’à vingt ou trente ans. Nous sommes en effet, tous deux, en bonne possession de nos moyens, sans discontinuer d’apprendre - et cela seul nous maintiendra jeunes: tous les jours apprendre. Dans la foulée, nous avons fait ensemble une grande balade en forêt.
De l’âge. - Ma bonne amie me dit sa panique à l’idée de se trouver plus près de soixante ans que de cinquante, alors que sa mère évoque de plus en plus sa propre fin. Du coup je la rassure en lui faisant valoir que nous sommes encore des jeunes gens et avons des tas de choses à faire, avec plus de compétences qu’à vingt ou trente ans. Nous sommes en effet, tous deux, en bonne possession de nos moyens, sans discontinuer d’apprendre - et cela seul nous maintiendra jeunes: tous les jours apprendre. Dans la foulée, nous avons fait ensemble une grande balade en forêt. 

 Porosité de Pascale Kramer. - Il est certains livres qui vous laissent, en mémoire, une marque unique, et tel est ce Retour d'Uruguay de Pascale Kramer, qui a cela de particulier qu'il nous touche et nous trouble sans qu'il ne s'y passe grand-chose, ni que ses personnages soient particulièrement remarquables.
Porosité de Pascale Kramer. - Il est certains livres qui vous laissent, en mémoire, une marque unique, et tel est ce Retour d'Uruguay de Pascale Kramer, qui a cela de particulier qu'il nous touche et nous trouble sans qu'il ne s'y passe grand-chose, ni que ses personnages soient particulièrement remarquables.

 À Paris, ce 11 septembre 2001. - A Paris depuis hier soir, où je suis arrivé assez cuité ; et ce matin, en sortant du studio de la rue du Bac, voici que j’égare le livre manuscrit de mes carnets de mars à septembre 2001, plein de lettres personnelles et de belles aquarelles. Puisse celui qui tombera dessus me le renvoyer ou l’apporter aux objets trouvés, mais quelle poisse en attendant!
À Paris, ce 11 septembre 2001. - A Paris depuis hier soir, où je suis arrivé assez cuité ; et ce matin, en sortant du studio de la rue du Bac, voici que j’égare le livre manuscrit de mes carnets de mars à septembre 2001, plein de lettres personnelles et de belles aquarelles. Puisse celui qui tombera dessus me le renvoyer ou l’apporter aux objets trouvés, mais quelle poisse en attendant! omprends maintenant pourquoi certaine consoeur a tenté de me joindre mercredi passé. Il y est en effet longuement question de la polémique qui m’a opposé à Maître Jacques, lequel s’étale de long en large sur les raisons qui lui valent, selon lui, des ennemis. Sa façon de plastronner, et de poser même au saint, me paraît du plus éminent ridicule, et je suis ravi de n’avoir pas été atteignable l’autre jour. Ce qui me fait sourire, c’est que la journaliste responsable de la page a bien choisi la citation de L’Ambassade du papillon où je rive son clou à Chessex, notant que le prétendu renard a une grave marque de collier au cou – perfidie de ma part qui a dû l’enrager à mort. Or tout cela m’indiffère complètement à présent: ma bonne amie m’en a fait la lecture au téléphone, mais je n’ai même pas regardé la page...
omprends maintenant pourquoi certaine consoeur a tenté de me joindre mercredi passé. Il y est en effet longuement question de la polémique qui m’a opposé à Maître Jacques, lequel s’étale de long en large sur les raisons qui lui valent, selon lui, des ennemis. Sa façon de plastronner, et de poser même au saint, me paraît du plus éminent ridicule, et je suis ravi de n’avoir pas été atteignable l’autre jour. Ce qui me fait sourire, c’est que la journaliste responsable de la page a bien choisi la citation de L’Ambassade du papillon où je rive son clou à Chessex, notant que le prétendu renard a une grave marque de collier au cou – perfidie de ma part qui a dû l’enrager à mort. Or tout cela m’indiffère complètement à présent: ma bonne amie m’en a fait la lecture au téléphone, mais je n’ai même pas regardé la page... À Genève, ce 27 septembre. - A dix heures et demie ce matin, à la gare de Cornavin, j’ai fait la connaissance de Tariq Ramadan, qui m’a impressionné par la clarté de son analyse de la situation et la justesse de ses observations. On m’a dit que c’était un type dangereux, notoire agent d’influence des Frères Musulmans, mais ce qu’il m’a dit ne m’a guère paru d’un fanatique avéré.
À Genève, ce 27 septembre. - A dix heures et demie ce matin, à la gare de Cornavin, j’ai fait la connaissance de Tariq Ramadan, qui m’a impressionné par la clarté de son analyse de la situation et la justesse de ses observations. On m’a dit que c’était un type dangereux, notoire agent d’influence des Frères Musulmans, mais ce qu’il m’a dit ne m’a guère paru d’un fanatique avéré.



 Lectures d'avant l'aube
Lectures d'avant l'aube
 De seize à vingt ans ils ont tous rêvé d’Amérique mais seuls quelques-uns sont partis, et, maintenant que le temps a passé, ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus voient le pays autrement du fait que ceux qui sont revenus parlent de ce qu’ils ont vu là-bas et du pays dont ils se sont langui avant de le retrouver, et le pays est embelli d’avoir été quitté parce que le pays est vu d’Amérique, un garçon tendre encore voit l’homme dur qu’il admire en secret lui dire que les femmes de là-bas ne valent pas celles de la montagne ici quand le printemps fait bander les gars, et celui qui est revenu pose sa main sur l’épaule du plus jeune et lui murmure que nul pays n’est plus beau que les Langhe les soirs d’été, mais ce qu’il raconte est aussi fait pour chasser le plus jeune de l’ennui de ces collines, fous le camp mon garçon, ne reste pas, réponds à l’appel de la rue, ne reste pas seul avec les vieux, va tenter ta chance, va vivre ta vie…
De seize à vingt ans ils ont tous rêvé d’Amérique mais seuls quelques-uns sont partis, et, maintenant que le temps a passé, ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus voient le pays autrement du fait que ceux qui sont revenus parlent de ce qu’ils ont vu là-bas et du pays dont ils se sont langui avant de le retrouver, et le pays est embelli d’avoir été quitté parce que le pays est vu d’Amérique, un garçon tendre encore voit l’homme dur qu’il admire en secret lui dire que les femmes de là-bas ne valent pas celles de la montagne ici quand le printemps fait bander les gars, et celui qui est revenu pose sa main sur l’épaule du plus jeune et lui murmure que nul pays n’est plus beau que les Langhe les soirs d’été, mais ce qu’il raconte est aussi fait pour chasser le plus jeune de l’ennui de ces collines, fous le camp mon garçon, ne reste pas, réponds à l’appel de la rue, ne reste pas seul avec les vieux, va tenter ta chance, va vivre ta vie…







 Aux dernières nouvelles, j’ai constaté qu’Alina Reyes avait fermé son site, après avoir fermé son blog depuis un certain temps déjà. A-t-elle eu raison ? Sans doute, en ce qui la concerne, et son livre l’illustre évidemment. Mais a-t-elle raison de réduire ceux qui pratiquent la blogosphère à des rats morts ? Je ne le crois pas. D’ailleurs les accents qui se veulent prophétiques, dans le genre catastrophiste, de Forêt profonde, sont à mes yeux la partie la plus faible du livre, et qui vieillira vite n’était-ce que par ses lourdeurs d’écriture, alors que le souffle de l’Eros, le souffle de la vie et le souffle de l’amour en traversent mainte pages superbes et qu’on relira demain.
Aux dernières nouvelles, j’ai constaté qu’Alina Reyes avait fermé son site, après avoir fermé son blog depuis un certain temps déjà. A-t-elle eu raison ? Sans doute, en ce qui la concerne, et son livre l’illustre évidemment. Mais a-t-elle raison de réduire ceux qui pratiquent la blogosphère à des rats morts ? Je ne le crois pas. D’ailleurs les accents qui se veulent prophétiques, dans le genre catastrophiste, de Forêt profonde, sont à mes yeux la partie la plus faible du livre, et qui vieillira vite n’était-ce que par ses lourdeurs d’écriture, alors que le souffle de l’Eros, le souffle de la vie et le souffle de l’amour en traversent mainte pages superbes et qu’on relira demain.
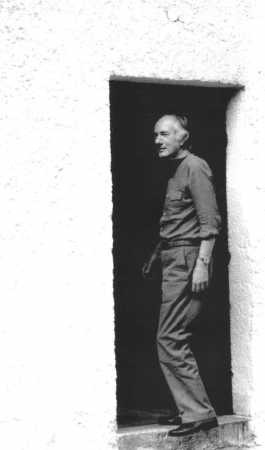

 - Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?
- Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?





 Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…
Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…
 Un paresseux fécond
Un paresseux fécond