 De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.
De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.
À La Désirade, ce jeudi 5 avril 2012. – Longuement et bien dormi en dépit de sciantes crampes. Fait ce rêve curieux d’un nouveau journal littéraire publié par une poétesse genevoise connue, entièrement consacré à sa propre célébration, avec des portraits sophistiqués de sa chère personne dans le style glamoureux du Studio Harcourt. Or je me demande, une fois de plus, comment cristallisent les rêves et plus précisément, en l’occurrence, comment un contenu polémique si précis a pris forme à partir des sentiments certes peu tendres que m’inspire le bas-bleu en question. J’enquêterais si j’étais moins paresseux.
Dans l’immédiat je préfère aborder le dernier recueil d’essais de Simon Leys, Le Studio de l'inutilité, dans lequel je trouve (notamment) un éclairant aperçu de la « belgitude » d’Henri Michaux, une approche de Simone Weil dont l’amicale admiration a rapproché Czeslaw Milosz et Albert Camus, et la mise en boîte carabinée de Roland Barthes après son mémorable voyage de 1974 en Chine, avec l’équipe de Tel Quel.
J’avais déjà bien ri en lisant Les Samouraïs de Julia Kristeva, qui en donne une relation hilarante de jobardise, par exemple quand je ne sais plus lequel de ces éminents intellectuels se demande pourquoi le Pouvoir chinois les a invités, à quoi Philippe Sollers répond que la caution de l’intelligentsia parisienne aux options du Pouvoir en question justifie probablement cette invitation...
Or Simon Leys rappelle que cette excursion d’idiots utiles correspond à une période de répression féroce accrue dont aucun de ceux-là n’a pipé mot. Mieux : dans un commentaire à ses notes de voyage, d’une insipidité abyssale, Roland Barthe justifie sa servilité en donnant du galon à un « discours ni assertif, ni négateur, ni neutre » et à « l’envie de silence en forme de discours spécial ».
À ce « discours spécial » de vieille dame gâteuse se tortillant dans son étole de mohair, Simon Leys répond en vrai Belge non moins spécial : « M. Barthes définit avec audace ce que devrait être la vraie place de l’intellectuel dans le monde contemporain, sa vraie fonction, son honneur et sa dignité : il s’agit, paraît-il, de maintenir bravement, envers et contre « la sempiternelle parade du Phallus » de gens engagés et autres vilains tenant du « sens brutal », ce suintement exquis d’un tout petit robinet d’eau tiède ».
Dans le numéro de janvier 2009 du Magazine littéraire, Philippe Sollers affirmait que les carnets chinois de Barthes reflétaient en somme la « décence ordinaire » célébrée par Orwell. Mais Simon Leys y voit plutôt « une indécence extraordinaire » et cite Orwell pour qualifier le non moins extraordinaire aveuglement d’une certaine intelligentsia occidentale face au communisme, d’Aragon en Union soviétique à Sartre léchant les bottes de Castro: « Vous devez faire partie de l’intelligentsia pour écrire des choses pareilles ; nul homme ordinaire ne saurait être aussi stupide »…
Mais il va de soi que Simon Leys gardera sa réputation d’« anticommuniste primaire », même sachant ce que nous savons aujourd’hui des crimes de la Révolution culturelle aux centaines de milliers de victimes, et qu’il incombe au très candide et très élastique Sollers de nous expliquer aujourd’hui, dans le Nouvel Ob’s de cette semaine, comment devenir Chinois…
Simon Leys. Le studio de l’inutilité. Flammarion, 301p.
Livre - Page 123
-
Contre les idiots utiles
-
Une visite à Patricia Highsmith
Cette petite maison de pierre au toit couvert d’ardoises, serré dans ce bled perdu que surplombent de hautes et farouches pentes boisées de châtaigniers roux, sur l’ubac du val Maggia, est vraiment le dernier endroit où l’on imaginerait le gîte d’une romancière américaine mondialement connue dont le dernier livre paru, Catastrophes, traite des aspects les plus noirs de la vie contemporaine. Pour arriver à sa porte, j’ai traversé toute la Suisse, hier, ralliant Locarno d’où, par le car postal jaune flambant, j’ai débarqué à l’arrêt du bord de la rivière, à vingt minutes de marche d’Aurigeno, après quoi je n’avais plus qu’à suivre les indications téléphonées à voix toute douce : le chemin du haut, la fontaine et, visible tout à côté, la porte verte dont le heurtoir est une délicate main de femme…
Il y avait longtemps, déjà, que je rêvais de rencontrer Patricia Highsmith. J’avais à témoigner à cette dame une reconnaissance personnelle, parce qu’elle m’avait apporté, comme à tant d’autres sans doute, quelque chose de vital à un moment donné : ce regard vrai sur le monde, à la fois implacable et tendre, conséquent et générateur de compréhension.
Et puis il y avait, aussi, le sempiternel malentendu à dissiper une fois de plus, de l’auteur policier aux succès amplifiés par le cinéma, et forcément déclassé dans les rangs de la littérature mineure alors que Graham Greene la tenait, à juste titre, pour un authentique médium poétique de l’angoisse humaine.
Comme si le seul suspense épuisait l’intérêt du Journal d’Édith, ce très émouvant portrait de femme brisée par le manque d’amour de son entourage, sur fond d’Amérique moyenne à l’époque de la guerre du Viêt-nam. Et comme si L’Empreinte du faux, son meilleur livre peut-être, ou Les Deux Visages de Janvier, Ce mal étrange ou Ceux qui prennent le large, son préféré à ce qu’elle me dira, nous intéressaient par leur intrigue criminelle. En réalité, les livres de Patricia Highsmith, comme les récits de Tchekhov ou les romans de Simenon, constituent autant de coups de sonde dans les zones sensibles de la psychologie humaine, où les dérives individuelles recoupent les névroses collectives de notre temps.
Le meilleur exemple en est d’ailleurs donné par le dernier livre de celle que je suis venu débusquer, intitulé Catastrophes et réunissant des nouvelles d’une même noirceur pessimiste, où l’auteur traite les thèmes des excès de la recherche médicale et de l’élimination des déchets nucléaires, de la pagaille sévissant dans les pays décolonisés, des conflits politico-religieux liés à l’apparition des femmes porteuses ou de l’ouverture cynique, dans l’Amérique des gagnants, des asiles d’aliénés déversant soudain sur le pays des hordes de fous à lier.
On m’avait dit, bien entendu, que la dame n’était pas toujours commode. À supposer qu’elle fût, dans la vie, aussi féroce que dans ses livres, et précisément dans ce tout dernier, il y avait certes de quoi trembler. De surcroît, j’avais un peu de retard à l’instant de me présenter à notre rendez-vous, n’ayant pas prévu la complication des correspondances. Ainsi m’aura-t-on puni de près de trois quarts d’heure d’attente, au point de m’inquiéter d’avoir fait ce long voyage en vain. Mais non: la porte de la petite maison a bel et bien fini par s’ouvrir sur une frêle vieille dame lippue, aux traits ravagés et à l’air méfiant, qui m’a invité à la précéder dans un sombre escalier donnant sur deux pièces modestes, la première agrémentée d’une immense vieille cheminée et la seconde, minuscule, entièrement occupée par deux tables de travail guignant vers le ciel, par-dessus les toits et les monts enneigés.
Comme je lui avais amené de petits cadeaux, à commencer par un joli dessin d’escargot de notre fille Julie et un jeu de tarots déniché la veille dans une brocante de Muralto, la redoutable ermite s’est bientôt radoucie.
Deux heures durant, je me suis efforcé, avec mon pauvre anglais, de la faire parler de son œuvre, quitte à brusquer sa réserve pudique. De fait, Patricia Highsmith n’aime guère parler d’elle-même. En revanche, elle s’anime dès qu’on aborde d’autres sujets. Simenon, par exemple, qu’elle estime un auteur vraiment sérieux, et sur lequel elle m’a longuement interrogé, tout excitée par ce que je lui ai raconté de l’homme et de mes lectures. Ou bien le monde actuel, dont elle suit les événements avec beaucoup d’attention même si, m’explique-t-elle, sa peur du sang (!) l’oblige à proscrire la télévision de chez elle. Engagée dans la mouvance d’Amnesty International, elle se dit écœurée par ce qui se passe dans les territoires occupés par Israël. Stigmatisant l’attitude des dirigeants, elle clame en outre sa honte de ce que les États-Unis participent à l’écrasement des Palestiniens.
Lorsque je lui ai demandé ce qu’elle aspirait à transmettre à son lecteur, elle m’a répondu modestement qu’elle aimerait lui suggérer une nouvelle façon de voir les choses, tout en espérant lui procurer le simple bonheur de lire. L’interrogeant sur les qualités humaines qu’elle met le plus haut, elle m’a cité la patience et l’honnêteté, et, loin de me snober lorsque je lui ai demandé en quel animal elle aimerait se voir réincarnée, l’auteur du Rat de Venise m’a répondu très sérieusement qu’elle aimerait être un éléphant dans son milieu naturel, à cause de son intelligence et de sa longue vie, ou bien un petit poisson dans un récif de corail.
Comme nous évoquions le glauque personnage de Ripley, je l’ai interrogée sur ce qu’elle pensait des motivations qui poussent selon elle les gens aux actes criminels. Alors elle d’affirmer que la plupart des crimes s’enracinent dans le besoin profond, chez l’individu, de rétablir la justice foulée au pied.
Sans redouter l’aspect incongru d’une telle question, je l’ai priée de me dire ce qu’elle dirait à un enfant qui lui demanderait de lui décrire Dieu. D’une voix douce, et avec le plus grand sérieux, elle m’a alors expliqué qu’elle dirait de Dieu, à l’enfant, que c’est un nom qui signifie beaucoup de choses. Que Dieu a été inventé par l’homme primitif qui cherchait à surmonter ses peurs élémentaires. Qu’elle chercherait à faire comprendre à l’enfant que chacun devrait être respectueux de tous les dieux que les peuples divers ont inventés et vénérés. Enfin qu’elle s’attacherait à expliquer à l’enfant que, tout au moins idéalement, un aspect important de l’idée de Dieu, exprimé par la Bible, se résume par l’injonction : « Aime ton prochain »…
(Cette visite date de 1989. Son évocation figure dans Les passions partagées, recueil de carnets paru chez Bernard Campiche) -
L'ombre du Mal
De la résistance. - Il s’agit de ne pas mépriser, sans cesser d’entretenir colère et révolte. La foutaise ambiante m’incline au décri, mais éviter le mépris. Pourtant il s’agit également de ne pas faiblir et de continuer à se battre. En ce qui concerne mes travaux, le recentrage est urgentissime. Je dois cesser de tout prendre sur moi, toujours au détriment de mon travail; mon activité alimentaire doit retrouver sa place seconde.
Ulysse fut une façon pour Joyce de recycler tous les débris de nos croyances et de nos savoirs explosés. Pour sa part, Joyce résistera au désenchantement par l’accroissement proportionnel de la jouissance du langage.
William Trevor est de ceux qui nous prouvent, tout tranquillement, qu’il est encore possible d’écrire après Joyce.
Celui qui se garde d’avoir le dernier mot par simple dandysme spirituel / Celle que les coqs insupportent sauf au lit ou au vin / Ceux que les débats binaires à la française ont toujours fait hausser les épaules, etc.
De la grossièreté. - Dès les premiers récits du jeune Tchékhov, on sent, sous forme bouffonne, une protestation contre la grossièreté et la muflerie de la vie russe. Or j’ai autant d’observations à faire autour de moi sur la grossièreté et la muflerie de mes contemporains, à cela près que les modulations en ont changé. La vulgarité actuelle se couvre de termes accommodants, style relax, etc.
Bush & Co. - Fahrenheit 9/11 de Michael Moore fait ressortir l’imbécillité de George W. Bush de façon saisissante. Terrible de penser que ce type est le maître du monde occidental. Terrible et significatif en cela qu’il incarne, avec une sorte d’arrogance inepte de fils à papa, le règne du Dieu Dollar et rien que cela.
De l’avenir radieux. – Au lieu de jeter les mots usés tu les réparerais comme d’anciens objets qui te sembleraient pouvoir servir encore, tu te dirais en pensant aux enfants qu’il est encore des lendemains qui chantent, tu te dirais en pensant aux cabossés qu’il est encore des jours meilleurs, tu ramasserais vos jouets brisés et tu te dirais, en te rappelant ce que disaient tes aïeux : que ça peut encore servir, et tu retournerais à ton atelier et le verbe rafistoler te reviendrait, et le mot te rappellerait le chant du rétameur italien qu’il y avait à côté de chez vous, et tout un monde te reviendrait avec ce chant – tout un monde à rafistoler…
Génie du mal. - En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assassin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait».
Je relève la phrase: « Les gens se pourlèchent de ce genre de chose ». Mais plutôt que de « crime parfait», s’agissant de Tom Ripley, je dirais: meurtre utilitaire et presque indifférent, pour ne pas avoir d’ennui.
A un moment donné, dans Ripley et ses ombres, il est question de Tom comme de la « source mystique du mal », et tout est dit je crois. Tom Ripley est une sorte d’homme sans qualités à la sauce américaine: sans conscience et sans désir, juste animé par une espèce d’instinct d’adaptation et de conservation, avec une touche esthète qui lui fait apprécier les belles et bonnes choses. Devenu tueur par inadvertance, ou peu s’en faut, il a continué de se défendre en supprimant les obstacles matériels ou humains qui l’empêchent de vivre tranquillement.
Je n’avais pas du tout saisi, jusque-là, sa nature complexe, simplement faute d’être allé à la source du personnage, dans Mr. Ripley. C’est là, seulement, qu’on découvre l’origine de ses complexes et de son ressentiment, là qu’on voit que sa vision du monde distante et cynique découle de la carence, dans sa vie d’enfant et d’adolescent, de toute espèce d’affection – comme l’a vécu la romancière.
C’est en somme un nouvel avatar de l’homme du ressentiment que Tom Ripley, qui s’arrange comme il peut avec l’adversité. Il a commencé de tuer à regret. Puis il a continué quand on l’embêtait. Graham Greene parlait, de Patricia Highsmith, comme d’un poète de l’angoisse. J’ajouterai que, comme Graham Greene, mais en agnostique, c’est également une romancière du mal.
Du mariole. – Il a la gueule du vainqueur avant d’avoir livré le moindre combat : d’avance il piétine, d’avance il s’imagine qu’il dévaste et cela le fait saliver, d’avance il se voit campé au premier rang, le front crâne - il se sent vraiment Quelqu’un ce matin dans la foule de ceux qu'il appelle les zéros...
Moralisme romand. - A tout ce que dit Alexandre Vinet de l’assèchement cérébral des philosophes de profession, je souscris. Mais Vinet voudrait moraliser la littérature, et là je ne le suis plus. Son côté vieille fille, qui prétend que seuls les esprits vulgaires veulent « toucher, palper », alors que ce sont ceux qui touchent et palpent, les Ramuz et les Cendrars ou les Cingria qui marqueront le renouveau de la littérature en Suisse romande.
Me sens de plus en plus libre et, en même temps, de plus en plus lié à ma bonne amie - vraiment le coeur du coeur de ma vie.
Du roman actuel. - Dans une vaticination assez fumeuse de la fin des années 50, Céline affirme que le roman contemporain n’a plus rien à nous apprendre, dans la mesure où toute information est désormais filée par le journalisme, le reste relevant de la « lettre à la petite cousine ». Mais je crois, pour ma part, qu’il a tort, et les romans d’un Philip Roth, d’un J.M. Coetzee ou d’un Amos Oz en sont l’illustration.
Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, en imminente voie d'impression aux bons soins de l'imprimeur Gasser du Locle, pour Olivier Morattel.Images: Patricia Highsmith et sa machine à écrire
-
Zigzags du Coyote
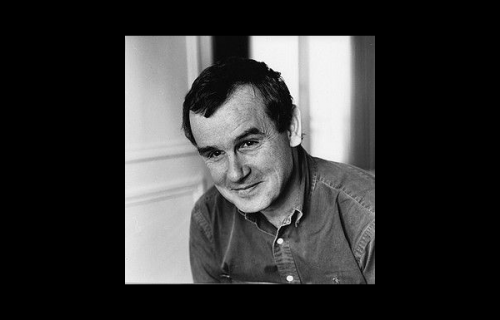
La terre est l'oreille de l'ours - journal kaléidoscopique de Jil Silberstein, à valeur de « célébration du vivant »
Jil Silberstein fut gratifié, par la compagne de sa vie – son «Aimée» comme il l’appelle - du surnom-totem de coyote. «Mico», alias Monique Silberstein, prématurément arrachée à la vie en 2006, avait vu juste. Il y a en effet du chien sauvageon en Jil, perpétuellement inquiet et curieux, affamé, à la fois hardi et peureux (c’est lui qui le dit), mélange de Rantanplan juvénile et de Croc-Blanc sans âge n’en finissant pas de perdre et de retrouver le Nord - le Grand Nord de préférence.
Au commencement de cet extraordinaire bouquin (au sens propre de l’extravagance du vivant, rompant avec l’ordinaire mortifère) que représente La Terre est l’oreille de l’ours, Jil fume sa pipe à la lisière d’une forêt de Moudon, non loin de la ferme qu'il habite avec Mico. Nous sommes en mars 2005, départ d’une espèce d’immense journal éclaté, bousculant la chronologie et qui marque le premier rendez-vous du voyageur avec la forêt et sa décision de la retrouver, de l’arpenter et d’en dresser l’inventaire physique et métaphysique. Magique royaume et lieu de retrouvailles avec les Esprits-maîtres vénérés par les Indiens du Québec-Labrador qui, entre 1992 et 1996, lui ont appris la forêt, le dépeçage du caribou, la sagesse terrienne et les vertus calmantes du tabac inspirateur. Les kids des Innus fument leur clope sans trop se soucier désormais du bois sacré: «Au mieux, le bois c’est le fun!». Mais notre coyote urbain n’en démord pas au seuil de ce «royaume conjuguant ombre, fraîcheur, silence, luxuriance, fragrances, pépiements, craquements, radieuses trouées de lumière»...
De nouvelles racines
Jil le coyote a pas mal trotté de par le monde au moment où, bientôt sexa, il entreprend ce «journal» à double valeur de bilan et de nouvelle alliance avec le Vivant. Quand il débarque de Paris, où il a vu le jour en 1948, à Genève puis à Lausanne, c’est un jeune dingo fou de grandes lectures (il tutoie Bernanos et Simone Weil, Georg Trakl et Dylan Thomas) dont les premiers poèmes, incandescents et hirsutes - le premier recueil s'intitule Exacerber l’instant - paraissent à L’Age d’Homme. S’il a déjà de grands voyages derrière lui, le coyote jette de nouvelles racines en Suisse romande, publie un tas d'articles un peu partout (jusque dans les colonnes de 24Heures), dirige une revue, reprend la librairie La Proue aux escaliers du Marché, travaille dans l’édition (à L’Age d’Homme puis chez Payot), publie une vingtaine de livres oscillant entre poésie et réflexion. Entretemps il rencontre son alter ego féminin, journaliste de radio qu’il suivra aux Etats-Unis et avec laquelle il partagera ses passions et en développera une nouvelle, pour la Nature. Dans les années 90, les voyages reprendront et plusieurs séjours à valeur initiatique, chez les Innus , en Guyane et dans la taïga, où l’enquête anthropologique recoupe le plaidoyer pour les peuples menacés et la nature saccagée. Autant d’expériences qui participant d’un grand voyage à consonances spirituelles, que marque soudain la maladie mortelle (lymphome de Burkitt) fatale à l'Aimée en quelques mois. Dans un petit livre bouleversant, Une vie sans toi (L'Age d’Homme, 2009), Jil Silberstein a filtré son indicible douleur. Or cette «tache aveugle» d’une vie joyeusement partagée accentue, par contraste noir, le tableau du «vivant» retrouvé dans la vaste chronique kaléidoscopique de La Terre est l’oreille de l’ours. Le coyote nous fait pleurer quand il pleure son Aimée, et rire aussi de lui, avec son côté Bouvard et Pécuchet découvrant la forêt. L'écrivain-poète touche souvent à l’épiphanie, nous fait sourire avec ses résolutions de vieil ado moralisant, nous émerveille par ses curiosités infinies, de Kerouac à Li Po en passant par le singe capucin de Servion - enfin le coyote nous fait zigzaguer dans sa foulée !
Jil Silberstein. La terre est l’oreille de l’ours. Noir sur blanc, 480p.
-
Au filtre du Temps
De la recréation. – Il est clair que c’est en Italie que vous avez écrit les meilleures choses sur l’Islande et dans ses carnets de Cape Code qu’elle a le mieux parlé de la foule japonaise - seul le Christ écrivait sur le sable hic et nunc : eux c’est toujours ailleurs et d’ailleurs qu’ils auront griffonné leurs poèmes : Walt Whitman claquemuré dans sa chambre et Shakespeare au pub, et chacun de vous est un autre, il y a plein ce matin de Verlaine dans la rue d’Utrillo, mais ce n’est que trois ans plus tard que je le noterai dans une salle d’attente d’aérogare, je ne sais encore où, alors que je note à l’instant ces pensées de l’aube devant une image de crépuscule…
Tchekhov en vérité. - Il y aura juste cent ans, le 2 juillet prochain, qu'Anton Pavlovitch Tchekhov s'éteignait dans la Villa Friederike de la petite station thermale de Badenweiler, en Forêt-Noire, à l'âge de 44 ans, vingt ans après le premier crachement de sang que la tuberculose lui arracha. Durant la nuit du 1 er juillet, Tchekhov se réveilla et, pour la première fois, pria son épouse Olga d'appeler un médecin. Lorsque le docteur Schwöhrer arriva, à 2 heures du matin, le malade lui dit simplement « Ich sterbe », déclinant ensuite l'offre qui lui fut faite d'une bouteille d'oxygène. En revanche, Tchekhov accepta de boire une flûte du champagne que son confrère médecin avait fait monter, remarqua qu'il y avait longtemps qu'il n'en avait plus bu, s'étendit sur le flanc et expira.
La suite des événements, le jeune Tchekhov aurait pu la décrire avec la causticité qui caractérisait ses premiers écrits. De fait, c'est dans un convoi destiné au transport d'huîtres que la dépouille de l'écrivain fut rapatriée à Moscou, où les amis et les proches du défunt avisèrent, sur le quai de la gare, une fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n'était pas destinée à Tchekhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie, dont la dépouille arrivait le même jour. Une foule immense n'en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de l'écrivain porté par deux étudiants.
En janvier de la même année, la dernière pièce de Tchekhov, La cerisaie, avait fait l'objet d'un succès phénoménal. L'interprétation de la pièce, à laquelle le metteur en scène Constantin Stanislavski avait donné des accents tragiques, déplut cependant à Tchekhov qui s'exclama: « Mais ce n'est pas un drame que j'ai écrit, c'est une comédie et même, par endroits, une véritable farce !»
Ce n'était que le dernier d'une longue série de malentendus qui avaient marqué les rapports de Tchekhov avec ses contemporains, avant de se perpétuer à travers les années. L'image d'un Tchekhov poète de l'évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, survit en effet dans le cliché du « doux rêveur », qui vole au contraire en éclats dès qu'on prend la peine de l'approcher vraiment.
En ville, ce 8 juillet. — Ma paranoïa se calme. Evoquant mon travail dans le journal, et plus précisément la présentation des livres, le rédacteur en chef m’a dit que j’étais irremplaçable. Voilà ce qu’il a dit à moi le rédacteur en chef: que j’étais irremplaçable. Irremplaçable il a dit le rédacteur en chef que j’étais. Et moi qui me trouvais proche de me mettre en situation d’être remplacé, que non pas: je suis irremplaçable. Et voilà comment on soigne la paranoïa : suffit d’un biscuit.
Dispositifs. - Un père de famille, dans son chalet de La Lenk, abat son épouse et ses deux petites filles avant de retourner son arme contre lui. L’événement, inattendu dans ce bled touristique sans histoires, a traumatisé l’entourage du couple, bien connu et apprécié. Un cellule de soutien psychologique a été mise sur pied. En remplacement pour deux heures dans un établissement secondaire, un jeune homme de vingt-cinq ans a semé le trouble dans une classe de jeunes filles en parlant sexe et en regrettant de ne pouvoir montrer le sien à ces demoiselles. Diverses mères en ont été bouleversées. Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied.
En ville, ce 9 juillet. - Notre grande petite Julie en pleurs hier. Son ami la traite en Balkanique. La délaisse de plus en plus au profit de ses copains, et lui reproche de ne pas s’occuper assez de lui. Elle doit pressentir qu’à long terme cette relation sera difficile, tant est énorme la différence entre eux qui va s’accentuer encore à proportion de l’incapacité du lascar à évoluer. Elle devra se conformer au modèle de la femme dominée et soumise au seigneur couillu, mais je la vois mal s’y résigner. Dès cet automne, elle s’émancipera au contraire en fréquentant la faculté de droit. Du moins sera-t-elle déjà mieux préparée à se défendre que n’importe quelle oie blanche.
Fait d’été. - Le Matin de ce matin consacre une page à une vieille dame, à Genève, qui a coupé les ailes à un petit martinet qu’elle a recueilli, pour l’empêcher de la quitter. Touchant. Mais la femme de chambre a cafté. Les institutions animalières s’indignent.
Lady L. - Un monde sans femme est une horreur, j’entends: sans ma bonne amie, qui incarne à mes yeux le contraire de l’emmerdeuse, genre chienne de garde ou patte à poussière.
À Sempach, ce 20 juillet. —Parti en voiture de service à destination de Brunnen, pour assister ce soir à la répétition du Guillaume Tell de Schiller, sur la prairie historique du Grütli, j’ai fait étape dans cette charmante ville dont le lac est battu au marteau de forgeron par un vent noir. Terrasses à touristes. Prix exorbitants. Huit franc le verre de rouge. Vitello tonnato précédé d’un potage suisse allemand. En fait ne me sens pas tout à fait de ce pays, même si je lui trouve du charme. A côté de la Stadtkeller de Sempach, jouxtant le monumental monument au héros Winkelried, se trouve le restaurant chinois Ching Chang. Un peu plus loin un panneau indicateur annonce: Schlacht. Tellement plus évocateur, ce mot, que « bataille ».
Soir. — Après avoir maudit ce pays encaissé sous la pluie, je l’ai béni ce soir en assistant à la représentation du Guillaume Tell de Schiller sur la prairie mythique du Grütli. Des tribunes élevées face au lac et aux montagnes, j’ai appelé Alfred Berchtold qui m’a dit redouter la trahison à la mode. Mais non: contre toute attente, c’est simplement la pièce qu’on donne là en version certes stylisée, mais avec de bons acteurs et quelques moments de réelle densité émotionnelle. Avec les Mythen en toile de fond, tandis que le jour déclinait sur ce paysage romantique à souhait et tout chargé d’histoire, la pièce de Schiller m’est apparue comme un grand hymne à la liberté et non du tout comme une célébration patriotarde.
Chassé-croisé. - Sous le titre d’Exit, le court métrage de Benjamin Kampf raconte les derniers instants de deux vieillards décidés à en finir ensemble. Enfin « décidés »: on comprend que c’est la femme, dominant son jules, qui l’a convaincu de la suivre dans la tombe alors qu’elle-même est condamnée. En présence de l’envoyée de l’agence Exit, alors que la vieille a demandé à son conjoint de leur mettre un disque, sur la musique suave duquel elle l’invite à danser une dernière fois, l’homme se cabre soudain et change d’avis. Du coup, la vieille, vexée et fâchée, avale son verre de substance létale et s’en va s’allonger comme prévu, bientôt suivie par son époux tout culpabilisé ; et les voilà gisant enfin tendrement l’un auprès de l’autre « malgré tout ». Cela traité avec une sorte de réalisme poétique, tendre et cruel, à la William Trevor.
(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel).
-
Un chant de survie
 Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.
Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.«Ce qu’on ne peut dire, il faut le taire», écrivait le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Petite phrase énigmatique, sous son air d’évidence, qui ressurgit à chaque fois que nous sommes confrontés à ce qui est désigné désormais par la formule d’«horreur absolue».
Comment dire celle-ci ? Comment dire l’atroce réalité d'un accident arrachant soudain vingt enfants à leurs parents. Comment ne pas rester «sans voix» à l’annonce de tels drames ? À plus grande échelle, comment dire la triple catastrophe du tremblement de terre, du tsunami et des explosions de centrales nucléaires qui se succédèrent, il y a un an de ça, dans la région japonaise du Tohoku, dont le seul nom de Fukushima (étymologiquement «l’île de la Fortune»...) symbolise désormais la tragédie «civile», comme Hiroshima en reste l’emblème guerrier ?
Or, voici qu’un livre, rien qu'avec des mots, les mots du coeur et les mots de la poésie, dit sur Fukushima ce que n’ont pas dit des millions d’images et des milliers d’articles. Voici que l’indicible stupéfaction, l’indicible malheur et l’indicible mélange de révolte et de résignation se trouvent exprimés par un lettré surfin pas vraiment «programmé» pour ça. Prof d’université à Tokyo depuis une vingtaine d'années, Michaël Ferrier, quadra d’origine franco-indienne, s’est déjà fait connaître par quelques livres certes remarquables par leur qualité d’écriture et l’originalité des observations portées par l’auteur sur le Japon. Mais la date du 11 mars aura marqué, sans doute, un tournant décisif dans sa vie et son oeuvre.
Comme si, tout à coup, le tremblement de terre l’avait investi du génie d’exprimer ce qui ne peut se dire: «À tombeau ouvert, tout ça bourdonne et branle, mille crocodiles en cavale et des cataractes de rossignols». Comme si la puissance cosmique de la nature, que d’aucuns prétendent désormais soumise à l’homme, lui inspirait un nouveau souffle épique. En écrivain puissant, il décrit ensuite le déchaînement des eaux sur une côte aux paysages enchanteurs et l’engloutissement de villages et de villes réduits à d’inimaginables tas de débris.
Comme une conversion

Et puis c’est en homme solidaire, avec son amie Jun qui l’a rejoint sous une table dès le premier séisme, que le portera le sentiment le plus faternel vers ses semblables. Sur le terrain, des côtes dévastées au sanctuaire de Fukushima, il revivra ce qu’en 1964 le grand Kenzaburo Oè vécut, comme une véritable conversion, à la rencontre des victimes d’Hiroshima. Ainsi Michaël et Jun vont-t-ils écouter des rescapés de tous âges et conditions. Ces témoignages sont parfois à pleurer, souvent aussi à hurler de rage en constatant l’omertà entretenue autour du nucléaire. Fukushima, récit d’un désastre, devient alors acte d’accusation, accumulant les preuves accablantes, autant pour les pontes japonais que pour un Sarko minaudant sur la «pertinence du nucléaire».
A fines touches extrêmement incisives et sensibles, où l’horreur approchée fait d’autant mieux ressortir la merveille de vivre (jamais le couple n’aura si bien fait l’amour qu’en retrouvant Kyoto, quelques jours après l’effroi), Michaël Ferrier achève son récit par une réflexion à valeur universelle intitulée La demie-vie, mode d’emploi: «La demi-vie nucléaire: une mort à crédit, Une longue existence de somnambule, toute une vie dans les limbes». Inutile d’ajouter que Fukushima plaide pour la vie rendue à sa beauté et à sa fragile plénitude, contre la domestication consentie.
Michaël Ferrier. Fukushima, récit d’un désastre. Gallimard, coll.L’Infini, 262p.
-
Aux couleurs d'un sage
Hermann Hesse à Montagnola, et ces jours au Kunstmuseum de Berne.
La belle saison se réfracte dans ce livre solaire: «Cet été est une fournaise digne de l’Inde, y lit-on par exemple. Même le lac a perdu depuis longtemps sa fraîcheur, mais tous les jours, en fin d’après-midi, une brise souffle sur notre plage; il est alors rafraîchissant de se baigner dans les vagues puis de rester debout, nu, en plein vent. C’est l’heure où, souvent, je descends ces pentes qui mènent à la plage. Je prends parfois avec moi un bloc de papier à dessins, une boîte d’aquarelle ainsi que des provisions et un cigare pour rester là toute la soireé.»
Ces lignes sereines, préludant à l’évocation sensuelle et pudique à la fois de jeunes filles au bain, Hermann Hesse les écrivait en été 1921, deux ans après son installation dans un petit palazzo baroque, «mi-comique, mi-majestueux» de Montagnola, au Tessin (Suisse méridionale) où il allait positivement renaître. Après le désastre de la guerre, durant laquelle il s’était épuisé en tâches humanitaires et en écrits pacifistes, l’écrivain avait quitté sa femme (internée dans un hôpital psychiatrique de Zurich pour schizophrénie) et ses trois jeunes fils (confiés à des amis ou placés en internat) afin de donner la «priorité absolue» à son travail littéraire. C’est au Tessin, où il vécut la seconde moitié de sa vie, qu’il écrivit la plupart des livres qui établirent sa renommée mondiale, consacrée en 1946 par le Prix Nobel, et c’est à Montagnola qu’il s’éteignit en 1962.
Au charme du Tessin, consommant la fusion du nord et du sud (il dira même y retrouver l’Inde, l’Afrique et le Japon...), Hesse avait déjà goûté en 1905, lors d’une randonnée pédestre, et en 1907, où il suivit une cure naturiste au fameux Monte Verità d’Ascona. Lorsqu’il y revient en 1919, après le «grand naufrage», l’ex-père de famille propriétaire n’est plus qu’un «petit écrivain sans le sou» qui se sent «étranger miteux et vaguement suspect», se nourrissant de lait, de riz et de macaronis, «portant ses vieux costumes jusqu’à ce qu’ils s’effrangent et ramenant, à l’automne, son souper de la forêt sous forme de châtaignes.» Loin de se plaindre, au demeurant, le poète célèbre les bienfaits de la vie en «amoureux du monde» porté à la sublimation de ses pulsions.
«Nous autres vagabonds, écrit-il alors, sommes rompus à l’art de cultiver les désirs amoureux précisément parce qu’ils ne sont pas réalisables, et cet amour qui devrait revenir à la femme, à le dispenser par jeu au village, aux lacs et aux cols de montagne, aux enfants du chemin, au mendiant près du pont, aux troupeaux sur l’alpage, à l’oiseau, au papillon. Nous détachons l’amour de son objet, l’amour lui-même nous suffit, de même que, dans nos errances, nous ne cherchons pas le but mais la joussances, le simple fait d’être par monts et par vaux.»
Ces accents lyriques préfigurent Le dernier été de Klingsor (1920), où la magie tessinoise sera très présente, et le sentiment de la nature romantico-bouddhiste qu’on retrouvera dans Siddharta (1922). On pense aussi aux émerveillements et aux pointes de rebellion d’un Robert Walser (très apprécié d’ailleurs par Hesse) en suivant l’écrivain au fil de ses promenades et des digressions jamais conventionnelles qu’il en tire dans ces écrits publiés par les quotidiens alémaniques ou allemands de l’époque. Loin de se dissoudre dans la jouissance égotiste, Hermann Hesse reste en efet bien virulent contre les philistins, notamment dans la cinglante Lettre hivernale envoyée du midi à ses amis berlinois où il fustige les «profiteurs de guerre» et autre bourgeois encourageant le poète crève-la-faim d’un sourire hypocritement paternaliste.«Je ne suis pas un très bon peintre, écrit Hesse dans un texte de 1926, je ne suis qu’un amateur; mais dans toute celle vallée, ajoute-t-il aussitôt, il n’y a pas une seule personne qui connaisse et aime mieux que moi les visages des saisons, des jours et des heures, les plissements du terrain, les dessins de la rive, les caprices des sentiers dans les bois, qui les garde comme moi précieusement en son coeur et vive avec eux autant que je le fais». Dans un des poèmes émaillant ce recueil de proses, intitulé Le Peintre peint une usine dans la vallé, la vision plastique de l’écrivain-aquarelliste se prolonge tout naturellement par les mots d’une feinte naïveté: «Tu est très belle aussi dans la verte vallée,/Usine, abri pourtant de tout ce que j’abhorre:/Course au gain, esclavage, amère réclusion». Ainsi salue-t-il le «tendre bleu, /bleu passé sur les murs des modestes demeures/A l’odeur de savon, de bière et de marmaille!», avant de lancer en finalement que «le plus beau, c’est bien la rouge chemineée/Dressée sur ce monde stupide,/Belle, fière, jouet ridicule,/Cadran solaire de géant».
Or, se défendant de poser au maître (même si certaines de ses aquarelles ont parfois la grâce lumineuse de celles d’un Louis Moillet ou du Klee des paysages stylisés, en beaucoup plus gauche), Hermann Hesse ne transmet pas moins, par la couleur, une vision du Tessin qui enchante le regard.
Partiellement inédit dans notre langue, ce livre dense et limpide est à la fois une plongée roborative dans l’univers d’un poète au verbe pur et bienfaisant, et une conversation passionnante avec un homme libre et formidablement vivant. La remarquable postface de Volker Michels, qui a dirigé la présente édition, ajoute encore à l’intérêt de cet ouvrage plus que bienvenu.
Hermann Hesse, Tessin. Proses et poèmes, avec 16 aquarelles polychromes et 2 photos hors texte. Traduit de l’allemand par Jacques Duvernet. Editions Metropolis, 345pp. -
Le cauchemar de l’homme fini
Retour sur Les Bienveillantes, cinq ans après...
Pour Bruno, qui a 18 ans, et pour Alban qui en a 20, et pour Quentin qui en a 22.
Je suis sorti de la lecture des Bienveillantes avec un sentiment d’insondable et froide tristesse qui m’a rappelé le muet effroi que j’ai éprouvé, à vingt ans, en découvrant Auschwitz. Pour la première fois de ma vie, à Auschwitz, m’est apparu quelque chose de réel que je ne pouvais concevoir dans mon irréalité de jeune idéaliste des années 60. Quelque chose d’immense et d’écrasant. Pas du tout les baraquements minables que j’imaginais : d’énormes constructions en dur, de type industriel. L’usine à tuer : voilà ce que j’ai pensé ; et je remarquai que dans la cour de l’usine à tuer désaffectée se débitaient des saucisses chaudes. Surtout : quelque chose d’impalpable, d’invisible et de non moins réel. Quelque chose d’impensable et d’indicible mais de réel.
J’avais vu, déjà, les images terribles de Nuit et brouillard, je savais par les livres ce qui s’était passé en ces lieux, dont je découvrirais plus tard d’autres témoignages, tels ceux du film Shoah. Mais ce que j’ai ressenti de réel à Auschwitz, comme je l’ai ressenti en lisant Les Bienveillantes, tient non pas aux pires visions mais à ce quelque chose d’impalpable et d’indicible, plus quelques pauvres détails : ces tas de cheveux, ces tas de dentiers ou de prothèses, ces tas d’objets personnels. Ces saucisses aussi. Et dans Les Bienveillantes : ce pull-over que le protagoniste a oublié quand il se rend, en Ukraine, sur les lieux d’un massacre de masse où il risque d’avoir un peu froid, pense-t-il soudain…
Or songeant à l’instant à la façon la plus juste d’exprimer le sentiment personnel que laisse en moi la lecture des Bienveillantes, je repense à ces mots notés par mon ami Thierry Vernet dans ses carnets : « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou biens ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».
Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ».
Max Aue est-il jamais né à lui-même ? Un seul épisode amoureux avec sa sœur jumelle Una, à l’adolescence, a cristallisé une passion absolue qu’il tentera vainement de revivre. Sodomisé à l’internat où sa mère et son beau-père, qu’il hait également, l’ont casé pour le punir de son inconduite incestueuse, l’homme jouira par le cul, c’est le mot cru et vrai, sans aimer quiconque, jusqu’à la rencontre d’Hélène, à la toute fin de la guerre, à l’amour de laquelle il ne parviendra pas à répondre après être mort à lui-même sans être né. Sa fantasmagorie infantile culminera dans l’Air d’avant la Gigue finale, où Max se retrouve seul dans la maison vide de sa sœur, en Poméranie, en proie à un délire onaniste autodestructeur.
Il y a de l’impubère ressentimental et du voyeur impatient de vivre toutes les expériences-limites, chez Max Aue, comme chez le Stavroguine des Démons de Dostoïevski. Ce chaos intérieur de l’avorton affectif, fils oedipien d’un grand absent dont on lui révélera les propres crimes de guerre, n’a pas empêché Max Aue d’accomplir de bonnes études de droit (en Allemagne, d’où il est originaire par son père), suivies d’une carrière dans la SS qui le conduit du front de l’Est aux plus hautes sphères de l’Etat, où il finira dans l’entourage immédiat du Reichsführer Himmler et autres Eichmann ou Speer. Vu par ses pairs, Max Aue fait figure d’élément compétent, du genre « intellectuel compliqué », juste un peu froid et rigide, et décidément lent à se marier. Mais rien chez lui du fanatique obtus ou du sadique. Lors des premières « actions » auxquelles il assiste, Max est de ceux qui vivent mal les massacres. S’il y participe, c’est par devoir et soumission à la visée civilisatrice du national-socialisme, au nom du Volk sacro-saint. Pourtant on perçoit à tout moment la fragilité idéologique de cet esthète plus attaché à la philosophie (il lit Tertullien), à la musique (Bach et Couperin) et à la littérature (Stendhal, Blanchot et Flaubert) qu’aux dogmes racistes du régime. Tout au long de la guerre, sa spécialité consiste à rédiger des rapports : sur la loyauté de la France (un premier séjour à Paris le fait rencontrer les collabos Brasillach et Rebatet), la nécessité ou non de liquider les Juifs du Caucase, le moral des troupes dans le « chaudron » de Stalingrad ou l’utilisation des déportés dans la guerre totale. Une scène inoubliable exprime la dualité schizophrénique du personnage : lorsque tel vieux savant juif tchétchène, avec lequel il s’entretient en grec ancien, le conduit sur une colline où un songe lui a révélé l’endroit de sa mort, qu’il tue sans comprendre la parfaite sérénité du saint homme.
D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».
La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.
Jonathan Littell. Les Bienveillantes. Gallimard, 903p. Réédité en Poche Folio en décembre 2007. No 4685. 1401p. -
Ceux qui naviguent aux étoiles

Celui qui reste fixe comme le pivot de l’éventail / Celle qui veille à l’heure de l’Oiseau / Ceux qui entendent la flèche à sifflet retomber dans la mer après avoir atteint sa cible / Celui qui reste ZEN dans la confusion ambiante / Celle qui progresse à l’intuition et régresse au raisonnement / Ceux qui ne se laissent pas démonter par la mer hors d’elle / Celui qui évite de monter les tours quand la sous-offe s’énerve / Celle qui te rappelle volontiers la scène de Chaplin où l’Adolf et le Benito se défient sur leurs chaises de coiffeur / Ceux qui en reviennent toujours à l’apparente impassibilité (tu parles !) de la Nature / Celui qui consacre une minute matinale quotidienne devant la fourmilière de la forêt voisine pour se rappeler qu’oncques agitement ou branle jamais n’arrangea que pouic / Celle qui ne se laisse pas entraîner sur les voies du stress en dépit de sa qualité d’entraîneuse de l’équipe féminine de freeride Les Battantes / Ceux qui détendent l’atmosphère en rotant dans la télécabine bondée / Celui qui pratique le rap mental dans les transports communs où le silence est d’or / Celle qui a perdu sa boussole mais pas le nord pour autant / Ceux qui savent s’orienter d’après la mousse des troncs et se retrouvent donc becs dans l’eau dans la forêt calcinée / Celui qui consacre sa vie à l’étude d’un seul papillon en pleine conscience polyphonique de la multitude des espèces y compris dans les fosses océaniques / Celle qui dit qu’elle jouit chaque fois que l’hostie se dépose sur le bout rose de sa langue par ailleurs bien pendue et tendue dans le French Kiss / Ceux qui ont cru trouve The Guide à l’école coranique d’à côté avant de découvrir les mérites du Routard / Celle qui ne voit point d’insulte dans l’expression « bosser comme un nègre » en tant que nettoyeuse sénégalaise exploitée par la firme Guerlain / Ceux qui ont fait de l’antiracisme un nouveau fonds de commerce pseudo-moral ou littéral / Celui qui traite volontiers ses amis de négros (hein Bona, hein Maxou ?) juste pour faire chier les ennemis de la liberté / Celle qui prétend que les Suédois ne sentent rien et les évite par conséquent mais il y a des exceptions Votre Honneur / Ceux qui évitent de dire que les Français ou les Suisses sont cons vu que c’est pas tous et pas tous les Danois non plus ni les Sénégalais ni même les Belges enfin quoi, etc.
Image : Philip Seelen
-
Chez les Jaccottet

À La Désirade, ce 1er janvier 2001. - Réveil un peu barbouillé dans les bras tout tendres de ma bonne amie, puis je me rendors après avoir lu quelques pages du Côté de Guermantes. Ensuite levé vers deux heures. Tout redevient intéressant.
(Soir). - Commencé ce soir de lire Pilgrim, du romancier canadien anglais Timothy Findley dont j’ai déjà lu Le dernier des fous et Chasseur de têtes, qui m’ont également passionné. En l’occurrence, ce roman modulant lui aussi une douce folie qu’on pourrait dire à la gloire de l’imagination romanesque, dans la filiation de Nabokov, avec plein d’anges et de papillons d’ailleurs, nous plonge à travers les siècles pour évoquer une sorte de présent perpétuel vécu par les avatars successifs de Pilgrim, alias le pèlerin, psychopathe selon nos codes qui commence par se pendre, dans les années 20 à Londres, au moyen de la ceinture de son peignoir de soie bleue solidement attachée à la solide branche d’un solide érable de la taille d’un solide immeuble de trois étages, et qui revit ensuite comme après tous ses suicides précédents, dès l’époque de Léonard de Vinci et de sa Joconde qu’il a bien connus. Dans le genre de l’éternel retour, qui m’a toujours paru l’idée d’un fou furieux, on ne fait pas plus entêtée malice car il y a là-dedans beaucoup d’humour tendre et d’intelligence incarnée.
Du romancier. - Un romancier doit oser être bête autant que minutieux et précis. Certaine idiotie (mais rusée, s’entend) est pour ainsi dire la clef de son rapport avec le monde. Il ne doit pas être plus intelligent que le commun. Sans faire la bête, il doit se laisser aller à la naïveté ou aux élans irraisonnés, à tout ce qui fait l’imprévu de la vie et des êtres.
De l’obscénité. - Après cet assez obscène défilé de mode à la TV, inspiré par la danse de derviches-tourneurs, on se demande: à quand la messe en dessous affriolants ?
Celui auquel sa mère reproche d’être né et qui en meurt / Celle qui se sent si seule après la mort de son mari / Ceux qui ont désiré la baise à mort, et qui en sont morts, etc.
À La Désirade, ce 5 janvier. – Je m’attarde ce matin sur la page de Moravagine consacrée au règne de la femme - règne du masochisme selon le narrateur. En fait Cendrars confond (selon moi) guerre des sexes et relation amoureuse, passion maladive et compréhension réciproque. Je sais qu’il y a du vrai dans ce qu’il dit (que disaient déjà Strindberg et Weininger, ou l’ami Gripari) mais cette vision du monde est néanmoins réductrice (à mes yeux). C’est peut-être bien une des lois de l’antagonisme des sexes qu’elle désigne, mais ce qui m’intéresse est tout ce qui, dans le lien vécu, la transgresse et la sublime, l’acclimate ou la pacifie. Pour ma part je me contentais de lancer à celle que je croyais alors la femme de ma vie : « Arrête ton cinéma ! », ensuite de quoi j’ai lancé à celle qui l’aura bel et bien été: « Arrêtons ce cirque ! »
Celui qui a laissé venir l’immensité des choses / Celle qui a pris les lettres de bois découpé pour en faire des caravanes / Ceux que le mot CARAVANES a fait rêver, etc.
Qu’un roman est l’histoire de nos possibles.
 Montélimar, ce 14 janvier. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais.
Montélimar, ce 14 janvier. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais.En entendant Philippe Jaccottet me dire qu’il est de ceux qui ont choisi de viser haut, je me suis senti comme exclu, comme renvoyé aux basses zones du commun, loin du ciel céleste des poètes, et j’ai pensé à l’image de la rose bleue à laquelle, injustement et justement à la fois, Dürrenmatt réduit la poésie poétique de Suisse romande. Mais bon : je suis quand même venu rendre visite au grand poète, les Jaccottet m’ont très gentiment reçu et je ferai une belle page dans 24 Heures sans rien laisser filtrer de ma réserve de malappris.
Je note cela sur la table d’un restauroute nul où j’ai décidé de passer la nuit. Médiocre repas bon marché. Bergerac caillouteux. À une table voisine, une retraitée terriblement bavarde (la soixantaine finissante) fait une véritable conférence sur le cinéma (Marlon Brando, Orson Welles, la décadence actuelle) à son conjoint qui n’en place pas une. Tous deux en survêtements. Elle finit son cours ex cathedra par un exposé des moeurs du coucou. Je n’en perds pas un mot.
Pleine de retraités à 19h.30, la salle est quasiment déserte deux heures plus tard. Que font-ils à l’instant ? Regardent-ils tous le même film ?
L’écriture romanesque pour sortir de soi.
 Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.
Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.La lumière de Grignan, un dimanche après-midi d’hiver, comme assourdie sous le ciel pur, dans les rues vides du bourg puis dans la chambre à musique de la vieille maison tout en hauteur où habitent les Jaccottet depuis plusieurs décennies - cette lumière du dehors se prolongeant à l’intérieur nous renvoie naturellement aux promenades du poète et aux tableaux de Madame. «Nous voulions vivre autrement qu’en Suisse, remarque Anne-Marie Jaccottet. Nous étions attirés par le Sud et, comme nous avions peu de moyens, nous avons imaginé cette solution».
Comme nous évoquons l’origine de la parole poétique, à propos de la rêverie sur laquelle s’ouvre le Cahier de verdure, où le poète parle de ce qui le pousse à écrire «pour rassembler les fragments plus ou moins lumineux et probants, d’une joie dont on serait tenté de croire qu’elle a explosé un jour, comme une étoile intérieure, et répandu sa poussière en nous», Philippe Jaccottet s’est mis à parler, non sans précautions scrupuleuses, avec son refus coutumier de toute certitude assenée, de ce qui s’est révélé dans la lumière de Grignan, et tout semble s’accorder.
De la beauté. – Il n’y a pas une place pour la beauté : toute la place est pour la beauté, du premier regard de l’enfance aux paupières retombées à jamais, et la beauté survit, de l’aube et de l’arbre et des autres et des étoiles de mémoire, et c’est un don sans fin qui te fait survivre et te survit.
De la bonté. – Il n’y a pas une place pour la bonté : toute la place est pour la bonté qui te délivre de ton méchant moi, et ce n’est pas pour te flatter, car tu n’es pas bon : tu n’es un peu bon parfois que par imitation et délimitation, ayant enfin constaté qu’il fait bon être bon.
De la vérité. – Il n’y a pas une place pour la vérité : toute la place est pour la vérité qui t’apparaît ce matin chiffrée comme un rébus – mon premier étant qu’elle me manque sans que je ne sache rien d’elle, mon second qu’elle est le lieu de cette inconnaissance où tout m’est donné pour m’approcher d’elle, et mon tout qu’elle est cette éternelle question à quoi se résume notre vie mystérieuse est belle.
Peintures: Giorgio Morandi; Anne-Marie Jaccottet.
(Ces notes sont extraites de Chemins de Traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril chez Olivier Morattel).
-
Révérence à Antonio Tabucchi
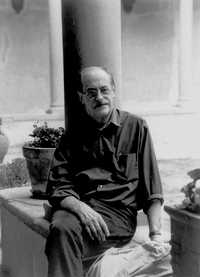
L’auteur de Pereira prétend a succombé à la maladie à Lisbonne, à l’âge de 68 ans.
C’est un des auteurs majeurs de la littérature italienne contemporaine qui vient de s’éteindre au Portugal en la personne d’Antonio Tabucchi, auteur de quelques livres «cultes» dont Pereira prétend , Nocturne indien ou Requiem, initialement rédigé en portugais. La mort du Toscan Tabucchi à Lisbonne n’a rien, à ce propos, de fortuit, puisque l’écrivain italien entretenait, avec le Portugal et sa langue, une relation privilégiée dominée par la grande figure tutélaire de Fernando Pessoa et l’amitié vivante d’Antonio Lobo Antunes. Il disait même avoir été adopté par le Portugal autant qu’il l’avait adopté. Dans ce jeu de filiations et d’affinités électives, on rappellera en outre que la «sonate» onirique de Requiem, qui se déroule à Lisbonne un dimanche caniculaire de juillet, évoque précisément la figure de Pessoa, méconnu de son vivant et considéré aujourd’hui comme le plus grand poète portugais du XXe siècle. Or le même Requiem a fait l’objet d’une adaptation, au cinéma, de Bernard Comment, traducteur fréquent de Tabucchi, et Alain Tanner.
Le livre le plus fameux de Tabucchi, Pereira prétend (Bourgois, 1995), s’enracine également dans le sol lusitanien et l’histoire du salazarisme, au fil de la remémoration lancinante d’un vieux journaliste solitaire revisitant son passé.
Beaucoup plus récents, deux autres romans admirables, Il se fait tard, de plus en plus tard (Gallimard, 2002) et Tristan meurt (Gallimard, 2004) font écho à ce récit mêlant lucidité et mélancolie et marquant peut-être le sommet de l’art du romancier.
Conteur « postmoderne » raffiné et érudit dans la lignée de Calvino et de Borges, Antonio Tabucchi, qui enseigna longtemps à Sienne et laisse quelque vingt cinq livres souvent traduits, excellait aussi dans la forme courte et les variations singulières, dans un esprit qu’il reliait lui même à la tradition baroque. Ainsi captait-il des Petits malentendus sans importance (Bourgois, 1987) et jouait volontiers sur des mises en abymes temporelles ou topologiques, se plaisant aussi à inventer des Autobiographies d’autrui (Seuil, 2003) ou des Rêves de rêves (Bourgois, 1994), avec un art singulier et une poésie baroque.
-
Ceux qui "réalisent"

Celui que le tremblement de terre a raffermi dans son respect amoureux de la Nature / Celle qui redécouvre la beauté du monde après le séisme / Ceux qui sont devenus tambours à l’unisson du monde en deux minutes et sept secondes cet après-midi du 11 mars 2011 /Celui qui lit couché dans la lumière éclaircie par la neige du Mont Fuji / Celle qui a offert ses lèvres au Professeur avec lequel elle s’est réfugiée sous la table juste avant l’effondrement des bibliothèques / Ceux qui ont découvert qu’on pouvait être à la fois reporter et poète et lisant les Notes de Hiroshima de Kenzaburo Oé et Fukushima de Michaël Ferrier / Celui qui décrit un début de séisme en évoquant « un bruit de mandibules, ténu et formidable, un langage de termites », puis « trente millions de hannetons et de cigales, de coccinelles et de grillons, tout un peuple d’insectes archaïques – criquets, chenilles, pucerons et papillons prenant possession de la table et de sa chaise, des meubles, des murs, avec une fureur de bestioles » / Celle qui vit en grabataire cette charge de « tout un tas de bourrins qui galopent », ce « troupeau de buffles poursuivis par des taons » (…) mille crocodiles en cavale et des cataractes de rossignols » / Ceux qui constatent interdits que « les choses les plus belles et les plus fragiles tombent les premières » / Celui que les mots aident à réaliser comme on dit en anglais / Celle qui a cru son heure venue et qui en est revenue sans voix / Ceux qui tremblent encore en racontent le tremblement et redoublent en se rappelant les répliques du tremblement / Celui qui a découvert la beauté du poisson-lanterne au creux de la vague noire / Celle que le flot a déposé sur l’arête rouge de la pagode / Ceux qui ont conservé un savoir de grotte / Celui qui devine la magnitude à l’oreille / Celle qui se remémore la peur de ses ancêtres au matin du 8 juillet 868 quand la terre trembla et fit s’écrouler les tourelles du palais impérial / Ceux qui voient en le séisme un boxeur à poings innombrables / Celui qui a téléchargé l’application capable de lui annoncer quand son plafond va s’effondrer dans à pei près cent secondes / Celle qui lisant Life and Opinions of Tristram Shandy quand son verre de tisane calmante s’est mise à trembler en crescendo maestoso / Ceux qui prennent un pain de béton sur la gueule alors qu’ils venaient de se beurrer / Celui qui lit la chronique du Grand Séisme du XIIe siècle dont parle le Dit de Heike et plus précisément ce qu’il advint entre l’heure du Sanglier et celle du Rat / Celle qui entend exploser la Centrale dans son bain moussant / Ceux qui refusent de participer à la fuite des Traders, etc.
(Cette liste a été jeté dans les marges de Fukushima, récit d’un désastre, de Michaël Ferrier, jusqu’à la page 68. À suivre…)
-
Ceux qui restent distants

Celui qui porte une cravate invisible même à la piscine / Celle qui dit « vous »à son gigolo et à son mainate / Ceux qui ménagent leurs avants / Celui qui s’excuse après son coup de boule à la flûtiste haltérophile / Celle qui pousse le respect humain jusqu’à la sévérité vieille France / Ceux qui sont bons comme le scout mais pas poires / Celui qui se montre digne comme le dindon de la duègne / Celle qui repasse les plats sans faire d’histoires / Ceux qui s’enhardissent en vain à provoquer la Maréchale / Celui qui invoque sa dignité de SDF à particule / Celle qui reste froide même plaquée à chaud / Ceux qui ne cassent rien même en se la pétant / Celui qui suit l’actualité au télescope / Celle qui fait approcher le coupable à portée de voix et le tance virulemment / Ceux qui ne sauraient confondre French Kiss et familiarité déplacée / Celui qui se retient de faire jouir la soprano colorature à cause des voisins sourds à l’art lyrique / Celle qu’insupporte la curiosité du retraité à questions précises dans l’escalier des buanderies / Ceux qui s’aiment dans la vapeur des lessiveuses / Celui qui stresse à l’approche de l’Inspection des ongles incarnés / Ceux qui ont renoncé à s’incarner par indolence surnaturelle / Celui qui s’interroge sur le cybersexe des anges / Celle qui ne fait que passer mais à distance n’est-ce pas… , etc.
Image : Philip Seelen
-
Chemins de traverse
Lectures du monde 2000-2005
Du Verbe, du souffle de la vie et de quelques notes jetées en passant
L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini, notait Charles-Albert Cingria, et cette formule m’accompagne depuis des décennies comme une belle approximation.
De fait j’ai appris, à travers les années, à me méfier de toutes les définitions de l’écriture, avec ou sans majuscule. Il me suffit d’ouvrir la Bible n’importe où, ou de lire n’importe quel texte dit sacré pour que toute définition de l’écriture soit balayée par le même souffle, et qu’on ne me parle pas de « peuple du Livre », car à mes yeux tout l’homme aspire au Livre d’un seul souffle.
Le souffle de la vie est autre chose. Le Verbe est une chose et le souffle de la vie est autre chose. Le vent dans l’herbe ou sur le sable est une chose et les mots pour l’évoquer participent d’autre chose. Notre vie est une chose et les notes que nous prenons pour ne pas oublier ceci ou cela de notre journée est autre chose. Une femme de vingt ans qui se fait agresser à la hache pendant une nuit d’été est un fait divers et c’est une chose, mais ce que cette femme en oubliera pour se protéger et survivre, ou ce qu’elle s’en rappellera et en écrira pour s’en délivrer est une autre chose qui peut nous délivrer aussi dans le même effort de mémoire et d’attention.
Cette question de l’attention est à mes yeux essentielle, et plus encore aujourd’hui qu’hier dans la mesure où la mémoire sous tous ses aspects se disperse aux zéphyrs du virtuel et de l’actuel alors même qu’on la célèbre au titre de travail ou au titre de devoir. Comme souvent aujourd’hui, la chose est d’autant plus invoquée qu’elle tend à se perdre ou à s’émietter – à se stocker entre fichiers et dossiers.
Or la mémoire n’est pas qu’un stock ou un vrac. La mémoire est un être vivant. La mémoire est une personne et plus encore : la chaîne des personnes et la somme des vivants. La mémoire est universelle et nous traverse, mais le lieu de la mémoire est unique et c’est le Verbe, à tous les sens de l’expression humaine car il y a un Verbe de la parole orale ou écrite comme il y a un verbe des formes et un verbe de la musique, par delà les mots.
Au commencement était le Verbe, dit l’Evangile, et cela s’écrit avec majuscule. Autre chose est le verbe sans majuscule, que ne porte pas le grand souffle sacré mais qui participe lui aussi du souffle de la vie comme je l’entends.
Lorsque j’ai commencé de prendre ces notes, vers 1965, donc entre seize et dix-huit ans, j’avais déjà conscience d’accomplir une espèce de rite sacré, sans prendre la pose pour autant. D’ailleurs en ces années la Bible m’ennuyait, dont je ne percevais pas le souffle initial. Le côté sacré du verbe sans majuscule m’atteignait en revanche à la lecture de Cendrars ou d’autres poètes ou romanciers ; vers mes treize ans j’avais commencé de mémoriser des centaines et des milliers de vers, les images de Baudelaire ou de Rimbaud alternaient avec les aventures de Bob Morane ou de San Antonio, la lecture de Vipère au poing d’Hervé Bazin m’avait saisi à quatorze ans, puis me saisit celle d’ Alexis Zorba de Nikos Kazantzaki à seize ans - déjà je me sentais à la fois de plusieurs âges et de plusieurs pays et mon attention éveillée, avivée, affûtée par ce début de lecture du monde, hors de toute autre école que buissonnière, cherchait les mots qui traduiraient mes émois et mes effrois, les peines et les joies de tous.
Ces notes, qui voudraient capter le souffle de la vie ont été consignées, dès le tournant de ma vingtième année et jusqu’aujourd’hui, dans une centaine de carnets constituant un journal de plus en plus « extime », quand bien même le lieu de l’intimité serait à mes yeux une source inextinguible de poésie. Ces notes, bon an mal an, sont devenues la base continue de ma présence au monde et de mon activité d’écrivain, cristallisant, et de plus en plus consciemment, comme d’un ouvrage concerté dans le temps et « avec le Temps », la substance infiniment variée de la vie vécue au jour le jour. Mon travail s’est déployé dans la narration romanesque et d’autres formes de l’expression littéraire, mais ces « journaliers », pour faire écho à ceux de Marcel Jouhandeau ou aux journaux respectifs de Paul Léautaud, de Jules Renard ou d’Amiel, aux notes de Ludwig Hohl ou plus essentiellement encore aux Feuilles tombées de Vassily Rozanov, correspondent le mieux à l’expression kaléidoscopique de ma perception du monde.
John Cowper Powys évoque ce « journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature », et l’on s’en voudrait de retirer sa majuscule à celle-ci. Mais la Littérature est une chose, et la vie littéraire autre chose à tout moment tributaire de la foire aux vanités ; et là encore, le souffle de la vie nous aide à faire la part de ce qui compte et de ce qui passe.
La Vérité avec majuscule est une chose, qui n’appartient pas à l’écrivain, et nos vérités sont autres choses, que le souffle de la vie porte et transforme au fil du Temps.
À cet égard on verra, dans ces pages, combien les tribulations individuelles momentanées, parfois marquées par l’humeur, voire la violence, s’apaisent avec le temps. De tumultueuses relations personnelles avec tel ou tel ami, de méchantes querelles littéraires avec tel autre personnage en vue, retrouvent leur juste proportion avec le recul des années et rien, finalement, ne me semble à regretter, au point que c’est avec la même indulgence acquise, le même haussement d’épaules, le même pardon affectueux que je considère, pour ma part, ceux avec lesquels j’ai parfois été en conflit à travers ces années – je pense surtout à Vladimir Dimitrijevic, qui fut mon plus cher ami et dont je me suis éloigné afin de préserver ma liberté, et à Jacques Chessex, avec lequel j’ai peut-être été trop dur et qui ne l’a pas moins été à mon égard - mais le souffle de la vie balaie toute rancœur et voici que, par delà les eaux sombres, je n’ai plus pour ceux-là que reconnaissance au nom de nos passions partagées.
Après la publication, en l’an 2000 et aux bons soins de Bernard Campiche, de L’Ambassade du papillon, reprenant mes carnets de 1993 à 1999 sans insertion d’aucune sorte - l’original manuscrit se trouvant juste élagué de quelques centaines de pages -, et celle des Passions partagées, en 2004, remontant trente ans auparavant (de 1973 à 1992) et modulant une forme plus composite nécessitée par le chaos personnel de mes notes de jeunesse et l’apport substantiel de mes lectures, un troisième recueil, intitulé Riches Heures et sous-titré Blog-notes 2005-2008, parut en 2009 à L’Age d’Homme à l’instigation de Jean-Michel Olivier. À ce propos, je soulignerai la considérable stimulation qu’a été, dès juin 2005, l’ouverture d’un blog littéraire intitulé Carnets de JLK, accueillant à la fois une partie de mes notes et d’innombrables articles, proses de toute sorte, essais narratifs ou autres évocations de rencontres et de voyages, dans une forme souvent dictée par ce nouvel appareillage et les liens singuliers qu’il tisse avec une nébuleuse de lecteurs.
Comme il en va des recueils précédents, respectivement dédiés à Bernard Campiche et à Jean-Michel Olivier, ce nouvel ensemble de mes carnets, reprenant en deux tomes la matière des années 2000 à 2011, est le fruit d’une nouvelle collaboration amicale avec Olivier Morattel, dont la sollicitation enthousiaste m’a touché et que je remercie vivement pour son attention.
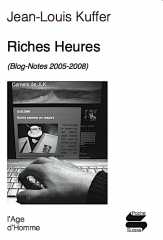 Cette attention, dont le manque représente une grande carence de notre époque, me disait un jour Maurice Chappaz, est à mes yeux le signe d’une qualité majeure, pour l’écrivain comme pour chacun : c’est une modulation de l’amour et de toute relation vraie. «Observer c’est aimer », écrivait encore Charles-Albert Cingria. En notre temps de fausse parole et d’atomisation généralisée, l’attention est une façon, purifiée de tout sentimentalisme et de toute idéologie, de lire le monde et de l’aimer, de refuser l’inacceptable et de dire ce qu’on estime le vrai.
Cette attention, dont le manque représente une grande carence de notre époque, me disait un jour Maurice Chappaz, est à mes yeux le signe d’une qualité majeure, pour l’écrivain comme pour chacun : c’est une modulation de l’amour et de toute relation vraie. «Observer c’est aimer », écrivait encore Charles-Albert Cingria. En notre temps de fausse parole et d’atomisation généralisée, l’attention est une façon, purifiée de tout sentimentalisme et de toute idéologie, de lire le monde et de l’aimer, de refuser l’inacceptable et de dire ce qu’on estime le vrai. La Désirade, en janvier 2012.
 (Ce texte constitue l'introduction de Chemins de traverse, à paraître fin avril aux éditions Olivier Morattel. Vernissage au Salon international du Livre de Genève, le 27 avril, de 17h. à 18h sur la scène de l'Apostrophe. Vernissage personnel au Sycomore, à Lausanne, le 2 mai, de 18h. à 21h.)
(Ce texte constitue l'introduction de Chemins de traverse, à paraître fin avril aux éditions Olivier Morattel. Vernissage au Salon international du Livre de Genève, le 27 avril, de 17h. à 18h sur la scène de l'Apostrophe. Vernissage personnel au Sycomore, à Lausanne, le 2 mai, de 18h. à 21h.) -
Orphée bicéphale


D'après Cocteau et Maïakovski, un spectacle total à Vidy, à voir, percevoir et écouter plus qu’à « comprendre »...
« Est-ce qu’il va falloir relire l’histoire d’Orphée ? », se demandait Pascal Couchepin à la sortie de la flamboyante première du Syndrome d’Orphée, mardi soir au théâtre de Vidy. Perplexe, l’ancien président de la Confédération, invité avec moult autres personnalités de marque, dont le Consul honoraire de Russie Frederik Paulsen ? Plus exactement : enthousiasmé par la « forme » et la puissance expressive de ce magnifique spectacle surtout musical et visuel. Un peu décontenancé, en revanche, comme une partie du public, par le « fond » du récit théâtral faisant se rencontrer, sur le chemin des enfers, deux poètes aussi différents (apparemment) que le furent Jean Cocteau et Vladimir Maïakovski.
Or Le Syndrome d’Orphée, conçu par le musicien et metteur en scène russe Vladimir Pankov, illustre bel et bien une parenté biographique et thématique entre ces deux grands lyriques achoppant à la modernité en usant des multiples moyens d’expressions nouveaux; tous deux anticonformistes, voire parfois provocateurs, contre l’esprit bourgeois pour Cocteau et contre la massification collectiviste pour Maïakovski. Enfin vivant chacun, en quelque sorte, le drame d’Orphée, chantre de la vie butant sur les miroirs vertigineux de la passion et de la mort. L’ombre de celle-ci a marqué la vie et l’œuvre de Cocteau, du suicide de son père à son Testament d’Orphée, notamment. Et la figure tragique du poète « phare » de la Révolution soviétique, « suicidé de la société » à son tour, participe d’un même éclat maudit qu’expriment ses fulgurances poétiques, où l’impact sonore et rythmique des mots compte plus que leur sens.
Rappelant le rêve de fusion des arts de l’avant-garde du XXe siècle, relancé dans les années 60 par l’aspiration à un théâtre « total», la réalisation de ce « soundrama » fait merveille dans sa partie musicale et vocale, intégrant des musiciens et des chanteurs d’opéra de haute volée, issus du studio SounDrama de Pankov et Olga Berger. Or cette coproduction du Théâtre de Vidy et du Festival Anton Tchekhov de Moscou, marquée par l’usage conjoint des langues française et russe (avec des surtitres pour celle-ci), engage également la participation de l’école Rudra-Béjart de Lausanne, avec une brochette de jeunes danseurs à la coule.
À relever alors qu’ en dépit du « scénario » quelque peu brouillon, d’une scénographie lourdingue et d’un recyclage de poncifs expressionnistes frisant le kitsch, la jeunesse et la verve, la passion, l’enthousiasme et le talent de l’interprétation, où brille notamment un angélique Heurtebise russe aux dons multiples, emportent finalement l’adhésion.
Théâtre de Vidy, jusqu’au 30 mars. A 19h sauf le vendredi, relâche le dimanche et lundi
-
Le génial bas-bleu

La vie de Madame de Staël est un roman carabiné. Fille de ministre, ennemie personnelle de Napoléon, cette sacrée tronche fut libérale, féministe et européenne avant tout le monde.
Ce pourrait être un prodigieux roman que celui de la vie de Madame de Staël. Avec une préface consacrée à une espèce de trinité familiale groupant une jeune femme de génie prénommée Germaine, sa digne mère lausannoise née fille de pasteur et sans fortune sous le nom de Suzanne Curchod, et son père Jacques Necker, banquier genevois richissime devenu ministre des finances de Louis XVI. Trois personnages hors du commun liés par un amour sublime et la même passion des lettres. Balzac aurait pu raconter le roman social de ce brillant trio de bourgeois accédant à l’aristocratie par le mariage (pas très heureux) de Germaine avec le baron de Staël. Tolstoï eût trouvé une belle matière dans la vie passionnée de Germaine et de ses amants de haut vol, sa fronde rebelle contre Napoléon et la cavalcade de ses exils à travers l’Europe. Et Proust se serait retrouvé lui aussi dans les salons prestigieux des Necker, à Paris, puis au château de Coppet où processionnèrent les meilleurs esprits.
 Or, cet extraordinaire roman existe bel et bien à l’état « virtuel », morcelé, et sous de multiples signatures. Simone Balayé en a rédigé le synopsis, en raccourci, dans un chapitre magistral de l’Histoire de la littérature romande (Payot, 1996) L’avocat académicien Jean-Denis Bredin, dans Une singulière famille, a brossé le triple portrait des Necker avant l’exil de 1793. Plus récemment, Michel Winock a consacré à Madame de Staël (Fayard, 2011) un très substantiel essai biographique illustrant l’importance de la pensée politique de « Mademoisele Saint-Ecritoire », selon le mot de Necker. Un ancien rédacteur en chef de 24Heures, Pierre Cordey, a pour sa part évoqué, avec beaucoup de sagacité sensible, Les relations de Madame de Staël et de Benjamin Constant au bord du lac Léman (Payot, 1966). Et sous la plume du même Constant, qui voyait en elle « de quoi faire dix ou douze homme distingués », le roman de Germaine se ramifie entre Adolphe, Cécile, son redoutable Journal intime et sa correspondance. Enfin l’œuvre de Madame de Staël elle-même (Slatkine, 3 vol, 1967) reste évidemment le corpus principal de cette saga imaginaire, touchant à tous les genres, du roman au théâtre et des essais aux témoignages d’époque, sans compter une correspondance fluviale.
Or, cet extraordinaire roman existe bel et bien à l’état « virtuel », morcelé, et sous de multiples signatures. Simone Balayé en a rédigé le synopsis, en raccourci, dans un chapitre magistral de l’Histoire de la littérature romande (Payot, 1996) L’avocat académicien Jean-Denis Bredin, dans Une singulière famille, a brossé le triple portrait des Necker avant l’exil de 1793. Plus récemment, Michel Winock a consacré à Madame de Staël (Fayard, 2011) un très substantiel essai biographique illustrant l’importance de la pensée politique de « Mademoisele Saint-Ecritoire », selon le mot de Necker. Un ancien rédacteur en chef de 24Heures, Pierre Cordey, a pour sa part évoqué, avec beaucoup de sagacité sensible, Les relations de Madame de Staël et de Benjamin Constant au bord du lac Léman (Payot, 1966). Et sous la plume du même Constant, qui voyait en elle « de quoi faire dix ou douze homme distingués », le roman de Germaine se ramifie entre Adolphe, Cécile, son redoutable Journal intime et sa correspondance. Enfin l’œuvre de Madame de Staël elle-même (Slatkine, 3 vol, 1967) reste évidemment le corpus principal de cette saga imaginaire, touchant à tous les genres, du roman au théâtre et des essais aux témoignages d’époque, sans compter une correspondance fluviale. Le roman du « Saint écritoire »
Le roman de Germaine de Staël écrivain (publié) commence à sa vingtaine avec des considérations enflammées sur Rousseau où perce déjà, pourtant, la protestation d’une féministe agacée par le « machisme » de Jean-Jacques. Sur la même ligne, en 1793, réfugiée à Coppet après les massacres de septembre 1792, elle publie de courageuses Réflexions sur le procès de la Reine où la même condition féminine est en cause. Mais c’est avec des essais plus ambitieux, où s’engage sa réflexion sur le bonheur lié à la liberté (De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, en 1796) et sur la fonction libératrice de la littérature en phase avec la vie et la dignité humaine (De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales) que s’affirment son éthique d’écrivain et son idéal républicain de justice.
Ses idées, héritées des Lumières mais révisées au vu des excès révolutionnaires, Germaine de Staël les fera passer aussi dans les pages, un peu oubliées aujourd’hui, de deux grands romans qui firent un tabac à travers toute l’Europe : Delphine, en 1802, dédié « à la France silencieuse », et qui enrage Napoléon, suivi de Corinne, en 1807, dont l’ouverture à l’Italie déplaît également à l’autocrate. Mais c’est sur De l’Allemagne, formidable hommage à la culture philosophique et littéraire de l’époque (Germaine connaît personnellement Goethe et Schiller), et préfiguration du romantisme et de l’Europe des cultures, que vont se déchaîner les foudres de Napoléon, qui le fera brûler et interdira le territoire français à la « traîtresse ».
N’empêche : le roman de Madame de Staël se poursuivra à travers de multiples exils, d’Autriche en Russie et de Suède en Angleterre, lui inspirant Dix années d’exil, récit majeur tenant du réquisitoire et de l’exorcisme, du bilan amer et de la réaction courageuse où se réaffirment les idéaux d’une femme émancipée en avance sur les temps à venir…
 La belle Curchod
La belle CurchodElle fut la femme du grand argentier du roi et la mère inquiète d’une femme de lettres taxée parfois de « Messaline ». On a daubé sur son « éternelle morale », on l’a accusée d’être jalouse de sa fille, on l’a parfois réduite à la stature d’un « bas bleu », et pourtant c’était une dame intéressante, et finalement attachante, que Suzanne Curchod, née en 1737 au presbytère de Crassier, fille de pasteur et sans fortune. Dotée d’une excellente éducation par son paternel, la descendante (par sa mère) des nobles huguenots réfugiés au joli nom d’Albert de Nasse, causait couramment latin à vingt ans, déchiffrait le grec, jouait du clavecin et faisait belle figure dans les salons lausannois. Sainte-Beuve en a témoigné et le jeune historien anglais Edward Gibbon l’aima au point de la demander en mariage, mais le père de Gibbon y opposa son veto. Jacques Necker, rencontré à Paris où Suzanne s’était retrouvée préceptrice du fils d’une dame de Vermenoux, dite « l’enchanteresse » pour son salon, fut un mari aimé et adulé, mais une vieille mélancolie sembla poursuivre la « belle Curchod ». Son grand amour de jeunesse fracassé, et les rudes tribulations infligées à cette âme sensible, assombrissent les pages de son journal intime. Elle n’en fut pas moins la « patronne » d’un des salons parisiens les plus prestigieux, et c’est à elle qu’on doit aussi la fondation de l’Hôpital Necker-Enfants malades, et divers écrits, dont ses «Réflexions sur le divorce ». Justice lui est rendue par Jean-Denis Bredin dans Une singulière famille.
-
La sincérité et ses limites

Un échange épistolaire sur la publication des carnets intimes et ses aléas. Le cinéaste Richard Dindo commente L’Ambassade du papillon de JLK. Cinq ans après, celui-ci s'apprête à remettre ça (?) dans ses Chemins de traverse, à paraître en avril 2012. À préciser que Richard Dindo, Alémanique d'origine italienne, tient un journal intime comptant aujourd'hui environ 15.000 pages, entièrement rédigé en français.
Kriegstetten, Hôtel Sternen, ce 22 janvier 2007. - je reçois ce message de Richard Dindo, à propos de L’Ambassade du papillon, qui me touche beaucoup par sa franchise: «Cher Jean-Louis, j’ai lu ces derniers jours avec grand intérêt, je dirais même avec passion, vos « Carnets », car comme vous savez, j’ai toujours été un fanatique de la littérature autobiographique. Dites-moi tout de suite ce qu’est devenue la fille de votre éditeur, son destin m’a fendu le coeur. J’espère qu’elle est toujours vivante et qu’elle va de nouveau bien. J’ai constaté par ailleurs que nous avons été marqué par les mêmes écrivains, encore que certains dont vous parlez je ne les connais que de nom, dont Antunes, Onetti, Gadda et Cingria. J’aime beaucoup comment vous parlez de votre femme et de vos filles, de votre mère, frère et beau-frère et j’aime ce que vous dites sur l’écriture et la lecture. J’aime beaucoup aussi votre goût de l’amitié et de la conversation amicale et finalement votre générosité. Des choses qui me sont plutôt inconnues. Je ne me suis toujours intéressé qu’aux femmes, les hommes m’ont toujours un peu ennuyé. Vous n’êtes pas loin finalement de penser pareil. Seule chose qui m’a un peu dérangé par moments: certaines citations sur votre premier roman, des louanges de vos amis, m’apparaissent un peu trop narcissiques. Je trouve aussi que vous allez un peu trop loin dans votre critique du caractère de Chessex. Une critique sans doute justifiée, mais à mon avis il ne fallait pas publier tous ces détails, je veux dire qu’il ne fallait pas aller au bout de cette critique. Ça devient trop humiliant pour l’autre, objectivement humiliant. Vous le mettez trop à nu à mon goût, ça m’a gêné. N’oubliez pas que les artistes ne sont pas des gens comme les autres, leur grain de folie fait partie de leur génie, il ne faut pas les juger psychologiquement, ni moralement, ni même politiquement, sinon on ne s’en sort plus. Je trouve votre « Journal » incroyablement honnête et sincère, parfois presque un peu trop honnête. J’ai toujours l’impression qu’il faut savoir garder des secrets dans la vie et ne pas tout dire ce qu’on pense. La grandeur est dans ce qu’on arrive à cacher, ce que les autres ne sauront jamais de nous, ce qu’on ne sait pas soi-même et ce qu’on ne veut peut-être même pas savoir et surtout dont on ne veut pas que les autres le sachent. La vraie dimension des gens et des choses restera toujours leur part cachée, laissée à l’imagination. L’intelligence ultime se trouve aux frontière du non-dit et de l’indicible, dans cette part non seulement maudite des choses, mais tout simplement absente qui se trouve toujours ailleurs et qui reste introuvable. On n’a pas toujours besoin de tout dire pour être honnête, à vrai dire je n’aime pas trop ce culte de l’honnêteté de chez nous, ce moralisme protestant dont je me méfie et que j’essaye d’exterminer dans mes films par la rigueur, la distance, la laconie, la réduction impitoyable à ce que je considère être l’essentiel. Ce qui n’exclut pas l’émotion, au contraire, émotion et analyse, à travers la beauté du langage, voilà ce qui m’intéresse. Mais tout cela vous le savez aussi bien que moi et vous le faites souvent comprendre d’une manière très belle et très touchante. Je sais bien qu’un « Journal » n’est pas un roman épuré, réduit à l’essentiel, mais des notes prises du jour au jour dans l’improvisation et le chaos du quotidien. Dans l’ensemble je suis très en phase avec vous. Ayant remarqué que vous aimez beaucoup Jean Genet aussi, je vous enverrai prochainement mon film sur lui, qui s’appelle Genet à Chatila. Je vous souhaite une bonne semaine, bien à vous, Richard.»
Cette lettre m’a beaucoup intéressé, plus que tous les compliments sur L’Ambassade du papillon. Ce que Dindo me dit sur notre part cachée, et de la pudeur qu’il faut préserver, est tout à fait vrai, mais je vais tâcher de lui dire mon sentiment à ce propos. Voici d’ailleurs ce que je lui ai répondu: «Cher Richard, La petite fille est morte le 21 décembre 2000. J’en raconte la fin atroce dans mes carnets de cette année. Le petit garçon a retenu les parents en vie, qui se battent depuis contre le CHUV pour obtenir justice après deux erreurs médicales caractérisées. Les hiérarques de l’Administration se sont conduits comme des brutes, mais le procès civil est en train d’aboutir, qui ne ressuscitera pas l’enfant. Voilà. Pour le caractère extrême, à certains égards, de ces carnets, je vous donne entièrement raison, sans regretter rien. J’ai été comme ça à ce moment-là, obsédé par certaines choses qui me paraissent aujourd’hui dérisoires, et ressentimental autant que je suis sentimental. Ils ont paru obscènes à certains, d’autres les ont trouvé pudiques. Je n’en sais rien. Sur Chessex, vous avez raison, mais moi aussi. J’ai raconté l’animal dans notre amitié et dans sa trahison. Il est comme ça et je trouvais intéressant de le montrer comme ça, sans le juger vraiment pour autant. Par la suite, j’ai dit le pire bien de certains de ses livres, et du mal de ceux qui me paraissaient trichés. Je ne serai plus jamais ami avec lui, pas à cause de moi mais pour l’attitude qu’il a eue envers Bernard Campiche lors de la maladie de la petite fille. A la sortie de L’Ambassade du papillon, il m’a traîné dans la boue en appelant à mon interdiction professionnelle. Je ne lui en veux pas. Lorsque j’ai dit ce que je pensais d’un de ses derniers livres, il m’a dit que j’étais son meilleur lecteur. Ainsi de suite. Je ne suis pas dupe. Honnête? Je ne sais pas. Vous l’êtes sûrement plus que moi, parce que vous avez plus lutté que moi et que vous êtes n’êtes pas un dépravé moralisant comme je l’ai été jusqu’à ma rencontre de celle qui a changé ma vie. Pour le narcissisme, vous avez encore raison, comme ceux qui ont parlé d’un plaidoyer pro domo. Mais tout cela je le vis, comme l’amitié vertigineuse avec mon ami le Roumain, qui a failli finir dans le sang après avoir fait beaucoup souffrir ma douce. Pourtant je ne regrette rien de rien. J’essaie de ne plus faire de mal à ceux que j’aime et j’essaie de ne faire que ce que j’aime, donc les aléas de la vie sociale ne me touchent plus guère. Ces derniers temps, j’ai été content de vous rencontrer. A l’instant je suis seul dans ma chambre du Sternen à Kriegstetten après avoir assisté à l’ouverture des Journées de Soleure. Je vous remercie de la parfaite franchise de votre mot et vous enverrai à mon retour Les passions partagées, qui a d’autres qualités et d’autres défauts. Je vais aller racheter le Journal de Frisch que je ne trouve plus et me réjouis de voir votre film. Je travaille actuellement au troisième recueil de mes carnets qui s’intitulera Le souffle de la vie »…
C'était donc en 2007, entretemps j'ai publié le troisième recueil de mes carnets sous le titre de Riches Heures, à L'Age d'Homme, et Le souffle de la vie est devenu Chemins de traverse, à paraître chez Olivier Morattel. Je tutoie désormais Richard Dindo et lui ai proposé de publier, dans Le Passe-Muraille, un extrait de son journal évoquant sa rencontre à New York avec Robert Franck, son père spirituel au même titre que Max Frisch...
-
Ceux qui ne sont pas reconnus
 Celui qui reconnaît un terroriste recherché en la personne de son dentiste Sayed Moussah qui lui avoue se trouver souvent importiné par les Services spéciaux au motif de cette ressemblance dont seule sa mère Aïcha est en somme responsable puisque le père s’est barré / Celle qui a reconnu l’inspecteur Derrick dans la micheline de Sienne / Ceux dont la cousine Micheline élève des ragondins aux Laurentides / Celui qui se fait prendre par la tempête dans les bois de Notre-Dame-de-la-Merci où rôde un dealer mal famé / Celle qui écoule de la neige dans une station de ski fréquentée par des admirateurs de Noir Désir / Ceux qui sont heureux sans le chercher autrement / Celui qui ne se reconnaît pas sur la photo Keystone de l’assassin présumé / Celle qui fait semblant de ne pas reconnaître son grand-oncle exigeant d’elle un rabais / Ceux qui veulent être reconnus en tant que candidats non admis à la Star Ac pour preuve de partialité raciste anti-Canaques / Celui qui prétend t’avoir connu vers Vegas dans un Greyhound alors que tu n’as jamais transité que sur Trailways / Celle qui trafiquait de la réglisse et du bois doux aux Oiseaux / Ceux qui savent que la brouille des deux Ivan de Gogol trouve des équivalents en Alsace et en Mandchourie / Celui qui installe un projo de théâtre sur son toit pour éclairer les menées louches de son voisin Pottier / Celle qui couche avec Pierre-Yves pour le tirer vers la droite / Ceux qui ne te reconnaissent même pas le droit de ne pas voter / Celui qui fait une sieste turbo dans le backstage de son pick-up / Celle qui drague les Indiens des containers d’Anchorage / Ceux qui se retrouvent au titre de gauchers brimées des années 55-66 / Celui qui affirme crânement que sans reconnaissance on ne sera jamais reconnu / Celle qui reconnaît s’être trompée en se trompant de frère au moment où rien n’était sûr / Ceux qu’on connaît moins qu’ils ne désirent être reconnus pour ce qu’on ne connaît pas d’eux à leur dire / Celui qui estime que le besoin effréné de reconnaissance de 87,7 % de nos contemporains découle d’un affaiblissement chiffrable à 22,3 % des vertus nutritives du lait maternel / Celle qui n’a pas été reconnue par son père le marabout évangéliste / Ceux qui reconnaissent qu’il se sont égarés dans le brouillard mais personne ne les entend et les loups de la région ne connaissent point la pitié / Celui qui a reconnu son frère le braqueur sous son passe-montagne tricoté par leur mère / Celle dont on a reconnu le courage dans son combat contre les murènes qui l’ont mortellement déchiquetée à la fin hélas / Ceux qui prétendent avoir été méconnus de leur vivant et demandent donc une compensation au Dieu Juste / Celui qui part en reconnaissance dans le biotope littéraire autrichien connu pour son hostilité aux Antillais bisexuels / Celle qui a senti le vent du boulet juste avant de péter un câble / Ceux qui finiront par reconnaître que tout ce qui brille n’est pas or vu que ça ne coûte rien, etc.
Celui qui reconnaît un terroriste recherché en la personne de son dentiste Sayed Moussah qui lui avoue se trouver souvent importiné par les Services spéciaux au motif de cette ressemblance dont seule sa mère Aïcha est en somme responsable puisque le père s’est barré / Celle qui a reconnu l’inspecteur Derrick dans la micheline de Sienne / Ceux dont la cousine Micheline élève des ragondins aux Laurentides / Celui qui se fait prendre par la tempête dans les bois de Notre-Dame-de-la-Merci où rôde un dealer mal famé / Celle qui écoule de la neige dans une station de ski fréquentée par des admirateurs de Noir Désir / Ceux qui sont heureux sans le chercher autrement / Celui qui ne se reconnaît pas sur la photo Keystone de l’assassin présumé / Celle qui fait semblant de ne pas reconnaître son grand-oncle exigeant d’elle un rabais / Ceux qui veulent être reconnus en tant que candidats non admis à la Star Ac pour preuve de partialité raciste anti-Canaques / Celui qui prétend t’avoir connu vers Vegas dans un Greyhound alors que tu n’as jamais transité que sur Trailways / Celle qui trafiquait de la réglisse et du bois doux aux Oiseaux / Ceux qui savent que la brouille des deux Ivan de Gogol trouve des équivalents en Alsace et en Mandchourie / Celui qui installe un projo de théâtre sur son toit pour éclairer les menées louches de son voisin Pottier / Celle qui couche avec Pierre-Yves pour le tirer vers la droite / Ceux qui ne te reconnaissent même pas le droit de ne pas voter / Celui qui fait une sieste turbo dans le backstage de son pick-up / Celle qui drague les Indiens des containers d’Anchorage / Ceux qui se retrouvent au titre de gauchers brimées des années 55-66 / Celui qui affirme crânement que sans reconnaissance on ne sera jamais reconnu / Celle qui reconnaît s’être trompée en se trompant de frère au moment où rien n’était sûr / Ceux qu’on connaît moins qu’ils ne désirent être reconnus pour ce qu’on ne connaît pas d’eux à leur dire / Celui qui estime que le besoin effréné de reconnaissance de 87,7 % de nos contemporains découle d’un affaiblissement chiffrable à 22,3 % des vertus nutritives du lait maternel / Celle qui n’a pas été reconnue par son père le marabout évangéliste / Ceux qui reconnaissent qu’il se sont égarés dans le brouillard mais personne ne les entend et les loups de la région ne connaissent point la pitié / Celui qui a reconnu son frère le braqueur sous son passe-montagne tricoté par leur mère / Celle dont on a reconnu le courage dans son combat contre les murènes qui l’ont mortellement déchiquetée à la fin hélas / Ceux qui prétendent avoir été méconnus de leur vivant et demandent donc une compensation au Dieu Juste / Celui qui part en reconnaissance dans le biotope littéraire autrichien connu pour son hostilité aux Antillais bisexuels / Celle qui a senti le vent du boulet juste avant de péter un câble / Ceux qui finiront par reconnaître que tout ce qui brille n’est pas or vu que ça ne coûte rien, etc.Image : Philip Seelen
-
Vialatte genre Deschiens

Au Théâtre de Vidy: une jolie mise en théâtre des chroniques du bienheureux Alexandre...
Alexandre Vialatte (1901-1971) achevait toutes ses chroniques en concluant : « Et c’est ainsi qu’Allah est grand », cerise ironique sur un gâteau de cocasserie. Vialatte était en effet la fantaisie loufoque incarnée, sur fond de gravité grinçante, quelque part entre les moralistes français et Pierre Desproges, le coq-à-l’âne auvergnat et l’humoriste Chaval observant des pharmaciens fuyant sous un noir nuage d’orage d’été.
À propos de l’été, le chroniqueur pléthorique (898 pièces) de La Montagne de Clermont-Ferrand (entre autres supports dont Le Crapouillot ou Marie-Claire…) conseillait les vacances dans les houillères noires, sous la pluie, ou même dans les égouts. Les hordes de vacanciers en reviendraient plus optimistes au bureau ou au guichet qu’en s’arrachant aux cocotiers de Palavas-les-Flots ou aux vahinés de la Grande Motte.
 Dandy gouailleur du genre anar de droite, Vialatte, qui fut le premier à traduire Kafka et signa une superbe évocation romanesque de la jeunesse intitulée Les fruits du Congo, peignait en somme l’Apocalypse quotidienne de Temps Modernes avec bonhomie, en frémissant à peine du noeud pap’. Sa façon de jouer avec les formules creuses du Café du commerce ou de l’intelligentsia prétentieuse, les Grandes Questions (« Où va l’homme ? ») ou de parodier les sentences définitives (« La femme remonte à la plus haute Antiquité… »), émaillées de (faux) proverbes bantous ou de vraies lapalissades, nous fait toujours sourire, parfois nous désopiler.
Dandy gouailleur du genre anar de droite, Vialatte, qui fut le premier à traduire Kafka et signa une superbe évocation romanesque de la jeunesse intitulée Les fruits du Congo, peignait en somme l’Apocalypse quotidienne de Temps Modernes avec bonhomie, en frémissant à peine du noeud pap’. Sa façon de jouer avec les formules creuses du Café du commerce ou de l’intelligentsia prétentieuse, les Grandes Questions (« Où va l’homme ? ») ou de parodier les sentences définitives (« La femme remonte à la plus haute Antiquité… »), émaillées de (faux) proverbes bantous ou de vraies lapalissades, nous fait toujours sourire, parfois nous désopiler. Largement rééditées (chez Julliard, aux bons soins de Ferny Besson), les chroniques d’Alexnadre Vialatte, à la fois épatantes à la découverte et un peu répétitives à la longue, n’étaient pas vraiment faites pour le théâtre. Charles Tordjman, mémorable « adaptateur » de Proust, a cependant risqué le passage à la scène en complicité avec Jacques Nichet, autre très fin « lecteur ». La chose pourrait lasser, n’étaient un dispositif scénique plaisant, genre BD en trois dimensions, et une interprétation pétulante, style Deschiens, de trois comédiens également irrésistibles : deux dames marquant l’opposition de la faconde plantureuse et de la gracilité piquante (Clotilde Mollet et Christine Murillo) et un monsieur (Dominique Piron) qu’on dirait sorti d’un dessin de Dubout ou… d’une chronique de Vialatte !
Théâtre de Vidy, Salle de répétition, jusqu’au1er avril, à 19h. sauf le lundi (relâche) et le dimanche 1er avril (18h.30
-
Shooting
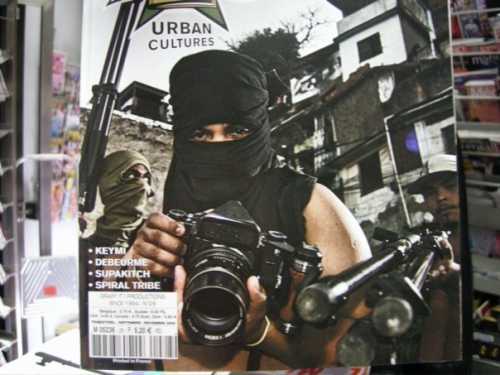
… Toi t’es typique la Fashion Victim qu’on suit jusqu’au bout du monde pour la cadrer grave, toi t’es la Top Gun Girl, toi je t’aligne et te snipe et là c’est le Grand Flash tu meurs et de vendeuse de Monoprix tu deviens la Madonna de la Spiral Tribe - en tout cas après la séance je te file mon phone et tu me rappelles…
Image : Philip Seelen
-
Des goûts et des couleurs
 Elle le lange, il chie, elle le nettoie, il paie, il retourne au bureau.
Elle le lange, il chie, elle le nettoie, il paie, il retourne au bureau.
Elle doit avoir la bouche pleine de chocolat quand il opte pour le French Kiss.
Cet autre exige qu’on l’appelle Excellence et qu’on lui suce les annulaires tandis qu’il mate une vidéo de Bruce Willis qu’il a toujours avec lui dans son attaché-case.
Les amateurs de conversations privées sont beaucoup plus nombreux qu’on ne l’imagine. Certains clients t’allongent jusqu’à des trois cents euros pour t’entendre parler de ton chien blanc ou de leur avenir.
Donaldson le Brésilien attend, pour sa part, que nous lui flattions la croupe. Il sait que nous sommes des tombes question publicité. Ce serait un scoop que de voir le mercenaire avant-centre de l’équipe nationale dans cette position d’offrande, et ces dames lui tourner leur compliment, comme quoi ses fesses sont plus belles que celles de Maradona ou de Ronaldinho, mais le contrat stipule l’absolue discrétion des employées et nous sommes une maison top sérieuse.Peinture: Lucian Freud
-
Ceux qui restent bohèmes

Celui qui aime dormir / Celle qui est toujours sensible au charme de l’aventure / Ceux qui se rappellent le beau temps de la drague / Celui qui convoite la pomme d’or du désir / Celle qui les faisait craquer en stop / Ceux qui invoquent la pureté de leurs frasques de l’été 77 / Celui qui est un peu jaloux (normal il est curé) de la liberté des jeunes amants / Celle qui aime choyer (dit-elle) la verge au nid / Ceux qui ont conscience de la Loi de l’éternelle fugacité en dépit de leurs à peine vingt ans / Celui qui rougissait beaucoup à seize ans / Celle qui ne fermait jamais la porte quand elle pissait / Ceux qui n’en veulent pas au Seigneur de ne les avoir point gâtés question physique vu qu’ils baisent comme des dieux / Celui qui a toujours compris les femmes par intuition poétique / Celle qui ne fait aucune distinction hiérarchique entre son âme et son cul / Ceux qui se reprochent (juste un peu) de ne savoir pas allier le sérieux à la légèreté / Celui qui voit la stoppeuse s’éloigner à regret / Celle qui pouvait rester des plombes au soleil (et parfois à l’ombre) à attendre le prince charmant camionneur / Ceux qui sont un peu crispés sous leur air rilax / Celui qui passait ses vacances au Lavandou quand il rencontra la Lula de BeBop / Celle qui fait comprendre au dragueur tchèque qu’elle préfère les Slovaques / Ceux qui ont compris à dix-sept ans que l’amour est un oiseau de bohème qui va les faire flipper jusqu’à cent sept ans / Celui qui préfère ce que ses camarades étudiants appellent de la mauvaise littérature genre Philip K. Dick mais pas tout / Celle qui a essayé de décoincer l’écrivain fils de pasteur mais en vain / Ceux qui ont connu la Loi des comités de surveillance de la liberté sexuelle à l’époque dure / Celui qui a fait de l’auto-stop un jeu de rôles assez drôle dans les années dite de La Route / Celle qui a rencontré Milos Forman à Nowy Zaky et qui lui a cédé quand il lui a passé Night in white satin / Ceux qui n’ont jamais craché sur un peu d’imprévu / Celui qui avait de la peine à admettre qu’une jeune fille fût si libre / Celle qui a toujours plus ou moins fermé les yeux sur le mufle qu’il y a plus ou moins en chaque mec / Ceux qui ne se doutaient pas qu’en 2011 ils ne resterait de la Tchécoslovaquie que la Slovaquie en ces régions de l’Est profond / Celui qui s’agace de voir la très jeune fille le dépasser sur divers plans alors qu’il pourrait la baffer facile mais il ose pas / Celle qui demande au stoppeur de lui montrer ses biceps gonflés /Ceux qui se caressent dans la voiture arrêtée en rase campagne et se disent qu’ils s’en souviendront en l’an 2000 sans se douter de ce qui les attend vraiment, etc.
-
Ces petites images admirables
INEDIT
Par François Beuchat
Vieille familiarité, et légende de l’oubli
J’ai vu trois pattes de chat dans la fenêtre bleue, certains hommes, certaines femmes commençaient leur repas, la dame assez maligne se promenait dans le square, et des enfants jouaient sur la place de jeux. Une montre, bracelet cuir, une bouteille de vin, le vin noir de nos rêves, dans une bouteille verte. Exquise absolution, petite danse revenue, miroir tout alangui, où sont les pattes de chat ? Un tableau de Caillebotte me montrait une maison, Gennevilliers des Hauts-de-Seine, chacun doit mourir quelque part. Proust vécut, boulevard Haussmann, Gide était à Auteuil, et l’autre dame assez maligne, sa promenade dans le square. Promenade qui tournait en rond, comme les pensées du solitaire, le chat était une illusion, pourtant il y avait la fenêtre bleue. Petite fiancée du Temps perdu, tu as vieilli comme les autres, le vent du large s’est levé, où sont donc les pattes de chat ? La musique littéraire mène la danse dans son coin, nous partions sans partir, et mourions sans mourir. Le bleu de l’artiste penché sur le bleu, ce bleu qui devient son propre bleu, ce bleu qui peut devenir le bleu de tous. L’homme assis ne regardait que les boucles d’oreilles, cercles de fil de fer, de la femme au pull vert qui levait le pouce et l’index de la main droite. La mer se reposait des fatigues ancestrales, en inondant le sable de nos jours secs et jaunes. J’ai vu trois pattes de chat dans la fenêtre bleue, la femme assez maligne, sa promenade dans le square. Promenade qui tournait en rond. Vieille familiarité, et légende de l’oubli.
 Manuscrit et manuscrits
Manuscrit et manuscritsManuscrit du cheval fâché avec son maître, maître queux à la tête de rat, manuscrit de l’enfant qui marche dans la neige, manuscrit des traîneaux et des clochettes, manuscrit de la faiblesse et de la maladie, manuscrit du regard lent et doux, manuscrit de la porte fermée, de quelques volets bruns. Manuscrit de l’escalier enneigé, de la chambre vleue où la lumière du jour est presque noire. Manuscrit des glaçons qui sont semblables à certaines menaces, manuscrit du chef-d’œuvre rêvé, de la table où sont quelques papiers, de la chaise sobre et rustique. Manuscrit de l’envol de la pensée, de la neige accablante ou salvatrice. Manuscrit des silhouettes emmitouflées, manuscrit du devoir qui précède la mort. Manuscrit de la folle joie secrète, après les amertumes répétées. Manuscrit de la folie bleue, de la nuit qui s’approche, manuscrit du chien et du loup, manuscrit entre chien et loup, manuscrit. Et l’accablement avait quelque chose de magnifique,il était comme une promesse de beauté. Manuscrit des Temps gris, des Temps bleus, des Temps saturnien et neigeux. Mais, presque toujours, manuscrit du cheval fâché avec son maître. Manuscrit entre chien et loup.
 Cette cabane de jardinier
Cette cabane de jardinierCette cabane de jardinier, sur laquelle tombait une neige sèche et vibrante, sa porte brune était fermée par un cadenas, les outils reposaient dans l’oubli. Dans l’attente d’une autre vie.
Ils attendent sur les gradins
Voici la bulle de la cité, ils attendent sur les gradins, les hiboux de ce conte ancien. Il y a les rêves mauves ou dorés, de drôles d’espérances troublées, un pastis d’un jour de juin, et la même poussière d’un boulevard. Toutes les peines tombent sur les pavés, ou ont un sursis dans les feuilles des arbres, petit éclat d’une espérance, rigueur de tout cerveau blessé. C’était un juillet nuageux, une Laotienne servait au bar, elle ferma boutique et partit avec sa sœur, une fleur d’orgueil entre les dents. Tout se perdit dans la poussière, même dans les feuilles clairsemées, dernières lueurs sur le boulevard, main coupée. Voici la bulle de la cité, ils attendent sur les gradins, les hiboux de ce conte ancien.
Papiers
Papiers des petites traverses, papiers fragiles, comme les âmes perturbées, papiers de la nouvelle semence, papiers retournés, ignorés, papiers quelquefois presque transparents, comme certains papillons des journées infinies. Papiers du néant repeuplé, papiers. Papiers des petits traversées, ah oui !
Musique des bords de mer et musique des fleuves
Est-ce le diable qui s’agite au fond du piano noir ? Est-ce la mouette qui vole tout au bord de la mer, et qu’on appelle vautour, oui, vautour de la mer ? La mouette, les mouettes, celles du Rhône, à Lyon, et celles du lac Léman ? Musique des bords de mer, et musique des fleuves, les étranges matins gris, oui, ils nous coupent le souffle. On s’embrouille dans les dates, mais tout ça ne fait rien, il reste l’air des jours, et le souffle des nuits, il reste quelques pensées qui ne demandent qu’à vivre, et quelques émotions, prises dans le ciel tout gris. Est-ce le diable qui s’agite au fond du piano noir ? La chanson est jolie, mais elle fait mal au cœur, musique des bords de mer et musique des fleuves.
Alors l’étrange vent
Je ne me suis penché sur les calendriers de la vie que pour mieux leur échapper, la fuite était jolie, la fuite était dangereuse, champignons des sous-bois, sorcières sur leur balai, doux fantômes persistants, querelles répétées. Alors l’étrange vent, on l’attendait toujours, la casquette sur la tête, et la main dans le vent. On respirait un peu, oui, juste ce qu’il fallait, pour une assise belle, et bellement légère. Alors un courant gris, alors un courant bleu, air qui redonne substance, alors l’étrange vent ».
Ces petites images admirables
Ce sont de petites images qui nous aidèrent à supporter la vie, on les avait quelquefois devant les yeux, d’autres fois seulement dans le cœur et l’imagination. Elles étaient modestes, discrètes et fugitives, elles allaient et venaient, elles étaient si proches de notre âme qu’elles se confondaient quasiment avec elle. Beauté prodigieuse de ces petites images. Etrange fidélité de ces petites images. On ne fait rien de mieux. La nuit, surtout, ces petites images surgissent avec une surprenante présence, et elles sont pour nous comme une chaleur infinie. On ne fait rien de mieux. Elles sont aussi les clés des songes, ces petites images admirables. On ne fait rien de mieux.
 (Ces textes inédits sont extraits d’un livre en chantier de François Beuchat. Ils seront publiés dans la prochaine double livraison 88-89 du Passe-Muraille, à paraître fin avril 2012, dont un des frontons sera consacré à la relève de la littérature romande. François Beuchat est l’auteur de plusieurs recueils de prose poétique publiés aux éditions d’autre part. Le dernier, L'oiseau dans la bocal; Fragments du roman d'une vie II, a paru en septembre 2010)
(Ces textes inédits sont extraits d’un livre en chantier de François Beuchat. Ils seront publiés dans la prochaine double livraison 88-89 du Passe-Muraille, à paraître fin avril 2012, dont un des frontons sera consacré à la relève de la littérature romande. François Beuchat est l’auteur de plusieurs recueils de prose poétique publiés aux éditions d’autre part. Le dernier, L'oiseau dans la bocal; Fragments du roman d'une vie II, a paru en septembre 2010)Images: Françoise Widhoff, lettres de Céline, JLK, Augustin Rebetez.
-
Ceux qu'on voit venir

Celui qui se tapit au fond de ton cerveau reptilien / Celle qui t’attend au contour de l’horizon / Ceux qui se préparent à bondir en shorts seyants / Celui qui te guette du bout du quai / Celle qui te hèle sous le hallier / Ceux qui ont le cul blanc sous la ligne de bronzage et des yeux de chevreuil / Celui qui correspond sur Facebook avec les lutteurs de divers pays / Celle qui se sent exclue du cercle des marraines de pompiers / Ceux qui matent le cybershow des deux soldats anglais au Ghana / Celui qui tient les Archives Nationales du Doute / Celle qui ne te dit des mots doux qu’en portugais / Ceux qui suivent la pensée du télépathe / Celui qui a des psychotics / Celle qui a une toque de fourrure de pubis synthétique / Ceux qui participent à l’énoncé du monde / Celui qui dit n’avoir plus de désirs au pluriel sans préciser ce qu’il en est du singulier / Celle que tu as fait épouser ton meilleur ami pour les garder sous la main / Ceux qui disent que la neige arrive alors que c’est juste une vieille aveugle aux cheveux blancs / Celui qui a plein de jeunes filles en fleurs en lui et autour de lui tant qu’à faire on va pas se gêner / Celle que le sordide masculin fascine quelque part / Ceux qui boivent les phrases de Pascal Quignard comme des verres d’eau claire et par exemple : « Elle aimait ce lieu. Elle aimait cet air si transparent par lequel tout était plus proche. Elle aimait cet air si vif où tout s’entendait davantage » / Celui qui te dit qu’il lui manque toujours quelque chose à la lecture de Quignard et tu lui réponds « j’comprends, j’comprends » » en savourant ta langue de bœuf aux câpres suavement poivrée et lui la sienne / Celle qu’on prend la main dans le sac au fond de la rue barrée aussi rougit-elle terriblement / Ceux qui clament vainement leur passions strictement sensuelle de la caissière de la Banque Principale qui n’en a qu’aux Comptes faisant les Bons Amis / Celui qui te remballe après avoir tout déballé / Celle qui offre du chablis à sa visiteuse au nez droit / Ceux qui détroussent les blondes pour renflouer les bourses des rousses / Celui qui savoure la soupe aux couteaux de la Bretonne / Celle qui fait le tour du propriétaire de ses souvenirs / Ceux qui affirment que le vin doit reposer dans le noir / Celui qui aime autant le silence des clairières que le tintamarre des boîtes et des bars / Celle qui avait 42 ans en 42 et en aurait eu 69 ans de plus en 11 si elle n’était pas morte en 63, ce qui te paraissait normal à tes 20 ans alors qu’à présent ça craint / Ceux qui font la grande commission dans le grand seau alors qu’ils pissent en douce dans le lavabo pendant que la gardienne lit son roman-photo / Celui qui boit son urine en psalmodiant une incantation New Age / Celle qui revêt sa crinoline et sa robe à flaflas sans rien dessous à seule fin de lâcher mine de rien un bon prout de protestation au milieu du Salon de Madame Banier du Vent / Ceux qui sont tatoués de la tête aux pieds ce qui ne se voit hélas qu’à la douche des forgerons anabaptistes / Celui qui aime être seul avec celle qui l’aime aussi / Celle qui s’est coulée dans son état de veuve comme dans un bain gratifiant / Ceux qui se taisent dans les brouillards retrouvés de l’Hiver austère, etc.
Image : Philip Seelen
-
Au présent retrouvé

À La Désirade, ce 14 août 2005. - Notre grande petite Sophie est revenue hier de Syrie, les bras surchargés de cadeaux. C’est un vrai souk qu’elle a déballé sous nos yeux ébahis. Nous en avons bien ri et j’étais tout songeur en l’entendant raconter que, là-bas, les femmes se baignent tout habillées; et de la voir, sur les photos, engoncée dans un imperméable comme par mauvais temps, en ces chaleurs torrides, m’a fait sourire aussi et me rappeler mon peu d’attirance pour ces pays et ces mentalités si figées dans les conventions pseudo-religieuses, évidemment claniques et toutes sociales. Dieu sait que je ne suis pas dupe des progrès dont nous nous targuons, mais un imperméable à la plage : franchement, non.
Générosité de l’égoïste. - Cocteau disait que, sur l’île déserte fameuse, c’est le dictionnaire qu’il emporterait en désignant, par manière de boutade, ce qu’on pourrait estimer «le livre des livres», mais cette formule convient aussi à certaines sommes de lecture dont celle que je préférais jusque-là était le formidable recueil des Plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, que vient rejoindre aujourd’hui l’épatant Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, lequel me fait regretter qu’il n’y ait pas plus d’égoïstes en ce monde d’altruistes déclarés.
Charles Dantzig a le sens très français, entre La Bruyère, Saint-Simon et Jules Renard, de la formule qui ramasse et sonne clair, mais ce n’est pas ce que je préfère chez lui. Je le préfère dans les développements subtils et les jugements au débotté, surtout je raffole de ce lecteur à sa pointe, pour reprendre ce terme cher au cher Baltasar Gracian.
Moralistes trash - Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football.
Dénoncer la pédophilie est une chose, mais faire ressentir quasi physiquement de quoi il retourne est une autre affaire, qui me semble réussie dans Mysterious skin, non du tout de façon moralisante mais de manière à la fois sourde et très directe. Tout est triste et beau dans Mysterious skin, comme dans Ken Park, et c’est pourquoi je parle de films moraux, au sens d’une dignité défendue avec plus d’amour et de respect humain que par les ordinaires sermons.
À La Désirade, ce 30 août. - Il a fait ce soir un crépuscule indicible où le rose bleuté du lac aux airs de fleuve immobile, le mauve orangé des montagnes de Savoie et le ciel pervenche flammé d’or doux, par delà tous les verts du val suspendu que surplombe notre nid d’aigle, semblaient flotter hors du temps, et c’est ainsi que ma lecture de La possibilité d’une île, amorcée cet après-midi dans le triple bleu du bord du lac exténué de soleil, sur la plage interdite de la réserve naturelle où je défie les vigiles à chiens allemands, se poursuivait en oscillant de l’instant présent au lointain futur.
Goya. - Chacun de ses portraits m’apparaît comme une rencontre: à chaque fois on est surpris par la folle individualité du personnage représenté, et chaque fois on remarque que de sa propre rencontre a découlé la manière du peintre, tantôt protocolaire et tantôt plus familière, subtilement narquoise dans le mise en valeur du Comte de Fernan Nunez en jeune héros romantique dont on subodore la suffisance, ou vibrant de tendresse filiale lorsqu’il représente son petit-fils Mariano Goya.
Jamais Goya ne triche à ce qu’il semble, s’exposant lui-même à l’instant de traduire tout ce que lui inspirent ses modèles, sans les flatter le moins du monde. Ainsi de Charles III en tenue de chasse dont la tronche rubiconde se détache sur la conque rose bleuté d’un ciel immense, alors que l’esquisse du Duc de San Carlos capte au vol la dureté et la trouble complexité d’un autre grand personnage.
Touchant de vérité jusque dans ses travaux de cour, Goya nous bouleverse dans ses représentations plus spontanées et véhémentes de la détresse humaine, comme dans cet asile de fous dont les visions angoissantes font pendant à celles des Désastres de la guerre.
Il y a là tout l’homme du haut en bas de la société, avec ses joies et ses angoisses, ses âges en balance (Célestina et sa fille, sur ce même balcon qu’on retrouvera chez Manet) et le mélange de souffrance et de confiance que me semblent symboliser les bras grand ouverts du Christ de La prière au jardin des Oliviers, dont le dépouillement pascalien vibre de la plus humble humanité.
Au présent absolu. - Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? »
Je vois ces idéogrammes sans les comprendre, mais c’est alors qu’il m’apparaît que les mots parlent en deça et au-delà des mots, comme le corps se fait âme lorsqu’il danse, et quand je dis le corps “en chinois” je pressens qu’il est corps du pain et du vin et que son âme le déborde et le prolonge tant dans les sept sens que dans les songes de la mélancolie.
Tout à l’heure, et c’était en l’an 700, là-bas à la corne du bois je fermais les yeux dans le parfum du soir et je traduisais en murmure ces traits ailés de pinceau depuis des siècles redevenu poussière: « Des jeunes filles se sont approchées de la rivière; elles s’enfoncent dans les touffes de nénuphars; on ne les voit pas, mais on les entend rire; et le vent se charge de senteurs en passant dans leurs vêtements ».
Et mille deux cents ans plus tard, rentré dans ma trappe, j’avais les yeux ouverts sur le journal et je me rappelais les mots de Tou Fou: « A la frontière, le sang humain se répand, formant des lacs. Mais l’ambition de l’Empereur n’est pas satisfaite! »
A La Désirade, ce 26 août. – Est-ce le nom d’Amélie Nothomb, ou le retour des vacances, qui me vaut un soudain afflux de lecteurs sur mes Carnets de JLK, hier montant au chiffre de 267, pour un total de 4411 visites en août ? Je ne sais, mais ce qui est sûr est que je tiens de plus en plus à ce rendez-vous quotidien, qui requiert de ma part une présence accrue.
De la formule. - Ne parvenant pas à remettre la main sur mon exemplaire, sûrement prêté et non rendu d’En ce moment précis de Dino Buzzati, j’en reviens à la version italienne et me relis ce premier fragment intitulé LA FORMULE que je traduis à la diable: «De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, un tel document ! Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte ».
A La Désirade, ce 25 août. - Il n’y a finalement rien de répréhensible, ni rien de provocateur dans Acide sulfurique, le dernier livre d’Amélie Nothomb que je viens d’achever ce soir avec la conviction que c’est, malgré sa brièveté et sa façon de ne toucher à des choses graves qu’en passant, et comme avec désinvolture, l’un de ses livres les plus intéressants et les plus stimulants quant à la réflexion, s’agissant d’une perversion majeure de l’époque annoncée par la première phrase: «Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus: il leur en fallut le spectacle».
Imaginer qu’un camp de concentration puisse être organisé à des fins de divertissement grand public, dont les détenus seraient effectivement envoyés à la mort pour corser le jeu, n’est qu’une façon de pousser à bout la logique du voyeurisme et du vampirisme existentiel qui fonde les trouvailles de plus en plus carabinées de la télé-poubelle, sans aller jusqu’aux exécutions à fins de jouissance sexuelle qui se filment clandestinement dans les snuff-movies.
Amélie Nothomb ne peut être accusée de manquer de respect aux victimes réelles des camps: elle faufile une réflexion sur le thème de l’abjection absolue en animant des sortes de figures théâtrales, un peu comme chez Anouilh, des masques mais aux traits imitant la vie à s’y méprendre, et dont le dialogue sonne juste. Bref, il y a de la moraliste, mais certes pas du genre lénifiant, chez cette observatrice assez retorse de la fausse vertu et de toutes les formes de mauvaise foi, dont la dernière est de lui en faire reproche.
De l’indifférence. – Telle est l’inscription que je lis au front de tant de blasés et de paresseux, de prétendus beaux esprits et de bien pensants suant l’ennui - ceux-là même qui, l’air grave, se pâmeront devant tel film ou tel livre «dérangeant»
Celui qu’on dit le maillon fort de la boîte intérimaire qui le gère à l’international / Celle qui assure dans le domaine du mégaturf / Ceux qui donneraient cher pour gagner plus / Celui qui travaille à temps perdu / Celle qui s’engage à arrêter de fumer à la place de son fils pompier / Ceux qui ont le réflexe de ne jamais réfléchir, etc.
De la musique et des silencieux. – Et s’ils entendaient encore, ce matin, qu’en savons-nous après tout, s’ils entendaient encore cette polyphonie des matinées qu’ils nous ont fait écouter à travers les années, s’ils entendaient ces voix qui nous restent d’eux, ce matin encore je les entends par les rues vibrantes d’appels et de répons : repasse le vitrier sous nos fenêtres, il y a bien du temps de ça mais je l’entends encore et les filles sourient aux sifflets des ouvriers - et si leurs tombes restaient ouvertes aux mélodies ?
(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; Lectures du monde 2000-2005, à paraître chez Olivier Morattel en avril 2012.)
Image: Philip Seelen
-
Ombres claires de mémoire
De rien et de tout.- En réalité je ne sais rien de la réalité, ni où elle commence ni si elle avance ou recule, pousse comme un arbre ou gesticule du matin au soir comme je le fais – ce que je sais c’est juste que tu es là, qu’ils sont là et que je suis là, à écouter cette voix se taire et nous parler…
Que notre joie demeure
(Paroles d’adieu, en mémoire de notre mère)
Tu nous as quittés ce jour-là: l’attaque t’a frappée à l’aube d’une belle journée d’été, ce jeudi-là, fête de l’Assomption. L’attaque ne t’a pas permis de profiter une fois encore du beau temps, selon ton expression: tu n’as pas pu suivre ton programme du jeudi qui consistait à descendre au bord du lac pour y nager, comme tu le faisais encore chaque semaine à 86 ans. Tu n’as même pas eu le temps de réaliser, comme tu disais: tu nous as quittés mais sans savoir que tu ne nous quittais pas tout à fait: tu nous as quittés et tu es restée encore avec nous quelques jours durant.
Quelques jours durant, tu es restée présente et absente. Durant ces quelques jours, nous avons pu nous tenir auprès de toi et te parler. Des jours et des nuits durant, nous avons veillé auprès de toi dans cette chambre du Centre hospitalier dominant la ville. La première nuit est tombée sur ce dernier jour que tu avais vu se lever, les lumières de la ville scintillaient autour de la cathédrale, puis il n’y a plus eu que l’obscurité dans laquelle on entendait ton souffle régulier, puis un autre beau jour s’est levé mais tes paupières sont restées fermées tandis que ton coeur continuait de battre.
Nous t’avons veillée à tour de rôle. Chacun à son tour, nous t’avons parlé. Nous t’avons un peu bercée et chacun à son tour, quand il était seul avec toi, chacun t’a dit ce qu’il avait à te dire sans trop savoir si tu l’entendais.
Nous as-tu entendus ? Tu n’en montrais aucun signe, mais est-ce qu’on sait ? Est-ce qu’on sait jamais, d’ailleurs, si l’on est entendu ? Est-ce que nous savons vraiment ce qui est entendu et compris, tous les jours, de ce que nous disons avec nos mots de gens conscients ? Et les mots sont-ils le seul moyen de se parler ?
Est-ce que tu nous sentais présents, autant que nous te sentions présente encore, malgré ton silence et tes yeux fermés ? Est-ce que tu nous as reconnus à nos voix, malgré tes yeux fermés et ton insensibilité apparente aux bruits de la ville ? Est-ce que tu as senti nos mains sur tes mains ou nos joues sur tes joues ? Est-ce que tu as peut-être même perçu, d’une manière qui nous échappe, ce que chacun de nous ressentait sans même te le dire ?
Peut-être, au fait, es-tu restée pour que nous te parlions encore ? Peut-être ce que nous vivions, à ces moments-là, seuls avec toi, durant ces heures et ces journées, dans le long silence d’un dimanche ou juste avant l’aube d’un nouveau jour, était-il une façon de nous retrouver nous-mêmes grâce à toi ? Peut-être désirais-tu que nous nous rencontrions les uns les autres auprès de toi ? Peut-être étais-tu déjà auprès de celui que tu as tant pleuré ? Est-ce qu’on sait une fois encore ?
Ta présence et ton silence étaient faits de ce mystère et de ces questions, et nous l’avons tous ressenti: ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui croient qu’il y a quelque chose au-delà du corps et ceux qui pensent que la mort achève tout, ceux qui croient que la Science aura le dernier mot et ceux qui ne savent pas, ceux qui sont sûrs et ceux qui se taisent.
Tu étais, pour ta part, comme l’a été celui que tu as aimé, de ceux qu’on peut dire des fidèles. Toi et lui vous avez été des fidèles, et plus encore en actes qu’en paroles.
Fidèles, vous l’avez été l’un à l’autre. Au-delà de votre intimité et de votre foyer, vous avez été fidèles à ces mots que tous nous avons lus et relus à chaque fois que nous nous retrouvions dans ce temple: Dieu est amour. Il n’y a pas à chercher beaucoup plus loin: Dieu est amour, et cet amour vous l’avez vécu et nous l’avez inspiré, vous l’avez partagé et partagé dans votre communauté.
Tu disais, sans trop de complications, que Dieu t’avait aidée à vivre. Un jour même, à l’un d’entre nous, tu as avoué que Dieu t’avait aidée à ne pas désespérer aux moments les plus douloureux de ta vie. Pas plus que notre père tu n’étais de ces gens qui prononcent des mots comme Le Seigneur ou l’Eternel, mais le nom du Christ t’était familier, auquel tu t’en remettais comme à la plus haute figure vivante de l’amour. Non pas le Christ-Roi brandissant une épée, mais le serviteur des pauvres, garant de fraternité et de justice. Et si tu avouais ne pas être trop sûre de ce qu’il y a après, tu n’en croyais pas moins que tu rejoindrais finalement celui qui t’a été arraché il y aura bientôt vingt ans de cela. Tu croyais que l’amour est plus fort que la mort. Et c’est dans le même esprit que tu nous as demandé d’écouter ensemble ce choral de Jean-Sébastien Bach qui, à travers les siècles, n’a cessé de perpétuer l’amour des fidèles: Jésus, que ma joie demeure...
Dans le mot de fidélité se conjuguent les mots croyance et confiance. Or, cette fidélité que vous avez vécue sans vous payer de mots, cette croyance que vous avez partagée sans jamais chercher à l’imposer, ont cimenté votre confiance et vous ont permis de construire. Votre fidélité allait de pair avec une entière honnêteté. Vous saviez la valeur des choses pour avoir dû lutter, comme tu nous l’as répété à l’envi, mais jamais vous n’avez admis que le seul profit puisse justifier une vie.
Tu nous as dit et répété, ces dernières années, combien le culte du profit te révoltait dans le monde actuel. Tu avais parfois tendance à ne plus voir que le noir, dans le monde actuel, mais là encore c’était une façon de réaffirmer ta fidélité aux valeurs qui ont fondé votre façon d’être et de vous comporter.
Quoi qu’il en soit, vous n’avez jamais été de ceux qui rejettent le monde actuel. Cette période parfois pénible de ce qu’on appelle les vieux jours, où tant de gens se sentent rejetés de la communauté et se replient sur eux-mêmes, ou s’éteignent même, vous l’avez vécue avec intensité en vous ouvrant au monde.
À ton chevet, dans le silence de la nuit ou la longueur des heures, tes enfants et tes petits-enfants se sont rappelés, sans doute, votre façon de leur montrer le monde et de désigner chaque chose par son nom.
Au commencement le monde était un jardin, et c’est vous qui nous l’avez révélé.
«Regardez !», nous disiez-vous, et c’est cela qui nous reste de vous : c’est le monde tel que vous l’avez gardé et regardé, c’est l’amour que vous avez gardé sans trop vous regarder…
 Un cauchemar. - Rêve dantesque la nuit dernière, à la fois plastique et très signifiant, m’évoquant aussi les Délices à la Jérôme Bosch. Nous étions d’abord perdus en campagne, à proximité d’une forêt où l’on nous recommandait de ne pas aller. Nous y allions tout de même et pour découvrir, bientôt, des tombes fraîches par dizaines, puis par centaines, les unes petites et les autres plus grandes, et des voitures aux vitres fumées stationnaient ça et là dans un climat de terrible menace. Nous cherchions donc à fuir, puis nous arrivions dans une espèce de grand parc de jeux où se mêlaient enfants et adultes, la plupart des messieurs à lunettes en costumes d’employés gris dont certains étaient accouplés à des enfants et les besognaient ou mimaient l’acte sexuel - tout restant cependant très «habillé». La scène avait quelque chose de silencieux et de banal, rien de cruel ni de lubrique, mais une sorte de jeu morne effrayant tout de même qui nous poussait à fuir une fois de plus, et nous arrivions au pied d’un bâtiment monumental, évoquant à la fois un palais babylonien et un bunker, dont on ne voyait du bas que les milliers de marches s’élevant vers les hauteurs comme dans un labyrinthe topologique à la Piranèse. Nous étions attirés par la montée de ces marches, mais soudain un petit chariot dévalait la rampe attenante, dans laquelle un nain à face de papier mâché, ou de viande boucanée, nous posait des questions de culture générale genre Trivial Pursuit. Nous comprenions que de bonnes connaissances nous permettraient de nous élever à bord de ce chariot. Mais déjà nous nous retrouvions dans une nuit glaciale et de nouveau très angoissante, peuplée d’ombres longeant de hautes clôtures de barbelés, le long desquelles patrouillaient des soldats aux allures d’escadrons de la mort. A un moment donné, des barrières s’ouvraient et la foule se précipitait vers cette percée, mais bientôt on apprenait qu’il faudrait tuer si l’on voulait passer de l’autre côté, et je ne suis pas sûr que j’y allais, mais je ne suis pas sûr du contraire non plus ; à vrai dire le rêve posait implicitement ce cas de conscience : tuer ou ne pas tuer pour s’en tirer, Il me semble que je n’y allais pas. Ou plus exactement il me semble que j’étais très attiré par la curiosité de tuer, mais que je n’y allais pas.
Un cauchemar. - Rêve dantesque la nuit dernière, à la fois plastique et très signifiant, m’évoquant aussi les Délices à la Jérôme Bosch. Nous étions d’abord perdus en campagne, à proximité d’une forêt où l’on nous recommandait de ne pas aller. Nous y allions tout de même et pour découvrir, bientôt, des tombes fraîches par dizaines, puis par centaines, les unes petites et les autres plus grandes, et des voitures aux vitres fumées stationnaient ça et là dans un climat de terrible menace. Nous cherchions donc à fuir, puis nous arrivions dans une espèce de grand parc de jeux où se mêlaient enfants et adultes, la plupart des messieurs à lunettes en costumes d’employés gris dont certains étaient accouplés à des enfants et les besognaient ou mimaient l’acte sexuel - tout restant cependant très «habillé». La scène avait quelque chose de silencieux et de banal, rien de cruel ni de lubrique, mais une sorte de jeu morne effrayant tout de même qui nous poussait à fuir une fois de plus, et nous arrivions au pied d’un bâtiment monumental, évoquant à la fois un palais babylonien et un bunker, dont on ne voyait du bas que les milliers de marches s’élevant vers les hauteurs comme dans un labyrinthe topologique à la Piranèse. Nous étions attirés par la montée de ces marches, mais soudain un petit chariot dévalait la rampe attenante, dans laquelle un nain à face de papier mâché, ou de viande boucanée, nous posait des questions de culture générale genre Trivial Pursuit. Nous comprenions que de bonnes connaissances nous permettraient de nous élever à bord de ce chariot. Mais déjà nous nous retrouvions dans une nuit glaciale et de nouveau très angoissante, peuplée d’ombres longeant de hautes clôtures de barbelés, le long desquelles patrouillaient des soldats aux allures d’escadrons de la mort. A un moment donné, des barrières s’ouvraient et la foule se précipitait vers cette percée, mais bientôt on apprenait qu’il faudrait tuer si l’on voulait passer de l’autre côté, et je ne suis pas sûr que j’y allais, mais je ne suis pas sûr du contraire non plus ; à vrai dire le rêve posait implicitement ce cas de conscience : tuer ou ne pas tuer pour s’en tirer, Il me semble que je n’y allais pas. Ou plus exactement il me semble que j’étais très attiré par la curiosité de tuer, mais que je n’y allais pas.Toujours pensé que le corps débordait ses frontières, comme un fleuve à l’orage.
L’homme civilisé a besoin à la fois de l’esclave et de la reconnaissance. D’où son double langage. Ne suffit pas de dénoncer le double langage. Plus important de saisir à quoi il tient.
L’écriture, comme la peinture, a besoin d’un fond. Ensuite on brasse la matière et tout à coup se dégage une forme. Pas du tout d’opposition entre ce qu’on appelle fond et forme.
Des gens qui pensent qu’ils ne sont rien sans avoir été «publiés» d’une manière ou de l’autre. L’obsession d’écrire à peu près égale à celle de percer à la Star Academy.
(Ces lignes sont extraites de Chemins de traverses; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel)
Image: cette (médiocre) aquarelle a été lavée sur un carnet au soir du 17 août 2002, de la fenêtre du CHUV, au chevet de notre mère mourante.
-
Ces jours-là...
Celui qui ne s’ennuie jamais sauf quand ça lui arrive faute d’attention / Celle qui ne s’ennuie même pas en regardant le émissions les plus idiotes de la télé ou en passant des heures sur ses patiences / Ceux qui ont toujours subi la vie et se sont donc pas mal fait tartir, etc.
De la sublimation. - Il y a un moment très émouvant, dans La Tache de Philip Roth, et c’est celui où le narrateur, Nathan Zuckerman, et Coleman Silk, son vieux voisin en rupture de conformité, deviennent amis en dansant ensemble le fox-trot sur une terrasse nocturne, comme ça, spontanément, et sans rien d’équivoque dans ce contact physique de deux mecs à moitié nus, avant d’échanger diverses confidences, notamment sur les femmes. Alors que Coleman a «repris du service» grâce au Viagra, Nathan sublime « grâce » à l’impuissance où l’a laissé son cancer de la prostate. Cette complicité me fait songer à celle des anciens combattants. Au reste, toute forme de sublimation me semble émouvante, et celle de Nathan me touche particulièrement en cela qu’elle va vers l’œuvre à faire…
Du vertige. - Me viennent certains matins ces élans et ces refus étranges. Voudrais prier mais point de mains. M’agenouiller mais point de jambes. Me lever et sortir mais point de porte ni de chemin devant la maison, et d’ailleurs point de maison. J’essaie de chanter mais rien ne vient. Courir une fois encore le long du ruisseau, mais j’ouvre les yeux sans voir, ou plutôt c’est comme si j’étais couvert d’yeux. Que se passe-t-il? Ou a passé ma corde à sauter? Et pourquoi les mots me font-ils si mal ce matin? Encore heureux: je me pose des questions, cependant mon corps ne me brûle plus puisque point de corps.
A La Désirade, ce lundi 6 juin 2005. – J’ai commencé, ces jours, à m’intéresser à la blogosphère, suite à un échange avec Pierre Assouline qui me citait dans sa République des livres. Or, surfant hier soir, j’ai pu constater l’inanité, voire l’ineptie de beaucoup de ces blogs, tristes reflets du vide intellectuel et spirituel de tant de gens. L’un est intitulé Toucher rectal, un autre Le coin des filles, un gay s’épanche dans Les bogosses et une aimable gourde, Au fil de l’eau, recense tous les lieux communs du Développement Personnel. Un certain Juan Asensio enfin, sous le masque du Stalker, déverse sa fureur bilieuse à la Léon Bloy en prétendant disséquer le «cadavre littérature», avec une emphase fumigène assez typique des excités à la Nabe et autres Dantec, et cette incapacité de tant de Français à considérer la pluralité des opinions et les nuances du jugement…
Celui qui devine les arrière-pensées du centre avant / Celle qui te présente le Federer du badminton bordelais / Ceux qui fréquentent les mauvais lieux pour l’ambiance, etc.
A La Désirade, ce mardi 7 juin. – Très fatigué ce matin, après une longue veille passée sur mon nouveau blog littéraire. Après deux jours seulement, ces Carnets de JLK sont déjà pas mal élaborés et je vais les étoffer régulièrement avec des textes de ma meilleure veine. Cela peut me servir, en premier lieu, de nouveau lieu d’archivage, et peut-être cela me permettra-t-il de nouer des liens fructueux - qui sait ?
De l’autre lumière. – Et toujours je reviendrai à l’œil secret de cet étang d’étain sous la lumière silencieuse de ce lever du jour qui pourrait en être le déclin, on ne sait trop, Rembrandt lui-même me savait trop ce qu’il révélait en mâchant ses cigares - et surtout pas d’effets de théâtre, de clair-obscur ou de faux mystère : laissez venir la beauté des choses qui n’a jamais été séparée de son ombre et qui diffuse cette aura sans le chercher…
A la Désirade, ce 9 juin. – La lecture, ce matin à 5 heures, des chroniques de Charles Sigel intitulées Le zist et le zest, m’a ramené au cœur de ma propre présence et m’a revigoré et redonné aussi l’envie d’écrire et de peindre. Il y a là, chez le plus remarquable humaniste de la Radio romande, une qualité de perception et d’écriture, de sentiment et d’expression qui me touche beaucoup.
Du premier geste. – Tes outils seraient là et tu les verrais en ouvrant les yeux, tu les verrais et ce serait comme si c’était eux qui te regardaient, ce matin sans espoir – pensais-tu, ce dernier matin du monde – pensais-tu, ce matin du dernier des derniers qui aurait perdu jusqu’à son ombre, tes outils seraient encore là et leur désir te reviendrait…
À La Désirade, ce 20 juin. - Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde bientôt l’appel de ma bonne amie restée en ville.
L’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.
Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.
Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.
Du Poids du monde. - Je ne sais pourquoi ce qu’écrit Peter Handke me fait penser, toujours, au travail du ver à soie. A le lire je revois ma mère faufilant avant de coudre. C’est cela même quand il parle de sa mère à lui, dans Le malheur indifférent: Handke faufile. A la fin du livre il note d’ailleurs ceci qui le justifie d’avance: « Plus tard, j’écrirai sur tout cela en étant plus précis ».
Et tout ce « travail littéraire » d’osciller entre l’effroi et son acclimatation, le cri et la glose, un récit de vie poignant et sa déconstruction simultanée, comme s’il y avait quelque chose d’inconvenant dans la simple émotion - comme si tout le tragique de la vie ne servait qu’à prendre des notes, et ces notes qu’à se tisser un cocon…
Au bord de la dépression: ces moments où il semble qu’on ait mal à tous les objets qu’on touche.
Ce personnage qui, après avoir touché le fond de la désolation, se met à s’intéresser passionnément au prix des choses. Il y a là comme un humour du désespoir qui me touche en ce moment précis. Handke acupuncteur. - En d’autres temps j’aurais peut-être rejeté ce livre aux observations parfois si vétilleuses, qui m’évoquent des sortes de flocons sensibles à consistance de bourre ou de soie floche, et pourtant je reviens et reviens au Poids du monde de Peter Handke comme à une méditation murmurée qui relance à tout moment la mienne ; et j’ai beau me reprocher de gratter ainsi ma plaie: je vois aussi la poésie qu’il y a là-dedans, et cet exercice d’attention qui aboutit à tout instant à la cristallisation d’images ou d’idées comme sécrétées par les gestes, les postures, les mouvements les plus imperceptibles du corps ou de l’esprit, celui-là comptant autant que celui-ci et débordant sur le corps de la nature et de l’univers.
Handke acupuncteur. - En d’autres temps j’aurais peut-être rejeté ce livre aux observations parfois si vétilleuses, qui m’évoquent des sortes de flocons sensibles à consistance de bourre ou de soie floche, et pourtant je reviens et reviens au Poids du monde de Peter Handke comme à une méditation murmurée qui relance à tout moment la mienne ; et j’ai beau me reprocher de gratter ainsi ma plaie: je vois aussi la poésie qu’il y a là-dedans, et cet exercice d’attention qui aboutit à tout instant à la cristallisation d’images ou d’idées comme sécrétées par les gestes, les postures, les mouvements les plus imperceptibles du corps ou de l’esprit, celui-là comptant autant que celui-ci et débordant sur le corps de la nature et de l’univers.
Celui qui dit et répète qu’il campe au bord du ciel / Celle qui se rappelle la première fois mais n’en parlera jamais / Ceux qui se rappellent plusieurs premières fois à choix, etc.
A La Désirade, ce 21 juin. – Ce qui pourrait n’être qu’un jeu (mon blog) est devenu pour moi une nouvelle stimulation, mais attention à l’obsession. Cela seul est néfaste: que l’esprit (et le cœur aussi) soit occupé et bientôt saturé au lieu de rester poreux. Cela est essentiel à mes yeux: rester poreux.
(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel)
Aquarelle JlK: Dunes de Sète, 2005. -
Divines surprises...
À La Désirade, ce 1er mars 2005. – Je suis impressionné, ce soir, par la lecture du Désir de Dieu de Jacques Chessex, qui me semble l’un de ses livres les plus libres et les plus aboutis du point de vue de la forme, dans le droit fil de L’Imparfait et de ses étonnantes Têtes, écrit littéralement « sous le regard de Dieu », selon l’expression de Pasternak qui recommandait précisément à Akhmatova d’écrire ainsi.
Ah mais quel bougre d’écrivain et combien je me sens proche de lui en ces pages fluides et un peu délirantes, que j’aurais pu écrire: « Je suis plein de Dieu, croyant le perdre, ne le perdant pas, craignant de ne plus le capter et l’écoutant sans cesse au fond de moi. Parce qu’avec l’exercice de Dieu, le désir de Dieu, la curiosité de Dieu, l’âge venant, je vis avec Dieu une espèce d’état de Dieu qui plus jamais ne s’interrompt».
Jacques Chessex parle ainsi de la présence de Dieu en nous et de notre dispersion devant Dieu – cela même qui me tarabuste si souvent: ma dispersion devant Dieu. Je ne sais pas trop à quoi cela tient mais cela me parle: il y a là une parole vive et une beauté, du sens, de la vigueur et de la profondeur, un homme enfin dépassé par son verbe.
De l’attente. – Je n’attends pas de toi le moindre compliment, tes congratulations ne sont pas une réponse, tes félicitations tu peux te les garder autant que tes révérences si tu ne t’engages pas à parler à ton tour, car c’est cela que j’attends de toi, mon ami (e), ce n’est pas que nous nous félicitions de nous féliciter, ce n’est pas que tu me trouves ceci ou que je t’estime cela – ce qui seul compte est que tes questions répondent à La Question à laquelle j’ai tenté de répondre, et que tu vives de la lettre que je t’envoie comme je vivrai de la tienne, non pas en échos d’échos mais à se dévoiler l’un l’autre tout en se lâchant sans lâcher du regard La Chose qui seule compte…
À La Désirade, ce 2 mars. – Malgré tout je me sens dans la main de Dieu. Ces aubes pures, aux fenêtres de La Désirade, sont autant de cantiques et tout aussitôt je me sens appelé à en témoigner.
Carnets de Thierry Vernet. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…
Thierry était un artiste pur, sans rien du cérébral théoricien, ses lettres étaient d’un écrivain mais je trouve, dans ses carnets, qui fait écho à sa vision si singulière, une pensée non moins dense à fulgurances saisissantes, par exemple lorsqu’il note que « c’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie» et quand il constate que «la foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose», ou, sur un autre registre encore, plus obscur et non moins pénétrant, qu’«une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».
Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issue personnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».
Il y a du protestant Amiel se flagellant dans certaines de ses admonestations, qui me rappellent mes propres repentances : « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais. »
Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».
À La Désirade, ce 8 mars. – Commencé ce soir de lire Esquisses d’exil de Soljenitsyne, qui me touche, m’agace, me passionne finalement par ce qu’il représente tout de même pour l’essentiel, malgré ses positions souvent si rigides, son intolérance, voire son injustice. Mais c’est l’évidence: nul n’est à cette hauteur, et surtout pas le pauvre Alexandre Zinoviev dont le dernier entretien que j’en ai lu, dans Lire, est à désespérer ceux qui l’ont connu et admiré.
Médium des tribus nouvelles. - Il y a, dans Impuretés de Philippe Djian, une révolte que je ressens moi aussi par rapport à tout ce qui défait la communauté des personnes, de la famille et de la société. Après Impuretés, je lis Frictions qui me touche également par sa densité émotionnelle et sa sourde aspiration à une sorte de communauté tribale, qu’on retrouve chez Pascale Kramer. Une fois de plus il y est question d’une relation familiale pourrie, avec ce jeune garçon témoin de la haine de ses parents puis se retrouvant, adulte, entre sa jeune femme top model et sa mère jouant celle qu’on abandonne. Le style de l’écrivain pèche parfois (alors qu’il le croit son point fort, non sans candeur) mais il y a là une quantité d’observations dans la masse qui me semblent d’aujourd’hui, et leur ressaisie traduit une vision juste du délabrement de ce pauvre monde.
Lady L. – Ma bonne amie ne cesse de m’émouvoir. Elle est essentiellement elle-même. Elle est toujours juste. Toujours elle-même et juste.
Celui qui ne s’étonne plus de l’ingéniosité mise par ses semblables à s’empoisonner l’existence / Celle qui est bonne comme le scout mais pas poire / Ceux que le mot de convivialité fait gerber mais qui aiment bien se trouver bien avec ceux qu’ils aiment bien, etc.
Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts.
De l’esprit d’enfance. - Plus je vais et plus je constate que je ne suis moi-même qu’en retrouvant ma disponibilité totale à l’esprit d’enfance. Toute autre posture intérieure, qui relativiserait les exigences de celui-là, me disconvient et plus: me contrarie. Jamais je ne serai adulte et responsable au sens où ils l’entendent, même si je me fais une idée aussi conséquente, sinon plus qu’eux, de toute vraie responsabilité.
 À La Désirade, ce 29 mars. - Une surprise, et de taille, m’attendait ce soir sous la forme d’une belle et flatteuse lettre de Maître Jacques, dont je retape ici l’exquis entier: « Cher Jean-Louis, Ton mot m’a fait plaisir. Retrouver ton écriture verte m’a fait plaisir. Et Francis Bacon on the Piccadilly Line… Plus je regarde la peinture, plus je perçois que Bacon est le peintre de tout le miserere d’un affreux siècle. Et de tous les siècles, si ses tableaux naissent et crient au creuset du malheur humain. Sacrifice et déjà rachat par la preuve même du cri ? Je crois que tu n’es pas loin de sentir de façon très proche cet affreux miracle. Mais je ne vais pas répéter mon livre!
À La Désirade, ce 29 mars. - Une surprise, et de taille, m’attendait ce soir sous la forme d’une belle et flatteuse lettre de Maître Jacques, dont je retape ici l’exquis entier: « Cher Jean-Louis, Ton mot m’a fait plaisir. Retrouver ton écriture verte m’a fait plaisir. Et Francis Bacon on the Piccadilly Line… Plus je regarde la peinture, plus je perçois que Bacon est le peintre de tout le miserere d’un affreux siècle. Et de tous les siècles, si ses tableaux naissent et crient au creuset du malheur humain. Sacrifice et déjà rachat par la preuve même du cri ? Je crois que tu n’es pas loin de sentir de façon très proche cet affreux miracle. Mais je ne vais pas répéter mon livre!Justement, ton article sur ce livre, et sur les poèmes liés à ce livre, m’a fortement (et agréablement) étonné: tu ne m’avais pas habitué à tel accueil depuis longtemps ! Mais j’ai l’âme simple en ces choses. Ton article est beau, de forme, d’écriture, de ton, et la filiation Cingria, si naturelle à nos deux natures, l’authentifie dès le début avec une clarté fraîche, comme sacrée, qui me touche infiniment. J’ai donc reçu ta chronique comme un cadeau à mon livre de vie, à mes poèmes de vie, et j’en ai été affermi dans le sentiment très serein de mes exercices.
J’ai été bien amusé aussi de la stupeur (le mot est faible ici !) que ton article a provoqué dans le petit marécage dont nous nous tenons, toi à la Désirade et moi forain, décidément éloignés. Dès sa parution, les coups de téléphone et messages écrits n’ont cessé de pleuvoir sur mon toit, de maints crapauds et vers de vase inquiets d’une réconciliation. C’est qu’ils ignorent qui écrit, lit, regarde de part en part, sur les pentes abruptes de Chamby et dans les collines de Ropraz. Plus près l’un et l’autre des éperviers, milans, terriers d’aube, que des coassements et des reptations. Jean-Louis, je te salue. Jacques ».
Jean-Jacques Rousseau: «Seul celui qui marche est apte au réel».
A La Désirade, ce jeudi 31 mars. – Les oiseaux sont en plein concert déjà lorsque j’ouvre, se matin, la fenêtre sur le ciel bleu dans le noir, à six heures et quelques, ah mais quelle joie!
Et cette pensée aussi, profonde, qui me vient à la lecture de la Recherche du temps perdu, comme tous les jours quelques paragraphes depuis tant de mois, où Marcel retrouve subitement sa grand-mère vivante, avec ce sentiment que je connais si bien maintenant que la mort est annulée par la remémoration.
Fait ce matin ce petit mot au Maître de Ropraz auquel je me promettais, il y a quelques années, de ne plus jamais serrer la patte ni d'adresser la parole après sa trahison et ses injures: « Cher Jacques, ton étonnement m’étonne, et je trouve un peu d’injustice dans le reproche que tu me fais de ne t’avoir plus fait bon accueil depuis longtemps». Est-ce en effet si longtemps que j’ai salué tes Têtes, autre livre admirable (et j’ose certes admirer ce qui porte tant à l’être) dont j’ai dit bien haut et clair, il me semble, à quel point il signalait la pointe d’un génie poétique ? C’est la visée de cette pointe qui me retient essentiellement à ce qu’on appelle la littérature, et qui est tellement plus que ce mot, tant qu’à la sourde fraternité de ceux qui n’ont pas renoncé à l’atteindre, dont tu es de toute évidence, et jusqu’aux plus impossibles, dont tu es également et bien plus que moi – ce qui est dire. Mais du reste nous nous fichons également au fond, et c’est pourquoi je me sens aussi libre de t’écrire que de ne pas t’écrire, selon nos humeurs.
Ce matin le concert des oiseaux avait déjà commencé lorsque j’ai ouvert mes fenêtres sur le ciel noir tournant au bleu. Cette fraîcheur du chant premier est de notre commun plaisir de Dieu qui dissipe toute mesquinerie et toute basse malice. Les coassements que j’entends d’ici ne sont que de batraciens qui baisent dans la mare d’en dessous. Ce sont de charmantes jeunesses dont j’aime le voisinage, comme de nos trois ânes et des oiseaux qui n’écoutent pas la radio. L’Old Sam nous souffle alors la sentence appropriée à l’heure: Encore une journée divine ! Bien à toi, Jean-Louis».
(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel).
Peinture: Thierry vernet, Crépuscule sur Onsernone, huile sur toile.
-
Par delà les eaux sombres

A La Désirade, ce 7 février 2005. – Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnets de 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma mort de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance secrète, éparse et d’autant plus véridique.
 Dits d’un franc-tireur. – Relevé ceci ce matin dans les Carnets de Calaferte: «Nul n’est mon rival, doit être la formule inconditionnelle». Et ça dans la foulée : « Notre seule honorable mesure est celle de l’amour et de la compassion.». Et cela que j’ai vécu, ces dernières années, plus souvent qu’à mon tour: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène».
Dits d’un franc-tireur. – Relevé ceci ce matin dans les Carnets de Calaferte: «Nul n’est mon rival, doit être la formule inconditionnelle». Et ça dans la foulée : « Notre seule honorable mesure est celle de l’amour et de la compassion.». Et cela que j’ai vécu, ces dernières années, plus souvent qu’à mon tour: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène».Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes prétendus amis: «l’indifférence froide»…
Soir. – C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, m’a en outre appris qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien piteux, mais en somme à l’image de cette époque.
 En mémoire de Georges Piroué. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, la merveille que c’est de lire. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ».
En mémoire de Georges Piroué. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, la merveille que c’est de lire. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ».Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se reconnaît « douteur fervent » et dit s’être fait « une religion de l’irréalité narrative », et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.
L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane - tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.
Du chemin. - On repart chaque matin de ce lieu d’avant le lieu et de ce temps d’avant le temps, au pied de ce mur qu’on ne voit pas, avec au cœur tout l’accablement et tout le courage d’accueillir le jour qui vient et de l’aider, comme un aveugle, à traverser les heures…
 Maudit Céline, vive Céline. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie.
Maudit Céline, vive Céline. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie.Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.
Alors même que l'écrivain, rescapé d'une exécution probable (un Brasillach n'y coupa pas, qui fut moins violent que lui et bien plus digne devant ses juges), s'ingéniait à réécrire son histoire avec autant de mauvaise foi que de rouerie inventive, les céliniens en nombre croissant se voyaient soupçonnés d'antisémitisme larvé s' ils ne se dédouanaient pas en invoquant le «délire» de l'intempestif, comme s'y est employée sa veuve Lucette Almanzor, accréditant elle-même la thèse de la folie de son cher Louis et bloquant la réédition des pamphlets.
Or, au fil des années, la publication de divers documents plus ou moins révélateurs ou accablants auront contribué à dévoiler le personnage dans sa complexité tordue, dont la créativité est inséparable de la paranoïa, la verve souvent nourrie par l'abjection, la lucidité aiguisée par une angoisse pascalienne, l’hygiénisme d’un Docteur Propper ou une plus triviale trouille de couard.
Oui, ce merveilleux orfèvre de la langue était à la fois un sale type, un ingrat mordant la main qui le nourrissait, un rapiat obsédé par son or, un délateur et un faux jeton en amitié, notamment. On peut certes, alors, choisir de ne pas le lire en se fondant sur ces jugements moraux, mais le lisant il faut tout lire de lui, n'était-ce que pour saisir d'où il vient et où il va. Si l’homme est indigne au sens de l’éthique courante, et d’autant plus qu’il n’a cessé de se dire innocent et de rejeter la faute sur les autres, l’écrivain me passionne plus qu’aucun autre par l’incomparable humanité de son écriture, abjection comprise.
Que l’amour est ma seule balance et ma seule boussole, j’entends : l’amour de ma bonne amie.
De l’humiliation- D’où vient le ressentiment? D’où viennent les pulsions meurtrières? D’où vient le crime ? C’est à ces questions que répondent les romans de Patricia Highsmith. Or, lorsque je lui ai demandé ce qui, selon elle, faisait le criminel, elle m’a répondu sans hésiter que c’était l’humiliation. Mais n’est-ce pas faire peu de cas de ce qu’il y a de mauvais en l’homme, lui ai-je objecté ? Alors elle de me regarder comme un adversaire possible et de se taire. Et moi de me taire, aussi, sans oser lui demander si la perversité de Tom Ripley ne lui a pas procuré, à elle également, cette espèce de plaisir trouble que le personnage met à se venger ?
De l’aura. – Certains êtres sont poétiques, je dirais plus exactement : diffusent une aura. Il y a cela chez ma bonne amie et chez tous ceux que j’aime, non du tout au sens d’un clan confiné de quelques- uns mais d’une famille sensible très élargie de gens dont l’âme rayonne à fleur de peau – ce que Georges Haldas appelait la « société des êtres ».
De la ligne verte. - A certains moments il n’y a plus que ça de vrai: une ligne après l’autre, une ligne après l’autre. C’est cela qui me relie à moi-même à l’encre verte: une ligne après l’autre.
Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui refusent de s’asseoir à la table des moqueurs, etc...
Des lieux et des gens. – Je suis saisi et même plus: hanté par les atmosphères et la substance affective des nouvelles de Judith Hermann. Il y a là-dedans une mélancolie, une tristesse et une poésie que je n’ai rencontrées nulle part ailleurs à cet état de densité et de clarté chez les auteurs de sa génération. Cette lecture me rappelle maintes situations que j’ai vécues, et j’y vois l’amorce d’innombrables évocations possibles de lieux ou de gens que je pourrais moduler dans une nouvelle suite d’histoires prolongeant celles du Maître des couleurs.
Je pense à tant de lieux et tant de gens. Je pense aux éphèbes que nous étions au square du Roule, au début des années 70, au milieu des fantômes de Juifs planqués par la mère de Catherine la danseuse du Ballet du XXe siècle. Je pense à Dale Bradley rencontré dans un ciné louche de San Francisco et qui m’a raconté le Vietnam de son père infirme dans la chambre du Sheraton où je l’ai accueilli en douce avec son sac de couchage. Je pense au journal de la communauté anarchiste que j’ai retrouvé dans ma trappe des Escaliers du Marché squattée par deux de ses membres. Je pense à mon premier voyage en Pologne dont les images me restent en noir et blanc – chair très pâle et barbelés, tendresse et folie nocturne. Je pense à l’humanité ravagée des aires d’autoroutes et des gares routières des States. Je pense à ma rencontre de Patricia Highsmith à laquelle j’ai apporté des dessins de nos filles et un jeu de tarots. Je pense à ma sœur au jardin et à son fils chaman. Je pense à un cousin dentiste pacsé avec son mécanicien au désespoir de son père. Je pense à ce type qui faisait les poches des Jeunes paroissiens au championnat des nageurs chrétiens. Je pense à mon incapacité de vivre en groupe. Je pense aux lettres que j’ai envie d’écrire. Je pense à la tristesse de ce camarade souffrant de la grande déprime des militants. Je pense à Diana qui couchait avec un peu tout le monde et que j’ai retrouvée au Brico-loisirs d’Aigle où elle m’a parlé de sa recherche de l’Autre Voie, etc.
De l’allegria. - Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dans quel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.
À La Désirade, ce 23 février. - Je pense à la mort. Je pense au vide. Je pense à la nuit. Je pense à mon père. Je pense à Dieu. Je suis imprégné de cette présence. Je suis plein de cette «voix». Cela parle en moi sans discontinuer. Mais n’est-ce pas «moi»? N’est-ce pas simplement ma conscience qui me parle? Et qu’est-ce que cette conscience ? Je ne sais. Je sens pourtant que je ne suis pas seul. Je pressens que cela signifie quelque chose. Sans prier je me trouve en état d’oraison. Ouvert à la nuit et au jour. Il est cinq heures et demie du matin. Donc je me lève.
Le prof à sa fenêtre qui se demande s’il ne devrait pas manifester avec les jeunes gens massés dans la rue, etc. Politiquement correcte est la bonne conscience.
Celui qui chemine sans laisser de trace sur le sable / Celle qui traite son frère Rodolphe de fasciste sentimental / Ceux qui conservent un portrait de Lénine dans le chalet d’aisance de leur masure du Périgord noir, etc.
 Des viatiques. – Je n’ai pas souvenir d’avoir jamais rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures - Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon retrouvé ces jours dans L’Illusion féconde: c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.
Des viatiques. – Je n’ai pas souvenir d’avoir jamais rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures - Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon retrouvé ces jours dans L’Illusion féconde: c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lecture du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel)
Image: Philip Seelen
-
De Rimbaud à Cézanne

De la peau. - Il est clair que l’amour est une affaire de peau, mais c’est ne rien comprendre que d’en déduire qu’il est alors épidermique ou superficiel. Ce qu’il faut reconnaître au contraire, c’est la profondeur que révèle la peau.
Bruxelles, ce 4 mars 2004. — Ce matin à l’expo Rimbaud. Très intéressante. Emouvant de voir qu’après le coup de pistolet dont il a été la cible, Arthur retire sa plainte contre Verlaine, qui sera poursuivi d’office. Très malheureuse histoire, qu’on sent pleine d’amour et d’excès, d’alcool et de folies, de passion et de désespoir. Ensuite au Musée d’Ixcelles, où nous avons découvert, avec émerveillement, les dessins de Munch. Rarement le sentiment que chaque trait vit et vibre à ce point-là. Bref, tout ça fera de la bonne matière pour trois reportages, mais j’ai hâte de retrouver ma bonne amie et notre nid d’aigle…
En ville, ce 7 mars. - Invité ce midi à la Télévision romande, Lionel Baier dit cette chose intéressante, relative aux jeunes gens d’aujourd’hui: qu’ils sont beaucoup plus vite et largement informés que naguère, et que l’expérience chez eux précède en somme la réflexion, sans exclure celle-ci. C’est ainsi que le protagoniste de Garçon stupide, beau grand con employé dans une fabrique de chocolat, lisse comme les gadgets qu’il convoite, drague sur les aires d’autoroute et, pour se faire du blé, va jusqu’à se prostituer avec une sorte de candeur cynique avant de découvrir, sous le regard de son amie, qui succombe elle-même au désespoir, le vide de la vie qu’il mène – cela constaté sans trace de moralisme, sur un ton nouveau, unique dans ce pays.
De la solitude. - Je me dis ce matin que Dieu doit se sentir aussi seul que moi, avant les premiers chants d’oiseaux. Le monde est si froid avant les premiers chants d’oiseaux…
À La Désirade, ce 22 mars. — Il a reneigé sur les fleurs. La saison nous pèse. Mais je souris, ce matin, en lisant De l’onanisme du fameux Dr Tissot. Dans sa préface de cuistre, Christophe Calame parle de la « grande modération » du toubib, alors que celui-ci attaque aussitôt le « crime abominable » de la masturbation. Calame argue du fait que Tissot se réclame, plus que du puritanisme chrétien, de la mesure des Romains, contre la fureur de l’obsédé sexuel, mais ça n’y change rien: le discours du toubib est lui aussi furieux, qui décrit les maux abominables découlant de toute perte de semence, non seulement par masturbation mais au fil des pollutions nocturnes et finalement de tout rapport sexuel. Au nombre des « châtiments » qui menacent le criminel, plus que l’opprobre divin, Tissot dénombre avec délices la consomption dorsale et l’affaiblissement général, la gangrène du pied et la perte de la vue, le rejet de matières calcaires et autres misères non moindres. Et c’est ça que notre calamiteux préfacier taxe de modération…
 Des femmes au travail. - J’ai regardé ce matin plusieurs des Portraits réalisés par Alain Cavalier, qui me plaisent beaucoup. Chaque portrait dure une douzaine de minutes, quasiment en plan-fixe mais cadré et «décoré» avec un soin extrême.
Des femmes au travail. - J’ai regardé ce matin plusieurs des Portraits réalisés par Alain Cavalier, qui me plaisent beaucoup. Chaque portrait dure une douzaine de minutes, quasiment en plan-fixe mais cadré et «décoré» avec un soin extrême.Il y a la matelassière au beau visage lumineux et aux mains toutes déformées, qui dit tranquillement que son travail a été sa vie. Son mari ne fichait rien : elle a élevé seule ses cinq enfants sans aide sociale ; elle ne se plaint pas pour autant. Ensuite il y a la fileuse qui prépare une copie de la tapisserie de Bayeux. Elle apprête elle-même les teintures de sa laine. On la voit extraire la garance de l’arbuste, puis un certain violet d’un coquillage. Elle a un visage à la Rembrandt dans le clair-obscur. Elle cite la Bible à propos de certains mélanges de matériaux déconseillés. Puis il y a Mauricette la trempeuse, qui réalise des pétales de fleurs artificielles en soie, en coton ou en mousseline. Elle exerce son métier depuis la guerre.
Je pourrais entendre un artisan me parler de son travail des heures et des heures durant, et d’autant plus qu’Alain Cavalier prête une attention réellement religieuse à ces dames.
J’aime beaucoup sa façon égale d’approcher la maître-verrier et la dame-lavabo férue de Verdi. L’une et l’autre sont belles sous son regard, aussi intéressantes l’une que l’autre. Il filme la vilaine lampe qui éclaire le sous-sol de la dame-lavabo et qu’elle appelle son soleil, et vraiment c’est un soleil à ce moment précis, sur une espèce de plante verte. Il filme avec amour la rémouleuse qui a une dégaine à la Léautaud, et le fait qu’il la filme dans un studio bleu, avec sa guimbarde à pédale, au lieu de la suivre dans les rues populaires où elle accoutume de se livrer à son commerce, n’est pas du tout artificiel pour autant. Elle lui dit tranquillement qu’elle a roulé sa première cigarette à treize ans et que telle petite pince, dans son nécessaire, lui permet de couper son petit bouc.
Alain Cavalier a le sens et le goût du détail, souvent traduit par des mots précis, soulignés d’un ton subtilement précieux. Lorsque la bistrote parle de sa mitrailleuse (un système de préparation des apéritifs), il enregistre illico. C’est une espèce d’écrivain à sa façon, et c’est un poète de l’image à n’en pas douter. Il y a en outre, dans ces portraits, des images évoquant les grands peintres, que ce soit Rembrandt, Vermeer ou Georges de La Tour.
De la confiance. - Tu peux compter sur moi, te dit-il, vous pouvez compter sur elle aussi, nous disent-ils, et les enfants peuvent compter sur eux, dit-on pour faire bon poids, sur quoi la vie continue, je n’ai pas à vérifier tes dires, elle le croit sur parole, ils n’étaient pas sûrs de pouvoir vraiment tenir leurs promesses mais on savait qu’elle serait là pour l’épauler et qu’il tenait trop à eux pour les trahir - il avait eu un rêve, ils n’en pouvaient plus de trop de mensonges et de défiance, je compte sur vous, leur dit-il, et ça les engage, on dirait...
Celui qui n’est jamais arrivé à l’heure de toute sa carrière d’astrophysicien en pull-over grosses mailles / Celle qui n’a épousé que des irréguliers / Ceux qui sont arrivés à Buchenwald en costumes-cravates, etc.
 À La Désirade ce 29 mars. — L’aube est toute pure ce matin, et je me sens aussi le coeur léger et l’âme sereine, tout prêt aux bonnes rencontres de cette semaine. En lisant L’exemple de Cézanne, je me dis que ce pèlerinage aux sources du peintre est pour Ramuz un repérage de sa propre situation, de sa solitude et d’une même ambition inaperçue, nimbée de silence. Il y a ceux, d’un côté, qui ont leurs stèles et leurs bustes, et puis il y a Cézanne qui se fond dans le pays de Cézanne, Cézanne qui s’est agrandi par son oeuvre aux dimensions d’un pays, Cézanne que Ramuz retrouve partout dans ce pays qui est lui-même comme un agrandissement de son pays à lui.
À La Désirade ce 29 mars. — L’aube est toute pure ce matin, et je me sens aussi le coeur léger et l’âme sereine, tout prêt aux bonnes rencontres de cette semaine. En lisant L’exemple de Cézanne, je me dis que ce pèlerinage aux sources du peintre est pour Ramuz un repérage de sa propre situation, de sa solitude et d’une même ambition inaperçue, nimbée de silence. Il y a ceux, d’un côté, qui ont leurs stèles et leurs bustes, et puis il y a Cézanne qui se fond dans le pays de Cézanne, Cézanne qui s’est agrandi par son oeuvre aux dimensions d’un pays, Cézanne que Ramuz retrouve partout dans ce pays qui est lui-même comme un agrandissement de son pays à lui.(Ces notes sont extraite de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel).










