
Sale fille confirme le talent sulfureux d’Anne-Sylvie Sprenger
« J’aurais voulu que ma mère m’aime. Qu’elle s’intéresse à moi, qu’elle s’inquiète de mes silences, me rassure les soirs d’orage », soupire la jeune Julie, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’a pas été gâtée en matière de sollicitude maternelle. Mal dotée par la nature, même laide à son propre dire, elle n’a jamais entendu que des reproches après avoir servi, dès sa prime adolescence, d’objet sexuel à sa mère éperdue de solitude en dépit (ou à cause) des multiples amants la baisant debout et la battant comme plâtre sous les yeux de sa fille à la fois dégoûtée par ces « choses sexuelles » et tout de même fascinée. Ainsi le besoin d’être aimée se confond-il d’emblée, pour l’adolescente, avec des pratiques auxquelles elle avoue prendre plaisir. « Je me suis abandonnée à ces saletés parce que je suis une petite vicieuse et que j’aime ça, c’est bien sûr ». Elle y a tôt et violemment associé des petites filles du voisinage, refusant en revanche tout contact ultérieur avec les hommes, ces brutaux velus qui lui ont pris sa maman sans qu’aucun d’eux ne l’ait reconnue pour sa fille. Par la suite, c’est une quadra prénommée Violette, en panne conjugale momentanée, qui lui révèle sa propre jouissance au cours de séances évoquant des combats tarentules plus que de suaves scènes d’amour lesbien. Cette catégorie ne convient d’ailleurs guère aux relations proprement « innommables » que Julie entretient avec le sexe, associé à tout coup à la mort, comme l’innocence du premier oiseau qu’elle achève à coup de marteau est lié à la révolte contre la souffrance qui la fait étouffer sa grand-mère en fin de vie – cette « nouvelle maman », après la mort de la vraie, dûment étranglée puis jetée sous le train par sa fille aimante, qui lui chantait la si tendre berceuse traversant tout le livre de sa petite musique de nuit : « I chöre/N’es Glöckli/Da lütet/So nett », « J’entends/les cloches/Elles sonnent/ si joliment ».
Il y a presque de quoi rire, à la lecture de Sale fille, tant l’abomination y prolifère et jusqu’à saturation, aux lisières de l’humour noir et de la pornographie panique sonnant le retour du refoulé puritain. C’est d’ailleurs dans les parages de Morges, la ville aux mômiers, que cela se passe, où les ombres hallucinées de Louis Soutter, saintes et catins, dansent leurs sarabandes au pied de la croix du Seigneur compatissant.
Dans un climat tout proche aussi de celui qui baigne la part érotico-mystique des livres de Jacques Chessex, d’ailleurs cité en exergue, Anne-Sylvie Sprenger reconduit les hantises obsessionnelles de l’éclatant Vorace, en développant ici des variations sur le thème médiéval de la luxure et de la mort. Morbide et dégoûtant, diront peut-être certains ; complaisant dans la saleté, estimeront d’autres. Je conclurai plutôt à l’aspiration radicale et véridique, chez l’auteur, à un exorcisme sec et franc « comme l’os », en espérant son dépassement ultérieur du côté de la vie…
Anne-Sylvie Sprenger. Sale fille. Fayard
-
-
La grâce incarnée

Jacob Berger, présent aux Journées de Soleure pour y présenter son dernier film, 1 Journée, observe avec autant d’acuité que de tendresse les crises de la relation. Thème récurrent dans le cinéma des auteurs actuels.
Qu’est-ce qui « foire » dans tant de relations actuelles, et d’abord au sein de la famille ? Trop peu d’amour ? Trop d’égoïsme ? Pas assez d’attention ? Désirs frustrés ? Rôles imposés ? C’est de tout cela, et de bien plus encore, que parle 1 Journée de Jacob Berger, film aussi remarquable par sa densité émotionnelle que par son élaboration formelle (lire 24Heures du 23 janvier), qui revient plus précisément sur la relation de filiation abordée dans Aime ton père (2002), deuxième long métrage du réalisateur quadragénaire (fils de l’écrivain John Berger, il est né en Grande-Bretagne en 1963), après Les anges, très remarqué à sa sortie (1990).
- Qu’aviez-vous à cœur d’exprimer dans 1 Journée ?
- A l’origine, j’avais l’envie de continuer mon exploration de la vie familiale et de parler du couple. Je défends cette théorie qu’en temps de paix, dans nos contrées, nous passons l’essentiel de notre temps à en découdre avec les autres, qu’il s’agisse de sentiment ou de ressentiment, de colère, de jalousie, de désir, etc. Il y a là une réalité humaine très vibrante mais qu’on évoque le plus souvent par la bande, et que j’ai voulu aborder de façon frontale. Une figure nous intéressait particulièrement, Noémie Kocher (co-scénariste) et moi, c’était la femme absente à elle-même : l’épouse, la mère, la femme au travail qui joue son rôle sans incarner sa vie. Or j’avais envie de la montrer au moment où elle décide de prendre sa vie en mains, ne fût-ce que pour partir.
- Comment vous est venue l’idée de la triple narration ?
- La question du point de vue m’intéressait, que j’ai déjà traitée dans Aime ton père. Il me semble d’ailleurs que c’est la nature du cinéma de passer ainsi d’un regard à l’autre, et l’idée de raconter la même journée par trois personnages correspondait à mon désir, dans un cadre apparemment classique, de raconter une histoire de façon nouvelle. Or je crois que ce regard multiple est le plus adéquat à la saisie du monde à facettes dans lequel nous vivons, où ce que l’un appelle terrorisme est combat de survie pour l’autre. Ainsi ce qui nous semble d’abord lâcheté, chez le père de mon film, participe du caractère tragique de sa recherche d’une punition.
- Quel a été l’apport de Noémie Kocher dans le scénario ?
- Le film avait besoin d’un point de vue féminin. Si j’ai gardé la main sur la structure du scénario, Noémie l’a énormément nourri, également du côté de l’enfant, par exemple dans sa la poésie personnelle du gosse ou sa façon magique de compter.
- Avez-vous construit les personnages en pensant à des acteurs identifiés ?
- Oui et non, car le casting a pris du temps. Noémie a vite « vu » Natacha Régnier, qui a accepté dès que je lui ai montré Aime ton père. Pour l’homme, il me le fallait très masculin, avec une forte énergie érotique, en même temps que de la fragilité, ce qui ne court pas les rues en Suisse et en France, contrairement aux Etats-Unis. Bruno Todeschini m’a paru l’un des deux ou trois oiseaux rares. Quant à Noémie, je savais d’emblée qu’elle serait la maîtresse…
- Et l’enfant ?
- C’était le gros problème. Trouver un petit acteur capable de « tenir » un film entier n’est pas facile. Je voulais un enfant qui ait du plaisir et de la fierté à jouer : un môme qui exprime une forme un peu sauvage d’intelligence. Or Louis Dussol, qui n’a pas de père, a montré d’emblée le désir de répondre à mon attente. Très vite, il a trouvé une espèce de gravité, d’insolence dans le regard qui m’électrisait.
- Ses répliques ne sont-elles pas parfois celles d’un adulte ?
- En fait il parle très peu, et sa mère, neurasthénique, le pousse à jouer parfois un rôle « protecteur ». Cela étant, cette maturité grave fait partie du personnage, comme on la retrouve souvent chez des gosses angoissés ou en douleur.
- Qu’est-ce pour vous que le propre du cinéma ?
- On dirait autre chose à chaque film nouveau, mais je crois qu’il y dans le cinéma quelque chose qui défie l’intellect. L’intention ne s’y exprime jamais totalement, comme dans les autres arts. Je dirai qu’il y a une sorte de présence du saint esprit dans le cinéma : le souffle de la vie, la puissance du désir, la violence de l’attraction ou de la haine ne se commentent pas : ils sont incarnés. Le cinéma est à la fois une lourde machine qui vous demande un travail d’entrepreneur, mais il lui arrive d’être visité par ce miracle de l’incarnation. C’est ce qui fait sa grâce.Photo: Pierre Abensur
-
La mort du père
La Symphonie du Loup, de Marius Daniel Popescu (premières pages)
Il avait presque quarante ans, une bonne partie de ses cheveux étaient blancs, il nous a quittés deux jours après l’accident. Ces deux jours-là, il était dans le coma, à l’hôpital où ils l’ont opéré à la tête. Les chirurgiens qui l’ont opéré disaient qu’il avait des chances de s’en sortir. Ils lui ont découpé une partie du crâne. Ils avaient demandé à sa femme une signature pour l’intervention chirurgicale. Sa femme a signé qu’elle acceptait les risques de l’opération. Ils étaient mariés depuis deux ans. Ils habitaient dans une petite maison et avec eux il y avait sa fille à elle, de son premier mariage, sa mère à elle et il y avait encore sa grand-mère à elle. Il vivait avec ces quatre femmes dans la maison. La fille à elle avait dix-huit ans. La grand-mère à elle avait huitante ans. Il était ingénieur en génie civil. La mère à elle était sourde-muette. Elle avait presque soixante ans. Quand il est mort, il travaillait sur un chantier en province. C’était un chantier où il dirigeait la construction d’une fabrique de fromage. Ces temps-là, il rentrait à la maison seulement le samedi soir. Il repartait sur le chantier le lundi matin. Vers huit heures du matin. Le lundi matin, sa femme n’allait pas au travail. Sa femme était la gérante d’un magasin d’instruments de musique. Elle vendait des violons, des pianos, des flûtes et des batteries. Elle était plus jeune que lui. Elle avait douze ans de moins que lui. Il pratiquait le métier d’ingénieur depuis une dizaine d’années. C’était son deuxième métier. Son premier métier était celui de maître de sports. Il avait pratiqué l’athlétisme. Il avait fait des études de maître de sports. Quand tu es né, il enseignait le sport à des sourds-muets, dans une école spéciale. Il a appris la nouvelle de ta naissance par téléphone. Il n’y avait pas beaucoup de téléphones à l’époque. Il a appris la nouvelle de ta naissance vers neuf heures du soir et il a pris un taxi pour se rendre à l’hôpital. Tu aimais bien aller avec lui en taxi. Quand le taxi passait d’une portion de route couverte par de l’asphalte à une portion de route couverte par des pavés, tu aimais bien le changement de sons créé par le frottement des roues du taxi sur la couverture de la route. Le son des roues du taxi, sur les pavés, étaient comme une cavalerie à la charge. Tu aimais bien jouer au cavalier qui chargeait les ennemis. Il a donné un gros pourboire au chauffeur du taxi. Pendant tout le trajet, il a dit plusieurs fois au chauffeur qu’il venait d’être père. Il a quitté le taxi et il a parcouru en courant l’espace qui menait au service des nouveaux-nés et il a gravi les marches des escaliers trois par trois, jusqu’à la porte, et il a sonné. Le portier de la maternité est sorti pour lui dire qu’il ne pouvait pas te voir en dehors des heures de visite; le portier de la maternité pensait à un gros pourboire, et il lui a dit qu’il devait venir le lendemain matin, à partir de dix heures. Ton père a cassé la gueule du portier de la maternité. Il lui a donné deux coups de poing. Il a visé d’abord l’oeil droit du portier de la maternité puis, avec la deuxième coup il a visé la bouche. Deux coups de poing en pleine figure pour le portier de la maternité. Puis il est monté tout seul à l’étage. Il a commencé à ouvrir les portes des salles et il appelait ta mère par son prénom. Il a réveillé tout le monde. Il vous a vite trouvés. Les infirmières et les médecins n’ont pas pu l’empêcher de vous voir à dix heures du soir. Il savait que tu étais né prématurément. Tu es né à sept mois et, quand il est entré dans la pièce où tu étais avec ta mère, il t’a vu dans la couveuse et il a dit à l’infirmière «sortez-le!», et l’infirmière t’a sorti immédiatement et il t’a pris dans ses bras et il t’a embrassé et il a dit que tu avais un gros nez. Il a embrassé ta mère. Il te portait dans ses bras et il souriait dans la chambre d’hôpital. Tu n’as pas un gros nez. Tu as son nez à lui. Il n’est pas resté longtemps à la maternité. Il est resté à peu près un quart d’heure puis il est redescendu et il est sorti en passant à côté du portier de la maternité qui était en train de se faire soigner par deux infirmières. Il est allé chercher ses amis. Il a trouvé une dizaine de ses amis et il les a invités dans le meilleur restaurant de la ville. Il leur a offert à manger et à boire toute la nuit. Il a mangé et il a bu avec eux. Il leur a parlé de toi et de ton nez. Quand un vendeur de roses est entré dans le restaurant, il l’a appelé d’un signe de la main et il lui a acheté toutes les fleurs. Il est revenu tôt, le matin, à la maternité. Il est descendu du taxi avec les roses dans les bras. Le portier de le veille est venu lui ouvrir. Le portier de la veille avait les lèvres gonflées et bleues et il avait un oeil couvert par l’enflure de la joue. Le portier de la veille lui a ouvert la porte de la maternité, ton père est entré sans rien dire et le portier a refermé la porte et il est retourné dans sa petite cabine de portier. Ton père a donné toutes les roses à ta mère. Physiquement, tu lui ressembles. Autrement, tu ne ressembles à personne de la famille. Une fois, ta mère t’a dit que tu étais fils de Dieu; c’est parce qu’elle ne voulait pas d’enfant. Elle travaillait beaucoup et son travail la tenait loin de sa maison. Elle était expert comptable et elle était toujours en route. Elle vérifiait les comptes de plusieurs entreprises. Elle ne voulait pas avoir d’enfant. Quand elle était enceinte de toi, c’est ton père qui voulait l’enfant. Ta mère t’a dit qu’elle avait payé ton avortement. Chaque fois qu’elle allait à l’hôpital, pour avorter, il allait avec elle. Il l’accompagnait et, en chemin, il la persuadait, chaque fois, de rentrer à la maison. Il lui a fait rebrousser le chemin de l’avortement. Quatre fois, il a tout fait pour qu’elle n’avorte pas. La quatrième fois, quand elle voulait aller à l’hôpital, il lui a dit que c’était impossible. Il lui a dit que personne ne ferait cet avortement parce que c’était trop tard. Tu étais assez grand, dans le ventre de ta mère. Plus personne ne pouvait te toucher. C’est comme ça qu’elle t’a gardé. Ta mère et ton père s’aimaient beaucoup. Il t’ont beaucoup aimé, depuis le début. Cette histoire d’avortement, c’est une histoire de Dieu. C’est pour cela que ta mère a dit que tu étais fils de Dieu. Elle a voulu te dire que tu allais mourir par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. Ton père lui avait transmis la volonté de Dieu. C’est comme ça qu’elle a interprété le désir de ton père de garder l’enfant. Maintenant, tu es là. Tu es là, avec moi. Nous parlons. Nous nous regardons. Nous avons beaucoup de souvenirs à nous raconter. Des fois, tu parles comme moi. Autrement, tu parles comme personne d’autre. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui parle comme toi. J’ai nonante-huit ans et, durant toute ma vie, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui parle comme toi, tu comprends ? J’ai fait les deux guerres mondiales. J’ai été combattant pendant les deux guerres mondiales. Ton père aimait que je lui raconte des faits de guerre. Il était un guerrier, ton père. Un guerrier qui n’a jamais accepté cette histoire de parti unique. Dans les réunions de l’entreprise, il engueulait toujours quelqu’un, un membre du parti unique ou un lèche-cul du parti unique. Les lèches-culs du parti unique étaient des lèche-culs du parti unique parce qu’ils voulaient devenir des membres du parti unique. Ton père n’a léché le cul de personne. Ton père n’a jamais voulu entrer dans ce parti unique. Quand il est mort, je t’ai envoyé deux télégrammes. Avec le premier télégramme, je voulais te prévenir. Je voulais te préparer à la mauvaise nouvelle. Dans le deuxième télégramme, je te disais «papa est mort». Les services de la poste ont fait que c’est le deuxième télégramme qui est arrivé en premier. L’autre, où je te disais que ton père allait mal, est arrivé en dernier. Tu m’as dit que tu étais à la pêche, dans la rivière, avec la canne à pêche. Ta tante est venue au bord de la rivière et elle pleurait et elle t’a appelé en te disant que ton père était mort. Tu as sorti de l’eau le fil de ta canne à pêche, tu as pris dans ta main le hameçon, tu as enlevé le ver de terre accroché à l’ hameçon, tu as accroché
l’ hameçon à la canne à pêche et tu as commencé à marcher, dans l’eau, vers le bord de la rivière où ta tante pleurait et disait que ce qui t’arrivait était malheureux. Dans une de tes mains, tu as dit que tu que tu tenais le sac en plastique qui contenait les poissons pêchés. Tu avais pêché environ deux kilos de poisson. Tu marchais dans l’eau et tu tenais ta canne à pêche sur une de tes épaules et tu pensais à ton père et tu regardais l’eau de la rivière et ta tante qui t’attendait sur le bord de la rivière et tu regardais les peupliers qui poussaient sur le bord de la rivière où ta tante t’attendait et tu pensais à ta canne à pêche faite d’une tige de roseau. Il faisait chaud. Tu étais habillé d’un pantalon court et, dans une des poches de ce pantalon court, tu avais une boîte de cire dans laquelle tu gardais les vers de terre pour la pêche. Tu avais dans cette poche cette boîte métallique avec son couvercle troué afin que les vers de terre puissent respirer. Dans l’autre poche de ton pantalon court, tu avais une boîte en plastique, une boîte de médicaments et dans cette boîte tu gardais des hameçons de réserve. Tu avais plusieurs hameçons de réserve. Tu avais une ceinture en cuir à ce pantalon court et à ta ceinture était pendu, dans son fourreau, ton couteau de pêche. Ton couteau de pêche, fait d’une de mes baïonnettes de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens bien du jour où je t’ai donné cette baïonnette. Tu t’approchais du bord de la rivière et tu voyais ta tante qui avait un tablier sur sa robe, et tu pensais qu’elle était en train de préparer le repas. Tu pensais à ton père. Tu l’avais vu deux mois en arrière. Il t’avait acheté un vélo. Un vélo de course pour ta réussite à l’examen. Deux mois auparavant, ton père et toi, vous avez fêté ton entrée au lycée. Tu voulais un vélo de course. Il t’avait acheté ce vélo de course. L’eau de la rivière était chaude et tu l’as quittée en montant sur le bord où ta tante pleurait et disait «c’était un brave homme, ton père.» Tu as pris le sac en plastique qui contenait les poissons et tu l’as donné à ta tante. Elle a pris le sac avec les poissons et vous êtes partis vers la maison, en suivant le chemin qui longeait le bord de la rivière. Vous avez marché sous les branches des saules et sous les branches des peupliers. Quand le bord de la rivière a rejoint la route, vous avez pris le chemin qui mène à la maison de ta tante et chaque fois que vous croisiez quelqu’un la tante lui annonçait la mauvaise nouvelle, elle s’arrêtait quelques secondes et elle disait «son père vient de mourir.» Tu regardais ta tante et les gens qui venaient d’apprendre que ton père était mort. Tu étais pieds nus. Jusqu’à la maison de la tante, vous avez rencontré plusieurs personnes qui habitaient la rue et qui connaissaient ton père et qui apprenaient que ton père venait de mourir. Tu ne parlais pas. Tu es entré dans la cour de la maison de la tante et tu as sorti la boîte avec les vers de terre, tu lui as enlevé le couvercle et tu as versé les vers de terre sur la terre des rosiers, à l’ombre, et tu as vu comme les vers de terre commencent à bouger et à chercher des trous dans la terre des rosiers et à disparaître dans ces trous qui les abritent de la chaleur. Tu as remis le couvercle de la boîte de cire et tu as remis dans ta poche cette boîte métallique. Tu as longé la maison de ton oncle, jusqu’à la terrasse, tu as posé par terre ta canne à pêche, tu as enlevé ton couteau de pêche de la ceinture, tu as mis ce couteau sur la table de la terrasse puis tu as sorti de tes poches la boîte avec les hameçons de réserve et la boîte métallique avec le couvercle troué et tu as mis ces deux boîtes sur le comptoir en bois installé contre la barrière qui sépare la terrasse de la basse-cour. Tu as dit à ta tante que tu allais chez ta grand-mère. La grand-mère habitait la même rue. Elle habitait deux cent mètres plus loin. Tu habitais avec ta grand-mère. Dans la même maison, ta grand-mère avait deux chambres et un grand hall et tu avais deux chambres à toi tout seul. Tu avais quatorze ans. Tu venais d’avoir quatorze ans. Tu as fait tout seul le chemin entre la maison de ton oncle et la maison de ta grand-mère. Tu pensais à la mort. La mort de ton papa n’était pas la mort. Tu te rendais compte que la mort de quelqu’un n’est pas ta mort. Tu comprenais que ton père ne te parlerait plus jamais et tu savais que cela ne signifiait pas que ton père te quitterait pour toujours. Tu es entré dans la cour de la maison où tu habitais avec ta grand-mère maternelle et tu a vu ta grand-mère t’accueillir depuis le seuil de sa cuisine d’été. Elle t’a dit «sois fort, tous on fini dans la terre, qu’on le veuille ou pas!». Elle t’a dit «il est mort jeune, ton père» et elle t’a demandé si tu voulais te laver. Elle a sorti de la cuisine un tabouret et une bassine en plastique et elle a placé la bassine sur le tabouret, devant la porte de sa cuisine, puis elle est allée prendre de l’eau à la fontaine de la maison, dans la cour. Elle a rempli d’eau une grande casserole et elle a mis cete casserole remplie d’eau sur un des feux allumés de la cuisinière, puis elle a apporté le savon et elle l’a posé sur le tabouret à côté de la bassine en plastique. Tu étais assis sur le seuil de la porte de la cuisine d’été et tu regardais les châtaigners de la cour et le cerisier. Tu ne pensais à rien. Tu regardais tes bras croisés sur tes genoux et tu regardais tes pieds nus et tu regardais les gens qui passaient dans la rue et que tu reconnaissais à travers les fentes de la palissade. Elle est venue avec de l’eau chaude et elle a versé dans la bassine plusieurs litres d’eau chaude, puis elle est venue avec de l’eau froide et elle a versé de l’eau froide par dessus l’eau chaude et elle a testé de ses mains le mélange d’eau chaude et d’eau froide, puis elle t’a dit «elle est bonne, tu peux commencer», et elle est partie dans la cuisine d’été. Ton père était une sorte de rebelle qui disait tout en face et à n’importe qui. Tu as pris le savon, et, debout, devant la bassine posée sur le tabouret, tu as mis une de tes mains dans l’eau, tu as pris de l’eau dans la paume de ta main, tu as mis l’eau sur tes bras, sur tes épaules, sur ton cou, sur ta poitrine, et tu savonnais chaque partie de ton corps. Tu ne voyais pas beaucoup ton père. Tu le voyais seulement quelques mois par année. Tu voyais l’eau sale couler depuis ton corps dans la bassine en plastique, tu frottais ta peau et tu voyais une couche de mousse grise se former à la surface de l’eau de la bassine et ta grand-mère te regardait depuis le seuil de sa cuisine d’été. Quand elle a vu que tu étais prêt, elle t’a apporté de l’eau froide pour te rincer et elle a versé de l’eau froide sur ton corps à l’aide d’un seau et tu prenais des filets d’eau froide dans les paumes de tes mains et tu laissais couler de l’eau froide sur tes bras et tes épaules et ta nuque, et c’est là que tu as pleuré pour la première fois. Pour la première fois de ta vie, à quatorze ans, tu as pleuré.
Ce texte constitue la première séquence de La Symphonie du Loup, parue aux éditions José Corti, 398p. La Symphonie du Loup
La Symphonie du Loup Dès l’ouverture, limpide et poignante, de cette chronique polyphonique que constitue La Symphonie du loup, le lecteur est saisi par la puissance expressive et narrative de l’auteur, évoquant initialement la scène capitale de son adolescence, au jour où lui fut annoncée la mort accidentelle de son père. D’emblée aussi, la modulation vocale du récit, par le truchement de la voix du grand-père paternel, figure tutélaire faisant pendant à celle du père disparu, inscrit cette remémoration dans le flux et les rythmes d’une véritable épopée personnelle au temps du Parti unique. Dans cette Roumanie de la dictature du « socialisme réel » dont nous découvrons peu à peu le décor déglingué et la vie quotidienne, avec une frise de personnages hauts en couleurs dont la vitalité expansive colore et réchauffe un univers teinté d’absurde, Marius Daniel Popescu puise une substance romanesque effervescente, que son talent de romancier fixe en visions inoubliables, comme celle de tel cheval martyrisé. En contrepoint de ces rhapsodies « gitanes » proches parfois de la transe, se dessine le motif tout de douceur et de délicatesse de la vie présente de l’écrivain, où le fils éperdu se reconstruit dans son rôle de père attentionné et de « loup » pacifié.
Il y a comme une « chronique européenne » en raccourci dans ce grand récit alterné, profus et généreux, qui brasse plusieurs cultures et les expériences de plusieurs générations, finalement ressaisi dans l’unité d’une langue-geste originale.
Marius Daniel Popescu, né à Craiova (Roumanie) en 1963, et établi à Lausanne depuis 1990, où il gagne sa vie en qualité de chauffeur de bus au Transports publics locaux, est à la fois écrivain, poète et prosateur. Il a commencé de composer et de publier de la poésie dans son pays d’origine, où parurent quatre recueils. Son premier ouvrage de poèmes en langue française, intitulé 4 x 4, poèmes tout-terrains et publié par les éditions Antipodes, à Lausanne, fut suivi en 2004 par Arrêts déplacés, chez le même éditeur, qui obtint le prix Rilke 2006. Proche du quotidien par sa poésie, dans une veine rappelant parfois le lyrisme urbain d’un Raymond Carver ou d’un Charles Bukowski, Marius Daniel Popescu a lancé dès 2004 un journal dont il est le rédacteur unique, à l’enseigne du Persil, marqué par la même démarche lyrique et critique visant à la sacralisation des choses de la vie et à la lutte contre l’uniformisation.Bien présent dans la vie littéraire romande, par le truchement d’animations diverses (dans les prisons ou les écoles), de collaborations à des revues ou à divers médias, Marius Daniel Popescu publie aujourd'hui La symphonie du loup, première grande prose polyphonique brassant des thèmes autobiographiques fortement enracinés dans son expérience roumaine, avec le constant contrepoint de sa vie actuelle. Marié à l’artiste lausannoise Marie-Josée Imsand, Marius Daniel Popescu est père de deux enfants.
Photo JLK
-
Marthe Keller au débotté

JOURNÉES DE SOLEURE La célèbre comédienne d’origine bâloise préside le jury du Prix du cinéma suisse, qui sera remis mercredi 23 janvier aux Journées de Soleure (21-27 janvier).
Si Marthe Keller a fait une brillante carrière internationale à l’écran, à la télévision, au théâtre et plus récemment dans la mise en scène d’opéra, le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne doit rien au cinéma suisse. Révélée en France par Philippe de Broca, elle a joué avec Lelouch avant d’enchaîner une brillante série américaine, notamment avec John Schlesinger (Marathon Man),Sydney Pollack (Bobby Deerfield) et Billy Wilder (Fedora). Trente ans plus tard, sans parler de ses innombrables rôles au théâtre, elle a plus d’une septantaine de films à son palmarès sur les deux écrans, un prix d’interprétation (Par amour d’Alain Tasma), le prix du cinéma suisse 2006 pour le meilleur second rôle dans Fragile ,de Laurent Nègre, et six nouveaux tournages en 2007…
- Quelle impression vous fait le cinéma suisse actuel ?
- A vrai dire, je le connais peu, vivant le plus souvent à l’étranger. Cela résume d’ailleurs sa situation : à savoir qu’il est peu visible hors des frontières helvétiques, si l’on excepte les festivals, ce que je trouve très regrettable. Pour la vingtaine de films que j’ai vus, comme les autres membres du jury, en prévision des Journées de Soleure, je dirai que mon impression générale a été bonne, à deux ou trois exceptions près. Ce qui est sûr, c’est que le potentiel est là : des réalisateurs et des acteurs de talent, des projets intéressants, un niveau artistique satisfaisant, et j’aurais alors envie de dire : maintenant, foncez !
- Manque d’ambition ?
- Probablement, même si je ne veux pas généraliser à partir d’une vue partielle. Manque de sûreté en tout cas, comme souvent dans notre pays où nous n’osons pas affirmer nos qualités, pourtant bien réelles. Manque de moyens aussi, du fait qu’il n’y a pas d’industrie du cinéma.
- Vous semble-t-il identifiable en tant que « cinéma suisse » ?
- Oui et non. A l’époque des Tanner, Soutter et autres Goretta, plus Godard évidemment, dont j’ai vu les films parce qu’ils étaient largement exportés et diffusés, et que j’ai beaucoup aimés, la « marque » était liée à un engagement et à une identification comparables à ce qui faisait qu’il y avait un « cinéma tchèque » ou un « cinéma polonais ». On avait plutôt affaire à des auteurs ou des groupes d’auteurs qu’à des emblèmes nationaux. Dans les films que j’ai vus pour Soleure, le souci « politique » n’a plus la même signification même si les thèmes sociaux restent bien présents, comme dans le reste du monde, mais je remarque un ton commun, qui tient à des détails, à une façon d’être et de se comporter, une certaine sauvagerie et un certain rapport à la nature à la Robert Walser. Enfin une chose me manque dans ce que j’ai vu : l’humour.
- Trop sérieux, le cinéma suisse ?
- Ce que j’ai adoré, dans le cinéma italien par exemple, c’est la manière d’aborder de grands thèmes sociaux ou politiques, sans perdre le sens de l’humour. Ceci dit, le sérieux est aussi une qualité, et je le trouve particulièrement remarquable dans le documentaire suisse.
- Quel souvenir gardez-vous de votre participation à Fragile, le film de Laurent Nègre dont vous étiez la tête d’affiche ?
- J’estime avoir eu beaucoup de chance dans ma carrière, et c’est pourquoi je trouve normal d’« aider » les artistes plus jeunes. Du tournage de Fragile, à vrai dire très bref pour moi, puisque je n’ai travaillé qu’une semaine avec l’équipe, je garde un souvenir de qualité, autant pour le travail que les relations humaines. Le film m’a touché, ensuite, par son étrangeté et le mystère qu’il diffuse, également par ce « ton » que j’évoquais.
- Pourquoi ne vous voit-on pas plus souvent dans des films suisses ?
- Parce que personne ne vient me chercher ! Même après le film de Laurent Nègre: pas une proposition. Et figurez-vous que la presse alémanique vient de se souvenir de moi alors qu’elle m’avait « oubliée » depuis des décennies. Mais je ne me plains pas : je viens de tourner six films d’affilée, au cinéma et pour la télévision, dont au moins deux, voire trois, me semblent bons…
- Quel film récent vous a-t-il marquée ?
- Le grand cinéma d'auteur des Bergman, Bunuel, Fellini et consorts, est en chute libre, mais j’ai trouvé, dans La vie des autres du jeune Florian Henckel von Donnersmarck, tout ce que j’attends du bon cinéma : l’intelligence, la sensibilité, le courage, l’émotion, bref on paierait pour jouer dans un tel film !
- De beaux projets ?
- Pour le moment je me repose, car j’ai beaucoup travaillé l’année dernière, et j’aspire maintenant choisir des projets de qualité. Au théâtre, celui de réaliser Ghost à New York, et pour le cinéma : de nombreux scénarios en lecture. Aussi, j’ai besoin de me ressourcer: de prendre le temps de vivre… -
Charme et style de Sagan
 C’est un livre absolument goûteux, vivant et chaleureux, que Sagan à toute allure, approche biographique joyeusement désordonnée de Françoise Sagan par Marie-Dominique Lelièvre. S’y déploie un portrait kaléidoscopique remarquable de la femme-enfant propulsée au pinacle de la gloire littéraire dès son premier roman (Bonjour tristesse, en 1954), dont on peut rappeler qu'il fut adoubé par les plus éminents auteurs et critiques de l'époque (de Paulhan à Nadeau, ou d'Arland à Chardonne, Mauriac ou De Fallois). En outre, la traversée de l’œuvre, nourrie par une lecture pertinente, se mêle à une chronique très documentée de la vie de patachon menée par Sagan dont nous découvrons pas mal d’aspects du caractère (à dominante bon enfant désarmant) et de la vie, entre sauteries et retraites d’écriture, fêtes et déprimes ou défonces. Françoise Quoirez (née en 1935) y apparaît en garçonne craquante (quasiment un play-boy…) aussi douée que fragile, de mœurs très libres, incapable de vivre ou de dormir seule (elle a mis autant de belles dames dans son lit, dont Ava Gardner, que de beaux mecs, sans compter ses deux maris), buvant sec, claquant son fric au casino ou en boîte et plus encore à sniffer, sans que ce tourbillon d’inconduite ne laisse la moindre trace dans le style de la romancière, disciple bohème de Stendhal à l’art concis et fluide, d’une musicalité sans faille, cousine vieille France de Scott Fitzgerald avec sa fêlure à elle.
C’est un livre absolument goûteux, vivant et chaleureux, que Sagan à toute allure, approche biographique joyeusement désordonnée de Françoise Sagan par Marie-Dominique Lelièvre. S’y déploie un portrait kaléidoscopique remarquable de la femme-enfant propulsée au pinacle de la gloire littéraire dès son premier roman (Bonjour tristesse, en 1954), dont on peut rappeler qu'il fut adoubé par les plus éminents auteurs et critiques de l'époque (de Paulhan à Nadeau, ou d'Arland à Chardonne, Mauriac ou De Fallois). En outre, la traversée de l’œuvre, nourrie par une lecture pertinente, se mêle à une chronique très documentée de la vie de patachon menée par Sagan dont nous découvrons pas mal d’aspects du caractère (à dominante bon enfant désarmant) et de la vie, entre sauteries et retraites d’écriture, fêtes et déprimes ou défonces. Françoise Quoirez (née en 1935) y apparaît en garçonne craquante (quasiment un play-boy…) aussi douée que fragile, de mœurs très libres, incapable de vivre ou de dormir seule (elle a mis autant de belles dames dans son lit, dont Ava Gardner, que de beaux mecs, sans compter ses deux maris), buvant sec, claquant son fric au casino ou en boîte et plus encore à sniffer, sans que ce tourbillon d’inconduite ne laisse la moindre trace dans le style de la romancière, disciple bohème de Stendhal à l’art concis et fluide, d’une musicalité sans faille, cousine vieille France de Scott Fitzgerald avec sa fêlure à elle.Marie-Dominique Leliève, qui écrit avec bonheur elle aussi, a multiplié les rencontres de gens qui ont aimé Sagan, de Florence Malraux à Bernard Franck, entre cinquante autres, dont les témoignages dégagent une tendresse irrépressible pour cet androgyne ludionesque qui fut aussi, et surtout, un écrivain de classe, c'est à savoir classique et classieux, pas encore pour classes terminales mais qui vivra verra...
Sagan à toute allure, de Marie-Dominique Lelièvre. Denoël, 343p.
-
Toute honte savourée

Passé de la gauche (il fut secrétaire des Temps Modernes), à la droite anarchisante, Jean Cau (1925-1993) laisse une œuvre considérable de romancier (La pitié de Dieu, Goncourt 1961), de nouvelliste élégant et d’essayiste stylé aux positions réactionnaire qui lui valurent une aussi mauvaise réputation qu’à son ami Jean Dutourd. Or celui-ci, académicien jovial, eut l’idée, à la fin des années 1980, de l’inciter à se présenter à son tour à l’Académie française, ce qu’il entreprit à son corps plus ou moins défendant, avec la cuisante obligation, en cas de vote favorable, d’avoir à prononcer l’éloge d’Edgar Faure, qu’il dit « ce Fregoli cuit et recuit, mariné et faisandé, décomposé et recomposé dans toutes les sauces de trois républiques »… Si cette corvée lui fut épargnée, le bretteur ne considéra pas moins, post coïtum interruptus, sa requête, repoussée par quinze voix contre quatorze, comme une action basse de sa part, une tache qu’il s’est donné pour tâche de laver en racontant cette « farce ».
On ne lui fera pas le procès trop facile du mauvais perdant se dédouanant : ce petit récit de ses visites, paru à titre posthume, nous vaut en effet quelques propos et autres portraits aussi peu académiques qu’improbablement voués à l’immortalité - à tout le moins piquants.
Jean Cau. Le Candidat. (préface d’Alain Delon tel qu'en lui-même modeste et pompon).
Editions Xenia, 96p. -
Avec les mots du cœur

Anne-Lise Thurler est décédée ce matin, laissant une œuvre vibrante d’humanité.
C’est une figure attachante de la littérature romande qui s’est éteinte aujourd'hui en la personne d’Anne-Lise Thurler, romancière et nouvelliste dont le dernier récit, paru en avril 2007 chez Zoé sous le titre de La fille au balcon, restera comme l’un de ses ouvrages les plus aboutis, les plus frémissants de sensibilité et les plus ouverts à la compréhension de l’autre.
Il y est question, après la mort de la mère de la narratrice, de l’effort que celle-ci s’impose afin de retrouver, malgré des années d’incompréhension et de maltraitance, celle dont elle s’était déjà rapprochée durant les dernières années de sa vie. Avec une lucidité claire nuancée de tendresse blessée, Anne-Lise Thurler aura donné, dans ce dernier livre paru, le meilleur d’un talent toujours nourri par la vie, qui s’est déployé dans le roman (Le crocodile ne dévore pas le pangolin et Lou du fleuve) et les nouvelles (Scènes de la mort ordinaire et L’enfance en miettes). Attentive aux misères du monde, elle avait également composé, avec Selajdin Doli, réfugié kosovar, un récit-témoignage à deux voix évoquant les tribulations des Albanais du Kosovo, intitulé Aube noire sur la plaine des merles, adapté au théâtre par Isabelle Bonillo et présenté au fil d’une longue tournée en Suisse romande.
Terrassée par la maladie avant la cinquantaine (elle était née en 1960 à Fribourg et vivait au Mont-sur-Lausanne avec ses deux jeunes enfants), Anne-Lise Thurler laisse, à ceux qui l’ont connue, le souvenir d’un belle personne rayonnante et généreuse.
-
Le courage de Boualem Sansal

Le village de l’Allemand, entre Shoah et Djihad
La lecture du Village de l’Allemand, nouveau roman de l’écrivain algérien Boualem Sansal, est immédiatement prenante. Aussitôt on plonge dans un drame aux multiples occurrences personnelles et autres ramifications historico-politiques, dont le Mal du XXe siècle et de celui qui a si dangereusement commencé, entre Shoah et Djihad, tisse la trame de sang et de destruction, d’ignominie et de honte.
Cela commence, en octobre 1996, par le journal du jeune Malrich (prénom condensant Malek et Ulrich), dont le langage signale un beur de banlieue plutôt atypique, puisque son père est d’origine allemande, et qui commence d’écrire six mois après le suicide de son grand frère Rachel (condensé de Rachid et Helmut), brillant sujet, comme on dit, mais sombré dans le désespoir on ne sait pourquoi.
On le comprend mieux après que Com’Dad, le commissaire de quartier de la « zone urbaine sensible de première catégorie » où survivote Malrich, remet à celui-ci les quatre cahiers chiffonnés constituant le journal de Rachel, ledit Com’Dad lançant au plus ou moins voyou : « Faut lire, ça te mettra du plomb dans la tête. Ton frère était un type bien ». Et de fait, ces cahiers vont changer la vie de Malrich, comme la vie de Rachel a changé, au lendemain d’un massacre, en 1994, qui a coûté la vie à ses parents, là-bas dans un douar du bout du monde du nom d’Aïn Deb, quand il découvrit qui fut en réalité son père déclaré « martyr », l’ancien SS Hans Schiller…
On sait le grand talent de Boualem Sansal, auteur de l’admirable Serment des Barbares, et son courage intellectuel, qui lui a dicté l’an dernier la lettre ouverte de colère et d'espoir au pouvoir et au peuple algérien intitulée Poste restante : Alger. On se rappelle l’amitié qui le liait à Rachid Mimouni, autre romancier intègre qui mourut désespéré en Europe et dont le corps rapatrié dans son pays fut déterré par les islamistes pour être dépecé et livré aux chiens de la nuit. Je me souviens qu’à ma dernière rencontre de Mimouni je lui souhaitai d’être protégé par Allah. Or c’est le même Allah que j’invoque en lisant ce nouveau livre, inspiré par une histoire vraie, où alternent les voix des deux frères, celle de Rachel relayant elle-même les voix de tous les témoins de l’horreur, Primo Levi en tête et transmettant à celle de Malrich une nouvelle conscience et l’espoir que la honte puisse être dépassée par le « geste d’amour » de son sacrifice…
Boualem Sansal. Le village de l'Allemand, ou le journal des frères Schiller. Gallimard, 263p. -
Pierrot le fou le reste

La Compagnie Un air de rien revisite Pierrot le fou de Godard en évitant le recyclage complaisant. A voir à Vidy.
Quel sens cela peut-il bien avoir, plus de quarante ans après le choc artistique qu'a constitué la sortie de Pierrot le fou (en 1965), de revisiter au théâtre l'un des films «cultes» de Jean-Luc Godard, alors même que celui-ci dénonce aujourd'hui le manque de créativité des nouvelles générations? Comment échapper au réchauffé, voire à la resucée débile, étant entendu que ce qui survit du film tient essentiellement au cinéma, plus exactement: à la géniale «musique de plans» de Godard? Après Bonnie and Clyde ou Sailor and Lula, cette énième cavale des amants libertaires ne se réduirait-elle pas à un recyclage opportuniste?
Telles sont les questions que se seront posées d'aucuns avant d'assister au Pierrot le fou de la Compagnie Un air de rien, dans une mise en scène très inventive de Sandra Gaudin et une (belle et efficace) scénographie de Sylvie Kleiber, assistée par Joan Ayrton pour l'horizon pictural, avec une équipe de trentenaires fringants pour complices, dont sept comédiens pétants de talentueuse santé.
Qu'est-ce que Pierrot le fou à l'origine? En gros, pour citer un bout du scénario de Godard, c'est l'histoire de Ferdinand et Marianne qui «sautent dans l'eau en riant. Ils ne réussissent pas à sauver les valises mais s'en foutent, et s'éloignent en se tenant par la taille. Le long de la plage déserte, éclairée par le soleil couchant, la mer efface la trace de leurs pas.» C'est donc une histoire d'amants sur la plage du monde, ici et maintenant, dont on va suivre les traces de pas avant que la mer ne les efface, à moins que ça ne finisse à la mitraillette, comme dans les polars à quatre sous, et qu'il en reste du rouge, assorti à la robe de la dame...
Au théâtre, maintenant, c'est tout de suite la question du langage qui est posée par une petite fille au ballon à Pierrot vautré dans sa baignoire et lisant sa propre histoire pour lâcher justement ce mot de «langage»: «Ah mais, m'sieur, le langage, c'est quoi?»
Eh bien, voici ce que c'est: c'est du piapia de pub gorillé, ce sont les formules de la persuasion clandestine et de la philosophie à La petite semaine de Suzette postmoderne, c'est du patchwork de clichés émaillant tous les discours de tous les pouvoirs et de tous les affects du monde qui nous entoure autant en 2008 qu'en 1965, y compris les images pastichant la téloche ou les journaux gratuits.
C'est plus précisément la road story de Marianne et Ferdinand préludant à celle des Valseuses de Blier ou de Tueurs nés de Stone, mais avec les moyens du théâtre. Donc c'est redécoupé pour la scène, avec un montage de plans ad hoc, un dialogue recousu pile-poil «sur la bête». Et «la bête» vivante sur scène: sept comédiens en chair et en os pour dire la vie vite au moyen d'un éventail d'expressions touchant à toutes les formes, via le chant et la danse, la citation légendaire (le couple en Dauphine), le clin d'oeil au burlesque américain ou à la bande dessinée anarchisante, notamment.
Les acteurs réunis en l'occurrence sont tous épatants, à commencer par Diane Müller et Christian Scheidt (Marianne et Ferdinand), bien entourés par Hélène Cattin avec ses jolis nénés à l'air de femme superactuelle, Jean-Paul Favre qui chante et danse avec la grâce d'un éléphanteau de revue, Shin Iglesias «dégageant» elle aussi un max, Magali Tosato jouant Magali Tosato comme dans un film de Godard, et Nicolas Rossier en Godard à cigare pour l'envoi final.
Surtout, avec musiques et lumières (Pascal Noël, Ben Merlin et Guitos Fournier), costumes (Marie-Christine Meunier) et objets plus ou moins automobiles combinés dans l'ensemble du montage, sans temps morts ni trous d'espace, le ton du spectacle, en crescendo, «sonne» juste, ludique, intelligent et rigolo, le pied léger. Rien d'un «jeunisme» de pacotille dans cette réalisation chaleureusement accueillie, mais comme un air de jeunesse tonifiant...
Lausanne, Théâtre de Vidy, jusqu’au 3 février. www.theatrevidy.chCet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 17 janvier 2008.
-
Une musique fraternelle

Sur La visite de la fanfare d’Eran Kolirin
On s’attend d’abord à une satire ou, du moins, à un film jouant sur l’ironie, en découvrant les premières séquences de La visite de la fanfare de l’Israélien Eran Kolirin, dès l’arrivée des ploucs de la fanfare de la police d’Alexandrie dans ce trou perdu d’Israël où ils sont censés représenter l’honneur de l’harmonie égyptienne. Hélas, un malentendu les fait débarquer dans le bled de Bet Hatkiva au lieu de Patah Tikva où ils étaient attendus, et plus moyen de se tirer de là avant le bus du lendemain. Or on s’amuse de voir paniquer leur cérémonieux directeur (Sasson Gabai), imbu de sa tâche comme s’il en allait d’un enjeu national, et le premier passage en revue des membres de cette clique perdue, dont l’élément le moins contrôlable est le beau jeune Khaled aux yeux bleus cherchant la gueuse et traînant la patte en murmurant My funny Valentine de Chet Baker, ne manque pas de sel.
Bientôt, cependant, dès l’apparition de Dina (la merveilleuse Ronit Elkabetz), tenancière du bistrot de la vague bourgade où ils ont échoué, et qui les accueille pour la nuit, la cocasserie insolite de l’épisode va céder le pas à une émotion croissante, liée à l’atmosphère générale du récit et aux relations se nouant entre les personnages. Pour la soirée, Dina s’est réservé les deux fleurons masculins du groupe (le directeur coincé à souhait mais bel homme, et le jeune Khaled), tandis que leurs collègues subissent l’humeur mitigée d’une famille qui les reçoit de moins bonne grâce. Entre un dancing pour patineurs à roulettes et une boîte plus branchée, un jardin public et un bord de mer, les protagonistes vont frayer plus ou moins et parfois communiquer, tantôt par la musique (ce beau moment où Egyptiens et Israéliens se mettent à chanter Summertime) et tantôt par le geste (la séduction d’un laideron par un garçon timide qu’instruit Khaled nettement plus à la coule), ou par la confidence personnelle qui marque l’échange le plus émouvant du film, entre Dina et le chef tombant le masque et révélant son passé douloureux avant de se révéler, lui aussi, un adepte de Chet Baker...
 On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému.
On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému. -
Ceux qui se ressourcent
Celui qui se remet à la cure de phosphate / Celle qui brûle ses toxines en courant dans les escaliers / Ceux qui vont d'un bon pas sur leurs prothèses nickelées / Celle qu'insupportent les romans qui ne finissent pas bien / Ceux que leur pessimisme fait péter le feu / Celui qui se la pète aux amphètes /Celle qui acquiert avec confiance le package Poids (sauge, verveine, citronnelle, chiendent, feuilles de bigaradier) drainant, reminéralisant et détoxiquant/Ceux qui sourient sans discontinuer aux séances d’aquagym/Celui qui estime qu’un pot de gelée royale vaut le prix d’un Evangile relié plein cuir/Celle qui découvre enfin la pressothérapie après deux divorces épuisants quoique rémunérateurs/Ceux qui parlent russe dans le jacuzzi/Celui qui a appris à distinguer le bigaradier coupe-faim de l’oranger ordinaire traité aux produits chimiques/Celle qui va se fumer une pipe de tabac hollandais sur la terrasse enneigée après que son amie Rosemonde lui a clairement fait des remarques sur son surpoids et ses humeurs de sanglier/Ceux qui se repassent la vidéo de l’exécution de Saddam en attendant l’heure de leur traitement botulique/Celui qui lit Eschyle dans l’Espace Détente du centre thermal/Celle qui remarque que ce qui manque au centre est une enceinte de barbelés et des miradors pour surveiller ceux qui refusent de se relaxer/Ceux qui ne sont pas loin de penser que le watsu est la grande conquête de la nouvelle culture japonaise/Celui qui se fait expliquer l’origine du shiatsu par le Japonais aux long cheveux qui lui a emprunté Le Tapin (c’est ainsi qu’il appelle le journal Le Matin)/Celle qui explique à la petite amie du Japonais aux longs cheveux que la raclette ne se déguste pas avec de la bière sans alcool/Ceux qui passent des heures dans la salle de repos panoramique à s’efforcer de ne penser à rien sans y parvenir nom de Dieu/Celui qui se demande comment son chien Fellow réagirait à la cure de relaxation Reiki plusieurs fois millénaire/Celle qui recommande la massage à la pierre volcanique aux Hollandais qui lui ont révélé les vertus du massage pédimaniluve/Ceux qui estiment que les employés des Sources ne devraient pas faire usage des fraiseuses Honda pour le déneigement des abords des bassins en plein air à cause des gaz polluants et d’une nuisance phonique pas possible/Celui qui se paie une teinture de sourcils pour se donner plus de chances auprès du jeune Chilien Pablo Escudo dont il apprécie les interprétations au pianola/Celle qui pète les plombs dans le hammam/Ceux qui déclarent que la cure de détente totale Nirvana à 75 francs les 30 minutes ne vaut pas la caresse orgiaque des buses d’eau…
Peinture: Leonor Fini
-
L'énigme de CELA
Carnets de 2007 (fragments)
De la musique. - Il m’est difficile, de parler de musique, autant que des livres qui me sont les plus chers, comme si cela relevait d’une part trop intime, à la limite de l’indicible. Je peux parler de littérature et de peinture sans aucune difficulté, je peux parler de blues ou de rock, qui ne me touchent guère en profondeur (même si je peux réécouter un blues cent fois de suite), mais il en va tout autrement de la musique, que je ne puis qu’évoquer en relation avec telle ou époque de ma vie, Bach pour la maison de notre enfance, Puccini dans ma trappe artiste des escaliers du Marché, Mahler au Grand Chemin ou à La Malmeneur, Arvo Pärt dans ma trappe viennoise ou Schubert à La Désirade, entre cent autres, de Fauré à Purcell…
Insomnie I. – CELA m’empêche de dormir et c’est bien: je reconnais CELA pour mon bien, CELA ne se dit pas, qui advient lorsque je me retourne ou me déporte. CELA est mon indicible et ma justification non volontaire.
Angoisse. – Je me dis qu’elle n’est pas de moi et précisément: elle est en moi le plus que moi qui me taraude, m’interroge et me porte à faire éclater ce moi trop étriqué et trop personnel. Par elle je renoue avec le fonds impersonnel qui procède de la personne mystérieuse. CELA est ma zone sacrée.Blanchot. – Longtemps je me suis couché sans le lire, mais ces nuits de bonne heure j’ouvre L’Amitié comme un recours secret. Je ne désire en parler à personne. Leur culte m’a fait me tenir à distance tout en le lisant en douce de loin en loin, lui en son moi nombreux, son silence clair, tellement doucement éclairant.
Mondanité. – Tenue de ville exigée. Dressing code. L’endroit où il faut être. Toutes ces formules d’un théâtre nul me remontent à la gorge en lisant Comment parler des livres qu’on n’a pas lus? Cela même que je fuis avec Walser et Bartleby à travers les taillis et le long des arêtes.
Grimace. – Le fantasme est grimace, qui n’est même pas un masque. Celui-ci serait pudeur ou protection, allusion à autre chose, même pulsion pure, tandis que le fantasme est sans histoire, j’entends le fantasme sexuel multimédiatique qui ne raconte rien mais branle la multitude.
Bartleby. – L’esquive de celui qui refuse de jouer ne me suffit pas. Je serai l’ennemi de l’intérieur. Je sonderai la bauge et m’en ferai le témoin. Ils croient m’avoir mais je leur souris au nez: je réponds à leur parole vide par mon silence songeur. Je mimerai leur vulgarité et leur platitude. Je vis tous les jours ce grand écart entre la substance et l’insignifiance.
Du non intérieur. – La Daena, de l’angéologie iranienne, est le modèle céleste à la ressemblance duquel j’ai été créé et le témoin qui m’accompagne et me juge en chacun de mes gestes. Au moment ultime je la verrai s’approcher de moi, transfigurée selon la conduite de ma vie en une créature encore plus belle ou en démon grimaçant. Ma Daena n’attend chaque jour qu’un petit non qui soit pour elle une pensée belle. Elle attend ta conversion matinale, me dis-je en lui souriant, puis je l’oublie en attendant demain qui m’attend, mais je garde en moi ce petit non que j’oppose à tout moment à ce qui risque d’enlaidir ma Daena…
Insomnie II. – CELA est à la fois le butoir et l’échappée. Tout vise à l’esquiver ou à l’acclimater dans la société du non-être, mais CELA me tient présent. Telle étant la formule: rester présent.
CELA. - Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, mais plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.
-
Un verbe de vibrant cristal

Poésie de Maurice Chappaz
« C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant».
Ce double accent porté, par un immense poète méconnu du grand public qui n’a jamais écrit un seul vers, sur la pureté cristalline et le caractère tonifiant de l’écriture de Maurice Chappaz, pour un texte de haute qualité poétique mais ne ressemblant à rien de ce qu’on attend dans le genre – ni poème versifié, ni prose poétique non plus - vaut aujourd’hui encore et pour toute l’œuvre de Maurice Chappaz, de son premier texte publié, Un homme qui vivait couché sur un banc, à ses derniers écrits de nonagénaire encore vif d’esprit et de plume. Toute l’œuvre de Maurice Chappaz, qu’on pourrait situer dans un Valais «tibétain » et un temps qui serait à la fois celui des Géorgiques de Virgile et des géniales improvisations de Rimbaud, est aussi bien du même cristal, qu’elle se module en vers libres ou qu’elle se décline en chroniques, en récits épiques ou lyriques, et jusque dans son formidable Evangile selon Judas, paru en 2001 chez Gallimard et passé quasiment inaperçu de la critique française.
De la découpe de cette écriture, de son ton et de sa musique, il faut donner immédiatement quelques exemples. Et du tout début pour commencer, avec ce qu’on pourrait dire l’entrée en lice du jeune poète, dans son premier texte publié en 1939 sous le titre d’ Un homme qui vivait couché sur un banc, d’ailleurs dédié à Cingria : « Il est temps d’entrer dans ce monde, d’allumer une cigarette et de tirer sur la fumée, sur le feuillage tremblant et bleu de l’air maintenant. Il s’agit de s’infuser ce qui est, et cet air du matin on le boit. » Tout de suite nous frappe le tour physique de la phrase de Chappaz, son recours à des éléments très concerts et sa transmutation simultanée en début de légende dorée. A l’école des poètes ou des chroniqueurs antiques, mais aussi des Riches Heures médiévales et du vélocipédiste Charles-Albert, Maurice Chappaz se présente d’emblée en troubadour anarchisant, passant par là comme le poète de Ramuz et notant cela simplement qui se trouve à sa vue : « Il y a des granges, des entrepôts, le char des paysans et les camions chargés de vivres qui démarrent dans les goudrons, tout un bazar d’étoffes, de charges de légumes, d’enfants des rues et les rudes travailleurs manuels ; la vie du peuple magnifique avec ses odeurs, sa peinture – odeur de foin, peinture de fruits ». Simple comme bonjour et telle sera la crâne représentation initiale du travail du poète : « Moi je m’étends sur un banc pour toute la journée. Rien faire, absolument rien faire ». Cela sonne, au seuil de la Deuxième Guerre mondiale et venant de la part d’un jeune fils d’avocat en vue, notable du Valais qui aimerait le voir se lancer dans le Droit et ne pas trop musarder, comme une déclaration d’indépendance et une prise de parole apparemment coupée des grandes préoccupations du monde. Pourtant, on verra par la suite que, loin de se cantonner dans une tour d’ivoire de littérateur, Maurice Chappaz jouera bel et bien son rôle dans la communauté, mais toujours en poète, voire en visionnaire.
 L’attention au monde
L’attention au monde
Un élément me semble fondamental dès l’entrée en poésie de Maurice Chappaz, et c’est son attention au détail des moindres choses, qu’il va saisir et « enluminer » par le truchement des mots et des images. Il le répétera d’ailleurs soixante ans plus tard dans son dernier opuscule, paru en 2007, au titre joyeusement provocant (Hors de l’Eglise pas de salut) par les temps qui courent : «le péché capital, le seul péché est le manque d’attention. Le temps présent se précipite telle une chute d’eau. Hâte-toi de puiser ! C’est-à-dire : sois attentif. » Or l’attention n’est pas que la consommation de la « chose vue » mais sa consumation et sa transmutation, qui fait que le spectacle le plus banal devient un fragment de tableau. Comme un livre d’image s’ouvre d’ailleurs Testament du Haut-Rhône, premier chef-d’œuvre: « Je loge à quelques lieues seulement de la forêt, au bout d’une prairie où les eaux s’évadent. Par les fenêtres ouvertes de ma demeure de bois (qui me porte et toute une famille d’enfants déguenillés, en train maintenant de dormir), on entend les clochettes d’un troupeau de chèvres qui se déplace sur les pentes ainsi qu’une eau courante ou un nuage de feuilles sèches ».
Ou encore, revenant un peu plus loin « à la lisière d’une ville assez vaste » où il avoue passer « pour connaître des femmes », l’errant lyrique poursuit son début de chronique légendaire : « Une angoisse agréable me poussait à travers des parcs et d’anciens quartiers pour surprendre les échanges secrets de la foule dans lesquels, comme une once d’or, je pesais ma propre luxure et le deuil de mon enfance. Je fréquentais les jardins de lilas et l’extrémité d’une banlieue où s’amalgamaient quantité de boutiques et de cafés pareils aux boulettes d’ossements que rejette l’estomac des hiboux. » Or, ces clochettes des chèvres semblables, sur la montagne de l’aube qui pourrait être d’une aquarelle chinoise, à « une eau courante ou à un nuage de feuilles sèches », et ces boutiques et autres cafés « pareils aux boulettes d’ossements » déféqués par des oiseaux de nuit, sont du Chappaz le plus pur, comme le sont ces vers de Tendres campagnes à la dévotion de la femme aimée :
« Mon désir d’elle
la fait ressembler à une carafe d’eau glacée
qui circule en plein midi
à la terrasse d’un café.
Mon désir d’elle la pose sur la table
telle une cathédrale claire et fragile,
le litre et le verre.
Mais mes lèvres balbutient de soif
et cette transparence est pour mon esprit
une nuit au milieu du jour.»
 Un franciscain nomade
Un franciscain nomade
Pour marquer sa double rupture radicale d’avec son milieu de riches bourgeois et la vie de flambeur qu’il a menée jusque-là, le jeune Francesco Bernardone se met à poil sur la place d’Assise, en 1206, avant d’endosser la tenue du Poverello, et la même mue vestimentaire symbolique, au début d’Un Homme qui vivait couché sur un banc, scelle l’entrée du jeune homme de 23 ans dans ce que son ami Georges Haldas appellera plus tard « l’état de poésie ». Celui-ci n’aura rien d’académique ni moins encore de statique : ce sera une façon de vivre autant qu’une instance fondatrice de l’écriture.
La vocation et le rôle du poète sont assez précisément définis par Chappaz dans ses premiers livres. Un homme qui vivait couché sur un banc évoque d’emblée la vie nouvelle d’un quidam qui se défait de « son habit fort civil » avec quelques jurons bien sentis (des « damned », des « christo », des « morbleu »…), pour revêtir le costume le plus simple. «Il libéra ses souliers d’une secousse et un instant il fut tout nu (rudement étrange, bonnes gens, Cicérons !) et un instant après chaussé d’espadrilles, vêtu d’un pantalon de toile bleue, d’un chandail et d’une vieille casquette, c’est-à-dire comme Jacques et comme Pierrot, ses amis». Et d’ajouter sur le même ton de romantisme bohème : « Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment beau, ce qui est extra, comme disent les enfants et les poètes, c’est la liberté ». Plus tard, après « sept années de tourmente », Testament du Haut-Rhône donnera de la poésie et du poète une définition plus grave et déjà prophétique puisque « les poètes seront en fait des devins. » Rien là pour autant d’occulte, mais le « voyant » de Rimbaud reste proche, qui s’oppose aux « assis » de la société conformiste : « Nous explorons les gouffres légers de l’enfance, décelant comme la chouette des Ecritures les ordres sacrés aujourd’hui pareils à des débris fanés. (…) Ceux que leurs propres cités rejettent, ceux-là seul auront le pouvoir d’écrire et de tester pour le monde défunt. J’en salue les héritiers : des ouvriers d’usine, des bergers, des semeurs de seigle, des petits marchands d’abricots et de raisons ; notre histoire sera faite par eux et non plus par les avocats ».
S’il y a du marginal errant en Chappaz, qui s’est heurté violemment à la volonté du père pour obéir à sa vocation, lui-même connaîtra cependant les responsabilités d’une charge de famille après son mariage avec S. Corinna Bille, en 1947, avec laquelle il aura trois enfants, et ne pourra donc passer sa vie « à ne rien faire, absolument rien faire ». L’expérience de la guerre, sa participation (de 1955 à 1958) à la construction du barrage de la Grande-Dixence, et le travail sur les domaines vignerons de la famille, constitueront, avec maintes virées proches et moult grands voyages autour du monde, autant d’expériences formatrices ou lucratives qui distinguent nettement son mode de vie de celui d’un homme de lettres, d’un professeur ou d’un journaliste, même si le poète écrivit lui aussi de nombreux articles et autres chroniques pour assurer la matérielle, tôt engagé en outre dans la défense de l’environnement naturel et culturel. Mais là encore, le combat de Maurice Chappaz s’inscrit dans l’ensemble d’une vision du monde marqué au sceau de la poésie. En dépit de son titre provocateur, le pamphlet qui a valu au poète haines privées et injures publiques, Les maquereaux des cimes blanches, est un poème autant qu’une attaque frontale des affairistes immobiliers et autres marchands du temple valaisan.
« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète furieux, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ». Friedrich Dürrenmatt reprochait à la poésie romande de cultiver la « rose bleue » de l’esthétisme. On voit que Maurice Chappaz échappe à cette accusation. Au reste, il ne s’agit pas pour lui de s’opposer au progrès au nom du « bon vieux temps ». Bien plus : c’est une « fuite en avant » qu’il dénonce, dont nous voyons aujourd’hui les conséquences et l’extension mondiale.
 Danses d’amour et de mort
Danses d’amour et de mort
L’œuvre de Maurice Chappaz, dans sa double nature lyrique et prophétique, ne saurait être séparée de la tradition biblique et de la foi catholique, comme l’a fort bien illustré Christophe Carraud dans le premier essai substantiel consacré, en France, à l’écrivain valaisan. Cela ne fait pas pour autant de Chappaz un «poète catholique » comme on peut le dire d’un Claudel, au sens d’un auteur à «message». La théologie de Chappaz passe par la poésie et rejoint les chants et les sagesses du monde, de l’Orient arabe aux poètes T’ang, sans diluer ses dogmes pour autant. On pense en outre à la Vita nova de Dante et à l’Amour courtois des troubadours provençaux en lisant Tendres campagnes, où la Dame est à la fois désirée et sublimée par le chant.
Cela étant, loin des tourments de conscience de l’âme romande, à dominante protestante, le catholicisme de Maurice Chappaz et plus encore sa poésie sont tissés de sensualité et de saveur. La langue poétique de Chappaz, jusque dans l’ Evangile selon Judas, est une fête. « La femme dans l’ombre où elle est nue /est comme le lourd printemps frais », écrit-il dans Verdures de la nuit, premier recueil marquant (daté 1938-1941) qui célèbre précisément La merveille de la femme et commence par cette invocation. « O juillet qui fleurit dans les artères /je désire toutes les choses /dans la rouge mémoire de mon sang/ bougent les limons et les chairs vivaces »…
Or à la merveille est consubstantiellement liée la « miette d’ombre » symbole de corruption ou de mort, et toute danse de joie se poursuit dans la transe des danses de morts, comme dans la peinture médiévale et ses « grotesques » auxquels nous renvoient le recueil A rire et à mourir.
« Quelle est cette idée de faire une œuvre avec de l’encre ! Personne n’écrit ainsi. Le chant vient du sang, sur les montagnes du cœur il coule et il arrose le monde. Il fait germer les pays, c’est lui qui procrée. Il envoie les pensées devenir des arbres, des oiseaux, saumons ou truites dans l’eau (comme dans les cascades spirituelles que tu essaies de remonter). Chaque signe a besoin d’une goutelette de sang pour être manifeste. »
La poésie de Maurice Chappaz n’a pas d’âge ni ne s’est altérée d’année en année, dans son chant autant que dans ses récits à multiples ramifications. La meilleure preuve en est la prose étincelante d’invention de l’ Evangile selon Judas, publié par l’octogénaire, ou sa nouvelle approche des contes africains réunis dans Orphées noirs, l’année de ses nonante ans ! Bref, Chappaz est un poète savoureux et lumineux, profond et tonique jusque dans ses lettres à Gustave Roud, son ami et correspondant de longue date, ou dans Le livre de C. en mémoire de Corinna Bille, son Journal de l’année 1984 ou ces textes inspirés que sont L’Océan, magnifique évocation d’un grand voyage passant par New York (qu’il appelle « Nouillorque » !), Le garçon qui croyait au Paradis ou La mort s’est posée comme un oiseau.
Dès le Testament du Haut-Rhône, la conscience d’une perte irrémédiable a marqué l’œuvre de Maurice Chappaz de son sceau, relançant ses mises en garde et ses colères. Mais la vie est bonne jusque dans l’évidence de notre fin : La mort est devant moi…
« La mort est devant moi
comme un morceau de pain d’épice,
la vie m’a tournoyé dans le gosier
comme le vin d’un calice.
L’une par l’autre j’ai cherché à les expliquer.
J’ai trempé le pain dans le vin,
je me suis assis,
j’ai fumé,
J’étais sauvage avec les femmes,
avec les mains, avec l’esprit.
J’ai tâché de travailler à des œuvres qui respirent.
Maintenant je cherche un parfum
dans la nuit. »
Bien enracinée dans sa terre d’origine et faisant écho aux préoccupations de notre temps, jusqu’à la ruade polémique, l’œuvre de Chappaz nous transporte à la fois autour du monde et hors du temps, ou plus exactement au cœur de ce noyau temporel que figure l’instant « éternisé » de la poésie. Ernst Jünger écrivait que celui qui touche au cœur de la réalité en atteint tous les points de la circonférence, et c’est exactement la vertu de la poésie à la fois engagée et dégagée de Maurice Chappaz, capable à tout coup, à partir du plus simple objet de tous les jours regardé avec attention, d’atteindre l’essentiel.
Mourir c’est écrire, écrit enfin Maurice Chappaz… pour ne pas mourir :
« Qui est-ce qui passe ici si tard ? Entre un genévrier et le saule tremblant sur le Haut-Rhône en 203o…
Je suis parti au pays de la mémoire.
L’écriture est une crevasse dans un glacier qui devrait être le ciel bleu. « Je suis seul comme Franz Kafka », dit Kafka. « Je vivrai plus longtemps que vous », répond Lorca aux miliciens qui l’agenouillent de force devant les fusils.
Au revoir mes amis de l’azur, compagnons de la Marjolaine ! Les cloches de mon église ont sonné toutes seules. Je reviens sans que vous le sachiez et je l’ignore aussi ».
Pour Lire Maurice Chappaz (choix succinct)
Un Homme qui vivait couché sur un banc, [Revue Suisse romande], 1939. Castella, Albeuve, 1988.
Verdures de la Nuit, Mermod, Lausanne, 1945. Castella, Albeuve, 1988.
Testament du Haut Rhône, Rencontre, Lausanne, 1953 et 1966. Fata Morgana, 2003.
Portrait des Valaisans en légende et en vérité, L’Aire, 1983.
Les Maquereaux des cimes blanches, Galland, Vevey, 1976. Zoé, Genève, 1984, 1994.
Maurice Chappaz, pages choisies. L’Age d’Homme, Poche Suisse, 1988
Le Garçon qui croyait au paradis, L’Aire, 1995.
La Mort s’est posée comme un oiseau, Empreintes, Lausanne, 1993.
Evangile selon Judas. Gallimard, 2001.
Maurice Chappaz, par Christophe Carraud. Seghers, 2005.
Ce texte a paru dans la revue ProLitteris. -
Les fruits amers de la liberté

Le Nouveau film de Ken Loach: It's a free World
On se trouve, dans le dernier film de Ken Loach, sarcastiquement intitulé It's a free World, pris au piège de cette prétendue liberté dans une espèce de frénétique course du rat – plus exactement de la ratte, laquelle se débat comme une belle diablesse dans le cercle infernal du nouveau marché aux esclaves des migrants plus ou moins clandestins de l’Europe de l’Est et de partout qui débarquent en Angleterre. Angie après s’être fait virer d’une agence de recrutement pour ne s’être pas soumise à la règle machiste de ses supérieurs, se retrouve sur le carreau et lance alors, avec sa colocataire Rose, une agence indépendante de placement assortie d’une cafétéria. Malgré les mises en garde réitérées d’un de ses copains-collègues, Angie développe bel et bien un début de réseau sans se rendre compte qu’elle empiète sur le terrain de négriers sans scrupules beaucoup plus puissants qu’elle. Comme elle-même, toujours un peu « borderline » depuis qu’elle doit assumer la charge de son fils Jamie (le père de celui-ci a décroché depuis longtemps et passe son temps devant la télé) avec l’aide de ses parents dépassés par les événements, recourt à des procédés de plus en plus proches de l’illégalité, Angie va se trouver acculée à une situation dont elle se sortira de la façon la plus abjecte, dénonçant un groupe de clandestins au Service de l’immigration, pour caser à leur place une quarantaine d'autres malheureux qu’elle rançonne pour ainsi dire, avant que tout ne se retourne contre elle.
Si le scénario du film (primé à Venise) est solidement construit, qui nous confronte à une imbrication de situations aussi scandaleuses que réelles, avec de brusques aperçus de détresses personnelles insoutenables, It's a free World, dans sa violence amère, a quelque chose de frustrant pour d'aucuns dans la mesure où Ken Loach se contente, de manière frontale, de montrer les choses telles qu’elles sont, sans béquilles critiques ni trace d’évolution rassurante chez la protagoniste, puisque Angie, à la toute fin du film, se retrouve quasiment à la case départ, à recruter de nouveaux Ukrainiens à Kiev…
Ceux qui ont besoin d’une « morale » ou d'un espoir lui reprocheront ce parti pris, que je trouve pour ma part d’une honnêteté conséquente. Le portrait d’Angie, dont la rage de s’en sortir va de pair avec une espèce de santé sensuelle et sauvage, est remarquable (et magnifiquement servi par Kierston Wareing, tout à fait saisissante en sa beauté sexy et râpeuse à la fois, l’énergie véhémente et l’ambiguïté dérangeante de son personnage), autant que celui de Rose (Juliet Ellis, incarnant une femme plus lucide et sensible à la fois que son amie), et le rôle central de ces deux femmes ajoute à la critique implicite du film, signifiant en somme que cette liberté de merde est aussi merdique pour les uns que pour les autres dès lors qu’on obéit aux mêmes codes que ceux du système qui aboutit à ce merdier… A nous, en effet, de remplir les vides de ce film plein d’humanité mais qui se refuse aux faux-fuyants politiquement corrects ou aux conclusions lénifiantes…. -
Un chant arraché à la douleur
Dans son deuxième livre, Demeure le corps, Philippe Rahmy module un admirable «chant d’exécration».
L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005, couronné par le Prix des Charmettes. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou, sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».
Peu de livres, en si peu de mots, savent dire avec tant de violence et de douceur, de rage et de délicatesse, de précision nue et crue (où l’on hurle tantôt parce qu’on en chie, et tantôt se branle pour arracher un peu de lait de feu au roncier de son corps) et de lyrisme déchirant la totalité complexe de la souffrance physique et spirituelle, dont coule aussi de source cette sainte phrase où le martyr jamais doloriste se dit «porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe»…
Ce livre se donne le sous-titre de Chant d’exécration, mais c’est surtout un chant d’amour et de manque innocent que Demeure le corps, d’une «honnêteté absolue» et revendiquée pour telle, d’une écriture soumise à une tenue, modulée dans un style, un rythme et une musicalité sans faille.
 Philippe Rahmy, Demeure le corps. Editions Cheyne, 60p.
Philippe Rahmy, Demeure le corps. Editions Cheyne, 60p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 10 octobre 2007.
-
Fellini le mendigot
A propos de Roberto Begnini et du chien d’Umberto D. « L’huile d’olive n’est pas morte !», s’exclamait l’énerguménal Roberto Begnini après la disparition de Federico Fellini, et de fait il y avait de cette saveur ambrée, de cette fluidité d’essence féminine bonne pour la salade et de cette délicatesse odorante et raffinée par les années, chez Fellini (la personne au fin parler malicieux, plus que le personnages déjà presque trop fellinien), qu’on peut rapporter à l’huile d’olive ou au regard du silure ou au pelage du chaton ou à l’agate de l’œil de hibou dans la nuit romaine. J’aime ce délire généreux du populo italien qui se coule dans les films du Maestro en sottovoce, et je ne sais pourquoi cette prodigalité pauvre me rappelle le petit chien d’Umberto D. , bouleversant mendigot du vieil homme dont la misère est comme un clin d’œil à fleur de larmes, tel Fellini faisant la manche aux portes de l’Etat et des Riches qu’il roulait en ne cessant de se plaindre - au bord du fou rire…
JLK: le chien d'Umberto D.
-
Le sel des jours
Carnets de 2007 (extraits)
La vision la plus émouvante de ma journée est celle de ma bonne amie endormie, lorsque je viens la rejoindre tard le soir. J’y vois à la fois une petite fille et une vieille gisante, elle a tous les âges et figure la plénitude de ma vie, ni plus ni moins, dont je n’ose penser à ce qu'elle serait sans elle… Il y a des semaines et des mois que je suis au bord de m’attaquer à son portrait, mais je ne me sens pas encore tout à fait prêt : je sans qu’il faut encore que je me purifie avant de m’y mettre vraiment. (Janvier 2007)
 Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons».
Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons».
Rêvé cette nuit que c’était la guerre. L’horreur physique tenait au fait que nous avions à traverser des souterrains très étroits où nous risquions à tout moment de rester coincés, comme souvent dans ce genre de rêves qui doivent venir de loin, je présume: de l’angoisse physique du nouveau-né ?Après le moment de noir qui m’accable chaque matin, je reviens à la vie en buvant mon café à la fenêtre d’où je vois le monde émerger lui aussi du noir en beauté; et ce mot me sauve alors: ce mot de beauté.
Sa qualité de porosité fait de Shakespeare l’écrivain des écrivains, plus encore que Baudelaire qui a pourtant tout senti lui aussi. Mais à la porosité s’allie l’effort de transmutation sans lequel la porosité ne serait qu’une disposition spongieuse et passive. La poésie est un acte.
On voit de plus en plus de gens, au cinéma mais aussi chez les écrivains, comme dans les médias, penser en termes de « coups » en oubliant l’œuvre à faire qui se développerait dans la durée et selon sa propre cohérence. Il s’agit avant tout d’être remarqué et d’occuper le devant de la scène, en cherchant le sujet « porteur » qui s’inscrit dans le trend du moment.
 Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir».
Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir».«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un.» Or tel est le ton de ce livre, qui est d’amour mais souvent âpre, difficile, arraché à la complication des relations hommes-femmes comme Au nord du capitaine, roman précédent de l’auteur, disait la complication des relations nord-sud; et l’âge venant, c’est l’enfance aussi qui remonte et toutes les années passées auprès de cette mère qui y retombe, tout le doux et le triste de la vie, la guerre entre les parents, la paix jamais établie…
Ce qui compte c'est de situer ce bouquin, mec, donc de prendre conscience qu’ Ulysse de Joyce est un remake de L’Odyssée d’Homère (pas le film, le texte d’Homère), qu’il se rattache plus ou moins au mouvement du flux de conscience et se passe à Dublin. Ouais, mec, Ulysse ça se passe à Dublin, c’est vachement chiant, j’veux dire, mais à Dublin tu bois une bière super. Bon mais maintenant on parle de Finnegans’wake. T’sais mec, Butor a écrit que Finnegan’s wake c’était du whisky, je l’ai pas lu mais c’est vachement bien vu, j’veux dire c’est super comme jugement littéraire… (Lire à la façon de Pierre Bayard).
Si tu veux savoir ce que pense Monsieur, vise Madame, me disait je ne sais plus qui, et de même ai-je toujours été attentif, sans le laisser forcément paraître, aux réactions de ma bonne amie par rapport aux gens que nous approchions, qu’il s’agisse de mes anciens amis, de collègues ou de relations courantes, avec l’impression de disposer d’une espèce de radar décelant et fixant ce que moi-même j’avais décelé sans forcément le fixer, plus enclin qu’elle à me leurrer, en tout cas en ce qui concerne mes propres amis, car il m’est arrivée de montrer la même lucidité acérée à l’endroit des siens, que je supportais comme elle supportait les miens. Ce qui est sûr est que nos deux appareils de détection sont assez redoutables dans leur exercice combiné, et que les faiseurs, les truqueurs, les mesquins, les faux-culs n’ont pas trop de chance avec nous deux. Ainsi ne nous arrive-t-il plus jamais de nous égarer ou de nous attarder dans une compagnie de raseurs ou de frimeurs, très vite d’accord pour repérer la sortie de secours dès que l’ennui menace en tel ou tel lieu…
 Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.
Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.
Mais le temps passe, il nous crible, nous serons bientôt tous morts tandis que les livres continueront de témoigner de ce qui nous dépasse, et j’ai envie à l’instant de retrouver l’âme de Georges Haldas, ses petits matins, ses balades en Grèce, ses lectures de Cavafy ou de Saba, ses lectures de l’Evangile, ses coups de gueule, ses chroniques merveilleuses du père (Boulevard des Philosophes) et de la mère (Chronique de la rue Saint-Ours), nos rencontre Chez Saïd où nos engueulades parfois chez Dimitri – tout ce qui fait le sel de la vie, et tout ce qu’il a cristallisé dans ses livres sans pareils.
Un jour j’ai reçu de la part de Jacques Chessex, après que j’eus publié un grand papier élogieux sur Georges Haldas, une carte postale m’apostrophant pour me reprocher de dire du bien de ce «cuistre christique» écrivant comme un balai, et quelques années après le même Chessex célébrait Haldas à la remise du prix Rod. Petite foire aux vanités de la littérature, à laquelle survivent les livres. Lorsque nous étions amis, Jacques Chessex m’a dit un soir sa réelle affection pour Haldas, malgré leurs différends de toute sorte, de même que Chappaz m’a dit la sienne, qui avait rompuz avec Haldas depuis leur jeunesse. Le premier jour que nous nous sommes rencontrés à Genève, en 1973, Georges Haldas a dit au petit crevé que j’étais alors: «Méfiez-vous des écrivains, il y a un diable en chacun de nous».
A l’instant, le regard perdu sur les crêtes enneigées des montagnes qui de cela se foutent comme du dernier fossile, je ressens le besoin de dire ma reconnaissance à Georges Haldas, et de ce pas j’irai tout à l’heure faire l’acquisition des derniers livres qu’il ne m’a pas envoyés. (17 février 2007)Peinture JLK: Creste senesi, 2007, huile sur toile
-
Le mentir créateur

Cendrars à l’oral.
Est-ce quand il mentait le plus que Cendrars était le plus vrai ? Ce serait trop facile de l’affirmer, surtout en un temps de grand déballage où l’on se figure que le vrai se réduit aux « révélations » avérées par les faits. Si Sauser devint une légende poétique dès le choix de son pseudonyme, c’est tout au long de sa vie, en écho à l’épopée de son œuvre, qu’il n’a cessé de développer les enluminures de ses Riches Heures, jusque dans les journaux l’interrogeant ou les micros se tendant vers sa gueule de pirate.
Ainsi que l’explique Claude Leroy, éditeur des nouvelles Œuvres complètes (« Tout autour d’aujourd’hui » en 15 volumes, chez Denoël), c’est après la Deuxième Guerre mondiale que le personnage de Cendrars se hausse au niveau d’une véritable légende vivante, jouant son personnage jusqu’à se parodier lui-même. Du mitan des années 1920 où il voit l’avenir de l’homme blanc en Amérique du sud, au lancement du premier spoutnik où sa carcasse le torture méchamment, voici, après les fameux entretiens avec Michel Manoll, une trentaine d’interviews ou de portraits plus ou moins fouillés, dont quelques vrais bijoux signés Parinaud, Labro (son premier papier !) ou Lapouge, notamment. Presque que du mentir vrai !
Rencontres avec Blaise Cendrars (1925-1959), textes établis par Claude Leroy. Editions Non Lieu, 302p. -
Beauvoir l’éclaireuse

ANNIVERSAIRE Simone de Beauvoir aurait eu cent ans aujourd’hui.
Le nom de Simone de Beauvoir, plus de vingt ans après sa mort (en 1986) reste l’un des plus connus, voire des plus adulés de la scène intellectuelle et littéraire française du XXe siècle. Plus qu’aucune femme écrivain de l’époque, le Castor (ainsi surnommée par un condisciple jouant sur le nom anglais de Beaver) fit figure, aux côtés de Jean-Paul Sartre, de véritable « icône », selon l’expression au goût du jour. De la bohème de Saint Germain-des-Prés aux manifestations de mai 68, en passant par la guerre d’Algérie et les luttes pour la dépénalisation de l’avortement, l’ancienne prof de philo fut concrètement engagée, par ses écrits et dans la rue, avec une intensité jamais démentie. Ainsi que l’explique Danièle Sallenave au début de la monumentale déconstruction critique qu’elle vient de publier sous le titre de Castor de guerre, « l’œuvre entière de Simone de Beauvoir, romans compris, porte ce sceau guerrier, jusque dans son style, la coupe de ses phrases, leur rythme, jusque dans la présence d’une voix qui ne laisse jamais le lecteur en repos ».
L’activisme politique de Simone de Beauvoir, ses voyages autour du monde, la caution qu’elle donne (avec Sartre) par sa présence et ses écrits aux causes révolutionnaires qu’elle estime justes et bonnes, face aux puissances de l’oppression et de l’injustice, de Cuba à la Chine de Mao, lui ont attiré les critiques les plus virulentes, parfois justifiées. Dans La lune et le caudillo, ainsi, Jeannine Verdès-Leroux a stigmatisé la complaisance aveugle du couple français, littéralement ébloui par Castro. De la même façon, l’obsession anti-bourgeoise de ces grands esprits fascinés par le « réel » et le peuple, leur haine anti-capitaliste et leur vindicte anti-américaine les auront-elles poussés à prendre des positions proches de celles des « idiots utiles » cher à Lénine. Du moins seront-ils restés conséquents (Sartre refusera le Nobel après avoir manifesté sa solidarité au terroriste Andreas Baader) et l’évolution de Simone de Beauvoir en imposera par l’approfondissement de son regard sur le « phénomène humain » qu’elle scrute à l’observation nette et honnête de sa propre vie.
Or il ne faut pas oublier l’œuvre. L’estime et la reconnaissance qu’elle suscite toujours découlent surtout du Deuxième sexe, ouvrage fondateur du féminisme publié en 1949, qui s’arracha à plus de vingt mille exemplaires dès la première semaine, fut traduit en plus de trente langues et valut à l’auteur la mise à l’index du Vatican. Pour rappeler le « ton » de l’époque, on peut relever que François Mauriac écrivit à l’un des collaborateurs des Temps modernes : « J’ai tout appris sur le vagin de votre patronne »... De la droite conservatrice à la gauche stalinienne, le livre déchaîna les passions. Cet ancrage dans l’atmosphère politiquement très polarisée des années doit être rappelé pour mieux évaluer la détermination frondeuse de la brillante agrégée en rupture de conformité, qui s’affirme dès L’Invitée, premier roman à la touche très personnelle paru en 1943. Avec Les mandarins (prix Goncourt 1956), autre roman qui pose la question de l’engagement et de ses pièges, et Les mémoire d’une fille rangée (1958) rapidement hissé au rang de best-seller, Simone de Beauvoir donne ses meilleurs livres avant la trilogie de ses mémoires dont Une mort trop douce, évoquant la fin de sa mère avec une remarquable noblesse.
C’est à la genèse et au développement de ces mémoires que Danièle Sallenave s’attache dans Castor de guerre en « dialoguant » sans discontinuer avec son impérieuse aînée, quitte à poursuivre la « dispute » pied à pied. Il en ressort, comme à la lecture de La cérémonie des adieux ou de la correspondance extrêmement vivante, parfois aussi captivante et drôle (le cynisme en plus) que celle de George Sand, du Castor avec Nelson Algren ou Claude Lanzmann (deux passions durables de l’amoureuse), un portrait nuancé qui rompt avec la figure caricaturale de la cheftaine à souliers plats ou de la patronnesse à chignon serré : une intellectuelle en guerre à la lucidité tranchante, mais également une femme orgueilleuse non moins qu’attachante - un écrivain qui gagne à être parcouru dans ses marges où la liberté se nuance d’humour et de spontanéité sans rides…
Danièle Sallenave. Castor de Guerre, Gallimard,601p.
Jacques Deguy et Sylvie Le Bon de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ecrire la liberté. Découvertes Gallimard, 126p.
Simone de Beauvoir, une femme entière. France 5, le 10 janvier, à 20h. 40, et sur Arte à 22h.35
La donneuse de leçons s’efface devant l’écrivain Qu’aurait pensé Simone de Beauvoir, en sa centième année, de la très large diffusion, advenue ces jours, d’une image intime la représentant toute nue, croquée de dos par un compère photographe de son amant américain Nelson Algren ? Se serait-elle réjouie de ce dernier pied de nez au conformisme de la bourgeoisie catholique dont elle était issue ? Y aurait-elle vu l’expression de sa liberté de mœurs ou se serait-elle indignée de ce que soit ainsi exploitée l’image de son corps ? Poser la question revient à s’interroger sur le culte voué à l’ « icône » du couple qu’elle formait avec Jean-Paul Sartre : deux grands intellectuels briseurs de tabous réduits eux-mêmes à un cliché pour touristes ou étudiants japonais. Or que magnifie ce cliché ? La bohème de Saint Germain-des-Prés ? L’emblème de deux esprits libres aux positions éthiques et politiques exemplaires ? Ou les deux derniers maîtres à penser d’une époque désormais sans « figures » ? Symboles bien discutables à vrai dire, tant le meilleur et le pire cohabitent dans l’« enseignement » de Sartre et du Castor.
Qu’aurait pensé Simone de Beauvoir, en sa centième année, de la très large diffusion, advenue ces jours, d’une image intime la représentant toute nue, croquée de dos par un compère photographe de son amant américain Nelson Algren ? Se serait-elle réjouie de ce dernier pied de nez au conformisme de la bourgeoisie catholique dont elle était issue ? Y aurait-elle vu l’expression de sa liberté de mœurs ou se serait-elle indignée de ce que soit ainsi exploitée l’image de son corps ? Poser la question revient à s’interroger sur le culte voué à l’ « icône » du couple qu’elle formait avec Jean-Paul Sartre : deux grands intellectuels briseurs de tabous réduits eux-mêmes à un cliché pour touristes ou étudiants japonais. Or que magnifie ce cliché ? La bohème de Saint Germain-des-Prés ? L’emblème de deux esprits libres aux positions éthiques et politiques exemplaires ? Ou les deux derniers maîtres à penser d’une époque désormais sans « figures » ? Symboles bien discutables à vrai dire, tant le meilleur et le pire cohabitent dans l’« enseignement » de Sartre et du Castor.Professeurs de liberté ? Mais quel usage en firent-ils en fermant les yeux sur les sinistres prisons de la dictature cubaine ou en célébrant la sanglante révolution culturelle maoïste ? « L’avenir m’a donné raison », ose écrire Simone de Beauvoir dans La Force des choses. Hélas pour elle, les victimes de « l’avenir » ont témoigné depuis lors, entre autres historiens non partisans. Pourtant l’admiratrice de BB (dont elle défendit la figure de femme libre…) n’est pas à jeter avec l’eau des bains de sang : reste l’œuvre. Un auteur qui écrivait « avec un fer à repasser », comme le prétendait Nathalie Sarraute ? Pas seulement : une femme heureusement contradictoire, une amoureuse à tempêtes, une fille à sa maman capable d’émotion devant Une mort trop douce, une vieille camarade touchante à la Cérémonie des adieux, une épistolière à la George Sand, une bête littéraire que nous osons préférer à la donneuse de leçons…
Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 9 janvier 2008. -
Le regard de la chouette
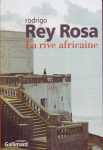
Un sentiment étrange, mêlé de curiosité froide et de satisfaction esthétique, non exempte de cynisme, se dégage de ce roman qui rappelle, par son climat et plus encore par le regard que jette l’auteur sur ces drôles d’animaux que sont nos semblables et leurs cultures variées, le climat et le regard des nouvelles les plus incisives de Paul Bowles. Nul hasard en cela, puisque Rodrigo Rey Rosa (né à Ciudad de Guatemala en 1958) fut disciple et ami du grand écrivain de Tanger, qui l’accueillit dans ses ateliers d’écriture et traduisit plusieurs de ses romans en anglais.
Autant dire que l’élève est plus qu’un épigone : un maître à son tour, jouant ici sur la « rencontre » de deux jeunes types - un berger fruste et un quidam colombien en rupture de conformité – qui ne se verront pas mais que réunit l’attrait, pour des raisons opposées, d’un oiseau capturé. Entre nature sauvage et civilisation faisandée, Maroc de l’arrière-pays aux superstitions encore vivaces et Tanger aux voyageurs « borderline », le roman met en rapport révélateur (comme dans les nouvelles mémorables du Scorpion de Bowles) deux mondes en train de se perdre dans un jeu de mimétisme et de fuite en avant. L’auteur ne « juge » pas pour autant, comme s’il avait lui-même arraché les yeux de la chouette pour « voir la nuit »...
Rodrigo Rey Rosa La rive africaine, traduit de l’espagnol (Guatemala) par Claude Nathalie Thomas. Gallimard, coll. Du monde entier, 176p. -
E la nave torna…


Fellini en grande traversée
C’est une légende incarnée que Federico Fellini en sa féerie freudo-clownesque, c’est la rouerie géniale et l’art artisan dans toutes les manifestations de son cinéma, c’est le cas de dire, qui touchait à la vie vivante autant qu’à sa transmutation multiforme, jetant mille éclats sur fond de vieille tendresse humaine et de malice populaire, de vitalité bondissante et de mélancolie. A-t-on d’ailleurs envie que la légende perde de son merveilleux ou de sa cocasserie au nom de la vérité des faits ? Un premier test est à faire avec la naissance du Maestro, qu’un journaliste fit naître dans un train, en voiture de première classe, une nuit de janvier 1920, tout près de Rimini. Or Fellini se garde de démentir. Se non è vero… Mais voici que nous apprenons la vérité: que les cheminots de la côte romagnole étaient alors en grève et que nul train ne put servir de salle d’accouchement roulante cette nuit-là…
 Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.
Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.
 Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.
Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.
J’allais reprendre le roman de Bob Dylan par François Bon, injustement laissé de côté depuis quelque temps, lorsque cet autre roman d’une vie et d’une œuvre (l’une et l’autre entremêlées intimement à tout instant, car le travail artistique était la substance même de la vie de Fellini) m’est tombé dans les mains pour y rester scotché, avec ses histoires pleines des nôtres, entre Giulietta et la Gradisca, la mère et les compères vitelloni…
Critique lui-même et dessinateur, scénariste et écrivain puis réalisateur, considérant la fabrications d'un film comme l’équipée d’un capitaine entraînant un équipage décidé à marcher en sens contraire… poète en mouvement incessant et formidablement attentif au moindre détail de ses réalisations (autant que son ami Pasolini, dont il freina la moindre les débuts, ou que Visconti dont on découvre ici les détails de la brouille et de la réconciliation), qui était essentiellement Fellini en tant qu’artiste? Un pittore ! Un peintre, répondait-il lui-même. Un peintre de notre temps aussi peu réaliste qu’abstrait, un peintre sur bulles de celluloïd qui eût aimé « fixer » un seul tableau, mais quoi, fermons les yeux tout en lisant : le tableau demeure…
Tullio Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.
Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

 Marius Daniel Popescu
Marius Daniel Popescu



