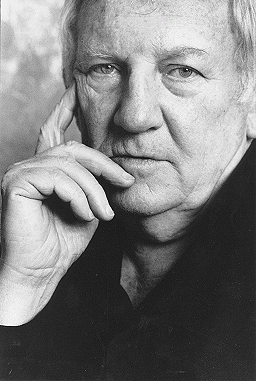Le plus grand auteur belge d’expression néerlandophone est mort à Anvers à l’âge de 78 ans.
C’est un des plus grands écrivains européens, à la fois romancier et dramaturge, nouvelliste et poète, doublé d’un créateur polymorphe (peintre et cinéaste) qui vient de disparaître en la personne de Hugo Claus. Il y a quelques années avait paru, dans un de ses derniers recueils, une nouvelle saisissante intitulée Une somnambulation, évoquant le « cancer verbal » vécu par le protagoniste atteint de la maladie d’Alzheimer, dont Claus souffrait lui-même et avait finalement demandé d’être délivré par euthanasie, conformément à la loi belge. En automne dernier, il n’en avait pas moins signé, avec 400 autres personnalités flamandes, une pétition s’opposant à la partition de la Belgique. Considéré comme le plus grand romancier, poète et dramaturge belge néerlandophone, Hugo Claus avait atteint une notoriété internationale avec Le Chagrin des Belges, éducation sentimentale et fresque historique à la fois ravageuse et lyrique d’une sombre période (1939-1947), traduite en français en 1985 et adaptée au cinéma par Claude Goretta. Le romancier y stigmatisait un tabou de l’histoire de la Belgique lié à la collaboration flamande et « rexiste », notamment. Eternel rebelle, distribuant volontiers ses propres tracts-poèmes dans la rue, Claus s’inscrivait dans la longue tradition frondeuse qui va de Till l’espiègle (Till Ulenspiegel en flamand) aux grotesques d’Ensor ou au cinéma belge actuel, lui-même ayant signé deux longs métrages (dont Sacrement) et de nombreux scénarios, alors que son théâtre compte plus de quarante pièces, publiées à Lausanne, aux éditions L’Age d’Homme, avec l’ensemble de sa poésie. De celle-ci, le grand critique Gaëtan Picon avait écrit qu’elle « brûle d’un feu trop vif pour prêter son incandescence au métal d’une autre langue ».
Né à Coutrai, près de Bruges, en 1929, dans la filiation d’une grande tribu flamande, Hugo Claus était de ces créateurs hors norme plus faits au feu de la vie qu’au lustre des académies, qui avait participé aux aventures avant-gardistes, surtout en matière picturale, dans la mouvance du groupe Cobra, ainsi qu’en témoigne l’ouvrage intitulé Hugo Claus imagier. Non sans coquetterie, Claus nous disait un jour qu’il était un grand peintre méconnu écrivant à ses heures…
A notre goût, l’expressionnisme de ses romans et de ses nouvelles sonde cependant plus profond que son univers plastique, dans le tréfonds des détresses et des délires non alignés, avec de mémorables merveilles relevant de la littérature universelle. Dès A propos de Dédé (1969), le ton acide et suavement tchékhovien était donné, relancé par Une douce destruction (1988), plus radical que le présumé chef-d’œuvre du Chagrin des Belges. Or la pleine mesure du génie de Claus serait ensuite marquée par L’Espadon (1989), L’empereur noir (1993), exaltant le regard terrible de l’enfant sur notre drôle de monde, et plus encore La Rumeur (1997), peut-être le sommet de l’œuvre narrative, qui fait revivre une communauté déglinguée style Deschiens en Flandre profonde, ou enfin Le dernier lit (1997), autant de livres constituent les moments mémorables de cette oeuvre, du côté de William Faulkner ou de Flannery O’Connor. Charnel et mystique, fraternel et révolté, sensuel et glacial, Hugo Claus, délivré de la maladie, survit dans ses livres.
Cet hommage a paru dans l'édition de 24 Heures du 20 mars 2008.