
À La Désirade, ce lundi 18 mai. – Très belle journée de mai, dont je profite pour scier du bois. En outre repris mon roman, que j’avancerai plus vigoureusement quand j’aurai bouclé ma nouvelle séquence de Mémoire vive.
°°°
Faut-il couper court à toute référence littéraire ou culturelle, genre « suivez mon regard », ou plutôt jouer avec, ou s’en foutre ?
Avant on s’extasiait dans les salons : « Ah, cet Elstir ! Oh, ce Bergotte ! ».
Et maintenant c’est sur Internet qu’on se pâme de concert : « Ah, ce Levinas ! Oh, cette Hannah Arendt ! ». Chacune et chacun se sentant plus ou moins, comme chez Madame Verdurin, de la « vieille équipe ». Mais les youngsters ne sont pas en reste : « Eh ça, Anna Todd, c grave kiffant ! », ou selon sa tribu : « Chauffe les djembés, Bisso Na Bisso », etc.
Ce mercredi 20 mai. – Mon roman commence, après son troisième chapitre et passée la page 100, à prendre forme, mais je ne vais pas forcer la cadence. J’aimerais continuer à y travailler très régulièrement. Il constituera ma tâche première du mois prochain, mais je tiens à ne pas m’emballer, visant un ouvrage bien senti et construit, cristallisant toute mes observations et réflexions actuelles, vingt ans après Le viol de l’ange.
°°°
Très intéressé par la lecture de La stratégie du chaos, basé sur une série d’entretiens avec l’historien ethiopien Mohammed Hassan, recueillis par Michel Collon et Grégoire Lalieu. S'y expose, pays par pays et avec une rare capacité de synthèse, un siècle et demi de colonialisme anglais, puis américain, avec l’accent porté sur les menées particulières propres à tout empire sur le déclin. C’est parce que les States se sentent perdre du terrain qu’ils deviennent de plus en plus soumis à leur hybris impérial, ou, plus précisément ; de plus en plus dangereux dans leur façon de semer le chaos pour garder leur pouvoir.
°°°
 En reprenant la lecture de Femmes, de Philippe Sollers, je me dis que tout ce brillant sonne souvent creux, et que ce défilé de prénoms féminins reste sans chair, sinon sans traits de vrais personnages romanesques. C’est le bottin demi-mondain des conquêtes du narrateur, assez mal individualisé par rapport à l’auteur (une espèce de double américain pas vraiment crédible), et le tableau d’époque relève de la même projection narcissique, dont les illustres figures (de Lacan à Barthes, en passant par Althusser) n’existent guère non plus en ronde-bosse.
En reprenant la lecture de Femmes, de Philippe Sollers, je me dis que tout ce brillant sonne souvent creux, et que ce défilé de prénoms féminins reste sans chair, sinon sans traits de vrais personnages romanesques. C’est le bottin demi-mondain des conquêtes du narrateur, assez mal individualisé par rapport à l’auteur (une espèce de double américain pas vraiment crédible), et le tableau d’époque relève de la même projection narcissique, dont les illustres figures (de Lacan à Barthes, en passant par Althusser) n’existent guère non plus en ronde-bosse.
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’il ne se dégage aucune espèce d’émotion réelle de cette chronique où le souci trop visible de la performance, de l’exposition et du plaidoyer pro domo, fondent un livre plutôt délayé et fuyant, très intéressant par fragments, comme le seront tous les romans suivants de l’auteur, mais relevant finalement du journal extime plus que de la fiction romanesque. Bien entendu, Sollers a déjà prévu toutes les réponses à toutes les objections, à jamais au-dessus de « tout ça ».
« Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort », ai-je lu quelque part, et c’est en somme cela qui manque terriblement à Philippe Sollers : de savoir, parfois, reconnaître sa faiblesse, sans s’en faire une vertu de plus…
 Au Cap d’Agde, Cité du soleil, ce mardi 26 mai. - Partis ce matin de La Désirade vers 11 heures, nous avons dévalé la vallée du Rhône sans trop de stress en dépit de l’allant furieux des poids lourds. Après une nouvelle peu concluante de Timothy Findley, j’ai commencé de nous lire Perfidia, le nouveau pavé de James Ellroy, pas vraiment passionnant non plus. Ensuite grappillé dans un recueil d’essais de Philippe Muray et le dernier opus posthume de Calet évoquant les quartiers de roture parisiens...
Au Cap d’Agde, Cité du soleil, ce mardi 26 mai. - Partis ce matin de La Désirade vers 11 heures, nous avons dévalé la vallée du Rhône sans trop de stress en dépit de l’allant furieux des poids lourds. Après une nouvelle peu concluante de Timothy Findley, j’ai commencé de nous lire Perfidia, le nouveau pavé de James Ellroy, pas vraiment passionnant non plus. Ensuite grappillé dans un recueil d’essais de Philippe Muray et le dernier opus posthume de Calet évoquant les quartiers de roture parisiens...
°°°
Arrivés à la Cité du soleil chère à Michel Houellebecq, nous avons retrouvé la mer et le ciel avec le bonheur de chaque fois. Faute de draps disponibles dans le studio, mal nettoyé de surcroît, que nous avons réservé, l’Agence Oltra nous a proposé de passer notre première nuit dans une chambre glamour de l’étage supérieur. Tout à fait notre genre : avec sa déco mauve/violette et son lustre de verroterie noire, ses posters de seins et de culs léchés, ses miroirs au plafond, ses tabourets de bar haut perchés - et point de table pour écrire évidemment. Je n’ai pas manqué de faire un chromo numérique de ma bonne amie dans ce cadre de rêve; et la nuit venue, nous nous sommes pointés au Ghymnos pour la pizza inaugurale traditionnelle, salués par les sourires de bienvenue du personnel nous reconnaissant d'année en année.
Cité du soleil, ce mercredi 27 mai. – Le soleil déjà haut ce matin quand nous nous sommes éveillés. Capté quelques images encore de notre studio glamour. Ensuite grand crème à la terrasse jouxtant le terrain de pétanque et bonne tchatche avec un gars du cru, la cinquantaine bronzée, beau mec faisant preuve de cette intelligence pratique que je préfère souvent aux débats pseudo-intellectuels.
Le type fait dans l’entretien des piscines. L’écoulement de celles-ci est de plus en plus souvent bouché par des capotes et autres strings.Se rappelle les « belles années » de cap d’Agde, où tout était plus naturel et joyeux, moins vulgaire surtout qu’avec les prétendus libertins et leur micmac sur la plage, du côté de ce qu’on appelle la baie des cochons : cent mètres de sable sur lesquels mille truies et verrats humains s’agglutinent et se branlent et s’enfilent et se matent tandis que les naturistes purs et doux, sinon pudibonds, passent tout tranquillement, l’air de rien, sur la bande de sable de deux mètres de large laissée libre au bord de l’eau, en recommandant aux enfants de regarder plutôt vers le large.
Cependant les néo-libertins « ramènent du pognon », et la Municipalité rampe. En principe, un seul acte sexuel commis sur la plage est légalement passible d’une amende de 6000 euros. La Municipalité pourrait se faire de la thune en faisant respecter la Loi, comme certaines années passées avec deux ou trois gendarmes à cheval, qui ont pourtant vite renoncé à cette pauvre traque. Car l’immobilier et le tourisme du cul ont leur propre loi, et la Municipalité rampe.
Dans la foulée, en nous baladant dans le centre commercial, nous constatons que trois anciennes boutiques de fringues sexy ont été remplacées par trois nouvelles boutiques de fringues sexy. Ce qu'on appelle le progrès...
 À part quoi la mer et le ciel nous comblent, à notre balcon sur les dunes que nous retrouvons depuis plus de trente ans, naguère avec les enfants et moins d’exhibos, mais toujours tonifiés par la large vision jusqu’à Sète et le bien nommé Mont Clair…
À part quoi la mer et le ciel nous comblent, à notre balcon sur les dunes que nous retrouvons depuis plus de trente ans, naguère avec les enfants et moins d’exhibos, mais toujours tonifiés par la large vision jusqu’à Sète et le bien nommé Mont Clair…
°°°
J’ai commencé, hier soir, de lire un petit recueil de deux nouvelles de John Cheever, qui m’ont aussitôt enchanté. Finesse et vitesse : voilà ce qui m’a tout de suite scotché.
 La première, Adieu mon frère, évoquant une réunion de famille plombée par la morosité puritaine d’un des frères, est d’une acuité d’observation et d’une justesse, dans la modulation des sentiments doux-acides, qui m’a rappelé les nouvelles d’Alice Munro, même si le ton et le style de Cheever sont tout à fait à lui.
La première, Adieu mon frère, évoquant une réunion de famille plombée par la morosité puritaine d’un des frères, est d’une acuité d’observation et d’une justesse, dans la modulation des sentiments doux-acides, qui m’a rappelé les nouvelles d’Alice Munro, même si le ton et le style de Cheever sont tout à fait à lui.
Curieusement, j’aurai passé quasiment à côté de cet auteur jusque-là. De fait, j’avais commencé de lire un de ses romans il y a des années de ça, mais sans aller jusqu’au bout, je ne me rappelle pas pourquoi. Peut-être n’était-ce pas encore le moment ? Alors que, dès les premières pages de la première de ces deux nouvelles, ma plus vive attention a été requise, comme lorsque, après son Nobel, J’ai entrepris de lire toutes les nouvelles de Munro.
Comme Alice Munro, précisément, John Cheever a été comparé à Tchékhov pour son mélange d’humour tendre et de mélancolie douce-amère. Carver y a eu droit lui aussi, et d’autres sans doute. Mais encore ? Il y a du vrai, mais il faudra préciser en quoi. Ce qui est sûr, c’est que je ne vois pas un nouvelliste de langue française (ni le regretté Daniel Boulanger, ni Annie Saumont, parmi les meilleurs) capable de fixer, en quelques pages, une situation, une atmosphère et une frise de personnages, puis de nouer et dénouer un drame à caractère universel, comme il en va des meilleurs récits de Tchékhov mais aussi de Flannery O’Connor, de Paul Bowles, de Scott Fitzgerald ou de l’Irlandais William Trevor, notamment. Or Cheever s’inscrit bel et bien dans ce club-là. Reste à détailler ses qualités propres.
Adieu, mon frère, ainsi, brocarde la méchanceté d’un vertueux avec une finesse d’observation sans faille, où la scène finale, d’une violence inattendue, se justifie a proportion de la monstruosité du puritain jugeant sa mère et les siens avec un manque de cœur absolu. Or Cheever est à la fois un peintre des sentiments et des lieux (la maison sur la falaise est immédiatement présente, qui évoque les tableaux de Hopper), un scénariste virtuose dans l’ellipse dramatique et un moraliste conséquent qui a l’air de se demander si c’est « ainsi que les hommes vivent »…
Mêmes qualités dans Une Américaine instruite, qui brosse le portrait d’un autre monstre significatif, dans le genre femme hyper-lettrée et militante tous azimuts, insupportablement cultivée (elle écrit un livre sur Flaubert) et soumettant son conjoint à une domination tissée de morgue et de mépris, non sans passer à côté de la simple vie et des demandes de son enfant, dont la mort va bousculer son planning.
 S’il y a du Tchékhov là-dedans, c’est du plus indigné devant l’imbécillité des gens peut-être très intelligents mais sans cœur (on se rappelle L’envie de dormir ou Volodia), et par la façon de John Cheever, comme son aîné russe, de ne jamais s’en tenir à une seule version ou un seul jugement à l’observation de la vie où chacun, d’une façon ou de l’autre, porte une certaine responsabilité. Enfin il y a l’art du narrateur, sans pareil. On comprend que Nabokov, Bellow et Updike aient placé John Cheever au top des écrivains américains de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Flannery O’Connor et Alice Munro, c’est en effet sa place…
S’il y a du Tchékhov là-dedans, c’est du plus indigné devant l’imbécillité des gens peut-être très intelligents mais sans cœur (on se rappelle L’envie de dormir ou Volodia), et par la façon de John Cheever, comme son aîné russe, de ne jamais s’en tenir à une seule version ou un seul jugement à l’observation de la vie où chacun, d’une façon ou de l’autre, porte une certaine responsabilité. Enfin il y a l’art du narrateur, sans pareil. On comprend que Nabokov, Bellow et Updike aient placé John Cheever au top des écrivains américains de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Flannery O’Connor et Alice Munro, c’est en effet sa place…
°°°
Très intéressé par Le Parapluie de Simon Leys de Pierre Boncenne, où l’ancien rédacteur en chef de Lire rend le plus bel hommage à la mémoire de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, mort en août 2014 et dont l’œuvre de sinologue et d’essayiste-pamphlétaire n’a pas encore été reconnue à sa juste valeur.
Or Pierre Boncenne a entretenu, pendant des années, une correspondance amicale qui paraît en même temps que son essai, sous le titre de Quand vous viendrez me voir aux Antipodes, et c’est donc en complicité, mais sans complaisance, qu’il revient sur la trajectoire de cette grande figure de l’intelligentsia contemporaine que je ne me lasse pas, pour ma part, de lire et relire depuis des années.
La première partie de l’essai fait une large part, évidemment, au plus fameux des livres de Simon Leys, Les Habits neufs du Président Mao, tant pour le rappel de son contenu, des circonstances de sa publication et de l’accueil souvent peu glorieux qui lui fut réservé par le milieu intellectuel, médiatique et universitaire parisien, où certains thuriféraires du maoïsme, notamment dans Le Monde, le firent passer pour un agent d’influence de la CIA, entre autres énormités.
°°°
Achevé cette nuit, vers 1 heure du matin, le visionnement de la 2esaison de la série américaine House of cards. À la fois de la grosse machine à la gloire des States, jusque dans l’étude des (très) mauvaises mœurs des deux protagonistes, aussi odieux qu’attachants à certains égards, du feuilleton haut de gamme très formaté, et, tout de même, un certain aperçu des mécanismes du pouvoir entre la Capitole et la Maison-Blanche, sans oublier les interprètes de tout premier plan réunis par le casting, Kevin Spacey et Robin Wright en tête.
Comme la chose est terriblement addictive, je ne suis pas fâché d’en avoir fini, mais j’en ai tiré, je crois, quelque chose, autant sur une certaine façon de se flatter en se dénigrant (on est bien en deça du procès de l’Empire par Oliver Stone) que par l’aperçu des coulisses du Pouvoir aux figures plus ou moins machiavéliques...
°°°
En lisant les nouvelles de L’Homme de ses rêves, de John Cheever, je me dis qu’il y a là-dedans quelque chose qui procède de la même réalité décalée que j’essaie de rendre dans mon roman, où l’élément poétique substitue une réalité plus réelle à ce qu’on croit la réalité la plus crédible. Comment dire ? C’est cela qu’il faut dire, justement, sans trop savoir comment, par le truchement d’une sorte de langue-dans-la-langue qui en dise plus que la seule langue.
Au Cap d’Agde, ce lundi 1er juin. – D’une escapade à Montpellier,dont le but était (pour moi) l’achat du plus possible de livres de John Cheever, nous sommes revenus avec une dizaine de nouveaux bouquins et de DVD. Durant les trajets d’aller et de retour, je nous ai lu deux nouvelles du recueil L’homme de sa vie, que j’ai téléchargé sur mon iPad, et j’ai trouvé deux autres recueils de Cheever chez Sauramps, à savoir Déjeuner de famille et Le ver dans la pomme, ce qui porte à une cinquantaine de nouvelles ce premier aperçu d’un auteur dont je me sens aussi proche que d’Alice Munro ou de Tchékhov.
°°°
Regardé ce soir le supplément au film Tom à la ferme consacré à un entretien avec Xavier Dolan, interprète admirable et réalisateur de ce thriller psychologique justement situé dans la filiation de Hitchcock, dont les quelques faiblesses du scénario (notamment en ce qui concerne le dénouement) sont palliées par une tension rythmique formidable à tous égards, image et story confondues.
J’avais entendu parler de Mummy, du même Dolan, présenté à Cannes au printemps de l’an dernier, mais je ne m’attendais pas à un tel talent de cinéaste (et d’acteur) et à une telle force, presque faulknérienne, dans la modulation d’un thème – l’homophobie - dégagé ici de tout traitement complaisant.
Ce qui est plus précisément intéressant, en l’occurrence, c’est que les trois protagonistes sont littéralement tenaillés par des sentiments-sensations confus et contradictoires. Tom, qui débarque dans la ferme de l’arrière-pays où l’on s’apprête à enterrer son amant, est immédiatement nié comme tel en dépit de l’évidence, après que le frère aîné a inventé une girl friend à son frère pour rassurer la mère. Celle-ci en veut à mort à celle-là de n’être pas venue, tout en sachant au fond de quoi il retourne, mais le déni du frère aîné va se transformer en relation sado-masochiste avec Tom qui découvre, à la ferme, une vie plus « réelle » que ce qu’il connaissait jusque-là.
Bref, l’imbroglio est très incarné et vraisemblable, le scénario fléchit un peu en bout de course mais la chose reste percutante et rend bien compte de la complexité de nos rapports avec « tout ça »…
°°°
La lecture des nouvelles de John Cheever m’enchante bonnement, et en crescendo, au fur età mesure que, les années passant, elles deviennent plus élaborées et plusriches de substance, plus imprégnées de poésie. J’ai achevé aujourd’hui L’Homme de ses rêves, regroupant des nouvelles des années 30, marquées par la Dépression. Quant à la comparaison de Cheever avec Tchékhov, elle se justifie en effet en ce qui concerne le regard de l’écrivain sur les gens ordinaires, avec un mélange équivalent de tendresse et d’humour.
Des années de crise sur la côte Est, avec lesnouvelles de John Cheever, j’ai passé à la même période évoquée dans les campagnes reculées des Appalaches, par le recueil Incandescences de Ron Rash, dont la première est d’une âpreté et d’une violence faulknériennes.
°°°
Le jeu des interférences entre divers modes de communication ou autres vecteurs d’expression, du livre au blog ou de la série télévisée aux échanges sur Facebook, entre autres, est légitime en cela qu’il investit de nouveaux comportements et autres arborescences mentales, mais il nefaut pas en abuser. Pour ce qui concerne mon roman en chantier, comme il en estallé du Viol de l’ange, initialement conçu comme un « roman virtuel », j’intègre à ma façon cette nouvelle donne en restant le plus attentif à la découpe de mon écriture.
°°°
Une fois de plus je constate que je dois me fier à mon subconscient pour ce qui touche à l’écriture romanesque, comme ce fut le cas pour Le Viol de l’ange. Quelque chose doit sortir, c’est évident, et le mieux est de se fier à ce flux qui se constitue en images puis en phrases parfois complètes, dès l’éveil matinal.
°°°
Ma bonne amie a lavé aujourd’hui sa troisième aquarelle, dont elle a vite saisi la technique particulière. Ce n’est pas encore tout à fait ça, mais je me la coince tout en poursuivant de mon côté l’exercice quotidien de la chose, dans ces carnets avec, parfois, un début de réussite...
°°°
Je suis de plus en plus intéressé et plusencore : touché par la lecture des nouvelles de John Cheever, dont je lis ces jours le recueil intitulé Le ver dans le fruit. À part Tchékhov et Alice Munro, je ne connais aucun auteur de nouvelles dont je me sente aussiproche. Cela tient à sa profonde intelligence de la condition humaine, à une douce folie qui traverse ses récits les plus sages d’apparence, autant qu’au lyrisme mélancolique de son art et à son sens profond des réalités sociales. Il y a chez lui un mélange très rare d’extrême sensibilité, de grande lucidité en matière de société et de typologie humaine, ainsi qu’un humour plus vif encore que chez Munro, qui tire des effets comiques de situations souvent délicates,voire tragiques.
 Cap d’Agde, ce lundi 8 juin. – La chaleur se faisant un peu lourde, je ne serai pas fâché, demain, de remonter sur nos hauteurs. Ce qu’attendant je suis allé me balader seul, en fin de matinée, dans la ville haute de Sète écrasée de soleil, au cimetière marin où j’ai salué MM. Paul Valéry et Jean Vilar, en passant par les librairies et une petite escale sur la place où je me suis payé une marmite de moules frites arrosée d’un quart de rouge, tout en lisant quelques pages des Mauvaises pensées de Valéry que j’ai trouvées l’autre jour à Pézenas.
Cap d’Agde, ce lundi 8 juin. – La chaleur se faisant un peu lourde, je ne serai pas fâché, demain, de remonter sur nos hauteurs. Ce qu’attendant je suis allé me balader seul, en fin de matinée, dans la ville haute de Sète écrasée de soleil, au cimetière marin où j’ai salué MM. Paul Valéry et Jean Vilar, en passant par les librairies et une petite escale sur la place où je me suis payé une marmite de moules frites arrosée d’un quart de rouge, tout en lisant quelques pages des Mauvaises pensées de Valéry que j’ai trouvées l’autre jour à Pézenas.
°°°
Très intéressé par l’introduction faite, par Hanif Kureishi, aux nouvelles complètes de John Cheever, à un niveau de compréhension fraternelle et d’intelligence littéraire qu’on voit rarement dans les hommages d’écrivains français (les Suisses, on n’en parle même pas !) à leurs pairs. J’adhère à tout de ce qui est écrit là, qu’on pourrait dire « de la famille »…
°°°
Dernier souper au Ghymnos où nous avons parlé, un peu, de notre vie commune depuis plus de trente ans, toute bonne dans les grandes largeurs, et pour nous deux et pour nos filles, je crois. Ensuite la soirée s’est achevée, sur fond de grondements orageux et d’éclairs lointains, à regarder la fin de la deuxième saison d’Abbey Downton, toujours d’aussi remarquable qualité.
Cap d’Agde, ce mardi 9 juin. – Dernière matinée de notre séjour, après le véhément orage d’été d’hier soir. Tôt éveillé ce matin, j’ai repensé à notre petit séjour avec reconnaissance. Tout s’est passé sans une ombre grâce à ma bonne amie, ou plutôt grâce à nous, grâce à notre vie, grâce à nos enfants, grâce à ce que nous ont légué nos parents - grâce à tout.
À La Désirade, ce mercredi 10 juin. – J’ai passé la journée sur le nouveau roman de Quentin, qui m’a beaucoup intéressé et que j’ai présenté ce soir de manière assez détaillée sur la Toile, alors que la culturelle de 24Heures, même pas fichue de se fendre d’un commentaire « maison », lui consacre un quart de page piqué à la Tribune de Genève et se réduisant à la formule paresseuse et nulle, désormais en vigueur, consistant à coller des éléments d’interview bâclée à une intro où, en l’occurrence, la journaliste montre bien qu’elle n’entre pas dans le jeu de l’auteur. Quelle suffisance et quel manque de sérieux !
°°°
 Le quatrième livre de Quentin Mouron a l’air d’un roman américain, plus précisément d’un thriller comme il en pullule, plus exactement encore d’un roman noir à résonances littéraires : le Crime et châtiment le Dostoïevski est d’emble cité en exergue, et l’on pense évidemment, en le lisant, à Non, ce pays n’es pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, ne serait-ce que parce que l’un de ses deux protagonistes, shérif,s e nomme Paul McCarthy…
Le quatrième livre de Quentin Mouron a l’air d’un roman américain, plus précisément d’un thriller comme il en pullule, plus exactement encore d’un roman noir à résonances littéraires : le Crime et châtiment le Dostoïevski est d’emble cité en exergue, et l’on pense évidemment, en le lisant, à Non, ce pays n’es pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, ne serait-ce que parce que l’un de ses deux protagonistes, shérif,s e nomme Paul McCarthy…
De même l’autre protagoniste, le détective cocaïnomane prénommé Franck, peut-il rappeler divers personnages ambivalents voire pervers du genre, par exemple des films d’un Abel Ferrara.
Cependant oublions un instant ces références ( et il y en aura bien d’autres) pour souligner le fait que, d’abord et avant tout, Trois gouttes de sang et un nuage de coke est un romande Quentin Mouron, et sûrement le plus abouti à ce jour.
À savoir qu’il est illico marqué par la papatte de Quentin, découlant d’un regard acéré sur le monde et les gens, reconnaissable à une écriture à la fois percutante et ciselée. En outre,comme dans ses trois premiers livres, Quentin Mouron aborde de grand thèmes qui lui tiennent à cœur,à savoir :la dégradation de la société et l’atomisation des individus, lasolitude qui en découle et la perte du sens fondant une vie, notamment.
De la génération suivant celle de Michel Houellebecq, le jeune auteur (né en 1989) pratique en outre une manière de narration-réflexion lestée de traits critiques voire polémiques, comme dans La Combustion humaine, qui rappelle à la fois les nouvelles d’un Ballard ou les romans, justement, de Michel Houellebecq. Comme devant, l'on relèvera, ici et là, quelque trait sentencieux frisant la dissertation ou le pédantisme. Péché de youngster, dont il se moque d'ailleurs lui-même...
Dès la première road-story de Quentin Mouron, intitulée Au point d’effusion des égouts (cetitre faisant allusion à Antonin Artaud), l’évocation d’une traversée panique des States exhalait déjà le mélange de tristesse et de rage d’un très jeune homme aussi poreux que teigneux, dans un récit à l’écriture déjà bien affirmée par ses rythmes et ses sonorités, ses images et ses formules frappées comme des médailles, dans la postérité de Céline.
Or on retrouve le regard du jeune routard « cadrant» l’église de Trona, symbole de spiritualité déglinguée, dansl’évocation d’uneautre église-bunker, transformée en locatif, ou dans les banlieues sinistres ousocialement sinistrées des alentours de Boston. De même retrouve-t-onl’humanité ordinaire, souvent morne ou déclassées, desdites interzonessuburbaines, dans ce nouveau roman qui accentue leur aspect mortifère.
Dans la filiation de Notre-Dame-de-la Merci,premier vrai roman deQuentin, Trois gouttes de sang et un nuage de coke développeet approfondit la composante« tchékhovienne » de son observation, où latendresse empathique (côté Paul Mc Carthy surtout) le dispute à une vision plusacide de la société des simulacres et des masques, sur fond de décadencesociale et culturelle, évidemment liée à la désastreuse vision du monde du néolibéralisme diluant.
Comme dans son roman canadien, l’auteur campe ici des personnages d’une réelle épaisseur humaine, dégagés de tout manichéisme moralisant mais illustrant belet bien, de façon diverse, une aspiration à certaine pureté.
Celle-ci est explicitement revendiquée par Franck le dandy, lecteur du Sâr Péladan (cet extravagant contempteur de la décadence fin de siècle, auteur visionnaire de livres lumineusement illuminés) et patron d’une agence privée, qui rêve de quelque crime gratuit relevant des beaux-arts, en lequel l’auteur, non sans ironie parodique, campe une sorte de meneur de jeu provocateur, qui se sert du grotesque pour mieux renvoyer moralisme et hypocrisie dos à dos. La scène finale, très théâtrale, marquant la confrontation du brave shérif supposé blanc comme neige et du « privé » jouant les pervers, oscille entre les grimaces de Dürrenmatt et de James Ensor...
Or on se gardera de chercher, dans Trois gouttes de sang et un nuage decoke, la conclusion trop rassurante d’un polar conventionnel, ni non plusl’arrière-plan « théologique » d’un Cormac McCarthy.
Néanmoins, jouant parfaitement le jeu du thriller socio-criminel, ce roman bref et dense, au scénario bien filé et très intéressant par ses observations et ses digressions, impose une fois de plus, et de façon plus ample et pénétrante que précédemment, l’intelligence d’un regard incluant les désarrois et les dégoûts d’une époque, non sans ménager des clairières d’immunité propices aux sentiments tendres et à la pensée vivace...
°°°
En recopiant les pages de mon roman écrites à Cap d’Agde en version manuscrite, à l’encre verte, je retrouve le bonheur que j’ai vécu durant les deux ans de composition du Viol de l’ange, il y a vingt ans de ça. Ce nouveau livre se forme plus lucidement que cela n’a été le cas avec le Viol, écrit tous lesmatins à 5 heures et souvent dans une espèce de transe ; et je m’en réjouis en avançant plus régulièrement aussi, l’esprit clair et l’expérience plus avancée à tous égards.
°°°
Mon roman en chantier fixe, de manière poétique - au sens particulier où je l’entends -, une réflexion sur le monde contemporain amorcée dès mon premier livre et qui n’a cessé de s’élargir dans mes carnets et mes récits divers, nouvelles et romans, pour former une première synthèse dans Le Viol de l’ange.
Pour le moment, ce nouveau roman-synthèse s’intitule La Vie des gens, mais c’est peut-être provisoire, comme Le viol de l’ange s’est longtemps intitulé Roman virtuel. J’ai pensé, depuis lors, à Nemrod & Co, ou à L’Ouvroir, mais cene sera probablement pas ça non plus. Le titre du Viol de l’ange m’était venu à la table de Maître Jacques, à l’auberge de Ropraz où nous nous régalions d’une langue de bœuf au câpres. J’avais lâché sans trop y croire: Le viol de l’ange. Et alors lui : c’est ça…
°°°
Ce qui m’a beaucoup intéressé, dans le nouveau roman de Quentin, c’est sa façon de filer une story. Sans la maestria constructiviste de Joël Dicker, qui s’est placé illico au top des storytellers, Quentin s’est donné la peine, après les bouffées narratives plus instinctives et parfois diffuses de Notre-Dame-de-la-Merci, que je tiens néanmoins pour son meilleur livre à ce jour, de développer une suite de séquences où le plan-par-plan s’agence sans rien d’artificiel ni de trop mécanique.
Même un peu téléphonée, et avec des artifices esthétiques qui fontun peu sourire (son privé dandy qui litPéladan, comme le protagoniste de Soumission lit Husymans…) , son intrigue module des thèmes qui ne sont qu’à lui, dont rien évidemment n’a été perçu par la pécore de la Tribune de Genève.
Quant à moi, je suis à peu près sûr que le lascar nous réserve d’autres surprises, si tant est qu’il ne se fasse pas laminer par le drôle de monde dans lequel nous vivons et se calme en matière d’ostentation plus ou moins tapageuse. Ce que j’aime bien pourtant, chez lui, est son art de se rendre tranquillement détestable auprès des éteignoirs et autres gendelettres surveillant le territoire, pour se la jouer plus librement. On le croit gonflé alors que je le sais beaucoup plus humble qu’il ne semble, beaucoup plus érieux qu’on ne pourrait le croire…
°°°
Mes deux tapuscrits de La Vie des gens et deMémoire vive, représentant un peu plus de 600 pages, vont se développer parallèlement jusqu’à la fin de l’année, se nourrissant mutuellement par osmose de faits et de fictions, suivant mes deux veines lyrique et critique de toujours.
°°°
J’ai été très intéressé, ces derniers jours, par la série anglaise Downton Abbey, détaillant la vie d’une famille de l’aristocratie terrienne du sud de l’Angleterre, dans une période de mutation économique et sociale courant du naufrage du Titanic aux années 1925.
Jamais je n’aurais eu l’idée d’y aller voir sans l’intérêt de Lady L. Or la chose est d’une qualité telle, tant pour la somme d’observations de toute espèce qu’elle cristallise, que pour la galerie de portraits qu’elle déploie upstairs (les maîtres) autant que downstairs (les domestiques), sans compter le dialogue toujours juste et naturel, l’interprétation de très haut vol et la densité dramatique de l’ensemble, qu’elle équivaut à la lecture d’un roman, s’inscrivant d’ailleurs dans le droit fil du roman anglais, de Jane Austen - pour le romantisme et la lucidité du regard sur la société – à Ivy Compton-Burnett dont la vivacité vacharde ne laisse de se retrouver ici chez les uns et les autres.
°°°
S’il est conseillé d’éviter la fréquentation prolongée des imbéciles, l’observation de ceux-ci ne saurait décourager un romancier consciencieux. Pour ma part, je me suis guéri des illusions de la gauche en fréquentant des imbéciles de gauche, et de la droite où ils ne sont pas en moindre nombre. L’imbécile pur est plus rare. Question subsidiaire : quand t’es-tu montré réellement un pur imbécile ?
 Ce dimanche 14 juin. –Au cap de mes 68 ans, passé ce matin à 8h.47 (un vaudeville françaiss’intitule Le train de 8h47, m’a rapporté ma mère qui le tenait de son médecin lettré de ce matin-là) , je pense précisément à mes bons parents : à notre père mort à cet âge très précisément, en mars 1983, et à notre mère tombée dans sa salle de bain, vingt ans plus tard, alors qu’elle se préparait crânement, octogénaire vaillante, à descendre à la piscine vu que c’était l’été et qu’il faisait beau.
Ce dimanche 14 juin. –Au cap de mes 68 ans, passé ce matin à 8h.47 (un vaudeville françaiss’intitule Le train de 8h47, m’a rapporté ma mère qui le tenait de son médecin lettré de ce matin-là) , je pense précisément à mes bons parents : à notre père mort à cet âge très précisément, en mars 1983, et à notre mère tombée dans sa salle de bain, vingt ans plus tard, alors qu’elle se préparait crânement, octogénaire vaillante, à descendre à la piscine vu que c’était l’été et qu’il faisait beau.
Mon fère aîné, qui buvait pas mal et fumait des Mary Long, nous a quittés à l’âge de 55 ans, et notre aïeul maternel, absolument abstinent et ne cessant de répéter qu’une cigarette tue un lapin, chopa une insolation à l’approche de sa centième année. Donc rien n’est sûr...
Or j’aimerais bien, pour ma part, disposer encore de deux ou trois ans pour achever six livres en chantier, à part les trois que j’aurai finis cette année, et ensuite la vie en décidera.
Je me rappelle en attendant que, la dernière fois que j’ai rencontré Maître Jacques, m’annonçant fièrement la parution du Juif pour l’exemple en traduction russe, le cher homme me disait qu’il comptait bien vivre encore vingt ou trente ans, ce qui me parut d’un bel optimisme ; mais trois semaines après je me retrouvai, tard le soir à la rédaction, à lui peaufiner une oraison funèbre épurée (ou presque) de tout ce qui nous avait parfois opposés…
Paul Léautaud : « C’est cela, la vie. On travaille, on fait des livres avec des tas de salutations à Pierre et à Paul. On attend la gloire, la fortune – et on claque en chemin ».


 Romances. – Les filles de l’été se repaissaient de feuilletons à l’eau de rose et les garçons de fumetti, aux filles de l’été nos mères et nos tantes refilaient les derniers numéros de Nous Deux, et toutes cet été-là craquèrent pour les yeux bleus de Jean Sorel en beau meccano qui en pinçait pour la fille d’un richeto, et l’histoire intitulée L’été fatal finissait par le crash en auto des deux amants après une première et dernière nuit qui faisait rêver les fanciulle de tous les âges - se non è vero è ben trovato...
Romances. – Les filles de l’été se repaissaient de feuilletons à l’eau de rose et les garçons de fumetti, aux filles de l’été nos mères et nos tantes refilaient les derniers numéros de Nous Deux, et toutes cet été-là craquèrent pour les yeux bleus de Jean Sorel en beau meccano qui en pinçait pour la fille d’un richeto, et l’histoire intitulée L’été fatal finissait par le crash en auto des deux amants après une première et dernière nuit qui faisait rêver les fanciulle de tous les âges - se non è vero è ben trovato...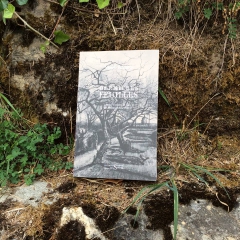
 La métaphysique est soif.
La métaphysique est soif. Je me demande souvent pourquoi, depuis 40 ans, je n’ai cessé de revenir à Rozanov, que Dimitri et Czapski m’ont fait découvrir au tournant de mes vingt-cinq ans. « Voilà, ce livre a été écrit pour vous », m’avait dit un soir Dimitri en me faisant cadeau de l’édition Gallimard de La Face sombre du Christ, assortie d’une longue préface de Josef Czapski. Or, cette page que je viens de lire en est la réponse : à cause de cette âme, à cause de la musique de cette âme, à cause de ce que filtre cette musique, en moi, de l’âme du monde.
Je me demande souvent pourquoi, depuis 40 ans, je n’ai cessé de revenir à Rozanov, que Dimitri et Czapski m’ont fait découvrir au tournant de mes vingt-cinq ans. « Voilà, ce livre a été écrit pour vous », m’avait dit un soir Dimitri en me faisant cadeau de l’édition Gallimard de La Face sombre du Christ, assortie d’une longue préface de Josef Czapski. Or, cette page que je viens de lire en est la réponse : à cause de cette âme, à cause de la musique de cette âme, à cause de ce que filtre cette musique, en moi, de l’âme du monde. Rozanov n’a jamais écrit de poème, mais la poésie qui émane de ses pages est incomparable, que je retrouve chez Annie Dillard, pas plus poète que le penseur russe. Mais je reprends presque tous les jours Au présent et je retrouve ce même flux de l’âme d’une personne qui participe de l’âme du monde le plus physique qui soit en apparence, dont Teilhard voyait l’incandescence.
Rozanov n’a jamais écrit de poème, mais la poésie qui émane de ses pages est incomparable, que je retrouve chez Annie Dillard, pas plus poète que le penseur russe. Mais je reprends presque tous les jours Au présent et je retrouve ce même flux de l’âme d’une personne qui participe de l’âme du monde le plus physique qui soit en apparence, dont Teilhard voyait l’incandescence.  Il n’y a pas de grande critique, me semble-t-il, sans poésie. Rozanov cesse d’être poète quand il ferraille dans les domaines politique ou théologique, mais son âme est ailleurs. Dès qu’il donne dans l’idéologie, il s’empêtre, comme Dimitri s’y empêtrait, alors que Czapski y échappait.
Il n’y a pas de grande critique, me semble-t-il, sans poésie. Rozanov cesse d’être poète quand il ferraille dans les domaines politique ou théologique, mais son âme est ailleurs. Dès qu’il donne dans l’idéologie, il s’empêtre, comme Dimitri s’y empêtrait, alors que Czapski y échappait.  Rozanov est le grand poète de l’intimité, taxé de pornographie parce qu’il parle du sexe comme personne, d’antisémitims parcequ’il aime le judaïsme comme aucun chrétien, ou d’anti-christianisme pour safaçon d’accuser le Christ d’avoir stérilisé le monde. Rozanov mélange tout enécrivant n’importe où pour s’exprimer plus immédiatement (il écrit parfois surla semelle de ses souliers, au bord de la rue des prostituées), comme AnnieDillard mélange tout, réfléchissant à la nature du Mal en visitant les lieuxsaints de Jérusalem ou s’interrogeant sur l’innocence d’un Dieu qu’on dit compatissant et qui semble plutôtimpuissant à outrance, faible et peut-être divin à proportion de cettefaiblesse. Quant à Philippe Jaccottet, il mélange tout à sa façon plus épurée, lumières de Grignan et baroquisme de Gongora, Thomas Mann en traduction dont les propos sur Nietzsche n'en finissent pas de m'éclairer, le silence Morandi et Mandelstam en résonance...
Rozanov est le grand poète de l’intimité, taxé de pornographie parce qu’il parle du sexe comme personne, d’antisémitims parcequ’il aime le judaïsme comme aucun chrétien, ou d’anti-christianisme pour safaçon d’accuser le Christ d’avoir stérilisé le monde. Rozanov mélange tout enécrivant n’importe où pour s’exprimer plus immédiatement (il écrit parfois surla semelle de ses souliers, au bord de la rue des prostituées), comme AnnieDillard mélange tout, réfléchissant à la nature du Mal en visitant les lieuxsaints de Jérusalem ou s’interrogeant sur l’innocence d’un Dieu qu’on dit compatissant et qui semble plutôtimpuissant à outrance, faible et peut-être divin à proportion de cettefaiblesse. Quant à Philippe Jaccottet, il mélange tout à sa façon plus épurée, lumières de Grignan et baroquisme de Gongora, Thomas Mann en traduction dont les propos sur Nietzsche n'en finissent pas de m'éclairer, le silence Morandi et Mandelstam en résonance...  Enfin, de retour à La Désirade et retrouvant ma bonne amie et mes livres, j’ouvre le recueil de poèmes intitulé Halte sur le parcours, après avoir découvert en Samuel Brussell un poète qu’on peut dire aussi « métaphysique » dans ses épiphanies voyageuses, comme un Joseph Brodsky ou un Adam Zagajewski, et dont je recopie ce morceau daté de mars1980, à New York, sous le titre d' À un poète de langue russe.
Enfin, de retour à La Désirade et retrouvant ma bonne amie et mes livres, j’ouvre le recueil de poèmes intitulé Halte sur le parcours, après avoir découvert en Samuel Brussell un poète qu’on peut dire aussi « métaphysique » dans ses épiphanies voyageuses, comme un Joseph Brodsky ou un Adam Zagajewski, et dont je recopie ce morceau daté de mars1980, à New York, sous le titre d' À un poète de langue russe.
 Moi l’un : - De fait, le genre nain de jardin, petite villa bien alignée et désormais pourvue d’un jacuzzi, m’a toujours fait fuir, comme Robert Walser ou Charles-Albert Cingria fuyaient les tea-rooms. Et les plus fous: Adolf Wölffli génie d'art brut, Louis Soutter génie d'art visionnaire, Aloyse et ses gueules d'anges, et Zouc et tant d'autres...
Moi l’un : - De fait, le genre nain de jardin, petite villa bien alignée et désormais pourvue d’un jacuzzi, m’a toujours fait fuir, comme Robert Walser ou Charles-Albert Cingria fuyaient les tea-rooms. Et les plus fous: Adolf Wölffli génie d'art brut, Louis Soutter génie d'art visionnaire, Aloyse et ses gueules d'anges, et Zouc et tant d'autres... Trois artistes suisses des plus alignés: Adolf Wölfli le schizo, Aloÿse la timbrée et Louis Soutter le siphonné.
Trois artistes suisses des plus alignés: Adolf Wölfli le schizo, Aloÿse la timbrée et Louis Soutter le siphonné. 
 Rafik Ben Salah. La véritable histoire de Gayoum ben Tell. Xénia, 139p.
Rafik Ben Salah. La véritable histoire de Gayoum ben Tell. Xénia, 139p. Celui qui sourit sous cape quand il entend dire de lui qu’il suit un Chemin / Celle qui s’obstine à avancer dans la nuit noire au fond de laquelle elle croit savoir une fourmi noire sur une pierre noire / Ceux qui tapent sur le ciel à coups de masse en espérant voir de l’autre côté / Celui qui avance sans même penser que qui n’avance pas recule / Celle qui dit en fixant la dame en noir dans le miroir : pense te voir ! / Ceux qui s’arrêtent un instant pour constater que les vagues océaniques effritent les coraux puis reprennent leur chemin le long des falaises de Pitcairn dangereuses par brouillard/ Celui qui sait que le sable noir procède de la lave et non de la bave du taureau qui n'atteint point la blanche palombe / Celle qui suivrait volontiers les gazelles de Gobi si elle avait des ailes / Ceux qui découvrent un rhinocéros du tertiaire dans les sables du désert dont les tempêtes provoquent de l’électricité statique comme chacun sait / Celui qui aappris par le télescope spatial Hubble qu’il y a environ neuf galaxies par être humain soit quatre vingts milliards de galaxies abritant au moins cent milliards de soleils/ Celle qui rappelle à sa sœur Suzanne faiseuse de chichis que la Voie Lactée contient quatre cent milliards de soleils / Ceux qui estiment que chaque grain de sable contient un Bouddha et chaque Bouddha un désert vivant / Celui qui découvre ce matin que les Troyens avaient la plus haute idée de leur personne avant de disparaître comme nous disparaîtrons après trois p'tits tours et puis s’en vont / Celle qui se dit « en recherche » même quand elle trouve le temps long /Ceux qui se tiennent chaud sur terre comme au ciel quand il fait beau / Celui qui va d’un bon pas Dieu sait sûrement pas où / Celle qui a branché son GPS sur éternité avec arrêt buffet à la Closerie des lilas / Ceux qui font un enfant dans le dos à l’éternel retour, etc.
Celui qui sourit sous cape quand il entend dire de lui qu’il suit un Chemin / Celle qui s’obstine à avancer dans la nuit noire au fond de laquelle elle croit savoir une fourmi noire sur une pierre noire / Ceux qui tapent sur le ciel à coups de masse en espérant voir de l’autre côté / Celui qui avance sans même penser que qui n’avance pas recule / Celle qui dit en fixant la dame en noir dans le miroir : pense te voir ! / Ceux qui s’arrêtent un instant pour constater que les vagues océaniques effritent les coraux puis reprennent leur chemin le long des falaises de Pitcairn dangereuses par brouillard/ Celui qui sait que le sable noir procède de la lave et non de la bave du taureau qui n'atteint point la blanche palombe / Celle qui suivrait volontiers les gazelles de Gobi si elle avait des ailes / Ceux qui découvrent un rhinocéros du tertiaire dans les sables du désert dont les tempêtes provoquent de l’électricité statique comme chacun sait / Celui qui aappris par le télescope spatial Hubble qu’il y a environ neuf galaxies par être humain soit quatre vingts milliards de galaxies abritant au moins cent milliards de soleils/ Celle qui rappelle à sa sœur Suzanne faiseuse de chichis que la Voie Lactée contient quatre cent milliards de soleils / Ceux qui estiment que chaque grain de sable contient un Bouddha et chaque Bouddha un désert vivant / Celui qui découvre ce matin que les Troyens avaient la plus haute idée de leur personne avant de disparaître comme nous disparaîtrons après trois p'tits tours et puis s’en vont / Celle qui se dit « en recherche » même quand elle trouve le temps long /Ceux qui se tiennent chaud sur terre comme au ciel quand il fait beau / Celui qui va d’un bon pas Dieu sait sûrement pas où / Celle qui a branché son GPS sur éternité avec arrêt buffet à la Closerie des lilas / Ceux qui font un enfant dans le dos à l’éternel retour, etc.





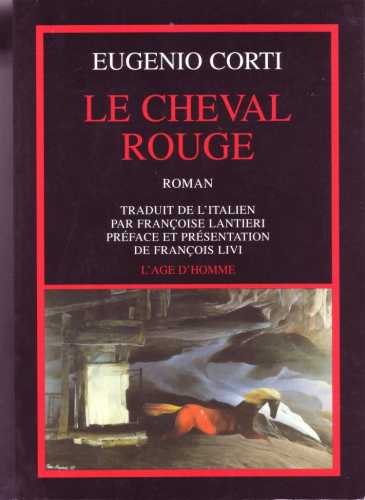
 Première impression, le lendemain, du Marché des amants de Christine Angot, entamé les pieds dans l’eau ? Va-t-on vers un nouvel épisode de la lettre à la petite cousine dont parlait l’affreux Céline ? De Marc qu’elle découvre à Bruno dont elle s’est un peu fatiguée mais qui est plus beau que Marc, lequel hésite la moindre avant de partir en Corse avec les siens, le feuilleton se dessine mais c’est la phrase, surtout, qui me scotche. La phrase d’Angot se délie et le dialogue a la pêche. Ecriture électrique. Bon, mais là faut regagner la ville pour faire ses adieux à sa grande petite fille qui se tire un mois en Colombie…
Première impression, le lendemain, du Marché des amants de Christine Angot, entamé les pieds dans l’eau ? Va-t-on vers un nouvel épisode de la lettre à la petite cousine dont parlait l’affreux Céline ? De Marc qu’elle découvre à Bruno dont elle s’est un peu fatiguée mais qui est plus beau que Marc, lequel hésite la moindre avant de partir en Corse avec les siens, le feuilleton se dessine mais c’est la phrase, surtout, qui me scotche. La phrase d’Angot se délie et le dialogue a la pêche. Ecriture électrique. Bon, mais là faut regagner la ville pour faire ses adieux à sa grande petite fille qui se tire un mois en Colombie…

 Je sais bien que la prose de Gustave Roud vaut mieux que la rose bleue, mais on a compris que ce n'est pas La Chose qui est visée ici, comme l'avait bien perçu Dürrenmatt le malappris, que l'ambiance pieuse et vénérante qui entoure La Chose dans les réunions vespérales et les lectures en plein air de la paroisse littéraire romande.
Je sais bien que la prose de Gustave Roud vaut mieux que la rose bleue, mais on a compris que ce n'est pas La Chose qui est visée ici, comme l'avait bien perçu Dürrenmatt le malappris, que l'ambiance pieuse et vénérante qui entoure La Chose dans les réunions vespérales et les lectures en plein air de la paroisse littéraire romande.  'illusion ruminée. - Un effort méritoire a été accompli, récemment, par le jeune lettreux Daniel Vuataz, en sorte de rappeler les mérites d'une autre "institution" locale qui fit date en nos contrées et au-delà, sous le titre de Gazette littéraire. Avec un enthousiasme légèrement myope, notre ami Vuataz va jusqu'à parler d'"âge d'or de la presse culturelle romande" à propos de cette publication certes estimable mais qui ne touchait guère qu'une élite bourgeoise et ses marges plus ou moins contestataires. La Gazette littéraire de Franck Jotterand était un excellent journal que les amateurs romands de littérature aimaient bien retrouver malgré ses côtés (j'avais vingt ans et des poussières quand je le lisais) un peu snobs. Cela étant, sa disparition n'est pas que l'affaire d'un règlement de comptes à caractère politique, tel que le décrit Daniel Vuataz sur la base de documents qui en disent long sur la pleutrerie des interlocuteurs de Jotterand: elle procède aussi de la fin d'une société lettrée et de l'épuisement d'une formule journalistique que d'autres publications comparables, comme les Nouvelles littéraires à Paris, ont su remodeler, avec d'autres moyens évidemment.
'illusion ruminée. - Un effort méritoire a été accompli, récemment, par le jeune lettreux Daniel Vuataz, en sorte de rappeler les mérites d'une autre "institution" locale qui fit date en nos contrées et au-delà, sous le titre de Gazette littéraire. Avec un enthousiasme légèrement myope, notre ami Vuataz va jusqu'à parler d'"âge d'or de la presse culturelle romande" à propos de cette publication certes estimable mais qui ne touchait guère qu'une élite bourgeoise et ses marges plus ou moins contestataires. La Gazette littéraire de Franck Jotterand était un excellent journal que les amateurs romands de littérature aimaient bien retrouver malgré ses côtés (j'avais vingt ans et des poussières quand je le lisais) un peu snobs. Cela étant, sa disparition n'est pas que l'affaire d'un règlement de comptes à caractère politique, tel que le décrit Daniel Vuataz sur la base de documents qui en disent long sur la pleutrerie des interlocuteurs de Jotterand: elle procède aussi de la fin d'une société lettrée et de l'épuisement d'une formule journalistique que d'autres publications comparables, comme les Nouvelles littéraires à Paris, ont su remodeler, avec d'autres moyens évidemment. Dans La combustion humaine, prochain roman encore inédit de Quentin Mouron, il est question d'un éditeur passionné de Proust et complètement désabusé, s'agissant de la création contemporaine, qui se targue pourtant de savoir quand "il y a littérature". Ce roman hirsute à l'urgence indéniable, traitant (notamment) de notre implication dans les nouvelles relations établies par les réseaux sociaux - l'on y trouve un formidable gorillage de Facebook, soit dit en passant -, fera peut-être figure d'OVNI aux yeux de nos chers paroissiens. Affaire à suivre. En ce qui me concerne, j'ai balancé - sur Facebook évidemment ! mon verdict pontifical à Quentin à propos de son tapuscrit lu en moins de deux heures: "Il y a littérature"...
Dans La combustion humaine, prochain roman encore inédit de Quentin Mouron, il est question d'un éditeur passionné de Proust et complètement désabusé, s'agissant de la création contemporaine, qui se targue pourtant de savoir quand "il y a littérature". Ce roman hirsute à l'urgence indéniable, traitant (notamment) de notre implication dans les nouvelles relations établies par les réseaux sociaux - l'on y trouve un formidable gorillage de Facebook, soit dit en passant -, fera peut-être figure d'OVNI aux yeux de nos chers paroissiens. Affaire à suivre. En ce qui me concerne, j'ai balancé - sur Facebook évidemment ! mon verdict pontifical à Quentin à propos de son tapuscrit lu en moins de deux heures: "Il y a littérature"... 


 Ainsi s’ouvre la nouvelle de Pierre Jean Jouve intitulée Dans les années profondes : « Il y a dans la rapport de ces régions quelque chose d’inépuisable et de mystérieux. Il y a une qualité qui ne parvient pas à son terme. Il y a plusieurs régions étagées, enfermées dans les cent vallées bleues des montagnes creuses, ou au contraire sur le piédestal de roc de lumière et d’abstraction, tout en haut. »
Ainsi s’ouvre la nouvelle de Pierre Jean Jouve intitulée Dans les années profondes : « Il y a dans la rapport de ces régions quelque chose d’inépuisable et de mystérieux. Il y a une qualité qui ne parvient pas à son terme. Il y a plusieurs régions étagées, enfermées dans les cent vallées bleues des montagnes creuses, ou au contraire sur le piédestal de roc de lumière et d’abstraction, tout en haut. »

 Ce qu'en dit Bernard de Fallois, éditeur:
Ce qu'en dit Bernard de Fallois, éditeur: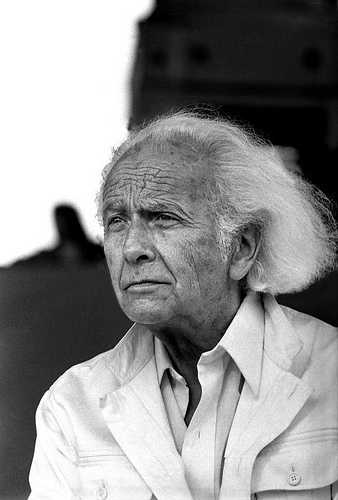 Un essai de Daniel Bougnoux (censuré !) et un nouveau volume de La Pléiade ravivent la mémoire du grand écrivain controversé.
Un essai de Daniel Bougnoux (censuré !) et un nouveau volume de La Pléiade ravivent la mémoire du grand écrivain controversé. Louis Aragon. Oeuvres romanesques V. La Pléiade, 1537p.
Louis Aragon. Oeuvres romanesques V. La Pléiade, 1537p.






 Le problème de la critique littéraire de type universitaire, et notamment en Suisse romande, c’est qu’elle est le fait de types, ou de typesses, qui n’ont rien vécu, ou qui ne laissent rien filtrer de ce qu’ils ont (un peu) vécu dans leur approche et leur interprétation des textes.
Le problème de la critique littéraire de type universitaire, et notamment en Suisse romande, c’est qu’elle est le fait de types, ou de typesses, qui n’ont rien vécu, ou qui ne laissent rien filtrer de ce qu’ils ont (un peu) vécu dans leur approche et leur interprétation des textes. Il y a une espèce de douce folie dans les nouvelles de John Cheever, qui me convient à merveille car c’est ainsi, aussi, que je ressens la vie, toujours extravagante sur les bords et tirant de là son irrésistible comique. On voit cela, mieux que dans ses récits des années 30-40, marqués par un réalisme social plus âpre, dans les nouvelles de la maturité, et notamment dans le recueil du Déjeuner e famille, telles Clancy dans la tour de Babel et La chasteté de Clarissa. De fait, le personnage de Clancy est véritablement une figure du comique universel, qu’on pourrait dire l’ahuri révélateur ou le confondant imbécile.
Il y a une espèce de douce folie dans les nouvelles de John Cheever, qui me convient à merveille car c’est ainsi, aussi, que je ressens la vie, toujours extravagante sur les bords et tirant de là son irrésistible comique. On voit cela, mieux que dans ses récits des années 30-40, marqués par un réalisme social plus âpre, dans les nouvelles de la maturité, et notamment dans le recueil du Déjeuner e famille, telles Clancy dans la tour de Babel et La chasteté de Clarissa. De fait, le personnage de Clancy est véritablement une figure du comique universel, qu’on pourrait dire l’ahuri révélateur ou le confondant imbécile. Achevé ce matin la lecture de La petite galère de Sacha Desprès. Vraiment très bien, et qui me surprend d’autant plus que le thème des banlieues fait aujourd’hui alterner, presque automatiquement, colères feintes et trémolos convenus. Or il y a là quelque chose de vécu du dedans, et j’y reconnais du vrai en dépit du regard parfois étroit de la vision modulée, donnant par exemple à penser que tous les mecs sont des salauds.
Achevé ce matin la lecture de La petite galère de Sacha Desprès. Vraiment très bien, et qui me surprend d’autant plus que le thème des banlieues fait aujourd’hui alterner, presque automatiquement, colères feintes et trémolos convenus. Or il y a là quelque chose de vécu du dedans, et j’y reconnais du vrai en dépit du regard parfois étroit de la vision modulée, donnant par exemple à penser que tous les mecs sont des salauds.  J’ai repris ce soir les lettres de Simon Leys à Pierre Boncenne, qui sont aussi constamment pertinentes que tout ce qui a été publié par ce très grand Monsieur. Qu’il parle des livres qu’il est en train de lire ou des idées de Jean-François Revel, pour lequel il a beaucoup d’admiration, de Simone Weil (et de Gustave Thibon à propos de celle-ci) ou de navigation en mer (avec sesfils), du dernier recueil de nouvelles d’Alice Munro dont il relève la profondeempathie à la Tchékhov - mais un fonds de tristesse qui le gêne -, des bateleurs de l’intelligentsia parisienne (il ne manque pas une occasion de brocarder joyeusement l’inénarrable BHL) ou, par effet de contraste, du courage intellectuel d’un Orwell et de divers contempteurs de la Révolution culturelle chinoise, dont il aura été le précurseur et le plus vaillant adversaire dans le domaine francophone, Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, me semble toujours sensé, naturel , jamais pédant, joyeusement lui-même.
J’ai repris ce soir les lettres de Simon Leys à Pierre Boncenne, qui sont aussi constamment pertinentes que tout ce qui a été publié par ce très grand Monsieur. Qu’il parle des livres qu’il est en train de lire ou des idées de Jean-François Revel, pour lequel il a beaucoup d’admiration, de Simone Weil (et de Gustave Thibon à propos de celle-ci) ou de navigation en mer (avec sesfils), du dernier recueil de nouvelles d’Alice Munro dont il relève la profondeempathie à la Tchékhov - mais un fonds de tristesse qui le gêne -, des bateleurs de l’intelligentsia parisienne (il ne manque pas une occasion de brocarder joyeusement l’inénarrable BHL) ou, par effet de contraste, du courage intellectuel d’un Orwell et de divers contempteurs de la Révolution culturelle chinoise, dont il aura été le précurseur et le plus vaillant adversaire dans le domaine francophone, Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, me semble toujours sensé, naturel , jamais pédant, joyeusement lui-même. Ce lundi 22 juin. – Pendant que L.était en ville avec des amis, j’ai regardé tout à l’heure Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, évoquant les relations triangulaires, à la fois explicites, dans leur mimétisme, et pas moins épineuses, nouées entre une paire d’amis des deux sexes et un très beau jeune blond, genre Adonis, mais stupide à l’évidence.
Ce lundi 22 juin. – Pendant que L.était en ville avec des amis, j’ai regardé tout à l’heure Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, évoquant les relations triangulaires, à la fois explicites, dans leur mimétisme, et pas moins épineuses, nouées entre une paire d’amis des deux sexes et un très beau jeune blond, genre Adonis, mais stupide à l’évidence. Geneva Airport, Ce 30 juin. - Ma bonne amie vient de me rappeler, au téléphone, que nous fêtons aujourd’hui les 33 ans de notre mariage. Je le note en attendant, assis en face d’un jeune Syrien, à l’aire de départ A2 del’aéroport de Genève, l’avion pour Amsterdam où je vais passer quatre jours que je dirai de repérages pour mon roman.
Geneva Airport, Ce 30 juin. - Ma bonne amie vient de me rappeler, au téléphone, que nous fêtons aujourd’hui les 33 ans de notre mariage. Je le note en attendant, assis en face d’un jeune Syrien, à l’aire de départ A2 del’aéroport de Genève, l’avion pour Amsterdam où je vais passer quatre jours que je dirai de repérages pour mon roman. Arrivé à Amsterdam, j’ai pris mes quartiers sous les toits de l’hôtel The Poet, dans une chambre vraiment exiguë du quatrième étage, avec une espèce de caisse rustique en guise de table. Cela devient un peu la règle des réservations par Internet que d’obtenir les chambres les plus moches à prix réduit. Mais enfin,comme l’endroit a quand même quelque chose de gentiment bohème, avec son imposte donnant sur les toits, et que je me trouve ici à cent mètres du Rijks, à trois cent mètres du Stedelijk et à un kilomètre du Vondelpark, je n’ai pas pensé, pas plus qu’à Venise en novembre dernier, à réclamer une autre chambre avec de vraies fenêtres et une vraie table, mais j’y songerai la prochaine fois à Cracovie.
Arrivé à Amsterdam, j’ai pris mes quartiers sous les toits de l’hôtel The Poet, dans une chambre vraiment exiguë du quatrième étage, avec une espèce de caisse rustique en guise de table. Cela devient un peu la règle des réservations par Internet que d’obtenir les chambres les plus moches à prix réduit. Mais enfin,comme l’endroit a quand même quelque chose de gentiment bohème, avec son imposte donnant sur les toits, et que je me trouve ici à cent mètres du Rijks, à trois cent mètres du Stedelijk et à un kilomètre du Vondelpark, je n’ai pas pensé, pas plus qu’à Venise en novembre dernier, à réclamer une autre chambre avec de vraies fenêtres et une vraie table, mais j’y songerai la prochaine fois à Cracovie. Amsterdam,ce 2 juillet.- On ne s'y attendait pas, mais alors vraiment pas. On était là pour autre chose, et rien que pour ça. On était en train d'écrire quelque chose qui avait à voir avec cette ville et sesgens, donc on s'en imprégnait du matin au soir, le long des canaux et par les ruelles; on était ailleurs tout en étant bien là, on était tout à sa rêverie et les mots du roman venaient tout seuls, on avait passé deux heures avec un ami sans être sûr de cela qu'il ne fût pas un personnage de papier comme les autres, et les pages se tournaient, les séquences nouvelles s'ajoutaient aux précédentes sans qu'on eût le sentiment d'y être pour quelque chose tant la rêverie était dense, quand celle-ci soudain, loin de s'interrompre pour autant, changea de nature et de texture, la musique intérieure devenant couleur pure et joie partagée, comme fléchée par l'annonce: OASIS DE MATISSE.
Amsterdam,ce 2 juillet.- On ne s'y attendait pas, mais alors vraiment pas. On était là pour autre chose, et rien que pour ça. On était en train d'écrire quelque chose qui avait à voir avec cette ville et sesgens, donc on s'en imprégnait du matin au soir, le long des canaux et par les ruelles; on était ailleurs tout en étant bien là, on était tout à sa rêverie et les mots du roman venaient tout seuls, on avait passé deux heures avec un ami sans être sûr de cela qu'il ne fût pas un personnage de papier comme les autres, et les pages se tournaient, les séquences nouvelles s'ajoutaient aux précédentes sans qu'on eût le sentiment d'y être pour quelque chose tant la rêverie était dense, quand celle-ci soudain, loin de s'interrompre pour autant, changea de nature et de texture, la musique intérieure devenant couleur pure et joie partagée, comme fléchée par l'annonce: OASIS DE MATISSE. Amsterdam,ce 3 juillet.- Il y a des jours où le poids du monde se trouve conjuré par le chant du monde, et c’est ce que je me dis ce soir après avoir accompagné, avec son fils et ses amis, un amoureux de la vie jusqu’au seuil de la mort, là-bas au bord d’un lac, quelque part au Québec, je ne sais pas en quelle année, et c’est comme ça qu’un matin de mars 1983 nous aurons accompagné notre père, présent autour de lui de l’aube à la nuit où il nous quitta.
Amsterdam,ce 3 juillet.- Il y a des jours où le poids du monde se trouve conjuré par le chant du monde, et c’est ce que je me dis ce soir après avoir accompagné, avec son fils et ses amis, un amoureux de la vie jusqu’au seuil de la mort, là-bas au bord d’un lac, quelque part au Québec, je ne sais pas en quelle année, et c’est comme ça qu’un matin de mars 1983 nous aurons accompagné notre père, présent autour de lui de l’aube à la nuit où il nous quitta.
 À La Désirade, ce mardi 7 juillet. –Fraîcheur matinale bienvenue. Je renoue avec une pensée active à la reprise de Tu dois changer ta vie, de Peter Sloterdijk, à propos de « la religion » et de l’immense malentendu qu’elle représente aujourd’hui.
À La Désirade, ce mardi 7 juillet. –Fraîcheur matinale bienvenue. Je renoue avec une pensée active à la reprise de Tu dois changer ta vie, de Peter Sloterdijk, à propos de « la religion » et de l’immense malentendu qu’elle représente aujourd’hui. D’où ma grand-mère paternelle, très prude, tenait-elle son puritanisme de Vaudoise, née Vuillemin, et son recours sentencieux aux « paroles » bibliques, tirées surtout de l’Ancien Testament, style vanité des vanités ? Et que signifiait concrètement le ralliement de mon grand-père maternel à la secte adventiste ? Pourquoi telle de mes nièces, qui ne va jamais au culte, a-t-elle décidé avec son jules de se marier à l’église, répétant à trois reprises son entrée avec son père sur le thème de la Marche Nuptiale ? Est-il toujours important de se rendre « au culte » ou « à la messe » pour des foyers suisses décidés aujourd’hui d’ aller de l’avant ?
D’où ma grand-mère paternelle, très prude, tenait-elle son puritanisme de Vaudoise, née Vuillemin, et son recours sentencieux aux « paroles » bibliques, tirées surtout de l’Ancien Testament, style vanité des vanités ? Et que signifiait concrètement le ralliement de mon grand-père maternel à la secte adventiste ? Pourquoi telle de mes nièces, qui ne va jamais au culte, a-t-elle décidé avec son jules de se marier à l’église, répétant à trois reprises son entrée avec son père sur le thème de la Marche Nuptiale ? Est-il toujours important de se rendre « au culte » ou « à la messe » pour des foyers suisses décidés aujourd’hui d’ aller de l’avant ? Mais voici qu’à un moment donné me reposant sur un banc circulaire, l’envie me prit de revoir mes images de la journée, toutes captées par Mac le Nomade contenant,en outre, la copie des 120 premières pages d’un roman en chantier que je venais précisément continuer en ces lieux à cause d’un de ses personnages, sans compter les milliers de pages de mes carnets, une douzaine de livres enregistrés et j’en passe.
Mais voici qu’à un moment donné me reposant sur un banc circulaire, l’envie me prit de revoir mes images de la journée, toutes captées par Mac le Nomade contenant,en outre, la copie des 120 premières pages d’un roman en chantier que je venais précisément continuer en ces lieux à cause d’un de ses personnages, sans compter les milliers de pages de mes carnets, une douzaine de livres enregistrés et j’en passe.  Et voilà qu’une semaine après, un appel d’Amsterdam m’annonce la bonne nouvelle par la voix d’une jeune femme, au prénom d’Aimée, qui nous apprend (Lady L. m’a relayé pour la communication détaillée en anglais) qu’elle a découvert Mac le Nomade abandonné sur ce banc-là, tout à côté de son logis, et qu’il lui a fait la même impression qu’un petit chien abandonné. Ainsi l'a-t-elle recueilli...
Et voilà qu’une semaine après, un appel d’Amsterdam m’annonce la bonne nouvelle par la voix d’une jeune femme, au prénom d’Aimée, qui nous apprend (Lady L. m’a relayé pour la communication détaillée en anglais) qu’elle a découvert Mac le Nomade abandonné sur ce banc-là, tout à côté de son logis, et qu’il lui a fait la même impression qu’un petit chien abandonné. Ainsi l'a-t-elle recueilli...
 Le départ du roman est en effet "inapproprié" à souhait, puisqu'il démarre sur un inceste caractérisé, relevant bonnement du viol pédophile. La victime de celui-ci, à vrai dire consentante, et un ado de quinze ans prénommé Desmond, métis très intelligent et se sentant un peu coupable d'avoir cédé aux avances de sa grand-mère Grace ("vieille" de 39 ans et qui a enfanté sept fois depuis ses douze ans, notamment de quatre garçons aux prénoms empruntés aux Beatles) alors que celle-ci en redemande bientôt auprès d'un autre kid plus à la coule.
Le départ du roman est en effet "inapproprié" à souhait, puisqu'il démarre sur un inceste caractérisé, relevant bonnement du viol pédophile. La victime de celui-ci, à vrai dire consentante, et un ado de quinze ans prénommé Desmond, métis très intelligent et se sentant un peu coupable d'avoir cédé aux avances de sa grand-mère Grace ("vieille" de 39 ans et qui a enfanté sept fois depuis ses douze ans, notamment de quatre garçons aux prénoms empruntés aux Beatles) alors que celle-ci en redemande bientôt auprès d'un autre kid plus à la coule. Entre deux séjours du premier en prison, Oncle et neveu partagent le même logis au 33e étage d'une tour de la "mégapole mondiale" Diston, où l'espérance de vie moyenne est estimée à une cinquantaine d'années. Si la "faute" de Desmond reste ignorée de l'oncle terrible aux féroces pitbulls, sa fureur moralisante se déchaînera sur l'autre garçon que sa mère a séduit sans que nul ne sache dans quelles circonstances précises, sûrement atroces, il le fait disparaître - c'est le "trou noir" du roman.
Entre deux séjours du premier en prison, Oncle et neveu partagent le même logis au 33e étage d'une tour de la "mégapole mondiale" Diston, où l'espérance de vie moyenne est estimée à une cinquantaine d'années. Si la "faute" de Desmond reste ignorée de l'oncle terrible aux féroces pitbulls, sa fureur moralisante se déchaînera sur l'autre garçon que sa mère a séduit sans que nul ne sache dans quelles circonstances précises, sûrement atroces, il le fait disparaître - c'est le "trou noir" du roman. De fait, la grandeur de ce roman ne tient pas qu'à son tableau au vitriol de la vulgarité. À l'aperçu de ce qu'il y a certes de plus vil et de plus vain dans nos sociétés dites évoluées, au côté "cheap" de la nouvelle richesse, au toc de la réussite à bon marché s'oppose en effet la "vraie vie" de Desmond et Dawn - jamais aidés par l'oncle mais lui imposant peu à peu la vision d'une existence normale qu'il a toujours piétinée -, jusqu'à l'arrivée d'un enfant irradiant la dernière partie du livre sans qu'on puisse parler de happy end téléphoné...
De fait, la grandeur de ce roman ne tient pas qu'à son tableau au vitriol de la vulgarité. À l'aperçu de ce qu'il y a certes de plus vil et de plus vain dans nos sociétés dites évoluées, au côté "cheap" de la nouvelle richesse, au toc de la réussite à bon marché s'oppose en effet la "vraie vie" de Desmond et Dawn - jamais aidés par l'oncle mais lui imposant peu à peu la vision d'une existence normale qu'il a toujours piétinée -, jusqu'à l'arrivée d'un enfant irradiant la dernière partie du livre sans qu'on puisse parler de happy end téléphoné... 
 En reprenant la lecture de Femmes, de Philippe Sollers, je me dis que tout ce brillant sonne souvent creux, et que ce défilé de prénoms féminins reste sans chair, sinon sans traits de vrais personnages romanesques. C’est le bottin demi-mondain des conquêtes du narrateur, assez mal individualisé par rapport à l’auteur (une espèce de double américain pas vraiment crédible), et le tableau d’époque relève de la même projection narcissique, dont les illustres figures (de Lacan à Barthes, en passant par Althusser) n
En reprenant la lecture de Femmes, de Philippe Sollers, je me dis que tout ce brillant sonne souvent creux, et que ce défilé de prénoms féminins reste sans chair, sinon sans traits de vrais personnages romanesques. C’est le bottin demi-mondain des conquêtes du narrateur, assez mal individualisé par rapport à l’auteur (une espèce de double américain pas vraiment crédible), et le tableau d’époque relève de la même projection narcissique, dont les illustres figures (de Lacan à Barthes, en passant par Althusser) n Au Cap d’Agde, Cité du soleil, ce mardi 26 mai. - Partis ce matin de La Désirade vers 11 heures, nous avons dévalé la vallée du Rhône sans trop de stress en dépit de l’allant furieux des poids lourds. Après une nouvelle peu concluante de Timothy Findley, j’ai commencé de nous lire Perfidia, le nouveau pavé de James Ellroy, pas vraiment passionnant non plus. Ensuite grappillé dans un recueil d’essais de Philippe Muray et le dernier opus posthume de Calet évoquant les quartiers de roture parisiens...
Au Cap d’Agde, Cité du soleil, ce mardi 26 mai. - Partis ce matin de La Désirade vers 11 heures, nous avons dévalé la vallée du Rhône sans trop de stress en dépit de l’allant furieux des poids lourds. Après une nouvelle peu concluante de Timothy Findley, j’ai commencé de nous lire Perfidia, le nouveau pavé de James Ellroy, pas vraiment passionnant non plus. Ensuite grappillé dans un recueil d’essais de Philippe Muray et le dernier opus posthume de Calet évoquant les quartiers de roture parisiens... À part quoi la mer et le ciel nous comblent, à notre balcon sur les dunes que nous retrouvons depuis plus de trente ans, naguère avec les enfants et moins d’exhibos, mais toujours tonifiés par la large vision jusqu’à Sète et le bien nommé Mont Clair…
À part quoi la mer et le ciel nous comblent, à notre balcon sur les dunes que nous retrouvons depuis plus de trente ans, naguère avec les enfants et moins d’exhibos, mais toujours tonifiés par la large vision jusqu’à Sète et le bien nommé Mont Clair… La première, Adieu mon frère, évoquant une réunion de famille plombée par la morosité puritaine d’un des frères, est d’une acuité d’observation et d’une justesse, dans la modulation des sentiments doux-acides, qui m’a rappelé les nouvelles d’Alice Munro, même si le ton et le style de Cheever sont tout à fait à lui.
La première, Adieu mon frère, évoquant une réunion de famille plombée par la morosité puritaine d’un des frères, est d’une acuité d’observation et d’une justesse, dans la modulation des sentiments doux-acides, qui m’a rappelé les nouvelles d’Alice Munro, même si le ton et le style de Cheever sont tout à fait à lui. S’il y a du Tchékhov là-dedans, c’est du plus indigné devant l’imbécillité des gens peut-être très intelligents mais sans cœur (on se rappelle L’envie de dormir ou Volodia), et par la façon de John Cheever, comme son aîné russe, de ne jamais s’en tenir à une seule version ou un seul jugement à l’observation de la vie où chacun, d’une façon ou de l’autre, porte une certaine responsabilité. Enfin il y a l’art du narrateur, sans pareil. On comprend que Nabokov, Bellow et Updike aient placé John Cheever au top des écrivains américains de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Flannery O’Connor et Alice Munro, c’est en effet sa place…
S’il y a du Tchékhov là-dedans, c’est du plus indigné devant l’imbécillité des gens peut-être très intelligents mais sans cœur (on se rappelle L’envie de dormir ou Volodia), et par la façon de John Cheever, comme son aîné russe, de ne jamais s’en tenir à une seule version ou un seul jugement à l’observation de la vie où chacun, d’une façon ou de l’autre, porte une certaine responsabilité. Enfin il y a l’art du narrateur, sans pareil. On comprend que Nabokov, Bellow et Updike aient placé John Cheever au top des écrivains américains de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Flannery O’Connor et Alice Munro, c’est en effet sa place… 
 Cap d’Agde, ce lundi 8 juin. – La chaleur se faisant un peu lourde, je ne serai pas fâché, demain, de remonter sur nos hauteurs. Ce qu’attendant je suis allé me balader seul, en fin de matinée, dans la ville haute de Sète écrasée de soleil, au cimetière marin où j’ai salué MM. Paul Valéry et Jean Vilar, en passant par les librairies et une petite escale sur la place où je me suis payé une marmite de moules frites arrosée d’un quart de rouge, tout en lisant quelques pages des Mauvaises pensées de Valéry que j’ai trouvées l’autre jour à Pézenas.
Cap d’Agde, ce lundi 8 juin. – La chaleur se faisant un peu lourde, je ne serai pas fâché, demain, de remonter sur nos hauteurs. Ce qu’attendant je suis allé me balader seul, en fin de matinée, dans la ville haute de Sète écrasée de soleil, au cimetière marin où j’ai salué MM. Paul Valéry et Jean Vilar, en passant par les librairies et une petite escale sur la place où je me suis payé une marmite de moules frites arrosée d’un quart de rouge, tout en lisant quelques pages des Mauvaises pensées de Valéry que j’ai trouvées l’autre jour à Pézenas. Le quatrième livre de Quentin Mouron a l’air d’un roman américain, plus précisément d’un thriller comme il en pullule, plus exactement encore d’un roman noir à résonances littéraires : le Crime et châtiment le Dostoïevski est d’emble cité en exergue, et l’on pense évidemment, en le lisant, à Non, ce pays n’es pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, ne serait-ce que parce que l’un de ses deux protagonistes, shérif,s e nomme Paul McCarthy…
Le quatrième livre de Quentin Mouron a l’air d’un roman américain, plus précisément d’un thriller comme il en pullule, plus exactement encore d’un roman noir à résonances littéraires : le Crime et châtiment le Dostoïevski est d’emble cité en exergue, et l’on pense évidemment, en le lisant, à Non, ce pays n’es pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, ne serait-ce que parce que l’un de ses deux protagonistes, shérif,s e nomme Paul McCarthy…  Ce dimanche 14 juin. –Au cap de mes 68 ans, passé ce matin à 8h.47 (un vaudeville françaiss’intitule Le train de 8h47, m’a rapporté ma mère qui le tenait de son médecin lettré de ce matin-là) , je pense précisément à mes bons parents : à notre père mort à cet âge très précisément, en mars 1983, et à notre mère tombée dans sa salle de bain, vingt ans plus tard, alors qu’elle se préparait crânement, octogénaire vaillante, à descendre à la piscine vu que c’était l’été et qu’il faisait beau.
Ce dimanche 14 juin. –Au cap de mes 68 ans, passé ce matin à 8h.47 (un vaudeville françaiss’intitule Le train de 8h47, m’a rapporté ma mère qui le tenait de son médecin lettré de ce matin-là) , je pense précisément à mes bons parents : à notre père mort à cet âge très précisément, en mars 1983, et à notre mère tombée dans sa salle de bain, vingt ans plus tard, alors qu’elle se préparait crânement, octogénaire vaillante, à descendre à la piscine vu que c’était l’été et qu’il faisait beau.



 À propos des cuistres et de Jacques Mercanton à Pattaya...
À propos des cuistres et de Jacques Mercanton à Pattaya... 