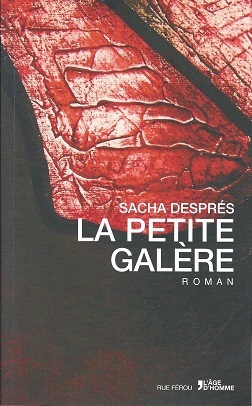
Sacha Després signe, avec La petite galère, un premier roman d’une densité émotionnelle et d’une qualité d’écriture rares. Avec Quentin Mouron, Mélanie Chappuis, Antoine Jaquier, Max Lobe, Dunia Miralles et Julien Bouissoux, notamment, la jeune romancière achoppe à une réalité sociale et psychologique très actuelle en maîtrisant une langue-geste tissée d'oralité.
On ressort sonné de la lecture de La petite galère de Sacha Després, dont le crescendo dramatique aboutit à un dénouement réellement déchirant où réalité brute et folle détresse, violence et désarroi, souffrance incarnée et projections fantasmatiques se bousculent dans une mêlée qui prend aux tripes et au cœur.
Or le plus étonnant est que, d’un imbroglio affectif et psychologique exacerbé par l’abjection d’un des protagonistes – type de pervers narcissique bien cadré -, et par la haine vengeresse qu’il suscite, la romancière parvienne à tenir jusqu’au bout le fil (barbelé) d’un récit concis et cohérent, tout à fait intelligible en dépit de l'ambiante confusion des sentiments.
Très remarquable tableau d’époque, sur fond de crise sociale et de dérives individuelles, La petite galère, qui se déroule dans une Zone Urbaine Sensible de la région parisienne, détaille les tribulations de deux sœurs affectivement et sensuellement fusionnelles (Marie dite La Jolie, née le lendemain de la mort de Claude François, et Laura, sa cadette de seize ans, contemporaine du Club Dorothée…), marquées par le suicide de leur mère et confrontées, avec l’aide minable du chèque mensuel de leur père, à ce qu’on appelle la liberté.
Dès les premières « séquences » du roman, dont la découpe narrative évoque à la fois un storyboard cinématographique et une chronique très habilement agencée et datée par de brèves allusions aux événements du monde, l’écriture de Sacha Despés impressionne par son mélange d’efficacité et de sensibilité délicate, de vigueur et de finesse.
D’un monde présumé inculte, et sans une once de démagogie, elle dégage les mêmes sentiments délicats qu’a évoqués le cinéaste Abdellatif Kechiche dans L’Esquive, merveille de finesse et d’humour, ou encore Germinal Roaux dans Left foot right foot, alors que, littérairement parlant, l’on est ici dans la foulée d’un Olivier Adam ou d’une Virginie Despentes, ou encore d’un Samuel Benchetrit, sans références ni influences explicites au demeurant.
D’un point de vue stylistique, pour la manière très concentrée et souvent poétique de traiter ses très courtes phrases, Sacha Després rappelle aussi les récits noirs d’un Louis Calaferte ou les nouvelles incisive d’une Annie Saumont qui a capté, la première, les tournures de la langue des banlieues.
Là-dessus, il faut parler, en détail, du contenu de ce livre prenant et riche de mille observations pertinentes, parfois unilatéral dans son regard sur le sexe dit fort (tous les hommes du roman rivalisent de nullité), mais dont la rage des personnages féminins se justifie ô combien...
La Prairie
C’est un signe avant-coureur d’humour réjouissant que de voir un lieu tel qu’un grand ensemble bétonné d’une Zone Urbaine Sensible baptisé La Prairie. Bien entendu,le titre de Petite galère, dans le contexte de La Prairie, fait référence implicite à la petite maison de Michael Landon dont les épisodes agrestes réjouirent les téléspectateurs du tournant des années 70-80. Mais je retiens pour ma part l’ironie du nom, comme de voir un asile de vieux baptisé L’étoile du matin. Cerise sur le gâteau : lorsque, après une prise d’otages dans le collège de la cité, la narratrice constate le soir : « La Prairie passe à la télé. »…
Des gens peu « people »
Autant qu’elle a le sens du dialogue, souvent elliptique, Sacha Després a le don de silhouetter un personnage, sans le caricaturer, à quelques exceptions près. Au premier plan : Laura et Marie, leurs parents Caroline et Charles, le prof de français quadra-séduisant Wilder et l’ami de Marie Jacky Branlard, dit Jack.
On est là entre prolos et Français très moyens. Laura, 16ans, portée sur l’écrit perso, est déjà femme dans sa tête et son ventre, avec les infos utile de son aînée Marie, 26ans, barmaid et placeuse à l’Opéra Bastille, qui voulait devenir artiste et, à défaut, se lie à un plasticien bidon avant d’en pincer pour Jack, si « différent ».
De Caroline, employée des PTT et mère à 18 ans, on ne sait pas trop de choses avant son suicide, sinon qu’elle aura été aussi immature et perdue que son plouc de conjoint.
Charles, en effet, genre rocker ringard, n’a « jamais été à l’aise avec les sentiments », et sa seule défense est de traiter sa femme et ses filles de cinglées.
Wilder, première facette du pervers narcissique soft, incarne le prof esthète porté sur la nymphette ou la bourgeoise snob, selon l’occasion.
Jack, second avatar hard du pervers narcissique éduqué à la dure par un militaire et reproduisant la violence dominatrice d’icelui + les excuses hypocrites du dominant à « conscience politique », est à la fois un branleur et un vampire. Du point de vue romanesque, le lascar sort du lot par son abjection.
La story
Culturellement de la génération des consommateurs de films et de séries télévisées, comme un Quentin Mouron, Sacha Després se donne la peine de filer une intrigue qui tienne la route, à la fois dans le synchronique et le diachronique.
Au présent de l’indicatif, la story – prioritairement celle de Laura – détaille une éducation sentimentale et sexuelle qui pourrait être aussi morne qu’un couloir de béton ou convenue qu’une cave à tournantes, mais la romancière corse son récit par de subtils glissements à travers le temps (bien daté par la citation d’événement d’actu précis) et les lieux ou les niveaux de réalité, entre réel glauque et fantasmes ou projections onirico-spirites.
Traversée des banlieues perçues comme un sinistre no woman’s land, le roman emprunte aussi ses codes au conte érotique (à la limite de l'esthétique convenue à mon goût), avec un point de fuite relevant du fantastique, marqué par la figure fantomatique de Clothilde.
En arrière-plan, quelques portraits vivement dessinés : Djamila l’Algérienne qui se débrouille avec quatre enfants et se console dans les bras de Touria, laquelle a fait de la prison pour s’être violemment défendue contre son jules agressif, désormais sur une chaise roulante. La mère bourgeoise de Nelly la rebelle, et celle-ci. Ou Alejandro l’artiste de pseudo-avant-garde, qui réinvente (40 ans après...) le happening sanglant alors que son collègue « découvre » l’art scatophile.
Thèmes
Au départ et au milieu de tout ça, quoi ? Banal au possible : le manque d’amour. Misère affective sur fond de médiocrité culturelle. Quelques petites phrases résument la situation. Au réveillon de ses douze ans, Laura s’entend dire par son père : « Tu sais ma grande, tu as été une erreur, autant que tu le saches ». À 4heures du mat, le 1er janvier 2000 quand les filles retrouvent leur mère suicidée aux médocs : « Caroline ne verra pas l’an 2000 ». Ou pour le couple « incarcéré » par ses enfants : « Ils auront désormais quelque chose à gérer ».
Autre thème : la déglingue sociale. Et pour exemple, l’état du collège, un « foutoir ». Tableau sévère : pp. 52/53. On se rappelle le livre de François Bégaudeau...
Et pour avaler ces arêtes: l’amour et le sexe. Assez miraculeusement, la génération de Youporn reste romantique « au fond », quoique très libre en apparence. Mais en l’occurrence, la « pureté » est du côté des filles, même jugées salopes par les mecs qui en usent. Pour en parler, Sacha Després ne manque pas d’humour. Ainsi quand Laura y va de son blow job dans la loge de l’opéra Bastille : «Le sexe du prof a un gout de cacahuète ». Ou non moins joli : « La bite est brûlante. On pourrait y faire cuire un œuf ».
Dans la foulée, le thème du ressentiment s’exacerbe dès l’apparition de Jack, qui deviendra très moral à proportion de la fermeté de Laura à lui résister. Là s’esquisse un personnage typique de l’époque qui pourrait nourrir tout un roman balzacien sur le simulacre moralisant…
En outre, là-dessous se développe comme une modulation réitérée, en milieu pseudo-libéré, de la guerre des sexes.
Enfin, le triple thème de l’amour, de la folie et de la mort structure les relations de Laura, Marie, Caroline et Clothilde, d’une manière à la fois claire et confuse, s’agissant d’une réalité évidemment impossible à démêler.
De l’oral et à l’écrit
Comme dans le premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, ou comme dans 49, rue de Berne de Max Lobe ou Ils sont tous morts d’Antoine Jaquier, notamment, l’atout majeur de La Petite galère est le langage, et plus exactement une sorte de langue-geste combinant l’oral et l’écrit, sans référence directe à Céline mais bel et bien dans cette filiation intégrant le parler contemporain. Sacha Després n’abuse pas, heureusement,du verlan, mais quand les garçons du collège parlent de Laura, dite Lo, dite biatche, cela donne ça et ça sonne juste et musical. :«Téma la biatche /comme elle béflan grave / j’lui mettrais bien une cartouche à la teuch / j’suis trop en chien de meuf ».
La phrase de Sacha Després, brève et qui claque, vaut aussi par sa concentration de sens et d’émotion. Lorsque Laura considère l’intérieur tendance ethno de Jack l’intello rêvant de gérer le JT, le constat est sans appel :« L’asticot ne fait pas le ménage ».
Mais l’écriture est aussi un thème implicite de la narration, puisque Laura griffonne et que c’est par des lettres érotiques que Marie, à la place de Laura et pour celle-ci, séduit et attire Wilder le lettreux sadien sur les bords.
Bref, La petite galère est un premier roman signalant un vrai talent, et cette chose essentielle pour un écrivain, qu’on pourrait dire un noyau dur et doux à la fois. L’on se gardera, pour autant, de bêler au chef-d’œuvre. Dans un contexte publicitaire écervelant, un tel livre doit être lu au lieu d’être adulé du fait de la jeunesse de son auteur ou de l’actualité de sa thématique. Actuellement, notamment par le fait des réseaux sociaux, la parution d’un roman fait figure de performance sociale ou festive qu’acclament d’innombrables « j’aime », après quoi c’est l’oubli. Nombres de premiers romans, ces dernières années, ont fait pschitt à parution et sont restés, ensuite, sans suite précisément.
Sacha Després vaut mieux que ça, je crois. On lui souhaite d’en « baver grave » sur la suite…
Sacha Després. La Petite galère. L’Âge d’Homme, 194p. 2015

 Cependant Théo se faufilait jusqu’au pied de l’immense toile dont le peintre venait de retoucher le serpent bleu, non sans poursuivre son invective : «L’art, la religion et la boisson, voilà trois trucs qui vous démolissent un pauvre bougre, mais filez donc et pensez plutôt à devenir un Monsieur ! »
Cependant Théo se faufilait jusqu’au pied de l’immense toile dont le peintre venait de retoucher le serpent bleu, non sans poursuivre son invective : «L’art, la religion et la boisson, voilà trois trucs qui vous démolissent un pauvre bougre, mais filez donc et pensez plutôt à devenir un Monsieur ! » 

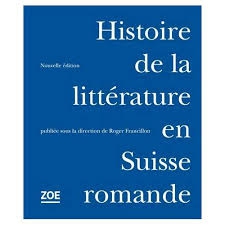

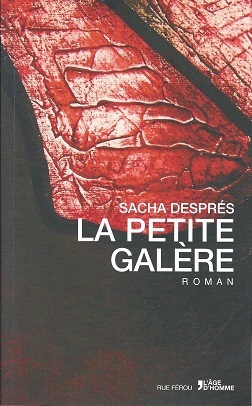

 Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.
Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.  La grande affaire de ce roman est ce qu'on pourrait dire, sans railler, le mystère de l'incarnation. Toutes les conférences, colloques et autres séminaires n'expliqueront jamais ce qui n'est jamais qu'une question d'implication - Costello parle plus exactement d'"incrustation". Or c'est bien plus dans sa rencontre physique avec sa soeur Blanche, religieuse versée dans l'étude du sida en Afrique, que dans les véhéments débats qui les opposent (Blanche ne jure que par la Vérité chrétienne, alors qu'Elizabeth défend l'humanisme de source grecque)que le « mystère » agit. Et le récit "out of record" qu'Elizabeth fait au lecteur, faute d'oser en parler à Blanche, de l'acte (érotique) le plus charitable qu'elle ait jamais commis, pour l'apaisement d'un vieux mourant, "incarne" également une vérité humaine inavouable que l'espace du roman fait résonner, dans la conscience et le coeur du lecteur, comme un aveu faisant valdinguer toutes les « idées ».
La grande affaire de ce roman est ce qu'on pourrait dire, sans railler, le mystère de l'incarnation. Toutes les conférences, colloques et autres séminaires n'expliqueront jamais ce qui n'est jamais qu'une question d'implication - Costello parle plus exactement d'"incrustation". Or c'est bien plus dans sa rencontre physique avec sa soeur Blanche, religieuse versée dans l'étude du sida en Afrique, que dans les véhéments débats qui les opposent (Blanche ne jure que par la Vérité chrétienne, alors qu'Elizabeth défend l'humanisme de source grecque)que le « mystère » agit. Et le récit "out of record" qu'Elizabeth fait au lecteur, faute d'oser en parler à Blanche, de l'acte (érotique) le plus charitable qu'elle ait jamais commis, pour l'apaisement d'un vieux mourant, "incarne" également une vérité humaine inavouable que l'espace du roman fait résonner, dans la conscience et le coeur du lecteur, comme un aveu faisant valdinguer toutes les « idées ».



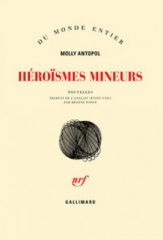 (Cette liste renvoie à la lecture des nouvelles du (magnifique) premier recueil de Molly Antopol, intitulé Héroïsmes mineurs (The Unamericans) et paru récemment chez Gallimard dans la collection Du monde entier)
(Cette liste renvoie à la lecture des nouvelles du (magnifique) premier recueil de Molly Antopol, intitulé Héroïsmes mineurs (The Unamericans) et paru récemment chez Gallimard dans la collection Du monde entier)
 Or, le fait de ne point voir l’oiseau mythique dont les plumes orbnaient le divin Quetzalcoatl, inspirerait précisément les conspirateurs en leur premieère conférence au bord du gouffre où il fut décidé de travailler, désormais et partout, fût-ce dans le plus épais brouillard des circonstances, à la réparation du monde commencée par la restitution, aux choses et aux êtres, de leurs couleurs, à la lutte contre ceux-là, dont un Nitchevo, qui ne voyaient plus que la noirceur de tout, enfin et surtout à la restauration et la préservation d’un temps permettant de voir, de ses simples yeux de mortel, et par exemple du sommet du métaphorique Irrazu, les deux plus grandes mers de l’Atlantico et du Pacifico, et l’entier de la Planète alentour – à réparer elle aussi et peut-être avant tout.
Or, le fait de ne point voir l’oiseau mythique dont les plumes orbnaient le divin Quetzalcoatl, inspirerait précisément les conspirateurs en leur premieère conférence au bord du gouffre où il fut décidé de travailler, désormais et partout, fût-ce dans le plus épais brouillard des circonstances, à la réparation du monde commencée par la restitution, aux choses et aux êtres, de leurs couleurs, à la lutte contre ceux-là, dont un Nitchevo, qui ne voyaient plus que la noirceur de tout, enfin et surtout à la restauration et la préservation d’un temps permettant de voir, de ses simples yeux de mortel, et par exemple du sommet du métaphorique Irrazu, les deux plus grandes mers de l’Atlantico et du Pacifico, et l’entier de la Planète alentour – à réparer elle aussi et peut-être avant tout.
 - Quel est, pour vous, le rapport entre la lecture et l'écriture ?
- Quel est, pour vous, le rapport entre la lecture et l'écriture ?
 Pour l'écriture, j'avais commencé de tenir des carnet en 1965-66 avant et après un voyage en Pologne où, gauchiste déjà déviant, j'ai découvert le socialisme réel et la réalité "pour mémoire" de l'usine à exterminer d'Auschwitz. Puis, à la suite d'un accident de moto, dans la foulée des Autobiographies de Brunon Pomposo de Charles-Albert Cingria, lequel m'avait libéré entretemps du discours marxiste, j'ai écrit un premier récit, en 1973, cristallisant les expérience de ma "folle jeunesse" sous un titre pompeusement romantique tiré de la Sonate d'automne d'Oscar Lubicz-Milosz et suggéré par Dimitri, Ô terrible, terrible jeunesse ! Coeur vide ! En me rappelant ces étapes, je constate que je n'aurai écrit que trois livres en trente ans, avant de passer à la cadence d'au moins un livre sinon deux par an. C'est que, parallèlement, je voyais, en tant que chroniqueur littéraire, les livres inutiles déferler. Or je me pique de n'avoir publié que des livres pour moi marquants, poil aux dents. Donc la lecture et l'écriture seraient deux moments d'une même démarche incluant l'expérience existentielle, l'absorption et l'expression. En perspective cavalière, je constate que mes écrits se partagent entre la chronique continue de mes carnets, deux romans et une vingtaine de nouvelles, plus une kyrielle de proses digressives qui se multiplient à l'envi sur la trame de mes blogs et de Facebook, comme un work in progress sans cesse nourri par de nouvelles lectures, d'autres voyages ou de nouvelles rencontres. Quant à celles-ci, il y en a une seule dont je puisse dire qu'elle a changé ma vie et ce fut celle, un soir dans un bar, de celle que j'appelle ma bonne amie, à qui tous mes livres sont dédiés.
Pour l'écriture, j'avais commencé de tenir des carnet en 1965-66 avant et après un voyage en Pologne où, gauchiste déjà déviant, j'ai découvert le socialisme réel et la réalité "pour mémoire" de l'usine à exterminer d'Auschwitz. Puis, à la suite d'un accident de moto, dans la foulée des Autobiographies de Brunon Pomposo de Charles-Albert Cingria, lequel m'avait libéré entretemps du discours marxiste, j'ai écrit un premier récit, en 1973, cristallisant les expérience de ma "folle jeunesse" sous un titre pompeusement romantique tiré de la Sonate d'automne d'Oscar Lubicz-Milosz et suggéré par Dimitri, Ô terrible, terrible jeunesse ! Coeur vide ! En me rappelant ces étapes, je constate que je n'aurai écrit que trois livres en trente ans, avant de passer à la cadence d'au moins un livre sinon deux par an. C'est que, parallèlement, je voyais, en tant que chroniqueur littéraire, les livres inutiles déferler. Or je me pique de n'avoir publié que des livres pour moi marquants, poil aux dents. Donc la lecture et l'écriture seraient deux moments d'une même démarche incluant l'expérience existentielle, l'absorption et l'expression. En perspective cavalière, je constate que mes écrits se partagent entre la chronique continue de mes carnets, deux romans et une vingtaine de nouvelles, plus une kyrielle de proses digressives qui se multiplient à l'envi sur la trame de mes blogs et de Facebook, comme un work in progress sans cesse nourri par de nouvelles lectures, d'autres voyages ou de nouvelles rencontres. Quant à celles-ci, il y en a une seule dont je puisse dire qu'elle a changé ma vie et ce fut celle, un soir dans un bar, de celle que j'appelle ma bonne amie, à qui tous mes livres sont dédiés.  - Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Quel sens ce travail a-t-il au fond pour vous ?
- Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Quel sens ce travail a-t-il au fond pour vous ? - Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde ?
- Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde ? - Que pensez-vous du temps qui passe et de la mort qui nous sépare des autres et nous rapproche toujours plus de nous-mêmes ?
- Que pensez-vous du temps qui passe et de la mort qui nous sépare des autres et nous rapproche toujours plus de nous-mêmes ?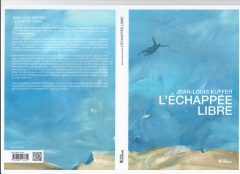
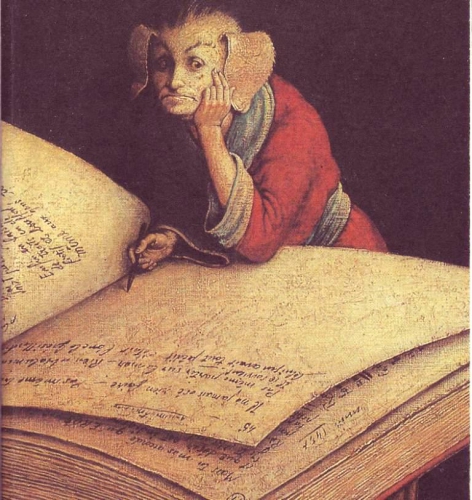




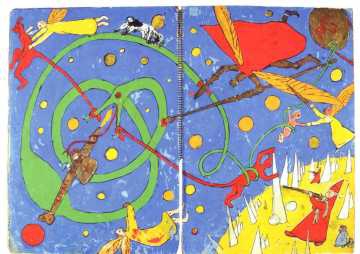



 Sur l
Sur l Sur la littérature: "L'identité française, ensuite, c'est la littérature. Je m'inquiète qu'elle soit de moins en moins enseignée à l'école. Que les fables de La Fontaine ne soient plus apprises aux enfants. Que Les Châtiments de Victor Hugo prennent la poussière. Et je répète là ce que j'ai écrit dans Marianne: si je devais choisir entre la littérature française et la gauche, si la gauche me donnait l'impression de rompre avec cette nourriture essentielle que sont les livres, je choisirais la littérature. Et ce n'est pas un propos de mandarin. J'ai connu un paysan qui n'avait lu qu'un livre dans sa vie, c'était Les Misérables: il était cultivé.
Sur la littérature: "L'identité française, ensuite, c'est la littérature. Je m'inquiète qu'elle soit de moins en moins enseignée à l'école. Que les fables de La Fontaine ne soient plus apprises aux enfants. Que Les Châtiments de Victor Hugo prennent la poussière. Et je répète là ce que j'ai écrit dans Marianne: si je devais choisir entre la littérature française et la gauche, si la gauche me donnait l'impression de rompre avec cette nourriture essentielle que sont les livres, je choisirais la littérature. Et ce n'est pas un propos de mandarin. J'ai connu un paysan qui n'avait lu qu'un livre dans sa vie, c'était Les Misérables: il était cultivé. ur l'ouverture au monde: "Certes, il y a aujord'hui une désolante tendance identitariste qui fait fi de l'ouverture au monde de notre pays. Cette ouverture que la Révolution a consacrée et qui existait déjà avec certains rois de France. Ce "souci du monde" fat aussi parti de notre identité. Il n'empêche: je ne voispas pourquoi la France serait le seul pays à ne pas avoir droit à une identité"...
ur l'ouverture au monde: "Certes, il y a aujord'hui une désolante tendance identitariste qui fait fi de l'ouverture au monde de notre pays. Cette ouverture que la Révolution a consacrée et qui existait déjà avec certains rois de France. Ce "souci du monde" fat aussi parti de notre identité. Il n'empêche: je ne voispas pourquoi la France serait le seul pays à ne pas avoir droit à une identité"... Celui qui traite son épouse Frieda à moitié paralysée mais encore assez lucide, 87 ans au compteur, de vieille tomate / Celle qui prétend avoir tenu ses promesses faites à Dieu Le Fils le jour de sa communion solennelle à l’église catholique Saint-Christophe jouxtant les studios de Radio-Lausanne à la grande époque de l’inspecteur Picoche / Ceux qui font les quatre cents coups dans le pavillon Les Poulains de l’Etablissement médico-social Au Point du jour / Celui qui se rappelle l’odeur croupie des bras du ruisseau de la Vuachère au printemps des écrevisses / Celle qui a serré son trousseau dans une certaine malle qu’elle a déclarée maudite après que sa mère Fernand née Roduit eut éconduit son septième prétendant / Ceux qui en venaient au mains au cinéma Bio au temps des westerns à 50 centimes / Celui qui se rappelle assez exactement le sentiment de délivrance qu’il a éprouvé lorsqu’il a ouvert la cage des treize perruches qu’on lui a offertes pour son neuvième anniversaire coïncidant avec l’arrivée des réfugiés hongrois / Celle qui faisait payer vingt centimes à ses enfants quand leur échappait le moindre merde-chier / Ceux qui logeaient une quinzaine de saisonniers italiens dans les anciens poulaillers du domaine / Celui qui a vu l’incendiaire Gavillet de près quand on l’a emmené menotté et penaud après que les gendarmes l’eurent localisé dans le bois de la Scie sur dénonciation du taupier Jolidon/
Celui qui traite son épouse Frieda à moitié paralysée mais encore assez lucide, 87 ans au compteur, de vieille tomate / Celle qui prétend avoir tenu ses promesses faites à Dieu Le Fils le jour de sa communion solennelle à l’église catholique Saint-Christophe jouxtant les studios de Radio-Lausanne à la grande époque de l’inspecteur Picoche / Ceux qui font les quatre cents coups dans le pavillon Les Poulains de l’Etablissement médico-social Au Point du jour / Celui qui se rappelle l’odeur croupie des bras du ruisseau de la Vuachère au printemps des écrevisses / Celle qui a serré son trousseau dans une certaine malle qu’elle a déclarée maudite après que sa mère Fernand née Roduit eut éconduit son septième prétendant / Ceux qui en venaient au mains au cinéma Bio au temps des westerns à 50 centimes / Celui qui se rappelle assez exactement le sentiment de délivrance qu’il a éprouvé lorsqu’il a ouvert la cage des treize perruches qu’on lui a offertes pour son neuvième anniversaire coïncidant avec l’arrivée des réfugiés hongrois / Celle qui faisait payer vingt centimes à ses enfants quand leur échappait le moindre merde-chier / Ceux qui logeaient une quinzaine de saisonniers italiens dans les anciens poulaillers du domaine / Celui qui a vu l’incendiaire Gavillet de près quand on l’a emmené menotté et penaud après que les gendarmes l’eurent localisé dans le bois de la Scie sur dénonciation du taupier Jolidon/ 







