
Je relève dans Les lignes et les jours, les carnets de Peter Sloterdijk, cette phrase qu’il cite de L’Amant de Lady Chatterley : « We’ve got to live no matter how many skies have fallen », ce que le cher Fred-Roger Cornaz, dont j’ai tellement entendu parler des frasques de dandy décadent, traduit par « Il faut bien que nous vivions, malgré la chute de tant de cieux »…
°°°
À La Désirade, ce jeudi 15 mai 2014. – Une page entière m’est consacrée ce matin dans L’Hebdo, qui souffle le froid et le chaud, sous un titre accrocheur, assez vulgaire, limite injurieux mais bien de l’époque : JLK, feignasse ou génie ? La page est divisée en deux sur la hauteur : d’un côté le coup de pied de l’âne de Julien Burri, qui me faisait récemment des grâces en me demandant mon avis sur son nouveau livre, et de l’autre l’éloge sans partage d’Isabelle Falconnier, parlant de mon livre avec chaleur et reconnaissance. Et qu’en dire ? Surtout ne pas répondre au petit Julien, dont il est assez logique qu’il réduise mon livre à rien faute d’y trouver ce que son narcissisme de fiote creuse y cherche du bout du mufle. Et pour dame Falconnier, la remercier. Reste que je prends tout ça comme si cela ne me concernait pas – comme je me le disais l’autre jour: que je me sens un peu ces temps comme si j’étais déjà « de l’autre côté » ; et je me rappelle que les écrivains que je place le plus haut, tels Charles-Albert Cingria ou Ludwig Hohl, n’ont jamais eu droit de leur vivant au quart de la reconnaissance que, pour ma part, j’ai déjà obtenue.
°°°
 Après les recensions déjà remarquables de Francis Richard et de Sergio Belluz, à propos de L’échappée libre, Jean-Michel Olivier me gratifie d’un véritable feuilleton critique comme on n’en fait plus aujourd’hui, me rappelant le papier magistral consacré par Pierre-Olivier Walser au Viol de l’ange. Surtout me touche son attention réelle. Il pourrait être plus sévère que je ne lui en voudrais aucunement. On me croit parano parce qu’il m’est arrivé de réagir violemment à des critiques suant l’injustice ou l’ineptie, et j’ai été imbécile de répondre,mais je pense, avec l’ami Gripari, qu’une critique négative contient toujours un élément intéressant – et c’est d’ailleurs le cas de celle, récente, de Julien Burri, si injuste et inepte soit-elle - , plus qu’un dithyrambe de complaisance.
Après les recensions déjà remarquables de Francis Richard et de Sergio Belluz, à propos de L’échappée libre, Jean-Michel Olivier me gratifie d’un véritable feuilleton critique comme on n’en fait plus aujourd’hui, me rappelant le papier magistral consacré par Pierre-Olivier Walser au Viol de l’ange. Surtout me touche son attention réelle. Il pourrait être plus sévère que je ne lui en voudrais aucunement. On me croit parano parce qu’il m’est arrivé de réagir violemment à des critiques suant l’injustice ou l’ineptie, et j’ai été imbécile de répondre,mais je pense, avec l’ami Gripari, qu’une critique négative contient toujours un élément intéressant – et c’est d’ailleurs le cas de celle, récente, de Julien Burri, si injuste et inepte soit-elle - , plus qu’un dithyrambe de complaisance.
Ceci dit, comme l’artisan qui estime avoir donné le meilleur de lui-même en fabriquant tel ou tel objet, je suis reconnaissant à JMO de parler, avec la précision d’un lecteur qui est lui-même écrivain et de premier ordre, de mon vingtième livre.
À propos de L’échappée libre, par Jean-Michel Olivier
1. Du journal au carnet
L’entreprise monumentale de Jean-Louis Kuffer, écrivain, journaliste, chroniqueur littéraire à 24Heures, commence avec ses Passions partagées (lectures dumonde 1973-1992), se poursuit avec la magnifique Ambassade du papillon(1993-1999), puis avec ses Chemins de traverse (2000-2005), puis avec ses Riches Heures (2005-2008) pour arriver à cette Échappée libre (2008-2013) qui vient de paraître aux éditions l’Âge d’Homme. Indispensable…
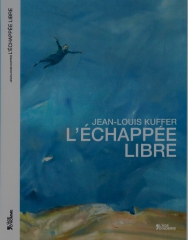 Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens,encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.
Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens,encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.
À la base de tout, il y a les carnets, « ma basse continue, la souche et le tronc d’où relancer tous autres rameaux et ramilles. »
Ces carnets, toujours écrits à l’encre verte et souvent enluminés de dessins ou d’aquarelles, comme les manuscrits du Moyen Âge, qui frappent par leur aspect monumental, sont aussi le meilleur document sur la vie littéraire de ces quarante dernières années : une lecture du monde sans cesse en mouvement et en bouleversement, subjective, passionnée, empathique.
2. Une passion éperdue
Ces carnets se déploient sur plusieurs axes :l ectures, rencontres, voyages, écriture, chant du monde, découvertes.
Les lectures, tout d’abord : unepassion éperdue.
Personne, à ma connaissance, ne peut rivaliser avec JLK (à part, peut-être, Claude Frochaux) dans la gloutonnerie, l’appétit de lecture, la soif de nouveauté, la quête d’une nouvelle voix ou d’une nouvelle plume ! Dans L’Échappée libre, tout commence en douceur, classiquement, si j’ose dire, par Proust et Dostoïevski, qu’encadre l’évocation touchante du père de JLK, puis de sa mère, donnant naissance aux germes d’un beau récit, très proustien, L’Enfant prodigue (paru en 2011aux éditions d’Autre Part de Pascal Rebetez). On le voit tout de suite :l’écriture (ou la littérature) n’est pas séparée de la vie courante : au contraire, elle en est le pain quotidien. Elle nourrit la vie qui la nourrit.
Dans ses lectures, JLK ne cherche pas la connivence ou l’identité de vues avec l’auteur qu’il lit, plume en main, et commente scrupuleusement dans ses carnets, mais la correspondance. C’est ce qu’il trouve chez Dostoiëvski, comme chez Witkiewicz, chez Thierry Vernet comme chez Houellebecq ou Sollers (parfois). Souvent, il trouve cette correspondance chez un peintre, comme Nicolas de Stäël, par exemple.
Ou encore, au sens propre du terme, dans les lettres échangées avec Pascal Janovjak, jeune écrivain installé à Ramallah, en Palestine. La correspondance, ici, suppose la distance et l’absence de l’autre — à l’origine, peut-être, de toute écriture.
De la Désirade, d’où il a une vue plongeante sur le lac et les montagnes de Savoie, JLK scrute le monde à travers ses lectures. Il lit et relit sans cesse ses livres de chevet, en quête d’unsens à construire, d’une couleur à trouver, d’une musique à jouer. Car il y adans ses carnets des passages purement musicaux où les mots chantent la beautédu monde ou la chaleur de l’amitié.
Un exemple parmi cent : « Donc tout passe et pourtant je m’accroche, j’en rêve encore, je n’ai jamais décroché : je rajeunis d’ailleurs à vue d’œil quand me vient une phrase bien bandante et sanglée et cinglante — et c’est reparti pour un Rigodon. On ergote sur le style, mais je demande à voir : je demande à le vivre et le revivre à tout moment ressuscité, vu que c’est par là que la mémoire revit et ressuscite — c’est affaire de souffle et de rythme et de ligne et de galbe, enfin de tout ce qu’on appelle musique et qui danse et qui pense. »
 3.Aller à la rencontre
3.Aller à la rencontre
Lire, c’est aller à la rencontre de l’autre. Peu importent sa voix ou son visage, que la plupart dutemps nous ne connaissons pas. Les mots que nous lisons dessinent un corps, unregard singulier, une présence qui s’imposent à nous au fil des pages. Et laplupart du temps, c’est suffisant…
Mais JLK est un homme curieux. Il dévore les livres, toujours en quête de nouvelles voix, passe son temps à s’expliquer avec ces fantômes vivants que sont les écrivains.Souvent, il veut aller plus loin. C’est ainsi qu’il part à la rencontre du cinéaste Alain Cavalier ou du poète italien Guido Ceronetti. Et la rencontre, à chaque fois, est un miracle. Correspondance à nouveau. Porosité des êtres qui se comprennent sans se vampiriser. JLK n’a pas son pareil pour nous faire partager, par l’écriture, ces moments de grâce.
Dans L’Ambassade dupapillon et dans Passions partagées, il y avait les figures puissantes (et parfois envahissantes) de Maître Jacques (Chessex) et de Dimitri (l’éditeur Vladimir Dimitrijevic), deux personnages centraux de la vie littéraire de Suisse romande. L’Échappée libre s’ouvre sur lesretrouvailles avec Dimitri, l’ami perdu pendant quinze ans.Retrouvailles à la fois émotionnelles et difficiles, ndant quinze ans.
Retrouvailles à la fois émotionnelles et difficiles, car le temps n’efface pas les blessures. Pourtant,JLK ne ferme jamais la porte aux amis d’autrefois et le pardon trouvetoujours grâce à ses yeux. Brèves retrouvailles, puisque Dimitri se tuera dansun accident de voiture en 2011 avant que JLK ait pu vraiment s’expliquer aveclui. Mais pouvait-on s’expliquer avec le vif-argent Dimitri, dont la mort futaussi dramatique que sa vie fut aventureuse ?
D’autres morts jalonnent L’Échappéel ibre : Maurice Chappaz, Jean Vuilleumier, Gaston Cherpillod, GeorgesHaldas. Un âge d’or de la littérature romande. À ce propos, les hommages queJLK rend à ces grands écrivains (trop vite oubliés) sont remarquables par leurérudition, leur sensibilité et leur intelligence. Et toujours cette empathiepour l’homme et l’œuvre, à ses yeux indissociables.
4. Les secousses du voyage
 Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu(il est trop attaché à son nid d’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à la main. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie,congrès sur la francophonie au Congo, voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade enTunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyage pour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres…
Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu(il est trop attaché à son nid d’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à la main. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie,congrès sur la francophonie au Congo, voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade enTunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyage pour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres…
Chaque voyage provoque des secousses et des bouleversements, et JLK n’en revient pas indemne.
En allant au Portugal, par exemple, JLK seplonge dans un roman suisse à succès, Train de nuit pour Lisbonne dePascal Mercier, qui lui ouvre littéralement les portes de la ville.
 Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité.
Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité.
Au retour, « le cœur léger, mais la carcasse un peu pesante », son escapade lusitanienne lui aura redonné le goût(et la force) de se mettre à sa table de travail. Car JLK travaille comme un nègre. Carnets, chroniques, « fusées » ou « épiphanies » à la manière de Joyce.Mais aussi le roman, toujours en chantier, le grand roman de la mémoire et de l’enfance qui hante l’auteur depuis toujours.
« La mémoire de l’enfance est une étrangemachine, qui diffuse si longtemps et si profondément, tant d’années après etcomme en crescendo, à partir de faits bien minimes, tant d’images et desentiments se constituant en légendes et se parant de quelle aura poétique. Moiqui regimbais, qui n’aimais guère ces séjours chez ces vieilles gens austères de Lucerne, qui m’ennuyais si terriblement lorsque je me retrouvais seul dansce pays ont je refusais d’apprendre la langue affreuse, c’est bien là-bas quej’ai puisé la matière première d’une espèce de géopoétique qui m’attache enprofondeur à cette Suisse dont par tant d’autres aspects je me sens étranger,voire hostile. »
Ce grand livre de la mémoire et des 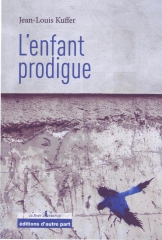 premières émotions, JLK le remet plusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuseou tourmentée, exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également les péripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité.
premières émotions, JLK le remet plusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuseou tourmentée, exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également les péripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité.
À ce propos, JLK rend compte avec justesse des livres, souvent remarquables, qui, pour une raison obscure, passent à côtéde leur époque. Claude Delarue et son Bel obèse, par exemple. Ou lesromand d’Alain Gerber. Ou même la poésie cristalline d’un Maurice Chappaz. Sansparler d’un Vuilleumier doux-amer. Ou d’un Charles-Albert Cingria, trop peu lu, qui reste pour JLK une figure tutélaire : le patron.
5. Suite et fin
Cette brève plongée dans L’Échappée libre serait très incomplète si je ne mentionnais l’insatiable curiosité de l’auteur, vampireavéré, pour les nouvelles voix de la littérature — et en particulier la littérature romande.
Même s’il n’est pas le premier à découvrir le talent de Quentin Mouron, il est tout de suite impressionné par cette écriture qui frappe au cœur et aux tripes dans son premier roman Au point d’effusion des égouts. Oui, c’est un écrivain, dont on peut attendre beaucoup. De même, il vantera bien vite les mérites d’un faux polar, très bien construit, qui connaîtra un certain succès : La Vérité surl ’affaire Harry Québert, d’un jeune Genevois de 27 ans, Joël Dicker.JLK aime allumer les mèches de bombes à retardement qui parfois font beaucoupde bruit…
On peut citer encore d’autres auteurs que JLK décrypte et célèbre à sa manière : Jérôme Meizoz, Douna Loup ou encore Max Lobe, extraordinaire conteur des sagas africaines
Toujours à l’affût, JLK est le contraire des éteignoirs qui règnent dans la presse romande, prompts à étouffer toute étincelle, tout début d’enthousiasme, et qui sévissent dans Le Temps ou dans les radios publiques. Même s’il se fait traiter de « fainéant » par un journaliste de L’Hebdo (comment peut-on écrire une ânerie pareille ?), JLK demeure la mémoire vivante de la littérature de ce pays, une mémoire sélective, certes, partiale, toujours guidée par sa passion des nouvelles voix, mais une mémoire singulière, jalouse de son indépendante.
Si cette belle Échappée libre s’ouvrait sur l’évocation du père et de la mère de l’auteur (sans oublier la marraine de Lucerne, berceau de la mémoire) et les retrouvailles émouvantes avec le barbare Dimitri, le livre s’achève sur la venue des anges. Une cohorte d’anges.
 Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce. Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.
Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce. Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.
Lire le monde, dans ses énigmes et sa splendeur,pour le comprendre et le faire partager, telle est l’ambition de JLK. Cela veut dire aussi : trouver sa place et son bonheur non seulement dans les livres (on est très loin, ici, d’une quelconque Tour d’Ivoire), mais dans le monde réel,les temps qui courent, l’amour de sa bonne amie et de ses filles. Et les livres, quelquefois, nous aident à trouver notre place…
L’Échappée libre commence le premier jour de l’an 2008 ; et il s’achève le 30 juin 2013. Évocation des morts au commencement du livre et adresse aux vivants à la fin sous la forme d’une prière à « l’enfant qui vient ». Cet enfant a le visage malicieux de Declan, fils d’Andonia Dimitrijevic et petit-fils de Vladimir. C’est un enfant porteur de joie — l’ange qu’annonçait la fin du livre. « Tu vas nous apprendre beaucoup, l’enfant, sans t’en douter, Ta joie a été la nôtre, dès ton premier sourire, et mourir sera plus facile de te savoir en vie. »
Toujours, chez JLK, ce désir de transmettre le feu sacré des livres !
Chaque livre est une Odyssée qui raconte les déboires et les mille détours d’un homme exilé de chez lui et enquête d’une patrie — qui est la langue. L’Échappée libre explore lemonde et le déchiffre comme si c’était un livre. L’auteur part de la Désirade pour mieux y revenir, comme Ulysse, après tant de pérégrinations, retrouve Ithaque.
Il y a du pèlerin chez JLK, chercheur de sens comme on dit chercheurd’or. Une quête jamais achevée. Un Graal à trouver dans les livres, mais aussi dans le monde dont la beauté nous brûle les yeux à chaque instant.
°°°
Paul Léautaud : « Il m’arrive de me dire, de certaines choses que j’écris : Mais ce n’est pas mal du tout ! » en éclatant de rire. »

 Venezia, sulle Zattere, stamattina del 21 novembre, alle 7:30. - "Encore une journée divine !" s'exclame la vieille peau du vieux Sam se sortant de sa vieille poubelle, et la sphère orange sort là-bas du toit d'un palazzo, entre Saint Marc et le Rédempteur, tandis qu'il cloche partout à toute volée. À la station Santo Spirito du vaporetto, la balle orange a rebondi dans un reflet que je retrouve ensuite dans une flaque, par delà laquelle une jeune fille en noir ondule sur place en son taï-chi, qui me rappelle aussitôt Lady L. et ses filles à leur cérémonial du mercredi soir. Miss you Lady Mine, would be cool to be two but we'll come back soon my Bijou. Et voici donc le plus bel endroit de l'univers où affluent les fidèles et leurs cierges bientôt plantés ensemble tandis qu'une main de prêtre, juste visible au portillon du confessionnal, exprime le calme de celui qui en vu d'autres et tient les clés du pardon. Comme une pancarte ordonne NO FLASH, mon image sera floue. Tant pis: je capte. Et la lumière des cierges me suffira pour les jeunes gens qu'il y a là, style Maveric mon occulte ami des Vosges en ses candides seize ans. Quoi de plus neuf ce matin que cette vieille nef à voiles arrimée au quai de la Dogana ? Le médium Joyaux, alias Sollers, a mille fois raison: c'est ici que le neuf commence. "La plupart de mes livres, qui ne sont ni d'un "historien" ni d'un "esthète", ni d'un "écrivain à court de sujet",et encore moins d'un adepte du tourisme, des expositions, des congrès internationaux et du dispositif industriel d'exploitation, le disent.En réalité, on s'en apercevra un jour, le nouveau est là".
Venezia, sulle Zattere, stamattina del 21 novembre, alle 7:30. - "Encore une journée divine !" s'exclame la vieille peau du vieux Sam se sortant de sa vieille poubelle, et la sphère orange sort là-bas du toit d'un palazzo, entre Saint Marc et le Rédempteur, tandis qu'il cloche partout à toute volée. À la station Santo Spirito du vaporetto, la balle orange a rebondi dans un reflet que je retrouve ensuite dans une flaque, par delà laquelle une jeune fille en noir ondule sur place en son taï-chi, qui me rappelle aussitôt Lady L. et ses filles à leur cérémonial du mercredi soir. Miss you Lady Mine, would be cool to be two but we'll come back soon my Bijou. Et voici donc le plus bel endroit de l'univers où affluent les fidèles et leurs cierges bientôt plantés ensemble tandis qu'une main de prêtre, juste visible au portillon du confessionnal, exprime le calme de celui qui en vu d'autres et tient les clés du pardon. Comme une pancarte ordonne NO FLASH, mon image sera floue. Tant pis: je capte. Et la lumière des cierges me suffira pour les jeunes gens qu'il y a là, style Maveric mon occulte ami des Vosges en ses candides seize ans. Quoi de plus neuf ce matin que cette vieille nef à voiles arrimée au quai de la Dogana ? Le médium Joyaux, alias Sollers, a mille fois raison: c'est ici que le neuf commence. "La plupart de mes livres, qui ne sont ni d'un "historien" ni d'un "esthète", ni d'un "écrivain à court de sujet",et encore moins d'un adepte du tourisme, des expositions, des congrès internationaux et du dispositif industriel d'exploitation, le disent.En réalité, on s'en apercevra un jour, le nouveau est là".




 e n'y avais pas pensé mais le personnage de Théo, l'artiste amstellodamois de mon roman en chantier, doit quelque chose à la fois à Thierry et au vieux Monod. Ces huguenots chrétiens, mécréants au sens conventionnel des bien-pensants, sont de mon Shadow Cabinet, autant qu'Annie Dillard et qu'Alice Munro mes frangines occultes. J'essaie, dans La vie des gens, d'évoquer la quête d'immunité de quelques personnages non résignés au pire. Contre la fausse parole omniprésente, j'essaie de dire ce qui pourra toujours l'être, à la lumière d'un amour non sentimental. Le corps massacré du poète Pier Paolo Pasolini a été retrouvé un matin de novembre de l'an 1975, donc il y aura bientôt quarante ans de ça, et ce matin je lisais un de ses poèmes, qui lui survit.
e n'y avais pas pensé mais le personnage de Théo, l'artiste amstellodamois de mon roman en chantier, doit quelque chose à la fois à Thierry et au vieux Monod. Ces huguenots chrétiens, mécréants au sens conventionnel des bien-pensants, sont de mon Shadow Cabinet, autant qu'Annie Dillard et qu'Alice Munro mes frangines occultes. J'essaie, dans La vie des gens, d'évoquer la quête d'immunité de quelques personnages non résignés au pire. Contre la fausse parole omniprésente, j'essaie de dire ce qui pourra toujours l'être, à la lumière d'un amour non sentimental. Le corps massacré du poète Pier Paolo Pasolini a été retrouvé un matin de novembre de l'an 1975, donc il y aura bientôt quarante ans de ça, et ce matin je lisais un de ses poèmes, qui lui survit. Pier Paolo Pasolini: "Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli". Eppoi: "Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques".
Pier Paolo Pasolini: "Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli". Eppoi: "Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques". 
 En reprenant la lecture de La Trinité bantoue, dont le titre fait allusion à trois instances divines de la cuture camerounaise (le Créateur Nzambé, Elômlombi le dieu des esprits qui plânent sur nos âmes, et les Bankôko figurant nos ancêtres), je me suis rappelé les deux témoignages également révélateurs du prêtre ami de Pasolini et de l'interprète de Jésus, quarante ans après le tournage de L'Evangile selon Matteo, à propos des rapports très particuliers entretenus par l'écrivain-cinéaste avec la religion chrétienne, le Christ ou l'Eglise. Pour son ami prêtre, il est impensable que Pasolini soit réellement mécréant, contrairement à ce qu'il a dit aux journalistes. Or Pasolini le lui a dit clairement aussi: que les journalistes ne devraient pas poser certaines questions. De la même façon, il semble impensable que le jeune Catalan engagé par Pasolini pour incarner le Christ, militant anti-franquiste de 19 ans qui n'avait aucune envie de jouer cette comédie, ait vécu cette expérience sans y engager de son âme. À vrai dire, tous les visages apparaissant dans le Vangolo secondo Matteo semblent touchés par la grâce, à l'opposé diamétral des romances hollywoodiennes avec Jésus blonds aux aisselles épilées.
En reprenant la lecture de La Trinité bantoue, dont le titre fait allusion à trois instances divines de la cuture camerounaise (le Créateur Nzambé, Elômlombi le dieu des esprits qui plânent sur nos âmes, et les Bankôko figurant nos ancêtres), je me suis rappelé les deux témoignages également révélateurs du prêtre ami de Pasolini et de l'interprète de Jésus, quarante ans après le tournage de L'Evangile selon Matteo, à propos des rapports très particuliers entretenus par l'écrivain-cinéaste avec la religion chrétienne, le Christ ou l'Eglise. Pour son ami prêtre, il est impensable que Pasolini soit réellement mécréant, contrairement à ce qu'il a dit aux journalistes. Or Pasolini le lui a dit clairement aussi: que les journalistes ne devraient pas poser certaines questions. De la même façon, il semble impensable que le jeune Catalan engagé par Pasolini pour incarner le Christ, militant anti-franquiste de 19 ans qui n'avait aucune envie de jouer cette comédie, ait vécu cette expérience sans y engager de son âme. À vrai dire, tous les visages apparaissant dans le Vangolo secondo Matteo semblent touchés par la grâce, à l'opposé diamétral des romances hollywoodiennes avec Jésus blonds aux aisselles épilées. Celui qui n'a qu'un masque de chair et pour plus très longtemps en termes d'années-lumière / Celle qui a mangé son masque de laitues avec le reste du mascarpone / Ceux qui ont rencontré l'âme soeur au carnaval de Venise et son frère au Tyrol mais pas la même année / Celui qui durant le tournage de La mort à Venise conduisait le corbillard de secours au cas où / Celle qui apprend que le modèle du Tadzio de La mort à Venise était un liftier de l'hôtel Baur au Lac de Zurich dont le vieillissant Thomas Mann s'était entiché à l'insu de sa Frau Doktor qui pensait surtout à l'époque aux obligations vestimentaires d'une épouse de Nobel de littérature / Ceux qui n'ont pas vu venir la mort à Venise ni ailleurs d'aillleurs / Celui qui milite pour l'élargissement des trottoirs de son bourg en sorte de faciliter les rencontres entre générations / Celle qui demande à Jean-Patrick de ne rien lui "celer" au point que ce garçon de bon sens se demande ce que ça cache / Ceux qui ont démasqué le pervers au bonnet de nuit bleu clair à pompon louche / Celle qui porte un masque en tête de gondole au goûter d'anniversaire d'Amélie Nothomb / Ceux qui demandent un rabais au gondolier demi-sang / Celui qui prétend que la Venise du Nord seule pouvait être propice à l'éclosion du génie de Spinoza sinon ça se saurait / Celle que Régis Debray appelle "ma dulcinée" dans son pamphlet contre Venise et qui y est revenue à l'insu du vieux raseur pour un gondolier qui assure / Ceux qui ont la peau à fleur de masque et des os dessous qui crameront comme tout le reste destiné à se trouver recueilli dans une urne sur le piano de famille qui lui ne prend pas une ride, etc.
Celui qui n'a qu'un masque de chair et pour plus très longtemps en termes d'années-lumière / Celle qui a mangé son masque de laitues avec le reste du mascarpone / Ceux qui ont rencontré l'âme soeur au carnaval de Venise et son frère au Tyrol mais pas la même année / Celui qui durant le tournage de La mort à Venise conduisait le corbillard de secours au cas où / Celle qui apprend que le modèle du Tadzio de La mort à Venise était un liftier de l'hôtel Baur au Lac de Zurich dont le vieillissant Thomas Mann s'était entiché à l'insu de sa Frau Doktor qui pensait surtout à l'époque aux obligations vestimentaires d'une épouse de Nobel de littérature / Ceux qui n'ont pas vu venir la mort à Venise ni ailleurs d'aillleurs / Celui qui milite pour l'élargissement des trottoirs de son bourg en sorte de faciliter les rencontres entre générations / Celle qui demande à Jean-Patrick de ne rien lui "celer" au point que ce garçon de bon sens se demande ce que ça cache / Ceux qui ont démasqué le pervers au bonnet de nuit bleu clair à pompon louche / Celle qui porte un masque en tête de gondole au goûter d'anniversaire d'Amélie Nothomb / Ceux qui demandent un rabais au gondolier demi-sang / Celui qui prétend que la Venise du Nord seule pouvait être propice à l'éclosion du génie de Spinoza sinon ça se saurait / Celle que Régis Debray appelle "ma dulcinée" dans son pamphlet contre Venise et qui y est revenue à l'insu du vieux raseur pour un gondolier qui assure / Ceux qui ont la peau à fleur de masque et des os dessous qui crameront comme tout le reste destiné à se trouver recueilli dans une urne sur le piano de famille qui lui ne prend pas une ride, etc.  Alla Calcina delle Zattere, Venezia, lunedì 19 novembre 2014. - Dappertutto quelle maschere ! Mi sveglio col sentimento amaro del vuoto senza viso di quelle maschere nella Città deserta, senza più alcun popolo suo. Masques de rien ni personne. Mille boutiques de masques sans âme. La Merveille est partout mais gangrenée, aux lieux d'afflux, par ce kitsch odieux, les visages de vrais Vénitiens chassés de la scène dans les coulisses ou les arrière-cours où sèche encore un peu de linge, passé le premier Sottoportego - surpris le saint silence de telle petite corte della Pelle...
Alla Calcina delle Zattere, Venezia, lunedì 19 novembre 2014. - Dappertutto quelle maschere ! Mi sveglio col sentimento amaro del vuoto senza viso di quelle maschere nella Città deserta, senza più alcun popolo suo. Masques de rien ni personne. Mille boutiques de masques sans âme. La Merveille est partout mais gangrenée, aux lieux d'afflux, par ce kitsch odieux, les visages de vrais Vénitiens chassés de la scène dans les coulisses ou les arrière-cours où sèche encore un peu de linge, passé le premier Sottoportego - surpris le saint silence de telle petite corte della Pelle... En fin de matinée dominicale, hier, les immenses salles de l'Accademia étaient à peu près vides, dont les jeunes gardiens semblaient s'ennuyer gravement. Pour ma part, j'aurais pu me réjouir de me retrouver seul devant La Tempête, et seul ensuite ou presque en compagnie de La Vecchia portant son billet de passage estampillé Col tempo, seul avec la fringant jeune homme rêveur de Giorgione me faisant si fort penser aux personnages de Rembrandt, autant que la mère à l'enfant me fixant de l'autre bout de la nuit des siècles (1476-77) mais non: j'étais un peu triste de voir si peu de gens là autour, et personne devant les beautés saintes de Bellini.
En fin de matinée dominicale, hier, les immenses salles de l'Accademia étaient à peu près vides, dont les jeunes gardiens semblaient s'ennuyer gravement. Pour ma part, j'aurais pu me réjouir de me retrouver seul devant La Tempête, et seul ensuite ou presque en compagnie de La Vecchia portant son billet de passage estampillé Col tempo, seul avec la fringant jeune homme rêveur de Giorgione me faisant si fort penser aux personnages de Rembrandt, autant que la mère à l'enfant me fixant de l'autre bout de la nuit des siècles (1476-77) mais non: j'étais un peu triste de voir si peu de gens là autour, et personne devant les beautés saintes de Bellini.


 Thierry Vernet: "Aux gens normaux le miracle est interdit". Ou ceci pour la route: "Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d'autant et probablement plus de sa laideur".
Thierry Vernet: "Aux gens normaux le miracle est interdit". Ou ceci pour la route: "Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d'autant et probablement plus de sa laideur". 


 Ce mercredi 5 novembre.– La lecture tôt l’aube des Tessons de Jean Prod’hom, combinant des images de ces petits débris d’objets - parfois ornés de fines enluminures résultant du travail de l’eau et du sable -, et de brèves proses faisant écho à ces trouvailles en les situant dans la suite des jours et autres séjours – notamment en Bretagne côtière -, m’a enchanté ce matin. J’ai beau me défier de plus en plus d’un certain minimalisme esthétisant, dans le magasin de porcelaine duquel je rue d’ailleurs dès lepremier chapitre de mon roman en chantier : ce petit recueil aux fines et belles images procède d’une démarche de mémoire qui remonte à nos enfances de petits explorateurs sauvageons le long des berges des rivières (la Vuachère de notre quartier, remontée du lac à ses sources forestière, en passant par un long égout souterrain en pleine ville ) et de nos premiers rivages marins. Le tesson est ce qu’on pourrait dire le débris d’un objet de culture peaufiné par la nature. Il se distingue du galet ou de la boucle d’oreille ensablée : c’est un fragment de quelque chose d’autre et qui garde parfois une bribe de motif peint ou d’inscription, d’où le mystère et le charme. Le plus bel exemple à mes yeux est celui du tesson de Jean Prod’hom porteur d’une aile de papillon. Son image rejoint celle du petit Argus bleu sous minuscule enveloppe de papier de soie que Nabokov a confié à mon ami Reynald peu avant sa mort et que Reynald, mon plus cher ami de jeunese, m’a confié avant la sienne…
Ce mercredi 5 novembre.– La lecture tôt l’aube des Tessons de Jean Prod’hom, combinant des images de ces petits débris d’objets - parfois ornés de fines enluminures résultant du travail de l’eau et du sable -, et de brèves proses faisant écho à ces trouvailles en les situant dans la suite des jours et autres séjours – notamment en Bretagne côtière -, m’a enchanté ce matin. J’ai beau me défier de plus en plus d’un certain minimalisme esthétisant, dans le magasin de porcelaine duquel je rue d’ailleurs dès lepremier chapitre de mon roman en chantier : ce petit recueil aux fines et belles images procède d’une démarche de mémoire qui remonte à nos enfances de petits explorateurs sauvageons le long des berges des rivières (la Vuachère de notre quartier, remontée du lac à ses sources forestière, en passant par un long égout souterrain en pleine ville ) et de nos premiers rivages marins. Le tesson est ce qu’on pourrait dire le débris d’un objet de culture peaufiné par la nature. Il se distingue du galet ou de la boucle d’oreille ensablée : c’est un fragment de quelque chose d’autre et qui garde parfois une bribe de motif peint ou d’inscription, d’où le mystère et le charme. Le plus bel exemple à mes yeux est celui du tesson de Jean Prod’hom porteur d’une aile de papillon. Son image rejoint celle du petit Argus bleu sous minuscule enveloppe de papier de soie que Nabokov a confié à mon ami Reynald peu avant sa mort et que Reynald, mon plus cher ami de jeunese, m’a confié avant la sienne…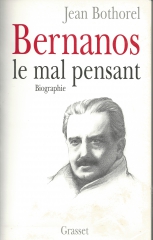 Je ne connaissais pas bien, jusque-là, la vie de Georges Bernanos, dont je n’ai lu que quelques-uns des livres, tel le vertigineux Monsieur Ouine. C’est donc avec une attention nouvelle que j’ai entrepris, parallèlement à la lecture de Pas pleurer de Lydie Salvayre, dont une ligne de la narration suit la composition des Grands cimetières sous lalune, durant l’année 1936 que l’écrivain a passée à Palma de Majorque, celle de Bernanos le mal pensant de Jean Bothorel, qui m’intéresse au plus haut point à la fois pour la matière existentielle traitée et par l’équanimité chaleureuse du biographe. Le jeune Bernanos est issu de la France bourgeoise chauvine et antisémite par tradition catholique, mais ce qui apparaît avec les années est le caractère farouchement indépendant du lascar, qui va conquérir et tenir une position à égale distance de la droite et de la gauche, marquée par le choc terrible de la guerre civile dont il a vu les atrocités commises par ceux de son camp.
Je ne connaissais pas bien, jusque-là, la vie de Georges Bernanos, dont je n’ai lu que quelques-uns des livres, tel le vertigineux Monsieur Ouine. C’est donc avec une attention nouvelle que j’ai entrepris, parallèlement à la lecture de Pas pleurer de Lydie Salvayre, dont une ligne de la narration suit la composition des Grands cimetières sous lalune, durant l’année 1936 que l’écrivain a passée à Palma de Majorque, celle de Bernanos le mal pensant de Jean Bothorel, qui m’intéresse au plus haut point à la fois pour la matière existentielle traitée et par l’équanimité chaleureuse du biographe. Le jeune Bernanos est issu de la France bourgeoise chauvine et antisémite par tradition catholique, mais ce qui apparaît avec les années est le caractère farouchement indépendant du lascar, qui va conquérir et tenir une position à égale distance de la droite et de la gauche, marquée par le choc terrible de la guerre civile dont il a vu les atrocités commises par ceux de son camp. Ce vendredi 7 novembre. – La cérémonie du mariage civil, en fin de matinée à l’Hotel de Ville, s’est passée dans les formes mais sans aucune rigidité officielle, aux ordre d’une officière aussi sexy que sympa. Nos mariés étaient arrivés à la Palud à bord d’une superbe Citroën 11 CV grise évoquant les belles années des gangsters de cinéma, aucun détail du décorum n’avait été négligé, y compris la façade fleurie de l’Hôtelde Ville, la photographe s’est montrée superpro et le repas à l’italienne qui a suivi ne nous a pas moins comblés. Moi qui suis aussi peu mariages qu’enterrements, je ne me suis pas senti mal dans ma jacket signée Ralph Lauren et mes pompes Sanmarino, et tout le monde avait l’air heureux.
Ce vendredi 7 novembre. – La cérémonie du mariage civil, en fin de matinée à l’Hotel de Ville, s’est passée dans les formes mais sans aucune rigidité officielle, aux ordre d’une officière aussi sexy que sympa. Nos mariés étaient arrivés à la Palud à bord d’une superbe Citroën 11 CV grise évoquant les belles années des gangsters de cinéma, aucun détail du décorum n’avait été négligé, y compris la façade fleurie de l’Hôtelde Ville, la photographe s’est montrée superpro et le repas à l’italienne qui a suivi ne nous a pas moins comblés. Moi qui suis aussi peu mariages qu’enterrements, je ne me suis pas senti mal dans ma jacket signée Ralph Lauren et mes pompes Sanmarino, et tout le monde avait l’air heureux. 
 ux qui ont laissé les mers et les océans faire la vaisselle du monde / Celui qui déchiffre la calligraphie des débris de tempêtes / Celle qui constate que ce tesson de céramique précolombienne trouvé à Puntanares provient de la même pièce que celle qu’elle a trouvée une autre année non loin de là / Ceux qui se demandent si le terme de tesson convient aux cailloux de mémoire du Grand Poucet/ Celui qui fait le ménage genre océan qui déménage / Celle qui fait collection des grands pierres roses ou bleues des bords du Rhin vers Bad Ragaz mais on garde le secret et n’en ramasse que la nuit c’est promis / Ceux qui disent « trop beau » avant de relancer à l’eau ces débris de trop de beauté/ Celui qui te dit j’vois pas ce que tu trouves à ce bout de porcelaine de pot de chambre dont l’entier vaudrait même rien sur le marché / Celle qui n’a pas sa langue dans sa poche mais un ravissant bijou de pierre lunaire sculpté par la mer des Caraïbes artiste à ses heures / Ceux qui se taisent devant le bleu de fleur bleue d’un fragment de probable théière genre Meissen de la bonne époque / Celui qui demande à Sylvain quel tesson il ramène des rives de la Volga / Celle qui te dit en joual que t’es son chum / Ceux qui font valoir leur droit de bris, etc.
ux qui ont laissé les mers et les océans faire la vaisselle du monde / Celui qui déchiffre la calligraphie des débris de tempêtes / Celle qui constate que ce tesson de céramique précolombienne trouvé à Puntanares provient de la même pièce que celle qu’elle a trouvée une autre année non loin de là / Ceux qui se demandent si le terme de tesson convient aux cailloux de mémoire du Grand Poucet/ Celui qui fait le ménage genre océan qui déménage / Celle qui fait collection des grands pierres roses ou bleues des bords du Rhin vers Bad Ragaz mais on garde le secret et n’en ramasse que la nuit c’est promis / Ceux qui disent « trop beau » avant de relancer à l’eau ces débris de trop de beauté/ Celui qui te dit j’vois pas ce que tu trouves à ce bout de porcelaine de pot de chambre dont l’entier vaudrait même rien sur le marché / Celle qui n’a pas sa langue dans sa poche mais un ravissant bijou de pierre lunaire sculpté par la mer des Caraïbes artiste à ses heures / Ceux qui se taisent devant le bleu de fleur bleue d’un fragment de probable théière genre Meissen de la bonne époque / Celui qui demande à Sylvain quel tesson il ramène des rives de la Volga / Celle qui te dit en joual que t’es son chum / Ceux qui font valoir leur droit de bris, etc.




 Deville
Deville


 La lecture de Tchékhov est pour moi vivifiante, peut-être plus encore que celle de Dostoïevski ou de Tolstoï, en cela qu’elle est pure de toute idéologie religieuse ou politique, et qu’elle achoppe à des vies fragiles ou égarées,souvent même perdues. Il y a chez lui une attention aux gens, de toutes espèces, pauvres ou riches, qui va, sans exagération, vers plus d’empathie et de compréhension.
La lecture de Tchékhov est pour moi vivifiante, peut-être plus encore que celle de Dostoïevski ou de Tolstoï, en cela qu’elle est pure de toute idéologie religieuse ou politique, et qu’elle achoppe à des vies fragiles ou égarées,souvent même perdues. Il y a chez lui une attention aux gens, de toutes espèces, pauvres ou riches, qui va, sans exagération, vers plus d’empathie et de compréhension. Le portrait très nuancé, sévère mais juste, de Gide par Simon Leys, dans son Protée et autres essais, où il fait la part du grand homme de lettres et du vieillard maniaque courant après les petits garçons, m’intéresse autant que ses développements sur Stevenson, Confucius, Don Quichotte ou Orwell. C’est le type de l’honnête homme que ce grand passeur disparu récemment, dont je vais lire tous les écrits qui me sont encore inconnus.
Le portrait très nuancé, sévère mais juste, de Gide par Simon Leys, dans son Protée et autres essais, où il fait la part du grand homme de lettres et du vieillard maniaque courant après les petits garçons, m’intéresse autant que ses développements sur Stevenson, Confucius, Don Quichotte ou Orwell. C’est le type de l’honnête homme que ce grand passeur disparu récemment, dont je vais lire tous les écrits qui me sont encore inconnus.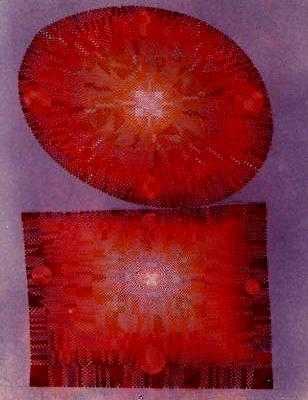
 Locarno, all’Alba, ce mercredi 6 août. - Départ ce matin vers midi. Passons par Ulrichen où je m’arrête au cimetière dans lequel repose notre lointain aïeul l’abbé toscan qui engrossa la mère-grand de notre grand-mère – illico chassée des lieux pour inconduite -, montons au col du Nufenen dont je découvre les majestueuses hauteurs, puis gagnons Locarno en tirant la langue aux automobilistes immobilisés par les calamiteuses files d’attente du sud du Gotthard. Tout au long de la route, je lis à ma bonne amie, entre autres, le petit roman de Bertrand Redonnet, Le Diable et le berger, toujours très Maupassant poitevin et néanmoins très Redonnet, charnel de langue et rebelle de ton. Enfin nous avons retrouvé notre point de chute de l’Alba avec reconnaissance, le sourire amical des employées portugaises et de la patronne à perruque de bronze noir, la piscine bleu Hockney et la vue sur le lac et les monts – la terrasse de Da Luigi et, ce soir, la Piazza Grande où quelque 8000 spectateurs assistaient à Lucy de Luc Besson, genre BD d’anticipation où je m’étonne de ne m’être pas ennuyé une minute en dépit de l’ineptie de la chose.
Locarno, all’Alba, ce mercredi 6 août. - Départ ce matin vers midi. Passons par Ulrichen où je m’arrête au cimetière dans lequel repose notre lointain aïeul l’abbé toscan qui engrossa la mère-grand de notre grand-mère – illico chassée des lieux pour inconduite -, montons au col du Nufenen dont je découvre les majestueuses hauteurs, puis gagnons Locarno en tirant la langue aux automobilistes immobilisés par les calamiteuses files d’attente du sud du Gotthard. Tout au long de la route, je lis à ma bonne amie, entre autres, le petit roman de Bertrand Redonnet, Le Diable et le berger, toujours très Maupassant poitevin et néanmoins très Redonnet, charnel de langue et rebelle de ton. Enfin nous avons retrouvé notre point de chute de l’Alba avec reconnaissance, le sourire amical des employées portugaises et de la patronne à perruque de bronze noir, la piscine bleu Hockney et la vue sur le lac et les monts – la terrasse de Da Luigi et, ce soir, la Piazza Grande où quelque 8000 spectateurs assistaient à Lucy de Luc Besson, genre BD d’anticipation où je m’étonne de ne m’être pas ennuyé une minute en dépit de l’ineptie de la chose. All’Alba, ce dimanche 10 août. – En songeant ce matin à mon projet de papier sur L’Ami barbare, magistralement remanié et amélioré par JMO, le mot de légende me vient, qui en amorcera la première phrase : la légende est une manière, pour l’homme, d’exorciser la mort en transformant le plomb de la vie quotidienne en or, etc.
All’Alba, ce dimanche 10 août. – En songeant ce matin à mon projet de papier sur L’Ami barbare, magistralement remanié et amélioré par JMO, le mot de légende me vient, qui en amorcera la première phrase : la légende est une manière, pour l’homme, d’exorciser la mort en transformant le plomb de la vie quotidienne en or, etc. All’Alba, ce jeudi 14août.- Nous avons rejoint ce midi nos amis Jasmine et Pascal Rebetez dans un grotto de Verscio où nous avons bien mangé (polenta à la tessinoise) et passé de bonnes heures. Pascal me raconte une histoire assez tordante à propos de Godard, à qui il demandait un jour – à propos d’un projet de film pour l’Expo – ce qu’il en serait des droits d’auteurs des innombrables citations émaillant le film. Alors Godard (bonne imitation par Pascal de l’accent traînant de celui-ci) de répondre : « Ben quoi, ils peuvent me faire un procès, c’est sûr ; et s’ils me font un procès, je fais un film du procès… »
All’Alba, ce jeudi 14août.- Nous avons rejoint ce midi nos amis Jasmine et Pascal Rebetez dans un grotto de Verscio où nous avons bien mangé (polenta à la tessinoise) et passé de bonnes heures. Pascal me raconte une histoire assez tordante à propos de Godard, à qui il demandait un jour – à propos d’un projet de film pour l’Expo – ce qu’il en serait des droits d’auteurs des innombrables citations émaillant le film. Alors Godard (bonne imitation par Pascal de l’accent traînant de celui-ci) de répondre : « Ben quoi, ils peuvent me faire un procès, c’est sûr ; et s’ils me font un procès, je fais un film du procès… » Ensuite à La Sala pour y voir Homo Faber, le dernier film de Richard. L’intro de celui-ci, mordante à souhait à l’égard desperroquets, est intéressante, et j’ai été bonnement émerveillé de revoir la chose sur grand écran, tant les trois femmes et les images sont belles, et puissante la mélodie du texte de Frisch.
Ensuite à La Sala pour y voir Homo Faber, le dernier film de Richard. L’intro de celui-ci, mordante à souhait à l’égard desperroquets, est intéressante, et j’ai été bonnement émerveillé de revoir la chose sur grand écran, tant les trois femmes et les images sont belles, et puissante la mélodie du texte de Frisch. Piazza Grande, ce vendredi 15 août. – Repris complètement, ce matin, mon texte sur L’Ami barbare, dont Isabelle Falconnier, qui me l’a commandé pour L’Hebdo, s’est dit enchantée ce soir. Je me suis efforcé de bien mettre en rapport fiction et vérité, faits et légende,en soulignant la verve épique du livre. Je ne crois pas avoir forcé la note, tout en laissant filtrer mon enthousiasme alors que la première mouture du livre, ce printemps, m’avait laissé perplexe à certains égards – mais ce diable de JMO a écouté cet emmerdeur de JLK et fait honneur à notre ami le barbare…
Piazza Grande, ce vendredi 15 août. – Repris complètement, ce matin, mon texte sur L’Ami barbare, dont Isabelle Falconnier, qui me l’a commandé pour L’Hebdo, s’est dit enchantée ce soir. Je me suis efforcé de bien mettre en rapport fiction et vérité, faits et légende,en soulignant la verve épique du livre. Je ne crois pas avoir forcé la note, tout en laissant filtrer mon enthousiasme alors que la première mouture du livre, ce printemps, m’avait laissé perplexe à certains égards – mais ce diable de JMO a écouté cet emmerdeur de JLK et fait honneur à notre ami le barbare…

 À La Désirade, ce vendredi 4 juillet 2014 – Très intéressé, cet après-midi, par le premier volet de la série documentaire consacrée à l’Amérique par Oliver Stone, qui s’est attaché à des aspects méconnus de l’histoire contemporaine, à commencer par les tenants et les aboutissants du recours à la bombe atomique, avec un accent porté sur le rôle du vice-président Wallace, écarté par Truman au profit des vautours anticommunistes. Je suis impressionné par la virulence autocritique du propos, qui tourne même, parfois, au procès radical à la Michael Moore, jusqu’à l’excès me sembe-t-il. Du moins rompt-on avec les pieux mensonges…
À La Désirade, ce vendredi 4 juillet 2014 – Très intéressé, cet après-midi, par le premier volet de la série documentaire consacrée à l’Amérique par Oliver Stone, qui s’est attaché à des aspects méconnus de l’histoire contemporaine, à commencer par les tenants et les aboutissants du recours à la bombe atomique, avec un accent porté sur le rôle du vice-président Wallace, écarté par Truman au profit des vautours anticommunistes. Je suis impressionné par la virulence autocritique du propos, qui tourne même, parfois, au procès radical à la Michael Moore, jusqu’à l’excès me sembe-t-il. Du moins rompt-on avec les pieux mensonges… Ce que j’apprécie énormément chez Peter Sloterdijk est son regard panoptique et la remarquable porosité de sa perception, à la fois d’un dialecticien très libre et d’un historien de la philosophie, d’un écrivain et d’un véritable poète dans ses visions et autres mises en rapport.
Ce que j’apprécie énormément chez Peter Sloterdijk est son regard panoptique et la remarquable porosité de sa perception, à la fois d’un dialecticien très libre et d’un historien de la philosophie, d’un écrivain et d’un véritable poète dans ses visions et autres mises en rapport. À La Désirade, ce dimanche 6 juillet. – Il est probable que mon entretien avec Jean Ziegler, paru le 25 juin dernier dans 24heures, aura été ma dernière contribution à notre « grand quotidien », et je le note sans aigreur mais non sans mélancolie, tant m’attriste la dérive de nos pages culturelles dans la démagogie clientéliste et l’insignifiance à tous égards. J’y vois la fin d’un monde, et plus particulièrement la disparition d’une société lettrée, mais je ne tirerai pas pour autant l’échelle derrière moi. En outre je vais consacrer quelques heures, aujourd’hui, à la transcription de mon entretien avec Bruno Deville, à propos de Bouboule, son premier long métrage, qui sera sans doute ma dernière production journalistique à tire de mercenaire. Après quoi je ne serai plus, décidément, « sur un plateau »…
À La Désirade, ce dimanche 6 juillet. – Il est probable que mon entretien avec Jean Ziegler, paru le 25 juin dernier dans 24heures, aura été ma dernière contribution à notre « grand quotidien », et je le note sans aigreur mais non sans mélancolie, tant m’attriste la dérive de nos pages culturelles dans la démagogie clientéliste et l’insignifiance à tous égards. J’y vois la fin d’un monde, et plus particulièrement la disparition d’une société lettrée, mais je ne tirerai pas pour autant l’échelle derrière moi. En outre je vais consacrer quelques heures, aujourd’hui, à la transcription de mon entretien avec Bruno Deville, à propos de Bouboule, son premier long métrage, qui sera sans doute ma dernière production journalistique à tire de mercenaire. Après quoi je ne serai plus, décidément, « sur un plateau »…  J’ai ces jours, travaillant à La Vie des gens, le sentiment de revenir à la fiction comme au moment où la matière du Viol de l’ange a commencé de cristalliser, en été 1995, à l’époque du massacre de Srebrenica. C’est grâce à ce roman que j’ai commencé à dire « plus de choses », à proportion de la liberté que ménage, précisément, la fiction.
J’ai ces jours, travaillant à La Vie des gens, le sentiment de revenir à la fiction comme au moment où la matière du Viol de l’ange a commencé de cristalliser, en été 1995, à l’époque du massacre de Srebrenica. C’est grâce à ce roman que j’ai commencé à dire « plus de choses », à proportion de la liberté que ménage, précisément, la fiction. Pensé ce matin à une liste dédiée à Ceux qui tombent des nues, inspirée par le chaos des derniers événements du monde : crash en Ukraine, agression israélienne dans la bande de Gaza, Berlusconi blanchi, construction d’un pont à Hong-Kong, chasse au trésor, lecture des Ombres du métis de Sébastien Meier, meurtre de Chloé, etc. L’idée m’en est venue en repensant à ces divers événements comme issus d’un mauvais rêve alors qu’ils émanent de la plus ordinaire réalité, comme les enfants nés malformés dont parle Annie Dillard dans Au Présent. Très bon sujet pour ce dimanche orageux.
Pensé ce matin à une liste dédiée à Ceux qui tombent des nues, inspirée par le chaos des derniers événements du monde : crash en Ukraine, agression israélienne dans la bande de Gaza, Berlusconi blanchi, construction d’un pont à Hong-Kong, chasse au trésor, lecture des Ombres du métis de Sébastien Meier, meurtre de Chloé, etc. L’idée m’en est venue en repensant à ces divers événements comme issus d’un mauvais rêve alors qu’ils émanent de la plus ordinaire réalité, comme les enfants nés malformés dont parle Annie Dillard dans Au Présent. Très bon sujet pour ce dimanche orageux. Je fais ces jours retour à Tchékhov, avec le recueil de récits traduits etprésentés par André Markowciz sous le titre Le violon de Rotschild. Très intéressé par la préface de Gérard Conio, qui évoque une dimension spirituelle, voire évangélique, souvent méconnue de cet écrivain classé témoin lucide mais en somme désenchanté, voire cynique. À propos de Tchékhov, Dimitri parlait, comme de Céline, de la vision du médecin qui constate, prend en compte les maux dont souffrent ses semblables et, sans illusions, les décrit et envisage la meilleure façon d’y remédier. C’est la vision du réformiste patient, combien plus honnête et constructive que celle durévolutionnaire. À cela s’ajoutant l’homme de cœur, enquêtant au bagne alorsqu’il crève de tuberculose, chrétien de fait plus que de foi ou de théorie.
Je fais ces jours retour à Tchékhov, avec le recueil de récits traduits etprésentés par André Markowciz sous le titre Le violon de Rotschild. Très intéressé par la préface de Gérard Conio, qui évoque une dimension spirituelle, voire évangélique, souvent méconnue de cet écrivain classé témoin lucide mais en somme désenchanté, voire cynique. À propos de Tchékhov, Dimitri parlait, comme de Céline, de la vision du médecin qui constate, prend en compte les maux dont souffrent ses semblables et, sans illusions, les décrit et envisage la meilleure façon d’y remédier. C’est la vision du réformiste patient, combien plus honnête et constructive que celle durévolutionnaire. À cela s’ajoutant l’homme de cœur, enquêtant au bagne alorsqu’il crève de tuberculose, chrétien de fait plus que de foi ou de théorie.  À La Désirade,ce jeudi 24 juillet. – Je pensais ce matin au côté sale de la réalité, à propos des Ombres du métis de Sébastien Meier. Saleté des images de Gaza. Saleté de la mort. Saleté des corps tombés du ciel en Ukraine, encore visibles sur les images de la télé. Saleté des tas de cheveux à Auschwitz (souvenir de1966). Saleté des tabloïds. Saleté des photos de l’abject journal Détective. Et tout de suite, à lire Les ombres du métis : saleté de la prison, de la promiscuité, de la vulgarité brutale des échanges entre prisonniers - et cette sensation d’être pris au piège, littéralement empêtré, comme les personnages de Tchékhov ou de Simenon sont pris au piège et empêtrés.Mais curieusement, comme chez Tchékhov ou Simenon, toutes proportions gardées évidemment, la saleté de l’univers des Ombresdu métis se révèle, peu à peu, porteuse d’émotion et de vérité, à l’opposé d’une réalité propre-en-ordre, blanchie (au sens du blanchiment de l’argent) par le refus de voir ce qui est, l’hypocrisie et le mensonge.
À La Désirade,ce jeudi 24 juillet. – Je pensais ce matin au côté sale de la réalité, à propos des Ombres du métis de Sébastien Meier. Saleté des images de Gaza. Saleté de la mort. Saleté des corps tombés du ciel en Ukraine, encore visibles sur les images de la télé. Saleté des tas de cheveux à Auschwitz (souvenir de1966). Saleté des tabloïds. Saleté des photos de l’abject journal Détective. Et tout de suite, à lire Les ombres du métis : saleté de la prison, de la promiscuité, de la vulgarité brutale des échanges entre prisonniers - et cette sensation d’être pris au piège, littéralement empêtré, comme les personnages de Tchékhov ou de Simenon sont pris au piège et empêtrés.Mais curieusement, comme chez Tchékhov ou Simenon, toutes proportions gardées évidemment, la saleté de l’univers des Ombresdu métis se révèle, peu à peu, porteuse d’émotion et de vérité, à l’opposé d’une réalité propre-en-ordre, blanchie (au sens du blanchiment de l’argent) par le refus de voir ce qui est, l’hypocrisie et le mensonge.
 La lecture de Pascal Quignard, dont je viens de commencer le prochain livre, Mourir de penser, tout en reprenant Les Désarçonnés et Rhétorique spéculative, me stimule beaucoup dans mes écrits du matin. À certains moments, j’ai l’impression que ce que je lis est écrit spécialement pour moi comme, parfois,on peut le ressentir de la musique de Schubert. Plus j’y reviens et plus je me dis que, dans ses largeurs propres, et surtout dans ses profondeurs, c’est le meilleur styliste français actuel, plus constant et plus pur, plus profond surtout, qu’un Pierre Michon ou qu’un Philippe Sollers, si remarquables que soient aussi ces deux là.
La lecture de Pascal Quignard, dont je viens de commencer le prochain livre, Mourir de penser, tout en reprenant Les Désarçonnés et Rhétorique spéculative, me stimule beaucoup dans mes écrits du matin. À certains moments, j’ai l’impression que ce que je lis est écrit spécialement pour moi comme, parfois,on peut le ressentir de la musique de Schubert. Plus j’y reviens et plus je me dis que, dans ses largeurs propres, et surtout dans ses profondeurs, c’est le meilleur styliste français actuel, plus constant et plus pur, plus profond surtout, qu’un Pierre Michon ou qu’un Philippe Sollers, si remarquables que soient aussi ces deux là. À La Désirade, ce mercredi 25 juin. – Gracieuse surprise de ce matin, sur le rebord extérieur de la nouvelle grande fenêtre de ma chambre : ce petit rouge-queue frais émoulu, descendu de son nid sous la solive, qui me regarde, un peu effaré, puis se lance dans un premier vol. Or j’étais en train de lire, au même moment, le prochain livre de Pascal Quignard, Mourir de penser, et plus précisément cette page : «Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde.
À La Désirade, ce mercredi 25 juin. – Gracieuse surprise de ce matin, sur le rebord extérieur de la nouvelle grande fenêtre de ma chambre : ce petit rouge-queue frais émoulu, descendu de son nid sous la solive, qui me regarde, un peu effaré, puis se lance dans un premier vol. Or j’étais en train de lire, au même moment, le prochain livre de Pascal Quignard, Mourir de penser, et plus précisément cette page : «Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde. Le propos de mes Tours d’illusion est la remise en cause du format, et plus précisément duformatage, à tous égards. Or je suis en train d’étendre cette sortie à tout ce qui procède de la répétition stérile ou de l’automatisme parasitaire, en me référant implicitement à Max Dorra (auquel j’ai emprunté l’image des tours d’illusion) et à Pascal Quignard (mes lectures de ces jours), autant qu’à Gustave Thibon (L’Illusion féconde) ou à Peter Sloterdijk, notamment.
Le propos de mes Tours d’illusion est la remise en cause du format, et plus précisément duformatage, à tous égards. Or je suis en train d’étendre cette sortie à tout ce qui procède de la répétition stérile ou de l’automatisme parasitaire, en me référant implicitement à Max Dorra (auquel j’ai emprunté l’image des tours d’illusion) et à Pascal Quignard (mes lectures de ces jours), autant qu’à Gustave Thibon (L’Illusion féconde) ou à Peter Sloterdijk, notamment.

 Héliopolis, ce 23 mai. - Nous avonsfait cet après-midi escale à Sète, dont j’aime décidément l’aspect de petite ville portuaire à canaux et ruelles, point trop policée et d’un grand charme avec ses maisons à trois étages aux façades à la fois élégantes et décaties, l’étagement de ses places ombragées et de ses « marches » ascendantes, jusqu’au Mont Saint-Clair; et l’heure passée à la librairie de L’Echappée belle a été des plus fructueuse, dont nous avons ramené une quinzaine de nouveaux livres. Riches de notre butin, nous nous sommes ensuite arrêtés sur une terrasse jouxtant le marché couvert, ma bonne amie se plongeant aussitôt dans un essai sur la démocratie de Dominique Schnapper (L’Esprit démocratique des lois) tandis que je tombais illico sous l’emprise du verbe cinglant et coloré d’In Kali Jean Bofane, dont le nouveau roman, Congo Inc., comme il avait commencé de nous le raconter à Lubumbashi, suit la trajectoire d’un jeune Pygmée découvrant, en lisière de forêt vierge, l’univers virtuel des jeux vidéo et de la puissance par procuration, fasciné par la technologie et quittant bientôt sa forêt natale pour la jungle urbaine de Kinshasa.
Héliopolis, ce 23 mai. - Nous avonsfait cet après-midi escale à Sète, dont j’aime décidément l’aspect de petite ville portuaire à canaux et ruelles, point trop policée et d’un grand charme avec ses maisons à trois étages aux façades à la fois élégantes et décaties, l’étagement de ses places ombragées et de ses « marches » ascendantes, jusqu’au Mont Saint-Clair; et l’heure passée à la librairie de L’Echappée belle a été des plus fructueuse, dont nous avons ramené une quinzaine de nouveaux livres. Riches de notre butin, nous nous sommes ensuite arrêtés sur une terrasse jouxtant le marché couvert, ma bonne amie se plongeant aussitôt dans un essai sur la démocratie de Dominique Schnapper (L’Esprit démocratique des lois) tandis que je tombais illico sous l’emprise du verbe cinglant et coloré d’In Kali Jean Bofane, dont le nouveau roman, Congo Inc., comme il avait commencé de nous le raconter à Lubumbashi, suit la trajectoire d’un jeune Pygmée découvrant, en lisière de forêt vierge, l’univers virtuel des jeux vidéo et de la puissance par procuration, fasciné par la technologie et quittant bientôt sa forêt natale pour la jungle urbaine de Kinshasa.  Au Cap d’Agde, ce lundi 26 mai. – J’ai marché tôt ce matin sur la plage en profitant du premier soleil de huit heures, resongeant à ma lecture du dernier roman de Jean Bofane, tout à fait intéressant et plus encore, sans qu’il me transporte comme je l’ai été à la lecture de 2666 de Roberto Bolano. Néanmoins il y a chez l’auteur une verve et un travail sur le langage qui fait de lui un voleur et un violeur de notre chère langue française, tel que nous en avons fait l’éloge, en riant pas mal, lors du congrès de Lubumbashi où nousnous sommes connus en octobre 2012.
Au Cap d’Agde, ce lundi 26 mai. – J’ai marché tôt ce matin sur la plage en profitant du premier soleil de huit heures, resongeant à ma lecture du dernier roman de Jean Bofane, tout à fait intéressant et plus encore, sans qu’il me transporte comme je l’ai été à la lecture de 2666 de Roberto Bolano. Néanmoins il y a chez l’auteur une verve et un travail sur le langage qui fait de lui un voleur et un violeur de notre chère langue française, tel que nous en avons fait l’éloge, en riant pas mal, lors du congrès de Lubumbashi où nousnous sommes connus en octobre 2012. Ludwig Wittgenstein : « Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».
Ludwig Wittgenstein : « Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».
 Après les recensions déjà remarquables de Francis Richard et de Sergio Belluz, à propos de L’échappée libre, Jean-Michel Olivier me gratifie d’un véritable feuilleton critique comme on n’en fait plus aujourd’hui, me rappelant le papier magistral consacré par Pierre-Olivier Walser au Viol de l’ange. Surtout me touche son attention réelle. Il pourrait être plus sévère que je ne lui en voudrais aucunement. On me croit parano parce qu’il m’est arrivé de réagir violemment à des critiques suant l’injustice ou l’ineptie, et j’ai été imbécile de répondre,mais je pense, avec l’ami Gripari, qu’une critique négative contient toujours un élément intéressant – et c’est d’ailleurs le cas de celle, récente, de Julien Burri, si injuste et inepte soit-elle - , plus qu’un dithyrambe de complaisance.
Après les recensions déjà remarquables de Francis Richard et de Sergio Belluz, à propos de L’échappée libre, Jean-Michel Olivier me gratifie d’un véritable feuilleton critique comme on n’en fait plus aujourd’hui, me rappelant le papier magistral consacré par Pierre-Olivier Walser au Viol de l’ange. Surtout me touche son attention réelle. Il pourrait être plus sévère que je ne lui en voudrais aucunement. On me croit parano parce qu’il m’est arrivé de réagir violemment à des critiques suant l’injustice ou l’ineptie, et j’ai été imbécile de répondre,mais je pense, avec l’ami Gripari, qu’une critique négative contient toujours un élément intéressant – et c’est d’ailleurs le cas de celle, récente, de Julien Burri, si injuste et inepte soit-elle - , plus qu’un dithyrambe de complaisance.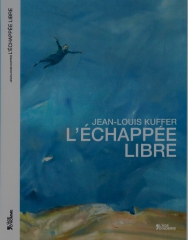 Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens,encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.
Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens,encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie. 3.Aller à la rencontre
3.Aller à la rencontre Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu(il est trop attaché à son nid d’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à la main. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie,congrès sur la francophonie au Congo, voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade enTunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyage pour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres…
Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu(il est trop attaché à son nid d’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à la main. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie,congrès sur la francophonie au Congo, voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade enTunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyage pour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres… Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité.
Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité.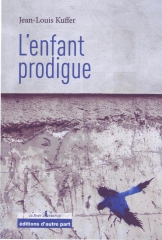 premières émotions, JLK le remet plusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuseou tourmentée, exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également les péripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité.
premières émotions, JLK le remet plusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuseou tourmentée, exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également les péripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité. Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce. Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.
Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce. Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.
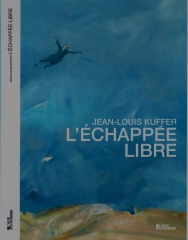 À La Désirade, ce 10 avril 2014. - Mon livre est magnifique, que je suis allé chercher ce midi à L’Âge d’Homme. Andonia était tout sourire, de même que Patrick Vallon que j’ai remercié pour son travail d’édition digne de ce nom. La couverture est splendide, avec une reproduction parfaite de la grande toile de Robert Indermaur, et le texte en 4epage, sans un élément biographique – comme je le voulais.
À La Désirade, ce 10 avril 2014. - Mon livre est magnifique, que je suis allé chercher ce midi à L’Âge d’Homme. Andonia était tout sourire, de même que Patrick Vallon que j’ai remercié pour son travail d’édition digne de ce nom. La couverture est splendide, avec une reproduction parfaite de la grande toile de Robert Indermaur, et le texte en 4epage, sans un élément biographique – comme je le voulais.
 À Nyon, ce mercredi 30 avril. – Je suis descendu très tôt ce matin pour assister, à l’Usine à gaz de Nyon, à l’atelier de Richard Dindo mis sur pied à l’enseigne du festival Visions du réel. Deux heures durant, mon cher sanglier a détaillé la suite de ses films avec force détails biographiques personnels dont j’ignorais certains (notamment les coïncidences liées à sa rencontre de Max Frisch) tout en éclairant sa démarche et la genèse de son dernier Opus,Homo Faber, que j’ai pas mal commenté avec lui étant la seule personne dans la salle à l’avoir déjà vu. J’aime bien le mélange de modestie objective et d’orgueil farouche avec lesquels il parle de son travail, non sans brocarder au passage ceux qu’il appelle « les perroquets », que j’appelle pour ma part les éteignoirs. Je n’ai cessé de prendre des notes tout en dialoguant avec lui. Je suis de plus en plus, en dépit de ma timidité, celui qui, au premier rang de la salle, pose des questions et demande des précisions. La salle, pleine, était très attentive (public de cinéphiles à l’évidence, entre 30 et 60 ans), et j’ai senti la satisfaction de l’intéressé, qui a reçu hier un sesterce d’or « à la carrière ». Après la séance, je suis allé déjeuner tout seul après avoir déposé un exemplaire dédicacé de L’échappée libre à son hôtel.
À Nyon, ce mercredi 30 avril. – Je suis descendu très tôt ce matin pour assister, à l’Usine à gaz de Nyon, à l’atelier de Richard Dindo mis sur pied à l’enseigne du festival Visions du réel. Deux heures durant, mon cher sanglier a détaillé la suite de ses films avec force détails biographiques personnels dont j’ignorais certains (notamment les coïncidences liées à sa rencontre de Max Frisch) tout en éclairant sa démarche et la genèse de son dernier Opus,Homo Faber, que j’ai pas mal commenté avec lui étant la seule personne dans la salle à l’avoir déjà vu. J’aime bien le mélange de modestie objective et d’orgueil farouche avec lesquels il parle de son travail, non sans brocarder au passage ceux qu’il appelle « les perroquets », que j’appelle pour ma part les éteignoirs. Je n’ai cessé de prendre des notes tout en dialoguant avec lui. Je suis de plus en plus, en dépit de ma timidité, celui qui, au premier rang de la salle, pose des questions et demande des précisions. La salle, pleine, était très attentive (public de cinéphiles à l’évidence, entre 30 et 60 ans), et j’ai senti la satisfaction de l’intéressé, qui a reçu hier un sesterce d’or « à la carrière ». Après la séance, je suis allé déjeuner tout seul après avoir déposé un exemplaire dédicacé de L’échappée libre à son hôtel. 


 Witkiewicz l’avait perçu dès les années 20 du siècle passé : que la folie désormais se manifesterait sous l’aspect de la normalité et des conventions ordinaires rapportées au format. Or c’est valable, aujourd’hui, pour toutes les sociétés et les cultures normées, comme on dit, à tel point que l’on peut ressentir à tout moment, devant la télé ou en lisant les journaux, et désormais en surfant sur les réseaux sociaux, l’impression de vivre dans un monde d’aliénés. Exemples à foison.
Witkiewicz l’avait perçu dès les années 20 du siècle passé : que la folie désormais se manifesterait sous l’aspect de la normalité et des conventions ordinaires rapportées au format. Or c’est valable, aujourd’hui, pour toutes les sociétés et les cultures normées, comme on dit, à tel point que l’on peut ressentir à tout moment, devant la télé ou en lisant les journaux, et désormais en surfant sur les réseaux sociaux, l’impression de vivre dans un monde d’aliénés. Exemples à foison.
 À Tunis, ce même soir, Hôtel El Hana, 23h. – « Tout le monde, ici, fait semblant ! » Voilà ce que Rafik ben Salah, venu me cueillir bien amicalement, ce soir à l'aéroport de Carthage où nous nous sommes retrouvés avec plus d'une heure de retard, me lance dans la Twingo qu'il a conduit sans décolérer jusqu'à mon hôtel de l'avenue Bourguiba, à cent mètres du ministère de l’Intérieur de sinistre mémoire, qu’il appelle le Minustaire dans son roman.
À Tunis, ce même soir, Hôtel El Hana, 23h. – « Tout le monde, ici, fait semblant ! » Voilà ce que Rafik ben Salah, venu me cueillir bien amicalement, ce soir à l'aéroport de Carthage où nous nous sommes retrouvés avec plus d'une heure de retard, me lance dans la Twingo qu'il a conduit sans décolérer jusqu'à mon hôtel de l'avenue Bourguiba, à cent mètres du ministère de l’Intérieur de sinistre mémoire, qu’il appelle le Minustaire dans son roman. Je ne pensais pas y revenir aussi tôt, vu que la Tunisie et les Tunisiens ont bien d'autres aspects plus avenants à faire valoir, et d'autres problèmes plus urgents, mais les médias locaux de ces jours y ramènent, annonçant que le ministère del'intérieur va sévir contre le niqab, ou voile intégral. Si l'argument invoqué aujourd'hui par les autorités implique le risque de dissimuler, sous le niqab, quelque terroriste armé, un récente affaire, hallucinante par les dimensions qu'elles a prises, de l'hiver 2011 au printemps2012, prouve que l'arme de guerre du niqab est peut-être plus efficace quand elle devient ce qu'on pourrait dire la robe-prétexte du fanatisme. La meilleure illustration en est l'affrontement, parfois d'une extrême violence, qui a eu lieu des mois durant dans l'enceinte en principe protégée de la Manouba, la faculté des Lettres de l'université de Tunis, opposant UNE étudiante refusant de se dévoiler, soutenue par une camarilla de prétendus défenseurs de la liberté religieuse, par ailleurs étrangers à l'université, et les autorités et autres professeurs de celle-ci.
Je ne pensais pas y revenir aussi tôt, vu que la Tunisie et les Tunisiens ont bien d'autres aspects plus avenants à faire valoir, et d'autres problèmes plus urgents, mais les médias locaux de ces jours y ramènent, annonçant que le ministère del'intérieur va sévir contre le niqab, ou voile intégral. Si l'argument invoqué aujourd'hui par les autorités implique le risque de dissimuler, sous le niqab, quelque terroriste armé, un récente affaire, hallucinante par les dimensions qu'elles a prises, de l'hiver 2011 au printemps2012, prouve que l'arme de guerre du niqab est peut-être plus efficace quand elle devient ce qu'on pourrait dire la robe-prétexte du fanatisme. La meilleure illustration en est l'affrontement, parfois d'une extrême violence, qui a eu lieu des mois durant dans l'enceinte en principe protégée de la Manouba, la faculté des Lettres de l'université de Tunis, opposant UNE étudiante refusant de se dévoiler, soutenue par une camarilla de prétendus défenseurs de la liberté religieuse, par ailleurs étrangers à l'université, et les autorités et autres professeurs de celle-ci. Tunis, sur une terrasse de l'Avenue Bourguiba, ce mercredi 19 février. – J’ai remarqué, depuis hier, que l’accès à mon profil de Facebook se trouvait désormais bloqué et que diverses perturbations affectent également mon blog. Je présume que mes derniers papiers, critiques voire sarcastiques à propos du niqab, et citant assez longuement les Chroniques du Manoubistan, expliquent ce qui me semble un évident acte de censure. J’espère ne pas faire de parano, mais comment l’expliquer sinon ? Au reste, j’éprouve quelque chose de pesant en ces lieux, que nous n’avons pas ressenti du tout en juillet 2011 où l’atmosphère était à l’effervescence joyeuse et aux échanges amicaux.
Tunis, sur une terrasse de l'Avenue Bourguiba, ce mercredi 19 février. – J’ai remarqué, depuis hier, que l’accès à mon profil de Facebook se trouvait désormais bloqué et que diverses perturbations affectent également mon blog. Je présume que mes derniers papiers, critiques voire sarcastiques à propos du niqab, et citant assez longuement les Chroniques du Manoubistan, expliquent ce qui me semble un évident acte de censure. J’espère ne pas faire de parano, mais comment l’expliquer sinon ? Au reste, j’éprouve quelque chose de pesant en ces lieux, que nous n’avons pas ressenti du tout en juillet 2011 où l’atmosphère était à l’effervescence joyeuse et aux échanges amicaux. Ce soir au Sheraton avec Rafik et son frère ministre Hafedh. Conversation nourrie d’informations sur ce que prépare le gouvernement de transition. Notre ami est en charge de la justice et des droits de l’homme, et ce qu’il me dit est intéressant. De retour à l’hôtel j'ai lu la moitié d'un essai virulent contre le parti Ennhahda, d'un certain Adnan Liman, qui décrit le parti islamiste comme une branche des Frères musulmans visant à l'établissement d'un Etat totalitaire, avec le soutien d'Israël et del'Amérique.
Ce soir au Sheraton avec Rafik et son frère ministre Hafedh. Conversation nourrie d’informations sur ce que prépare le gouvernement de transition. Notre ami est en charge de la justice et des droits de l’homme, et ce qu’il me dit est intéressant. De retour à l’hôtel j'ai lu la moitié d'un essai virulent contre le parti Ennhahda, d'un certain Adnan Liman, qui décrit le parti islamiste comme une branche des Frères musulmans visant à l'établissement d'un Etat totalitaire, avec le soutien d'Israël et del'Amérique. À ceux qui n'en finissent pas de me recommander de profiter de ce séjour tunisien, je ne réponds pas plus que s'ils m'enjoignaient de profiter du Sahel ou du Qatar, tant cette notion de profit m'est étrangère, mais ce n'est même pas de morale qu'il en va. De fait je compte bien, mieux que profiter au sens d'en avoir pour mon argent, m'imprégner de réalité tunisienne, comme j'ai commencé de le faire en visionnant déjà treize films récents et en me perdant ces jours dans les rues et les foules, à subir la nuit dernière ma voisine d'en dessus niqabée le jour et n'en finissant pas de hululer de volupté après le dernier appel du muezzin, ou la vociférante manif islamiste de ce matin vers le ministère de l'intérieur, et les livres nouveaux, ma douce au téléphone de ses hauteurs enneigées, les journaux et les confidences de tel cireur de chaussures...
À ceux qui n'en finissent pas de me recommander de profiter de ce séjour tunisien, je ne réponds pas plus que s'ils m'enjoignaient de profiter du Sahel ou du Qatar, tant cette notion de profit m'est étrangère, mais ce n'est même pas de morale qu'il en va. De fait je compte bien, mieux que profiter au sens d'en avoir pour mon argent, m'imprégner de réalité tunisienne, comme j'ai commencé de le faire en visionnant déjà treize films récents et en me perdant ces jours dans les rues et les foules, à subir la nuit dernière ma voisine d'en dessus niqabée le jour et n'en finissant pas de hululer de volupté après le dernier appel du muezzin, ou la vociférante manif islamiste de ce matin vers le ministère de l'intérieur, et les livres nouveaux, ma douce au téléphone de ses hauteurs enneigées, les journaux et les confidences de tel cireur de chaussures... Je me la suis jouée Freddy Buache, cet après-midi, en m'installant au premier rang du cinéma Parnasse où se donnait, pour 3 dinars, le nouveau long métrage de fiction de Taïeb Louhichi, L'Enfant du soleil, belle histoire de filiation supposée , qui voit le jeune Yanis, en quête de paternité, débarquer chez un romancier qui lui semble avoir raconté sa propre histoire dans un des ses livres, non sans raison comme on le verra...
Je me la suis jouée Freddy Buache, cet après-midi, en m'installant au premier rang du cinéma Parnasse où se donnait, pour 3 dinars, le nouveau long métrage de fiction de Taïeb Louhichi, L'Enfant du soleil, belle histoire de filiation supposée , qui voit le jeune Yanis, en quête de paternité, débarquer chez un romancier qui lui semble avoir raconté sa propre histoire dans un des ses livres, non sans raison comme on le verra... El Hana, ce jeudi 27 février. – J’étais un peu maussade ce matin. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres rencontrée l’autre jour à la Manouba et se dédoublant en ces lieux pour l’animation culturelle du journal national de treize heures.
El Hana, ce jeudi 27 février. – J’étais un peu maussade ce matin. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres rencontrée l’autre jour à la Manouba et se dédoublant en ces lieux pour l’animation culturelle du journal national de treize heures. À La Désirade, ce samedi 1er mars. – Retrouvé ma bonne amie avec bonheur et reconnaissance. Notre vie est toute bonne et c’est ici. Notre vie est bonne,aussi, lorsque nous la prenons avec nous, comme en hiver dernier à travers laFrance, le Portugal et l’Espagne. Hélas à Tunis, ces jours, notre vie n’était pas là – même pas la moitié…
À La Désirade, ce samedi 1er mars. – Retrouvé ma bonne amie avec bonheur et reconnaissance. Notre vie est toute bonne et c’est ici. Notre vie est bonne,aussi, lorsque nous la prenons avec nous, comme en hiver dernier à travers laFrance, le Portugal et l’Espagne. Hélas à Tunis, ces jours, notre vie n’était pas là – même pas la moitié…

 À La Désirade, ce 9 janvier.- Commencé de lire le tapuscrit du nouveau roman de Max. Très bien. Plus maîtrisé que la première mouture du précédent, intéressant par sa matière (en gros : la vie quotidienne d’unBantou en Suisse) et très bien rythmé. J’ai fait quelques corrections et Zoé finira le job avec lui.
À La Désirade, ce 9 janvier.- Commencé de lire le tapuscrit du nouveau roman de Max. Très bien. Plus maîtrisé que la première mouture du précédent, intéressant par sa matière (en gros : la vie quotidienne d’unBantou en Suisse) et très bien rythmé. J’ai fait quelques corrections et Zoé finira le job avec lui.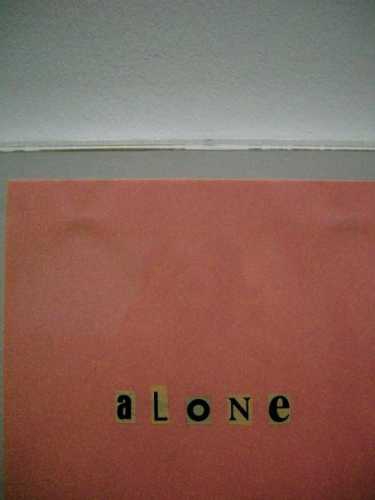
 Il est certains livres auxquels on revient comme en certains lieux dits aujourd'hui « de mémoire » ou tenant lieux de greniers universels et autres débarras - de ce que les Madrilènes appellent le Rastro ou de ce que les Parisiens appellent les Puces, et telle est l'Autobiographie des objets de François Bon, à l'exclusion de toute nostalgie douceâtre puisque ce repérage personnel des choses évocatrices de dates et de faits balise un parcours personnel et familial, voire générationnel (pour parler le langage des temps qui courent), où se perçoit, dans le transit des objets et de la relation qui nous y a attachés et continue parfois de le faire, l'évolution de tout un bout desiècle, de nos aïeux à nos enfants, les têtes de chapitres de l'Autobographie des objets relançant à tout coup nos propres souvenances. Ainsi de Transistor ou de Dictionnaires, de Photos de classe ou deNavigateurs solitaires - qui tout aussitôt fait surgir Alain Bombard d'une déferlante-, ou encore de Pattes d'eph ou de Premier livre…
Il est certains livres auxquels on revient comme en certains lieux dits aujourd'hui « de mémoire » ou tenant lieux de greniers universels et autres débarras - de ce que les Madrilènes appellent le Rastro ou de ce que les Parisiens appellent les Puces, et telle est l'Autobiographie des objets de François Bon, à l'exclusion de toute nostalgie douceâtre puisque ce repérage personnel des choses évocatrices de dates et de faits balise un parcours personnel et familial, voire générationnel (pour parler le langage des temps qui courent), où se perçoit, dans le transit des objets et de la relation qui nous y a attachés et continue parfois de le faire, l'évolution de tout un bout desiècle, de nos aïeux à nos enfants, les têtes de chapitres de l'Autobographie des objets relançant à tout coup nos propres souvenances. Ainsi de Transistor ou de Dictionnaires, de Photos de classe ou deNavigateurs solitaires - qui tout aussitôt fait surgir Alain Bombard d'une déferlante-, ou encore de Pattes d'eph ou de Premier livre… Ce qu'il y a de poétique chez François Bon l'est sans le vouloir. François Bon écrit par exemple ceci de la deux-chevaux: « Quatre roues sous un parapluie, c'était le projet de base de la deux-chevaux ». Ce qui commence bien. C'est du lyrisme sans forcer. Continuant comme ça: « Dans les années soixante elle s'en éloigne, plus pimpante, les odeurs à l'intérieur sont toujours aussi réjouissantes, mêlant plastique, métal et tissu ». Ensuite s'ajoutent de précises considérations techniques sur le véhicule par excellence de notre jeunesse, après le vélosolex, aboutissant au récit d'une équipée sans permis en ville que le père de l'auteur se retint de punir par une « terrible danse » puisque, garagiste et fils de, il était pour quelque chose dans les engouements mécaniques du bon fiston dont on constate à tous les coins de pages la passion respectueuse pour les objets de métier (sa première règle à calcul vaut son missel de première communion) ou de loisir (sa première guitare Yamaha).
Ce qu'il y a de poétique chez François Bon l'est sans le vouloir. François Bon écrit par exemple ceci de la deux-chevaux: « Quatre roues sous un parapluie, c'était le projet de base de la deux-chevaux ». Ce qui commence bien. C'est du lyrisme sans forcer. Continuant comme ça: « Dans les années soixante elle s'en éloigne, plus pimpante, les odeurs à l'intérieur sont toujours aussi réjouissantes, mêlant plastique, métal et tissu ». Ensuite s'ajoutent de précises considérations techniques sur le véhicule par excellence de notre jeunesse, après le vélosolex, aboutissant au récit d'une équipée sans permis en ville que le père de l'auteur se retint de punir par une « terrible danse » puisque, garagiste et fils de, il était pour quelque chose dans les engouements mécaniques du bon fiston dont on constate à tous les coins de pages la passion respectueuse pour les objets de métier (sa première règle à calcul vaut son missel de première communion) ou de loisir (sa première guitare Yamaha). François Bon cite aussi la revue en fascicules Tout l'Univers, qui nous a fait également voyager par l'imagination, comme les premières tournées de Connaissance dumonde. En Suisse romande, nous avons eu droit à la formidable série des Albums N.P.C.K., produits par le conglomérat chocolatier Nestlé-Peter-Cailler-Kohler, sur les pages desquelles nous collions des vignettes obtenues par l'achat de produits desdites firmes. Or les collections de ces albums, souvent liquidées par des mères impatientes de "faire de la place", valent aujourd'hui des sommes. Je garde précieusement mes exemplaires d'Oiseaux de tous payset de La ronde des métiers...
François Bon cite aussi la revue en fascicules Tout l'Univers, qui nous a fait également voyager par l'imagination, comme les premières tournées de Connaissance dumonde. En Suisse romande, nous avons eu droit à la formidable série des Albums N.P.C.K., produits par le conglomérat chocolatier Nestlé-Peter-Cailler-Kohler, sur les pages desquelles nous collions des vignettes obtenues par l'achat de produits desdites firmes. Or les collections de ces albums, souvent liquidées par des mères impatientes de "faire de la place", valent aujourd'hui des sommes. Je garde précieusement mes exemplaires d'Oiseaux de tous payset de La ronde des métiers...  J'aurais envie désormais d'envisager les qualités qu'on pourrait dire d'un « romancier de cinéma » ou d'un "poète de cinéma", d'un "peintre de cinéma" ou d'un "musicien de cinéma"...
J'aurais envie désormais d'envisager les qualités qu'on pourrait dire d'un « romancier de cinéma » ou d'un "poète de cinéma", d'un "peintre de cinéma" ou d'un "musicien de cinéma"... 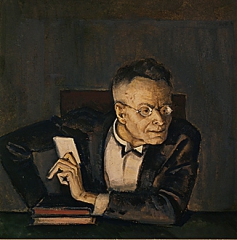 La perversion du langage, aux yeux de Karl Kraus , est aussi bien le signe de la décadence sociale que de l'effondrement des structures internes de l'individu. Or cette dégénérescence est visible, plus qu'ailleurs, dans la presse. « Ce que la vérole a épargné sera dévasté par la presse », affirme-t-il comme le fit enRussie, quelques années plus tôt, un Vassily Rozanov. Et ce n'est pas qu'une boutade: pour Karl Kraus, en effet, défenseur du classicisme, traducteur d'Aristophane et de Shakespeare, admirateur de Goethe et de Nestroy, formidable écrivain lui-même, le langage de plus en plus dépersonnalisé de la presse, l'effet dissolvant de sa pensée au rabais, et la diffusion des idées générales qui en découle, sont autant de signes avant-coureurs de l'avènement d'un nouvel homme conditionné, prêt à suivre le premier démagogue.
La perversion du langage, aux yeux de Karl Kraus , est aussi bien le signe de la décadence sociale que de l'effondrement des structures internes de l'individu. Or cette dégénérescence est visible, plus qu'ailleurs, dans la presse. « Ce que la vérole a épargné sera dévasté par la presse », affirme-t-il comme le fit enRussie, quelques années plus tôt, un Vassily Rozanov. Et ce n'est pas qu'une boutade: pour Karl Kraus, en effet, défenseur du classicisme, traducteur d'Aristophane et de Shakespeare, admirateur de Goethe et de Nestroy, formidable écrivain lui-même, le langage de plus en plus dépersonnalisé de la presse, l'effet dissolvant de sa pensée au rabais, et la diffusion des idées générales qui en découle, sont autant de signes avant-coureurs de l'avènement d'un nouvel homme conditionné, prêt à suivre le premier démagogue. Un rêve éveillé
Un rêve éveillé Le livre de Michel Bernard est riche,dont les thèmes se nouent en un écheveau qu'il serait trop long de débrouiller ici. Mais il faut parler aussi de la merveilleuse prose de ce jeune auteur, sensuelle, chargée à l'extrême supportable et nous entraînant parfois en des détours si subtils, que l'agacement aurait raison de nous si l'ironie ne venait tout aussitôt distraire celui-là de la préciosité, et la gravité de la démarche nous consoler de trop belles moulures: « Verbe rugueux, âcre, pesant, gonflé d'odeurs, c'est celui que je peins, entre les cuisses des dames, sous leurs robes, entre lesyeux d'une vierge qui dort (...) Je les peindrai qui voient ce jour, voient cetinstant, à l'instant où le sexe devient muet ».
Le livre de Michel Bernard est riche,dont les thèmes se nouent en un écheveau qu'il serait trop long de débrouiller ici. Mais il faut parler aussi de la merveilleuse prose de ce jeune auteur, sensuelle, chargée à l'extrême supportable et nous entraînant parfois en des détours si subtils, que l'agacement aurait raison de nous si l'ironie ne venait tout aussitôt distraire celui-là de la préciosité, et la gravité de la démarche nous consoler de trop belles moulures: « Verbe rugueux, âcre, pesant, gonflé d'odeurs, c'est celui que je peins, entre les cuisses des dames, sous leurs robes, entre lesyeux d'une vierge qui dort (...) Je les peindrai qui voient ce jour, voient cetinstant, à l'instant où le sexe devient muet ». À La Désirade, ce samedi 19 octobre. - J'ai trouvé, dans la lecture des nouvelles d'Alice Munro, découverte à la faveur de son récent Nobel de littérature,un écho à ma propre rêverie existentielle que je n'avais jamais perçu jusque-là chez aucun auteur, sauf chez Tchékhov. Tous les sujets de ces nouvelles me touchent par leur substance et leur traitement, si délicat et si juste. Aussi, les nouvelles d'Alice Munro jouent sur le dévoilement progressif d'un secret, dont le lecteur tient la clef en lui.
À La Désirade, ce samedi 19 octobre. - J'ai trouvé, dans la lecture des nouvelles d'Alice Munro, découverte à la faveur de son récent Nobel de littérature,un écho à ma propre rêverie existentielle que je n'avais jamais perçu jusque-là chez aucun auteur, sauf chez Tchékhov. Tous les sujets de ces nouvelles me touchent par leur substance et leur traitement, si délicat et si juste. Aussi, les nouvelles d'Alice Munro jouent sur le dévoilement progressif d'un secret, dont le lecteur tient la clef en lui.
 Les Regards sur Nietzsche d'Henri Guillemin sont intéressants , où j'ai trouvé pas mal de remarques utiles et équilibrées. On ne la lui fait pas et c'est très bien: très bien de résister à l'énergumène, mieux que ne le fait un Sollers, dont la vénération confine parfois à la jobardise.
Les Regards sur Nietzsche d'Henri Guillemin sont intéressants , où j'ai trouvé pas mal de remarques utiles et équilibrées. On ne la lui fait pas et c'est très bien: très bien de résister à l'énergumène, mieux que ne le fait un Sollers, dont la vénération confine parfois à la jobardise.  Ce que j'aime bien chez Henri Guillemin - et c'est aussi pour me rappeler ses conférences captivantes -, c'est qu'il ose mettre les pieds dans le plat d'une certaine intelligentsia allemande ou française qui, dès que sort le nom de Nietzsche, se signe ou se met au garde-à-vous. Guillemin, lui, reste perplexe et naturel, avec le même aplomb qu'un René Girard examinant le cas de l'énergumène. Le long chapitre sur les relations humaines de FN (surtout Wagner, Lou Salomé et ses mère et soeur) n'amène rien de très nouveau mais éclaire le topo, pour parler peuple, comme le premier chapitre sur les "trous noirs" de la bio de FN, côté mal d'enfance, mal portance et mal baisance. Quant au dernier chapitre sur les prodromes d'une idéologie récupérée par les nazis à titre posthume, il me semble bien affronter les difficultés présentées par une pensée souvent ambiguë et contradictoire, au-delà de ses provocations.
Ce que j'aime bien chez Henri Guillemin - et c'est aussi pour me rappeler ses conférences captivantes -, c'est qu'il ose mettre les pieds dans le plat d'une certaine intelligentsia allemande ou française qui, dès que sort le nom de Nietzsche, se signe ou se met au garde-à-vous. Guillemin, lui, reste perplexe et naturel, avec le même aplomb qu'un René Girard examinant le cas de l'énergumène. Le long chapitre sur les relations humaines de FN (surtout Wagner, Lou Salomé et ses mère et soeur) n'amène rien de très nouveau mais éclaire le topo, pour parler peuple, comme le premier chapitre sur les "trous noirs" de la bio de FN, côté mal d'enfance, mal portance et mal baisance. Quant au dernier chapitre sur les prodromes d'une idéologie récupérée par les nazis à titre posthume, il me semble bien affronter les difficultés présentées par une pensée souvent ambiguë et contradictoire, au-delà de ses provocations.  À La Désirade, ce lundi 22 juillet. - En passant en revue, hier soir, les journaux de la semaine dernière, je suis tombé sur une page consacrée à l'imbécillité proférée, en Chine, par Ueli Maurer, l'actuel président de la Confédération, selon lequel il s'agit maintenant de « tourner la page de Tian'anmen ». On ne saurait mieux illustrer la servilité de nos autorités, ou plus précisément celle de ce philistin caractérisé - un vrai pleutre doublé d’un pignouf. Les victimes innocentes du massacre du 4 juin 1989 ne comptent pas, pour ce boutiquier servile, plus que pour l’épicier Blocher se flattant d’avoir commercé avec la Chine avant tout le monde. Honte à ces larbins !
À La Désirade, ce lundi 22 juillet. - En passant en revue, hier soir, les journaux de la semaine dernière, je suis tombé sur une page consacrée à l'imbécillité proférée, en Chine, par Ueli Maurer, l'actuel président de la Confédération, selon lequel il s'agit maintenant de « tourner la page de Tian'anmen ». On ne saurait mieux illustrer la servilité de nos autorités, ou plus précisément celle de ce philistin caractérisé - un vrai pleutre doublé d’un pignouf. Les victimes innocentes du massacre du 4 juin 1989 ne comptent pas, pour ce boutiquier servile, plus que pour l’épicier Blocher se flattant d’avoir commercé avec la Chine avant tout le monde. Honte à ces larbins !  Je reviens au Nègre factice, génial récit de Flannery O’Connor.
Je reviens au Nègre factice, génial récit de Flannery O’Connor. La surabondante jactance critique encombre les rivages de l'océanique Recherche du temps perdu de MarcelProust, mais il vaut la peine, et c'est un vif plaisir, de lire le récent Proust contre Cocteau de Claude Arnaud,très éclairante approche d'une rivalité littéraire d'abord ancrée dans la vieaffective et mondaine des deux écrivains, illustrant mieux qu'aucune autre la question du mimétisme tantôt destructeur et tantôt bénéfique qu'un René Girard a démêlée dans son magistral Mensonge romantique et vérité romanesque, notamment.
La surabondante jactance critique encombre les rivages de l'océanique Recherche du temps perdu de MarcelProust, mais il vaut la peine, et c'est un vif plaisir, de lire le récent Proust contre Cocteau de Claude Arnaud,très éclairante approche d'une rivalité littéraire d'abord ancrée dans la vieaffective et mondaine des deux écrivains, illustrant mieux qu'aucune autre la question du mimétisme tantôt destructeur et tantôt bénéfique qu'un René Girard a démêlée dans son magistral Mensonge romantique et vérité romanesque, notamment.  Aux abysses humains de Proust, pour commencer, c'est en effet un monstre à la fois effrayant et touchant qu'on va retrouver: un "insecte atroce", comme le disait de lui son jeune ami Lucien Daudet, pour mettre en garde Cocteau.
Aux abysses humains de Proust, pour commencer, c'est en effet un monstre à la fois effrayant et touchant qu'on va retrouver: un "insecte atroce", comme le disait de lui son jeune ami Lucien Daudet, pour mettre en garde Cocteau. Céline est à mes yeux le plus grand poète français en prose du XXe siècle, avec les traits catastrophiques de celui-ci et des qualités de style comme personne.
Céline est à mes yeux le plus grand poète français en prose du XXe siècle, avec les traits catastrophiques de celui-ci et des qualités de style comme personne.
 Je me suis rappelé les horreurs révélatrices du recueil de Catastrophes, signé Patricia Highsmith, en lisant le roman, plombé de mélancolie noire et traversé d'éclairs de lucidité, que Frédéric Jaccaud a publié récemment sous le titre de La nuit.
Je me suis rappelé les horreurs révélatrices du recueil de Catastrophes, signé Patricia Highsmith, en lisant le roman, plombé de mélancolie noire et traversé d'éclairs de lucidité, que Frédéric Jaccaud a publié récemment sous le titre de La nuit.  Départ possible d’un roman. Pensé l'autre jour que cela pourrait sortir du virtuel. Départ d'Ewa de la zone industrielle de Katowice (captée dans Import Export d’Ulrich Seidl), qui se retrouve sur l'écran d'un mec surfant sur Internet au coeur de la Cité où commence le roman sur papier.
Départ possible d’un roman. Pensé l'autre jour que cela pourrait sortir du virtuel. Départ d'Ewa de la zone industrielle de Katowice (captée dans Import Export d’Ulrich Seidl), qui se retrouve sur l'écran d'un mec surfant sur Internet au coeur de la Cité où commence le roman sur papier. Vassily Rozanov : «Toutes les religions passeront et cela restera: simplement rester assis sur une chaise et regarder au loin. »
Vassily Rozanov : «Toutes les religions passeront et cela restera: simplement rester assis sur une chaise et regarder au loin. »
