 A propos d''Un archipel dans mon bain, de Jean-Euphèle Milcé
A propos d''Un archipel dans mon bain, de Jean-Euphèle Milcé
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Euphèle Milcé sait dire beaucoup en peu de mots. Condenser : l’art du poète. La promesse de son premier roman, L’Alphabet des nuits, est tenue dans le second, Un archipel dans mon bain, autant par le choix des thèmes que par la qualité de l’écriture – cette recherche constante de la tournure nouvelle, de la phrase courte mais habitée, du mot juste, autant dans son sens que dans sa sonorité.
Evita se raconte au présent. À « quarante ans et quelques centimes », veuve d’un riche peintre « mort artiste et amoureux absolus », elle s’ennuie dans sa tristesse, en « un jour qui s’enroule méthodiquement dans mille aunes de chagrin ». Mais une courte lettre anonyme la force à avouer qu’elle a menti à propos de son passé. Non, elle n’a pas connu ses parents, qui ne possédaient certainement ni galerie à Londres, ni résidence secondaire en Grèce. Elle n’a pas de diplôme, n’a pas appris de métier. Et n’a vécu son enfance que « par saisons désaccordées ».
En parallèle nous est contée l’arrivée à Genève de Marie Raymonde, jeune femme née sur l’île bretonne d’Ouessant, qui débarque « avec un embryon de rêve » dans cette « ville de nulle part, de nulle appartenance », puis galère dans un bistrot jusqu'à être engagée dans une douteuse « agence de mannequins ».
Les chapitres développent en alternance ces deux histoires qui avancent ainsi côte à côte, jusqu’à se rejoindre, puisque l'on finit par comprendre que Marie Raymonde n'est personne d'autre qu'Evita, vingt ans plus tôt.
Retour au présent, où Evita, « déesse de la lubie », se cherche une île sur la carte du monde, un endroit où ranger son enfance et, peut-être, placer son futur. Et c’est Haïti qu’elle choisit – à moins que ce ne soit Haïti qui la choisisse. Elle quitte la maison de « ce village vaudois » où elle est arrivée après avoir changé de nom, quitte le jardin gigantesque, les amis de feu son mari, et elle s’envole de l’autre côté de l’Atlantique.
C’est là que se déroule la deuxième partie du livre. En Haïti. On retrouve alors encore plus franchement ce regard sombre et cette langue attentive, inventive, qui dominaient dans le premier roman de l’auteur. Il y a cependant modulation, car contrairement à Assaël, le narrateur de L’Alphabet des nuits, Evita est Blanche, son passeport est français, et c’est une femme, ce qui change considérablement la manière d’appréhender le monde. Assaël était Haïtien, errait donc dans ses propres terres, nous en montrait les révoltes et les peurs intestines. Evita arrive de l’extérieur, elle découvre en même temps que nous « un pays à travers ses malheurs entrelacés ». Mais Port-au-Prince reste Port-au-Prince, un « espace qui a perdu son destin de capitale », une « ville déchue qui traverse ses jours et ses nuits sans véritable rancune », qui porte toujours « les traces d’une ancienne grandeur ».
À travers trois personnages (« l’ancêtre » d'Evita, « l’arrière-grand-oncle » et celui qui « aurait pu être le grand-père ») à peine plus qu’esquissés en de courts chapitres et que l’on sent pourtant bien vivants, Milcé développe une belle réflexion sur la filiation, la mémoire, l’histoire universelle dans laquelle se fondent les histoires personnelles, les déchirements et les renouements avec des passés plus ou moins ensevelis, et puis ce thème éternel de l’errance. « En réalité, la vraie histoire n’est que celle qui nous convient. Et le reste s’identifie à l’oubli. Au patrimoine. ». Trois hommes qui ont la double fonction d’éclairer chacun un certain pan de l’Histoire, et de nous mener à travers les siècles jusqu’à Evita, puis à sa fille. Ils sont les « racines voyageuses, avaleuses de kilomètres », ballottés entre deux îles – Ouessant et Haïti –, traversant inlassablement l’Océan écartelé « entre deux continents. Deux mondes ». La généalogie, cet art « de nouer ficelles, câbles, lignes de sisal, fils de nylon, cordes de chanvre entre eux », s’exprime ici dans ce qu’elle a de plus beau et fascinant – l’ancêtre et sa descendance écorchés au fil barbelé de l’histoire du monde, qui s’y accrochent quand même, malgré tout, parce qu’ils n’ont pas le choix.
L’île, c’est l’unité qui tente de se faire une place dans l’archipel impitoyable, c’est ce morceau de terre au milieu des eaux qui lutte pour ne pas s’effondrer ni se laisser engloutir, tout en se demandant quel est le volcan qui, jadis, l’a craché au monde. L’île, dans ce roman, c’est Ouessant, c’est Genève, c’est bien sûr Haïti, et puis c’est Marie Raymonde qui deviendra Evita, c’est la petite Gaëlle, sa fille… Toutes ces îles qui forment les « éléments épars d’une tentative d’espoir ».
Bruno Pellegrino
Jean-Euphèle Milcé, Un archipel dans mon bain, Bernard Campiche Editeur, 2006, 160 pages.
Cet article est à paraître dans la dernière livraison du Passe-Muraille de juillet 2006.





 Notes avant parution
Notes avant parution émoires de porc-épic. Seuil, 229p. Après Verre cassé , l’auteur congolais le plus en vue du moment à Paris poursuit une œuvre alternant la pleine pâte du roman et les pointes de la réflexion. Il réinvestit ici l’esprit du conte à la manière africaine.
émoires de porc-épic. Seuil, 229p. Après Verre cassé , l’auteur congolais le plus en vue du moment à Paris poursuit une œuvre alternant la pleine pâte du roman et les pointes de la réflexion. Il réinvestit ici l’esprit du conte à la manière africaine.






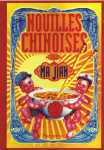




 Tracy Chapman au Montreux Jazz Festival. Après les électrochocs d’Eels, la chanteuse a fait oublier la touffeur du Miles Hall pris d’assaut par 2000 fans.
Tracy Chapman au Montreux Jazz Festival. Après les électrochocs d’Eels, la chanteuse a fait oublier la touffeur du Miles Hall pris d’assaut par 2000 fans.
 L’auteur démasqué (23)
L’auteur démasqué (23)
 C’est un film intéressant à de multiples égards que One+One dans la présente version « autorisée » par Jean-Luc Godard, assortie de plusieurs entretiens explicatifs éclairants sur sa genèse, notamment avec Jean Douchet et Christophe Conte, ainsi qu’un making of de Richard Mordaunt.
C’est un film intéressant à de multiples égards que One+One dans la présente version « autorisée » par Jean-Luc Godard, assortie de plusieurs entretiens explicatifs éclairants sur sa genèse, notamment avec Jean Douchet et Christophe Conte, ainsi qu’un making of de Richard Mordaunt.






 Une lettre de Rainer Maria Rilke
Une lettre de Rainer Maria Rilke


 Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent
Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent 



 L’Auteur démasqué (22)
L’Auteur démasqué (22)

