Hubert Haddad, dans son roman incandescent et poétique, nous fait vivre la tragédie de l’intérieur par le truchement de personnages attachants.
A l’écart des estrades, le romancier d’origine tunisienne, établi à Paris dès son enfance, a développé une œuvre considérable mais un peu méconnue, riche d’une cinquantaine d’ouvrages touchant à la poésie, à la nouvelle, à l’essai et au roman. Palestine, relevant de ce dernier genre, est un des plus beaux livres de cette rentrée.
- Quelle est la genèse de Palestine ?
- D'abord mes origines judéo-berbères, une enfance bercée par l'Orient - on parlait arabe côté adultes et vivait dans la culture maghrébine -, et la complainte du retour à Jérusalem, en "Palestine" disait ma grand-mère Baya qui, bien vieille, n'avait pas mémorisé la création de l'État d'Israël. Concrètement, j'ai abordé le sujet il y a près de vingt ans, dans un roman récemment réédité par Zulma, Oholiba des songes. Oholiba est la Jérusalem déchue de l'exode, comparée à une prostituée, dans Ézéchiel. Je me suis aperçu a posteriori que ce roman qui interroge le monde yiddish après la Shoah s'achevait à peu près où commence Palestine. Parti en Inde du sud à la recherche des judaïsme antique au Kerala, à Kranganore et à Cochin, il y a deux ans, je projetais en fait d'écrire un autre livre proche du sujet, de manière allégorique en imaginant un vieux musicien israélien d'origine polonaise déçu par la politique de son pays qui se retrouve par hasard dans la vieille synagogue de Cochin et qui se réconcilie avec son judaïsme à travers la légende du royaume de Cranganore. C'est la genèse du livre. De retour, la réalité, l'actualité du conflit m'a tellement bouleversé que j'ai abandonné ce roman pour écrire dans une certaine urgence intime ce Palestine.
- Comment vivez-vous personnellement ce conflit ?
- Dans la déchirure, sachant que les Palestiniens et les Juifs sont les enfants d'une même terre, à travers la disparité des siècles et les conversions, le flottement identitaire. Des erreurs ont été commises à tous les échelons des États et des institutions internationales, mais aujourd'hui il y a une réalité vivante qui excède les schémas qui furent ceux de l'impérialisme en déconfiture: deux peuples vivent là de manière substantielle, sans recours direct à d'autres cultures, même si la pesanteur des alliances, Occident contre monde arabe, n'arrange pas les choses. Il est temps d'inventer ensemble dans ce bout de territoire un avenir exemplaire, par l'échange culturel et scientifique, le rétablissement des droits fondamentaux de l'individu et des peuples. Ce qui est une tragédie peut devenir une chance.
- Comment avez-vous travaillé ? Le roman a-t-il fait l'objet de repérages précis?
- J'ai pas mal de proches qui vivent ou qui ont vécu en Israël, personnellement je n'ai jamais pu m'y résoudre. Mon frère Michael qui est présent dans le livre, qui effectivement a tout abandonné un jour (en 1978) pour aller vivre dans une cabane de bois de cinq mètres carrés en bordure de Jérusalem Est, était parti à vingt ans plein d'espérance, il a connu la vie de kibboutz, il était artiste peintre et enseigna à l'École des Beaux-Arts de Jérusalem. Finalement, il abandonna même sa cabane et vint se suicider à Paris, dans le Ménilmontant de l'exil. Tout ce passé, la pensée des amis musulmans et des amis juifs m'ont conduit à écrire ce roman à l'intuition, pénétré par le sentiment étrange d'une autre vie. Je ne suis pas allé à Hébron, pourtant des journalistes qui ont enquêté longuement là-bas m'ont dit qu'il y a dans Palestine une parfaite véracité tant géographique (là, bien sûr, je me suis documenté) que d'ambiance. Un romancier travaille avec une sorte d'intensité un peu hallucinatoire jusqu'à ce qu'il se sente en possession de tous les fils, les tensions, les couleurs. Mais j'irais un jour à Hébron, sur les pas de mon frère Michael et de mes personnages.
- Comment les personnages vous sont-ils apparus ? Comment les développez-vous ?
- Les personnages sont l'expression pure de mon sentiment intérieur, informulable théoriquement dans la platitude toujours sujette au manichéisme de l'analyse et de la dialectique: ils ont surgi en moi avec la force de mon émotion, de mon trouble, de mon désir infini de paix et de réconciliation entre des visages souffrants de mon histoire, de notre histoire à tous.
- Les personnages féminins semblent les porteurs, dans le roman, des seuls espoirs et d’une aspiration positive à la pacification. Est-ce valable d’une façon plus générale selon vous?
- D'un point de vue global, universel, oui: parce qu'elles peuvent remettre en question le patriarcat qui est responsable de millénaires d'exactions depuis Caïn, parce qu'elles ont en elles une expérience, une histoire propre de l'aliénation, de l'asservissement, de l'injustice. Libérées de la violence ordinaire, elles enseigneront la paix, et la fraternité à une humanité renaissante.
- Que peut un roman par rapport à la perception d'une telle tragédie?
- Le roman nous sort des schémas fermés, des oppositions aveugles. Il donne à comprendre par empathie, il peut réveiller parce qu'il touche au plus intime de l'être qui est notre partage à tous, par-delà les opinions et les communautés. Comme la peinture ou la musique, le roman voudrait restituer la nuance et la contradiction, la chair, le vivant dans son tremblement.
- Comment, personnellement, malgré la fin très sombre de Palestine, envisagez-vous l’évolution du conflit et son issue éventuelle?
- Il y aura un jour deux États souverains qui vivront dans une paix d'abord relative et bientôt entière, c'est seulement une histoire de temps, c'est-à-dire de vies humaines. Mon roman Palestine n'est pas désespéré, mais c'est une tragédie. La tragédie a des effets de catharsis, elle voudrait ouvrir le cœur et l'esprit. En cela, elle est optimiste.
 La tragédie au coeur
La tragédie au coeur
Un sentiment de plus en plus oppressant, quasi physique, assorti d'une angoisse omniprésente, saisissent le lecteur de ce roman-labyrinthe très dense et intense, dont le jeune protagoniste, Arabe de Jérusalem sous l'uniforme de Tsahal, se trouve pris dès la première séquence dans un engrenage fatal.
Attaqué par un commando de factieux palestiniens, il est blessé et dépouillé de son uniforme et de son passeport avant que ses agresseurs ne soient tous massacrés. Il se prénommait Cham jusqu'au moment d'être recueilli par une vieille Palestinienne aveugle qui voit en lui le sosie de Nessim, son fils disparu. Il sera Nessim aussi pour Falastin, la fille de l'aveugle qui le soigne et dont il tombe follement amoureux. Falastin entretient un espoir de pacification proportionné à l'horreur qu'elle a vécue lorsque son père, leader d'un front démocratique, est mort à ses côtés dans un attentat. Cham-Nessim l'Israélien pris pour un Palestinen sera planqué et piégé une seconde fois après une folle fuite, au lendemain d'une nuit avec Falastin que scelle une effusion momentanée que le retour au réel empêchera de s'incarner dans le temps à venir.
Si la tragédie du conflit israélo-palestinien est ressaisie avec une foison de détails - au milieu d'une nature merveilleusement rendue et d'un quadrillage de murs et de check-points signalant l'absurde hybris de l'homme, - qui valent tous les reportages, les péripéties de Palestine importent moins, à l'évidence, que leur résonance émotionnelle et leur valeur hautement symbolique à de multiples égards. L'écriture incisive, mais très sensible et sensuelle à la fois, qui tire parfois le roman vers la fable ou le conte poétique à l'orientale, cristallise enfin le message d'humanité et la beauté nullement esthétisante de cet admirable roman.
Hubert Haddad. Palestine. Zulma, 152p.
Cet entretien a paru dans l'édition de 24 Heures du 30 octobre 2007.







 L’épreuve de l’entrevue
L’épreuve de l’entrevue

 Suit un Who's who en travelling sur une suite de pipole surtout littéraires, de Rousseau à Milena Moser (star momentanée du roman zurichois qui ne méritait peut-être pas tant d'attention), en passant par une vingtaine d'écrivains et vaines plus ou moins significatifs (Cendrars, Bouvier, Chessex, Bichsel, Loetscher, Ella Maillart) et par quelques "figures" ou "marques" helvétiques notables, telle l'inoubliable Zouc ou notre benêt cantonal Oin-Oin, la ménagère fictive - mais très réelle question commerce - Betty Bossi et le non moins incontournable Godard, cousin reconnu d'un charpentier de Bursinel.
Suit un Who's who en travelling sur une suite de pipole surtout littéraires, de Rousseau à Milena Moser (star momentanée du roman zurichois qui ne méritait peut-être pas tant d'attention), en passant par une vingtaine d'écrivains et vaines plus ou moins significatifs (Cendrars, Bouvier, Chessex, Bichsel, Loetscher, Ella Maillart) et par quelques "figures" ou "marques" helvétiques notables, telle l'inoubliable Zouc ou notre benêt cantonal Oin-Oin, la ménagère fictive - mais très réelle question commerce - Betty Bossi et le non moins incontournable Godard, cousin reconnu d'un charpentier de Bursinel. À celles-ci j'ajouterai - oubliée par l'auteur -, celle de la délectable chronique intitulée Ma vie et relatant les tribulations européenne de Thomas Platte, chevrier de montagne en son enfance et devenu, avec des bandes d'enfants cheminant à travers l'Allemagne et la Pologne, un grand humaniste bâlois de la Renaissance, père de deux autres savants médecins que Sergio Belluz n'ignore pas plus que leur biographe Leroy-Ladurie...
À celles-ci j'ajouterai - oubliée par l'auteur -, celle de la délectable chronique intitulée Ma vie et relatant les tribulations européenne de Thomas Platte, chevrier de montagne en son enfance et devenu, avec des bandes d'enfants cheminant à travers l'Allemagne et la Pologne, un grand humaniste bâlois de la Renaissance, père de deux autres savants médecins que Sergio Belluz n'ignore pas plus que leur biographe Leroy-Ladurie... Sergio Belluz. La Suisse en kit. Editions Xénia.
Sergio Belluz. La Suisse en kit. Editions Xénia. 
 Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois
Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie qui fait que le Maurice Chappaz de l’Evangile selon Judas fait écho, jusque dans son délire prompt d’octogénaire rimbaldisant, au livre fulgurant de Pierre Michon…
Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie qui fait que le Maurice Chappaz de l’Evangile selon Judas fait écho, jusque dans son délire prompt d’octogénaire rimbaldisant, au livre fulgurant de Pierre Michon…  Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p.
Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p. Maurice Chappaz. Evangile selon Judas. Gallimard.
Maurice Chappaz. Evangile selon Judas. Gallimard.






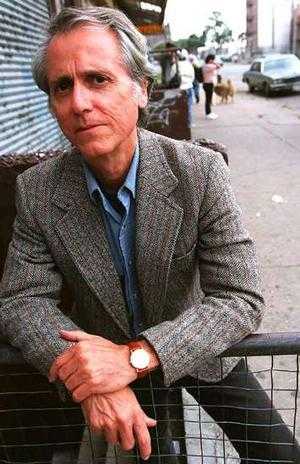
 Un ange trépasse
Un ange trépasse
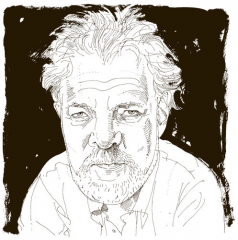





 Nabokov à son pupitre, photo de Horst Tappe.
Nabokov à son pupitre, photo de Horst Tappe.


 Pèlerinage à nos sources
Pèlerinage à nos sources

 A propos de conversation, il est par ailleurs intéressant d’observer plus précisément les dialogues d’Une vie divine, qui relèvent somme toute de la non-conversation. Toujours étincelant dans le soliloque, Philippe Sollers est en revanche incapable de moduler un vrai dialogue, l’interlocutrice (il n’a jamais d’interlocuteur) n’intervenant jamais qu’en faire-valoir, comme d’ailleurs tous les « personnages » féminins des « romans » de l’auteur.
A propos de conversation, il est par ailleurs intéressant d’observer plus précisément les dialogues d’Une vie divine, qui relèvent somme toute de la non-conversation. Toujours étincelant dans le soliloque, Philippe Sollers est en revanche incapable de moduler un vrai dialogue, l’interlocutrice (il n’a jamais d’interlocuteur) n’intervenant jamais qu’en faire-valoir, comme d’ailleurs tous les « personnages » féminins des « romans » de l’auteur.




 Bret Easton Ellis, Oeuvres complètes en 2 vol. Préface de Cécile Guilbert, suivie d'un entretien (très intéressant) de l'écrivain avec Jon-Jon Goulian, paru dans la Paris Review. Volume1, 1040p.: Moins que zéro, Les lois de l'attraction, American psycho, Zombies. Volume 2,
Bret Easton Ellis, Oeuvres complètes en 2 vol. Préface de Cécile Guilbert, suivie d'un entretien (très intéressant) de l'écrivain avec Jon-Jon Goulian, paru dans la Paris Review. Volume1, 1040p.: Moins que zéro, Les lois de l'attraction, American psycho, Zombies. Volume 2, 




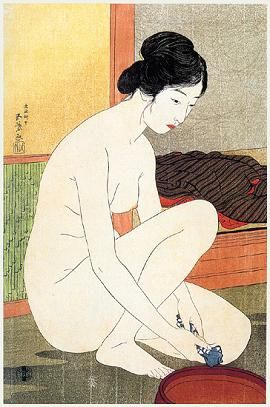
 La chimpanzée blonde est sortie, à mon insu, de la page 460 d’Une vie divine. C’est tout à fait le genre de la positiviste américaine que je rencontrai à sept reprises au cours de mes pérégrinations dans le monde et l’arrière-monde, me demandant à chaque fois à quelle Cause j’avais enfin résolu de me consacrer. L’idée que je puisse vouer ma vie à la lecture et à l’écriture l’insupportait absolument. La pire de ces réincarnations de la fameuse Petite Femme de Kafka, qui représente l’équivalent des Pépères scrutant les femmes-fontaines à la longue-vue phalloïde et tremblotante de culpabilité, me traqua sept jours durant dans les rues de Cordoue, avant que je ne la semasse (ceci est un subjonctif andalou typique) dans les enchevêtrements de la Mezquita.
La chimpanzée blonde est sortie, à mon insu, de la page 460 d’Une vie divine. C’est tout à fait le genre de la positiviste américaine que je rencontrai à sept reprises au cours de mes pérégrinations dans le monde et l’arrière-monde, me demandant à chaque fois à quelle Cause j’avais enfin résolu de me consacrer. L’idée que je puisse vouer ma vie à la lecture et à l’écriture l’insupportait absolument. La pire de ces réincarnations de la fameuse Petite Femme de Kafka, qui représente l’équivalent des Pépères scrutant les femmes-fontaines à la longue-vue phalloïde et tremblotante de culpabilité, me traqua sept jours durant dans les rues de Cordoue, avant que je ne la semasse (ceci est un subjonctif andalou typique) dans les enchevêtrements de la Mezquita.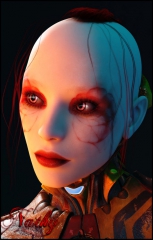



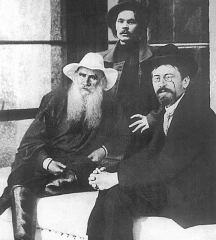


 Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.
Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.





 Entre Balzac et les Russes
Entre Balzac et les Russes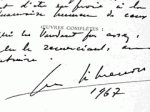




 Loin de donner dans la jobardise au goût du jour, pas plus que dans le trop facile persiflage, Philippe Lafitte (re)construit un beau personnage de nature hypersensible, fragile, angoissé par le vide (au tout début de sa métamorphose, Sandy réduit l’œuvre d’Andy à ce même vide) et cherchant un nouveau sens à sa vie, équivalant finalement à une sorte de renaissance d’Andy. Parallèlement, loin d’être réduite à l’hystérique déséquilibrée dont on garde l’image, Valerie Solanas se trouve comme « sauvée » par le romancier, ou plus précisément par la rencontre « magique » de Sandy. Dans la foulée, on ne manquera pas de remarquer l’humour de la situation, qui fait se côtoyer, puis s’aimer presque, les deux marginales en quête d’un peu de bonheur compensant leur inassouvissement profond.
Loin de donner dans la jobardise au goût du jour, pas plus que dans le trop facile persiflage, Philippe Lafitte (re)construit un beau personnage de nature hypersensible, fragile, angoissé par le vide (au tout début de sa métamorphose, Sandy réduit l’œuvre d’Andy à ce même vide) et cherchant un nouveau sens à sa vie, équivalant finalement à une sorte de renaissance d’Andy. Parallèlement, loin d’être réduite à l’hystérique déséquilibrée dont on garde l’image, Valerie Solanas se trouve comme « sauvée » par le romancier, ou plus précisément par la rencontre « magique » de Sandy. Dans la foulée, on ne manquera pas de remarquer l’humour de la situation, qui fait se côtoyer, puis s’aimer presque, les deux marginales en quête d’un peu de bonheur compensant leur inassouvissement profond.


