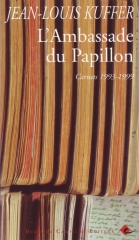Annie Dillard: "Pourquoi lisons-nous, sinon dans l'espoir d'une beauté mise à nu, d'une vie plus dense et d'un coup de sonde dans son mystère le plus profond ?"
Ce mercredi 3 août. – Conduisant ce matin Lady L. à l’hôpital, après sa très mauvaise chute dans le sentier de La Désirade, j’ai fait l’acquisition, en me baladant à Montreux, du Dragon du Muveran de Marc Voltenauer, ce polar nordico-préalpin dont on a beaucoup parlé dans nos régions (où il « cartonne » véritablement, ayant dépassé les 20.000 exemplaires) et que je suis curieux de juger par moi-même. Au vu de la moue ou des propos dédaigneux de plusieurs lettreux a priori contrariés par toute forme de succès populaire, et dans la foulée du phénomène Dicker, je m’en fais pour ainsi dire un malin devoir…

(Soir) - Contre toute attente, j’ai tout de suite été « scotché » par la lecture du Dragon du Muveran, aux chapitres brefs et bien ancrés dans le pays, sans trop donner pour autant dans le réalisme terrien pour ne pas dire lourdement terre à terre. L’auteur n’a d’ailleurs rien du littérateur de terroir, en phase (comme on dit) avec la société actuelle, ne serait-ce qu’avec son arrière-fond de classe moyenne émancipée (sur les hauts de Gryon où prolifèrent les résidences secondaires) et son inspecteur gay cultivé lancé dans une enquête carabinée.
°°°
Petits emmerdements physiques de l’âge. Vives douleurs plantaires, soudaines lancées articulaires aux genoux, crampes cruelles la nuit et souffle court le jour en remontant la pente. Eh mais, on se passerait bien de tout ça, pourtant il paraît que « c’est la vie »…
°°°
 Il y a pas mal de temps que j’avais entrepris la lecture du Secret de Tchékhov de Wanda Bannour, puis je l’ai laissé de côté, lui trouvant un air par trop didactique à la russe, mais c’était injuste me dis-je à reprendre cette étonnante reconstitution de la vie littéraire à la fin du XIXe siècle, par le truchement d’un journal fictif de Souvorine et d’écrits non moins fictifs de Tchékhov. Wanda Bannour a visiblement tout lu à propos de l’un et de l’autre, et ce que j’ai cru d’abord le regard d’un bas-bleu recomposant laborieusement un pseudo-journal, se déploie à vrai dire en récit romanesque très documenté et très vivant, que j’ai repris avec autant d’intérêt que de plaisir. Bref, je me suis amendé, et j’aime bien aussi ce mouvement de réexamen qui n’est pas tant de repentir que d’exigence de plus d’attention. J’avais mal regardé, etc.
Il y a pas mal de temps que j’avais entrepris la lecture du Secret de Tchékhov de Wanda Bannour, puis je l’ai laissé de côté, lui trouvant un air par trop didactique à la russe, mais c’était injuste me dis-je à reprendre cette étonnante reconstitution de la vie littéraire à la fin du XIXe siècle, par le truchement d’un journal fictif de Souvorine et d’écrits non moins fictifs de Tchékhov. Wanda Bannour a visiblement tout lu à propos de l’un et de l’autre, et ce que j’ai cru d’abord le regard d’un bas-bleu recomposant laborieusement un pseudo-journal, se déploie à vrai dire en récit romanesque très documenté et très vivant, que j’ai repris avec autant d’intérêt que de plaisir. Bref, je me suis amendé, et j’aime bien aussi ce mouvement de réexamen qui n’est pas tant de repentir que d’exigence de plus d’attention. J’avais mal regardé, etc.
°°°
Je suis impressionné par la lecture de Clous, recueil de poèmes d’Agota Kristof publié à titre posthume. Poésie très noire, apparemment désespérée comme l’était celle de Francis Giauque, et pourtant non: il y a là-dedans de la lumière et de la musique, qu’il m’incombera de détailler plus précisément.
°°°
Ce lundi 15 août. – C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de Reynald, le 15 août 1985. J’ai retrouvé récemment le poème que je lui avais consacré, repris et amélioré, dont l’abbé Vincent, à qui je l’ai envoyé, m’a dit qu’il l’avait beaucoup touché.

À l’ami disparu
En mémoire de Reynald.
Ce soir j’avais envie de te téléphoner, comme ça, sans raison,
pour entendre ta voix, comme tant d’autres fois.
Après tout c’était toi, déjà, ces longs silences.
Mais je sais bien, allez vous étiez occupés :
les patients, les enfants, l’éternelle cadence.
Ce n’était plus, alors, le temps de nos virées
au biseau des arêtes ;
ou comme ces années en petits étudiants dans l’étroite carrée :
les rires, avec ta douce, que nous faisions alors !
L’emmerdeur d’en dessous qui cognait aux tuyaux.
tout ce barnum : la vie !
Et ce soir de nouveau j’aurais aimé semer
un peu ma zizanie.
Ou parler avec toi, comme tant d’autres fois.
J’avais presque oublié ce dimanche maudit,
cette aube au bord du ciel
au miroir effilé,
la griffe de ta trace
au-dessus des séracs.
Tu vaincras, tu vaincras scandes-tu : tu vaincras!
L’orgueil de ton défi !
Mais soudain à la Vierge là-haut qui te bénit -
à toi sans le savoir est lancé le déni
d’une glace plus noire.
Ce dimanche maudit, juste à ton dernier pas.
Et ce cri ravalé, et ce gouffre creusé.
Et l’effroi des parois – et la mort qui se tait…
Sais-tu que je t’en veux ce soir,
ami, parti tout seul
comme un bandit !
(ce 13 décembre 1987,
après le 15 août 1985)
°°°
Que pèse la douleur en poésie ? Ou plus exactement_ que pèse la poésie devant la souffrance des hommes ? Le philosophe allemand Theodor Adorno a écrit ceci, dont on a fait un usage souvent réducteur, mais il l’a bel et bien écrit : «Plus la société devient totalitaire, plus l’esprit y est réifié et plus paradoxale sa tentative de s’arracher à la réification de ses propres forces. Même la conscience la plus radicale du désastre risque de dégénérer en bavardage. La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes ».
Avec le recul, et après les multiples nuances apportées à cette « interdiction » de la poésie par Adorno, la réflexion sur le rôle et la valeur de la poésie face à la barbarie, autant que celui de l’art, est à reprendre plus sereinement dans la foulée de l’Esthétique hégélienne, etc.
Pour ma part, j’ai toujours préféré la compagnie des poètes à celle des philosophes, exception faite des penseurs qui sont à la fois artistes et poètes, de Pascal à Sloterdijk.
 Ce samedi 20 août. – Il m’est arrivé hier quelque chose que je n’imaginais pas avant-hier, consistant à découvrir un livre d’un écrivain norvégien quadra qui pourrait être mon fils par l’âge, comme je pourrais être le petit-fils de Marcel Proust si la Providence en avait eu la fantaisie, et dont la démarche autobiographique visant l’inatteignable absolu du TOUT DIRE, à la fois courageuse et vouée au scandale, recoupe celle des carnets que je tiens depuis la fin des années 60 - où, précisément, cet auteur du nom de Karl Ove Knausgaard a vu le jour -, dont j’ai publié plus de 2000 pages sur lesquelles seules 500 pages, dans le volume intitulé L’Ambassade du papillon, traduisent cette aspiration au TOUT DIRE puisque je n’y ai fait aucune retouche en dépit de coupes nécessitées par le format du livre, entre autres pages jugées impubliables par l’éditeur
Ce samedi 20 août. – Il m’est arrivé hier quelque chose que je n’imaginais pas avant-hier, consistant à découvrir un livre d’un écrivain norvégien quadra qui pourrait être mon fils par l’âge, comme je pourrais être le petit-fils de Marcel Proust si la Providence en avait eu la fantaisie, et dont la démarche autobiographique visant l’inatteignable absolu du TOUT DIRE, à la fois courageuse et vouée au scandale, recoupe celle des carnets que je tiens depuis la fin des années 60 - où, précisément, cet auteur du nom de Karl Ove Knausgaard a vu le jour -, dont j’ai publié plus de 2000 pages sur lesquelles seules 500 pages, dans le volume intitulé L’Ambassade du papillon, traduisent cette aspiration au TOUT DIRE puisque je n’y ai fait aucune retouche en dépit de coupes nécessitées par le format du livre, entre autres pages jugées impubliables par l’éditeur
Or Knausgaard a poussé le bouchon bien au-delà de ce qu’on pourrait dire la ligne rouge de la pudeur ou de la protection de son entourage, et d’emblée la lecture de La Mort d’un père m’a saisi et passionné, mais à la fois conforté dans mon actuelle position de réserve personnelle qui aurait dû m’interdire, en principe, de blesser des personnes vivantes en les nommant dans un livre publié - ce que j’ai pourtant fait dans L’Ambassade du papillon...
Ce qui m’intéresse alors dans le cas de Knausgaard, dont la démarche est aussi radicale et peut-être détestable (lui-même dit détester ce qu’il écrit et regretter de se comporter en « tueur ») que littéraire, c’est précisément que son apparence « brute de décoffrage » va bel et bien de pair avec une démarche littéraire de type proustien transposée dans notre époque de langage avarié et d’indiscrétion généralisée, avec une vivacité narrative, une limpidité et une originalité dans les variations de focale de son observation qui relève de la littérature considérée comme une sorte de journal de bord de l’humanité, ainsi que la définissait John Cowper Powys.
C’est à cause de Proust que j’ai découvert hier Knausgaard, ou plutôt grâce à l’une de mes libraires préférées, du nom de France Rossier, à la librairie La Fontaine de Vevey (on parque sur la Grand’Place et c’est à droite au début de le rue du Lac très prisée ces jours par les touristes de partout), à laquelle j’ai d’abord dit mon peu d’empressement de lire les livres de la rentrée, assez occupé que je suis ces jours à (re)lire l’intégrale de la Recherche du temps perdu à raison de dix pages par jours, et cinq ou sept autres livres de la pile de cinq ou sept cents qui attendent.
Du moins lui ai-je acheté, par curiosité, le roman écrit à dix-huits mains par les kids de l’AJAR, sous le beau titre de Vivre près des tilleuls ; le dernier recueil de textes d’Erri De Luca intitulé Le plus et le moins, deux récits de l’écrivain-voyageur Richard Kapuscinski (Il n’y aura pas de paradis et Le Christ à la carabine) et un roman islandais que m’a recommandé un vieil ami de Facebook, le tout jeune Maveric (moins de 20 ans), D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds, signé Jón Kalman Stefánnson.
Or au moment où j’allais payer cette (bonne) pioche, France Rossier me dit « attendez voir ! », et la voici se diriger vers le rayon des poches d’où elle revient avec cette Mort d’un père de Knausgaard qu’elle tenait à m’offrir gracieusement, me promettant la lecture d’une autobiographie tellement hors du commun, voire invraisemblable, qu’on pouvait subodorer une affabulation, mais enfin j’en jugerais, en tout cas si ce n’était pas Proust ça y faisait penser parfois.

Et de fait, deux quarts d’heure plus tard, attablé devant une Suze sur la terrasse du café du Signal (à gauche en montant la route qui conduit au Vallon de Villard par les Bains de l’Alliaz, dont le patron est top sympa), je trouvai, dans les premières pages de La mort d’un père, consacrée à notre façon de planquer les morts sous des draps (au bord de la route en cas d’accident de voiture, ou à la morgue) et d’en évacuer la réalité physique sous terre, etc., puis dans les pages qu’il consacre à l’immuabilité des yeux dans un visage (on vérifie au selfie ou sur les derniers portraits de Rembrant), ou encore à la redoutable réalité que représentent les soins d’une enfant en bas âge et les vacations ménagères d’un père moderne, au détriment de sa passion d’écrire, quelque chose d’effectivement proustien chez cet écrivain qui confesse d’ailleurs avoir « bu la Recherche du temps perdu » et dont un thème de la réflexion narrative porte immédiatement sur notre situation dans le Temps…
°°°
 La façon dont Knausgaard parle, la quarantaine passée, du premier regard porté sur les jeunes filles en fleurs de son adolescence, m’a aussitôt projeté quarante ans en arrière, comme la première apparition de son père, en train de jardiner, m’a rappelé le nôtre retournant un carreau de terre pour y trouver tantôt un tibia et tantôt un crâne – la terre de notre jardin provenant de l’excavation de l’ancien cimetière de la Sallaz sur les hauts de Lausanne…
La façon dont Knausgaard parle, la quarantaine passée, du premier regard porté sur les jeunes filles en fleurs de son adolescence, m’a aussitôt projeté quarante ans en arrière, comme la première apparition de son père, en train de jardiner, m’a rappelé le nôtre retournant un carreau de terre pour y trouver tantôt un tibia et tantôt un crâne – la terre de notre jardin provenant de l’excavation de l’ancien cimetière de la Sallaz sur les hauts de Lausanne…
°°°
Les écrivains qui attaquent le roman familial (dont un Philippe Sollers) ou le réalisme prétendument « populiste » (un Charles Dantzig) me font sourire, me rappelant un Alexandre Zinoviev fustigeant l’idéologie soviétique avec une furia d’idéologue soviétique, ou que tous ceux qui brocardent le nombrilisme des autres avant de tout ramener à eux.
°°°
Knausgaard n'écrit pas un roman familial : il écrit la vie.
°°°
Il est clair, à mes yeux, que la meilleure littérature me ramène à moi, mais ce moi est propre à tous. L'on voit ces jours un collectif de jeunes écrivains romands, attroupés sous le sigle de l’AJAR, s'en prendre au moi sempiternel de l'auteur « classique » pour lui opposer leur travail de groupe tellement plus convivial et libéré du nombrilisme, n’est-ce pas.

Or cette niaiserie « jeuniste » à peut-être du bon momentanément, comme tout exercice sportif ou artisanal, classe de violon ou atelier d’écriture à Missoula. Mais ensuite ? Qui fait les vrais livres ? Qui d’autres que des cinglés solitaires, des âmes sensibles perdues sur un atoll au milieu de la foule, un Bouvier ou un Cendrars et pas un collectif de groupies de Bouvier ou de Cendrars, etc. Une chose est de construire une bonne série télévisée, genre Six Feet under, et ça peut se faire en collectif de pros de haut niveau, mais autre chose est d’écrire la première page de La mort d’un père, où se trouve décrit le mécanisme inéluctable de la mort d’un corps humain au milieu des objets qui l’entourent, globalement indifférents au phénomène, ou le début du Voyage au bout de la nuit ou la scène de la mort du prince André dans La guerre et la paix, etc.
°°°
 « La littérature me semble ce qui fait essayer de sortir de soi pour parler de tous », écrit fort justement Charles Dantzig dans Les écrivains et leur mondes, paru récemment dans la collection Bouquins et constituant un exceptionnel creuset de jugements (et parfois de préjugés) sur la littérature précisément, avec le défaut ( ?) de tous les écrits personnels de privilégier les goûts personnels de l’auteur.
« La littérature me semble ce qui fait essayer de sortir de soi pour parler de tous », écrit fort justement Charles Dantzig dans Les écrivains et leur mondes, paru récemment dans la collection Bouquins et constituant un exceptionnel creuset de jugements (et parfois de préjugés) sur la littérature précisément, avec le défaut ( ?) de tous les écrits personnels de privilégier les goûts personnels de l’auteur.
°°°
Le TOUT DIRE en matière d'intimité, en cette époque d'exhibition exponentielle, licite et consommable à grande échelle, commercialisable et donc industrialisée, est paradoxalement plus délicat, voire difficile, pour un écrivain d'aujourd'hui, et notamment pour ce qui touche aux sensations et aux sentiments réels éprouvés par un enfant ou un adolescent confronté à l'éveil de la sensualité ou à une première passion, au premier sperme ou au premier sang.
Je note ce qui précède en marge des pages de La mort d'un père consacrées au premier sperme, dont il remarque l’odeur de mer, et au premier délire amoureux du jeune Karl Ove, suscité par une certaine Hanne, officiellement petite amie d'un autre gars de leur âge, par conséquent plus ou moins inatteignable, mais dont l'intensité folle, plus fantasmatique que réellement incarnée, rappelle les sentiments non moins extrêmes éprouvés par le Narrateur de la Recherche à l'égard de la petite Gilberte Swann qui le chambre, le snobe, l'attire et le repousse comme il le fait lui-même pour attiser et désamorcer puis relancer sa jalousie, etc.
°°°
Dire que la mort n'existe pas semble un paradoxe, et pourtant il y là une vérité que j'ai reconnue en lisant les derniers mots d'une grande épopée romanesque serbe intitulée Migrations et que mon ami Dimitri appelait le plus beau roman du monde, à savoir: "Les migrations existent. La mort n'existe pas".
Je dirais plus précisément à l'instant (mon i-Phone indique 9h.14) que la mort n'existe qu'aux yeux de la vie humaine, sans préjuger de ce que ressentira notre chien Snoopy devant mon cadavre si je défunte avant lui comme c’est fort probable...
Karl Ove Knausgaard a vu son premier mort à l'été 1998, alors qu'il allait sur ses trente ans, le cadavre étant celui de son père. Tandis qu'il se trouvait là avec son frère Yngve, le bruit d'une tondeuse à gazon, à côté de la chapelle où reposait le défunt, lui fit craindre un instant que celui-ci ne se réveille, sous le regard vaguement narquois de son frère aîné. Et lui de noter une quinzaine d'années plus tard: « Ce fut un instant horrible: Mais lorsqu’il fut passé et que malgré tout le bruit et les émotions mon père demeura immobile, je compris qu’il n’existait pas, Le sentiment de liberté qui m’envahit alors fut aussi difficile à maîtriser que les vagues de tristesse l’avaient été et il trouva la même échappatoire: un sanglot totalement indépendant de ma volonté ».
Or je me rappelle que le même type de sanglot, irrépressible, m'a secoué au volant de notre voiture quand ma nièce (et filleule) Virginie m'a annoncé, sur mon portable, que mon frère venait de mourir, et c'était en 1997, alors qu'il n'était âgé que de 55 ans.
°°°

Je note ces détails ce matin d'une parfaite limpidité (nous avons la chance de ne pas avoir de parents ou d'enfants sous les décombres de tel village d'Ombrie ou de telle ville de Syrie) en me rappelant les pages de La mort d'un père consacrées à ce que je viens d'évoquer, où Karl Ove Knausgaard parle aussi de son rapport avec un monde dans lequel on taxe d'irréalité ce qui est précisément le plus réel, et de réel ce qui relève du fantasme.
°°°
D'aucuns affirment que le seul amour de Marcel Proust fut sa mère, transformée en grand-mère dans la Recherche. Un biographe moyennement subtil affirme que le cher Marcel était une femme du point de vue sexuel. André Gide, lui, reprocha à Proust de faire de son chauffeur et gigolo hétéro corse Agostinelli une Albertine probablement lesbienne à ses heures. Certains célèbrent le côté fiction de la Recherche. D'autres estiment que Proust n'a rien inventé, etc.

Quant à moi je pense que tout se tient dans cet imbroglio, dont le noyau est un coeur de réacteur atomique auquel sont reliés tous les points de la circonférence personnelle et familiale, sociale et pour ainsi dire universelle de la réalité perceptible puisque l'écrivain est aussi curieux de mode féminine que d'info récente (les avatars de l'affaire Dreyfus ou la visite à Paris du tsar de toutes les Russies), des progrès de la médecine ou de la vie des salons littéraires, des bordels pour messieurs aimant les messieurs ou des goûters de femmes riches parlant stratégie militaire, de tous les parlers populaires ou du snobisme et de l'imbécilité des gens les plus en vue, etc.
°°°
 Le TOUT DIRE de Proust peut être obscène, mais il n'est jamais vulgaire. il en va de même du TOUT DIRE de Knausgaard, qui est plus direct que celui de Proust sans être vulgaire non plus. La langue de Proust, extraordinairement artiste, parfois surchargée comme le salon de Sarah Bernhardt croulant de bimbeloterie plus ou moins exotique au milieu des plantes d'ornement vivantes ou peintes, des meubles tarabiscotés et des brûle parfums ou des oiseaux vivants ou empaillés - la phrase de Proust est fin-de-siècle comme celle de Knausgaard est début-de-siècle, par exemple quand il est avec son grand frère dans la salle d'attente des pompes funèbres (qu'il compare à celle d'un dentiste) en vue de l'enterrement de leur père, avec ce bout de dialogue qui fait court pour en dire long:
Le TOUT DIRE de Proust peut être obscène, mais il n'est jamais vulgaire. il en va de même du TOUT DIRE de Knausgaard, qui est plus direct que celui de Proust sans être vulgaire non plus. La langue de Proust, extraordinairement artiste, parfois surchargée comme le salon de Sarah Bernhardt croulant de bimbeloterie plus ou moins exotique au milieu des plantes d'ornement vivantes ou peintes, des meubles tarabiscotés et des brûle parfums ou des oiseaux vivants ou empaillés - la phrase de Proust est fin-de-siècle comme celle de Knausgaard est début-de-siècle, par exemple quand il est avec son grand frère dans la salle d'attente des pompes funèbres (qu'il compare à celle d'un dentiste) en vue de l'enterrement de leur père, avec ce bout de dialogue qui fait court pour en dire long:
"Pauvre papa, dis-je.
Yngve me regarda.
- S'il ya quelqu'un qui ne mérite pas la pitié, c'est lui.
- Je sais, mais tu vois ce que je veux dire.
Il ne répondit pas. D'abord grave pendant quelques secondes, le silence devint tout simplement du silence".
°°°
Définir le genre d'une œuvre littéraire d'envergure est aussi délicat, parfois, que de classer une œuvre d'art. L'un des meilleurs livres de Georges Simenon, Pedigree, est un roman autant qu'une autobiographie, alors que les prétendus romans de nombreux auteurs contemporains ne sont que des auto-fictions ou des journaux intimes déguisés qui accusent une pauvreté d'imagination totale.
Ce qui apparie Proust et Knausgaard est alors peut-être là: dans leur imagination respective, qui leur fait donner vie à des cendriers ou des miettes de brioches, à savoir: la symphonie des sentiments humains et les intermittences du coeur.
Personnellement, je n'ai jamais été obligé par mon père de pêcher le cabillaud avant de foncer à l'école, et mon père n'a pas fini dans la déchéance alcoolique, mais la façon de sensibiliser ces épisodes, comme l'évocation de la campagne norvégienne traversée par les deux frères en début de deuil, me touchent autant que l'incommensurable tristesse de Marcel après la mort de sa grand-mère ou la beauté tout à fait gratuite d'une robe d’une ancienne cocotte se la jouant grande bourgeoise, lorsque le jeune Narrateur vexé de se voir largué par sa petite amie va faire du charme à la mère de celle-ci en lui faisant entendre qu'il ne tient plus du tout à sa fille pour que ça se répète et tourne peut-être à son avantage - enculage de mouches qui aboutit à cette phrase d'anthologie:
“Les jours où Mme Swann n’était pas sortie du tout, on la trouvait dans une robe de chambre de crêpe de Chine, blanche comme une première neige, parfois aussi dans un de ces longs tuyautages de mousseline de soie, qui ne semblent qu’une jonchée de pétales roses ou blancs et qu’on trouverait aujourd’hui peu appropriés à l’hiver, et bien à tort. Car ces étoffes légères et ces couleurs tendres donnaient à la femme - dans la grande chaleur des salons d’alors fermés de portières et desquels les romanciers mondains de l’époque trouvaient à dire de plus élégant, ce qu’ils disaient “douillettement capitonnés” - le même air frileux qu’aux roses qui pouvaient y rester à coté d’elle, malgré l’hiver, dans l’incarnat de leur nudité, comme au printemps”.

Bref, tout ca n'est que littérature, mais c'est la vie même et pour tout dire: c'est le parfum de la vie transformée et quintessenciée, etc.
Ce mercredi 31 août. – J’ai comme l’impression que mes variations sur la lecture de Karl Ove Knausgaard, modulées en suite sous le titre de Pour tout dire, sont en train de devenir un texte en soi, distinct de ces carnets. Je vais donc leur réserver un espace propre, qui pourrait bien devenir un livre en soi…

Quant à ces carnets, je vais continuer à les tenir avec cette légère distance qui marque tout ce que j’écris désormais par rapport à mon « vécu », comme on dit, etc.
°°°
Peter Handke, dans L'heure de la sensation vraie: «Dans la mesure où le monde se remplissait pour lui de secrets, il s'ouvrait et pouvait être reconquis. Lorsqu'il traversa un pont à proximité de la gare de l'Est, il vit en bas, à côté de la voie, un vieux parapluie: il n'était plus une indication pour autre chose, mais un objet en soi, beau ou laid, beau et laid, tout ensemble avec tous les autres».