
RENCONTRE Nullarbor, prix Nicolas Bouvier 2007 et cité parmi les 20 meilleurs livres 2007 du magazine Lire, marque l’apparition d’un écrivain de forte trempe : David Fauquemberg. Vient de reparaître en Folio !
L’Aventure, au sens le plus fort, d’un combat de l’homme avec la nature, et contre lui-même, tel que l’ont célébré un Melville ou un Hemingway, est-elle encore possible aujourd’hui ? Elle l’a été doublement pour David Fauquemberg, puisque c’est en forcené qu’il l’a vécue dans sa vingtaine avant d’en tirer un véritable roman initiatique.
- D’où le goût du voyage vous vient-il ?
- Je suis né en 1973, à Saint-Omer, mais j'ai grandi aux frontières du bocage normand - l'horizon à 20m, des clôtures, des haies d'arbres, pas étonnant que les grands espaces m'attirent ! Très tôt, je me suis mis à lire comme un malade tout ce qui me tombait sous la main, Jules Verne, Stevenson, London, Balzac, Flaubert, Giono, puis très vite Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Cendrars, Conrad, Melville, Knut Hamsun, Guimaraes Rosa, Faulkner (le grand choc de mes vingt ans, que je relis régulièrement, en anglais, et qui me met sur le cul à chaque fois), etc. Mais aucun rapport d'érudition ni de vénération dans tout cela : j'ai ce défaut/qualité d'oublier très vite, en surface, ce que je lis. Impossible de me souvenir de l'exacte intrigue, des personnages, de citations. Mais il me reste des sensations, très fortes, des images, des ambiances. J'ai un rapport excessivement physique à l'écrit, d'où la radicalité de certains choix, qui me font sans doute passer à côté de certains auteurs : j'aborde le livre comme dans un combat à mains nues, et si le contact ne s'opère pas, si le livre ou moi refusons le combat, je laisse tomber. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à justifier rationnellement mes préférences/rejets, ce qui me vaut bien des disputes ! Bref, à 17 ans direction Paris, études littéraires, philosophie, années de voyages (j'ai écrit ma maîtrise, L'artiste et la cité chez Platon, sur le pont d'un voilier, entre le Cap-Vert et les Antilles) et de lecture, de cinéma (jusqu'à trois films par jour !) A 25 ans, je me retrouve prof de philo le temps d'une année (perdu dans les forêts de Laponie, j'ai loupé la rentrée d'une semaine...), puis je me barre, excédé, en Australie - plus que l'aspect pédagogique, c'est la rigidité temporelle du métier, la répétition, qui m'ont fait fuir. Et puis je voulais voir du pays, j'étais en quête d'intensité. En Australie, je passe deux ans entre Melbourne où je suis basé, et les quatre coins du pays quand je m'éclipse. Nullarbor correspond aux derniers mois de ce voyage, les plus durs. Retour fulgurant (plus de visa) juste après ce périple dans l'Ouest, laissant derrière moi un amour, des amis. Je rentre cassé, littéralement, en France. Pas de boulot, pas d'argent, pas de chez moi. J'essaie de digérer ce voyage mais, cette fois, je ne sais pas quoi en faire. Les images, les sensations se bousculent, je suis hanté. Alors je commence à écrire, d'abord pour remettre de l'ordre, apprivoiser ce chaos. Comme le boxeur qui se réveille dans le vestiaire, se rappelle vaguement avoir baissé la garde au 2e round, et "refait le combat" pour tenter de comprendre comment il s'est retrouvé KO au 6e. Mais j'ai aussitôt compris qu'il ne suffirait pas de jeter les événements sur le papier, tels quels, pour me les approprier. Qu'il allait falloir trouver une langue, une structure. Bref, écrire. Ce que je n'avais jamais fait, à part de timides essais de poésie. Là, je ne pouvais plus me défiler, j'étais hanté, et puis j'avais le temps puisque pas de travail, l'appartement d'un ami à Paris, j'ai passé un an à écrire sans arrêt, dans l'inspiration du moment, dans le désordre.
- Comment avez-vous construit Nullarbor ?
- L'écriture, pour moi, c'est la pratique d'une certaine intensité, c'est proche de la musique, mélange fragile du jeu et d'une nécessaire rigueur, au service d'une voix, aspect le plus crucial à mon sens de la chose littéraire. C'est aussi le moyen de transmettre cette intensité au lecteur, un vecteur d'émotion, de révolte, de violence. C'est une discipline et un combat. Pendant sept ans, j'ai retravaillé le texte, essuyant plusieurs refus d'éditeurs pour des versions intermédiaires. Et pour gagner ma vie, j'ai écrit des guides, je suis devenu traducteur, j'ai fait des petits boulots. Et puis ma femme Christine m'a rejoint depuis l'Australie, Pablo est né en 2002, Ulysse en 2004. Contrairement aux clichés souvent véhiculés (l'écrivain maudit, sans amour, sans enfants...), ce cadre familial m'a aidé à venir à bout de ce livre, en m'obligeant à utiliser au mieux le peu de temps que j'avais. M'interdisant, en outre, de par les innombrables sacrifices consentis de part et d'autre, de baisser les bras devant les refus, nombreux, des éditeurs. Dès 2003, Alain Dugrand apparaît (l'Ange gardien de ma dédicace), se prend d'affection pour mon texte, m'encourage, me conseille, me relit encore et encore, tente de me faire publier. Courant 2006, enthousiasmé par la présente version du texte, il en parle à Michel Le Bris, qui publie Nullarbor et le défend farouchement.
- Dans quelle mesure vous identifiez-vous au narrateur ?
- L'expression même de "m'identifier au narrateur" me semble inappropriée, dans la mesure où ce narrateur se caractérise par l'érosion progressive, la quasi abolition de son identité. Mais je me reconnais dans sa présence au monde, dans le fait que ce qui le définit, c'est ce qu'il traverse et le regard qu'il porte sur les événements. Il n'est, en quelque sorte, que le point de convergence de toutes ses expériences, c'est-à-dire rien. La trajectoire est bien sûr recomposée - comment un point isolé aurait-il conscience, sur le moment, d'appartenir à une trajectoire ? Mais cette trajectoire n'est pas artificielle, c'est la logique même du récit, qui s'est imposée d'elle-même par une sorte de développement organique, presque miraculeux, et qui sert de fil directeur sous-jacent. Car c'était là l'un des défis de ce projet d'écriture : comment donner une unité, une structure, au récit d'un voyage ? Il me semblait intéressant de traiter le voyage avec le même soin romanesque qu'une histoire d'amour, qu'un roman policier, etc. Ce qui à mon sens n'a pas été tellement fait - sauf peut-être Kerouac dans certaines de ses œuvres, ou Bouvier dans Le Poisson-Scorpion. Quant à savoir dans quelle mesure cette trajectoire reflète l'exact déroulé des faits, du voyage réel (mais existe-t-il seulement un voyage "réel" ? Don Quichotte, lui, voyage, pas l'insupportable Sancho), cela m'importe peu. La part de l'imagination (pendant le voyage, pendant l'écriture) me semble impossible à mesurer, d'autant que cette histoire, ce sont quelques mois de voyage et sept ans d'écriture.
- Avez-vous pris de notes au cours du voyage ?
- Pas la moindre - je voyageais ! Je me disais l'autre jour qu'écrire en essayant de se souvenir comment on a scié une branche est aussi périlleux de que manier la hache en pensant à comment l'écrire... C'est la raison pour laquelle si peu de récits de voyage trouvent grâce à mes yeux : le voyage est souvent écrit avant même de se faire, et l'écrit est mort à force de tordre le voyage pour en faire un bien consommable, et de s'accrocher comme un banc de moule à la "vérité" des faits. Pour moi, l'écriture ne peut pas être documentaire. Je lis d'ailleurs très peu d'ouvrages scientifiques ou documentaires. Je ne veux pas rapporter des faits ou des idées par écrit, mais créer du réel, des sensations, des émotions à l'aide des mots, ce qui est fort différent. L'imagination fait partie intégrante de notre manière de percevoir le monde et ceux qui l'habitent.
- Comment travaillez-vous ?
- Je conçois d’abord une première version, assez vite, disons en un an. Suit alors un lent et long processus de raffinage, avec mille et une réécritures - réécritures en effet, car je ne travaille pas par retouches ponctuelles mais réécris des pans entiers de texte - un chapitre, deux, et plusieurs fois le livre entier, d'une traite, en deux ou trois semaines. Par deux fois, j'ai même réécrit mon livre en partant d'une page blanche, sans m'appuyer sur la version précédente. C'était nécessaire, car je voulais obtenir un récit organique, dense et éclaté à la fois, avec un soubassement d'un seul tenant, malgré les ellipses, les raccourcis, les sauts et changements de rythme - c'est le récit d'un voyage... Donc, toutes proportions gardées, chaque réécriture devait se faire d'un seul geste, un peu à la manière de la calligraphie chinoise, avec son trait unique. A la fondation Miro de Barcelone, il y a ce tableau tardif, dans une des salles du haut, un simple trait de pinceau noir, oblique, parfait, harmonieux. Avec ce commentaire : "Je sais que certains se gausseront, mais ils ignorent qu'il m'aura fallu trente ans pour tracer ce trait". C'est exactement ça : il m'aura fallu sept ans pour tracer cette trajectoire-là. La dernière version du texte, extrêmement remaniée, je l'ai travaillée sans filet, en acceptant de supprimer des scènes, des personnages, de réécrire le début, la fin (la scène finale, je l'ai écrite en deux ou trois heures, au tout dernier moment, mais elle était là, déjà, quelque part). Pour l’essentiel, j'ai la conviction que tout ce que j'ai réécrit, gommé, raturé, coupé demeure présent dans la version finale. Ces 180 et quelques pages restent "grosses" des 300 pages initiales, et des milliers de pages réécrites. De là naît la tension du texte. Sur la structure du texte, son unité me revient l'image qu'emploie Merleau-Ponty à propos du rapport entre le temps et l'éternité : celle d'un jet d'eau, dont chaque particule suit un mouvement fuyant et apparemment chaotique, et pourtant le jet d'eau, lui, reste immobile. Bref, mon écriture est triturée-élaguée mille fois, mais elle n'en est que plus naturelle. Je m'explique. La grande leçon de ces quelques années de travail, c'est que, pour moi, la spontanéité n'est pas dans le premier jet, qui m'apparaît saturé de poses, de postures, de masques, de scrupules, d'inhibitions, de prétention, de "à la manière de...", de fausses façades. La plus grande spontanéité est pour moi le fruit d'un long et lent travail. La version finale du texte, c'est parfaitement moi enfin (et bien plus que moi, bien sûr, sinon pas de littérature), sans pose ni fard. C'est ma voix, mon regard, mon style. Dans le même temps que je travaillais sur le texte, le texte me travaillait, on ne ressort pas indemne d'un tel corps à corps. Le but, c'était de rendre l'énergie insensée, l'intensité furieuse et les changements de rythme de ce voyage-là. Plus généralement, la violence du monde, saute à la gueule de qui se place au ras des choses, vulnérable. Il fallait bien sûr que le texte ait une portée universelle, à quoi bon sinon raconter ses petits voyages ? Et puis, le but, c'était d'écrire. Ecrire pour parler du monde, mais écrire.
- A quoi travaillez-vous actuellement ?
- A un roman : l'histoire d'un groupe de boxeurs amateurs, qui se déroule à Cuba. Ce ne sera pas un livre sur la boxe, ni un livre sur Cuba, mais ce thème-là et ce cadre-là, que je connais bien tous les deux, doivent me permettre de poursuivre mon travail d'écriture, de pousser encore davantage dans le sens d'un impact physique, d'un rapport frontal aux choses.
 Sur la route de nulle part
Sur la route de nulle part
Deux grandes épreuves marquent les pics du récit-roman de Nullarbor : une hallucinante campagne de pêche où le protagoniste affronte des hommes aussi coriaces que les requins, et la rencontre d’un mentor aborigène, Ancien du peuple Bardi passé par le Vietnam, dont la mort revêt une dimension quasi mythique sur fond de déglingue mélancolique.
La première étape de cette road story traverse le désert fameux de la Nullarbor, dont l’auteur s’attarde moins à détailler les beautés naturelles qu’à rendre la « respiration » obsédante, perceptible à fleur de nuit. Cette traversée se fait dans une caisse japonaise hors d’âge, avec un poète de Perth ferré en grec ancien et jouant les durs, auquel le narrateur s’attache avant de s’en détacher aussi sec.
Car notre jeune routard ne cesse de viser plus loin, d’abord Broome et ensuite les territoires plus ou moins édéniques de la région de Wreck Point où il partage quelque temps la vie des aborigènes. Rien pour autant, chez lui, du niaiseux rêvant du paradis perdu en se traînant d’anse en crique comme ce couple d’Italiens inconsistants auprès duquel il ne s’attarde guère.
De fait, on le sent chercher « du vrai », et c’est auprès d’Augustus, genre grand fauve humain. A la fois sauvage et fou, encore en symbiose avec la nature et considérant d’autant plus amèrement l’avancée des nouveaux prédateurs de l’internationale vacancière, Augustus sera son initiateur, dont la dernière leçon consistera à disparaître après l’avoir renvoyé vivre sa vie de Napoléon (tel étant le surnom dont il l’a affublé) plein d’avenir…
Ce qui est également pleine d’avenir, chez David Fauquemberg, c’est l’écriture. Prégnante, solide, dynamique, allante, concrète au possible et traversée d’une espèce de poésie émanée de la vie même que son verbe clair et dru transfigure, cette écriture est elle-même action. Les objets disent le dépotoir qu’est devenu ce monde où le coup de boule de Zidane retentit jusqu’au fond du bush, entre marinas de luxe et crocodiles aux aguets. Proche à la fois du Cendrars épico-tropical et du déprimé magnifique qu’est le Bouvier du Poisson-scorpion et des fantomatiques îles d’Aran, David Fauquemberg est plus qu’un étonnant voyageur: un étonnant écrivain.
David Fauquemberg. Nullarbor. Höbeke, 187p

 …Il est certain que ce serait tromper notre peuple que de ne pas reconnaître la gravité de la situation, qui nous oblige à ouvrir les yeux tout grands de sorte à considérer les choses telles qu’elles sont et non telles qu’on voudrait qu’elles fussent en se voilant la face …
…Il est certain que ce serait tromper notre peuple que de ne pas reconnaître la gravité de la situation, qui nous oblige à ouvrir les yeux tout grands de sorte à considérer les choses telles qu’elles sont et non telles qu’on voudrait qu’elles fussent en se voilant la face …




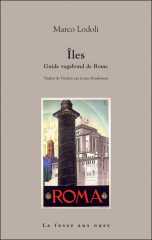 Marco Lodoli. Îles ; guide vagabond de Rome. Traduit de l’italien par Louise Boudonnat. La Fosse aux ours, 218p.
Marco Lodoli. Îles ; guide vagabond de Rome. Traduit de l’italien par Louise Boudonnat. La Fosse aux ours, 218p. Cormac Mc Carthy. Un enfant de Dieu. Traduit de l’anglais par Guillemette Bellesteste. Actes sud,1992 ; Points Seuil- roman noir, 2008.
Cormac Mc Carthy. Un enfant de Dieu. Traduit de l’anglais par Guillemette Bellesteste. Actes sud,1992 ; Points Seuil- roman noir, 2008. Jacques Perry-Salkow. Anagrammes ; pour sourire ou rêver. Le Seuil, 176p.
Jacques Perry-Salkow. Anagrammes ; pour sourire ou rêver. Le Seuil, 176p.

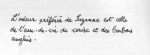 Hervé Guibert retrouvé ce matin, l’esprit d’Hervé que je retrouve au coin du feu, le corps d’Hervé libéré de sa torture, l’écriture sans rature d’Hervé Guibert décrit le Paradis de Louise : « Elle dit qu’elle ne l’imagine pas. Le corps, de toute façon, n’a plus d’existence, et elle me cite un passage de l’Evangile où un esprit naïf demande avec lequel de ses sept maris une femme qui s’est mariée sept fois entrera au Paradis». Et je lis du petit livre entrouvert de Hafid Aggoune: « Si les livres n’avaient pas été là, je serais mort dans cette forêt. Lire m’a sauvé la vie et le voyage a commencé. Les mots sont mon sang, mon fouet, mon feu ». Enfin je lis ces mots de Jean-Jacques Nuel : « Tout était à écrire. Un livre n’y suffirait pas ».
Hervé Guibert retrouvé ce matin, l’esprit d’Hervé que je retrouve au coin du feu, le corps d’Hervé libéré de sa torture, l’écriture sans rature d’Hervé Guibert décrit le Paradis de Louise : « Elle dit qu’elle ne l’imagine pas. Le corps, de toute façon, n’a plus d’existence, et elle me cite un passage de l’Evangile où un esprit naïf demande avec lequel de ses sept maris une femme qui s’est mariée sept fois entrera au Paradis». Et je lis du petit livre entrouvert de Hafid Aggoune: « Si les livres n’avaient pas été là, je serais mort dans cette forêt. Lire m’a sauvé la vie et le voyage a commencé. Les mots sont mon sang, mon fouet, mon feu ». Enfin je lis ces mots de Jean-Jacques Nuel : « Tout était à écrire. Un livre n’y suffirait pas ». Hervé Guibert, Suzanne et Louise. Roman-photo. Gallimard, 2005 ; Jean-Jacques Nuel, Le nom. A Contrario, 2005 ; Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit. FolioEssais, 2005 ; Hafid Aggoune, Quelle nuit sommes-nous ?. Farrago, 2005.
Hervé Guibert, Suzanne et Louise. Roman-photo. Gallimard, 2005 ; Jean-Jacques Nuel, Le nom. A Contrario, 2005 ; Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit. FolioEssais, 2005 ; Hafid Aggoune, Quelle nuit sommes-nous ?. Farrago, 2005.


 Fernand Melgar. Exit-le droit de mourir, 1h.15. Disponible en DVD
Fernand Melgar. Exit-le droit de mourir, 1h.15. Disponible en DVD

 Or il m’est difficile, à vrai dire, d'exprimer le bonheur profond, que j’aurais pu prolonger des heures, et largement partagé par ma abonne amie, de retrouver ce peintre de la pure transfiguration spirituelle, qui allie sapience et simplicité à l’aube de la Renaissance et scelle le meilleur savoir et la meilleure pensée du Moyen Âge tout en multipliant, en artiste radieux, les échappées vers le primitif et vers le tout moderne – sans le chercher évidemment.
Or il m’est difficile, à vrai dire, d'exprimer le bonheur profond, que j’aurais pu prolonger des heures, et largement partagé par ma abonne amie, de retrouver ce peintre de la pure transfiguration spirituelle, qui allie sapience et simplicité à l’aube de la Renaissance et scelle le meilleur savoir et la meilleure pensée du Moyen Âge tout en multipliant, en artiste radieux, les échappées vers le primitif et vers le tout moderne – sans le chercher évidemment. Enfin, entre Giotto et Piero, avant la psychologie et les pâmoisons, avant aussi la dilution progressive du spirituel dans l’Art, on est ici dans un équilibre entre rigueur absolue et plasticité déliée, qui tend la contemplation – cela ressenti au cœur de Rome aussi bien que dans les déserts de Fiesole et autres hauts lieux de Toscne ou d'Ombrie...
Enfin, entre Giotto et Piero, avant la psychologie et les pâmoisons, avant aussi la dilution progressive du spirituel dans l’Art, on est ici dans un équilibre entre rigueur absolue et plasticité déliée, qui tend la contemplation – cela ressenti au cœur de Rome aussi bien que dans les déserts de Fiesole et autres hauts lieux de Toscne ou d'Ombrie...
 Lettres à Pascal Janovjak (2)
Lettres à Pascal Janovjak (2)




 Sur Les amants réguliers de Philippe Garrel
Sur Les amants réguliers de Philippe Garrel


 Abou el Kacem Chebbi (
Abou el Kacem Chebbi (

 Sur la route de nulle part
Sur la route de nulle part



 Double façade
Double façade
 Toni Morrison, Un don. Traduit de l’anglais (USA) par Anne Wicke. Christian Bourgois, 192p. Toni Morrison signera ses livres chez Payot-Lausanne (Plaace Pépinet) ce vendredi 15 mai de 17h. à 18h.45.
Toni Morrison, Un don. Traduit de l’anglais (USA) par Anne Wicke. Christian Bourgois, 192p. Toni Morrison signera ses livres chez Payot-Lausanne (Plaace Pépinet) ce vendredi 15 mai de 17h. à 18h.45. Un entretien avec Toni Morrison, en 1998.
Un entretien avec Toni Morrison, en 1998.






 Pour mémoire: à la sortie de la projection, au Festival de Locarno 2008, de La Forteresse de Fernand Melgar, dont Fahad K. est l'un des protagonistes, Madame Eveline Widmer Schlumpf, ministre helvétique en charge du dossier de l'asile, déclarait à JLK: "Je suis impressionnée. C'est un film objectif qui peut aider à la meilleure compréhension humaine des requérants d'asile dans notre pays. J'espère qu'il sera largement diffusé dans les écoles et que nos collaborateurs le verront eux aussi." No comment...
Pour mémoire: à la sortie de la projection, au Festival de Locarno 2008, de La Forteresse de Fernand Melgar, dont Fahad K. est l'un des protagonistes, Madame Eveline Widmer Schlumpf, ministre helvétique en charge du dossier de l'asile, déclarait à JLK: "Je suis impressionnée. C'est un film objectif qui peut aider à la meilleure compréhension humaine des requérants d'asile dans notre pays. J'espère qu'il sera largement diffusé dans les écoles et que nos collaborateurs le verront eux aussi." No comment...