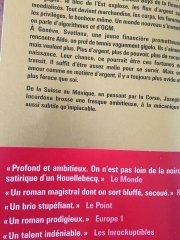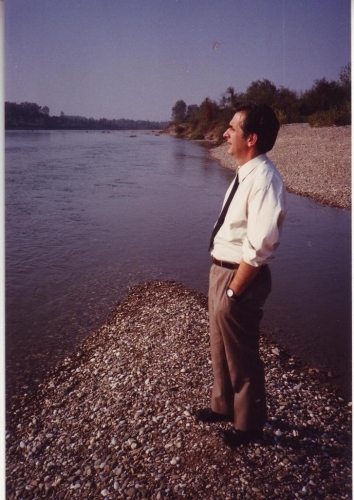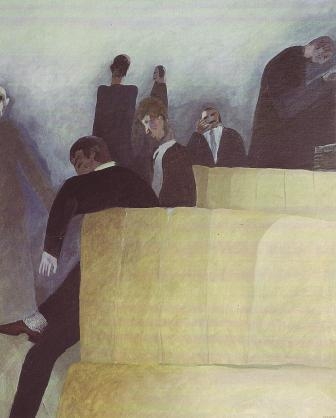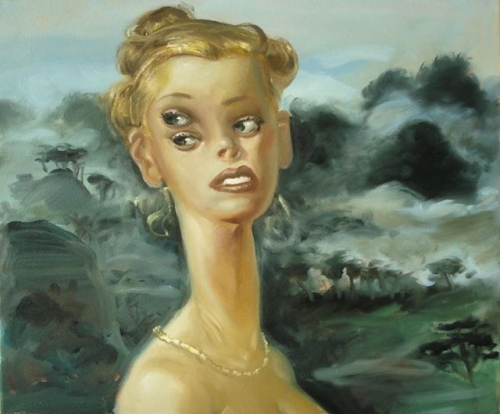Carnets de JLK - Page 38
-
Pas une minute à perdre
 Je regarde le Temps passeravec sa clope au bec,il est hirsute et mal peigné,il a l’air distrait;se souvient-il d’où il venaitquand il est apparuau premier jour du calendrier,et sait-il distinguerl’année chinoise du jour d’après ?Pour le moment il passeet se dépasse à l’avenantau défi de l’impasse...La durée est imprévisible:on la dit capricieuse,les enfants n’en voient pas la fin,et quant au vieux Berbèreil n’y voit que du ventdans le nuage du désert;elle non plus ne saurait pas direce que contient son sac à main:elle pose pour un photographe,elle agrafe son basà l’aile d’un oiseau passantpar ici ou par là -elle n’en fait toujours qu’à sa guisequi n’est que de durer...Les heures auront tourné dans la courà la poursuite des minutes,en attendant la chutedes secondes en fines averses,et le temps que la durée verseses caresses légèresde lumière sur nos visages,comme un âge a passé...Peinture: Thierry Vernet.
Je regarde le Temps passeravec sa clope au bec,il est hirsute et mal peigné,il a l’air distrait;se souvient-il d’où il venaitquand il est apparuau premier jour du calendrier,et sait-il distinguerl’année chinoise du jour d’après ?Pour le moment il passeet se dépasse à l’avenantau défi de l’impasse...La durée est imprévisible:on la dit capricieuse,les enfants n’en voient pas la fin,et quant au vieux Berbèreil n’y voit que du ventdans le nuage du désert;elle non plus ne saurait pas direce que contient son sac à main:elle pose pour un photographe,elle agrafe son basà l’aile d’un oiseau passantpar ici ou par là -elle n’en fait toujours qu’à sa guisequi n’est que de durer...Les heures auront tourné dans la courà la poursuite des minutes,en attendant la chutedes secondes en fines averses,et le temps que la durée verseses caresses légèresde lumière sur nos visages,comme un âge a passé...Peinture: Thierry Vernet. -
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2020)CARACO L'INFRÉQUENTABLE. – Retombant l’autre jour sur Ma confession d’Albert Caraco, je me disais dès les premières pages que ce livre de sa cinquantaine, l’année précise de son suicide annoncé (il avait résolu de ne pas survivre plus d’une nuit à la mort de son père), serait aujourd’hui vilipendé par les bien pensants plus que ceux de Gabriel Matzneff, et probablement interdit de vente pour peu qu’on en publie des extraits dans les journaux , à commencer par Le Monde qu’il ne cesse de conspuer comme un parangon de conformisme aveugle.Le Monde aimerait pourtant cette citation tirée de la page 102 de Ma confession. «Je suis de cœur avec les révoltés de l’an 68, ils éprouvaient ce que je sens, ils ne se concevaient eux-mêmes, d’où leurs faiblesses, ils valaient mieux que leurs idées et leurs méthodes, nous reverrons demain ce que nous vîmes, nous sommes arrivés au point où la subversion est le dernier espoir, la légalité n’étant qu’une imposture ».Caraco écrivait ces lignes en 1971, après avoir suivi les événements de mai 68 dans son Semainier de l’incertitude, où il regrettait de n’avoir plus vingt ans et vilipendait Charles de Gaulle, mais la suite de cette page, que je cite sans souscrire du tout à son racisme endiablé, ferait hurler les lectrices et lecteurs du Monde.«Le Maquignon de l’Elysée est aussi l’homme qui capitula vers 1962 face à la vermine algérienne et grâce auquel l’Algérie tient la France, ce paradoxe est le plus beau des temps modernes, la France a payé cher, très cher, trop cher l’amitié problématique des Arabes, la voilà pleine d’Africains hideux, noirs, bruns ou jaunes, syphilitiques, vicieux et dangereux, encore une autre génération et ce sera la métissage. Moi, je m’en réjouis et j’attends les Dupont crépus et les Dubois camus, les Durand olivâtres et les Dupuis lippus »…Albert Caraco n’aimait pas la vie, et c’est notre premier désaccord à part de multiples divergences d’opinions (sa détestation des chrétiens et sa conviction que les Juifs sauveront le monde, notamment, entre autres jugements sur la littérature ou les arts qui sont d’un galant homme du XVIIIe siècle…), mais son génie m’intéresse autant que m’horripile son gnosticisme, et ses observations me saisissent souvent par leur pénétration, sans parler de son savoir immense, bref lire Caraco me semble un formidable tonique, effet répulsif compris...
(Lectures du monde, 2020)CARACO L'INFRÉQUENTABLE. – Retombant l’autre jour sur Ma confession d’Albert Caraco, je me disais dès les premières pages que ce livre de sa cinquantaine, l’année précise de son suicide annoncé (il avait résolu de ne pas survivre plus d’une nuit à la mort de son père), serait aujourd’hui vilipendé par les bien pensants plus que ceux de Gabriel Matzneff, et probablement interdit de vente pour peu qu’on en publie des extraits dans les journaux , à commencer par Le Monde qu’il ne cesse de conspuer comme un parangon de conformisme aveugle.Le Monde aimerait pourtant cette citation tirée de la page 102 de Ma confession. «Je suis de cœur avec les révoltés de l’an 68, ils éprouvaient ce que je sens, ils ne se concevaient eux-mêmes, d’où leurs faiblesses, ils valaient mieux que leurs idées et leurs méthodes, nous reverrons demain ce que nous vîmes, nous sommes arrivés au point où la subversion est le dernier espoir, la légalité n’étant qu’une imposture ».Caraco écrivait ces lignes en 1971, après avoir suivi les événements de mai 68 dans son Semainier de l’incertitude, où il regrettait de n’avoir plus vingt ans et vilipendait Charles de Gaulle, mais la suite de cette page, que je cite sans souscrire du tout à son racisme endiablé, ferait hurler les lectrices et lecteurs du Monde.«Le Maquignon de l’Elysée est aussi l’homme qui capitula vers 1962 face à la vermine algérienne et grâce auquel l’Algérie tient la France, ce paradoxe est le plus beau des temps modernes, la France a payé cher, très cher, trop cher l’amitié problématique des Arabes, la voilà pleine d’Africains hideux, noirs, bruns ou jaunes, syphilitiques, vicieux et dangereux, encore une autre génération et ce sera la métissage. Moi, je m’en réjouis et j’attends les Dupont crépus et les Dubois camus, les Durand olivâtres et les Dupuis lippus »…Albert Caraco n’aimait pas la vie, et c’est notre premier désaccord à part de multiples divergences d’opinions (sa détestation des chrétiens et sa conviction que les Juifs sauveront le monde, notamment, entre autres jugements sur la littérature ou les arts qui sont d’un galant homme du XVIIIe siècle…), mais son génie m’intéresse autant que m’horripile son gnosticisme, et ses observations me saisissent souvent par leur pénétration, sans parler de son savoir immense, bref lire Caraco me semble un formidable tonique, effet répulsif compris... -
Vues sur Ludwig Hohl
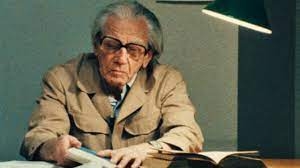 Par Albert CaracoC’est un grand écrivain et qui n’aura peut-être jamais beaucoup de lecteurs, parce qu’il est profond en restant monotone et, quand il est sublime, en demeurant étroit. J’ai de l’estime pour sa façon de penser, j’en ai de plus en plus pour sa façon d’écrire, mais je ne parviens pas à l’aimer : les puritains me refroidissent et c’est un puritain des lettres, on me dira que nous en manquons effroyablement et que les imposteurs mènent le bal, on me dira que Ludwig Hohl est le Cézanne de ces temps, et que son œuvre réfléchit la probité la plus entière… Mais quoi ? Je lui pardonnerais d’avoir moins de rigueur, s’ils montrait parfois plus de charmes et de grâces; il m’en impose, je l’avoue, et cependant il me repousse, il a souvent raison, il n’en devient pas toujours plus aimable. Est-ce l’effet de la raison ou de l’intransigeance de l’auteur ? Les deux sans doute.À qui ressemble-t-il ? À Lichtenberg ? En apparence seulement, parce que Lichtenberg est drôle et que notre auteur, lui, ne l’est presque jamais. À Wittgenstein ? Non pas, car Wittgenstein est un savant et qui paraît avoir l’esprit mathématique, où Ludwig Hohl moralise à peu près comme nous respirons, quand il ne prêche. À Jean-Paul ? Jean-Paul est souvent illisible est toujours trop sentimental avec, de plus, le goût des digressions ou des parenthèses, quand Ludwig Hohl se lit facilement encore qu’il ne soit pas tellement plaisant à lire. Il est original, à n’en pouvoir douter, il ne l’ignore point et même il va jusqu’à nous le remémorer. Il parle, au reste, incessamment de sa personne, ce puritain ne s’oublie guère, il n’a rien d’un ascète, c’est un peu ce qu’on appelait un juste. Voilà, me semble-t-il, le mot est lâché : Ludwig Hohl est un juste. Il est incomparable dans ses méditations touchant la pauvreté, ni Proudhon ni Marx ne sont allés plus loin, c’est un sujet qu’on n'aime pas a définir, cela me remet en mémoire certaines pages de Péguy, voire de Léon Bloy, à cette différence près que Ludwig Hohl est un athée, ayant quelques parties de philosophe. Son athéisme et radical et l’on a l’impression qu’il ne reviendra plus sur cette attitude. Er ist ein gottloser Mensch, aber kein geistloser, das Gegenstück von Léon Bloy, ein Denker ohne Glauben, verzweifelt und dennoch verklärt, mit Weisheit ausgerüstet und dennoch abstossend. Er ist ein ausgemachter deutscher, nach innen offen manchmal sogar nach oben. Er spintisiert ein wenig wie der Schumacher aus Görlitz, ein wenig langweilig, ein bischen dumpf, und plötzlich blitzt er und der geist erscheint.Traduire Ludwig Hohl me paraît difficile, le français ne se prête guère aux ruminations mentales et l’espagnol encore moins. Man fühlt das Werden der Gedanken und ihr Wachsen, bei den Frazosen un den Spanien spürt man bloss die Endform. La pensée de l’auteur est à l’état naissant. Avec cela, c’est un esprit solide, il marche volontiers à pas de plomb, en ahanant un peu. J’admire son bon sens, c’est un cyclope, die Arbeit ist sein Leitmotiv, il parle topujours de travail avec une insistance pathétique. Der Lob des schweren materials klingt durchaus calibanisch : c’est donc un Caliban de bonne volonté, qui rêve d’être un Ariel. Ludwig Hohl hat eben keine Schwingen, er besteigt immerhin die höchsten Berge, doch vierfüssig, mit Zähnen une mit Nägeln.Je reconnais qu’il touche parfois au sublime encore qu’il ne reste pas assez dans ses hauteurs, il n’a point trouvé l’art de s’y faire une place, il est gradualiste, il n’est pas subitiste et nous dirons que c’est un juste auquel la grâce aura manqué.Cet homme surprenant attendait le miracle, il attendait, outre la gloire, un ou plusieurs mécènes, il n’a pas trouvé l’être providentiel qu’il espérait, de là ses pages les plus déchirantes, – non sans complaisance (mais nous la lui pardonnerons ) il professera son génie (Porträt ). Hohl a certes des éclairs de génie et voilà qui nous remémore un Lichtenberg ; Il manque à l’un tout comme à l’autre un certain don de la synthèse, à quoi les auteurs des génies se peuvent reconnaître. Er zieht di Bruch stücke dem Zusammenhange vor, weil es ihm nicht gelingen ist, bis zur Synthese zu gelangen. Doch dies beweist nicht nur, dass er ein Schöpfer sei. Je lui reproche je n’avoir pas lu les philosophes et s’il résonne sur la praxis é la façon d’un Engels, ke me méfie un peu de son socialisme, où je découvre des relents de stalinisme.Comment ne goûterait-on pas ses pages sur le métier d’écrivain ? C’est là qu’ils montre souvent le meilleur de son esprit et quand je le lis je crois voir Cézanne, ses maladresses et sa probité, touchantes et parfois sublimes. Il tourne souvent dans le cercle mais il y fait – de temps en temps– entrer le monde, aussi beaucoup lui sera pardonné, même sa manie de tout rapporter à Ludwig Hohl, lequel est le Dieu de ses livres, et dont la présence est réelle, fût-elle bien caché.Avec cela, c’est un historien et - s’il le voulait– des plus remarquables, dommage qu’il n’en traite pas assez souvent et que l’histoire en somme l’intéresse moins que Ludwig Hohl. Son essai touchant la Réforme (2) ne peut que susciter mon admiration, ses réflexions sur l’Eglise sont pareillement heureuses. L’on souhaiterait qu’il donnât plusieurs morceaux de cette qualité. Hohl est un conteur symboliste, a l’instar d’un Kafka, il marie les sous-entendus et l’évidence d’une manière qu’il est permis d’appeler de l’art. Son Vernunft und Güte est un chef-d’œuvre et c’est le canevas d’un grand roman, genre Noeud de vipères de Mauriac. Est-ce le reflet de sa propre vie ? Au fond, son drame est d’être Suisse. En un pays comme la Suisse, où l’on manque à ce point de malheureux qu’il faut les importer pour leur commettre ces travaux auxquels les habitants préféreront l’exil, Hohl est un phénomène et je présume que d’aucuns le lui reprochent.; il n’est pas devenu célèbre, alors que d’autres, moins doués le sont, puis il est resté pauvre en une contrée où l’on a la religion de l’ordre, de l’efficace, du rendement et des vertus civiques. Il est un peu hors cadre. Est-ce sa faute ? En quels pays serait-il vraiment à sa juste place ? Comment répondre ? Une existence, que l’esprit informe, sera toujours un cas d’espèce et sa reconnaissance, de la part des hommes, un miracle. Lui reprocherons-nous de l’avoir attendu ?Albert Caraco(1) Nuances et détails III/9(2) Notes.Ce texte a paru dans la livraison de La Revue de Belles-Lettres, No3, 1969, consacrée à Ludwig Hohl.
Par Albert CaracoC’est un grand écrivain et qui n’aura peut-être jamais beaucoup de lecteurs, parce qu’il est profond en restant monotone et, quand il est sublime, en demeurant étroit. J’ai de l’estime pour sa façon de penser, j’en ai de plus en plus pour sa façon d’écrire, mais je ne parviens pas à l’aimer : les puritains me refroidissent et c’est un puritain des lettres, on me dira que nous en manquons effroyablement et que les imposteurs mènent le bal, on me dira que Ludwig Hohl est le Cézanne de ces temps, et que son œuvre réfléchit la probité la plus entière… Mais quoi ? Je lui pardonnerais d’avoir moins de rigueur, s’ils montrait parfois plus de charmes et de grâces; il m’en impose, je l’avoue, et cependant il me repousse, il a souvent raison, il n’en devient pas toujours plus aimable. Est-ce l’effet de la raison ou de l’intransigeance de l’auteur ? Les deux sans doute.À qui ressemble-t-il ? À Lichtenberg ? En apparence seulement, parce que Lichtenberg est drôle et que notre auteur, lui, ne l’est presque jamais. À Wittgenstein ? Non pas, car Wittgenstein est un savant et qui paraît avoir l’esprit mathématique, où Ludwig Hohl moralise à peu près comme nous respirons, quand il ne prêche. À Jean-Paul ? Jean-Paul est souvent illisible est toujours trop sentimental avec, de plus, le goût des digressions ou des parenthèses, quand Ludwig Hohl se lit facilement encore qu’il ne soit pas tellement plaisant à lire. Il est original, à n’en pouvoir douter, il ne l’ignore point et même il va jusqu’à nous le remémorer. Il parle, au reste, incessamment de sa personne, ce puritain ne s’oublie guère, il n’a rien d’un ascète, c’est un peu ce qu’on appelait un juste. Voilà, me semble-t-il, le mot est lâché : Ludwig Hohl est un juste. Il est incomparable dans ses méditations touchant la pauvreté, ni Proudhon ni Marx ne sont allés plus loin, c’est un sujet qu’on n'aime pas a définir, cela me remet en mémoire certaines pages de Péguy, voire de Léon Bloy, à cette différence près que Ludwig Hohl est un athée, ayant quelques parties de philosophe. Son athéisme et radical et l’on a l’impression qu’il ne reviendra plus sur cette attitude. Er ist ein gottloser Mensch, aber kein geistloser, das Gegenstück von Léon Bloy, ein Denker ohne Glauben, verzweifelt und dennoch verklärt, mit Weisheit ausgerüstet und dennoch abstossend. Er ist ein ausgemachter deutscher, nach innen offen manchmal sogar nach oben. Er spintisiert ein wenig wie der Schumacher aus Görlitz, ein wenig langweilig, ein bischen dumpf, und plötzlich blitzt er und der geist erscheint.Traduire Ludwig Hohl me paraît difficile, le français ne se prête guère aux ruminations mentales et l’espagnol encore moins. Man fühlt das Werden der Gedanken und ihr Wachsen, bei den Frazosen un den Spanien spürt man bloss die Endform. La pensée de l’auteur est à l’état naissant. Avec cela, c’est un esprit solide, il marche volontiers à pas de plomb, en ahanant un peu. J’admire son bon sens, c’est un cyclope, die Arbeit ist sein Leitmotiv, il parle topujours de travail avec une insistance pathétique. Der Lob des schweren materials klingt durchaus calibanisch : c’est donc un Caliban de bonne volonté, qui rêve d’être un Ariel. Ludwig Hohl hat eben keine Schwingen, er besteigt immerhin die höchsten Berge, doch vierfüssig, mit Zähnen une mit Nägeln.Je reconnais qu’il touche parfois au sublime encore qu’il ne reste pas assez dans ses hauteurs, il n’a point trouvé l’art de s’y faire une place, il est gradualiste, il n’est pas subitiste et nous dirons que c’est un juste auquel la grâce aura manqué.Cet homme surprenant attendait le miracle, il attendait, outre la gloire, un ou plusieurs mécènes, il n’a pas trouvé l’être providentiel qu’il espérait, de là ses pages les plus déchirantes, – non sans complaisance (mais nous la lui pardonnerons ) il professera son génie (Porträt ). Hohl a certes des éclairs de génie et voilà qui nous remémore un Lichtenberg ; Il manque à l’un tout comme à l’autre un certain don de la synthèse, à quoi les auteurs des génies se peuvent reconnaître. Er zieht di Bruch stücke dem Zusammenhange vor, weil es ihm nicht gelingen ist, bis zur Synthese zu gelangen. Doch dies beweist nicht nur, dass er ein Schöpfer sei. Je lui reproche je n’avoir pas lu les philosophes et s’il résonne sur la praxis é la façon d’un Engels, ke me méfie un peu de son socialisme, où je découvre des relents de stalinisme.Comment ne goûterait-on pas ses pages sur le métier d’écrivain ? C’est là qu’ils montre souvent le meilleur de son esprit et quand je le lis je crois voir Cézanne, ses maladresses et sa probité, touchantes et parfois sublimes. Il tourne souvent dans le cercle mais il y fait – de temps en temps– entrer le monde, aussi beaucoup lui sera pardonné, même sa manie de tout rapporter à Ludwig Hohl, lequel est le Dieu de ses livres, et dont la présence est réelle, fût-elle bien caché.Avec cela, c’est un historien et - s’il le voulait– des plus remarquables, dommage qu’il n’en traite pas assez souvent et que l’histoire en somme l’intéresse moins que Ludwig Hohl. Son essai touchant la Réforme (2) ne peut que susciter mon admiration, ses réflexions sur l’Eglise sont pareillement heureuses. L’on souhaiterait qu’il donnât plusieurs morceaux de cette qualité. Hohl est un conteur symboliste, a l’instar d’un Kafka, il marie les sous-entendus et l’évidence d’une manière qu’il est permis d’appeler de l’art. Son Vernunft und Güte est un chef-d’œuvre et c’est le canevas d’un grand roman, genre Noeud de vipères de Mauriac. Est-ce le reflet de sa propre vie ? Au fond, son drame est d’être Suisse. En un pays comme la Suisse, où l’on manque à ce point de malheureux qu’il faut les importer pour leur commettre ces travaux auxquels les habitants préféreront l’exil, Hohl est un phénomène et je présume que d’aucuns le lui reprochent.; il n’est pas devenu célèbre, alors que d’autres, moins doués le sont, puis il est resté pauvre en une contrée où l’on a la religion de l’ordre, de l’efficace, du rendement et des vertus civiques. Il est un peu hors cadre. Est-ce sa faute ? En quels pays serait-il vraiment à sa juste place ? Comment répondre ? Une existence, que l’esprit informe, sera toujours un cas d’espèce et sa reconnaissance, de la part des hommes, un miracle. Lui reprocherons-nous de l’avoir attendu ?Albert Caraco(1) Nuances et détails III/9(2) Notes.Ce texte a paru dans la livraison de La Revue de Belles-Lettres, No3, 1969, consacrée à Ludwig Hohl. -
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2021)HIRONDELLES. – Il y avait ce soir, le long du Grand Canal, une prodigieuse concentration d’hirondelles tournoyant et virevoltant entre la lisière du bois et le champ de tournesols de l’autre rive, et j’ai pensé que la profusion des moustiques qui me harcèlent ces temps au déclin du jour, à chaque fois que je m’approche du sous-bois marécageux, attirait cette nuée, comme me l’a d’ailleurs confirmé mon ami René, féru d’ornithologie et que j’appelle dès que j’ai une question relative aux oiseaux ; et de fait il vient de me confirmer par phone que la prochaine migration se préparait et que les troupes de sous-espèces mêlées se rassemblaient avant le grand départ, que les moustiques non encore exterminés par les pesticides leur tenaient lieu de souper et que tout à l’heure elles iraient dormir en grappes dans les roseaux, car les hirondelles dorment en grappes pour se protéger des rapaces et des fouines, ai-je-donc appris ce soir sans cesser de subir les assauts des moustiques qu’elles n’ont pas avalé en vol, etc. (Ce lundi 23 août, vers Noville)CORPS MAUDIT. – Le pauvre Zorn était étranglé, au propre et au figuré, par sa cravate de fils de «gens bien», adolescent mal dans sa peau et le restant à travers les années avant sa longue période de dépression, et si je comprends sa pudeur maladive et sa crainte de se pointer aux douches de la gym, comme je l’ai éprouvée à un degré moindre entre dix et treize ans, jamais je n’ai vécu cette honte et ce mépris du corps et du sexe, tel qu’il les décrit, et c’est en somme par contraste que je redécouvre, grâce à la lecture de Mars, la monstruosité de cette vie congelée par le conformisme social et l’obsession de la bienséance, qui impliquait le mépris du corps en général et plus encore de la sexualité, non tant pour des raisons morales que sociales - ses parents n’étant pas des puritains religieux mais des bourgeois guindés fréquentant l’église sans croire à rien et ne manquant aucun enterrement pour y être vus…
(Lectures du monde, 2021)HIRONDELLES. – Il y avait ce soir, le long du Grand Canal, une prodigieuse concentration d’hirondelles tournoyant et virevoltant entre la lisière du bois et le champ de tournesols de l’autre rive, et j’ai pensé que la profusion des moustiques qui me harcèlent ces temps au déclin du jour, à chaque fois que je m’approche du sous-bois marécageux, attirait cette nuée, comme me l’a d’ailleurs confirmé mon ami René, féru d’ornithologie et que j’appelle dès que j’ai une question relative aux oiseaux ; et de fait il vient de me confirmer par phone que la prochaine migration se préparait et que les troupes de sous-espèces mêlées se rassemblaient avant le grand départ, que les moustiques non encore exterminés par les pesticides leur tenaient lieu de souper et que tout à l’heure elles iraient dormir en grappes dans les roseaux, car les hirondelles dorment en grappes pour se protéger des rapaces et des fouines, ai-je-donc appris ce soir sans cesser de subir les assauts des moustiques qu’elles n’ont pas avalé en vol, etc. (Ce lundi 23 août, vers Noville)CORPS MAUDIT. – Le pauvre Zorn était étranglé, au propre et au figuré, par sa cravate de fils de «gens bien», adolescent mal dans sa peau et le restant à travers les années avant sa longue période de dépression, et si je comprends sa pudeur maladive et sa crainte de se pointer aux douches de la gym, comme je l’ai éprouvée à un degré moindre entre dix et treize ans, jamais je n’ai vécu cette honte et ce mépris du corps et du sexe, tel qu’il les décrit, et c’est en somme par contraste que je redécouvre, grâce à la lecture de Mars, la monstruosité de cette vie congelée par le conformisme social et l’obsession de la bienséance, qui impliquait le mépris du corps en général et plus encore de la sexualité, non tant pour des raisons morales que sociales - ses parents n’étant pas des puritains religieux mais des bourgeois guindés fréquentant l’église sans croire à rien et ne manquant aucun enterrement pour y être vus…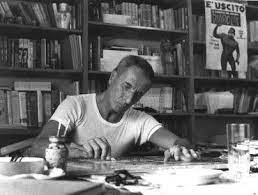 RECONNAISSANCE. – Dans le fragment intitulé Gratitude figurant au début de l’espèce de journal-montage que constitue En ce moment précis, le narrateur de Buzzati commence à faire l’inventaire des merveilles innombrables qui nous incitent à nous réjouir, comme le fait d’être un moi au milieu de milliards d’autres individus qui nous aident à nous sentir moins seul, puis d’être soi aujourd’hui après d’autres milliards de disparus qui nous permettent d’apprécier le fait d’être vivant et de pouvoir nous mesurer au passé, comme nous pouvons mesurer notre chance de n’être pas atteint de la lèpre ou du lupus érythémateux, de n’être pas né dans un pays en guerre ou en zone de famine, puis l’argument change un peu, l’on se demande s’il n’y a pas dans «tout ça» de l’exagération, trop de planètes et trop de rhumatismes, trop de volcans aux pulsions incontrôlables et trop de Chinois, tout «ce travail de naissances, de souffrances et de tragédies, perpétuel depuis des millions d’années, dans le seul but de me complaire ! », tant de douleurs « pour que je puisse apprécier mon petit bien-être », et moi qui ne veux pas comprendre, toi qui chaque jour continues de « jouir de ce palais mystérieux » - tous les jours reprend « le chœur des peines », et vous qui restez « assis à jouer » dans la solitude du jardin, etc.AUTOPUB. – L’écrivain alémanique Paul Nizon, dans une conversation avec Pajak qui fait l’objet d’un petit livre épatant paru récemment, que j’ai lu en trois heures et achevé au chevet de ma bonne amie en train de subir sa huitième perfusion de chimie palliative, ne cesse de se lancer des fleurs à un point qui m’a d’abord semblé comique, voire ridicule.Ainsi, vantant les exceptionnelles qualités avant-gardistes de son Canto – un livre qui date de 1963 et dont le total insuccès l’a probablement mortifié à l’époque - il semble persuadé que le monde va enfin le redécouvrir et l’admirer sans réserve, avant de déclarer comme ça que son œuvre est telle qu’on ne peut la comparer qu’à celle d’un Shakespeare, et là je me suis demandé si ses 91 ans n’avaient pas transformé l’écrivain sympathique et intéressant que j’ai rencontré à Paris il y a une quarantaine d’années en fanfaron sénile ; puis je me suis dit que non, vu qu’à part ce bluff apparent, me rappelant celui d’un Philippe Sollers – quand celui-ci annonçait la parution de son prochain roman comme un « tsunami éditorial » -, ses autres propos restent d’un esprit vif et pénétrant, et que tout ce qu’il dit de la littérature et de la peinture (surtout Van Gogh) en particulier, autant que de la vie en général et de sa « création », est aussi sensé et intéressant que ce que Pajak dit de son côté, alors quoi ?Alors je me dis que le vieux fonds bernois et russe de Nizon, son atavisme de moujik matois passé des milieux chics de Zurich au monde parisien des années 70, puis au kitsch publicitaire mondialisé, explique cette espèce de jovial cynisme d’écrivain supérieurement civilisé (comme l’est aussi Sollers) qui, reconnaissant que «ce pays n’est pas pour le vieil homme», joue des exagérations monstrueuses de la barbarie médiatique actuelle et en remet «pour sa seule gloire». Alors pourquoi pas Shakespeare ? Pourquoi pas le nouvel Homère à chapeau de gangster de cinéma ? Pourquoi pas un pied de nez au philistin ?LE MENDIGOT. – Nous marchions ce matin sur le quai aux fleurs parmi la foule de joyeuse fin d’été, les beaux enfants et les gens heureux, quand cette espèce de gueux en guenilles brunes, littéralement cassé en deux, les jambes horriblement tordues et le torse comme enfoncé, une main décharnée serrant un petit gobelet vide, de longs cheveux filasses et une longue barbe biblique, le reste du visage à peu près invisible, lamentable image de la pauvreté semblant sorti d’un souk pouilleux du Moyen-Orient ou, actualité oblige, du tréfonds d’une ruelle de Kaboul, m’est apparu comme une image de la détresse et de la désolation absolue, et j’ai marché comme toujours, ai demandé une pièce à Lady L. et suis allé la lui donner en lui souhaitant «courage» ; mais ensuite, revenu à ma bonne amie, j’ai compris qu’elle, une fois de plus, ne marchait pas autant que moi, me disant que sûrement le pauvre bougre n’était pas venu là tout seul, autant dire qu’on se servait de lui comme appât, cependant je ne démordrai jamais de ma conception de la mendicité et de l’obligation absolue d’y répondre, surtout dans notre contexte de nantis mais pas seulement, et ce n’est pas « courage » que je dirai à mon prochain mendiant mais « merci », va savoir pourquoi et qu’on ne me parle pas de bonne conscience qui se dorlote : même manipulé le vieux mendigot de ce matin fait partie à mes yeux de ceux dont la seule présence est une grâce, etc. (Ce samedi 28 août)
RECONNAISSANCE. – Dans le fragment intitulé Gratitude figurant au début de l’espèce de journal-montage que constitue En ce moment précis, le narrateur de Buzzati commence à faire l’inventaire des merveilles innombrables qui nous incitent à nous réjouir, comme le fait d’être un moi au milieu de milliards d’autres individus qui nous aident à nous sentir moins seul, puis d’être soi aujourd’hui après d’autres milliards de disparus qui nous permettent d’apprécier le fait d’être vivant et de pouvoir nous mesurer au passé, comme nous pouvons mesurer notre chance de n’être pas atteint de la lèpre ou du lupus érythémateux, de n’être pas né dans un pays en guerre ou en zone de famine, puis l’argument change un peu, l’on se demande s’il n’y a pas dans «tout ça» de l’exagération, trop de planètes et trop de rhumatismes, trop de volcans aux pulsions incontrôlables et trop de Chinois, tout «ce travail de naissances, de souffrances et de tragédies, perpétuel depuis des millions d’années, dans le seul but de me complaire ! », tant de douleurs « pour que je puisse apprécier mon petit bien-être », et moi qui ne veux pas comprendre, toi qui chaque jour continues de « jouir de ce palais mystérieux » - tous les jours reprend « le chœur des peines », et vous qui restez « assis à jouer » dans la solitude du jardin, etc.AUTOPUB. – L’écrivain alémanique Paul Nizon, dans une conversation avec Pajak qui fait l’objet d’un petit livre épatant paru récemment, que j’ai lu en trois heures et achevé au chevet de ma bonne amie en train de subir sa huitième perfusion de chimie palliative, ne cesse de se lancer des fleurs à un point qui m’a d’abord semblé comique, voire ridicule.Ainsi, vantant les exceptionnelles qualités avant-gardistes de son Canto – un livre qui date de 1963 et dont le total insuccès l’a probablement mortifié à l’époque - il semble persuadé que le monde va enfin le redécouvrir et l’admirer sans réserve, avant de déclarer comme ça que son œuvre est telle qu’on ne peut la comparer qu’à celle d’un Shakespeare, et là je me suis demandé si ses 91 ans n’avaient pas transformé l’écrivain sympathique et intéressant que j’ai rencontré à Paris il y a une quarantaine d’années en fanfaron sénile ; puis je me suis dit que non, vu qu’à part ce bluff apparent, me rappelant celui d’un Philippe Sollers – quand celui-ci annonçait la parution de son prochain roman comme un « tsunami éditorial » -, ses autres propos restent d’un esprit vif et pénétrant, et que tout ce qu’il dit de la littérature et de la peinture (surtout Van Gogh) en particulier, autant que de la vie en général et de sa « création », est aussi sensé et intéressant que ce que Pajak dit de son côté, alors quoi ?Alors je me dis que le vieux fonds bernois et russe de Nizon, son atavisme de moujik matois passé des milieux chics de Zurich au monde parisien des années 70, puis au kitsch publicitaire mondialisé, explique cette espèce de jovial cynisme d’écrivain supérieurement civilisé (comme l’est aussi Sollers) qui, reconnaissant que «ce pays n’est pas pour le vieil homme», joue des exagérations monstrueuses de la barbarie médiatique actuelle et en remet «pour sa seule gloire». Alors pourquoi pas Shakespeare ? Pourquoi pas le nouvel Homère à chapeau de gangster de cinéma ? Pourquoi pas un pied de nez au philistin ?LE MENDIGOT. – Nous marchions ce matin sur le quai aux fleurs parmi la foule de joyeuse fin d’été, les beaux enfants et les gens heureux, quand cette espèce de gueux en guenilles brunes, littéralement cassé en deux, les jambes horriblement tordues et le torse comme enfoncé, une main décharnée serrant un petit gobelet vide, de longs cheveux filasses et une longue barbe biblique, le reste du visage à peu près invisible, lamentable image de la pauvreté semblant sorti d’un souk pouilleux du Moyen-Orient ou, actualité oblige, du tréfonds d’une ruelle de Kaboul, m’est apparu comme une image de la détresse et de la désolation absolue, et j’ai marché comme toujours, ai demandé une pièce à Lady L. et suis allé la lui donner en lui souhaitant «courage» ; mais ensuite, revenu à ma bonne amie, j’ai compris qu’elle, une fois de plus, ne marchait pas autant que moi, me disant que sûrement le pauvre bougre n’était pas venu là tout seul, autant dire qu’on se servait de lui comme appât, cependant je ne démordrai jamais de ma conception de la mendicité et de l’obligation absolue d’y répondre, surtout dans notre contexte de nantis mais pas seulement, et ce n’est pas « courage » que je dirai à mon prochain mendiant mais « merci », va savoir pourquoi et qu’on ne me parle pas de bonne conscience qui se dorlote : même manipulé le vieux mendigot de ce matin fait partie à mes yeux de ceux dont la seule présence est une grâce, etc. (Ce samedi 28 août) -
Le Temps accordé

(Lectures du monde, 2021)ZORN. – Je n’étais pas sûr de vouloir le relire, j’hésitais à cause de ce que nous vivons depuis cinq mois, je me souvenais que je n’avais pas aimé ce livre au moment où tout le monde l’adulait pieusement – j’en avais même écrit du mal dans La Gazette en incriminant sa façon d’invoquer trop dogmatiquement l’origine familiale et politique du cancer, mais je me disais aussi que mon point de vue actuel serait peut-être différent à l’aune de «mon» propre crabe, en rémission, et de celui, beaucoup plus redoutable, de ma bonne amie, enfin me voilà en train d’annoter l’exemplaire retrouvé de Lady L. (acquis en 1980) où, après avoir passé mon premier agacement assez semblable à mon sentiment d’il y a quarante ans ( !), je trouve à présent tout un ensemble d’observations qui m’éclairent à la fois sur mes propres préjugés de l’époque et sur une réalité, scannée par l’auteur : sur cette vie bel et bien figée et mortifère d’une certaine Suisse que je fustige moi aussi depuis les années 70, etc.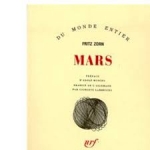 Ce qui m’apparaît surtout, mieux qu’en ma trentaine de gauchiste repenti, c’est la vérité cruelle de l’observation de ce fils de trop bonne famille (la nôtre était plus modeste, plus vivante et surtout plus aimante) et le caractère implacable et plus général de son analyse des faits de langage trahissant quel mode de vie guindé et coincé (sa démolition de la notion d’harmonie et de perfection de façade, qui vaut bel et bien pour tout un pays), l’enquête phénoménologique qu’il poursuit sur ses proches et sur lui-même alors qu’il a l’âge que j’avais au moment de le lire, mais moi je baisais et je courais le montagnes…
Ce qui m’apparaît surtout, mieux qu’en ma trentaine de gauchiste repenti, c’est la vérité cruelle de l’observation de ce fils de trop bonne famille (la nôtre était plus modeste, plus vivante et surtout plus aimante) et le caractère implacable et plus général de son analyse des faits de langage trahissant quel mode de vie guindé et coincé (sa démolition de la notion d’harmonie et de perfection de façade, qui vaut bel et bien pour tout un pays), l’enquête phénoménologique qu’il poursuit sur ses proches et sur lui-même alors qu’il a l’âge que j’avais au moment de le lire, mais moi je baisais et je courais le montagnes…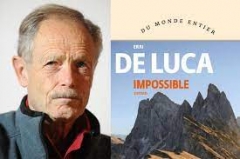 L’IMPOSSIBLE. – Nous ne pensions pas que cela fût possible, et d’ailleurs elle me le disait une semaine encore avant le Diagnostic : « Moi le cancer ? Mais pas question : pas mon truc ! », sur quoi je me retrouve à son chevet dans le Service et ses oiseaux de papier de malheur, à lire Impossible d’Erri De Luca pendant que le goutte-à-goutte lui transmet son poison salvateur (!) pour les deux trois heures que la perfusion va durer.Tout à l’heure j’irai rejoindre mon compère René pendant qu’elle somnolera plus ou moins, mais pour l’instant je me retrouve imaginairement sur une vire des Dolomites d’où le narrateur, interrogé par un jeune magistrat chargé de l’« affaire » est soupçonné d’avoir poussé un ancien camarade révolutionnaire dans le vide (il vengerait ainsi la trahison de ce « collaborateur de justice ») alors que lui réduit cette « rencontre » à une pure coïncidence, et tout de suite cette plongée dans le passé des «années de plomb» m’a rappelé cette « époque publique », selon l’expression du narrateur, dont je me suis distancé après deux ans seulement de militantisme plutôt dilettante, et l’image de ma bonne amie m’est revenue comiquement avec sa dégaine à la Angela Davis qu’elle avait alors – membre du Groupe Afrique – juste avant que ma chère malade me « libère » en me rappelant que notre ami René m’attend à une terrasse. (Ce vendredi 20 août)COMPÈRES. – En rémission lui aussi d’une tumeur à vrai dire bien plus méchante que la mienne, mon ami René m’a raconté que, se trouvant à poil sur son lit de clinique, il y a deux ans de ça, dans un imbroglio de tuyaux et de sondes, de cathéters et autres fils électriques, il a pour la deuxième fois, après son opération, décidé de survivre.La première, c’était après le premier diagnostic qui lui est tombé dessus comme un coup de hache, mais la seconde lui paraissait la plus décisive après l’intervention mahousse : pas question de claquer, je veux vivre ; et le voici revenant de Camargue où il est allé observer je ne sais quel petit rapace très rare avec son fils Luca comme lui passionné d’ornithologie…Nous n’avons pas fait la révolution ensemble, ni gravi aucune cime ou parcouru aucune arête, mais notre complicité est unique, pudique et sûre, et je sais qu’il comprendrait et aimerait le dernier livre de De Luca qu’il me dit d’ailleurs avoir rencontré lors d’une des tournées du théâtre de Vidy, quelque part au fin fond de la France, vieux Monsieur en chemise légère signant dans une petite librairie au milieu de deux ou trois dames et qu’il avait pris pour un auteur local avant de le reconnaître.Par ailleurs, durant les vingt ans que nous avons animé Le Passe-Muraille ensemble nous nous sommes entendus sur à peu près tout sans aucune forme de rivalité si fréquente dans le milieu littéraire – ni lui ni moi n’étions en somme «milieu» en quoi que ce soit, et c’est avec la même reconnaissance que nous évoquons aujourd’hui le privilège énorme que ç’a été de rencontrer tant de gens intéressants durant ces décennies de totale liberté professionnelle à une époque où il y avait plus de trente théâtres entre Lausanne et Genève, des centaines de parutions à chaque rentrée littéraire romande, mes innombrables équipées parisienne et l’aventure qu’il a vécue au côté de René Gonzalez, la mienne avec Dimitri dont la mémoire sera honorée ces jours, mais à présent, bordel, à quel éditeur se fier, quel interlocuteur trouver dans la profusion confuse ?MICHOU. – Comme nous évoquions le chaos océanique de l’Internet, et plus précisément le tsunami des influenceurs à la petite semaine, mon compère René me cite le succès phénoménal d’un certain Michou, qui draine des millions de followers en gesticulant dans le vide sur un vague fond de rap, et je vais y voir pour trouver, en effet, un avatar français du même branle numérique mondial, documenté depuis longtemps aux States et dans les pays asiatiques où des zombies femelles et mâles accumulent des fortunes en ne faisant qu’apparaître et se vendre, au propre ( !) en se manuélisant à vue pour de la thune, ou au figuré en monétisant divers produits cosmétiques et autres peluches, etc. Et puis quoi ? Et puis rien...HISTORIQUE. – La dernière expression médiatique en vogue dans le commentaire sportif , dont la niaiserie en dit long sur l’époque, consiste à parler de «l’Histoire qui s’écrit» à propos de n’importe quelle performance personnelle ou collective, alors même que, dans les plus grandes largeurs de la pompe locale ou internationale, l’on se répand plus que jamais en commémorations et autres «devoirs de mémoire», où l’admiration légitime se transforme en célébration et en outrances lyriques aussi ridicules que celle de ce cher confrère se demandant, l’autre jour, si Roger Federer n’allait pas céder bientôt son auréole d’immortel de la raquette pour cause de mal de genou, etc.DU RIDICULE. – Plus j’avance dans la relecture du récit de Zorn, et plus ses observations me renvoient à celles que j’ai pu faire dans un autre milieu social que le sien, dont certaines caractéristiques ressortissent à la même mentalité confinée, voire étriquée, d’une époque.Sur la côte dorée zurichoise, l’on te disait d’aller «voir à Moscou» si tu avais des penchants socialisants, et toute forme d’originalité ou de talent excessif relevait d’une faute de goût ou d’un écart de conduite relevant du « ridicule » sans qu’on osât même prononcer ce mot en forme de jugement de valeur.Quant au milieu petit-bourgeois qui était le nôtre, il était plus débonnaire, mais je me souviens de la sœur d’un ami fiancée avec un bourgeois nanti, qui évoquait cette classe sociale plus huppée en affirmant que les parents de son promis avaient «quelque argent», avec un ton qui en disait long sur ses rêveries...Or chacun voit le « ridicule » de l’autre avec les yeux de son milieu, et c’est ainsi que nos parents ne pouvaient appeler que «rupins» les habitants d’une partie réservée du quartier de nos enfances, où se concentraient quelques villas plus luxueuses que nos maisons familiales subventionnées typiques de ces débuts des trente glorieuses, etc.AU BORD DU CIEL. – Je lisais hier le récit de De Luca évoquant les « conquérants de l’inutile» et l’élan physique et moral poussant son protagoniste à la recherche de « la beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l’air, comme le rivage avec la mer », et je me suis rappelé notre dernier parcours d’arête avec Reynald, dix jours avant sa chute mortelle dans les séracs du Dolent, puis j’ai rejoint Lady L. à La Désirade où elle remontait pour la première fois depuis des mois, surmontant la fatigue consécutive à sa sixième perfusion, son manque de souffle et l’affaiblissement de ses muscles, encouragée par sa fille Number One, qui l’a voiturée là-haut, et cheminant ensuite d’une chaise à l’autre – sa fille Number Two ayant balisé les cent vingt-cinq mètres de la montée en disposant trois sièges d’étape… pour retrouver ensuite les petits lascars dont l’aîné l’a questionnée à propos de sa calvitie de nouveau-né et de sa maladie, plus angoissé évidemment (il a quatre ans) que son petite frère (qui en a deux) mais semblant apaisé par ses explications.Je n’ose trop penser à ce qu’a éprouvé ma bonne amie en retrouvant La Désirade, après l’accès de mélancolie qui m’a pris l’autre jour en y remontant après un détour à l’isba – et tous ces livres, tous ces manuscrits, tous ces documents, tous ces tableaux, tous ces objets, tout cet univers familier dont la maladie et d’autres circonstances nous ont éloignés -, mais il me semble que l’un et l’autre restons « dans la sérénité », en tout cas aux yeux des autres, et je souris en pensant au message de l’ami R., l’autre jour, qui me disait qu’il admirait ma « ténacité », faisant allusion à notre situation, alors que lui, me dit-il, aurait pris la fuite dans les mêmes circonstances…Et quoi encore ? Comme s’il fallait de la ténacité pour accompagner une personne qu’on aime, et plus précisément ma bonne amie, Lady L. au grand cœur quoique très charcuté récemment, patronne vénérée de notre chien Snoopy et mère avérée de nos filles lui ressemblant comme une blonde et une brune peuvent ressembler à une brune devenue blonde puis chauve, propriétaire en titre de notre Honda Jazz et gestionnaire de nos biens meubles et volatils, enfin la petite fille émouvante et la vieille fée que je crèverais d’abandonner sous prétexte qu’un putain de crabe la grignote, autant dire restant ainsi avec elle sans le moindre mérite en espérant ne pas lui faire la mauvaise farce de clamser avant elle sous l’effet de mon propre souffle au cœur, etc. (Ce dimanche 22 août).
L’IMPOSSIBLE. – Nous ne pensions pas que cela fût possible, et d’ailleurs elle me le disait une semaine encore avant le Diagnostic : « Moi le cancer ? Mais pas question : pas mon truc ! », sur quoi je me retrouve à son chevet dans le Service et ses oiseaux de papier de malheur, à lire Impossible d’Erri De Luca pendant que le goutte-à-goutte lui transmet son poison salvateur (!) pour les deux trois heures que la perfusion va durer.Tout à l’heure j’irai rejoindre mon compère René pendant qu’elle somnolera plus ou moins, mais pour l’instant je me retrouve imaginairement sur une vire des Dolomites d’où le narrateur, interrogé par un jeune magistrat chargé de l’« affaire » est soupçonné d’avoir poussé un ancien camarade révolutionnaire dans le vide (il vengerait ainsi la trahison de ce « collaborateur de justice ») alors que lui réduit cette « rencontre » à une pure coïncidence, et tout de suite cette plongée dans le passé des «années de plomb» m’a rappelé cette « époque publique », selon l’expression du narrateur, dont je me suis distancé après deux ans seulement de militantisme plutôt dilettante, et l’image de ma bonne amie m’est revenue comiquement avec sa dégaine à la Angela Davis qu’elle avait alors – membre du Groupe Afrique – juste avant que ma chère malade me « libère » en me rappelant que notre ami René m’attend à une terrasse. (Ce vendredi 20 août)COMPÈRES. – En rémission lui aussi d’une tumeur à vrai dire bien plus méchante que la mienne, mon ami René m’a raconté que, se trouvant à poil sur son lit de clinique, il y a deux ans de ça, dans un imbroglio de tuyaux et de sondes, de cathéters et autres fils électriques, il a pour la deuxième fois, après son opération, décidé de survivre.La première, c’était après le premier diagnostic qui lui est tombé dessus comme un coup de hache, mais la seconde lui paraissait la plus décisive après l’intervention mahousse : pas question de claquer, je veux vivre ; et le voici revenant de Camargue où il est allé observer je ne sais quel petit rapace très rare avec son fils Luca comme lui passionné d’ornithologie…Nous n’avons pas fait la révolution ensemble, ni gravi aucune cime ou parcouru aucune arête, mais notre complicité est unique, pudique et sûre, et je sais qu’il comprendrait et aimerait le dernier livre de De Luca qu’il me dit d’ailleurs avoir rencontré lors d’une des tournées du théâtre de Vidy, quelque part au fin fond de la France, vieux Monsieur en chemise légère signant dans une petite librairie au milieu de deux ou trois dames et qu’il avait pris pour un auteur local avant de le reconnaître.Par ailleurs, durant les vingt ans que nous avons animé Le Passe-Muraille ensemble nous nous sommes entendus sur à peu près tout sans aucune forme de rivalité si fréquente dans le milieu littéraire – ni lui ni moi n’étions en somme «milieu» en quoi que ce soit, et c’est avec la même reconnaissance que nous évoquons aujourd’hui le privilège énorme que ç’a été de rencontrer tant de gens intéressants durant ces décennies de totale liberté professionnelle à une époque où il y avait plus de trente théâtres entre Lausanne et Genève, des centaines de parutions à chaque rentrée littéraire romande, mes innombrables équipées parisienne et l’aventure qu’il a vécue au côté de René Gonzalez, la mienne avec Dimitri dont la mémoire sera honorée ces jours, mais à présent, bordel, à quel éditeur se fier, quel interlocuteur trouver dans la profusion confuse ?MICHOU. – Comme nous évoquions le chaos océanique de l’Internet, et plus précisément le tsunami des influenceurs à la petite semaine, mon compère René me cite le succès phénoménal d’un certain Michou, qui draine des millions de followers en gesticulant dans le vide sur un vague fond de rap, et je vais y voir pour trouver, en effet, un avatar français du même branle numérique mondial, documenté depuis longtemps aux States et dans les pays asiatiques où des zombies femelles et mâles accumulent des fortunes en ne faisant qu’apparaître et se vendre, au propre ( !) en se manuélisant à vue pour de la thune, ou au figuré en monétisant divers produits cosmétiques et autres peluches, etc. Et puis quoi ? Et puis rien...HISTORIQUE. – La dernière expression médiatique en vogue dans le commentaire sportif , dont la niaiserie en dit long sur l’époque, consiste à parler de «l’Histoire qui s’écrit» à propos de n’importe quelle performance personnelle ou collective, alors même que, dans les plus grandes largeurs de la pompe locale ou internationale, l’on se répand plus que jamais en commémorations et autres «devoirs de mémoire», où l’admiration légitime se transforme en célébration et en outrances lyriques aussi ridicules que celle de ce cher confrère se demandant, l’autre jour, si Roger Federer n’allait pas céder bientôt son auréole d’immortel de la raquette pour cause de mal de genou, etc.DU RIDICULE. – Plus j’avance dans la relecture du récit de Zorn, et plus ses observations me renvoient à celles que j’ai pu faire dans un autre milieu social que le sien, dont certaines caractéristiques ressortissent à la même mentalité confinée, voire étriquée, d’une époque.Sur la côte dorée zurichoise, l’on te disait d’aller «voir à Moscou» si tu avais des penchants socialisants, et toute forme d’originalité ou de talent excessif relevait d’une faute de goût ou d’un écart de conduite relevant du « ridicule » sans qu’on osât même prononcer ce mot en forme de jugement de valeur.Quant au milieu petit-bourgeois qui était le nôtre, il était plus débonnaire, mais je me souviens de la sœur d’un ami fiancée avec un bourgeois nanti, qui évoquait cette classe sociale plus huppée en affirmant que les parents de son promis avaient «quelque argent», avec un ton qui en disait long sur ses rêveries...Or chacun voit le « ridicule » de l’autre avec les yeux de son milieu, et c’est ainsi que nos parents ne pouvaient appeler que «rupins» les habitants d’une partie réservée du quartier de nos enfances, où se concentraient quelques villas plus luxueuses que nos maisons familiales subventionnées typiques de ces débuts des trente glorieuses, etc.AU BORD DU CIEL. – Je lisais hier le récit de De Luca évoquant les « conquérants de l’inutile» et l’élan physique et moral poussant son protagoniste à la recherche de « la beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l’air, comme le rivage avec la mer », et je me suis rappelé notre dernier parcours d’arête avec Reynald, dix jours avant sa chute mortelle dans les séracs du Dolent, puis j’ai rejoint Lady L. à La Désirade où elle remontait pour la première fois depuis des mois, surmontant la fatigue consécutive à sa sixième perfusion, son manque de souffle et l’affaiblissement de ses muscles, encouragée par sa fille Number One, qui l’a voiturée là-haut, et cheminant ensuite d’une chaise à l’autre – sa fille Number Two ayant balisé les cent vingt-cinq mètres de la montée en disposant trois sièges d’étape… pour retrouver ensuite les petits lascars dont l’aîné l’a questionnée à propos de sa calvitie de nouveau-né et de sa maladie, plus angoissé évidemment (il a quatre ans) que son petite frère (qui en a deux) mais semblant apaisé par ses explications.Je n’ose trop penser à ce qu’a éprouvé ma bonne amie en retrouvant La Désirade, après l’accès de mélancolie qui m’a pris l’autre jour en y remontant après un détour à l’isba – et tous ces livres, tous ces manuscrits, tous ces documents, tous ces tableaux, tous ces objets, tout cet univers familier dont la maladie et d’autres circonstances nous ont éloignés -, mais il me semble que l’un et l’autre restons « dans la sérénité », en tout cas aux yeux des autres, et je souris en pensant au message de l’ami R., l’autre jour, qui me disait qu’il admirait ma « ténacité », faisant allusion à notre situation, alors que lui, me dit-il, aurait pris la fuite dans les mêmes circonstances…Et quoi encore ? Comme s’il fallait de la ténacité pour accompagner une personne qu’on aime, et plus précisément ma bonne amie, Lady L. au grand cœur quoique très charcuté récemment, patronne vénérée de notre chien Snoopy et mère avérée de nos filles lui ressemblant comme une blonde et une brune peuvent ressembler à une brune devenue blonde puis chauve, propriétaire en titre de notre Honda Jazz et gestionnaire de nos biens meubles et volatils, enfin la petite fille émouvante et la vieille fée que je crèverais d’abandonner sous prétexte qu’un putain de crabe la grignote, autant dire restant ainsi avec elle sans le moindre mérite en espérant ne pas lui faire la mauvaise farce de clamser avant elle sous l’effet de mon propre souffle au cœur, etc. (Ce dimanche 22 août). -
Au Temps retourné
 Vous me trouverez chez vous tous les jours:je suis votre obligé;sans l’avoir même imaginéje me suis trouvé là,et la nuit vous me rejoindrezsur le toit où l’on fume...L’on vous dit partis en fuméemais c’est une légendeà laquelle je n’ai jamais cru:la Chine ancienne m’est présenteautant que le fol Hannibals’agitant dans la chapelle ardente,et le sage Atalante,et Léonard sur son chevalou Schubert en ses doux hiversou la Belle endormiese retrouvant au fond des heuresoù l’on parle en dormant...Nous nous retournerons pour voirvos lucioles à la nuitvenue ou dans le soir qui vient;jamais vous n’avez égaréla boussole étoilée,et jamais ne se dira plus,en ces lieux éclairés,ce qui ne se dit pas...Image: Philip Seelen.
Vous me trouverez chez vous tous les jours:je suis votre obligé;sans l’avoir même imaginéje me suis trouvé là,et la nuit vous me rejoindrezsur le toit où l’on fume...L’on vous dit partis en fuméemais c’est une légendeà laquelle je n’ai jamais cru:la Chine ancienne m’est présenteautant que le fol Hannibals’agitant dans la chapelle ardente,et le sage Atalante,et Léonard sur son chevalou Schubert en ses doux hiversou la Belle endormiese retrouvant au fond des heuresoù l’on parle en dormant...Nous nous retournerons pour voirvos lucioles à la nuitvenue ou dans le soir qui vient;jamais vous n’avez égaréla boussole étoilée,et jamais ne se dira plus,en ces lieux éclairés,ce qui ne se dit pas...Image: Philip Seelen. -
Le Temps accordé
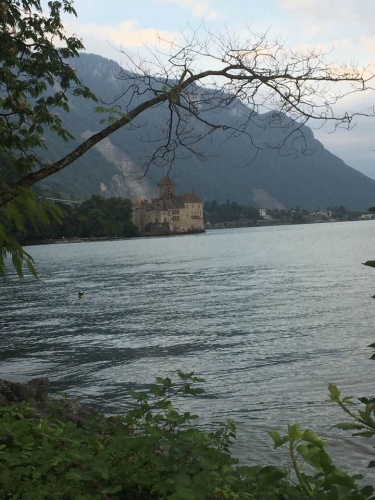
PASSÉ DÉCOMPOSÉ. – Marchant ce soir sur le quai en vue du Château, et me remémorant les stances romantiques assez ampoulées du Prisoner of Chillon de Lord Byron, je me suis rappelé les questions historiques embarrassantes dont m’avait harcelé Vladimir Volkoff, certain après-midi très ensoleillé sur le grand bateau blanc au pont arrière réquisitionné pour la célébration des 25 ans de L’Âge d’Homme - questions relatives, précisément, au sujet du poème en question, donc à Bonivard dont je ne savais à peu près rien, et tout à l’heure j’interroge Lady L. à ce propos, elle qui fait mine depuis quelques années de s’intéresser à notre histoire, mais elle m’envoie promener après m’avoir juste lancé que Bonivard était une espèce d’idéaliste genevois opposé aux ducs de Savoie, exactement ce que j’avais dit à Volkoff que ce vague impatientait, et voici que j’apprends par Wikipedia qui fut, plus en détail, ce nobliau du bout du lac portant un titre dans la hiérarchie ecclésiastique locale, qui paya de six ans de geôle son opposition aux Savoie, fut arraché d’une Genève encore catholique qu’il retrouva protestante à son retour après avoir coupé à l’estrapade et s’accommodant si bien des changements qu’il devint, notable rétabli, l’un des premiers historiens de la République et l’auteur de traités de droit – tout cela que j’annonce crânement à ma bonne amie qui me dit non sans provocation qu’elle n’en à rien à souder à ce moment précsr et se gausse même de mon essai de rattrapage tardif, comme je me suis gaussé cet après-midi du passé « théologique » de notre ami Bernard C. passé prendre des nouvelles de la santé de sa vieille complice de la HEP avec un pack de Cocas… (Ce mardi 17 août)
DE LA FOI. – Octogénaire resté très vif d’esprit, et dont la main droite bat la mesure comme un moignon d’aile hors de contrôle (Parkinson) mais semblant battre comiquement la mesure de son discours, notre ami Bernard C. se prête au jeu quand je le charrie, à propos de son passé d’étudiant en théologie succédant à un premier apprentissage de radio-télégraphiste, sur le ton inquisitorial des gens qui vous demandent « où vous en êtes avec Dieu », et dans la foulée nous parlons de Berne, de la Bibliothèque national où j’ai déposé mes archives, sur la même rue où se trouvait sa pension de jeune homme (je n’arrive pas à me le représenter physiquement en jeune homme, probablement avec l’air très convenable d’un aspirant pasteur qui s’ignore encore), il se rappelle son goût particulier pour l’un des grands ponts sur l’Aar et de sa fascination pour le roman de Pascal Mercier, Train de nuit pour Lisbonne, il m’avoue en passant qu’il a lâché ses études de théologie avant même qu’il ait compris qu’on pouvait être pasteur sans avoir la foi, et là je lui demande ce que c’est que la foi pour un protestant, si ça a le moindre sens d’avoir la foi avec cette mentalité scientifique et ce refus de la magie et des mystères, puis je lui parle de Peter Sloterdijk (dont il n’a jamais entendu parler) et de son dernier livre, Faire parler le ciel, où il est question non pas de théologie mais de théopoésie, à savoir de tout ce qui a été écrit des dieux multiples et du Dieu devenu l’Écrivain unique à foison de nègres de toutes les couleurs, et tout ça a l’air de stimuler la bonne humeur de notre ami qui ne partira pas sans noter les références du livre d’histoire locale que lui a recommandé Lady L. ainsi que de Faire parler le ciel et La Folie de Dieu du même Sloterdijk, après que nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’avoir ou non la foi n’a pas la moindre importance vu que ce qui compte est le rite et les modalités visibles ou invisibles de l’oraison et des grâces diverses, l’entretien commun de la bonté et ce qui nous fait lever les yeux au ciel et chantonner de joie, etc.
Bernard le chrétien mécréant nous avait déjà quittés quand je me suis rappelé que le vieux Théodore Monod, se traitant lui-même de mécréant, avoue dans Révérence à la viequ’il prononce, tous les matins, ses Béatitudes, et de même la prière du cœur fait-elle partie, depuis des années, de ce que Sloterdijk le cycliste appellerait mon fitness spirituel…

CHRIST DES DOULEURS. – Je l’ai découvert tout au fond de l’église de Caux, vide et assez froide quoique pas autant qu’un de ces temples protestants à vous glacer le sang tel que les évoque justement Victor Hugo à propos du temple de Vevey, et la présence de cette effigie du Crucifié m’a paru d’autant plus émouvante, à côté des diverses représentations de l’art sacré marquant l’intérieur de l’édifice, qu’elle avait les traits d’une épure de la douleur relevant d’un art réellement empreint de spiritualité. Je n’y ai pas vu une œuvre d’art alors que l’objet, en concentré d’émotion, dépassait par celle-ci tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire, sans ressortir seulement à l’esthétique, comme une espèce de prière de bois à consistance de doux ivoire et taché de sang divinement humain, etc.

NETTOYAGE CALVINISTE. – Ce qu’écrit Victor Hugo de l’église Saint-Martin de Vevey n’est pas dans un sac, mais il a raison et ce qu’il en dit pourrait se rapporter à d’innombrables temples « réformés » de nos régions, dont l’aspect « nettoyé » a d’ailleurs contaminé pas mal d’édifices catholiques ou de sanctuaires contemporains de béton brossé : Quant à l’église de Vevey, Victor Hugo dit plus précisément qu’elle a subi « cette espèce de dévastation soigneuse, méthodique et vernissée que le protestantisme inflige aux églises gothiques. Tout est ratissé, raboté, balayé, défiguré, blanchi, lustré et frotté. C’est un mélange stupide et prétentieux de barbarie et de nettoyage», etc.

MELTING POT. – Il est passé neuf heures du soir et je prends ces notes sur la terrasse du Coucou (Altitude 1150 mètres, à peu près la hauteur de La Désirade à deux vals d’écart) donnant sur les lointains lémaniques enflammés par le crépuscule, je suis monté tout à l’heure de la chapelle de Caux au Christ souffrant empêché de voir le lac par l’affreuse masse arrière du palace de Caux érigé à l’enseigne du Réarmement moral, j’ai passé devant le chalet du fondateur du festival de Jazz de Montreux, à l’enseigne du Picotin, dans la piscine duquel moult célébrités ont brassé l’eau peu bénite mais revigorante du maître de céans – j’ai vu des limousines y voiturer James Brown et sa bande ou Quincy Jones et la sienne, entre tant d’autres -, et me voici avec mon escort dog au milieu des dîneurs chics, seul à me contenter d’un Aperol Spritz et d’un café au lait dit renvers + deux boules de glace alors que ma douce, qui a savouré ce midi une Pizza Napoli à la Dolce, donc 666 mètres plus bas, s’inquiète probablement du lent retour de ses promeneurs du soir… (ce mercredi 18 août)
-
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2021)À REBOURS. – L’âge où nous nous raconterions en remontant le fil du temps, du jour écoulé aux semaines et aux mois, et sans cesser d’avancer en revivant sans ressasser, en quête non tant de vérité que de sérénité…
(Lectures du monde, 2021)À REBOURS. – L’âge où nous nous raconterions en remontant le fil du temps, du jour écoulé aux semaines et aux mois, et sans cesser d’avancer en revivant sans ressasser, en quête non tant de vérité que de sérénité… TEL JOUR PAR EXEMPLE... – Lady L. m’a dit tout à l’heure que le souffle recommençait de lui manquer, et cela ne m’a guère étonné après tout ce qu’elle a trafiqué du matin au soir pendant que j’étais à Lausanne pour mes dents, le matin la lessive et le chien jusqu’au casino et retour sans son rollator, ensuite sûrement nos comptes et ses affaires diverses et d’autres rangements, son repas puisque je n’y étais pas et ensuite le repassage pendant que l’aide de ménage s’activait autour d’elle, et tout ça sans trop peiner comme ces derniers jours déclarés « de repos » entre les séquences de chimio reprenant vendredi ; donc sa remarque ne m’a pas trop inquiété les « circonstances » étant ce qu’elles sont, mais on en revenait à cette espèce de limite qui lui est désormais imposée depuis son opération, et ça ira comme ça ces prochains temps, me dis-je, comme je me le suis dit à moi-même toute la journée en vacillant pas mal du fait de mes troubles cardiaques et neurologiquess et des faiblesses musculaires qui me font craindre l’éventuelle obstruction de mes stents évoquée par l’angiologue Noyau, ce soir sur le quai aux Fleurs avant qu’elle ne me parle de son souffle, sortant à mon tour avec le chien, et dans les couloirs du train durant mon deuxième aller-retour de la journée après le premier trajet matinal en voiture (le deuxième rendez-vous fixé pour récupérer mes dents rechargées), et avant le retour dans les rues de Lausanne, comme en fin de matinée à la bibliothèque universitaire où j’ai fait un saut après le premier rendez-vous et me suis donc trouvé sans dents d’en bas (l’appareil d’en haut à sa place mais celui d’en bas retiré et ne me restant qu’une seule dent heureusement cachée par le masque), et le choc au passage à la bibliothèque vers midi, le coup de blues en voyant tous ces étudiants appliqués, pas un de plus de trente ans, tous beaux et sans un regard pour ce vieil oiseau déplumé qui se rappelait tant d’heures heureuses en ces lieux, la rage et la joie mêlées, la même joie que trois heures plus tard quand j’ai vu, dans la librairie où je m’étais promis d’aller pêcher les coffrets de La Recherche qui me manquent, hélas manquants là aussi, je suis tombé sur Nuit de foi et de vertu, le recueil de poèmes de Louise Glück que Gallimard a sorti en version bilingue et que j’ai commencé de lire sur une terrasse puis dans le train du retour, immédiatement séduit par le ton de cette voix et par les résonances de son chant – et là je m’aperçois que je n’ai pas parlé de l’« épisode grec » de mon premier rendez-vous de ce matin, quand le bel assistant - genre Levantin à voix douce et zyeux perses - de la dentiste (la jolie dentiste, devrais-je préciser, que j’appelle « jeune fille » et qui m’appelle «jeune homme» en me demandant ce que je suis en train d’écrire) m’a évoqué les trois semaines de vacances qu’il vient de passer en Grèce, le salopiau, avant de me proposer de me rincer la bouche…D’AUTRES RÉSURGENCES. - Dans la foulée de cette esquisse de récit mal fichu d’une journée à l’envers, j’entend encore ma bonne amie me dire, l’autre matin, que sa maladie lui ramène tout un monde de souvenirs enfouis qu’elle n’a jamais été du genre à ressasser, n’étant pas de mon espèce introspective passablement obsessionnelle, et voici donc que, confrontés tous deux à un temps plus compté que naguère - ne serait-ce qu’au début de cette année pour ce qui la concerne -, après le rude avertissement de ma crise cardiaque, nous en arrivons à aborder des thèmes, des souvenirs partagés ou non, des considérations sur la vie et les gens qui se chargent d’une nouvelle densité, toutes choses qui seront à détailler plus précisément…
TEL JOUR PAR EXEMPLE... – Lady L. m’a dit tout à l’heure que le souffle recommençait de lui manquer, et cela ne m’a guère étonné après tout ce qu’elle a trafiqué du matin au soir pendant que j’étais à Lausanne pour mes dents, le matin la lessive et le chien jusqu’au casino et retour sans son rollator, ensuite sûrement nos comptes et ses affaires diverses et d’autres rangements, son repas puisque je n’y étais pas et ensuite le repassage pendant que l’aide de ménage s’activait autour d’elle, et tout ça sans trop peiner comme ces derniers jours déclarés « de repos » entre les séquences de chimio reprenant vendredi ; donc sa remarque ne m’a pas trop inquiété les « circonstances » étant ce qu’elles sont, mais on en revenait à cette espèce de limite qui lui est désormais imposée depuis son opération, et ça ira comme ça ces prochains temps, me dis-je, comme je me le suis dit à moi-même toute la journée en vacillant pas mal du fait de mes troubles cardiaques et neurologiquess et des faiblesses musculaires qui me font craindre l’éventuelle obstruction de mes stents évoquée par l’angiologue Noyau, ce soir sur le quai aux Fleurs avant qu’elle ne me parle de son souffle, sortant à mon tour avec le chien, et dans les couloirs du train durant mon deuxième aller-retour de la journée après le premier trajet matinal en voiture (le deuxième rendez-vous fixé pour récupérer mes dents rechargées), et avant le retour dans les rues de Lausanne, comme en fin de matinée à la bibliothèque universitaire où j’ai fait un saut après le premier rendez-vous et me suis donc trouvé sans dents d’en bas (l’appareil d’en haut à sa place mais celui d’en bas retiré et ne me restant qu’une seule dent heureusement cachée par le masque), et le choc au passage à la bibliothèque vers midi, le coup de blues en voyant tous ces étudiants appliqués, pas un de plus de trente ans, tous beaux et sans un regard pour ce vieil oiseau déplumé qui se rappelait tant d’heures heureuses en ces lieux, la rage et la joie mêlées, la même joie que trois heures plus tard quand j’ai vu, dans la librairie où je m’étais promis d’aller pêcher les coffrets de La Recherche qui me manquent, hélas manquants là aussi, je suis tombé sur Nuit de foi et de vertu, le recueil de poèmes de Louise Glück que Gallimard a sorti en version bilingue et que j’ai commencé de lire sur une terrasse puis dans le train du retour, immédiatement séduit par le ton de cette voix et par les résonances de son chant – et là je m’aperçois que je n’ai pas parlé de l’« épisode grec » de mon premier rendez-vous de ce matin, quand le bel assistant - genre Levantin à voix douce et zyeux perses - de la dentiste (la jolie dentiste, devrais-je préciser, que j’appelle « jeune fille » et qui m’appelle «jeune homme» en me demandant ce que je suis en train d’écrire) m’a évoqué les trois semaines de vacances qu’il vient de passer en Grèce, le salopiau, avant de me proposer de me rincer la bouche…D’AUTRES RÉSURGENCES. - Dans la foulée de cette esquisse de récit mal fichu d’une journée à l’envers, j’entend encore ma bonne amie me dire, l’autre matin, que sa maladie lui ramène tout un monde de souvenirs enfouis qu’elle n’a jamais été du genre à ressasser, n’étant pas de mon espèce introspective passablement obsessionnelle, et voici donc que, confrontés tous deux à un temps plus compté que naguère - ne serait-ce qu’au début de cette année pour ce qui la concerne -, après le rude avertissement de ma crise cardiaque, nous en arrivons à aborder des thèmes, des souvenirs partagés ou non, des considérations sur la vie et les gens qui se chargent d’une nouvelle densité, toutes choses qui seront à détailler plus précisément… POÉSIE. – En commençant cet après-midi de lire le recueil de Louise Glück sur la terrasse du café de Grancy, gardant mon masque avant la récupération de mes dents, j’ai été immédiatement touché, et même ébranlé, par ces vers rythmés plus que rimés, modulant une mélodie intérieure qui m’a rappelé, en tout différent, les strophes d’un Lubicz-Milsoz ou le Pavese le plus intime et le plus « universel » à la fois, avec un mélange d’extrême sensibilité et de force expressive jamais porté à l’excès ou à l’effet; et ensuite, me rappelant le vieil Alfred Berchtold qui lisait des poèmes à sa chère et tendre en fin de vie, je me suis dit, comme rarement, que j’aurais envie à mon tour de lire ces pages à Lady L. sans penser pour autant, cela va sans dire, que nous sommes peut-être « en fin de vie », non mais des fois…
POÉSIE. – En commençant cet après-midi de lire le recueil de Louise Glück sur la terrasse du café de Grancy, gardant mon masque avant la récupération de mes dents, j’ai été immédiatement touché, et même ébranlé, par ces vers rythmés plus que rimés, modulant une mélodie intérieure qui m’a rappelé, en tout différent, les strophes d’un Lubicz-Milsoz ou le Pavese le plus intime et le plus « universel » à la fois, avec un mélange d’extrême sensibilité et de force expressive jamais porté à l’excès ou à l’effet; et ensuite, me rappelant le vieil Alfred Berchtold qui lisait des poèmes à sa chère et tendre en fin de vie, je me suis dit, comme rarement, que j’aurais envie à mon tour de lire ces pages à Lady L. sans penser pour autant, cela va sans dire, que nous sommes peut-être « en fin de vie », non mais des fois… -
En mémoire de Dimitri
Dix ans après la mort accidentelle du fondateur des éditions L'Âge d'Homme, un hommage collectif sera rendu le dimanche 22 août prochain à Montricher à l'enseigne de la Fondation Jan Michalski, incluant une table ronde sur le thème de l'édition "à la marge", trois témoignages personnels de Georges Nivat, Claude Frochaux et Thierry Wolton, et une exposition retraçant le parcours de Dimitri. Entrée libre. Réservations sur le site de la fondation:info@fondation-janmichalski.chVladimir Dimitrijevic, surnommé Dimitri, s'est tué le 28 juin 2011 sur une route de France. Le fondateur de L'Age d'Homme fut un éditeur de classe européenne. Il publia plus de 4000 livres à Lausanne. En août 1983 parut, à Lausanne, un extraordinaire roman de l'écrivain russe Vassili Grossman, intitulé Vie et destin. Entre autres fleurons des éditions L'Age d'Homme, fondées en nos murs en 1966, ce livre bouleversant confrontait le lecteur à la double horreur totalitaire, au XXe siècle, du nazisme et du stalinisme. Dimitri l'appelait "le livre de nos mères".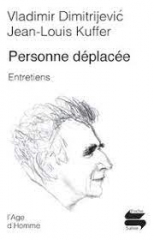 Or la vie de Vladimir Dimitrijevic, né en 1934 à Skopje, évoque elle aussi un roman scellé par le destin. Fils d’un artisan horloger-bijoutier jeté en prison en 1945, comme nombre de commerçants, le jeune Vladimir, fou de littérature et de football, s'enfuit de son pays à vingt ans sous le faux nom d’un personnage de Simenon. Dans son "autobiographie d'un barbare" parue sous le titre de Personne déplacée, Dimitri a raconté ses années d'enfance et de jeunesse marquées par les crimes des nazis et des oustachis croates, mais aussi par les visites à son père emprisonné. Arrivé en Suisse le 4 mars 1954 avec 12 dollars en poche, le jeune déserteur de l’armée du peuple devint libraire à Neuchâtel puis, à Lausanne, chez Payot, où son passage a laissé un souvenir indélébile. Or, impatient de combler les « vides » d’un catalogue selon son cœur, le passeur de vocation, soutenu par quelques amis et son épouse Geneviève, fonda L’Age d’Homme en 1966.Dans la foulée, il ne tarda pas à tisser des liens avec Paris, où il se rendait régulièrement à bord d' « Algernon », son fourgon d’éternel errant dans lequel il serrait son sac de couchage par mesure d’économie. Les rapports compliqués de Dimitri avec l’argent marquaient d’ailleurs une partie de sa légende. Lui qui était capable de lésiner sur des droits d'auteurs légitimes, alla ainsi jusqu’à hypothéquer sa maison de hauts de Lausanne afin de publier les pavés d’Alexandre Zinoviev, des Hauteurs béantes au mémorable Avenir radieux.Ses positions idéologiques rebutaient également d'aucuns. Orthodoxe croyant et conservateur, il passa d’un anticommunisme résolu à un nationalisme serbe qui le rapprocha, dès la fin des années 1980, de ceux-là même qui avaient persécuté son père. Lorsqu'on lui reprochait d'être "pro-serbe", celui qui eût mérité la citoyenneté d'honneur de notre pays répondait sobrement: "pas pro-Serbe, juste Serbe"...Mondialement connu pour son catalogue slave, L’Age d’Homme redimensionna également l’édition romande. À côté de l’intégrale mythique du Journal intime d’Amiel et des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, de nombreux écrivains romands contemporains y ont publié leurs ouvrages.Au nombre des auteurs «phares» défendus par Dimitri figuraient le titan américain Thomas Wolfe, idole de sa jeunesse, autant que Chesterton ou Dürrenmatt, Georges Haldas au premier rang des écrivains romands, ou les Français Vladimir Volkoff et Pierre Gripari, entre tant d'autres francophones de Belgique et du Québec.Dans les grandes largeurs, Dimitri était un homme inspiré, proprement génial par moments, qui pouvait se montrer d’une extrême délicatesse de sentiments. Ses intuitions de lecteur étaient incomparables et ses curiosités inépuisables.Mais c’était aussi un «barbare», selon sa propre expression, qui ne savait pas «faire le beau».Malgré les services exceptionnels qu’il rendit à notre littérature et à notre vie culturelle, aucune reconnaissance publique ne lui a été manifestée - honte à nos autorités -, mais il ne s’en plaignait pas, n’ayant rien fait pour flatter.En son antre du Métropole, à Lausanne, nous l’avons connu irradiant et fraternel, puis il s’est assombri. Les lendemains de la guerre en ex-Yougoslavie, la difficulté de survivre dans cet «empire du simulacre» qu’il fut des premiers à stigmatiser, la perte de Geneviève qui l'avait secondé avec une incomparable abnégation, le poids du monde enfin ont accentué la part d’ombre de cette personnalité à la Dostoïevski, complexe et parfois insaisissable, croyant jusqu’au fanatisme, tantôt avenant et tantôt impossible, terroriste ou bouleversant de douceur retrouvée.Enfin, par delà les eaux sombres de sa mort tragique, «ses» milliers de livres évoquent la présence tutélaire de ce grand passeur.Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. Entretiens avec Jean-Louis Kuffer. Editions Pierre-Marcel Favre, 1986. Réédité en 2010 à L’Age d’Homme, en Poche suisse.Image JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987, lors de la présentation en Serbie de la traduction française de Migrations chef-d'oeuvre de Milos Tsernianski.
Or la vie de Vladimir Dimitrijevic, né en 1934 à Skopje, évoque elle aussi un roman scellé par le destin. Fils d’un artisan horloger-bijoutier jeté en prison en 1945, comme nombre de commerçants, le jeune Vladimir, fou de littérature et de football, s'enfuit de son pays à vingt ans sous le faux nom d’un personnage de Simenon. Dans son "autobiographie d'un barbare" parue sous le titre de Personne déplacée, Dimitri a raconté ses années d'enfance et de jeunesse marquées par les crimes des nazis et des oustachis croates, mais aussi par les visites à son père emprisonné. Arrivé en Suisse le 4 mars 1954 avec 12 dollars en poche, le jeune déserteur de l’armée du peuple devint libraire à Neuchâtel puis, à Lausanne, chez Payot, où son passage a laissé un souvenir indélébile. Or, impatient de combler les « vides » d’un catalogue selon son cœur, le passeur de vocation, soutenu par quelques amis et son épouse Geneviève, fonda L’Age d’Homme en 1966.Dans la foulée, il ne tarda pas à tisser des liens avec Paris, où il se rendait régulièrement à bord d' « Algernon », son fourgon d’éternel errant dans lequel il serrait son sac de couchage par mesure d’économie. Les rapports compliqués de Dimitri avec l’argent marquaient d’ailleurs une partie de sa légende. Lui qui était capable de lésiner sur des droits d'auteurs légitimes, alla ainsi jusqu’à hypothéquer sa maison de hauts de Lausanne afin de publier les pavés d’Alexandre Zinoviev, des Hauteurs béantes au mémorable Avenir radieux.Ses positions idéologiques rebutaient également d'aucuns. Orthodoxe croyant et conservateur, il passa d’un anticommunisme résolu à un nationalisme serbe qui le rapprocha, dès la fin des années 1980, de ceux-là même qui avaient persécuté son père. Lorsqu'on lui reprochait d'être "pro-serbe", celui qui eût mérité la citoyenneté d'honneur de notre pays répondait sobrement: "pas pro-Serbe, juste Serbe"...Mondialement connu pour son catalogue slave, L’Age d’Homme redimensionna également l’édition romande. À côté de l’intégrale mythique du Journal intime d’Amiel et des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, de nombreux écrivains romands contemporains y ont publié leurs ouvrages.Au nombre des auteurs «phares» défendus par Dimitri figuraient le titan américain Thomas Wolfe, idole de sa jeunesse, autant que Chesterton ou Dürrenmatt, Georges Haldas au premier rang des écrivains romands, ou les Français Vladimir Volkoff et Pierre Gripari, entre tant d'autres francophones de Belgique et du Québec.Dans les grandes largeurs, Dimitri était un homme inspiré, proprement génial par moments, qui pouvait se montrer d’une extrême délicatesse de sentiments. Ses intuitions de lecteur étaient incomparables et ses curiosités inépuisables.Mais c’était aussi un «barbare», selon sa propre expression, qui ne savait pas «faire le beau».Malgré les services exceptionnels qu’il rendit à notre littérature et à notre vie culturelle, aucune reconnaissance publique ne lui a été manifestée - honte à nos autorités -, mais il ne s’en plaignait pas, n’ayant rien fait pour flatter.En son antre du Métropole, à Lausanne, nous l’avons connu irradiant et fraternel, puis il s’est assombri. Les lendemains de la guerre en ex-Yougoslavie, la difficulté de survivre dans cet «empire du simulacre» qu’il fut des premiers à stigmatiser, la perte de Geneviève qui l'avait secondé avec une incomparable abnégation, le poids du monde enfin ont accentué la part d’ombre de cette personnalité à la Dostoïevski, complexe et parfois insaisissable, croyant jusqu’au fanatisme, tantôt avenant et tantôt impossible, terroriste ou bouleversant de douceur retrouvée.Enfin, par delà les eaux sombres de sa mort tragique, «ses» milliers de livres évoquent la présence tutélaire de ce grand passeur.Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. Entretiens avec Jean-Louis Kuffer. Editions Pierre-Marcel Favre, 1986. Réédité en 2010 à L’Age d’Homme, en Poche suisse.Image JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987, lors de la présentation en Serbie de la traduction française de Migrations chef-d'oeuvre de Milos Tsernianski. -
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2021)ENTRE AUTRES NOUVELLES.— Ils vous demandent des nouvelles, mais vous ne savez pas que leur dire, comment ni pourquoi – c’est vrai quoi : pourquoi dire quoi que ce soit de ce qu’on vit quand on vit ça, comment le dire à quelqu’un qui ne le vit pas ?Cependant vous les comprenez, vous savez bien que ce n’est pas de la mauvaise curiosité de leur part, et ce serait facile de leur répondre en deux mots ceci ou cela, mais vous savez aussi que ça ne leur suffit pas, et vous non plus ça ne vous suffirait pas de dire ce que vous vivez en deux ou trois mots, donc on balance entre l’esquive et les échanges suivis avec quelques très proches, alors même que les réseaux ont faussé cette notion de proximité en empiétant de plus en plus sur l’intime et le secret de chacun.Pour le reste on dira que la santé n’est pas le principal, n’était-ce que pour couper court à l’obsession du moment qui fait qu’on ne serait plus ces jours que du matériel humain à vacciner, et que si vous venez nous trouver – tout de même le minimum qu’on puisse exiger de ceux qui s’en inquiètent -, vous serez bien reçus autant par elle, qui est cette semaine en congé de chimio et fait parfois jusqu’à cent mètres à pied sur la Grand-Rue et retour, tandis que lui vous prépare un risotto; et tous deux vous feront oublier qu’ils sont malades, très gravement s’agissant d’elle et un peu moins en ce qui le concerne - lui dont le cœur pourrait lâcher d’un moment à l’autre -, parce qu’il y a tout ce qu’ils vivent à côté de ça, et que la vie continue et ça je te raconte pas mais c’et promis : on se tient au courant pour d’autres nouvelles, etc.
(Lectures du monde, 2021)ENTRE AUTRES NOUVELLES.— Ils vous demandent des nouvelles, mais vous ne savez pas que leur dire, comment ni pourquoi – c’est vrai quoi : pourquoi dire quoi que ce soit de ce qu’on vit quand on vit ça, comment le dire à quelqu’un qui ne le vit pas ?Cependant vous les comprenez, vous savez bien que ce n’est pas de la mauvaise curiosité de leur part, et ce serait facile de leur répondre en deux mots ceci ou cela, mais vous savez aussi que ça ne leur suffit pas, et vous non plus ça ne vous suffirait pas de dire ce que vous vivez en deux ou trois mots, donc on balance entre l’esquive et les échanges suivis avec quelques très proches, alors même que les réseaux ont faussé cette notion de proximité en empiétant de plus en plus sur l’intime et le secret de chacun.Pour le reste on dira que la santé n’est pas le principal, n’était-ce que pour couper court à l’obsession du moment qui fait qu’on ne serait plus ces jours que du matériel humain à vacciner, et que si vous venez nous trouver – tout de même le minimum qu’on puisse exiger de ceux qui s’en inquiètent -, vous serez bien reçus autant par elle, qui est cette semaine en congé de chimio et fait parfois jusqu’à cent mètres à pied sur la Grand-Rue et retour, tandis que lui vous prépare un risotto; et tous deux vous feront oublier qu’ils sont malades, très gravement s’agissant d’elle et un peu moins en ce qui le concerne - lui dont le cœur pourrait lâcher d’un moment à l’autre -, parce qu’il y a tout ce qu’ils vivent à côté de ça, et que la vie continue et ça je te raconte pas mais c’et promis : on se tient au courant pour d’autres nouvelles, etc. MON UNIVERSITE CONTINUE. – La lecture de Balzac m’est devenue, depuis que je l’ai reprise en avril dernier, comme une relance festive de mes universités buissonnières, et pour le meilleur, me semble-t-il, tant ce que j’en vis aujourd’hui m’apparaît dans une quasi totalité jamais perçue jusque-là.C’est ainsi que je vois, mieux que jamais avant, ce qui fait d’Illusions perdues le plus extraordinaire « reportage » qui soit relatif à l’origine de la presse, du journalisme et de ce qu’on appelle aujourd’hui les médias, combinant le roman d’apprentissage et l’implacable aperçu de la corruption progressive d’un jeune homme de grand talent et de faible caractère, le tableau de tout un milieu où interfèrent l'Art et l'Argent, la Littérature et le Commerce, le Théâtre et la Politique, et la fusion "poétique" de l'observation sociale et de l'analyse morale, délectable descente aux enfers de l'agréable et du cynisme sous le regard mélancolique de ceux qui refusent la compromission, etc.
MON UNIVERSITE CONTINUE. – La lecture de Balzac m’est devenue, depuis que je l’ai reprise en avril dernier, comme une relance festive de mes universités buissonnières, et pour le meilleur, me semble-t-il, tant ce que j’en vis aujourd’hui m’apparaît dans une quasi totalité jamais perçue jusque-là.C’est ainsi que je vois, mieux que jamais avant, ce qui fait d’Illusions perdues le plus extraordinaire « reportage » qui soit relatif à l’origine de la presse, du journalisme et de ce qu’on appelle aujourd’hui les médias, combinant le roman d’apprentissage et l’implacable aperçu de la corruption progressive d’un jeune homme de grand talent et de faible caractère, le tableau de tout un milieu où interfèrent l'Art et l'Argent, la Littérature et le Commerce, le Théâtre et la Politique, et la fusion "poétique" de l'observation sociale et de l'analyse morale, délectable descente aux enfers de l'agréable et du cynisme sous le regard mélancolique de ceux qui refusent la compromission, etc.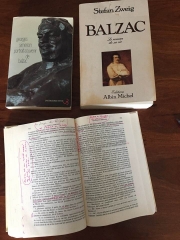 UN BON JEUNE HOMME. – Après m’avoir envoyé un premier message dans lequel il me disait, comme ça, que ce serait pour lui un bonheur « inouï » de collaborer au Passe-Muraille, le jeune Arnaud G. m’a envoyé, non sans candeur, copie de sa licence de lettres, dont je lui ai dit que je n’avais que fiche, puis, sur ma demande insistante, le PDF de son mémoire consacré à Dostoïevski, que j’ai lu avec beaucoup d’attention et d’intérêt, et notamment parce qu’il dépasse le cadre conventionnel d’un travail académique, à quelques détails près.Je m’attendais évidemment à tomber, ici ou là, sur le terme « intradiégétique », et ça n’a pas manqué, mais la démonstration proposée, relative à la construction des personnages et au primat « théâtral » du dialogue, qui structure bonnement la narration des Démons, selon lui, entre autres éléments découlant d’un lecture approfondie du roman et de ses commentateurs (de Bakhtine à Pierre Pascal ou André Markowicz, en passant par Berdiaev et Chestov que j’ai lus à son âge…), tout ça m’a réellement épaté et même ému alors qu’on prétend que tout est fichu et qu’il n’y a plus qu’à retirer l’échelle… et c’est d’ailleurs de ça que nous avons parlé, entre autres, avec ce jeune homme lumineux et modeste qui m’attendait en fin d’après-midi à la terrasse du Rubis de Vevey où nous avons parlé (moi surtout, sacré bavard) presque trois heures durant après qu’il m’eut fait une scène de sincère contrition au motif qu’il avait oublié son porte-monnaie… (Ce mardi 10 août)
UN BON JEUNE HOMME. – Après m’avoir envoyé un premier message dans lequel il me disait, comme ça, que ce serait pour lui un bonheur « inouï » de collaborer au Passe-Muraille, le jeune Arnaud G. m’a envoyé, non sans candeur, copie de sa licence de lettres, dont je lui ai dit que je n’avais que fiche, puis, sur ma demande insistante, le PDF de son mémoire consacré à Dostoïevski, que j’ai lu avec beaucoup d’attention et d’intérêt, et notamment parce qu’il dépasse le cadre conventionnel d’un travail académique, à quelques détails près.Je m’attendais évidemment à tomber, ici ou là, sur le terme « intradiégétique », et ça n’a pas manqué, mais la démonstration proposée, relative à la construction des personnages et au primat « théâtral » du dialogue, qui structure bonnement la narration des Démons, selon lui, entre autres éléments découlant d’un lecture approfondie du roman et de ses commentateurs (de Bakhtine à Pierre Pascal ou André Markowicz, en passant par Berdiaev et Chestov que j’ai lus à son âge…), tout ça m’a réellement épaté et même ému alors qu’on prétend que tout est fichu et qu’il n’y a plus qu’à retirer l’échelle… et c’est d’ailleurs de ça que nous avons parlé, entre autres, avec ce jeune homme lumineux et modeste qui m’attendait en fin d’après-midi à la terrasse du Rubis de Vevey où nous avons parlé (moi surtout, sacré bavard) presque trois heures durant après qu’il m’eut fait une scène de sincère contrition au motif qu’il avait oublié son porte-monnaie… (Ce mardi 10 août) -
Le Temps accordé
(Lectures du monde, 2021)À DISTANCE. – Je n’ai cessé, depuis mes treize quatorze ans, de fréquenter Paris, mais toujours à distance, et pendant les décennies que j’ai sévi dans la chronique littéraire, y revenant parfois chaque mois pour rencontrer des écrivains, je n’ai cessé de me tenir à distance de ceux-ci et plus encore du milieu littéraire, autant que de la paroisse romande, et relisant ces jours Illusions perdues je comprends mieux que, d’abord par instinct et caractère farouche, autant que par expérience de timide, je me sois tenu à l’écart sans nouer presque aucune relation amicale durable, à quelques exceptions près, dont mon cher François ; et je me rappelle alors nos bons moments fraternels avec un Alain Gerber et «la patronne», mais Alain à Paris faisait figure de sanglier des Vosges comme je restais le chevrier des hauts gazons helvètes; ou bien, par la littérature essentiellement, j’ai entretenu des liens suivis avec Pierre Gripari, flanqué de son compère Clergé, et avec Bernard de Fallois, suivi lui aussi d’une espèce de double en la personne de son ami Claude, tous en marge cependant de ce qu’on appelle le parisianisme, que j’ai toujours fui…Or je lis à l’instant, dans le dernier roman de Metin Arditi, cette sentence du marchand Mansour, mentor du jeune Avner, à savoir que « la distance est mère de toutes les sagesses », où j’entends, bien plus qu’une prudence cauteleuse, la précaution liée à ce que René Girard appelle la «médiation externe», qui caractérise le lien de deux amis unis par une même passion désintéressée, sans interférences mimétiques aiguisant les rivalités. Avec Alain il y avait, ainsi, la littérature et le jazz...Girard montre bien la différence de ces deux instances à propos de Don Quichotte, lié à Sancho Pança sous le régime de la « médiation interne », où la rivalité amoureuse ne cesse de troubler la relation des deux personnages, par contraste avec la complicité «chaste» entretenue par Quichotte et le Bachelier, partageant la même passion pour les romans de chevalerie.Comme le disait Saint-Ex en bon chef de la patrouille des castors littéraires, l’amitié (ou l’amour, je ne sais plus) ne consiste pas à se regarder mais à regarder ensemble dans la même direction, etc.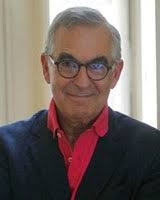 ARDITI ET GIRARD. – Chose comique : après que, sur Messenger, j’ai fait remarquer à Metin Arditi que la triangulation mimétique était non seulement manifeste mais intense, entre certains des personnages de L’Homme qui peignait les âmes, et que cela intéresserait beaucoup un René Girard, dont je ne sais s’il l’a lu, il me répond que « le gars » qui lui envoie ce message est celui-là même qui l’a incité, un soir, à lire le Girard en question, dont Mensonge romantique et vérité romanesque l’a passionné, entre autres…Or cela me touche, comme chaque fois qu’une de mes admirations se trouve partagée et prolongée, dans ce que j’appelle «la bonne suite», de plus en plus rare aujourd’hui à ce qu’il me semble, et que je retrouve avec d’autant plus de reconnaissance avec un Quentin qui, de loin en loin, m’a incité à lire tel ou tel livre (le dernier étant celui d’Aurélien Bellanger) ou qui a lu tel ou tel autre livre que je lui ai conseillé, etc.Voilà ce qui m’attache en somme à quelqu’un: qu’il donne suite…LA POÉSIE EXORCISME. – Je disais à Lady L., l’autre jour, que je sentais en moi la possibilité du racisme, comme un réflexe viscéral qui ne doit rien à mon éducation – même si celle-ci en filtrait sans doute quelque chose des générations aînées, sans que rien n’en transparaisse faute, sans doute, d’occasions incarnées (je ne me souviens pas de la présence d’un seul Noir dans le quartier de notre enfance, ni dans nos classes et jusqu’au bac, dans les années 60), mais jamais je n’ai eu la moindre pensée ni le moindre geste raciste avec aucun des Noirs ou des Arabes que j’ai fréquentés, et c’est avec horreur et tristesse que j’ai revu hier soir Mississipi burning, auquel je repensais ce matin en me rappelant le poème de mon ami Bona, dans la plaquette du Songe de Leonora Carrington, qu’on pourrait dire un exorcisme de toute haine, ressortissant à la guerre des sexes ou aux conflits raciaux, au fil d’une grande métaphore rappelant ce que Michel Serres dit de l’hominisation à propos des fables de La Fontaine; et du coup je me suis dit que j’en ferai ma prochaine chronique en y associant ce que Montaigne dit de nos relations avec l’animal, où je citerai généreusement les vers magnifiques de mon frère congolais …
ARDITI ET GIRARD. – Chose comique : après que, sur Messenger, j’ai fait remarquer à Metin Arditi que la triangulation mimétique était non seulement manifeste mais intense, entre certains des personnages de L’Homme qui peignait les âmes, et que cela intéresserait beaucoup un René Girard, dont je ne sais s’il l’a lu, il me répond que « le gars » qui lui envoie ce message est celui-là même qui l’a incité, un soir, à lire le Girard en question, dont Mensonge romantique et vérité romanesque l’a passionné, entre autres…Or cela me touche, comme chaque fois qu’une de mes admirations se trouve partagée et prolongée, dans ce que j’appelle «la bonne suite», de plus en plus rare aujourd’hui à ce qu’il me semble, et que je retrouve avec d’autant plus de reconnaissance avec un Quentin qui, de loin en loin, m’a incité à lire tel ou tel livre (le dernier étant celui d’Aurélien Bellanger) ou qui a lu tel ou tel autre livre que je lui ai conseillé, etc.Voilà ce qui m’attache en somme à quelqu’un: qu’il donne suite…LA POÉSIE EXORCISME. – Je disais à Lady L., l’autre jour, que je sentais en moi la possibilité du racisme, comme un réflexe viscéral qui ne doit rien à mon éducation – même si celle-ci en filtrait sans doute quelque chose des générations aînées, sans que rien n’en transparaisse faute, sans doute, d’occasions incarnées (je ne me souviens pas de la présence d’un seul Noir dans le quartier de notre enfance, ni dans nos classes et jusqu’au bac, dans les années 60), mais jamais je n’ai eu la moindre pensée ni le moindre geste raciste avec aucun des Noirs ou des Arabes que j’ai fréquentés, et c’est avec horreur et tristesse que j’ai revu hier soir Mississipi burning, auquel je repensais ce matin en me rappelant le poème de mon ami Bona, dans la plaquette du Songe de Leonora Carrington, qu’on pourrait dire un exorcisme de toute haine, ressortissant à la guerre des sexes ou aux conflits raciaux, au fil d’une grande métaphore rappelant ce que Michel Serres dit de l’hominisation à propos des fables de La Fontaine; et du coup je me suis dit que j’en ferai ma prochaine chronique en y associant ce que Montaigne dit de nos relations avec l’animal, où je citerai généreusement les vers magnifiques de mon frère congolais … DOLCE RIVIERA. - Beau moment d’insouciance radieuse à nous offert ce matin sur le quai aux Fleurs, Lady L. profitant (je déteste ce verbe autant que je déteste les profiteurs) de cette période de répit entre deux perfusions et leurs retombées parfois pénibles, tandis que défile la procession bigarrée des vacanciers de toute espèce et de tous âges, avec plein d’enfants et de pères-et-mères attentionnés, plein de baigneurs et de baigneuses dont l’une arbore des seins nus en forme de poires joliment brunes qu’un chenapan mordrait bien en passant, plein de petits chiens et leurs dames d’accompagnement, et voici passer majestueusement La Suisse, fierté de la Compagnie Générale de Navigation (CGN) résumant à merveille ce cliché d’un dimanche estival d’Assomption sûrement béni par la Dame éternelle et ses saints en pédalos. (Ce dimanche 15 août)
DOLCE RIVIERA. - Beau moment d’insouciance radieuse à nous offert ce matin sur le quai aux Fleurs, Lady L. profitant (je déteste ce verbe autant que je déteste les profiteurs) de cette période de répit entre deux perfusions et leurs retombées parfois pénibles, tandis que défile la procession bigarrée des vacanciers de toute espèce et de tous âges, avec plein d’enfants et de pères-et-mères attentionnés, plein de baigneurs et de baigneuses dont l’une arbore des seins nus en forme de poires joliment brunes qu’un chenapan mordrait bien en passant, plein de petits chiens et leurs dames d’accompagnement, et voici passer majestueusement La Suisse, fierté de la Compagnie Générale de Navigation (CGN) résumant à merveille ce cliché d’un dimanche estival d’Assomption sûrement béni par la Dame éternelle et ses saints en pédalos. (Ce dimanche 15 août) -
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2021)VALEUR AJOUTÉE. – Après qu’un simple choc contre le mur a fait tomber le Port de Trouville de Floristella, l’autre jour, Lady L. m’a demandé de le confier en réparation à mes compères encadreurs en leur faisant valoir, a-t-elle insisté, qu’elle y tenait comme à ses prunelles.Juste accroché à un clou malingre, et la couche de peinture argentée de son cadre sommaire s’écaillant, la chose mérite en effet mieux que ça, et Floristella, qui était restauratrice d’ancien, aurait été la première à en convenir…Quant au fait que Lady L. tienne tellement à ce Port de Trouville, autant que moi d’ailleurs et comme à toutes les toiles acquises ou offertes de nos deux amis, je présume qu’il lui parle autant, je crois, par la douceur de ses bleus que par le rappel de notre amitié, nos tendres moments de complicité, ce que chacun a tenu à nous dire à travers les années avec son art, Thierry plus librement lyrique en ses effusions colorées ou dans sa brume mélancolique, Floristella plus purement contemplative et saintement fidèle à l’objet.
(Lectures du monde, 2021)VALEUR AJOUTÉE. – Après qu’un simple choc contre le mur a fait tomber le Port de Trouville de Floristella, l’autre jour, Lady L. m’a demandé de le confier en réparation à mes compères encadreurs en leur faisant valoir, a-t-elle insisté, qu’elle y tenait comme à ses prunelles.Juste accroché à un clou malingre, et la couche de peinture argentée de son cadre sommaire s’écaillant, la chose mérite en effet mieux que ça, et Floristella, qui était restauratrice d’ancien, aurait été la première à en convenir…Quant au fait que Lady L. tienne tellement à ce Port de Trouville, autant que moi d’ailleurs et comme à toutes les toiles acquises ou offertes de nos deux amis, je présume qu’il lui parle autant, je crois, par la douceur de ses bleus que par le rappel de notre amitié, nos tendres moments de complicité, ce que chacun a tenu à nous dire à travers les années avec son art, Thierry plus librement lyrique en ses effusions colorées ou dans sa brume mélancolique, Floristella plus purement contemplative et saintement fidèle à l’objet.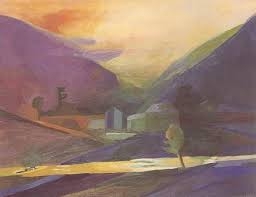 En tout cas la peinture a toujours été, pour nous quatre, autre chose qu’un goût mondain: le partage intime et constant, jamais démenti en plus de vingt ans, de nos regards sur le monde - et leur consonance affective entre nous. (Ce dimanche 8 août)UTILE OU FUTILE ? – On l’aura remarqué depuis deux ou trois décennies : que l’hôpital et ses couloirs se transforment ici et là en succursales de galeries d’art, parfois pour le meilleur - comme à l’entrée du CHUV lausannois avec une splendide sculpture monumentale d’Yves Dana – et plus souvent pour la déco plus ou moins convenue, voire conventionnelle, jusque dans ce nouveau conformisme que représente un certain art contemporain à grande diffusion, qui nous vaut, au sixième dessous du même CHUV, dans le hall d’accueil, cette litho d’Olivier Mosset, pontife suisse et mondial de l’abstraction géométrique qui m’a rappelé, à l’époque où j’étais chef de rubrique, les éloges automatiques de notre critique d’art célébrant, à chaque nouvelle expo de l’incontournable personnage, le caractère éminemment radical voire social et même politique, de ces formes plates et de ces couleurs froides ici relancées sous la forme non moins radicale, voire révolutionnaire, de deux rectangles surperposés jaune citron et rouge cramoisi...
En tout cas la peinture a toujours été, pour nous quatre, autre chose qu’un goût mondain: le partage intime et constant, jamais démenti en plus de vingt ans, de nos regards sur le monde - et leur consonance affective entre nous. (Ce dimanche 8 août)UTILE OU FUTILE ? – On l’aura remarqué depuis deux ou trois décennies : que l’hôpital et ses couloirs se transforment ici et là en succursales de galeries d’art, parfois pour le meilleur - comme à l’entrée du CHUV lausannois avec une splendide sculpture monumentale d’Yves Dana – et plus souvent pour la déco plus ou moins convenue, voire conventionnelle, jusque dans ce nouveau conformisme que représente un certain art contemporain à grande diffusion, qui nous vaut, au sixième dessous du même CHUV, dans le hall d’accueil, cette litho d’Olivier Mosset, pontife suisse et mondial de l’abstraction géométrique qui m’a rappelé, à l’époque où j’étais chef de rubrique, les éloges automatiques de notre critique d’art célébrant, à chaque nouvelle expo de l’incontournable personnage, le caractère éminemment radical voire social et même politique, de ces formes plates et de ces couleurs froides ici relancées sous la forme non moins radicale, voire révolutionnaire, de deux rectangles surperposés jaune citron et rouge cramoisi... De quoi égayer le «vécu» des cancéreux transitant par là ? La question ne se pose même pas, puisque personne ne remarque la fade présence de cet élément de décoration, au contraire (hélas) du mobile aux jolis oiseaux découpés tournant à n’en plus finir dans l’espace d’attente du même service, remplissant plus explicitement, du moins, cette fonction de stimulation des optimismes à bon marché…L’Art devenu composante de déco : voilà bien l’une des conquêtes de l’hospice mondial et de la généralisation du kitsch…DOGMATIQUE ABSTRAITE. – Ce qui est tout de même étonnant, c’est que l’art abstrait, supposé « déconstruire » toute représentation, et tout ce qui a été fait contre l’académisme, indéniablement répétitif et vidé de substance, et contre toute «littérature» ajoutée à la plastique, se soit progressivement transformé en pur discours où les notions de beauté et d’émotion devenaient de plus en plus suspectes alors qu’on réchauffait les vieux poncifs d’un art utilitaire, pour aboutir forcément à un nouvel académisme.Qu’on ose parler aujourd’hui de la «radicalité» d’un Mosset ou des minimalistes américains me paraît aussi bouffon que d’exposer, ici à Montreux, juste à côté de la statue d’un Nabokov au rire sardonique, les resucées industrielles d’un Andy Warhol embaumé depuis longtemps comme une momie blafarde…Or, que proposerais-je, pour ma part, en ornement idéal de la salle d’attente d’un service hospitalier ? Les peintres que j’aime ? Une paroi de Soutine, une autre de Soutter, la terrible Salle d’attente, justement, de Czapski, un couloir dévolu à Nicolas de Staël, un autre à Edvard Munch ou Emil Nolde ? Absolument pas ! Jamais je n'aurai l'impolitesse d'imposer mon goût à qui que ce soit, ni de me servir de l'Art ou de la Littérature à d'autres fins qu'essentiellement inutiles...L’Art a-t-il pour fonction le soutien du moral des troupes, des mal portants ou des hoiries endeuillées ? Faut-il décorer les casernes au même titre que les hôpitaux, et demain les parkings souterrains ou les morgues ?Marcel Aymé, par dérision, a évoqué, dans une nouvelle cocasse à sa manière, la peinture qui se mange. On veut bien que la musique adoucisse les mœurs, mais c’est comme malgré elle, ou malgré les tares de notre espèce, et non du tout par effet programmé.La tendance d’une époque fut de charger l’Art d’une fonction politique , après avoir exigé qu’il fût un soutien de la moralité publique et même privée. Or on aurait tort de croire que ces injonctions fussent surannées, au moment même où se répand un nouveau moralisme où toute passion, toute émotion, toute différenciation deviennent suspectes.Devra-t-on se faire vacciner, demain, contre le virus de l’Art ? Un pas de plus et l’Art ressortira aux soins palliatifs gérés par une indispensable Task Force et intégrés au programme de la fonctionnalité sanitaire…Ce qu’attendant je retourne à la lecture de L’Homme qui peignait les âmes de Metin Arditi, roman fondé sur la conviction tout à fait gratuite, en apparence, selon laquelle la Beauté pourrait sauver le monde…
De quoi égayer le «vécu» des cancéreux transitant par là ? La question ne se pose même pas, puisque personne ne remarque la fade présence de cet élément de décoration, au contraire (hélas) du mobile aux jolis oiseaux découpés tournant à n’en plus finir dans l’espace d’attente du même service, remplissant plus explicitement, du moins, cette fonction de stimulation des optimismes à bon marché…L’Art devenu composante de déco : voilà bien l’une des conquêtes de l’hospice mondial et de la généralisation du kitsch…DOGMATIQUE ABSTRAITE. – Ce qui est tout de même étonnant, c’est que l’art abstrait, supposé « déconstruire » toute représentation, et tout ce qui a été fait contre l’académisme, indéniablement répétitif et vidé de substance, et contre toute «littérature» ajoutée à la plastique, se soit progressivement transformé en pur discours où les notions de beauté et d’émotion devenaient de plus en plus suspectes alors qu’on réchauffait les vieux poncifs d’un art utilitaire, pour aboutir forcément à un nouvel académisme.Qu’on ose parler aujourd’hui de la «radicalité» d’un Mosset ou des minimalistes américains me paraît aussi bouffon que d’exposer, ici à Montreux, juste à côté de la statue d’un Nabokov au rire sardonique, les resucées industrielles d’un Andy Warhol embaumé depuis longtemps comme une momie blafarde…Or, que proposerais-je, pour ma part, en ornement idéal de la salle d’attente d’un service hospitalier ? Les peintres que j’aime ? Une paroi de Soutine, une autre de Soutter, la terrible Salle d’attente, justement, de Czapski, un couloir dévolu à Nicolas de Staël, un autre à Edvard Munch ou Emil Nolde ? Absolument pas ! Jamais je n'aurai l'impolitesse d'imposer mon goût à qui que ce soit, ni de me servir de l'Art ou de la Littérature à d'autres fins qu'essentiellement inutiles...L’Art a-t-il pour fonction le soutien du moral des troupes, des mal portants ou des hoiries endeuillées ? Faut-il décorer les casernes au même titre que les hôpitaux, et demain les parkings souterrains ou les morgues ?Marcel Aymé, par dérision, a évoqué, dans une nouvelle cocasse à sa manière, la peinture qui se mange. On veut bien que la musique adoucisse les mœurs, mais c’est comme malgré elle, ou malgré les tares de notre espèce, et non du tout par effet programmé.La tendance d’une époque fut de charger l’Art d’une fonction politique , après avoir exigé qu’il fût un soutien de la moralité publique et même privée. Or on aurait tort de croire que ces injonctions fussent surannées, au moment même où se répand un nouveau moralisme où toute passion, toute émotion, toute différenciation deviennent suspectes.Devra-t-on se faire vacciner, demain, contre le virus de l’Art ? Un pas de plus et l’Art ressortira aux soins palliatifs gérés par une indispensable Task Force et intégrés au programme de la fonctionnalité sanitaire…Ce qu’attendant je retourne à la lecture de L’Homme qui peignait les âmes de Metin Arditi, roman fondé sur la conviction tout à fait gratuite, en apparence, selon laquelle la Beauté pourrait sauver le monde… -
Ceux qui passent à vol d'oiseau

Celui qui sans mots assèche les récifs / Celle qui ne transige pas avec sa peur / Ceux qui prennent la main venue du plus loin de l’enfance / Celui qui ne suit l’insaisissable que dans les marges de la défaite / Celle qui renoue avec ses souvenances dans la chambre du soir / Ceux que réjouit la farce du soleil derrière l’écran de l’aurore / Celui qui bouscule l’énigme des certitudes / Celle qui ne frappe plus aux portiques de l’angoisse / Ceux qui voient les oiseaux énigmatiques se lever des cendres de la nuit / Celui qui ne se réjouit point de la désunion séparant le corps de l’esprit / Celle qui devine la vérité sous le masque du présent / Ceux qui estiment que l’homme et la bête ne font qu’un sans lâcher leur hot-dog / Celui qui sent le fauve même avec sa cravate à pois / Celle qui se rappelle les caresses des mains d’autrefois / Ceux qui font le buzz dans la canopée / Celle qui fait le bêta en mâle alpha / Celle qui dénonce le manque d’accès à l’Arche de Noé pour les sujets à mobilité réduite et les familles recomposées / Ceux qui savent que les oiseaux annoncent un dénouement sans préciser lequel, etc.
Peinture: Leonora Carrington
-
Retour à Scepanovic
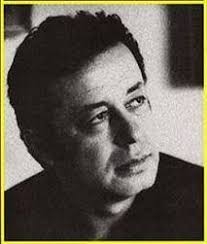
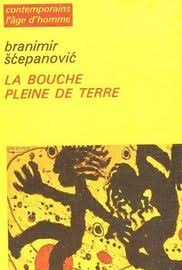 À propos de La mort de Monsieur Golouja et autres nouvelles.Les lecteurs de La bouche pleine de terre se souviennent sans doute du nom de Branimir Scepanovic, l’une des figures les plus marquantes de la littérature yougoslave d’après-guerre. Dans le présent recueil de nouvelles, ils retrouveront les grands thèmes et l’atmosphère fascinante de l’auteur serbe.Au début de La bouche pleine de terre, l’on voit comment, à la suite d’un malentendu, deux chasseurs se mettent à poursuivre un homme errant tout seul dans la forêt à la recherche de ses souvenirs d’enfance, et dans quelles circonstances la poursuite devient chasse à l’homme, à laquelle une foule croissante et gesticulante participe.Condamné à mort par les médecins, le protagoniste n’a pas de raison, apparemment, de fuir les gens qui se sont lancés à ses trousses, lesquels n’en ont pas plus de lui en vouloir. Or c’est précisément cet irrépressible élan vital, sur fond d’engrenage absurde, qui donne au récit de Scepanovic sa frénésie pathétique et la vérité de ses symboles.
À propos de La mort de Monsieur Golouja et autres nouvelles.Les lecteurs de La bouche pleine de terre se souviennent sans doute du nom de Branimir Scepanovic, l’une des figures les plus marquantes de la littérature yougoslave d’après-guerre. Dans le présent recueil de nouvelles, ils retrouveront les grands thèmes et l’atmosphère fascinante de l’auteur serbe.Au début de La bouche pleine de terre, l’on voit comment, à la suite d’un malentendu, deux chasseurs se mettent à poursuivre un homme errant tout seul dans la forêt à la recherche de ses souvenirs d’enfance, et dans quelles circonstances la poursuite devient chasse à l’homme, à laquelle une foule croissante et gesticulante participe.Condamné à mort par les médecins, le protagoniste n’a pas de raison, apparemment, de fuir les gens qui se sont lancés à ses trousses, lesquels n’en ont pas plus de lui en vouloir. Or c’est précisément cet irrépressible élan vital, sur fond d’engrenage absurde, qui donne au récit de Scepanovic sa frénésie pathétique et la vérité de ses symboles.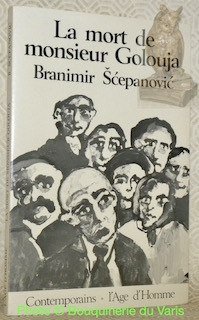 Avec La mort de Monsieur Golouja et La honte, nous retrouvons deux personnages directement confrontés à la mort alors que le héros d’ Avant de la vérité en découd avec les séquelles de la guerre.Dans la première de ces très remarquables nouvelles, la situation paradoxale à laquelle l’auteur parvient à nous faire croire, dans la tonalité des fables d’un Kafka, procède elle aussi d’un malentendu. Nous ne saurons jamais, de fait, ce qui a poussé Monsieur Golouja à s’arrêter quelques jours dans le trou de province suant l’insignifiance et l’ ennui où il va trouver la mort, alors qu’il se dirigeait initialement vers la mer pour y passer un congé; pas plus que nous ne parviendrons à démêler les raisons pour lesquelles il déclare, aux habitants qui l’interrogent sur sa présence en ces lieux, que c’est là qu’il a résolu de mettre fin à ses jours...Ce qui est sûr, en revanche, c’est que dès ce moment-là, Monsieur Golouja se trouve pris dans un engrenage tout aussi aussi implacable que celui de La bouche pleine de terre, à cela près – et c’est là une idée procédant d’un sentiment qui confère à la nouvelle sa résonance déchirante – que la fuite de Monsieur Goulouja passe par tous les délices imaginables...En effet, à la fois émus et flattés par la funeste résolution de Monsieur Goulouja, qui promet soudain de rompre la monotonie de leur existence, les habitants du bourg prennent–ils à cœur de rendre ses derniers jours agréables, lui offrant tout ce dont un quidam peut rrêver. Là-dessus, comme on pouvait s’y attendre, Monsieur Golouja reprend goût à la vie: choyé par les femmes et respecté de tous, il ne cesse de renvoyer la funèbre représentation qu’il leur a promise, poussant même l’insolence jusqu’à engraisser !Victimes et bourreauxL’une des caractéristiques les plus frappantes que nous connaissons de l'art de Branimir Scepanovic tient à la relation fondamentale, que l’écrivain réussit à suggérer, par des moyens essentiellement poétiques, unissant l’homme et l’univers.Les lecteurs de La bouche pleine de terre se souviennent, à l’évidence, de l’apparition insolite du protagoniste en costume de ville, dans une forêt de l’aube; du mélange de sensualité et de violence se dégageant du monde physique dont l’écrivain sait rendre la présence; ou encore, avec le sens de la mise en scène d’un cinéaste «mental», du contrepoint auquel l’auteur excelle, passant des libres espaces aux retours en arrière de la mémoire, du travelling effréné aux gros plan.Perdu dans le cosmos, l’homme selon Scepanovic n’est pas, toutefois, de ces fils de l’absurde qui foisonnent dans le roman contemporain. Enraciné dans une terre, avec des souvenirs qui lui donnent un espace intérieur, c’est bien plutôt un personnage tragique, tissé de bien et de mal, qui prend conscience de sa précarité dans des situations-limites.Tel apparaît aussi Antonio, dans Avant la vérité, qui revient après des années dans le village dont il commandait la garnison d’occupation. Attiré par le souvenir d’une femme qu’il a aimée, et dont il apprend qu’elle a été tuée pour s’être compromise en sa compagnie, ledit Antonio prend conscience de tout le mal qu’il a commis dans les circonstances arbitraires de la guerre. Cela étant, en face de la muette accusation des villageois, il ne se repent pas plus qu’il ne cherche à se blanchir, à la fois bourreau et victime dont l’auteur nous faire partager la souffrance d’homme fort – tant il est vrai que les personnages de tragédie sont parfois des hommes forts pris au piège de la réalité...Quant au narrateur de La honte, il se trouve également placé dans une situation qui le révèle subitement à lui-même : gisant au fond d’un ravin, à proximité des débris de sa voiture de sport, il ne sait trop s’il survivra, de sorte que la moindre péripétie de son attente, le moindre souvenir aussi, se chargent pour lui d’une signification décisive.Des crises purificatricesAvec La honte, nous retrouvons, plus que dans les autres nouvelles du présent ouvrage, le thème du passé restitué aux confins de la mort, si poignant dans La bouche pleine de terre.Au début du récit, ne connaissant du narrateur que le ton de la voix et le tragique de la situation, l’on se sent tout naturellement en sympathie avec lui. Mais ensuite – et c’est ce qui nous paraît remarquable aussi, chez l’écrivain – au fur et à mesure que se développe la confession de Vladimir, personnage rien moins qu’angélique qui se rappelle les quelques ignominies entachant son existence, le lecteur participe en quelque sorte à l’espèce de catharsis expiatoire du personnage, au lieu de le juger de l’extérieur.Et c'est la honte qu'éprouve une première fois Vladimir à la vision de la dureté des hommes, lorsqu’il constate que les automobilistes ne daignent pas lui porter secours ; la honte qui le fait rougir de lui-même, à l’instant de se remémorer une promesses jamais tenue ; l’humiliation qu’il a fait subir un jour à sa propre mère ; ou enfin la honte qu’il ressent à la pensée qu’un type de son acabit va survivre, lorsqu’il comprend que son cas est sans gravité – ces diverse cristallisations d’un même sentiment signalant par excellence le retour sur soi de la conscience, nous les reconnaissons évidemment en nous-mêmes, chacun à sa façon.«En regardant les gens, souvenez-vous de leur naissance encore si récente, de leur enfance, de leur mort prochaine –et vous les aimerez : tant de faiblesse !», écrivait Andrei Siniavski dans l’ensemble de méditations rédigées lors de son séjour au goulag et réunies sous le titre d’Une voix dans le chœur (Seuil, 1974). Dans le même ordre d’inclination fraternelle, les nouvelles de Branimir Scepanovic nous rappellent des vérités de toujours sous une forme littéraire accomplie.Branimir Scepanovic, La mort de monsieur Golouja. Editions L’Âge d’homme, 1978.(Cet article a paru dans La Liberté de Fribourg en février 1979)
Avec La mort de Monsieur Golouja et La honte, nous retrouvons deux personnages directement confrontés à la mort alors que le héros d’ Avant de la vérité en découd avec les séquelles de la guerre.Dans la première de ces très remarquables nouvelles, la situation paradoxale à laquelle l’auteur parvient à nous faire croire, dans la tonalité des fables d’un Kafka, procède elle aussi d’un malentendu. Nous ne saurons jamais, de fait, ce qui a poussé Monsieur Golouja à s’arrêter quelques jours dans le trou de province suant l’insignifiance et l’ ennui où il va trouver la mort, alors qu’il se dirigeait initialement vers la mer pour y passer un congé; pas plus que nous ne parviendrons à démêler les raisons pour lesquelles il déclare, aux habitants qui l’interrogent sur sa présence en ces lieux, que c’est là qu’il a résolu de mettre fin à ses jours...Ce qui est sûr, en revanche, c’est que dès ce moment-là, Monsieur Golouja se trouve pris dans un engrenage tout aussi aussi implacable que celui de La bouche pleine de terre, à cela près – et c’est là une idée procédant d’un sentiment qui confère à la nouvelle sa résonance déchirante – que la fuite de Monsieur Goulouja passe par tous les délices imaginables...En effet, à la fois émus et flattés par la funeste résolution de Monsieur Goulouja, qui promet soudain de rompre la monotonie de leur existence, les habitants du bourg prennent–ils à cœur de rendre ses derniers jours agréables, lui offrant tout ce dont un quidam peut rrêver. Là-dessus, comme on pouvait s’y attendre, Monsieur Golouja reprend goût à la vie: choyé par les femmes et respecté de tous, il ne cesse de renvoyer la funèbre représentation qu’il leur a promise, poussant même l’insolence jusqu’à engraisser !Victimes et bourreauxL’une des caractéristiques les plus frappantes que nous connaissons de l'art de Branimir Scepanovic tient à la relation fondamentale, que l’écrivain réussit à suggérer, par des moyens essentiellement poétiques, unissant l’homme et l’univers.Les lecteurs de La bouche pleine de terre se souviennent, à l’évidence, de l’apparition insolite du protagoniste en costume de ville, dans une forêt de l’aube; du mélange de sensualité et de violence se dégageant du monde physique dont l’écrivain sait rendre la présence; ou encore, avec le sens de la mise en scène d’un cinéaste «mental», du contrepoint auquel l’auteur excelle, passant des libres espaces aux retours en arrière de la mémoire, du travelling effréné aux gros plan.Perdu dans le cosmos, l’homme selon Scepanovic n’est pas, toutefois, de ces fils de l’absurde qui foisonnent dans le roman contemporain. Enraciné dans une terre, avec des souvenirs qui lui donnent un espace intérieur, c’est bien plutôt un personnage tragique, tissé de bien et de mal, qui prend conscience de sa précarité dans des situations-limites.Tel apparaît aussi Antonio, dans Avant la vérité, qui revient après des années dans le village dont il commandait la garnison d’occupation. Attiré par le souvenir d’une femme qu’il a aimée, et dont il apprend qu’elle a été tuée pour s’être compromise en sa compagnie, ledit Antonio prend conscience de tout le mal qu’il a commis dans les circonstances arbitraires de la guerre. Cela étant, en face de la muette accusation des villageois, il ne se repent pas plus qu’il ne cherche à se blanchir, à la fois bourreau et victime dont l’auteur nous faire partager la souffrance d’homme fort – tant il est vrai que les personnages de tragédie sont parfois des hommes forts pris au piège de la réalité...Quant au narrateur de La honte, il se trouve également placé dans une situation qui le révèle subitement à lui-même : gisant au fond d’un ravin, à proximité des débris de sa voiture de sport, il ne sait trop s’il survivra, de sorte que la moindre péripétie de son attente, le moindre souvenir aussi, se chargent pour lui d’une signification décisive.Des crises purificatricesAvec La honte, nous retrouvons, plus que dans les autres nouvelles du présent ouvrage, le thème du passé restitué aux confins de la mort, si poignant dans La bouche pleine de terre.Au début du récit, ne connaissant du narrateur que le ton de la voix et le tragique de la situation, l’on se sent tout naturellement en sympathie avec lui. Mais ensuite – et c’est ce qui nous paraît remarquable aussi, chez l’écrivain – au fur et à mesure que se développe la confession de Vladimir, personnage rien moins qu’angélique qui se rappelle les quelques ignominies entachant son existence, le lecteur participe en quelque sorte à l’espèce de catharsis expiatoire du personnage, au lieu de le juger de l’extérieur.Et c'est la honte qu'éprouve une première fois Vladimir à la vision de la dureté des hommes, lorsqu’il constate que les automobilistes ne daignent pas lui porter secours ; la honte qui le fait rougir de lui-même, à l’instant de se remémorer une promesses jamais tenue ; l’humiliation qu’il a fait subir un jour à sa propre mère ; ou enfin la honte qu’il ressent à la pensée qu’un type de son acabit va survivre, lorsqu’il comprend que son cas est sans gravité – ces diverse cristallisations d’un même sentiment signalant par excellence le retour sur soi de la conscience, nous les reconnaissons évidemment en nous-mêmes, chacun à sa façon.«En regardant les gens, souvenez-vous de leur naissance encore si récente, de leur enfance, de leur mort prochaine –et vous les aimerez : tant de faiblesse !», écrivait Andrei Siniavski dans l’ensemble de méditations rédigées lors de son séjour au goulag et réunies sous le titre d’Une voix dans le chœur (Seuil, 1974). Dans le même ordre d’inclination fraternelle, les nouvelles de Branimir Scepanovic nous rappellent des vérités de toujours sous une forme littéraire accomplie.Branimir Scepanovic, La mort de monsieur Golouja. Editions L’Âge d’homme, 1978.(Cet article a paru dans La Liberté de Fribourg en février 1979) -
Metin Arditi le répète : que l’art est pacificateur
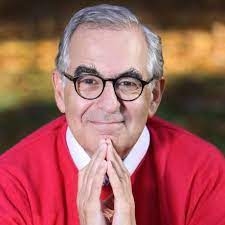
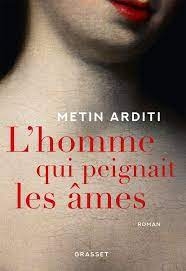
Un beau roman, évoquant le parcours d’un peintre d’icônes du XIe siècle, en Palestine, obéissant à l’amour humain plus qu’à la présumée Loi divine, et trois variations sur les errances de l’autorité « patriarcale », prolongent la réflexion d’un homme de bonne volonté engagé dans une œuvre de médiation fraternelle.
L’usage du mot icône s’est tellement dégradé, dans la profusion actuelle des images insignifiantes, que n’importe quelle célébrité s’en voit affublée par les temps qui courent, de Ronaldo l’ «icône du foot » aux « icônes » de la mode ou de la gastro, entre mille autres exemples.
Or l’icône, à son origine orthodoxe et canonique, est l’image par excellence du sacré, pour ainsi dire le visage de Dieu, de la Trinité ou des saints, qui devrait éclipser toute autre beauté. La Joconde, selon les canons de l’iconographie, devrait se voiler la face, ou c’est nous qui devrions la brûler comme fausse image selon les critères des iconographes, mais à ceux-là s’opposent, plus radicaux encore, les iconoclastes musulmans opposés à toute représentation des saintes figures ; et pire encore : toute forme d’art était suspecte au très pur et très dur Blaise Pascal en son djihâd janséniste mené à la pointe de la séculaire « querelle des images ».
Le cynique contemporain ricanera probablement à l’évocation de tels thèmes en une époque où, par exemple dans les ports-francs de la région genevoise et environs, les icônes les plus chargées de spiritualité pure font l’objet d’un trafic juteux – mais faisons comme si l’affaire était encore d’actualité…
Donc transportons-nous en l’an 1079 de notre ère, en « terre sainte » où cohabitent trois religions, pour assister à l’apprentissage d’un jeune fils de juif de stricte observance au prénom d’Avner, touché par les chants des moines orthodoxes auxquels il livre son poisson de petit pêcheur palestinien (il est encore ado au début du roman de Metin Arditi), qui découvre la beauté des icônes et décide d’en peindre à son tour , ou plus exactement d’en «écrire» , car son premier initiateur, un certain Anastase, lui apprend qu’une icône s’écrit.
Problème : le petit Avner, juif de souche mais désirant s’initier à l’iconographie dans les ateliers des monastères, consent à se faire baptiser sans avoir la foi au sens orthodoxe: il ne croit ni à la révélation ni à la résurrection comme ses frères ordonnés croient qu’on doit croire, donc les icônes qu’il apprend à «écrire», et qui seront bientôt plus belles que les autres constitueront autant de blasphèmes virtuels du genre de la Joconde déguisée en vierge Marie, etc.
Un conte aux (multiples) résonances actuelles
Sous la forme d’une espèce de conte romanesque à valeur d’apologue ou de parabole, L’homme qui peignait les âmes s’inscrit dans le droit fil du roman précédent de Metin Arditi, Rachel et les siens, « travaillant » déjà le thème de la cohabitation des trois religions du Livre sur le timbre-poste géographique de la terre sainte, dans un esprit de conciliation voire de pacification.
Le départ du roman est l’icône représentant un Christ guerrier qu’on croyait l’œuvre d’un moine du XVe siècle, et qui serait à vrai dire beaucoup plus ancienne, reliquat de la production d’un iconographe du XIe siècle. Scientifiquement avérée (chacune et chacun connaît évidemment le pouvoir révélateur d’une étude dendrochronologique permettant d’évaluer l’âge d’un bout de bois par ses cernes de croissances), l’hypothèse fonde la vérité historique de l’enquête (sur le terrain,) devenue roman, avec ce paradoxe apparent qu’un peintre d’âmes pacifiées ne nous laisse qu’une représentation de combattant armé comme l’étaient les croisés – les lecteurs découvriront ce que « cela » cache, au figuré et au propre…
Immédiatement attachant par ce qu’on pourrait dire sa beauté intérieure, sa porosité sensible et plus encore sa farouche indépendance d’esprit Avner ne séduit pas seulement sa belle cousine Myriam, avant la lectrice et le lecteur, mais aussi le moine Anastase et le marchand Mansour, deux mentors se substituant à un père moralisateur et rabat-joie ; et puis Avner est ancré dans le concret, il est sensuel et artisan autant qu’artiste, il sait recevoir comme il sait donner. Le noyau de son art particulier tient au fait que, « plutôt que de représenter la part d’humain dans le Christ et ses Saints, Avner inversait la démarche, faisait surgir la part de divine enfouie en chacun ». Autant dire que ce «retournement» ne peut qu’inquiéter les gardiens du Temple, quel qu’il soit, et que ce sont les autorités religieuses associées qui présideront à l’élimination par le feu des œuvres et de la personne de l’hérétique.
Il y a, de toute évidence, du Metin en lui, ou disons que l’écrivain propose, avec ce personnage, une incarnation avenante de son idéal de conciliation, sans esquiver les obstacles de la réalité et la déraison envieuse ou dogmatique des hommes. Avner lui-même est constamment menacé par sa propension à l’orgueil du «créateur», mais ses faiblesses autant que son génie particulier (comme chez Leonard de Vinci, Rembrandt, Van Gogh et tout artiste authentique en somme) s’inscrivent essentiellement dans la ressemblance humaine.
Où science et religion, art et morale dialoguent en liberté
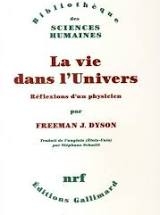
À la fin des ses « réflexions d’un physicien » parues sous le titre de La Vie dans l’univers, le célèbre Freeman J. Dyson, hérétique lui aussi, affirme que « la religion est une part essentielle de la condition humaine, elle est enracinée plus profondément et partagée plus largement que la science ». Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle « la religion », et pas question pour lui de fondre science et religion dans un méli-mélo spiritualisant.
« Si la science et la religion sont complémentaires, écrit encore Dyson, il vaut mieux qu’elle vivent séparément, en se respectant mutuellement, mais avec des identités et des comptes en banque séparés ». Et ceci : « Toute grande religion est associée à un grand art et une grande littérature, depuis la plus haute Antiquité ». Et cela : « Si l’on cherche des perspectives sur la nature humaine pour guider l’avenir de la religion, on en trouvera plus dans les romans de Dostoïevski que dans les revues de science cognitive ». Et cela enfin : « La littérature est le grand entrepôt de l’expérience humaine ».
Quel rapport avec un «écrivain» d’icônes du XIe siècle judéo-chrétien ? À chacune et chacun de le trouver. Avec un point de convergence: la Beauté, dont un personnage de Dostoïevski disait qu’elle sauverait le monde. La Beauté conjuguée, s’agissant d’Avner-Metin, avec la Bonté. Et cela avec ou sans les dogmes théologiques, les «lois de la physique » ou les codes de la morale courante – en toute liberté.
À préciser enfin que la défense de la ressemblance humaine ne serait qu’un conte à l’eau de rose si elle ne passait pas par l’expérience de la complexité et de la solitude, des feux de l’envie et de la violence. Ce à quoi l’auteur de L’Homme qui peignait les âmes s’est attaché au fil de trois monologues nous faisant sonder les cœurs, les âmes et les tripes de trois « pères », en les personnes de Sigmund Freud, d’un chef d’orchestre de renom mondial en train de perdre la mémoire et du pasteur Cornelius Van Gogh, père d’un irascible peintre d’icônes profanes au prénom de Vincent.
Quel rapport avec Avner ? Il serait intéressant de voir celui-ci peindre ceux-là… Mais c’est, là encore, Metin Arditi qui a «fait le job», avec l’empathie d’un écrivain sondant les cœurs comme le «petit Anastase » peignait les âmes…
Metin Arditi. L’homme qui peignait les âmes. Grasset, 2021. 291p.
Metin Arditi, Freud, les démons et autres monologues. BSN Press, coll. Fictio, 2021, 96p.
Freeman J. Dyson. La Vie dans l’univers, réflexions d’un physicien. Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2009, 256p.
»
-
Vialatte l'émerveillé
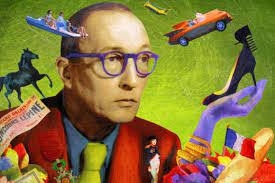 À propos des chroniques du grand Alexandre...L’esprit de l’homme est soumis à deux exigences contradictoires, disais l’excellent Alexandre Vialatte, consistant soit à chercher à savoir, soit à s’émerveiller plus spontanément; tantôt à progresser sur les chemins épineux de la connaissance scientifique, et tantôt à célébrer le monde le long des allées de la poésie.
À propos des chroniques du grand Alexandre...L’esprit de l’homme est soumis à deux exigences contradictoires, disais l’excellent Alexandre Vialatte, consistant soit à chercher à savoir, soit à s’émerveiller plus spontanément; tantôt à progresser sur les chemins épineux de la connaissance scientifique, et tantôt à célébrer le monde le long des allées de la poésie.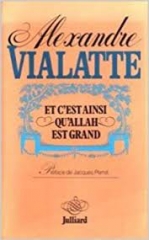 Par tempérament, le chroniqueur des Dernières nouvelles de l’homme, publié en 1978 avec une préface de Jacques Laurent, et dont on a eu raison de réunir encore les quelques 65 chroniques que voici, présentées par Jacques Perret et finissant toutes par la constatation que « c’est ainsi qu’Allah est grand », Alexandre Vialatte appartient sans contexte à la moitié portée au lyrisme de l’humaine engeance, ainsi qu’en témoigne l’incantation estivale que voici : «Rien n’est plus beau que le mois de juillet. Le soleil flamboie, la terre est surchauffée, les étoiles tournent lentement, l’alouette Lulu chante aussi, le coucou est parti pour l’Afrique australe ne laissant que son enfant le plus gras ; les gousses de genêt éclatent dans la chaleur torride, la sauterelle stridule sur les herbes brûlantes, l’homme joue du cornet à piston dans des kiosque de style chinois.»Mais à part ça, Vialatte est curieux de tout, pratiquant l’érudition joyeuse et ne cessant de procéder par rapprochements inattendus.
Par tempérament, le chroniqueur des Dernières nouvelles de l’homme, publié en 1978 avec une préface de Jacques Laurent, et dont on a eu raison de réunir encore les quelques 65 chroniques que voici, présentées par Jacques Perret et finissant toutes par la constatation que « c’est ainsi qu’Allah est grand », Alexandre Vialatte appartient sans contexte à la moitié portée au lyrisme de l’humaine engeance, ainsi qu’en témoigne l’incantation estivale que voici : «Rien n’est plus beau que le mois de juillet. Le soleil flamboie, la terre est surchauffée, les étoiles tournent lentement, l’alouette Lulu chante aussi, le coucou est parti pour l’Afrique australe ne laissant que son enfant le plus gras ; les gousses de genêt éclatent dans la chaleur torride, la sauterelle stridule sur les herbes brûlantes, l’homme joue du cornet à piston dans des kiosque de style chinois.»Mais à part ça, Vialatte est curieux de tout, pratiquant l’érudition joyeuse et ne cessant de procéder par rapprochements inattendus.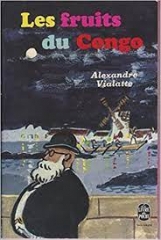 Et puis l’auteur des Fruits du Congo, ce petit chef-d’œuvre que trop peu de gens connaissent, bien qu’il leur soit aisément accessible (au Livre de poche), est également un philosophe, mais alors à l’antique, au grand sens propre de celui qui aime la sagesse ; et de là provient sans doute le peu d’empressement de l’écrivain à se prendre au sérieux, jouant souvent avec les grands mots ou les fortes sentences en les poussant à bout de logique.Ainsi, à la très grave question de savoir «où va l’homme ?», fit-il dans l’une des chroniques du premier recueil publié à sa mémoire, la réponse suivante : « Au bureau ». Paradoxe facile ? Recours par trop léger à un bon sens risquant de désamorcer tout entretien sérieux ? Oui et non. Parce qu’il est vrai il y a parfois du badinage un peu complaisant, pour ne pas dire du bavardage, dans les soliloques de cet heureux Alexandre.
Et puis l’auteur des Fruits du Congo, ce petit chef-d’œuvre que trop peu de gens connaissent, bien qu’il leur soit aisément accessible (au Livre de poche), est également un philosophe, mais alors à l’antique, au grand sens propre de celui qui aime la sagesse ; et de là provient sans doute le peu d’empressement de l’écrivain à se prendre au sérieux, jouant souvent avec les grands mots ou les fortes sentences en les poussant à bout de logique.Ainsi, à la très grave question de savoir «où va l’homme ?», fit-il dans l’une des chroniques du premier recueil publié à sa mémoire, la réponse suivante : « Au bureau ». Paradoxe facile ? Recours par trop léger à un bon sens risquant de désamorcer tout entretien sérieux ? Oui et non. Parce qu’il est vrai il y a parfois du badinage un peu complaisant, pour ne pas dire du bavardage, dans les soliloques de cet heureux Alexandre.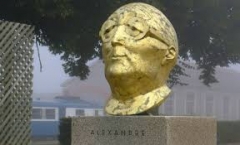 Qu’on en juge plutôt : «Beaucoup d’affiches conseillent à l’homme de mettre un tigre dans son moteur. Or, c’est une chose à ne jamais faire. Il y a longtemps que je l’ai signalé ici et dans plusieurs autres journaux. Il ne faut jamais mettre de tigre dans son moteur, surtout quand on a des enfants. Les enfants sont méchants, capricieux, étourdis, cruels avec les animaux : il n’y a qu’à voir comment ils traitent les mouches. Ils risquent de maltraiter le tigre, de l’irriter, de le rendre furieux ; de l’indisposer en lui arrachant une patte ou en lui tirant la moustache. Ou de le caresser à rebrousse-poil. La SPA est tâtillone et on s’expose à des amendes. Et la douane ? Il faut y songer. La douane sonde tout, même les moteurs. Il est difficile cacher le tigre ». Etc.Il est vrai qu’un recueil de chroniques est forcément inégal, dépendant à la fois des conjonctions astrales, du degré d’agressivité des rhumatismes du chroniqueur et, il ne faut pas l’oublier, des humeurs du lecteur. Autant dire, alors, qu’un livre du genre d’Et c’est ainsi qu’Allah est grand ne se doit en aucun cas dévorer d’une traite, sous peine de lasser, mais devrait toujours se trouver à portée de main, comme un breuvage spécial tout à fait propice à l’entretien de l’optimisme ou de la bonne respiration mentale.Un honnête homme de ce temps s’y exprime, à la fois très sage et facétieux, pour nous communiquer son indéfectible enthousiasme, qu’il en aille des faiblesse de caractère de l’hippopotame ou de la grandeur du zouave, des subtilités de la grammaire ou des couleurs de l’automne, de la psychologie de l’homme parvenant à la quarantaine ou de la dame de Copi, des moeurs de la pieuvre ou de tel mainate chantant La Marseillaise, du film 81/2 de Federico Fellini ou des progrès de l’astronomie enfantine, bref de tout ce qui empêche l’humain de s’abrutir (Vialatte sait au besoin se faire polémique) et de s’affadir, ressortissant à la poésie dans son acception la plus large : «On voit par là combien l’homme a besoin de ses trois dimensions et de brasseries ténébreuses. Combien il est dépaysé dès que ces éléments lui manquent. Combien il lui faut de piano, d’ombre, de songes et de vin glacé contre les terreurs du solstice. Le voilà au soir de sa vie dans la taverne de décembre. On va fermer. Les lampes s’éteignent une à une, les amis meurent l’un après l’autre. C’est le dernier client de la journée. Le garçon va retourner les chaises, ouvrir la porte sur la nuit. Elle est noire et le vent glacé. ».Alexandre Vialatte. Et c’est ainsi qu’Allah est grand. Julliard, 1979.(Ce papier a paru dans La Liberté de Fribourg le 8 février 1980)
Qu’on en juge plutôt : «Beaucoup d’affiches conseillent à l’homme de mettre un tigre dans son moteur. Or, c’est une chose à ne jamais faire. Il y a longtemps que je l’ai signalé ici et dans plusieurs autres journaux. Il ne faut jamais mettre de tigre dans son moteur, surtout quand on a des enfants. Les enfants sont méchants, capricieux, étourdis, cruels avec les animaux : il n’y a qu’à voir comment ils traitent les mouches. Ils risquent de maltraiter le tigre, de l’irriter, de le rendre furieux ; de l’indisposer en lui arrachant une patte ou en lui tirant la moustache. Ou de le caresser à rebrousse-poil. La SPA est tâtillone et on s’expose à des amendes. Et la douane ? Il faut y songer. La douane sonde tout, même les moteurs. Il est difficile cacher le tigre ». Etc.Il est vrai qu’un recueil de chroniques est forcément inégal, dépendant à la fois des conjonctions astrales, du degré d’agressivité des rhumatismes du chroniqueur et, il ne faut pas l’oublier, des humeurs du lecteur. Autant dire, alors, qu’un livre du genre d’Et c’est ainsi qu’Allah est grand ne se doit en aucun cas dévorer d’une traite, sous peine de lasser, mais devrait toujours se trouver à portée de main, comme un breuvage spécial tout à fait propice à l’entretien de l’optimisme ou de la bonne respiration mentale.Un honnête homme de ce temps s’y exprime, à la fois très sage et facétieux, pour nous communiquer son indéfectible enthousiasme, qu’il en aille des faiblesse de caractère de l’hippopotame ou de la grandeur du zouave, des subtilités de la grammaire ou des couleurs de l’automne, de la psychologie de l’homme parvenant à la quarantaine ou de la dame de Copi, des moeurs de la pieuvre ou de tel mainate chantant La Marseillaise, du film 81/2 de Federico Fellini ou des progrès de l’astronomie enfantine, bref de tout ce qui empêche l’humain de s’abrutir (Vialatte sait au besoin se faire polémique) et de s’affadir, ressortissant à la poésie dans son acception la plus large : «On voit par là combien l’homme a besoin de ses trois dimensions et de brasseries ténébreuses. Combien il est dépaysé dès que ces éléments lui manquent. Combien il lui faut de piano, d’ombre, de songes et de vin glacé contre les terreurs du solstice. Le voilà au soir de sa vie dans la taverne de décembre. On va fermer. Les lampes s’éteignent une à une, les amis meurent l’un après l’autre. C’est le dernier client de la journée. Le garçon va retourner les chaises, ouvrir la porte sur la nuit. Elle est noire et le vent glacé. ».Alexandre Vialatte. Et c’est ainsi qu’Allah est grand. Julliard, 1979.(Ce papier a paru dans La Liberté de Fribourg le 8 février 1980) -
En rimes sans raison
Les petits enfants n’en feront
jamais qu’à leur façon,
qui est celle des pucerons
flairant les potirons.
Les adolescents merveilleux,
déhanchés et radieux,
n’ont pour vrais rivaux que les dieux
les reluquant des cieux.
Les jeunes filles en crinolines
aux étoles d’hermine
ne recourront à la morphine
qu’au plus noir de la ruine.
Les vieux garçons en caleçons
comme colimaçons
bavent sans rime ni raison
dans le cou des tendrons.
Les filles de joie en retour d’âge
sourient davantage
en tournant des années les pages
de se retrouver sages.
La dame rôdant alentour
et sans aucun détour
choisit à chacun son tour
et le fauche haut et court.
-
Au moment silencieux

Arbres, là-bas, qui vous taisez
dans le silence bleu -
je fais de vous mes conseillers.
Le temps se prend au jeu ;
le blanc dessine mieux les choses
et met un souffle d’air
dans la torpeur où tout repose.
Un oiseau d’un ongle vif
griffe le verre de l’instant,
et là-bas le trait noir des ifs
indique une barrière.
-
Passage du poète

Ce type n’est pas de ce pays.
Cela ne se voit pas :
cela se sent à sa façon
de faire peser le ciel.
Il ne regarde pas ailleurs.
Il reste là longtemps :
Il ne sait pas ce qu’il fait là.
Nul ne sait qui il est.
Ce pays n’a pas les odeurs
du village là-bas :
des enfants, des vieux et des lieux
où vivre allait de soi.
Va-t-il donc rester là le temps
de nous donner un nom ?
Allons-nous le féliciter
de nous ressembler peu ?
Ce type est devenu quelqu’un
en parlant une fois
à ce passant ne disant mot
dont nul ne sait qui il était…
Image: Philip Seelen
-
Ce qu’ignore l’enfant
Le poète bien entendu,
dans la foule qui passe,
ne laisse pas le moindre espace
qu’on puisse dire insu.
La poésie serait partout
où ce qu’on dit la joie
tisserait de ses fils de soie
ce qu’on dit l’amour fou.
La foule cependant s’affaire
à ce qu’elle croit utile,
oublieuse de ces futiles
qui se disent poètes.
La joie cependant se répand
dans la douce lumière
des imprévisibles clairières
où s’attarde l’enfant.
(À l’isba, ce 5 juillet 2019).
-
Ce que parler veut dire
C’est en marchant là-bas
dans le sous-bois de ces années
que cela s’est mis à parler.
Je ne sais que te dire :
il n’y a pas d’explication ;
ce n’est qu’un fait divers.
Pas plus que la Beauté
cela n’est défini.
Sais-tu si l’arbre s’en souvient ?
Qui parle donc en toi
Quand les veilleurs ne disent mot ?Qui êtes vous muets ?
Dans mon ciel de papier,
mon ciel de lit, mon lit de ciel,
je n’entends que cela.(La Désirade, ce 6 novembre 2017)
-
Le Temps accordé
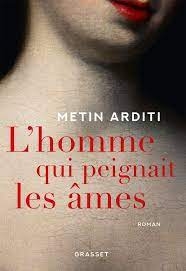 (Lectures du monde, 2021)AVEC LES YEUX. – Ce qui est bien avec le masque, c’est que tu vois mieux les gens sourire avec les yeux, me disait Lady L. l’autre jour, après que nous avions quitté son oncologue préféré avec lequel elle avait fait son plan de la semaine à venir, et j’y repense souvent, à la caisse de la grande surface d’à côté ou partout où l’on est encore censé se plier à cette précaution, en contraste avec les regards des gens sans masques souvent moins expressifs qu’avec, sur les quais ou dans les jardins publics où les sourires flottent ou se perdent. (Ce jeudi 5 août)ICÔNE.- L’usage du mot s’est tellement dégradé, dans la profusion actuelle des images insignifiantes, que n’importe quelle célébrité de pacotille s’en voit affublée. Or l’icône, à son origine orthodoxe et canonique, est l’image par excellence du sacré, pour ainsi dire le visage de Dieu qui éclipse toute autre beauté. La Joconde devrait se voiler la face, ou c’est nous qui devrions la brûler comme fausse image, et toute forme d’art était d’ailleurs suspecte au très pur et très dur Pascal en son djihâd janséniste.Mais voici qu’un jeune fils de juif de stricte observance , touché par les chants des moines orthodoxes auxquels il livre son poisson de petit pêcheur palestinien (il est encore ado au début du roman de Metin Arditi), découvre la beauté des icônes et décide d’en peindre à son tour , ou plus exactement d’en «écrire» , car son premier initiateur, un certain Anastase, lui apprend qu’une icône s’écrit .Problème : le petit Avner est juif et, plus délicat, n’a pas la foi au sens orthodoxe catholique et apostolique : il ne croit ni à la révélation ni à la résurrection , et plus grave encore : il n’y croira jamais, au dam de Blaise Pascal qui vous conseille de vous agenouiller et vous jure que la foi vous sera donnée comme au charbonnier quand il prie, rien a faire : même baptisé Avner ne croit pas comme ses frères ordonnés croient qu’on doit croire, donc les icônes qu’il apprend à « écrire », et qui seront bientôt plus belles que les autres seront autant de blasphèmes virtuels du genre de la Joconde déguisée en vierge Marie, etc.INCARNATION.- Czapski me dit un jour qu’il b... pour la couleur, et si j’y vais de mes points de suspension c’est qu’il me semblait tout à fait obscène qu’un vieil homme de haute spiritualité revenu des enfers du XXe siècle pût utiliser un verbe pareil, et pourtant comment mieux relier la couleur de l’art à la vie que par le sexe ?C’est une des questions que pose d’ailleurs Metin Arditi dans son roman: comment concilier sensualité et spiritualité ?Brutalement parlant: l’âme a-t-elle un cul, et que penser de la représentation d’une vierge ou d’un Christ qui feraient «bander» les mecs autant que les nanas ?Pas besoin d’aller bien loin : au musée de Bâle, l’on voit ainsi des Jésus d’une grâce ambiguë à la limite de la lascivité, et deux salles plus loin tu tombes sur le cadavre fameux qui affolait Dostoïevski, du Christ mort d’Holbein...
(Lectures du monde, 2021)AVEC LES YEUX. – Ce qui est bien avec le masque, c’est que tu vois mieux les gens sourire avec les yeux, me disait Lady L. l’autre jour, après que nous avions quitté son oncologue préféré avec lequel elle avait fait son plan de la semaine à venir, et j’y repense souvent, à la caisse de la grande surface d’à côté ou partout où l’on est encore censé se plier à cette précaution, en contraste avec les regards des gens sans masques souvent moins expressifs qu’avec, sur les quais ou dans les jardins publics où les sourires flottent ou se perdent. (Ce jeudi 5 août)ICÔNE.- L’usage du mot s’est tellement dégradé, dans la profusion actuelle des images insignifiantes, que n’importe quelle célébrité de pacotille s’en voit affublée. Or l’icône, à son origine orthodoxe et canonique, est l’image par excellence du sacré, pour ainsi dire le visage de Dieu qui éclipse toute autre beauté. La Joconde devrait se voiler la face, ou c’est nous qui devrions la brûler comme fausse image, et toute forme d’art était d’ailleurs suspecte au très pur et très dur Pascal en son djihâd janséniste.Mais voici qu’un jeune fils de juif de stricte observance , touché par les chants des moines orthodoxes auxquels il livre son poisson de petit pêcheur palestinien (il est encore ado au début du roman de Metin Arditi), découvre la beauté des icônes et décide d’en peindre à son tour , ou plus exactement d’en «écrire» , car son premier initiateur, un certain Anastase, lui apprend qu’une icône s’écrit .Problème : le petit Avner est juif et, plus délicat, n’a pas la foi au sens orthodoxe catholique et apostolique : il ne croit ni à la révélation ni à la résurrection , et plus grave encore : il n’y croira jamais, au dam de Blaise Pascal qui vous conseille de vous agenouiller et vous jure que la foi vous sera donnée comme au charbonnier quand il prie, rien a faire : même baptisé Avner ne croit pas comme ses frères ordonnés croient qu’on doit croire, donc les icônes qu’il apprend à « écrire », et qui seront bientôt plus belles que les autres seront autant de blasphèmes virtuels du genre de la Joconde déguisée en vierge Marie, etc.INCARNATION.- Czapski me dit un jour qu’il b... pour la couleur, et si j’y vais de mes points de suspension c’est qu’il me semblait tout à fait obscène qu’un vieil homme de haute spiritualité revenu des enfers du XXe siècle pût utiliser un verbe pareil, et pourtant comment mieux relier la couleur de l’art à la vie que par le sexe ?C’est une des questions que pose d’ailleurs Metin Arditi dans son roman: comment concilier sensualité et spiritualité ?Brutalement parlant: l’âme a-t-elle un cul, et que penser de la représentation d’une vierge ou d’un Christ qui feraient «bander» les mecs autant que les nanas ?Pas besoin d’aller bien loin : au musée de Bâle, l’on voit ainsi des Jésus d’une grâce ambiguë à la limite de la lascivité, et deux salles plus loin tu tombes sur le cadavre fameux qui affolait Dostoïevski, du Christ mort d’Holbein... Czapski lui-même se disait incapable de représenter le Christ, ce qu’il n’a fait qu’ici et là en dessins relevant de la prière, ou par la copie en interprétant une toile de Rouault. Mais les icônes sont partout dans la peinture de Czapski et c’est dans la peine et les douleurs qu’il dit la beauté de la vie humaine, par la chair meurtrie que ses humains deviennent divins et par la couleur que tout ça prie et chante.LE DON DU BONHEUR. – Il y a des gens, comme ça, qui ont l’air d’être faits pour le bonheur, ou ce qu’on appelle comme ça, et j’en ai été malgré toute ma mélancolie et mes tribulations de certaines années, j’ai eu en moi cette joie constante et pas qu’à cause de mes dents – c’est Virgil Gheorghiu, l’auteur de La 25e Heure, qui m’a révélé un jour que l’écart entre mes dents de devant s’intitulait «les dents du bonheur» -, il me semble que j’avais cette disposition heureuse, comme je l’ai reconnue chez Lady L., c’était comme un don, mérité ou non, et ce mot de don, cette notion du don, le don artistique ou le don de soi, me semble un thème important, que Metin aborde aussi à sa façon dans L’Homme qui peignait les âmes, et tout à coup je me rappelle, à propos du dilemme d’Avner le juif baptisé mais resté mécréant au fond de lui-même, que son attitude par rapport à «la foi» relève du même don d’aimer la vie et ses créatures et que son attitude par rapport au sexe relève de la même révérence à la vie (formule de Théodore Monod) qui passe tous les « canons » de l’orthodoxie – mais gare alors aux gardiens du Temple !LES ENFANTS. – Les petits lascars ont partagé notre repas de midi sans remarquer le moins du monde le fait que leur mère-grand, qui avait décidé de se montrer telle qu’elle est, avait un peu moins de cheveux qu’au début de l’année, comme si l’important était ailleurs, et c’est ce que nous nous disons tous les jours et tous les instants avec nos yeux d’enfants : que l’important est ailleurs, et plus précisément ici, de moment en moment, au cœur du temps. (Ce vendredi 6 août, lendemain de chimio)
Czapski lui-même se disait incapable de représenter le Christ, ce qu’il n’a fait qu’ici et là en dessins relevant de la prière, ou par la copie en interprétant une toile de Rouault. Mais les icônes sont partout dans la peinture de Czapski et c’est dans la peine et les douleurs qu’il dit la beauté de la vie humaine, par la chair meurtrie que ses humains deviennent divins et par la couleur que tout ça prie et chante.LE DON DU BONHEUR. – Il y a des gens, comme ça, qui ont l’air d’être faits pour le bonheur, ou ce qu’on appelle comme ça, et j’en ai été malgré toute ma mélancolie et mes tribulations de certaines années, j’ai eu en moi cette joie constante et pas qu’à cause de mes dents – c’est Virgil Gheorghiu, l’auteur de La 25e Heure, qui m’a révélé un jour que l’écart entre mes dents de devant s’intitulait «les dents du bonheur» -, il me semble que j’avais cette disposition heureuse, comme je l’ai reconnue chez Lady L., c’était comme un don, mérité ou non, et ce mot de don, cette notion du don, le don artistique ou le don de soi, me semble un thème important, que Metin aborde aussi à sa façon dans L’Homme qui peignait les âmes, et tout à coup je me rappelle, à propos du dilemme d’Avner le juif baptisé mais resté mécréant au fond de lui-même, que son attitude par rapport à «la foi» relève du même don d’aimer la vie et ses créatures et que son attitude par rapport au sexe relève de la même révérence à la vie (formule de Théodore Monod) qui passe tous les « canons » de l’orthodoxie – mais gare alors aux gardiens du Temple !LES ENFANTS. – Les petits lascars ont partagé notre repas de midi sans remarquer le moins du monde le fait que leur mère-grand, qui avait décidé de se montrer telle qu’elle est, avait un peu moins de cheveux qu’au début de l’année, comme si l’important était ailleurs, et c’est ce que nous nous disons tous les jours et tous les instants avec nos yeux d’enfants : que l’important est ailleurs, et plus précisément ici, de moment en moment, au cœur du temps. (Ce vendredi 6 août, lendemain de chimio) -
Un amour de Suisse

Un inépuisable et généreux Dictionnaire amoureux de la Suisse, où l’écrivain Metin Arditi, métèque d’origine judéo-ottomane finalement naturalisé par les faiseurs de Suisses, nous épate et nous intéresse au point de nous “décevoir en bien”, comme disent les Vaudois...
Les livres consacrés à la Suisse sont légion, des meilleurs aux pires dont le pamphlet très médiocre d'un Yann Moix est le parangon, mais il en est peu qui soient à la fois aussi grand public et vraiment instructifs pour l'étranger, compétents de propos et plaisants à lire, sympathiques de ton et gracieux d'expression, aussi foisonnants de curiosités significatives et aussi bonnement généreux que le Dictionnaire amoureux de la Suisse de Metin Arditi, qui se pose lui-même d'entrée de jeu en étranger.
Les Suisses qui se méfient des étrangers feraient bien, par manière de cure de jouvence à valeur de désintoxication, de lire cet épatant ouvrage de 615 pages qui parle, mieux que la plupart d'eux-mêmes, et sans effort apparent de leur complaire, de la fière équipe d'Alinghi et de Jean Ziegler - pour citer les deux bouts de l'Alphabet décliné -, du grand peintre Anker dont un certain Christoph Blocher possède la plus belle collection, et du tour des Dents du Midi, des éléphants du cirque Knie et des banquiers privés de Genève, du World Economic Forum de Davos - dont il fustige aimablement l'inutilité vaniteuse -, et de la gestion calamiteuse de Swissair, de la recette des bricelets et de l'exception royale de la ville de Bâle, de la finesse de la peinture de Balthus et de la splendeur des coteaux de Lavaux, de la symbolique soupe de Kapell et du non moins emblématique Guillaume Tell, de Griselidis Réal se reposant au cimetière des Rois (avec l'origine de l'appellation dans la foulée) entre le romancier autrichien Robert Musil (voir l'entrée à la lettre P pour Philippe Jaccottet) et les Genevois d'adoption que furent La philosophe Jeanne Hersch et l'écrivain Georges Haldas, la Venoge de Gilles et les combats quichottesques de l'hidalgo Franz Weber, la délicatesse de la poésie en prose d'un Gustave Roud et la rudesse de la face nord de l'Eiger, la dernière bien bonne de Oin-Oin et les vins préférés de l'auteur (il place le Chemin-deFer au top et recommande en Pinot noir celui des Grisons), la pratique exemplaire de l'apprentissage et les désastreuses conséquences d'une certaine votation pour l'avenir de la recherche helvétique, du beau-parler du très lustré Marc Bonnant et du génie candide de Robert Walser, des nuances du suisse allemand et du paradis perdu des narcisses - enfin pas tout à fait perdu puisque les premières pousses ressurgissent ces jours sous nos fenêtres en se la jouant éternel retour à l'instar du brillant jeune philologue Nietzsche revenant aussi volontiers en Suisse que Nabokov ou Simenon et autres lutteurs à la culotte.
Metin Arditi, métèque avéré de naissance (Turc d'origine et Juif de surcroît) n'a pas trouvé sa naturalisation dans une pochette-surprise, c'est le moins qu'on puisse dire.
À celle-là, le grand éditeur Vladimir Dimitrijevic, qui publia tout Cingria et tout Haldas ou presque ( qui ont leurs entrées séparées dans le dico d'Arditi) après l'intégrale du Journal intime d'Amiel (pas plus d'entrée que pour Dimitri et Zouc, nul n'est parfait), avait renoncé après d'humiliantes tracasseries, alors que lui, Metin l'Ottoman plus têtu qu'un Serbe, y est parvenu en d'épiques circonstances qui feraient frémir le plus obtus faiseur de Suisses - Rolf Lyssy est d'ailleurs cité au même titre que le club des cinq du cinéma suisse romand et Freddy Buache dans la foulée.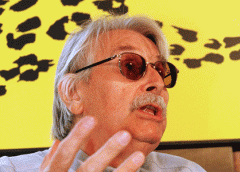
Cependant Arditi le ci-devant requérant de citoyenneté ne se plaint pas, réservant sa colère au sort des Juifs refoulés pendant la guerre (sans oublier les 27.00 qui y ont été accueillis, bien plus proportionnellement qu’en aucun pays européen et bien plus aussi qu’aux Etats-Unis), même s'il rappelle la réponse non moins pendable du super banquier Robert Studer faite à un journaliste qui l'interrogeait sur le montant des fonds juifs en déshérence : « peanuts » !!! Même attitude nuancée envers Ramuz, dont il admire l’immense talent et déplore les relents d’antisémitisme...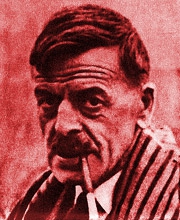
L'art de la synthèse exceptionnel de Metin Arditi va de pair avec un sens non moins remarquable de l'équanimité. S'il juge sévèrement Robert Studer, il n'en reconnaît pas moins ses grandes qualités, lesquelles accentuent par contraste l'aspect scandaleusement inhumain de ce petit mot de « cacahouètes » dont les conséquences furent dévastatrices. De la même façon, sans donner dans la complaisance omnitolérante, Arditi parle d'un ton d'égale empathie, avec ses bémols personnels, de Blocher le paysan self made businessman et de Ziegler l'éternel angry youngster.
Pour l'essentiel, Metin Arditi m'apparaît, dans cet inépuisable Dictionnaire amoureux tout personnel et donc plein de lacunes - à chacune et chacun de compléter... -, comme un homme de bonne volonté et, plus précisément au niveau citoyen (selon l’expression consacrée aujourd'hui), en bon génie de la cité.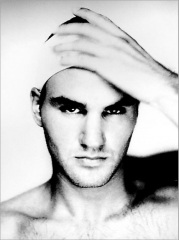
Parler avec autant de justesse équilibrée des Justes Carl Lutz et Paul Grüninger et de Corinne Bille ou du monumental Dürrenmatt, donner de si tonifiants exemples du parler roman (de Bobet ou Branlée à Tip top ou Toute-une-équipe) et détailler les qualités de Paul Klee ou de Rodgère Federer avec autant de finesse cultivée ou de compétence qu'en rendant justice à un Patrick Aebischer ou un Alexandre Yersin, voilà qui fait de ce Dictionnaire amoureux de la Suisse un ouvrage infiniment précieux, amical et captivant, souvent drôle et pourtant joliment sérieux, un livre d'écrivain (qui cite d'ailleurs certaines de ses propres pages à bon escient, à propos des instituts de jeunes gens ou de Nietzsche, notamment) parlant de ses pairs avec pas mal d’à-propos (de Bouvier où Chessex à Cingria ou de Frisch à Paul Nizon) et partage, avec feue sa mentor (mentoresse ou mentorelle ?) Jeanne Hersch, sa qualité majeure: la clarté.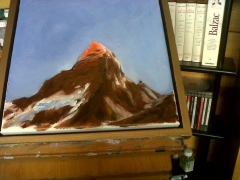
De fait, à l'ère de tous les soupçons et autres confusions, ce Dictionnaire amoureux de la Suisse, qui nous laisse pleine liberté de nous sentir parfois aussi étrangers dans notre propre patrie qu’un Rousseau, illustre la clarté particulière de notre pays quand il oublie de se replier sur lui-même, par exemple quand le premier soleil irradie la cime du Cervin vu du refuge de Schönbühl à cinq heures du matin ou sur les boîtes de chocolat en vente jusqu'au Japon ou en Arkansas.
Un étranger du dedans qui parle aussi bien et tranquillement du Sugus ou d'Ella Maillart, du Röstigraben ou du papa garagiste de Jean-Pascal Delamuraz, du Cenovis ou de la Patrouille des glaciers, du romanche ou de Joël Dicker (le papy de Metin ayant été le pote de celui de Joël le mal rasé) , de la Poya ou du mécénat éclairé des Hahneloser ou des Reinart, ne peut décidément être un mauvais Suisse sauf à considérer qu'il pèche, aux yeux de nos cuistres freinant à la montée et déclarant avec démagogie que LA SUISSE N’EXISTE PAS, coupable d'enthousiasme excessif faisant de lui un chantre attardé de l'helvétisme, alors que pour ma part, originaire d'Anet (Ins, en suisse allemand du Seeland cher au vieil Anker) tout aussi bien qu'Etienne Barilier dont le père à francisé le nom (en anglais nous serions des Cooper comme notre vieil ami Gary) la seule conclusion qui vienne au Lémanique vaudois que je suis devenu est que « cette affaire » de Metin m'a " déçu en bien"...
Metin Arditi. Dictionnaire amoureux de la Suisse. Dessins d'Alain Bouldouyre. Plon, 615 -
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2021)NO SOCIETY .- Nous ne sommes pas désespérés, mais nous sommes dans la perplexité, disait à peu près ce maître de la sensibilité que fut Charles du Bos, et c’est le même constat que nous faisions hier, avec le Baron, en évoquant la disparition de la société qui faisait naguère la vitalité de nos lettres et de nos scènes.Tu te rends compte que l’année de tes vingt ans, dans la VW bleue bluet de l’abbé V. , pote à la fois de Gustave Roud, de Georges Haldas et de Jacques Mercanton, nous sommes descendus chez Philippe Jaccottet à quatre avec le peintre Pierre Estoppey et le docteur Émile Moeri qui fut l’ami et le cardiologue de Cingria ?Et le soir dans la cuisine des Jaccottet, avec Wayland Dobson et son compagnon Jeannot L’Oiseau, je te raconte pas: c’était si gentil, si naturellement amical !Et c’était une putain de société: c’est grâce à Émile que j’ai rencontré la femme à la chèvre, une vieille originale qui vivait avec celle-ci, près de Grignan, dans une petite cave qui rappelait celle de Ludwig Hohl en plus fouettant quant à l’odeur, et à la même occasion que Jeannot l’Oiseau qui avait très bien connu Charles-Albert, m’a raconté pas mal de souvenirs inédits à son propos.Jeannot avait eu une période quasi géniale en tant que peintre, mais à cette époque il ne faisait plus que s’occuper des clavecins de Wayland et mémorisait je ne sais plus quelle encyclopédie , dont il savait déjà tout jusqu’à la lettre B !Je ne te dis pas que c’était l’âge d’or, pas du tout, mais le fait est que quelque chose se continuait là qui n’existe quasiment plus aujourd’hui.Dans ces années on avait une vingtaine de galeries d’art à Lausanne, actuellement moins de cinq, on recensait vingt lieux de théâtre actifs à part Vidy et Kléber-Méleau, tu en sais quelque chose, et quand tu publiais un livre tu pouvais compter en Suisse romande, sur une quinzaine de critiques qui parlaient à peu près le même langage, pour deux ou trois journalistes culturels dans le biotope actuel, etc.Pour autant, ni le Baron ni moi ne donnons dans le lamento des anciens combattants, d’accord pour déplorer le style « après nous les déluge » de trop de pionniers d’hier, de Godard à Dimitri ou de Freddy Buache à Claude Frochaux pour lesquels plus rien ne se fait de valable aujourd’hui.Lui-même est en train de répéter le rôle de Pyrrhus pour un Andromaque en projet, et quand je lui parle des qualités d’un Joseph Incardona dont je suis en train de lire Une saison en enfance, après avoir découvert La soustraction des possibles, il me dit qu’il a lu et aimé la première version du premier, d’abord intitulé Permis C, et qu’il a rencontré le personnage à l’occasion d’une interview filmée, que c’est un type bien, sûr de lui et intelligent, mais aussi sensible et compétent, et pareil pour Metin Arditi qu’il a aussi lu et admiré (notamment le Turquetto) et dont il a enregistré un monologue, avant ou après avoir rencontré la personne dont il me dit aussi grand bien alors que le milieu littéraire le jalouse et le dégomme plutôt, etc.Bref résultat des courses et comme le disait Dimitri : on continue!
(Lectures du monde, 2021)NO SOCIETY .- Nous ne sommes pas désespérés, mais nous sommes dans la perplexité, disait à peu près ce maître de la sensibilité que fut Charles du Bos, et c’est le même constat que nous faisions hier, avec le Baron, en évoquant la disparition de la société qui faisait naguère la vitalité de nos lettres et de nos scènes.Tu te rends compte que l’année de tes vingt ans, dans la VW bleue bluet de l’abbé V. , pote à la fois de Gustave Roud, de Georges Haldas et de Jacques Mercanton, nous sommes descendus chez Philippe Jaccottet à quatre avec le peintre Pierre Estoppey et le docteur Émile Moeri qui fut l’ami et le cardiologue de Cingria ?Et le soir dans la cuisine des Jaccottet, avec Wayland Dobson et son compagnon Jeannot L’Oiseau, je te raconte pas: c’était si gentil, si naturellement amical !Et c’était une putain de société: c’est grâce à Émile que j’ai rencontré la femme à la chèvre, une vieille originale qui vivait avec celle-ci, près de Grignan, dans une petite cave qui rappelait celle de Ludwig Hohl en plus fouettant quant à l’odeur, et à la même occasion que Jeannot l’Oiseau qui avait très bien connu Charles-Albert, m’a raconté pas mal de souvenirs inédits à son propos.Jeannot avait eu une période quasi géniale en tant que peintre, mais à cette époque il ne faisait plus que s’occuper des clavecins de Wayland et mémorisait je ne sais plus quelle encyclopédie , dont il savait déjà tout jusqu’à la lettre B !Je ne te dis pas que c’était l’âge d’or, pas du tout, mais le fait est que quelque chose se continuait là qui n’existe quasiment plus aujourd’hui.Dans ces années on avait une vingtaine de galeries d’art à Lausanne, actuellement moins de cinq, on recensait vingt lieux de théâtre actifs à part Vidy et Kléber-Méleau, tu en sais quelque chose, et quand tu publiais un livre tu pouvais compter en Suisse romande, sur une quinzaine de critiques qui parlaient à peu près le même langage, pour deux ou trois journalistes culturels dans le biotope actuel, etc.Pour autant, ni le Baron ni moi ne donnons dans le lamento des anciens combattants, d’accord pour déplorer le style « après nous les déluge » de trop de pionniers d’hier, de Godard à Dimitri ou de Freddy Buache à Claude Frochaux pour lesquels plus rien ne se fait de valable aujourd’hui.Lui-même est en train de répéter le rôle de Pyrrhus pour un Andromaque en projet, et quand je lui parle des qualités d’un Joseph Incardona dont je suis en train de lire Une saison en enfance, après avoir découvert La soustraction des possibles, il me dit qu’il a lu et aimé la première version du premier, d’abord intitulé Permis C, et qu’il a rencontré le personnage à l’occasion d’une interview filmée, que c’est un type bien, sûr de lui et intelligent, mais aussi sensible et compétent, et pareil pour Metin Arditi qu’il a aussi lu et admiré (notamment le Turquetto) et dont il a enregistré un monologue, avant ou après avoir rencontré la personne dont il me dit aussi grand bien alors que le milieu littéraire le jalouse et le dégomme plutôt, etc.Bref résultat des courses et comme le disait Dimitri : on continue!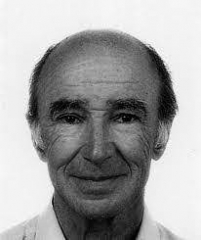 LE MARQUIS. – En me rappelant notre conversation d’hier avec le Baron, qui ferait aujourd’hui un Charlus formidable s’il était un peu plus flasque et portait des cheveux plus longs et plus blancs (en tout cas je le vois bien mieux dans ce rôle qu’un Delon ou qu’un Malkovitch), je pense à mon ami G. que j’avais appelé le Margrave dans mon premier livre et qui est notre Marquis depuis le début des années 70, autre extravagant merveilleux que j’ai commencé de peindre au Baron comme un dandy à la dégaine de Blaise Pascal et qui, depuis la fin de son adolescence parisienne, est devenu à Lausanne (et successivement s'entend) le compagnon de deux veuves de bouchers dont la seconde était aussi une fine artiste.Que ce soit, pour L’Âge d’Homme, en tant que traducteur au long cours des auteurs anglais ou américains (de Chesterton à Gore Vidal et Ronald Firbank, Ivy Compton-Burnett ou Saki, notamment), ou comme ami très proche de notre petit cercle de la maison sous les arbres de Dimitri, à peu près vingt ans durant, mais aussi en duo paradoxal (moi dans mes jeans rouge et mes chemises ouvertes, lui dans ses costumes haut de gamme de dandy aux longs doigts) à Florence une année où les tapins dans la rue louche de notre hôtel le prenaient pour une tante, à Vaduz pour la grand exposition Rubens, ou à Rome pour essayer de récupérer ensemble les manuscrits d’un auteur français proscrit, mon plus cher ami actuel est à tous égards la plus anachronique figure et pourtant avec lui plus qu’avec personne ( je ne parle pas de Lady L.) je me retrouve à tout coup au cœur du temps, et le Baron a l’air de comprendre ce dont je parle, comme je le comprends quand il me raconte, avec une liberté absolue, ses amitiés et ses amours...Je n’ai pas dit au Baron que le Marquis venait de publier au Cadratin, à compte d’auteur, ce qui doit être son vingtième livre, où quelques-uns, aussi exceptionnels à mes yeux qu’évidemment inaperçus, comme son grand recueil poétique offert à la deuxième femme de sa vie, Dans la vallée des larmes de la mort, et la stupéfiante Forêt silencieuse tenant en une seule phrase sans solution de continuité, tous deux tirés à moins de cent exemplaires, valent mieux que les deux tiers (pour rester positif) de la production actuelle de papier imprimé.Ce dernier livre, paru sous le nouveau pseudo de Gabriel d’Epalinges, est un recueil de poèmes délicieux composé pour (et avec) un petit garçon de sept ou huit ans, le petit-fils de sa dernière amie, qui montre un goût singulier pour les mots, et c’est Ariel en poésie…PRIÈRE D’INSÉRER. – « Le poète est semblable à un page qui de son cœur a fait l’hommage à son seigneur ou à sa dame. Ici le seigneur est un enfant qui s’éveille aux nobles beautés du française.Le jeu du poète est un jeu d’enfant, un jeu d emots qui obéit à des règles. La poésie versifiée est un îlot fortifié par la rime et le pied, sublime enceinte au milieu d’un océan de silence où les mots, je devrais dire les syllabes,, sont comme des caravelles jetés sur les mers de l’indifférence au caprice des vents voyoux.Jeu noble et solitaire comme le Nil dans le désert que foule le pied du dromadaire et qui se joue avec des vers. Un enfant de six ans et un homme dans on automne un hiver y jouèrent.Et maintenant cinglons pour l’île où Prospero (qui fut un jour Timon) n’est plus que souffles et que soupirs, n’est plus que la musique d'un mot.Ariel-Gabriel est là qui nous entraîne dans ce jeu de colin-maillard et de métamorphoses où les mots sortis de l’univers séculier entrent dans la clôture sacrée du théâtre.Ô poésie, j’élis ta solitude ! »Tel étant la quatrième de couverture de Gabriel ou le livre des enfantillages de mon bien cher ami G., Gérard Joulié et Sylvoisal en littérature…
LE MARQUIS. – En me rappelant notre conversation d’hier avec le Baron, qui ferait aujourd’hui un Charlus formidable s’il était un peu plus flasque et portait des cheveux plus longs et plus blancs (en tout cas je le vois bien mieux dans ce rôle qu’un Delon ou qu’un Malkovitch), je pense à mon ami G. que j’avais appelé le Margrave dans mon premier livre et qui est notre Marquis depuis le début des années 70, autre extravagant merveilleux que j’ai commencé de peindre au Baron comme un dandy à la dégaine de Blaise Pascal et qui, depuis la fin de son adolescence parisienne, est devenu à Lausanne (et successivement s'entend) le compagnon de deux veuves de bouchers dont la seconde était aussi une fine artiste.Que ce soit, pour L’Âge d’Homme, en tant que traducteur au long cours des auteurs anglais ou américains (de Chesterton à Gore Vidal et Ronald Firbank, Ivy Compton-Burnett ou Saki, notamment), ou comme ami très proche de notre petit cercle de la maison sous les arbres de Dimitri, à peu près vingt ans durant, mais aussi en duo paradoxal (moi dans mes jeans rouge et mes chemises ouvertes, lui dans ses costumes haut de gamme de dandy aux longs doigts) à Florence une année où les tapins dans la rue louche de notre hôtel le prenaient pour une tante, à Vaduz pour la grand exposition Rubens, ou à Rome pour essayer de récupérer ensemble les manuscrits d’un auteur français proscrit, mon plus cher ami actuel est à tous égards la plus anachronique figure et pourtant avec lui plus qu’avec personne ( je ne parle pas de Lady L.) je me retrouve à tout coup au cœur du temps, et le Baron a l’air de comprendre ce dont je parle, comme je le comprends quand il me raconte, avec une liberté absolue, ses amitiés et ses amours...Je n’ai pas dit au Baron que le Marquis venait de publier au Cadratin, à compte d’auteur, ce qui doit être son vingtième livre, où quelques-uns, aussi exceptionnels à mes yeux qu’évidemment inaperçus, comme son grand recueil poétique offert à la deuxième femme de sa vie, Dans la vallée des larmes de la mort, et la stupéfiante Forêt silencieuse tenant en une seule phrase sans solution de continuité, tous deux tirés à moins de cent exemplaires, valent mieux que les deux tiers (pour rester positif) de la production actuelle de papier imprimé.Ce dernier livre, paru sous le nouveau pseudo de Gabriel d’Epalinges, est un recueil de poèmes délicieux composé pour (et avec) un petit garçon de sept ou huit ans, le petit-fils de sa dernière amie, qui montre un goût singulier pour les mots, et c’est Ariel en poésie…PRIÈRE D’INSÉRER. – « Le poète est semblable à un page qui de son cœur a fait l’hommage à son seigneur ou à sa dame. Ici le seigneur est un enfant qui s’éveille aux nobles beautés du française.Le jeu du poète est un jeu d’enfant, un jeu d emots qui obéit à des règles. La poésie versifiée est un îlot fortifié par la rime et le pied, sublime enceinte au milieu d’un océan de silence où les mots, je devrais dire les syllabes,, sont comme des caravelles jetés sur les mers de l’indifférence au caprice des vents voyoux.Jeu noble et solitaire comme le Nil dans le désert que foule le pied du dromadaire et qui se joue avec des vers. Un enfant de six ans et un homme dans on automne un hiver y jouèrent.Et maintenant cinglons pour l’île où Prospero (qui fut un jour Timon) n’est plus que souffles et que soupirs, n’est plus que la musique d'un mot.Ariel-Gabriel est là qui nous entraîne dans ce jeu de colin-maillard et de métamorphoses où les mots sortis de l’univers séculier entrent dans la clôture sacrée du théâtre.Ô poésie, j’élis ta solitude ! »Tel étant la quatrième de couverture de Gabriel ou le livre des enfantillages de mon bien cher ami G., Gérard Joulié et Sylvoisal en littérature…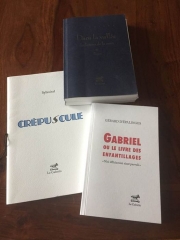 BARBARES. – Dimitri me racontait, un jour, sa visite à la veuve de Charles du Bos (disparu en 1939) et d’autres proches du grand Monsieur, pour me dire combien il s’était senti, au milieu de ces gens si délicats et raffinés, gentils et merveilleusement cultivés, un sac grossier et un barbare, et c’est ce que je me suis dit aussi lorsque, à vingt-deux ans, je suis entré en blue-jean et cheveux longs dans le salon lambrissé de bois gris suprême de Jeanne Sépibus, l’amie de Rilke au moins octogénaire, que je venais interviewer pour mon journal de papier sale…Et ces jours je me retrouve en compagnie occulte de Stefan Zweig qui raconte son monde d’hier et me parle de Verlaine et de Ramuz, de Freud qu’il a connu, de Weininger qu’il a plus ou moins snobé avant de reconnaître son génie, du fils de Léon Daudet suicidé (ou assassiné) à quatorze ans et dont il parle en pointant le manque de cœur de certains grands intellectuels professant les plus Hautes Valeurs avec des arguments de brutes à massues, etc.
BARBARES. – Dimitri me racontait, un jour, sa visite à la veuve de Charles du Bos (disparu en 1939) et d’autres proches du grand Monsieur, pour me dire combien il s’était senti, au milieu de ces gens si délicats et raffinés, gentils et merveilleusement cultivés, un sac grossier et un barbare, et c’est ce que je me suis dit aussi lorsque, à vingt-deux ans, je suis entré en blue-jean et cheveux longs dans le salon lambrissé de bois gris suprême de Jeanne Sépibus, l’amie de Rilke au moins octogénaire, que je venais interviewer pour mon journal de papier sale…Et ces jours je me retrouve en compagnie occulte de Stefan Zweig qui raconte son monde d’hier et me parle de Verlaine et de Ramuz, de Freud qu’il a connu, de Weininger qu’il a plus ou moins snobé avant de reconnaître son génie, du fils de Léon Daudet suicidé (ou assassiné) à quatorze ans et dont il parle en pointant le manque de cœur de certains grands intellectuels professant les plus Hautes Valeurs avec des arguments de brutes à massues, etc. -
Le Temps accordé
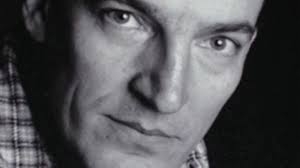 (Lectures du monde, 2021)LE BARON.- C’est moi qui l’ai relancé en pensant a Sam, mais c’est lui, j’espère, qui tirera le meilleur de nos retrouvailles, au Major de Cully où il m’attendait assis, aussi massif et la nuque droite, carrée et rasée que Von Stroheim, dans un impayable costume blanc mais sans guêtres ni cravate, chemise très bleue ouverte et sourire content à mon arrivée (moi aussi j'étais content: je venais de capter l’image d'une petite cigogne perchée sur un pilier d’amarrage de l’embarcadère) shake hand et proposition d’apéritif, mais non mon cher, mes douze médocs me limitent de ce côté - et de lui évoquer nos tribulations de ces derniers mois, pires à mes yeux que les incendies en Anatolie et que la plantée libanaise, et alors c’est lui qui m’avoue qu’il est planté et bonnement infoutu de rien écrire depuis trop de temps...
(Lectures du monde, 2021)LE BARON.- C’est moi qui l’ai relancé en pensant a Sam, mais c’est lui, j’espère, qui tirera le meilleur de nos retrouvailles, au Major de Cully où il m’attendait assis, aussi massif et la nuque droite, carrée et rasée que Von Stroheim, dans un impayable costume blanc mais sans guêtres ni cravate, chemise très bleue ouverte et sourire content à mon arrivée (moi aussi j'étais content: je venais de capter l’image d'une petite cigogne perchée sur un pilier d’amarrage de l’embarcadère) shake hand et proposition d’apéritif, mais non mon cher, mes douze médocs me limitent de ce côté - et de lui évoquer nos tribulations de ces derniers mois, pires à mes yeux que les incendies en Anatolie et que la plantée libanaise, et alors c’est lui qui m’avoue qu’il est planté et bonnement infoutu de rien écrire depuis trop de temps...
 Cependant je me rappelle, leçon d’un soir de Roland Jaccard et de je ne sais quel sage chinois , que c’est avec l’homme qu’on soigne l’homme, et comme il en est venu, suite a diverses bifurcations de la parlerie (Il s’est commandé un filet de perches et moi un tartare frites) à parler de sa nouvelle fonction occasionnelle de locuteur d’éloges funèbre (il en a fait un ou deux très appréciés, après quoi il a commencé d’être sollicité), je lui dis que làa est son salut: tu te sors les pouces du cul et tu en fais une nouvelle ou même un roman, et ça ne manque pas ensuite: je vois qu’il réfléchit et que ça pourrait rebondir.Mais j’insiste lourdement : tu cesses de faire ta névrose à deux sous devant la page blanche et tu appliques la méthode Julien Green, et comme je connais la formule par cœur pour en avoir fait l’exergue de mon propre roman en chantier, je cite cet extrait du Journal de 1956 - l'année de la naissance de mon vis-à-vis: "Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes"...Je sais que ça a l’air facile et surtout quand on est également en crise affective quasi libanaise comme il me l’a appris dans la foulée (il a répondu trois fois au téléphone depuis moins d’une heure) mais je sais que lui peut en faire quelque chose vu qu’il a déjà commis deux livres qui le placent au premier rang de nos auteurs, ce que je lui rappelle après en avoir écrit en long et en large. En 2018-2019, et tu sais que je ne flatte pas, je retiens deux romans de premier rang dans nos cantons de l’Ouest , a savoir le tien et celui de Barilier. Jawohl !
Cependant je me rappelle, leçon d’un soir de Roland Jaccard et de je ne sais quel sage chinois , que c’est avec l’homme qu’on soigne l’homme, et comme il en est venu, suite a diverses bifurcations de la parlerie (Il s’est commandé un filet de perches et moi un tartare frites) à parler de sa nouvelle fonction occasionnelle de locuteur d’éloges funèbre (il en a fait un ou deux très appréciés, après quoi il a commencé d’être sollicité), je lui dis que làa est son salut: tu te sors les pouces du cul et tu en fais une nouvelle ou même un roman, et ça ne manque pas ensuite: je vois qu’il réfléchit et que ça pourrait rebondir.Mais j’insiste lourdement : tu cesses de faire ta névrose à deux sous devant la page blanche et tu appliques la méthode Julien Green, et comme je connais la formule par cœur pour en avoir fait l’exergue de mon propre roman en chantier, je cite cet extrait du Journal de 1956 - l'année de la naissance de mon vis-à-vis: "Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes"...Je sais que ça a l’air facile et surtout quand on est également en crise affective quasi libanaise comme il me l’a appris dans la foulée (il a répondu trois fois au téléphone depuis moins d’une heure) mais je sais que lui peut en faire quelque chose vu qu’il a déjà commis deux livres qui le placent au premier rang de nos auteurs, ce que je lui rappelle après en avoir écrit en long et en large. En 2018-2019, et tu sais que je ne flatte pas, je retiens deux romans de premier rang dans nos cantons de l’Ouest , a savoir le tien et celui de Barilier. Jawohl !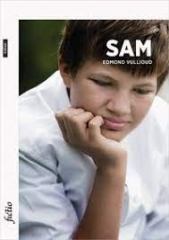 Ensuite, vers trois heures de l’après-midi, moi un peu flagada pour cause de sieste quotidienne sautée, et lui pour retourner à son téléphone de vieil ado à histoires compliquées, non moins qu' impatients tous deux de prendre des notes, je décide, le voyant sortir du pissoir de la place, après m'avoir accompagné au parking, et s’éloigner assez immense dans son costard blanc de colonial égaré chez les ploucs, de l’appeler ici le Baron. (Ce mardi 3 août)
Ensuite, vers trois heures de l’après-midi, moi un peu flagada pour cause de sieste quotidienne sautée, et lui pour retourner à son téléphone de vieil ado à histoires compliquées, non moins qu' impatients tous deux de prendre des notes, je décide, le voyant sortir du pissoir de la place, après m'avoir accompagné au parking, et s’éloigner assez immense dans son costard blanc de colonial égaré chez les ploucs, de l’appeler ici le Baron. (Ce mardi 3 août) -
Salamalecs aux foldingues

Trois écrivains – Corinne Desarzens, Jean-Yves Dubath et Antonin Moeri – et deux artistes – Christine Sefolosha et Stéphane Zaech – illustrent la douce folie visionnaire opposée au formatage du grand hospice occidental. Autant de pistes à l’écart de la meute...
Les ahuris sublimes restent parmi nous, qui méritent notre reconnaissance de rétifs au formatage absolu. Révérence à Corinne la cinglée qui cisèle ses paroles d’or en soutien-gorge noir, à Jean-Yves Dubath fouinant avec un Roumain dans une déchetterie de la Riviera, où a Antonin Moeri dansant la gigue en veste de pyjama à l’asile psy des Gentianes. Avec un salamalec supplémentaire aux artistes Christine Sefolosha, pour ses paquebots-buildings engloutis, et à Stéphane Zaech parodiant les Ménines de Velasquez et les femmes de Picasso avec ses jeunes beautés à trois yeux ou sept bras propres à mieux enlacer le jeune homme timide...
De Dürrenmatt a Zouc, via Robert Walser
Devant le Conseil fédéral helvétique, en présence du grand dissident tchèque Vaclav Havel devenu président, Friedrich Dürrenmatt prononça en novembre 1990 un discours ahurissant dans lequel il comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont les prisonniers (nous tous, qui roulons en 4x4 ou en vélo électronique) seraient les gardiens. Scandale! Délire de vieux saltimbanque millionnaire! Un vrai maboul ce Dürrenmatt!

Tellement fou, n’est-ce pas, que La visite de la vieille dame continue de se jouer autour du monde, fabuleuse métaphore de la trahison des riches dont le cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty a tiré un film non moins mordant sous le titre d’Hyènes.
Or Dürrenmatt s’inscrit, sur le mythique chemin forestier de Guillaume Tell, dans la longue lignée des réfractaires au propre-en ordre, du poète névropathe Robert Walser à la candeur rouée, au génie du souterrain helvète que figura Ludwig Hohl dans son entresol genevois, en passant par Roorda l’ex-Batave humoriste et Zouc la sale gamine fauteuse de vérités trop humaines.
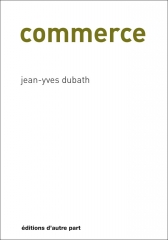 Déchets encombrants et trafics amoureux
Déchets encombrants et trafics amoureuxLa gestion des déchets se fait désormais sous contrôle strict en nos régions, où tout est trié et conditionné pour recyclage. La déchetterie des hauts de Montreux ferait rugir le jeune ferrailleur roumain Basile s’il rôdait encore en nos murs, mais il y a peu de chances. En revanche, il n’est pas exclu qu’on mette un jour la main sur Commerce de Jean-Yves Dubath sur les rayons de la ressourcerie du même lieu (juste sous l’autoroute, mais il vous faudra la carte magnétique d’accès) ou j’ai trouvé l’autre jour l’Anthologie de la poésie française de Gide en Pléiade.
Donc ce Basile, une nuit de mai 2013, fourrageait dans un tas de déchets encombrants d’une rue de Montreux, repéré par un certain Julius, artiste spécialisé dans le dessin charnel de beaux sportifs et plus si affinités, taxé de «Leonor Fini helvète» et salivant plus ou moins à l’imagination de troubles rencontres nocturnes.
Or l’ombre en question ne donne pas dans ce genre de commerce, Basile n’étant attiré que par les téléviseurs et autres micro-ondes au rebut, séchoirs Stewi ou vieilles radios Telefunken à rafistoler, entre deux escales chez «ces dames». Moins fou que Basile tu meurs! Mais les fantasmes de Julius vont en faire un «enchanteur» de la brocante, un «croisé» de la route, voire un ange.
En ces temps de normalisation généralisée, le goût «différent» d’un esthète délicat du genre de Julius ne devrait pas poser le moindre problème, pensez: en Suisse où il y a même des Noirs ou des transgenres parmi nos élus! N’empêche: pas question pour Julius de demander à Basile de poser tout nu pour lui! Du moins le privilège lui est-il accordé de rendre service au jeune Roumain plus souvent qu’à son tour, avant divers prêts d’argent qui vont corser la relation.
Commerce est un petit roman d’amour proustien, qui joue sur le même écart culturel séparant le Narrareur de la Recherche du temps perdu et la charmante gigolote au prénom d’Albertine, sur le même auto-aveuglement de l’amoureux «utile», et sur le même vertigineux chagrin. Mais il y a plus: car ce «commerce» affectif se développe sur fond de déséquilibre économique européen, dont Jean-Yves Dubath tire une fable.
Pour s’attirer l’amitié virile de Basile, Julius imagine en effet, dans sa candeur, une sorte de PME ou de «joint-venture» à l’enseigne de laquelle Basile revendra dans son pays des tableautins peints par Julius, lequel a renoncé aux nus équivoques pour se lancer dans le paysage alpestre. De quoi faire rêver à la Suisse dans la lointaine Valachie roumaine: je peins des cascades et des chalets, tu les revends en Moldavie, à nous la gloire et les euros!
Cependant Basile, terre à terre, ne comprend rien à cette histoire de tableaux: il n’en a qu’à l’argent de Julius, qui raque et rêve! Et plus son généreux et naïf ami le régale, plus Basile râle, voyant en ce «riche» une incarnation de l’Occident pourri alors que lui incarne l’éternel «pauvre». Et de réclamer plus d’argent tout en vilipendant la Suisse où tout se paie! Et la douce dinguerie de Julius de bouter le feu à la folie meurtrière de Basile!

L’histoire de Commerce pourrait ne relever que d’un mini-polar romand, qui finit dans le sang comme on l’a deviné: fait divers sordide bon pour les tabloïds. Or Dubath, en écrivain retors, styliste raffiné captant tous les niveaux de langage, parvient à en faire à la fois un épisode d’amour empêché, dérisoire et déchirant, et le constat amer d’une fracture sociale et culturelle plus large et profonde.
Contre la folie ordinaire: l’irrécupérable beauté
La Suisse propre sur elle et bien ordonnée, terrienne d’origine et pragmatique de tradition, s’est toujours méfiée des artistes et des écrivains, ces «originaux». Deux grands créateurs du 20e siècle, l’écrivain Robert Walser et le peintre Louis Soutter, ont pourtant marqué la littérature européenne et les arts plastiques de leurs traces à la fois hagardes et incomparables, hors de tout académisme et à l’écart des modes – tous deux à la frontière de la norme sociale et de l’équilibre psychique.
Or ces deux génies singuliers ont fait des petits, si l’on ose dire, à la fois en littérature, avec un Jean-Marc Lovay, et dans les arts plastiques avec une flopée de peintres travaillant aux marges de la figuration, plus ou moins inspirés par ce qu’on dit les arts premiers ou l’art brut, en diverses mouvances «sauvages» fleurant parfois la mode.

A supposer qu’il y ait des passerelles entre fiction et réalité, je me suis amusé à imaginer la rencontre de Julius, le peintre de «tableautins alpestres» collaborant avec un lithographe de Villeneuve, et de Stéphane Zaech, dans le minuscule atelier du même bourg où celui-ci travaille à d’immenses toiles dont les dernières furent exposées dans une grande galerie chic proche de la Bahnhofstrasse de Zurich.
Demoiselles à trois yeux, nus masculins ou chastes alpages
Un épisode cocasse du roman de Dubath voit Julius utiliser l’ordinateur de son lithographe pour découvrir, via Google Earth, que le terrain de Roumanie orientale qu’il a financé, et sur lequel il espérait implanter une galerie d’art, abrite en réalité une COOP toute neuve, où ses œuvres auraient détoné autant que les demoiselles à trois yeux et cinq jambes de ce dingue de Zaech. Mais Basile a-t-il vu un seul tableau de sa vie? En tout cas on veut croire que l’art de Julius peignant des nus masculins ou de chastes alpages est aussi «authentique» que celui de Stéphane Zaech – tout étant dans le style et le grain de folie, n’est-ce pas?

A cet égard, le réalisme fantastique marquant les grands paysages de Stéphane Zaech, où l’on voit des jungles foisonnantes jouxter des monts enneigés à la manière chinoise, sur les hauts de Montreux, entre visions érotiques et figures peinturlurées de chefs indiens en costumes baroques, ne le cède en rien aux visions oniriques d’une Christine Sefolosha, notoire «outsider» saturant ses hautes feuilles de figures animales ou humaines en un bestiaire rappelant les murs de Lascaux ou les rêves éveillés de certains surréalistes, de Max Ernst à Leonor Fini – l’inspiratrice présumée de Julius.

Styles divers mais souche commune dans le tréfonds imaginaire suscitant de multiples poussées, et même jaillissement en beauté non formatée! Rappelez-vous le dernier tweet de Donald Trump en contemplant les navires de Christine Sefolosha reposant à jamais dans les profondeurs océanes.

Or lequel, de l’Ubu planétaire, et de l’artiste aux yeux fertiles, est le plus fou? Et quel est ce monde dément, dans lequel un Christ de Léonard se voit livré aux maquereaux du Marché?
Style couilles de velours et pyjama de sortie
«L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini», notait un jour Charles-Albert Cingria, autre grand siphonné de notre littérature, dont Corinne Desarzens est héritière à sa façon de grande perche penchée comme la tour de Pise par grand vent, amoureuse d’un peu tout: des épeires diadèmes et des courges, des hommes aux grands yeux doux et des pruneaux qu’ils ont dans leur sac, des sirènes d’Engadine et des aigles albanais ou des proverbes éthiopiens («quand les toiles d’araignées s’unissent, elles peuvent arrêter un lion») des glands de corbillards et du chapeau de l’agaric champêtre, enfin de tout ce qu’elle absorbe («je suis tout ce que je rencontre») et qu’elle transforme en phrases coulées et en mots.

Fontaine à jet continu, Corinne Desarzens vient de publier trois livres et sept autres sont prêts à bondir des soutes de l’antre veveysan de Michel Moret, mais le Saint-Siège conseille surtout ces jours, avec Le soutien-gorge noir constituant une belle histoire d’amour empêché entre une certaine Monique et un œnologue hongrois, les piécettes de Couilles de velours qu’on peut emporter partout comme un bréviaire.
Ainsi les yeux au ciel:
«Pendant des années, le soir, debout dans le jardin, j’ai regardé clignoter des avions. La nuit répandait son encre. C’était calme, là-haut. Par intermittences, les avions émettaient des signaux, lâchaient des giclées de jus de citron, avec nervosité, avec régularité, peut-être même avec détresse. Pas plus qu’aux nouvelles du matin – ces autres déflagrations – il était possible de répondre à ces signaux, engloutis un moment plus tard, ne laissant pas la plus légère traîne de lumière derrière eux, sinon désolations et regrets. Des orbites ne se croiseraient jamais. À qui ressemblait la femme à la place 47B? Et le passager du siège 23A? Et puis un jour, un jour en dépit de tout, contre toute attente, un jour prodigieux, la boîte retrouve son couvercle, et la pierre, s’emboîtant au millimètre près, sa moitié manquante».
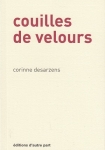
Un «jour prodigieux», ç’aurait été celui où le jeune type peu remarquable à l’époque, promis à devenir plus tard l’homme en veste de pyjama, aurait fait LA rencontre de sa vie, comme on dit dans les feuilletons romantiques à succès à la Marc Musso ou à la Guillaume Levy, et là encore ce serait un artiste (mais il y en a donc plein dans ce qu’on croit un jardin peuplé de seuls nains!), un sculpteur au prénom de Niko exposant jusqu’à San Francisco – où peut-être il aura rencontré Christine Sefolosha et son grand fils Tabo fameux au tir au panier – qui l’aurait bassiné pour la lui faire raconter, cette rencontre d’entre les rencontres, et c’est ainsi que se lancerait la narration réellement frappadingue de L’homme en veste de pyjama, dernier roman d’Antonin Moeri qu’on n’insultera pas en le situant une fois de plus dans la filiation de Robert Walser (qu’il a d’ailleurs traduit) et de Ludwig Hohl ou Thomas Bernhard, même s’il trouve ici une nouvelle vigueur inventive et une façon inédite de pratiquer le roman à multiples miroirs construisant peu à peu ses personnages dans la durée du récit.
«L’infini à la portée des caniches»
La Suisse romande de ce récit (quelque part entre le bout et le bord du même lac, on pourrait dire Geneva International et Cully), s’étend à vrai dire sur l’espace virtuel de ce que Limonov appelait le grand hospice occidental, et là encore il va s’agir de folie ordinaire, détaillée par un présumé «homme sans qualités» peu fait pour la réussite sociale et vite fatigué au marathon de l’amour fou, dont on est prié de supposer qu’il l’a connu même si rien n’est tout à fait sûr dans cette remémoration du Big Bang amoureux dont Céline estimait qu’il se réduisait à «l’infini à la portée des caniches».

Pas loin d’un Michel Houellebecq ou d’un Philippe Muray dans le regard qu’il porte sur la société contemporaine, dont il recycle à sa manière l’omniprésente novlangue à base de positivité suave et de nivellement vertueux, Antonin Moeri pousse ici plus loin que dans ses livres précédents (nouvelles et romans) par le truchement d’une dramaturgie portée par la langue, laquelle mime l’omniprésente et gesticulante jactance constituant l’arrière-plan social du roman.
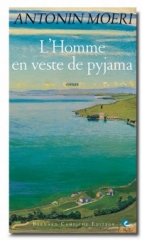
Guerre des sexes, comédie sociale investissant bientôt le monde de la Star Ac littéraire (car le futur homme à veste de pyjama griffonne sur des calepins autant qu’il zyeute), allers et retours de la mémoire qui invente en même temps qu’elle recycle, multiplication des conditionnels et des masques de rechange fusionnent en thèmes et variations au délire très contrôlé, et l’exorcisme se fait en beauté, une fois encore affaire de style, si débridé qu’il soit dans sa joyeuse et libératrice folie.
Jean-Yves Dubath. Commerce. Editions d’autre part, 124 p. 2017.
Christine Sefolosha. Timeless Wanderer. Genoud, 2015.
Stéphane Zaech, Loyola Peinture. art & fiction, 2000.
Corinne Desarzens. Le soutien-gorge noir. L’Aire, 2017; Couilles de velours. Editions d’autre part, 69p., 2017.
Antonin Moeri. L’homme en veste de pyjama. Bernard Campiche, 253p. 2017.

...qu’ont-ils en commun et qu’ont-ils à nous dire? Peut-être ce qu’on pourrait dire le Waldgang, ce chemin en forêt qui trace un réseau de sentiers entre passé et présent, villes et campagnes de cette Europe miniature que figure la Suisse. Des Grisons de Fleur Jaeggy au Jura de Zouc, ou du labyrinthe halluciné de Wölffli aux rhapsodies verbales de Peter Weber, une autre Suisse, tellurique et ingénue, sauvage et prodigue de poésie obscure ou fulgurante, ouvre des échappées à ce que Dürrenmatt disait, non sans provocation, notre prison sans barreaux…

-
Le Temps accordé
 (Lectures du monde, 2021)INTERFÉRENCES ONIRIQUES.- Le cerveau en phase dormante reste une assez terrifiante usine, dont la silhouette fantasmagorique me reste ce matin après ma rôderie d’hier soir autour des friches industrielles de Chavalon où je suis monté avec l’idée d’y voir la vue sur le Haut-Lac, mais pas moyen : le site est sécurisé et je ne suis plus assez élastique pour sauter les barrières de métal qui en bouclent et l’accès et le promontoire potentiel donnant sur les lointains lémaniques, mais le fait est que des pans entiers de ce dimanche de fête nationale ont basculé dans une suite de rêves où, des hauteurs du canyon de l’inspecteur Bosch écoutant Ron Carter sur sa terrasse (8 épisodes de la septième saison enfilés de cinq heures du soir à deux heures du matin) au-dessus des constellations lumineuses de la Cité des Anges, mon submental a glissé en fondu enchaîné dans le ciel de la baie de Montreux où des foules assistaient au phénoménal feu d’artifice du 1er aout, et le verbal s’est mêlé au visuel en rebrassant mes dernières impressions de lecture, en 1939 à la fin de l’introduction poignante du Monde d’hier de Stefan Zweig, qui évoque en deux pages la chute de la Maison européenne et le paradoxe du XXe siècle diabolique et génial, ce que dit Comte-Sponville de Zweig dans le dernier article de son Dictionnaire amoureux de Montaigne, à propos de l’identification de l’humaniste autrichien au témoin d’un autre siècle de démence humaine à motifs idéologiques (les guerres de religions après la Renaissance), puis en 1034 dans un monastère d’Acre avec le petit Avner de Metin Arditi que son amour instinctif de la vie et des gens, son émoi à l’écoute des psalmodies des moines orthodoxes et sa fascination naissante pour les icônes dressent lui aussi contre l’idéologie figée de son père juif sourcilleux - bref tout un magma qui finit par une conversation très personnelle avec le président Chirac portant sur les défauts «trop humains» de Léon Tolstoï et notre attachement «malgré tout» à son pacifisme et à son activisme évangélique - celui-là même qui avait poussé le jeune Josef Czapski, notre vieil ami, et sa sœur Maria à fonder leur petite communauté d’idéaliste au tout début du XXe siècle…Nota bene : pour faire bon poids, je me rappelle à l’instant que c’est Romain Rolland qui parle, quelque part, de la visite des deux jeunes Czapski à Tolstoï, et comme Rolland était proche de Zweig et que mes derniers messages à Quentin, envoyés hier matin depuis le quais aux Fleurs, lui recommandent la lecture de celui-là, tout se tient en somme « par-dessous », dans le rêve autant qu’à l’éveil…QUENTIN ET BALZAC. – Il porte le prénom d’un personnage de Faulkner, je ne suis pas sûr que ses parents l’aient choisi pour ça, mais le fait est que ce garçon a quelque chose qui me rappelle, avec son strabisme et ses gesticulations «dans le maïs», les figures à la fois délicates et frustes, boiteuses et sauvages de l’autre Big Will qui aurait apprécié, je crois, la lecture de Notre-Dame-de-la-merci, le livre que je préfère jusque-là du lascar, qui en fera sûrement bien d’autres et peut-être des meilleurs, comme il en ira de Joseph Incardona de vingt ans son aîné.Lorsque je lui ai apporté mon premier livre, écrit « grâce » à un accident de la route qui m’a immobilisé pendant des mois aux bons soins de notre mère, Dimitri a rédigé d’autorité, à ce récit à la fois autobiographique et très sublimé dans une langue à l’évidence marquée par la lecture de Cingria, une postface « où il était question d’âge », alors que j’avais vingt-cinq ans et lui treize de plus.
(Lectures du monde, 2021)INTERFÉRENCES ONIRIQUES.- Le cerveau en phase dormante reste une assez terrifiante usine, dont la silhouette fantasmagorique me reste ce matin après ma rôderie d’hier soir autour des friches industrielles de Chavalon où je suis monté avec l’idée d’y voir la vue sur le Haut-Lac, mais pas moyen : le site est sécurisé et je ne suis plus assez élastique pour sauter les barrières de métal qui en bouclent et l’accès et le promontoire potentiel donnant sur les lointains lémaniques, mais le fait est que des pans entiers de ce dimanche de fête nationale ont basculé dans une suite de rêves où, des hauteurs du canyon de l’inspecteur Bosch écoutant Ron Carter sur sa terrasse (8 épisodes de la septième saison enfilés de cinq heures du soir à deux heures du matin) au-dessus des constellations lumineuses de la Cité des Anges, mon submental a glissé en fondu enchaîné dans le ciel de la baie de Montreux où des foules assistaient au phénoménal feu d’artifice du 1er aout, et le verbal s’est mêlé au visuel en rebrassant mes dernières impressions de lecture, en 1939 à la fin de l’introduction poignante du Monde d’hier de Stefan Zweig, qui évoque en deux pages la chute de la Maison européenne et le paradoxe du XXe siècle diabolique et génial, ce que dit Comte-Sponville de Zweig dans le dernier article de son Dictionnaire amoureux de Montaigne, à propos de l’identification de l’humaniste autrichien au témoin d’un autre siècle de démence humaine à motifs idéologiques (les guerres de religions après la Renaissance), puis en 1034 dans un monastère d’Acre avec le petit Avner de Metin Arditi que son amour instinctif de la vie et des gens, son émoi à l’écoute des psalmodies des moines orthodoxes et sa fascination naissante pour les icônes dressent lui aussi contre l’idéologie figée de son père juif sourcilleux - bref tout un magma qui finit par une conversation très personnelle avec le président Chirac portant sur les défauts «trop humains» de Léon Tolstoï et notre attachement «malgré tout» à son pacifisme et à son activisme évangélique - celui-là même qui avait poussé le jeune Josef Czapski, notre vieil ami, et sa sœur Maria à fonder leur petite communauté d’idéaliste au tout début du XXe siècle…Nota bene : pour faire bon poids, je me rappelle à l’instant que c’est Romain Rolland qui parle, quelque part, de la visite des deux jeunes Czapski à Tolstoï, et comme Rolland était proche de Zweig et que mes derniers messages à Quentin, envoyés hier matin depuis le quais aux Fleurs, lui recommandent la lecture de celui-là, tout se tient en somme « par-dessous », dans le rêve autant qu’à l’éveil…QUENTIN ET BALZAC. – Il porte le prénom d’un personnage de Faulkner, je ne suis pas sûr que ses parents l’aient choisi pour ça, mais le fait est que ce garçon a quelque chose qui me rappelle, avec son strabisme et ses gesticulations «dans le maïs», les figures à la fois délicates et frustes, boiteuses et sauvages de l’autre Big Will qui aurait apprécié, je crois, la lecture de Notre-Dame-de-la-merci, le livre que je préfère jusque-là du lascar, qui en fera sûrement bien d’autres et peut-être des meilleurs, comme il en ira de Joseph Incardona de vingt ans son aîné.Lorsque je lui ai apporté mon premier livre, écrit « grâce » à un accident de la route qui m’a immobilisé pendant des mois aux bons soins de notre mère, Dimitri a rédigé d’autorité, à ce récit à la fois autobiographique et très sublimé dans une langue à l’évidence marquée par la lecture de Cingria, une postface « où il était question d’âge », alors que j’avais vingt-cinq ans et lui treize de plus. Or ce que j’aime chez Quentin, comme je l’ai trouvé dans le récit intitulé Une saison en enfance de Joseph Incardona, c’est qu’avec ces deux-là, comme avec Stefan Zweig ou Balzac, je me retrouve pour ainsi dire « hors d’âge », grâce à la littérature, ou ces jours grâce à la poésie et à la philosophie, en ce qui concerne Quentin puisque ce sont ses intérêts majeurs du moment.J’étais l’autre jour dans le jardin chinois de Burier lorsque, sur un banc à prendre des notes en rose et turquoise dans mon nouveau carnet genre moleskine (alors que j’écris d’habitude en vert dans mes PaperBlanks), je reçois un texto de Quentin qui me dit qu’un auteur romand de notre connaissance, le cher F.D., prof de lettres en retraite, lui a balancé comme ça qu’Illusions perdues était un roman «adolescent et naïf», ce qui me semble une stupidité d’autant pus éberluante que l’écrivain en question est un pair hautement estimable et quasiment un ami.Pourtant je me rends mieux compte, aujourd’hui, de l’incompréhension qui a présidé à la lecture de Balzac dans nos générations, et je réponds à Quentin que l’ado naïf en question a parlé plus génialement que quiconque de la naissance du journalisme et de sa corruption, dans Ilusions perdues, et que le dédoublement de l’Auteur en multiples personnages (Lucien, David, d’Arthez, Lousteau, etc.,) incarnant les multiples positions qu’on peut avoir par rapport à la «pure» littérature, à la vogue populaire du feuilleton, à l’usage commercial ou politique de la presse, au putanisme médiatique en train de se développer, etc., sans parler des portraits de femmes qui émaillent le roman – que ce dédoublement fonde un prodigieux roman de l’apprentissage autant qu’une leçon d’éthique artistique sans pareille, etc.QUESTION D’ÂGE. - Comme le relève André Comte-Sponville à propos de Zweig, l’amitié a été l’une des formes d’amour les plus constantes dans la vie de celui-ci, à des hauteurs évoquant la relation de Montaigne et La Boétie, non pas dans le sens d’une amitié amoureuse équivoque (comme d’aucuns n’ont pas manqué de le suggérer à propos de ces deux derniers), mais dans la relation « pure » d’esprits et d’expériences «en phase» que la différence de génération rend le plus souvent problématique.Le tutoiement prématuré et la puérilité des échanges actuels amorcés par l’exaspérant «coucou» font peut-être illusion aux yeux de certains, mais je parle d’autre chose : de l’amitié qui résiste au temps, et pour ma part, dans l’absolu de la relativité amicale, je n’ai guère qu’un ami au monde, que je voussoye depuis bientôt 50 ans, que j’aime comme un bon vieux fauteuil ou comme un chat, un paysage ou un parfum, comme la vie pour ce qu’elle a de meilleur ou comme notre prochaine conversation – tous mes autres amis n’étant en somme que de bons camarades, et c’est déjà beaucoup. Or tous ceux-là ont à peu près mon âge, y compris Quentin qui est aussi « vieux » avant l’âge que je l’étais au sien…Quant aux amies c'est un autre roman, ou le sujet de nouvelles pour Stefan Zweig.
Or ce que j’aime chez Quentin, comme je l’ai trouvé dans le récit intitulé Une saison en enfance de Joseph Incardona, c’est qu’avec ces deux-là, comme avec Stefan Zweig ou Balzac, je me retrouve pour ainsi dire « hors d’âge », grâce à la littérature, ou ces jours grâce à la poésie et à la philosophie, en ce qui concerne Quentin puisque ce sont ses intérêts majeurs du moment.J’étais l’autre jour dans le jardin chinois de Burier lorsque, sur un banc à prendre des notes en rose et turquoise dans mon nouveau carnet genre moleskine (alors que j’écris d’habitude en vert dans mes PaperBlanks), je reçois un texto de Quentin qui me dit qu’un auteur romand de notre connaissance, le cher F.D., prof de lettres en retraite, lui a balancé comme ça qu’Illusions perdues était un roman «adolescent et naïf», ce qui me semble une stupidité d’autant pus éberluante que l’écrivain en question est un pair hautement estimable et quasiment un ami.Pourtant je me rends mieux compte, aujourd’hui, de l’incompréhension qui a présidé à la lecture de Balzac dans nos générations, et je réponds à Quentin que l’ado naïf en question a parlé plus génialement que quiconque de la naissance du journalisme et de sa corruption, dans Ilusions perdues, et que le dédoublement de l’Auteur en multiples personnages (Lucien, David, d’Arthez, Lousteau, etc.,) incarnant les multiples positions qu’on peut avoir par rapport à la «pure» littérature, à la vogue populaire du feuilleton, à l’usage commercial ou politique de la presse, au putanisme médiatique en train de se développer, etc., sans parler des portraits de femmes qui émaillent le roman – que ce dédoublement fonde un prodigieux roman de l’apprentissage autant qu’une leçon d’éthique artistique sans pareille, etc.QUESTION D’ÂGE. - Comme le relève André Comte-Sponville à propos de Zweig, l’amitié a été l’une des formes d’amour les plus constantes dans la vie de celui-ci, à des hauteurs évoquant la relation de Montaigne et La Boétie, non pas dans le sens d’une amitié amoureuse équivoque (comme d’aucuns n’ont pas manqué de le suggérer à propos de ces deux derniers), mais dans la relation « pure » d’esprits et d’expériences «en phase» que la différence de génération rend le plus souvent problématique.Le tutoiement prématuré et la puérilité des échanges actuels amorcés par l’exaspérant «coucou» font peut-être illusion aux yeux de certains, mais je parle d’autre chose : de l’amitié qui résiste au temps, et pour ma part, dans l’absolu de la relativité amicale, je n’ai guère qu’un ami au monde, que je voussoye depuis bientôt 50 ans, que j’aime comme un bon vieux fauteuil ou comme un chat, un paysage ou un parfum, comme la vie pour ce qu’elle a de meilleur ou comme notre prochaine conversation – tous mes autres amis n’étant en somme que de bons camarades, et c’est déjà beaucoup. Or tous ceux-là ont à peu près mon âge, y compris Quentin qui est aussi « vieux » avant l’âge que je l’étais au sien…Quant aux amies c'est un autre roman, ou le sujet de nouvelles pour Stefan Zweig. LADY L. – Lorsque je lui parle de cette question de l’amitié entre deux mecs d’âge différent, ma bonne amie (que je pourrais aussi appeler mon bon amour) me dit qu’elle est peut-être possible à condition que le plus jeune soit demandeur, puis elle identifie tout de suite G. quand je lui évoque mon seul ami relativement « absolu » de très longue durée (elle pense comme moi que celle-ci est un critère), en me rappelant cependant la fidélité de R. que Maître Jacques, incapable d’amitié vraie pour sa part, taxait de « bon chien » et qui est en effet resté le plus loyal de mes compères depuis les années 80, mon compagnon de route et qui m’appelle « camarade » au téléphone comme si nous étions de vieux cocos du parti rouge.Cela dit, ce n’est qu’avec G. que nous pouvons nous dire «tout», à savoir n’importe quoi ou le contraire, et plus librement aujourd’hui que nous avons tous les deux un demi-pied au ciel…Par ailleurs, le culte de l'amitié n'est pas du tout notre genre, avec Lady L. Nous aimons bien nos amis, faut pas croire, mais faut pas pousser non plus, et Comte-Sponville a sûrement raison en émettant comme un petit doute sur la sublimité pyramidale de l'amitié de La Boétie et Montaigne, lequel en a probablement rajouté un peu comme souvent les écrivains quand ils visent la postérité.Or Montaigne est aussi le bon génie du quotidien. Lady L. revient de son marathon matinal de 500 mètres, jusqu'à la pharmacie holistique et retour avec son déambulateur, notre aide de ménage érythréenne débarque à l'heure pile et nous raconte les débuts du petit chien qu'elle a adopté tandis que Snoopy me regarde par en dessous avec son air de victime genre Le Chien de Columbo quand il réclame son Biscuit, donc la vie continue, mon palpitant refait des siennes mais là je vais me faire, calmos, le prochain épisode de Bosch où j'espère qu'on va passer les bracelets à l'affreux Carl Rogers et rendre justice à la petite Sonia Hernandez défuntée dans l'incendie criminel visant à déloger ces blattes d'immigrés, etc. (Ce lundi 2 août)
LADY L. – Lorsque je lui parle de cette question de l’amitié entre deux mecs d’âge différent, ma bonne amie (que je pourrais aussi appeler mon bon amour) me dit qu’elle est peut-être possible à condition que le plus jeune soit demandeur, puis elle identifie tout de suite G. quand je lui évoque mon seul ami relativement « absolu » de très longue durée (elle pense comme moi que celle-ci est un critère), en me rappelant cependant la fidélité de R. que Maître Jacques, incapable d’amitié vraie pour sa part, taxait de « bon chien » et qui est en effet resté le plus loyal de mes compères depuis les années 80, mon compagnon de route et qui m’appelle « camarade » au téléphone comme si nous étions de vieux cocos du parti rouge.Cela dit, ce n’est qu’avec G. que nous pouvons nous dire «tout», à savoir n’importe quoi ou le contraire, et plus librement aujourd’hui que nous avons tous les deux un demi-pied au ciel…Par ailleurs, le culte de l'amitié n'est pas du tout notre genre, avec Lady L. Nous aimons bien nos amis, faut pas croire, mais faut pas pousser non plus, et Comte-Sponville a sûrement raison en émettant comme un petit doute sur la sublimité pyramidale de l'amitié de La Boétie et Montaigne, lequel en a probablement rajouté un peu comme souvent les écrivains quand ils visent la postérité.Or Montaigne est aussi le bon génie du quotidien. Lady L. revient de son marathon matinal de 500 mètres, jusqu'à la pharmacie holistique et retour avec son déambulateur, notre aide de ménage érythréenne débarque à l'heure pile et nous raconte les débuts du petit chien qu'elle a adopté tandis que Snoopy me regarde par en dessous avec son air de victime genre Le Chien de Columbo quand il réclame son Biscuit, donc la vie continue, mon palpitant refait des siennes mais là je vais me faire, calmos, le prochain épisode de Bosch où j'espère qu'on va passer les bracelets à l'affreux Carl Rogers et rendre justice à la petite Sonia Hernandez défuntée dans l'incendie criminel visant à déloger ces blattes d'immigrés, etc. (Ce lundi 2 août) -
Le Temps accordé
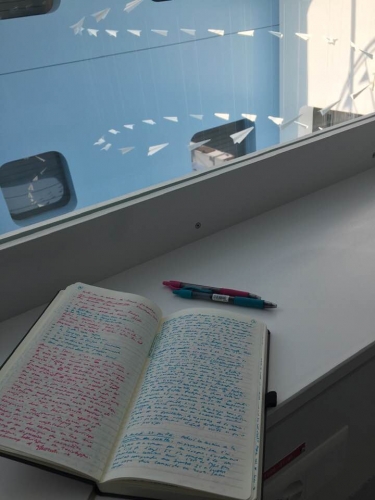 (Lectures du monde, 2021)« GARDE ÇA POUR TOI ! ». – Je n’ai pas besoin qu’L. me le recommande : cela va pour ainsi dire de soi, et disons que ça se précise et s’accentue avec l’expérience et la sensibilité de l’âge vu que ça m’est arrivé, plus souvent qu’on mon tour, de chiffonner certains (j’entends : certaines et certains) dans mes carnets publiés sans user d’initiales (je trouve ça un peu hypocrite, quand l’écrivain G.H. dégomme son pair sous les initiales de N.B.) ou en jouant de clefs et de périphrases, mais je souscris de plus en plus à la discrétion, malgré l’évidente indiscrétion que suppose toute publication, et donc je ne parlerai pas du dernier rapport de l’oncologue grec S.P. ni du personnage en question, de ce qui nous est tombé dessus en avril dernier par décret fatal et avec un raffinement dans la cruauté intéressant la Recherche jusqu’à Singapour, ni de ce que j’observe et note au fil de toutes nos conversations avec nos amies Josyane (prénom fictif) et Héloïse, qui en «savent un bout» en tant que pros de la soignance palliative.Cela étant, je ne crois pas être indélicat en précisant qu’un début de sympathie personnelle est née entre nous et le jeune spécialiste barbu/masqué aux yeux et aux rondeurs de grand ourson, auquel j’ai appris l’autre jour que son prénom de Sotiros n’était porté que par 2555 personnes «au monde», selon Wikipedia, ce qui l’a fait rire en ajoutant que sa région seule en comptait déjà une floppée…LE TRAÎTRE. – Le scribe usant de l’autofiction, ou publiant son «journal» de son vivant, se trouve potentiellement dans la situation d’un ennemi par rapport à son milieu ou à sa famille, rappelle Martin Amis dans l’espèce de roman sciemment autobiographique que constitue Inside story, où il aborde la question de l’autofiction à propos de Kingsley, son père fameux, et de son ami Saul Bellow, mais lui-même est du genre assez retors pour que son récit soit bel et bien un roman par l’espace qu’il ouvre et l’usage "en abyme" très inventif qu’il fait de ses personnages, à commencer par la figure épique de Christopher Hitchens, et Nabokov dont il va relancer la veuve, de Philip Roth et de Ian McEwan qu’il tutoie, etc.L’écrivain sérieux étant fondamentalement un espion et un agent double, la seule question à résoudre pour lui en la matière, sans parler des imprudences ou des provocations idiotes intéressant les occurrences judiciaires de bas étage qui alimentent les médias actuels, est celle du respect humain, mais quel amateur sincère de littérature voudrait se priver des pages de Paul Léautaud au chevet de son père qu’il observe en train de «décéder un peu plus », à cela près que le défunt n’est plus de ce monde au moment de la parution d’In memoriam, sûrement le plus saisissant de ses livres du point de vue émotionnel, comme Julien Green a interdit que son journal intégral fût publié avant un quart de siècle suivant sa mort et celle de ses proches.En ce qui me concerne, et dès ma jeunesse de lecteur, j’ai été très attiré par les « journaliers » d’écrivains (l’expression est de Jouhandeau) avant de rédiger et de publier des carnets, et la façon de Jouhandeau, précisément, de parler de son Elise, devenue mythique, à laquelle l’attache un «lien de ronces», m’apparaît comme une sorte de parangon de ce qu’on peut faire quand on a, en se gardant de la muflerie, le style pour sublimer le premier degré du caquetage quotidien.Certains en jugent sévèrement, comme Chardonne et Morand assimilant les journaliers de Jouhandeau à «du pipi », mais les meilleurs auteurs sont parfois les moins avisés pour juger leurs confrères d’une autre espèce, comme l’a prouvé Nabokov en radotant pas mal à propos de Faulkner ou de Dostoïevski...Souvenirs persos : après la parution de Lionel Asbo ou l'état de l'Angleterre, roman qu’on pourrait dire punkoïde de celui que les publicitaires ont appelé le Mick Jagger de la littérature anglaise, ayant pris rendez-vous avec Martin Amis, que j’imaginais un grand mec efflanqué à rictus, je retrouve un mince dandy plutôt court sur pattes et en joli pardessus demi-saison (il pleuvote au jardin du Luxembourg) que je fais rire en lui racontant je ne sais plus quoi à propos de Wyndham Lewis ou d’Ivy Compton-Burnett dont nous parlons comme de vieilles demoiselles lettrées en nous abritant ensuite sous mon grand parapluie quand la pluie parisienne se met à tambouriner, peut-être en évoquant aussi Somerset Maugham sirotant un drink sous un grand tulipier ou G.K. Chesterton libérant trois places dans le bus en levant son vaste derrière ; et de Jouhandeau je ne me rappelle que les mots de sa première lettre, quand j’avais quand même vingt-deux ans et des poussières et qu’il m’appelait, au premier jour de l’an 1970, « mon enfant »…
(Lectures du monde, 2021)« GARDE ÇA POUR TOI ! ». – Je n’ai pas besoin qu’L. me le recommande : cela va pour ainsi dire de soi, et disons que ça se précise et s’accentue avec l’expérience et la sensibilité de l’âge vu que ça m’est arrivé, plus souvent qu’on mon tour, de chiffonner certains (j’entends : certaines et certains) dans mes carnets publiés sans user d’initiales (je trouve ça un peu hypocrite, quand l’écrivain G.H. dégomme son pair sous les initiales de N.B.) ou en jouant de clefs et de périphrases, mais je souscris de plus en plus à la discrétion, malgré l’évidente indiscrétion que suppose toute publication, et donc je ne parlerai pas du dernier rapport de l’oncologue grec S.P. ni du personnage en question, de ce qui nous est tombé dessus en avril dernier par décret fatal et avec un raffinement dans la cruauté intéressant la Recherche jusqu’à Singapour, ni de ce que j’observe et note au fil de toutes nos conversations avec nos amies Josyane (prénom fictif) et Héloïse, qui en «savent un bout» en tant que pros de la soignance palliative.Cela étant, je ne crois pas être indélicat en précisant qu’un début de sympathie personnelle est née entre nous et le jeune spécialiste barbu/masqué aux yeux et aux rondeurs de grand ourson, auquel j’ai appris l’autre jour que son prénom de Sotiros n’était porté que par 2555 personnes «au monde», selon Wikipedia, ce qui l’a fait rire en ajoutant que sa région seule en comptait déjà une floppée…LE TRAÎTRE. – Le scribe usant de l’autofiction, ou publiant son «journal» de son vivant, se trouve potentiellement dans la situation d’un ennemi par rapport à son milieu ou à sa famille, rappelle Martin Amis dans l’espèce de roman sciemment autobiographique que constitue Inside story, où il aborde la question de l’autofiction à propos de Kingsley, son père fameux, et de son ami Saul Bellow, mais lui-même est du genre assez retors pour que son récit soit bel et bien un roman par l’espace qu’il ouvre et l’usage "en abyme" très inventif qu’il fait de ses personnages, à commencer par la figure épique de Christopher Hitchens, et Nabokov dont il va relancer la veuve, de Philip Roth et de Ian McEwan qu’il tutoie, etc.L’écrivain sérieux étant fondamentalement un espion et un agent double, la seule question à résoudre pour lui en la matière, sans parler des imprudences ou des provocations idiotes intéressant les occurrences judiciaires de bas étage qui alimentent les médias actuels, est celle du respect humain, mais quel amateur sincère de littérature voudrait se priver des pages de Paul Léautaud au chevet de son père qu’il observe en train de «décéder un peu plus », à cela près que le défunt n’est plus de ce monde au moment de la parution d’In memoriam, sûrement le plus saisissant de ses livres du point de vue émotionnel, comme Julien Green a interdit que son journal intégral fût publié avant un quart de siècle suivant sa mort et celle de ses proches.En ce qui me concerne, et dès ma jeunesse de lecteur, j’ai été très attiré par les « journaliers » d’écrivains (l’expression est de Jouhandeau) avant de rédiger et de publier des carnets, et la façon de Jouhandeau, précisément, de parler de son Elise, devenue mythique, à laquelle l’attache un «lien de ronces», m’apparaît comme une sorte de parangon de ce qu’on peut faire quand on a, en se gardant de la muflerie, le style pour sublimer le premier degré du caquetage quotidien.Certains en jugent sévèrement, comme Chardonne et Morand assimilant les journaliers de Jouhandeau à «du pipi », mais les meilleurs auteurs sont parfois les moins avisés pour juger leurs confrères d’une autre espèce, comme l’a prouvé Nabokov en radotant pas mal à propos de Faulkner ou de Dostoïevski...Souvenirs persos : après la parution de Lionel Asbo ou l'état de l'Angleterre, roman qu’on pourrait dire punkoïde de celui que les publicitaires ont appelé le Mick Jagger de la littérature anglaise, ayant pris rendez-vous avec Martin Amis, que j’imaginais un grand mec efflanqué à rictus, je retrouve un mince dandy plutôt court sur pattes et en joli pardessus demi-saison (il pleuvote au jardin du Luxembourg) que je fais rire en lui racontant je ne sais plus quoi à propos de Wyndham Lewis ou d’Ivy Compton-Burnett dont nous parlons comme de vieilles demoiselles lettrées en nous abritant ensuite sous mon grand parapluie quand la pluie parisienne se met à tambouriner, peut-être en évoquant aussi Somerset Maugham sirotant un drink sous un grand tulipier ou G.K. Chesterton libérant trois places dans le bus en levant son vaste derrière ; et de Jouhandeau je ne me rappelle que les mots de sa première lettre, quand j’avais quand même vingt-deux ans et des poussières et qu’il m’appelait, au premier jour de l’an 1970, « mon enfant »…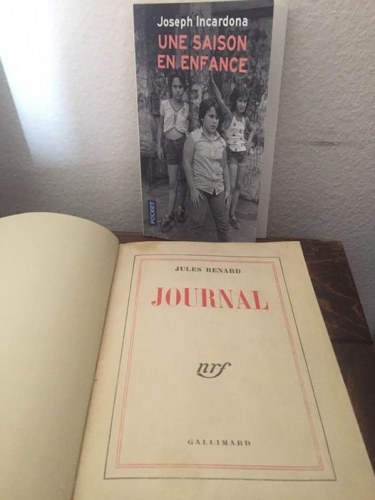 UN MEC SÉRIEUX. – C’est ce que je me suis dit de Joseph Incardona après avoir lu La soustraction des possibles : sérieux.Se jouant d’un genre clinquant qui souvent ne relève que de l’habile fabrique, alors qu’il y a là un Mensch en souterrain, un type de cœur et une voix.Sur quoi, lisant Une saison en enfance, dont je cite des passages entiers à Lady L., à commencer par l’incipit (« Mon père avait perdu son travail, et il fallait à nouveau déménager »), je me dis : un garçon bien, loyal, réglo, dont chaque mot est vécu et pesé sans peser dans le pathos, qui parle bien de sa mère et bien de son père dont il comprend les affrontements qu’il subit et qui le font grandir, un véritable écrivain dont la probité faussement sèche me rappelle Jules Renard dans un tout autre biotope (son arrivée en Sicile avec ses parents, chez le nonno et la nonna, est un morceau d’anthologie), avec cette phrase que me citait un soir Dimitri comme exemple de la parfaite économie poétique, derniers mots du Journal que je relis sans discontinuer sur l’exemplaire que le même Dimitri m’a filé, annoté par Albert Caraco qui l’avait fait relier pour sa bibliothèque, édition 1935 de la NRF – c’est le 6 avril 1910, il a 46 ans et s’éteindra le 22 mai : « Je veux me lever. Cette nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu’il arrive au talon pour que je me décide. Ca séchera dans les draps, comme quand j’étais Poil de carotte »…
UN MEC SÉRIEUX. – C’est ce que je me suis dit de Joseph Incardona après avoir lu La soustraction des possibles : sérieux.Se jouant d’un genre clinquant qui souvent ne relève que de l’habile fabrique, alors qu’il y a là un Mensch en souterrain, un type de cœur et une voix.Sur quoi, lisant Une saison en enfance, dont je cite des passages entiers à Lady L., à commencer par l’incipit (« Mon père avait perdu son travail, et il fallait à nouveau déménager »), je me dis : un garçon bien, loyal, réglo, dont chaque mot est vécu et pesé sans peser dans le pathos, qui parle bien de sa mère et bien de son père dont il comprend les affrontements qu’il subit et qui le font grandir, un véritable écrivain dont la probité faussement sèche me rappelle Jules Renard dans un tout autre biotope (son arrivée en Sicile avec ses parents, chez le nonno et la nonna, est un morceau d’anthologie), avec cette phrase que me citait un soir Dimitri comme exemple de la parfaite économie poétique, derniers mots du Journal que je relis sans discontinuer sur l’exemplaire que le même Dimitri m’a filé, annoté par Albert Caraco qui l’avait fait relier pour sa bibliothèque, édition 1935 de la NRF – c’est le 6 avril 1910, il a 46 ans et s’éteindra le 22 mai : « Je veux me lever. Cette nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu’il arrive au talon pour que je me décide. Ca séchera dans les draps, comme quand j’étais Poil de carotte »… À L’ISBA. – Avant les pétards des connards du soir, prenant le relais des explosions de clapets des moteurs de cylindrées gonflées des petits merdeux mal rasés de fins de semaine sous nos fenêtres, nous prenons la tangente, avec le sieur Snoopy, pour les hauteurs où nous nous retrouvons dans les hautes herbes non broutées des alentours de mon isba d’été (notre ami Pascal a décalé la montée des bestioles pour je ne sais quelle raison…), et là je constate, dans l’odeur sèche et un peu merdeuse de renfermé, qu’un Animal - probable descendant des loirs que j’ai délogés à La Désirade, à deux cents mètres de là sur la même courbe de niveau, pour les recycler en ce lieu plus sauvage – s’est exercé les canines sur un bouchon de bouteille de thé froid Naturaplan avant de s’attaquer au coin de cuir de Russie du fauteuil d’Oblomov et à ses bases de bois dont il a émietté une partie ; et je me promets d’y revenir avec les ustensiles de nettoyage adéquats, mais dans l’immédiat je retrouve, sur ma table, l’exemplaire dédicacé, par Roberto Calasso, d’un livre typique de sa manière de grand rêveur érudit, lui qui vient de nous quitter à ce que m’a appris l’autre jour la Professorella ; et quart d’heure plus tard, après avoir un peu aéré et refermé mon antre, Snoopy ayant filé entre temps à mon insu mais je sais où : droit à la Désirade où je surprends, dans leur capharnaüm inimaginable de jouets et de livres et de fringues empilées – la vraie maison du bonheur de Mamma Helvetia Bordelica - , notre Loyse (prénom de rechange pour publication) et son Larry + les deux tourbillons qui ne contribuent pas peu, avec Lady L. , à nous retenir du coté de la vie, etc.DANS SES BRAS. – Je reviens ce matin à Metin en reprenant son roman « théopoétique », comme dirait Peter Sloterdijk, et de retrouver son image de « Petit Paradis », à la première page de L’homme qui peignait les âmes, me fait dire à Lady L. que c’est ça que nous allons arranger au bas de la prairie de la Désirade, à côté de l’épine noire où «reposent» déjà les cendres de Katia : un petit mausolée style Chine ancienne où se retrouveront les cendres de Philip et les nôtres à nous, celles de nos gendres s’ils sont d’accord, de nos filles et de leurs enfants vers la fin du siècle ou peut-être même après, sait-on avec le complot transhumaniste qui se prépare.Mais ce qui compte plus en l’occurrence, ce sont les bras de ma bonne amie, bien vivants à côté de moi, sa peau plus douce que celle d’un enfant de lait (le plus souvent un peu trop molle, sur un bras trop court pour y allonger sa tendresse), et comme nous nous le disons tous les jours depuis que la Bête a commencé de nous menacer de ses pinces et que nous emmerdons en attendant: de moment en moment… (Ce dimanche 1er août)
À L’ISBA. – Avant les pétards des connards du soir, prenant le relais des explosions de clapets des moteurs de cylindrées gonflées des petits merdeux mal rasés de fins de semaine sous nos fenêtres, nous prenons la tangente, avec le sieur Snoopy, pour les hauteurs où nous nous retrouvons dans les hautes herbes non broutées des alentours de mon isba d’été (notre ami Pascal a décalé la montée des bestioles pour je ne sais quelle raison…), et là je constate, dans l’odeur sèche et un peu merdeuse de renfermé, qu’un Animal - probable descendant des loirs que j’ai délogés à La Désirade, à deux cents mètres de là sur la même courbe de niveau, pour les recycler en ce lieu plus sauvage – s’est exercé les canines sur un bouchon de bouteille de thé froid Naturaplan avant de s’attaquer au coin de cuir de Russie du fauteuil d’Oblomov et à ses bases de bois dont il a émietté une partie ; et je me promets d’y revenir avec les ustensiles de nettoyage adéquats, mais dans l’immédiat je retrouve, sur ma table, l’exemplaire dédicacé, par Roberto Calasso, d’un livre typique de sa manière de grand rêveur érudit, lui qui vient de nous quitter à ce que m’a appris l’autre jour la Professorella ; et quart d’heure plus tard, après avoir un peu aéré et refermé mon antre, Snoopy ayant filé entre temps à mon insu mais je sais où : droit à la Désirade où je surprends, dans leur capharnaüm inimaginable de jouets et de livres et de fringues empilées – la vraie maison du bonheur de Mamma Helvetia Bordelica - , notre Loyse (prénom de rechange pour publication) et son Larry + les deux tourbillons qui ne contribuent pas peu, avec Lady L. , à nous retenir du coté de la vie, etc.DANS SES BRAS. – Je reviens ce matin à Metin en reprenant son roman « théopoétique », comme dirait Peter Sloterdijk, et de retrouver son image de « Petit Paradis », à la première page de L’homme qui peignait les âmes, me fait dire à Lady L. que c’est ça que nous allons arranger au bas de la prairie de la Désirade, à côté de l’épine noire où «reposent» déjà les cendres de Katia : un petit mausolée style Chine ancienne où se retrouveront les cendres de Philip et les nôtres à nous, celles de nos gendres s’ils sont d’accord, de nos filles et de leurs enfants vers la fin du siècle ou peut-être même après, sait-on avec le complot transhumaniste qui se prépare.Mais ce qui compte plus en l’occurrence, ce sont les bras de ma bonne amie, bien vivants à côté de moi, sa peau plus douce que celle d’un enfant de lait (le plus souvent un peu trop molle, sur un bras trop court pour y allonger sa tendresse), et comme nous nous le disons tous les jours depuis que la Bête a commencé de nous menacer de ses pinces et que nous emmerdons en attendant: de moment en moment… (Ce dimanche 1er août) -
Le Temps accordé
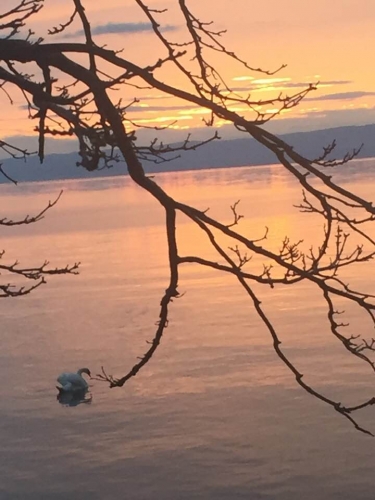 (Lectures du monde, 2021)LA CHÈVRE. – Ce rêve du plus pur kitsch surréaliste que j’ai fait à la fin de cette nuit m’a intéressé par l’amalgame de ses images et leur relance non moins délirante, au lendemain des festivités non moins insolites d’hier soir sous nos fenêtres...Le rêve : je marche sur le trottoir de gauche d’une rue ascendante, bientôt dépassé, sur le trottoir de droite, par Frédéric Maire qui me propose de le suivre au château, là-haut sur une falaise de calcaire ocre clair qui me rappelle celles du Mormont – le fameux Mormont qui a fait «parler de lui» récemment dans les médias en suite de l’action des zadistes opposés à l’exploitation de ses ressources par la firme bétonnière HOLCIM, et parvenu au château Frédéric me prie de l’aider à recoller la tête d’une chèvre de pierre au socle d’un monument célébrant la réconciliation socialo-communiste ; or cela tombe bien car j’ai gardé sur moi, de mes pioches de la veille dans le galetas où nous avons rangé les affaires et les livres de Philip Seelen après sa mort subite, un tube de colle UHU Max Repare Extreme, dont l’effet siccatif est immédiat; sur quoi Frédéric me remercie de sa voix que j’ai toujours appréciée, soit de près sur la terrasse du restau Da Luigi, à Locarno, soit de loin quand il se pointait, minuscule silhouette en chemise blanche à manches courtes, sur la scène de la Piazza Grande où nous avons bien des souvenirs communs, mais aucun qui se rapportât à une chèvre ou au socialisme à visages divers ; enfin je définirai cette voix par l’adjectif juvénile.Oui, et la voix juvénile de Frédéric, l’actuel directeur de la Cinémathèque suisse, va de pair avec son regard d’une fraîcheur presque enfantine de cinéphile resté capable d’enthousiasme que je me rappelle même en rêve, mais pourquoi cette chèvre ?DÉCALAGE. – À propos d’enthousiasme, il en a manqué à la petite foule de jeunes gens en tenues multicolores de coureurs réunis hier soir sur la place du marché au bas de laquelle Freddie Mercury n’en finit pas de jeter un bras de bronze au ciel, et qu’un animateur vociférant incitait à répéter We are the world en même temps qu’un orchestre aussi sommaire que bruyant assenait les trois coups répétitifs de la scie fameuse ; mais ça avait beau s’appeler Freddie’s Night, préludant conjointement au départ du Mountain Cross de toute la jolie bande convoquée au Tour des Alpes: celle-ci ne songeait qu’à sautiller sur place et multiplier les exercices préparatoires de stretching tandis que, souriant avec certaine mélancolie, Lady L. et moi passions sans trop nous attarder, elle avec son déambulateur et moi avec mes douleurs articulaires, chacun se rappelant peut-être ces années non moins festives où nous étions de semblables gazelles des pierriers…
(Lectures du monde, 2021)LA CHÈVRE. – Ce rêve du plus pur kitsch surréaliste que j’ai fait à la fin de cette nuit m’a intéressé par l’amalgame de ses images et leur relance non moins délirante, au lendemain des festivités non moins insolites d’hier soir sous nos fenêtres...Le rêve : je marche sur le trottoir de gauche d’une rue ascendante, bientôt dépassé, sur le trottoir de droite, par Frédéric Maire qui me propose de le suivre au château, là-haut sur une falaise de calcaire ocre clair qui me rappelle celles du Mormont – le fameux Mormont qui a fait «parler de lui» récemment dans les médias en suite de l’action des zadistes opposés à l’exploitation de ses ressources par la firme bétonnière HOLCIM, et parvenu au château Frédéric me prie de l’aider à recoller la tête d’une chèvre de pierre au socle d’un monument célébrant la réconciliation socialo-communiste ; or cela tombe bien car j’ai gardé sur moi, de mes pioches de la veille dans le galetas où nous avons rangé les affaires et les livres de Philip Seelen après sa mort subite, un tube de colle UHU Max Repare Extreme, dont l’effet siccatif est immédiat; sur quoi Frédéric me remercie de sa voix que j’ai toujours appréciée, soit de près sur la terrasse du restau Da Luigi, à Locarno, soit de loin quand il se pointait, minuscule silhouette en chemise blanche à manches courtes, sur la scène de la Piazza Grande où nous avons bien des souvenirs communs, mais aucun qui se rapportât à une chèvre ou au socialisme à visages divers ; enfin je définirai cette voix par l’adjectif juvénile.Oui, et la voix juvénile de Frédéric, l’actuel directeur de la Cinémathèque suisse, va de pair avec son regard d’une fraîcheur presque enfantine de cinéphile resté capable d’enthousiasme que je me rappelle même en rêve, mais pourquoi cette chèvre ?DÉCALAGE. – À propos d’enthousiasme, il en a manqué à la petite foule de jeunes gens en tenues multicolores de coureurs réunis hier soir sur la place du marché au bas de laquelle Freddie Mercury n’en finit pas de jeter un bras de bronze au ciel, et qu’un animateur vociférant incitait à répéter We are the world en même temps qu’un orchestre aussi sommaire que bruyant assenait les trois coups répétitifs de la scie fameuse ; mais ça avait beau s’appeler Freddie’s Night, préludant conjointement au départ du Mountain Cross de toute la jolie bande convoquée au Tour des Alpes: celle-ci ne songeait qu’à sautiller sur place et multiplier les exercices préparatoires de stretching tandis que, souriant avec certaine mélancolie, Lady L. et moi passions sans trop nous attarder, elle avec son déambulateur et moi avec mes douleurs articulaires, chacun se rappelant peut-être ces années non moins festives où nous étions de semblables gazelles des pierriers… SANTO STUPENDO. – Au hasard d’une recherche documentaire sur la Toile, je tombe sur trois pages, dans la version numérique du Magazine de la Migros surtout dévolu à la gastro de base et au développement personnel de la ménagère helvétique moyenne, consacrées à un ado italien du nom de Carlo Acutis, notable adepte de foot et des Pokémon, béatifié post mortem en octobre 2020 après avoir diffusé la Bonne Parole sur la Toile, qui affirmait notamment que l’euchariste est «une autoroute vers le ciel », et dont l’élévation au rang de saint patron d’Internet reste dépendant d’un second miracle à venir.De fait, si Carlo, mort à quinze ans de leucémie en 2006, a été béatifié par Sa Sainteté Francesco, c’est grâce à ce premier miracle qu’a été la guérison d’un jeune Brésilien malade du pancréas et dont les proches ont adressé une prière spéciale à l’âme de Carlo.Sur quoi je me dis que nous allons proposer, à quelque âme pieuse de notre connaissance, de procéder à la même oraison spéciale afin, d’une pierre deux coups, de délivrer ma bonne amie de sa Bête affreuse et, le miracle advenant, de hisser le beato Carlo au statut de sainteté qu'il mérite...QUESTION DE FIERTÉ. – J’ai manqué de tact aujourd’hui en proposant une nouvelle fois à Lady L., au moment de descendre sur les quais pour notre balade du soir, de se coiffer d’un foulard, mais j’aurais dû me rappeler que, déjà, elle avait exclu le port d’un postiche après la perte annoncée de ses cheveux, et mon insistance maladroite l’a blessée, mais moi aussi ça me blesse, merde, de la voir ainsi, de la savoir en prise à cette salope de Bête et de ne pouvoir rien faire - ceci dit je lui donne raison, c’est ça, on s’en fout des gens, tu es belle comme ça, t’as raison d’être fière de ta tête, sacrée caboche, d’ailleurs moi aussi j’ai l’air d’un oiseau déplumé et de toute façon qui nous remarque dans les vestiges du soir, etc. (Ce dimanche 25 juillet)
SANTO STUPENDO. – Au hasard d’une recherche documentaire sur la Toile, je tombe sur trois pages, dans la version numérique du Magazine de la Migros surtout dévolu à la gastro de base et au développement personnel de la ménagère helvétique moyenne, consacrées à un ado italien du nom de Carlo Acutis, notable adepte de foot et des Pokémon, béatifié post mortem en octobre 2020 après avoir diffusé la Bonne Parole sur la Toile, qui affirmait notamment que l’euchariste est «une autoroute vers le ciel », et dont l’élévation au rang de saint patron d’Internet reste dépendant d’un second miracle à venir.De fait, si Carlo, mort à quinze ans de leucémie en 2006, a été béatifié par Sa Sainteté Francesco, c’est grâce à ce premier miracle qu’a été la guérison d’un jeune Brésilien malade du pancréas et dont les proches ont adressé une prière spéciale à l’âme de Carlo.Sur quoi je me dis que nous allons proposer, à quelque âme pieuse de notre connaissance, de procéder à la même oraison spéciale afin, d’une pierre deux coups, de délivrer ma bonne amie de sa Bête affreuse et, le miracle advenant, de hisser le beato Carlo au statut de sainteté qu'il mérite...QUESTION DE FIERTÉ. – J’ai manqué de tact aujourd’hui en proposant une nouvelle fois à Lady L., au moment de descendre sur les quais pour notre balade du soir, de se coiffer d’un foulard, mais j’aurais dû me rappeler que, déjà, elle avait exclu le port d’un postiche après la perte annoncée de ses cheveux, et mon insistance maladroite l’a blessée, mais moi aussi ça me blesse, merde, de la voir ainsi, de la savoir en prise à cette salope de Bête et de ne pouvoir rien faire - ceci dit je lui donne raison, c’est ça, on s’en fout des gens, tu es belle comme ça, t’as raison d’être fière de ta tête, sacrée caboche, d’ailleurs moi aussi j’ai l’air d’un oiseau déplumé et de toute façon qui nous remarque dans les vestiges du soir, etc. (Ce dimanche 25 juillet) DORÉNAVANT. - Reprenant la lecture d’un petit recueil de morceaux choisis tirés des Essais de Montaigne, je tombe sur ce fragment amorcé par le mot dorénavant, qui se rapporte au vieillissement du corps et à l’altération de ses facultés, lui qui se voit «engagé dans les avenues de la vieillesse», et plus précisément: « ce que je serai dorénavant, ce ne sera plus qu’un demi-être, ce ne sera plus moi. Je m’échappe tous les jours , et me dérobe à moi »Et forcément cela me rappelle ce que me disait Lady L. l’autre jour rapport à son propre corps, comme quoi celui-ci lui devient étranger, tout comme l’exprimait aussi notre cher Thierry dans ses carnets, lui que j’ai vu si cruellement atteint dans son intégrité physique et continuer malgré tout, jusque sur son lit de mourant, à rendre grâces à la beauté du monde. Ainsi : «Quand son corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme ».Et cela enfin : « « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».Peinture : Thierry Vernet
DORÉNAVANT. - Reprenant la lecture d’un petit recueil de morceaux choisis tirés des Essais de Montaigne, je tombe sur ce fragment amorcé par le mot dorénavant, qui se rapporte au vieillissement du corps et à l’altération de ses facultés, lui qui se voit «engagé dans les avenues de la vieillesse», et plus précisément: « ce que je serai dorénavant, ce ne sera plus qu’un demi-être, ce ne sera plus moi. Je m’échappe tous les jours , et me dérobe à moi »Et forcément cela me rappelle ce que me disait Lady L. l’autre jour rapport à son propre corps, comme quoi celui-ci lui devient étranger, tout comme l’exprimait aussi notre cher Thierry dans ses carnets, lui que j’ai vu si cruellement atteint dans son intégrité physique et continuer malgré tout, jusque sur son lit de mourant, à rendre grâces à la beauté du monde. Ainsi : «Quand son corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme ».Et cela enfin : « « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».Peinture : Thierry Vernet -
Incardona peint en très noir un monde qu’il rêve meilleur
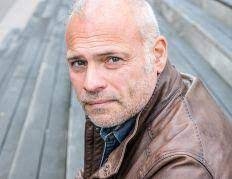
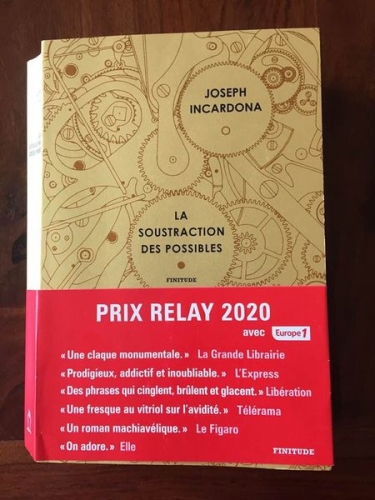 Après Joël Dicker, Quentin Mouron et quelques autres, Joseph Incardona, dans son étonnant dernier roman, La soustraction des possibles, prouve que l’on peut jouer avec les codes et stéréotypes du roman noir ou du thriller d’investigation sociale sans se détourner d’un certain héritage culturel ou littéraire romands, au point de nous faire croire qu’un mafieuse corse puisse s’enticher follement des romans de Ramuz, entre autres intuitions prometteuses…De prime apparence déjà, avec sa «couve» somptueuse, comme dorée à la feuilles, l’image de celle-ci qui évoque les rouages d’une horloge symbolisant à la fois la Suisse ou quelque Mécanisme mondial, et son bandeau publicitaire rouge vif annonçant le Prix Relay 2020 non sans aligner une dizaine d'extraits de critiques, tous dithyrambiques, le dernier roman de l’auteur italo-genevois Joseph Incardona semble jouer gagnant d’avance, pour ainsi dire «incontournable» sinon win-win...Cependant, peu enclin à saliver aux sollicitations pavloviennes des médias, j’aurai tout de même hésité, l’autre jour, avant de faire l’acquisition du présumé chef-d’œuvre de cet auteur romand plus ou moins atypique dont j’avais entendu parler moult fois sans lire une ligne de lui jusque-là, peut-être pour l’avoir «classé polar» à un moment où le genre en question me semblait de plus en plus convenu et d’écriture souvent moyenne voire médiocre, surtout en nos régions…À l’inverse, il y a des années que je me défie, tout autant, de ce qu’on a appelé «l’âme romande» dans notre paroisse littéraire bien grave, avec sa foison de romans pétris d’intériorité conflictuelle et frottés de spiritualité vague; et c’est avec reconnaissance, en tant que chroniqueur littéraire, que j’aurai salué, dès les années 2000, l’apparition de nouveaux auteurs à dégaine d’«électrons libres» , tels un Marius Daniel Popescu ou un Quentin Mouron, ou de formes narratives plus dynamiques, comme l’a illustré L’Amour nègre d’un Jean-Michel Olivier, avant l’apparition «phénoménale» d’un Joël Dicker que d’aucuns s’obstinent à regarder de haut, comme ils dédaignent le talent de conteur d’un Metin Arditi, etc.«En présence de la réalité»…À la fin des année 70, l’éditeur Vladimir Dimitrijevic publia, dans La Gazette de Lausanne, une tribune libre dans laquelle il déplorait que la littérature romande ne comptât pas l’ombre d’un Zola, reprochant en somme à nos écrivains de ne pas rendre suffisamment compte de la réalité sociale de ce pays, à tous les étages de la société, alors même que beaucoup d’entre eux se prétendaient «engagés» ou soucieux de «problèmes sociaux».Or, en dépit de l’exagération du constat, faisant peu de cas de certaines œuvres (notamment féminines) qui parlaient bel et bien de la société, de ses conflits externes et de ses tensions internes, il y avait du vrai dans cette observation qu’on peut d’ailleurs rapporter à la littérature helvétique dans son ensemble, jusque dans ses zones les plus urbanisées – un Hugo Loetscher, à Zurich, me fit d’ailleurs une remarque analogue.Cela pour dire quoi ? Que c’est bel et bien, ici et là, par le roman policier, en Suisse allemande avec un Dürrenmatt ou un Glauser, et en Suisse romande, beaucoup plus récemment, avec un Marc Voltenauer et un Nicolas Feuz – tout au moins dans leurs premiers ouvrages -, qu’un début de réalisme social, modulé par des personnages et des situations significatives, a esquissé le portrait de telle ou telle partie de notre société.C’est aussi l’un des mérites de La soustraction des possibles de Joseph Incardona, s’agissant du milieu genevois des affaires et des banques, non tant dans un reportage rigoureusement fouillé que dans une histoire d’amour à la fois conventionnelle en apparence (le feuilleton) et complexe (comme entre les lignes, l’essai pénétrant sur les motivations humaines gouvernées par l’argent), aux personnages très bien dessinés et à la dramaturgie puissamment orchestrée.
Après Joël Dicker, Quentin Mouron et quelques autres, Joseph Incardona, dans son étonnant dernier roman, La soustraction des possibles, prouve que l’on peut jouer avec les codes et stéréotypes du roman noir ou du thriller d’investigation sociale sans se détourner d’un certain héritage culturel ou littéraire romands, au point de nous faire croire qu’un mafieuse corse puisse s’enticher follement des romans de Ramuz, entre autres intuitions prometteuses…De prime apparence déjà, avec sa «couve» somptueuse, comme dorée à la feuilles, l’image de celle-ci qui évoque les rouages d’une horloge symbolisant à la fois la Suisse ou quelque Mécanisme mondial, et son bandeau publicitaire rouge vif annonçant le Prix Relay 2020 non sans aligner une dizaine d'extraits de critiques, tous dithyrambiques, le dernier roman de l’auteur italo-genevois Joseph Incardona semble jouer gagnant d’avance, pour ainsi dire «incontournable» sinon win-win...Cependant, peu enclin à saliver aux sollicitations pavloviennes des médias, j’aurai tout de même hésité, l’autre jour, avant de faire l’acquisition du présumé chef-d’œuvre de cet auteur romand plus ou moins atypique dont j’avais entendu parler moult fois sans lire une ligne de lui jusque-là, peut-être pour l’avoir «classé polar» à un moment où le genre en question me semblait de plus en plus convenu et d’écriture souvent moyenne voire médiocre, surtout en nos régions…À l’inverse, il y a des années que je me défie, tout autant, de ce qu’on a appelé «l’âme romande» dans notre paroisse littéraire bien grave, avec sa foison de romans pétris d’intériorité conflictuelle et frottés de spiritualité vague; et c’est avec reconnaissance, en tant que chroniqueur littéraire, que j’aurai salué, dès les années 2000, l’apparition de nouveaux auteurs à dégaine d’«électrons libres» , tels un Marius Daniel Popescu ou un Quentin Mouron, ou de formes narratives plus dynamiques, comme l’a illustré L’Amour nègre d’un Jean-Michel Olivier, avant l’apparition «phénoménale» d’un Joël Dicker que d’aucuns s’obstinent à regarder de haut, comme ils dédaignent le talent de conteur d’un Metin Arditi, etc.«En présence de la réalité»…À la fin des année 70, l’éditeur Vladimir Dimitrijevic publia, dans La Gazette de Lausanne, une tribune libre dans laquelle il déplorait que la littérature romande ne comptât pas l’ombre d’un Zola, reprochant en somme à nos écrivains de ne pas rendre suffisamment compte de la réalité sociale de ce pays, à tous les étages de la société, alors même que beaucoup d’entre eux se prétendaient «engagés» ou soucieux de «problèmes sociaux».Or, en dépit de l’exagération du constat, faisant peu de cas de certaines œuvres (notamment féminines) qui parlaient bel et bien de la société, de ses conflits externes et de ses tensions internes, il y avait du vrai dans cette observation qu’on peut d’ailleurs rapporter à la littérature helvétique dans son ensemble, jusque dans ses zones les plus urbanisées – un Hugo Loetscher, à Zurich, me fit d’ailleurs une remarque analogue.Cela pour dire quoi ? Que c’est bel et bien, ici et là, par le roman policier, en Suisse allemande avec un Dürrenmatt ou un Glauser, et en Suisse romande, beaucoup plus récemment, avec un Marc Voltenauer et un Nicolas Feuz – tout au moins dans leurs premiers ouvrages -, qu’un début de réalisme social, modulé par des personnages et des situations significatives, a esquissé le portrait de telle ou telle partie de notre société.C’est aussi l’un des mérites de La soustraction des possibles de Joseph Incardona, s’agissant du milieu genevois des affaires et des banques, non tant dans un reportage rigoureusement fouillé que dans une histoire d’amour à la fois conventionnelle en apparence (le feuilleton) et complexe (comme entre les lignes, l’essai pénétrant sur les motivations humaines gouvernées par l’argent), aux personnages très bien dessinés et à la dramaturgie puissamment orchestrée. Première surprise : c’est à Charles-Ferdinand Ramuz que l’auteur emprunte l’un de ses exergues : « Comme tout est clair pourtant, quand on consent à se mettre en présence de la réalité». Et c’est dans la clarté d’une sorte d’immanence hyperréaliste que nous voyons surgir, raquette en main, le prof de tennis trentenaire Aldo Bianchi, secundo italo-suisse comme l’auteur, Rastignac de modeste extraction qui, d’abord gigolo de la femme, prénommée Odile et en début de retour d’âge, d’un homme d’affaires du nom de René Langlois, lancé dans la commercialisation des OGM (nous sommes en 1989 et le bloc de l’Est va bientôt «intéresser» les banques suisses), pour s’allier ensuite à la non moins ambitieuse Svetlana, transfuge tchèque occupant un haut rang à l’UBS de Genève, pour une passion amoureuse de «pirates» à la Bonnie & Clyde, ou Sailor et Lula, en plus touchants.Bien campés physiquement et psychologiquement, les personnages du roman se déplacent sur des territoires et dans des décors qui font l’objet de véritables «tours du propriétaire», avec foison de détails, que ce soit pour décrire les origines du parc des Eaux-Vives devenu haut-lieu de tennis (avec une digression sur la fondation du tunnel du Gothard et le rôle particulier d’un Louis Favre en capitaliste cynique), les belles demeures de Cologny et les souterrains de l’UBS, tel club libertin ou telle prison lyonnaise aux mœurs infernales, tel alpage corse où un parrain de la mafia locale trait sa chèvre auprès d’une enfant handicapée, ou tel salon des Port-Francs de Genève où transitent les chefs-d’oeuvre de la peinture, dont une représentation du Grammont par Ferdinand Hodler - le même que j’entrevois de ma fenêtre à l’instant de rédiger ces lignes, etc.Entre réalité et fantasmes, kitsch et poésieEn invoquant la «réalité», Ramuz n’en appelait pas à une littérature de reportage ou de témoignage au premier degré, réservée au journalisme, à l’essai ou à ce qu’on appelé plus récemment les «récits de vie». Ramuz n’était pas le Zola désiré de Dimitrijevic, mais un poète du réel et du tragique entré en littérature avec un petit roman déchirant, intitulé Aline, qui n’a pas fait le «buzz» à l’époque mais reste un modèle de probité « poétique », comme le dit d’ailleurs Joseph Incardona à sa façon.Celui-ci, issu de milieu modeste comme une Janine Massard ou une Mireille Kuttel (Piémontaise d’origine dont il faudrait redécouvrir les romans) est un «secundo» ritalo-suisse de la génération d’après 68 (il est né le lendemain, en 69) dont la culture personnelle, littéraire ou philosophique est très mélangée et peu académique. Je ne le connais à vrai dire que par son dernier livre, mais celui-ci en dit long, entre les lignes, et par la voix même de l’auteur qui se pointe au coin de pages comme le malicieux Hitchcok à l’écran…Or que nous montre ce bon Joseph de la réalité suisse «au-dessus de tout soupçon» de notre ami Jean Ziegler ? Rien que nous ne sachions déjà plus ou moins après une flopée de « reportages », précisément, mais sa façon de jouer d’effets de réel, pas loin des procédés d’un Michel Houellebecq, et de rallier le drapeau noir du « mauvais genre » littéraire, constitue sa base logistico-esthétique, avec la vigueur et le savoir d’un grand «pro» qui sait, par ailleurs, ce qui distingue un Ramuz d’un critique de gauche style Niklaus Meienberg, ou un Balzac d’un auteur de polars à la Marc Voltenauer ou à la Nicola Feuz.S’il joue le jeu du genre, Incardona vise plus haut, comme son protagoniste croit «voir grand» en s’imaginant plein aux as et donc tout-puissant. Mais Joseph sait d’avance que son Aldo va se casser la gueule, et de même le feuilleton parfaitement agencé qu’il nous balance n’est-il qu’un moyen de nous dire autre chose, par quoi il rejoint en somme un Georges Halas pointant le «meurtre sous les géraniums», le Ramuz génial de Circonstances de la vie ou de La vie de Samuel Belet, voire le Dürrenmatt de La Promesse «relu » par Sean Penn… Tout cela qui semble très loin du Cercle littéraire lausannois ou de la Société de lecture genevoise, mais qui ressortit néanmoins, «quelque part». à la littérature…L’Avenir étant dans la bonté humaine…Dernier cadeau de la nuit, hier soir, cueilli dans le recueil récemment paru du poète italo-genevois Vince Fasciani : « Je fais partie d’une lignée de gens de peu / qui se sont frayé un passage à travers la bonté ». Tout à fait valable, au fond, pour le sieur Incardona, disciple de Carver et de Tchekhov sous ses airs de mec à la coule.La story visible de La soustraction des possibles passe donc par les péripéties violentes, et répétitives à vomir, des séries actuelles les plus addictives, avec intervention de caïds atroces, exécutions sommaires et révérence finale des ordures manucurées de la BSG qui s’en tirent comme les fossoyeurs de Swissair & Co à parachutes dorés.Effet de réel, page 161, avec la liste (incomplète) des crimes imputables à une banque que nous ne nommerons pas (le sigle UBS n’est connu que de la rédaction), entre comptes en déshérence (1995) et condamnation de la banque en question pour blanchiment aggravé de fraude fiscale (2019), avec une quinzaine d’autres scandales, et ne vous demandez pas si la réalité dépasse la fiction : cette réalité-là n’est qu’un fiction, la vraie réalité du roman relevant des affects et de la bonté possible.En bonus sous le feuilleton : une espèce de poème râpeux genre Tom Waits, avec l’accent d’un sale gamin des Pâquis. Vous avez dit chef-d’œuvre ? Pas encore. Trop de trucs encore et de tics, comme Balzac ou Simenon avant leurs contributions respectives majeures à la «comédie humaine». Mais la pâte est toute bonne, et la papatte de l’écrivain est d’un vrai dur, surtout dur à la tâche et la passion d’un pur.Joseph Incardona. La soustraction des possibles. Finitude, 2020.
Première surprise : c’est à Charles-Ferdinand Ramuz que l’auteur emprunte l’un de ses exergues : « Comme tout est clair pourtant, quand on consent à se mettre en présence de la réalité». Et c’est dans la clarté d’une sorte d’immanence hyperréaliste que nous voyons surgir, raquette en main, le prof de tennis trentenaire Aldo Bianchi, secundo italo-suisse comme l’auteur, Rastignac de modeste extraction qui, d’abord gigolo de la femme, prénommée Odile et en début de retour d’âge, d’un homme d’affaires du nom de René Langlois, lancé dans la commercialisation des OGM (nous sommes en 1989 et le bloc de l’Est va bientôt «intéresser» les banques suisses), pour s’allier ensuite à la non moins ambitieuse Svetlana, transfuge tchèque occupant un haut rang à l’UBS de Genève, pour une passion amoureuse de «pirates» à la Bonnie & Clyde, ou Sailor et Lula, en plus touchants.Bien campés physiquement et psychologiquement, les personnages du roman se déplacent sur des territoires et dans des décors qui font l’objet de véritables «tours du propriétaire», avec foison de détails, que ce soit pour décrire les origines du parc des Eaux-Vives devenu haut-lieu de tennis (avec une digression sur la fondation du tunnel du Gothard et le rôle particulier d’un Louis Favre en capitaliste cynique), les belles demeures de Cologny et les souterrains de l’UBS, tel club libertin ou telle prison lyonnaise aux mœurs infernales, tel alpage corse où un parrain de la mafia locale trait sa chèvre auprès d’une enfant handicapée, ou tel salon des Port-Francs de Genève où transitent les chefs-d’oeuvre de la peinture, dont une représentation du Grammont par Ferdinand Hodler - le même que j’entrevois de ma fenêtre à l’instant de rédiger ces lignes, etc.Entre réalité et fantasmes, kitsch et poésieEn invoquant la «réalité», Ramuz n’en appelait pas à une littérature de reportage ou de témoignage au premier degré, réservée au journalisme, à l’essai ou à ce qu’on appelé plus récemment les «récits de vie». Ramuz n’était pas le Zola désiré de Dimitrijevic, mais un poète du réel et du tragique entré en littérature avec un petit roman déchirant, intitulé Aline, qui n’a pas fait le «buzz» à l’époque mais reste un modèle de probité « poétique », comme le dit d’ailleurs Joseph Incardona à sa façon.Celui-ci, issu de milieu modeste comme une Janine Massard ou une Mireille Kuttel (Piémontaise d’origine dont il faudrait redécouvrir les romans) est un «secundo» ritalo-suisse de la génération d’après 68 (il est né le lendemain, en 69) dont la culture personnelle, littéraire ou philosophique est très mélangée et peu académique. Je ne le connais à vrai dire que par son dernier livre, mais celui-ci en dit long, entre les lignes, et par la voix même de l’auteur qui se pointe au coin de pages comme le malicieux Hitchcok à l’écran…Or que nous montre ce bon Joseph de la réalité suisse «au-dessus de tout soupçon» de notre ami Jean Ziegler ? Rien que nous ne sachions déjà plus ou moins après une flopée de « reportages », précisément, mais sa façon de jouer d’effets de réel, pas loin des procédés d’un Michel Houellebecq, et de rallier le drapeau noir du « mauvais genre » littéraire, constitue sa base logistico-esthétique, avec la vigueur et le savoir d’un grand «pro» qui sait, par ailleurs, ce qui distingue un Ramuz d’un critique de gauche style Niklaus Meienberg, ou un Balzac d’un auteur de polars à la Marc Voltenauer ou à la Nicola Feuz.S’il joue le jeu du genre, Incardona vise plus haut, comme son protagoniste croit «voir grand» en s’imaginant plein aux as et donc tout-puissant. Mais Joseph sait d’avance que son Aldo va se casser la gueule, et de même le feuilleton parfaitement agencé qu’il nous balance n’est-il qu’un moyen de nous dire autre chose, par quoi il rejoint en somme un Georges Halas pointant le «meurtre sous les géraniums», le Ramuz génial de Circonstances de la vie ou de La vie de Samuel Belet, voire le Dürrenmatt de La Promesse «relu » par Sean Penn… Tout cela qui semble très loin du Cercle littéraire lausannois ou de la Société de lecture genevoise, mais qui ressortit néanmoins, «quelque part». à la littérature…L’Avenir étant dans la bonté humaine…Dernier cadeau de la nuit, hier soir, cueilli dans le recueil récemment paru du poète italo-genevois Vince Fasciani : « Je fais partie d’une lignée de gens de peu / qui se sont frayé un passage à travers la bonté ». Tout à fait valable, au fond, pour le sieur Incardona, disciple de Carver et de Tchekhov sous ses airs de mec à la coule.La story visible de La soustraction des possibles passe donc par les péripéties violentes, et répétitives à vomir, des séries actuelles les plus addictives, avec intervention de caïds atroces, exécutions sommaires et révérence finale des ordures manucurées de la BSG qui s’en tirent comme les fossoyeurs de Swissair & Co à parachutes dorés.Effet de réel, page 161, avec la liste (incomplète) des crimes imputables à une banque que nous ne nommerons pas (le sigle UBS n’est connu que de la rédaction), entre comptes en déshérence (1995) et condamnation de la banque en question pour blanchiment aggravé de fraude fiscale (2019), avec une quinzaine d’autres scandales, et ne vous demandez pas si la réalité dépasse la fiction : cette réalité-là n’est qu’un fiction, la vraie réalité du roman relevant des affects et de la bonté possible.En bonus sous le feuilleton : une espèce de poème râpeux genre Tom Waits, avec l’accent d’un sale gamin des Pâquis. Vous avez dit chef-d’œuvre ? Pas encore. Trop de trucs encore et de tics, comme Balzac ou Simenon avant leurs contributions respectives majeures à la «comédie humaine». Mais la pâte est toute bonne, et la papatte de l’écrivain est d’un vrai dur, surtout dur à la tâche et la passion d’un pur.Joseph Incardona. La soustraction des possibles. Finitude, 2020.