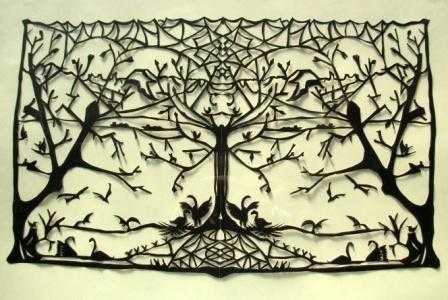
 DES LIVRES VITAUX. - Il y a, dans Austerlitz de W.G. Sebald, un caractère de nécessité qu’on ne trouve plus souvent dans la littérature actuelle. Je ne le trouve, à vrai dire, chez aucun auteur français contemporain, sauf peut être du côté des poètes ou des purs prosateurs. Je l’ai trouvé encore, très fort, chez Thomas Bernhard, mais pas partout. Je le trouve par bribes à chaque page d’Annie Dillard. Je le trouve parfois chez Haldas. Je le trouve chez un V.S. Naipaul ou chez un J.M. Coetzee. Je le trouve à chaque page de The same Sea d’Amos Oz.
DES LIVRES VITAUX. - Il y a, dans Austerlitz de W.G. Sebald, un caractère de nécessité qu’on ne trouve plus souvent dans la littérature actuelle. Je ne le trouve, à vrai dire, chez aucun auteur français contemporain, sauf peut être du côté des poètes ou des purs prosateurs. Je l’ai trouvé encore, très fort, chez Thomas Bernhard, mais pas partout. Je le trouve par bribes à chaque page d’Annie Dillard. Je le trouve parfois chez Haldas. Je le trouve chez un V.S. Naipaul ou chez un J.M. Coetzee. Je le trouve à chaque page de The same Sea d’Amos Oz.
 PLUS NOIR QUE NEIGE. - Un troubadour, en un vers inoublié, pour célébrer l’immaculée blancheur de sa Dame, disait la neige brune, et probablement pensait-il : noire.
PLUS NOIR QUE NEIGE. - Un troubadour, en un vers inoublié, pour célébrer l’immaculée blancheur de sa Dame, disait la neige brune, et probablement pensait-il : noire.
Mais c’est plus noir que neige sous le soleil assassin, cet après-midi derrière mes volets clos, que je discerne le diamant pur de la cruauté et de tout ce qui l’exprime et la conjure au même instant. Je regarde Fargo après avoir relu Le rat de Venise de Patricia Highsmith, je me rappelle en outre ma fascination pour J’étais Dora Suarez de Robin Cook, et je me demande alors: à quoi tient ce goût du noir qui nous transit de joie féroce ?
Est-ce un penchant morbide ? Nullement. Une façon de cynisme ou de délectation maussade ? Pas non plus. Non : je crois que c’est une histoire d’enfance. Cela tient sans doute au besoin de l’enfant d’entendre, à l’orée de la forêt de sa nuit, d’affreux contes qui lui permettent d’apprivoiser les présences qui s’y tapissent, mais il n’y a pas que ça. Il y a aussi cela que le noir exprime les choses telles qu’elles sont, les causes et les conséquences, et qu’au plus noir il appelle à la fois l’effroi et le rire – jamais le sourire : le rire froid.
Les enfants ne vous laissent aucune chance lorsque vous leur racontez des histoires: ils sont conséquents. Je ne parle pas des enfants gâtés : je parle des purs enfants de neige noire. Et de toute évidence, le tueur incarné par Peter Stormare, dans Fargo, est un enfant. D’une certaine manière, le marchand de bagnoles que joue William Macy, qui vient de lui demander d’enlever sa femme pour se tirer d’affaire, est aussi un enfant, mais alors: gâté. Il fuit. Il ne veut pas voir les conséquences. De la même façon, les enfants du Rat de Venise de Patricia Highsmith ne peuvent même pas imaginer les conséquences du fait qu’ils aient crevé un œil et coupé deux pattes à un rat passant par là : ils pensent déjà comme des adultes.
Patricia Highsmith, elle, ne pense pas comme un adulte : elle a le même esprit de conséquence que Peter Stormare qui, quand un flic le chicane, le tue, et quand le corps d’un complice l’encombre, le passe au broyeur sans quitter son expression d’enfant mélancolique. Donc Patricia Highsmith se met à la place du rat, nous fait visiter Venise à hauteur de rat, et fait réagir le rat en rat, qui mange au passage la moitié d’un visage de joli bébé simplement du fait que le bébé dégage la même odeur que ses bourreaux. C'est comme ça: le monde est comme ça.
L’humour des frères Coen dans Fargo est du plus beau noir, comme l’est aussi, mais à la limite du supportable, l’éclat du scalpel de Robin Cook dans J’étais Dora Suarez, qui frise le gore et me semble donc d’un noir moins pur.
Le plus beau noir peut être panique, mais pas guignolesque. Les enfants gâtés et les adolescents se font peur avec du gore qui n’est que la face inverse du rose pompon, c’est-à-dire qu’il esquive le réalisme absolu cher à l’enfance. Le noir de la neige s’en ressent.
L’enfance nous regarde. Les filles et les pères américains (dans Fargo autant que dans Le secret de Brokeback Mountain) essaient d’arranger les choses autant que les mères, mais les enfants et les rats l’entendent autrement, qui savent comment doit finir l’histoire…
TOUT DIRE. - Un écrivain peut-il tout dire? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables?
 Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline.
Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline.
 En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?
En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?
Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.
Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à le fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.
 Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase est juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus».
Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase est juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus».
 DE LA RESSEMBLANCE HUMAINE. - C’est un film poignant d’humanité que les Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, d’une grande beauté d’inspiration et d’image, dont se dégage à la fois l’évidence de la ressemblance humaine et le caractère inéluctable de l’hybris des nations, exacerbé par la guerre. Une scène absolument déchirante marque le sommet de cette expression de la fraternité: lorsque le flamboyant lieutenant-colonel Nishi (Tsuyoshi Iharo), champion olympique d’équitation au Jeux de Los Angeles, en 1932, qui vient d’épargner la vie d’un jeune Marine, succombant cependant à ses blessures, traduit à haute voix une lettre de sa mère au jeune homme, dont les choses toutes simples qu’elle raconte font se lever, l’un après l’autre, les soldats japonais présents, bouleversés et muets.
DE LA RESSEMBLANCE HUMAINE. - C’est un film poignant d’humanité que les Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, d’une grande beauté d’inspiration et d’image, dont se dégage à la fois l’évidence de la ressemblance humaine et le caractère inéluctable de l’hybris des nations, exacerbé par la guerre. Une scène absolument déchirante marque le sommet de cette expression de la fraternité: lorsque le flamboyant lieutenant-colonel Nishi (Tsuyoshi Iharo), champion olympique d’équitation au Jeux de Los Angeles, en 1932, qui vient d’épargner la vie d’un jeune Marine, succombant cependant à ses blessures, traduit à haute voix une lettre de sa mère au jeune homme, dont les choses toutes simples qu’elle raconte font se lever, l’un après l’autre, les soldats japonais présents, bouleversés et muets.
Le nom d’Iwo Jima rappelle une bande dessinée des années 50 représentant cette bataille aussi symbolique qu’inégale, où les «Japs» étaient réduits à l’image de l’ennemi aux yeux bridés, cruel et fanatique. Or on n’est pas ici au rebours de ce cliché, qui se contenterait d’humaniser les combattants japonais, mais au cœur de la tragédie qu’ils vivent en étant à la fois prêts à mourir pour l’Empereur et conscients que celui-ci les a abandonnés à leur piège. Plus encore: le décentrage du regard d’Eastwood, qui réalise quasiment un film japonais d’esprit et de forme, nous fait vivre les dernières heures de leur vie comme s’ils étaient sans uniformes et sans grades, seuls et nus devant la mort entre tunnels et tonnerre, mer et ciel crachant le feu.
On est ici à la fois dans le piège de l’Histoire et n’importe où ailleurs, dans un rêve halluciné aux objets fantomatiques (un seau de merde, des tanks semblant en carton noir, des épées contre des lance-flammes) et traversé de personnages infiniment proche, du général Kuribayashi au petit boulanger Saigo qui, par la grâce d’un extraordinaire jeune acteur, irradie tout le film de son demi-sourire candide.
Voici les hommes, voici la guerre, voici l’Armada américaine surgissant de la nuit sur une mer de plomb et voilà le premier cheval tué sous la première attaque aérienne. Tout se passe entre sable noir et grottes, comme dans un cauchemar de Frank Borzage ou de Kaneto Shindo, le film à l’air d’être en noir et blanc et voici que le gris tourne au brunâtre et que le blanc passe au bleu. Une obsédante petite musique distille d’un bout à l’autre ses gouttes de beauté tandis que dix hommes se fond sauter à la grenade après que l’un d’eux a été transformé en torche vivante. Violence sidérante et chaotique, mais tout restera dans quelques mémoires et voici les lettres exhumées entre la première et la dernière séquence – ces lettres des morts qui nous demandent de les enterrer en nos cœurs…
 NOTRE SEIGNEUR. -Le Christ a représenté, pour nous autres protestants de naissance, une image du Bien. C’est le Sauveur. Le Fils de l’homme, à savoir une personne à notre hauteur, mais également revêtu d’une cuirasse divine. Une espèce de super-Pasteur au sens biblique du berger. Le Bon Berger des vignettes d’école du dimanche. Au quotidien, cette figure nous tenait lieu de repère et de modèle, notamment avec le Sermon sur la montagne.
NOTRE SEIGNEUR. -Le Christ a représenté, pour nous autres protestants de naissance, une image du Bien. C’est le Sauveur. Le Fils de l’homme, à savoir une personne à notre hauteur, mais également revêtu d’une cuirasse divine. Une espèce de super-Pasteur au sens biblique du berger. Le Bon Berger des vignettes d’école du dimanche. Au quotidien, cette figure nous tenait lieu de repère et de modèle, notamment avec le Sermon sur la montagne.
Un besoin plutôt intellectuel et esthétique, à un moment donné, m’a porté vers le catholicisme. Mais rien ne m’en reste. Premier couac: ce prêtre qui me dit que la conversion pourrait se résumer à une discussion dans un bar.
L’orthodoxie aussi m’a attiré à un moment donné, sous l’influence surtout de Rozanov, puis de Florenski. Or lisant Rozanov, je me rends compte que l’imprégnation locale, les odeurs, les chants dans l’église font bien plus que les dogmes ou les doctrines. La religion dépendrait-elle alors surtout du climat moral et mental dans lequel nous avons baigné? Je suis tenté de le penser de plus en plus. Un autre père et une autre mère, d’autres aïeux et ma religion eût surement été tout autre…
Celui qui lape un gras potage avant de mâcher du gibier sous le lourd ciel de novembre / Celle qui contemple la pluie verticale de la nuit à Manchester City / Ceux qui ne surent jamais combien ils furent aimés, etc.
 POST MORTEM. – Derniers fragments d’un long voyage est un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie, que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible. Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. »
POST MORTEM. – Derniers fragments d’un long voyage est un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie, que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible. Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. »
Et de fait, à l’opposé de tout désespoir ressentimental, donc aux antipodes du fameux Mars de Fritz Zorn, ce journal d’une lente agonie dont les affres ne sont en rien édulcorées (« Il y a des moments où l’âme empalée au corps agonise. Enfer de la souffrance. Enfer jour après jour (…) Journée terrible. Nuit terrible. Ventre calciné (…) Tous ces jours, j’éprouve le malaise profond d’être dans le corps d’un autre. Je ne reconnais plus rien », etc.), mais dont le mouvement général est une ouverture graduelle à plus d’amour et plus de vraie vie.
«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».
Rien là-dedans d’une fuite dans une euphorie spiritualisante coupée de la chair, au contraire : ce journal débordant de tendresse, de petits faits cruels ou drôles de tous les jours, avec les proches, les amis, les soignants, les toubibs, les oiseaux de Vienne, est une traversée des apparence qui nous associe à tout instant à celle qui nous rejoint en nous quittant. On pense à Charlotte Delbo, à Etty Hillesum, à Flannery O'Connor chantonnant dans les grandes douleurs, à Philippe Rahmy endurant crânement le martyre des os de verre en lisant ce petit livre d’une condamnée à mort déterminée à ne pas lâcher le fil de la Merveille: « L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».
J’aimerais citer de pleines pages de ce petit livre atrocement revigorant: « Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté »…
 ZOMBIES. - La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur.
ZOMBIES. - La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur.
Gorillage narquois du Bûcher des vanités de l’élégant Tom Wolfe, American Psycho poussait beaucoup plus loin la description d’une société de battants oscillant entre les clichés de la réussite les plus flatteurs et une constante compulsion d’inassouvissement et de meurtre. D’un thème aux résonances dostoïevskiennes, le « jeune » écrivain a tiré un roman « panique » intéressant, mais alourdi de chapitres redondants, notamment sur la culture rock. Pourtant c’est tout autre chose qu’on lui a reproché : on le taxa de sadisme parce que son protagoniste se montrait aussi violent que les personnages des vidéos dont il s’abreuvait, de misogynie sous prétexte que des femmes étaient violées et assassinées au fil des pages. Surtout on admettait mal que Bret Easton Ellis, produit typique de la société américaine dorée sur tranche, pût s’enrichir en brossant le tableau de la dégénérescence de son propre milieu. C’était ne pas voir que l’écrivain n’avait jamais fait autre chose que de décrire son entourage avec la lucidité d’un sale môme blessé. C’était ne rien saisir non plus de l’enjeu de son livre, poussant à l’extrême la représentation de la folie collective d’une société pourrie.
Dès Moins que zéro, Bret Easton Ellis avait commencé de peindre le milieu de l’adolescence californienne au tournant des années 80 (il est né en 1964), flottant entre luxe et sexe, détresse affective et drogues douces ou dures. Dans Les lois de l’attraction, l’observation se développait à l’université, sur le mensonge oblitérant toutes les relations sous couvert de libération sexuelle et d’épanouissement apparent. En multipliant les points de vue des narrateurs successifs, le romancier parvenait à une sorte de mise à nu d’une ronde plus sinistre et déchirante que celle d’un Schnitzler au début du XXe siècle.
Quant aux treize récits de Zombies (en anglais The Informers) qui nous ramènent aux débuts de l’écrivain, ils donnent une idée forte de la largeur du spectre d’observation et de l’hypersensibilité de l’auteur, entièrement investie dans son écriture, telle qu’on la retrouve exacerbée dans Lunar Park à l’autre bout de son parcours.
Situées à Los Angeles au début des années 80, ces nouvelles évoquent une humanité stéréotypée, bronzée, souvent droguée, aux prénoms et aux silhouettes interchangeables de beaux surfers ou de belles actrices de TV (on a droit à ce titre après une pub de trois minutes), tous également informés ou informes.
Les situations de la narration rappellent souvent des standards de sit-coms tels qu’en débite la TV américaine à dose mégavomitive, en version superluxe et multisexuelle. Au présent de l’indicatif, Bruce téléphone de L.A. à son ami resté au New Hampshire pour lui raconter ses dernières rencontres (un certain Robert qui « pèse à peu près trois cents millions de dollars » et une certaine Lauren vraiment super) tandis que son interlocuteur, qui l’a déjà remplacé, se rappelle vaguement leurs vagues bons moments. Ou ce sont quatre amis qui se retrouvent dans un restau italien de Westwood, très gênés d’avoir à évoquer la mort (quelle horreur ce sujet, la mort, vraiment pas super) d’un proche crashé en voiture sous l’effet de la dope, un an auparavant ; et ce qu’on apprend, dans la foulée, c’est que toutes les relations entre ces quatre présumés « intimes » sont faisandées. Ensuite on voit une femme bourrée de médics, dont le fils se shoote et que son mari ne supporte que pour autant qu’elle sourie aux photographes de Hollywood. Ou c’est un père qui cherche à regagner la complicité de son fils qu’il emmène à Hawaï pour récolter les fruits amer de son manque total d’intérêt réel pour son ado. Et voici la vérité de l’enfant pourri : vous m’avez tout donné, sauf ce qui fait vivre et respirer. Bref, rarement on aura traduit le monstrueux ennui que c’est de jouir à vide ou de souffrir sans être aperçu ou entendu de quiconque.
Et tout ce que note Bret Easton Ellis de la société qu’il observe nous parle évidemment puisque tout inter-communique désormais dans l’ubiquité et l’instantanéité mondialisées. Qu’il s’agisse de ce rocker perclus de coke qui se traîne sur les scènes japonaises en cherchant à se rappeler un vague bon moment avec son groupe scié par un suicide, ou de cette jeune fille écrivant des lettres sans réponses à un petit ami, décrivant à celui-ci, qui ne répond pas, sa lente descente aux enfers de l’agréable : tout cela relève aussi bien de la ressaisie de sentiments largement partagées par les temps qui courent. S’il arrive à Bret Easton Ellis de représenter, dans plusieurs de ses nouvelles, des situations parodiant la pire matière gore, où l’on voit par exemple des paumés paniqués massacrer un enfant, ou des vampires s’adonner à leur penchant comme à un jeu de société (ce fut un temps très à la mode à Beverley Hills), c’est évidemment par esprit de conséquence, comme lorsqu’un Bukowski raconte l’histoire du couple stockant dans son frigo les morceaux du jeune autostoppeur qu’il a ramassé au bord d’une autoroute, pour les déguster à l’heure du SuperBowl. Nul cynisme en cela, juste un peu d’exagération, n’est-ce pas, et encore… On sait par ailleurs quel doux poète est l’affreux Hank. Et de même Bret Easton Ellis est-il au fond un bon garçon plein de sensibilité et de répulsion contre toute forme d’inhumanité, comme l’illustre Lunar Park, quitte à relancer de nouveaux malentendus. C’est que, du behaviourisme tout extérieur de Less than zero ou d’American Psycho, l’on pénètre, avec Lunar Park, plus en profondeur et en nuances subtiles, au cœur de l'œuvre d’un romancier, devenu son propre personnage, qui ne s’était jamais exposé à ce point…
 MUNCH À BÂLE. - Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles.Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aînée terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thème est repris de manière obsessionnelle. C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai. Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Philippe Sollers à propos de Francis Bacon: cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir.
MUNCH À BÂLE. - Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles.Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aînée terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thème est repris de manière obsessionnelle. C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai. Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Philippe Sollers à propos de Francis Bacon: cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir.  On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée. C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta.
On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée. C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta.
FEMMES. - Pourquoi suis-je si profondément touché par la perception métaphysique du monde qui caractérise certaines femmes, telles Christiane Singer, Annie Dillard ou Flannery O’Connor ? Peut-êter du fait du caractère profondément incarné de leur sentiment du monde, et par l’espèce d’absolutisme de leur rapport à la matière, qui touche à l’immatériel tant il est pris comme un tout, corps et âmes en quelque sorte.
 ARLEQUINS DE NABOKOV. - Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.
ARLEQUINS DE NABOKOV. - Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.
L’étoile bleue d’une étincelle de tramway, dans une rue de Berlin évoquant un décor de théâtre. Une jungle à myrtilles, au fond du parc d’un grand domaine russe, où des enfants ensoleillés vont se barbouiller de pulpe violette. Le désert silencieux d’un hôtel particulier de Saint-Pétersbourg, dont la lumière des lampes, terne et jaune en hiver, se reflète sur le linoléum enduit de colophane. Tout cela saisi avec son poids spécifique et sa rondeur très concrète, quand bien même la réalité serait transfigurée, chez Nabokov, par la double alchimie de la mémoire et du style.
Et ces souvenirs soudain rassemblés, comme une limaille multicolore, d’un voyage de noces traversant pays et saisons. Ou ces tortues du zoo de Berlin, enfonçant leurs têtes plates et ridées dans un monceau de légumes mouillés pour mâcher « salement » leurs feuilles. Ou cette table mise, dans un appartement saturé de parfum de femme, pour un souper très intime. Ou cet autre domaine russe enseveli sous les monceaux de neige.
Enfin tous ces moments dont la substance paraît tout à coup plus dense, où l’on voit mieux, comme sous une loupe, chaque détail de la tapisserie du monde ; et tous ces lieux, aussi, qu’un grand tremblement de passion ou qu’une tristesse de catastrophe incorporent à jamais à notre mémoire vive.
Si telle rue de Berlin, à tel moment de flamboyant crépuscule, dans les Détails d’un coucher de soleil, nous apparaît avec tant de relief, c’est que l’artiste a entreprise de raconter, dans un branle-bas d’images qui semble faire participer le monde entier à l’événement, la fin tragi-comique de Mark le blond, le « veinard en col dur », charmant vendeur de cravates dont la ferraille déambulatoire d’un tramway interrompt brutalement la course censée le jeter dans les bras de sa fiancée Klara, laquelle ne veut d’ailleurs plus entendre parler de lui – mais le pauvre garçon l’ignore.
Fait divers banalissime ? A n’en pas douter. Mais qui n’en devient pas moins, ici, le prétexte à restituer avec des moyens techniques typiquement « années vingt », qui rappellent à la fois le cinéma, la peinture futuriste et les formes narratives de Boulgakov, de Zamiatine ou de Pilniak, l’atmosphère de Berlin que le jeune exilé a bel et bien connue, mais alors transfigurée.
Vladimir Nabokov est de ces écrivains que rebutent le réalisme et l’aveu direct, mais dont les œuvres sont à la fois tissées de réminiscences autobiographiques. Ses romans, tels Pnine, Lolita ou Regarde les arlequins, l’illustrent aussi bien que ses quatre cycles de nouvelles, de L’extermination des tyrans à Mademoiselle O, en passant par Une beauté russe.
Or, pour en revenir au dernier recueil paru, le petit Pierre d’ Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire, car ce qui compte, en l’occurrence, tient précisément à la transformation du plomb en or, au passage du gris à l’enluminure, ou du particulier à l’universel. Ce qui nous touche, dans le triste après-midi que passe le garçon d’ Une mauvaise journée au milieu d’autres gosses qui le rejettent, c’est que Nabokov y capte l’essence de la détresse adolescente. Dans Le retour de Tchorb, autant que le dénouement grinçant, voire scabreux, d’un drame épouvantable, c’est la prodigieuse remémoration à laquelle se livre le protagoniste des beaux jours partagés, après la mort de la femme aimée. Avec La sonnette, comme dans Retrouvailles, c’est la façon de dire, sans lamento d’aucune sorte, l’errance et la solitude de l’exilé.
Il y a chez Vladimir Nabokov, un magicien de la langue, dont les jeux d’esprit nous éblouissent, comme dans La défense Loujine ou Feu pâle, d’autres de ses fameux romans.
Cependant, la lecture de ses nouvelles nous rappelle que l’écrivain est également un poète du sentiment, même si la pudeur voile chez lui toute effusion. Est-ce parce qu’on fait voler en éclats les clichés du toc sentimental ou de la mauvaise littérature qu’on est, pour autant, un cynique ou un cœur sec ? Tout au contraire, et la lecture de Noël, ressaisissant ici le désespoir d’un père qui vient de perdre son fils, achèvera sans doute de convaincre le lecteur que l’habit d’arlequin dont aimait à se parer l’écrivain dissimulait, aussi, un homme de cœur.
 VOYOU. - C’est un intense poète que William Cliff, un ange d’innocence que ce vagabond sous les étoiles dont la foulée le porte d’Ostende à Bénarès d’un enjambement d’alexandrin, et du fond d’un fjord à Atlanta, de bouges en bouges ou dans la grande Maison pleine de mauvais garçons comme lui dont les caves abritent de pauvres amours.
VOYOU. - C’est un intense poète que William Cliff, un ange d’innocence que ce vagabond sous les étoiles dont la foulée le porte d’Ostende à Bénarès d’un enjambement d’alexandrin, et du fond d’un fjord à Atlanta, de bouges en bouges ou dans la grande Maison pleine de mauvais garçons comme lui dont les caves abritent de pauvres amours.
Je l’avais entendu un soir lire ses poèmes dans une espèce de palais de la culture, à Bruxelles, et tout à coup la nuit s’ouvrait au-dessus des dorures et des diadèmes, tout à coup cette musique de sa langue à tagadam rythmique, et ses images de démolitions à perte de vue, de sémaphores le long des rails et des rues, de pauvres chambres et de pauvres corps vivant leurs plus riches heures à pauvres soupirs, ses ciels crevés s’ouvraient et trente-six mille soleils rimbaldiens tournoyaient. Or le voici revenir à Charleville-Mézière et s’exclamer : « Oh ! qu’il a dû gémir l’Adolescent qui erre/de rue en rue dans cette horrible ville mais /il a vite compris arrivé à Paris/que pour lui c’était une impasse encore plus noire /et qu’il devait chercher ailleurs ce qui ravit/l’âme et lui donnera l’eau qu’elle aimera boire »…
HIC ET NUNC. - Curieux orages tôt ce matin. Des éclairs sur le lac endormi, des grondements, comme de lointaines canonnades, auxquels a succédé une pluie tambourinante. A présent il fait un ciel tout noir, zébré d’éclairs invisibles (des lueurs d’éclairs) et ponctué, sur la rive d’en face, de signaux de tempête.
(A La Désirade, ce vendredi 11 mai)
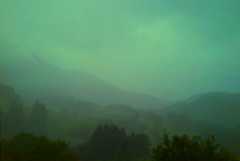 PEINDRE LA PLUIE. - J’aurais aimé peindre ce matin le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme.
PEINDRE LA PLUIE. - J’aurais aimé peindre ce matin le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme.
Ce fut d’abord une espèce de haut décor immobile au camaïeu gris bleuté, style opéra des spectres sous la cendre, que surmontaient de gros rouleaux de velours noir accrochés aux cintres des montagnes de Savoie. Toute vide et désolée, la scène avait une majesté funèbre de sanctuaire à l’abandon. Cependant, imperceptiblement, le décor se modifiait à vue d’un moment à l’autre, les masses suspendues semblant tout à l’heure des frontons devenaient des toiles déchiquetées pendues en plans superposés et délimitant de nouveaux lointains, entre lesquels filtraient ça et là d’obliques rayons comme liquéfiés dans le vent tiède.
Quelques instants plus tard, tout n’était plus que lambeaux de grisaille tombant en colonnes verticales sur les pentes boisées paraissant exhaler maintenant des bouffées de brume, et voici que la pluie se voyait là-bas le long des pentes et bien avant de nous tremper le front de ses premières grosses gouttes huileuses, puis il n’y eut plus du lac au ciel qu’un pan de pur chiffon sur lequel d’invisibles mains jouaient avec l’eau et l’encre, c’était à la fois sinistre et splendide, et tout se refermait enfin dans la pluie, il pleuvait partout, tout n’était plus que ciel en pluie mais cela ne saurait se dépeindre: il n’y a pas d’instruments pour cela ni d’art assez direct, c’est une trop ancienne sensation, il n’y aurait que la danse, mais la danse immobile, la danse de l’angoisse enfin levée, la pure danse jamais apprise du premier homme assoiffé, les mains ouvertes à la céleste onction…
Celui qui a rencontré Dalida au temps où elle devint Miss Egypte / Celle qui offre des dessous affriolants à sa belle-fille Zabou afin qu’elle fasse la reconquête de son fils adoré / Ceux qui vivent peinard dans les containers de l’usine à gaz désaffectée de la Banlieue Est, etc.
 AUDIBERTI. - Je me suis replongé ce matin dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti, pour en tirer une allègre évocation de Sète et de notre fin d’après-midi d’hier à bouquiner sous les frondaisons. De fait, il m’a semblé qu’il y avait, dans l’atmosphère de la petite ville méditerranéenne s’apprêtant à fêter ses origines italiennes, quelque chose de frais et de bigarré qui rappelait le début de Monorail et son tableau de Nice avec ses pédalos sur l’eau qu’il appelle des vagovagues… En tout cas je me promets de revenir, bientôt, à ce prodigieux sourcier de vocables et d’images, de sensations inattendues et de rapprochements fulgurants, d’intuition et de pensées, d’une constante originalité – je me promets de relire d’affilée Monorail et Marie Dubois et de lire enfin Dimanche m’attend.
AUDIBERTI. - Je me suis replongé ce matin dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti, pour en tirer une allègre évocation de Sète et de notre fin d’après-midi d’hier à bouquiner sous les frondaisons. De fait, il m’a semblé qu’il y avait, dans l’atmosphère de la petite ville méditerranéenne s’apprêtant à fêter ses origines italiennes, quelque chose de frais et de bigarré qui rappelait le début de Monorail et son tableau de Nice avec ses pédalos sur l’eau qu’il appelle des vagovagues… En tout cas je me promets de revenir, bientôt, à ce prodigieux sourcier de vocables et d’images, de sensations inattendues et de rapprochements fulgurants, d’intuition et de pensées, d’une constante originalité – je me promets de relire d’affilée Monorail et Marie Dubois et de lire enfin Dimanche m’attend.
(Cap d’Agde, ce vendredi 25 mai)
A tout ce que dit Alexandre Vinet de l’assèchement cérébral des philosophes de profession, je souscris. Mais Vinet voudrait moraliser la littérature, et là je ne le suis plus. Son côté vieille fille puritaine, qui prétend que seuls les esprits vulgaires veulent « toucher, palper », alors que ce sont bel et bien les sensitifs et les sensuels, les Ramuz, les Cendrars ou les Cingria, avant les Haldas, les Chappaz et les Chessex, qui marqueront le renouveau et l’épanouissement de la littérature en Suisse romande
ANTICIPATION. - L’herbe a poussé à La Désirade, comme à notre insu. L’herbe a poussé sous la pluie. L’herbe pousse presque à vue d’œil tandis que nous reprenons nos quartiers. Les glaciers fondent, à ce qu’on dit, mais l’herbe ne cesse de pousser et les eaux des mers et des lacs ne cessent de monter, au point qu’on se demande si c’est sur des barques que, demain, nous faucheront les îles d’herbe ?
(A La Désirade, ce lundi 28 mai).
 RÊVER A LA SUISSE. - On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat.
RÊVER A LA SUISSE. - On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat.
La première édition de Rêver à la Suisse, préfacée par Jean Paulhan, date de 1948, et l’on sent encore un peu la guerre dans la Suisse protégée que décrit Calet par le tout menu. Ainsi relève-t-il l’inscription figurant dans telle vitrine d’une prestigieuse confiserie de la place de Montreux, selon laquelle la Maison ne pourra livrer sa production d’Amandino pour cause persistante de restrictions.
Henri Calet se moquait-il de la Suisse en relevant ce détail qu’on pourrait trouver un summum de luxe futile, au cœur d’une Europe en ruines ? Et se moque-t-il de la Suisse en s’arrêtant à d’autres détails ténus tels que la forme et l’appareillage des urinoirs ou le fonctionnement de tel vertigineux funiculaire à crémaillère ? Je ne le crois pas du tout. On n’apprend certes à peu près rien de ce pays en lisant Rêver à la Suisse, mais on en sent en revanche le climat : on y est et tout est dit. Ne penser à rien en rêvant à la Suisse est au reste la meilleure disposition pour redécouvrir ce pays qui en contient plus que quiconque n'oserait en rêver sur le territoire d'un timbre-poste, et l'on verra que ce n'est pas rien...
Peu importe que je ressuscite avant ou après la mort. Ce qui compte est que le présent que je vis annule la mort.
 VOYAGE EN ZIGZAGS. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux. Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu…
VOYAGE EN ZIGZAGS. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux. Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu…
Mais voici qu’on arrive au fond de la vallée qu’annonce la bilingue dame du train : wir treffen in Brig ein, EndStation. Nous arrivons à Brigue, station terminus. Et de fait, c’est bien un verrou que représente ce lieu, au-delà duquel il faut franchir une haute marche pour continuer vers l’Est dans le Goms, la vallée de Conches, les hauts du glacier du Rhône et, plus loin encore, les vals suspendus de l’Engadine, pays de Nietzsche et de l’ours revenu des Balkans.
Mais c’est au nord que L’Intercity à destination de Zurich et Romanshorn m’emmène à présent à travers toute une théorie de tunnels. Une dernière lucarne me permet juste d’apercevoir, en bas, la plaine industrieuse, puis en haut un dernier glacier (les journaux parlent ce matin de leur disparition en 2050), sur quoi le train s’enfonce littéralement au cœur de la terre. Un bas-relief discret, à Goppenstein, rend hommage à ceux qui ont laissé leur peau dans la construction de cet indispensable ouvrage nous reliant ingénieusement à l'Europe.. Or la proximité du Simplon et du Lötschberg, lignes ferroviaires mythiques, me fait soudain penser à deux de mes arrières-grands-pères, l’un Alémanique et l’autre Romand, qui furent conducteurs de trains au début du siècle, l’un faisant même partie de l’historique équipe à inaugurer la voie du Gothard. Il me reste d’eux des photos de fringants moustachus à rutilants uniformes, mais je ne sais rien d’autre jusque-là de leur histoire précise, et je m’en veux à l’instant. Que d’incuriosité dans notre génération de jeans et de longs cheveux !
Passons : car nous voici sur l’aire alpestre de Kandersteg où divers jolis cars multicolores pleins de sages touristes se trouvent comiquement juchés sur divers wagons de transport, au titre du moderne ferroutage.
Par delà Kandersteg le train glisse doucement sur l’autre versant de la montagne, vers un agreste pays de lacs, et c’est bientôt le rivage de Spiez qui s’alanguit, autre haut-lieu de ma mythologie personnelle puisque s’y dresse la pyramide parfaite du Niesen, maintes fois représentée par les peintres, Hodler le tout premier. Justement, un Hodler vient d’être adjugé en Amérique 15 millions de dollars, mais cela ne signifie rien à mes yeux, sauf qu’un Hodler risque d’échapper à notre regard pour se retrouver dans un coffre-fort.
Tant pis : il nous reste le Niesen, que les Américains n’ont pas encore acheté, et je sais, au musée de Berne quelques Hodler que je retrouverai cette après-midi même.
En attendant, comme je suis descendu de train avec l’idée de laver une aquarelle du fameux Niesen, je déchante en constatant que la montagne s’est drapée dans une épaisse étole de brume. Peste de diva à caprices. Mais je passe ma rage à ma façon, à la piscine voisine d’un bleu californien et d’une eau glaciale, où je peine la moindre à tenir le rythme de deux Gretchen à fortes épaules qui se racontent leur semaine amoureuse. On n’imagine pas la vitalité galante des Gretchen de l’Oberland bernois, non plus que la vigueur de leur brasse coulée…
(De Montreux à Spiez, ce mardi 5 juin)
 SUISSE SAUVAGE. - C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…
SUISSE SAUVAGE. - C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…
Il y a, dans la voix de Tina Turner, du rouge acide et du vert saignant, avec des flammes de rose et de bleu tendre, comme je les ai retrouvés, au musée de Berne ou je me suis pointé dans l’après-midi, dans la peinture exacerbée de Kirchner auquel, avec d’autres foudres d’expressionnisme hantant les hauts gazons des Grisons (notamment un Albert Müller que j’ignorais et qui vaut son compère), est consacrée un flamboyante exposition.
Pour ceux qu’impatiente la nécessité de briser les clichés, comme on dit, la découverte des idylliques paysages d’Engadine se démantibulant sous la torsion des formes et la vocifération des couleurs, vaut le détour même si cette peinture fait très époque et, parfois, tourne au maniérisme. Kirchner du moins avait de quoi pousser à l’exorcisme, revenu de la Grande Guerre malade et drogué, contraint de se soigner au grand air où il finit par se suicider, en 1938, désespéré par la montée de l’autre peste.
Aussi j’aime le rappel de cette Suisse sauvage et brute, qui réagit à l’accablante quiétude du pays propre-en-ordre, qu’on retrouve dans la salle du musée de Berne réservée au phénoménal Wölffli, génial timbré dont les énumérations chiffrées des multimondes, enregistrées, tombent du plafond tandis que la passante et le passant déchiffrent son imagerie délirante.
Adolf Wölffli, Robert Walser, Aloyse, Louis Soutter: autant d’éclairants illuminés qui ne se sont jamais associés à aucun groupe mais dont le primitivisme fait écho à celui de Kirchner et de ses pairs.
 Après cette folie fiévreuse, et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’indéfinissable architecture vert-de-gris, que celle de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…
Après cette folie fiévreuse, et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’indéfinissable architecture vert-de-gris, que celle de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…
C’est en ce lieu même, je me le rappelle, que je vis cet autre spectacle attendrissant d’une Présidente de la Confédération en exercice, socialiste comme l’actuelle, porteuse d’un modeste cabas rempli de commissions et répondant patiemment, sans garde armé, à un groupe d’écoliers appenzellois faisant pèlerinage en ce haut-lieu sous la conduite de leur instituteur à queue de cheval et culotte de peau…
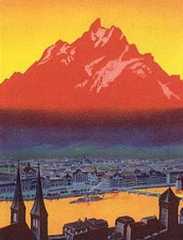 GREETINGS FROM LUCERNE. - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au cœur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés du monde, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais.
GREETINGS FROM LUCERNE. - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au cœur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés du monde, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais.
Face à ma fenêtre se dresse le Mont Pilate à la cime crénelée, qui doit son nom au fait que le meurtrier du Christ y est venu se jeter dans les eaux sombres d’un minuscule lac serti au creux de ses roches. On se rappelle évidemment qu’après que Tibère eut fait jeter Pilate au Tibre, les eaux horrifiées de celui-ci recrachèrent le déicide qui s’enfuit à travers les roseaux et les buissons jusqu’au Rhône, à la hauteur de Vienne, où il se jeta lui-même pour tenter de s’y noyer. Mais de là encore Pilate fut rejeté, qui se réfugia au bord du Léman pour y subir un sort analogue, lequel le fit rebondir jusqu’au pied de la farouche montagne de ces contrées alpines dont le lugubre petit lac reçut enfin les restes de l’âme tourmentée. C’est aux sursauts de celle-ci, depuis lors, qu’on attribue les orages fréquents de la région, qui fait se dresser les cheveux des enfants à la lisière du sommeil.
La légende n’est pas seule à faire de Lucerne une façon de centre de divers mondes, puisqu’y survivent les fantômes de Richard Wagner et de l’impératrice Sissi, et que s’y perpétue le culte de Pablo Picasso et de Paul Klee, du pain de poires et de la navigation à vapeur. De ma fenêtre de l’Hôtel Pickwick, plus à gauche, se distinguent quatorze plans d’un paysage évoquant quelque lavis chinois en dégradés de bleus pers et de noirs veloutés ; j’ai bien dit quatorze, et ce fut avéré par sept générations de paysagistes, avec le pic nanti d’un invisible ascenseur mécanique du Bürgenstock au sommet duquel gîte la star italienne Gina Lollobrigida, dont nous rêvions à treize ans au risque de provoquer la jalousie de ses rivales Ava Gardner et Doris Day…
Ce souvenir de chair ne peut que me rappeler, en ce lieu qui fut aussi celui de nos enfances – ma mère étant native de Lucerne -, les bains de bois, évoquant de hautes cabanes lacustres, où mes tantes (membres de la Société des Dames, dite Frauenverein) nous emmenaient tout petits nous rafraîchir, du côté réservé à leur sexe, d’où, entre les claies, se voyaient les hommes velus et dangereux.
«Là-bas c’est le vice », m’avait dit un soir ma tante E. en me désignant un quartier où clignotaient force néons roses et verts. La chose me frappa si fort que je n’eus de cesse d’y goûter une fois, plus tard, quand j’aurais l’âge de hanter ces lieux qu’elle disait mauvais. Or on a beau dire que les traditions se perdent : pas plus tard que tout à l’heure, j’ai repassé dans cette basse ruelle que ma tante perdue de vertu stigmatisait jadis et qu’y vois-je alors ? Gottverdami, sous une enseigne dorée figurant le cerf dans sa parade : ni plus ni moins, irradiant de suaves reflets roses et verts, que le Cabaret Dancing Cacadou…
(Lucerne, ce mercredi 6 juin)
Celui qui court à la mer et plonge sept fois la tête dans les flots / Celle qui se considère comme la réincarnation de la Reine de la Nuit à l’agacement manifeste de Fernande l’organisatrice du Jeu de Rôle des anciens du ski-club / Ceux qui recapitalisent leur banque d’émotions, etc.
 MARTYR ET POÈTE. - L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».
MARTYR ET POÈTE. - L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».
Peu de livres, en si peu de mots, savent dire avec tant de violence et de douceur, de rage et de délicatesse, de précision nue et crue et de lyrisme déchirant la totalité complexe de la souffrance physique et métaphysique, avec cette sainte phrase où le martyr jamais doloriste se dit «porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe»…
Ce livre se donne le sous-titre de Chant d’exécration, mais c’est surtout un chant d’amour et de manque innocent que Demeure le corps, d’une «honnêteté absolue» et revendiquée, d’une écriture soumise à une tenue, modulée dans un style, un rythme et une musicalité sans faille
Celui qui a gagné un lapin vivant à la tombola des aveugles / Celle qui ne supporte pas le remplaçant boiteux du laitier Jolidon / Ceux qui crèvent les ballons qui tombent dans leur jardin privatif, etc.
 MATER FURIOSA. - Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.
MATER FURIOSA. - Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.
On n’aime pas cette sale carne, mais le personnage reste terriblement humain, comme Alceste ou Tartuffe, avec ce mélange d’épique et de comique, mais aussi de faiblesse et de détresse, qui fascine autant sinon plus que les figures de victimes ou de justes.
Plus que la Marie, c’est la condition même de ces paysans pauvres de l’époque de la Grande Guerre qui nous semble cruelle et dégradante, et le constat me rappelle ce qu’on m’a raconté des paysans de notre famille fuyant la terre à la même époque : « Des sept enfants, pas un ne restera sur cette terre à laquelle leur père a consacré sa vie. »
Lorsque, après avoir failli tuer Marie, Joanny se retrouve mourant à ses côtés, elle en arrive à boire encore l’eau de Cologne nécessaire à sa toilette, mais sa propre fin à elle ne manquera pas pour autant de gueule, stupéfiant ceux qui la soignent par le courage qu’elle montre face à la Douleur.
 FRIEDRICH LE GRAND. - Génie de l’espèce volcanique, Friedrich Dürrenmatt écrivait comme un écolier follement appliqué, dont chaque paragraphe de sa petite écriture carrée était essayé et repris, révisé cent et mille fois au point qu’à son œuvre comptant trente volumes il faudrait en rajouter trente autres au moins de brouillons. Des récits fantastiques de La Ville aux romans policiers à double fond tels que Le Juge et son bourreau ou Le Soupçon, ou des pièces radiophoniques (la fameuse Panne) aux écrits récents mêlant paraboles et réflexions, en passant par l’essai politique (sur Israël ou sur la Suisse), les dessins à la plume et la peinture virulemment expressionnistes, cet immense bonhomme n’aura cessé d’approfondir les thèmes qui le hantent depuis ses jeunes années : l’individu perdu dans le grand labyrinthe, la corruption du pouvoir et de la justice par l’argent, la dilution de toute responsabilité dans le chaos de l’Histoire, l’entropie cosmique et l’autodestruction de l’humanité. Autant de thèmes qui traversent son théâtre, de l'increvable Visite de la vieille dame, qui continue de se jouer aux quatre coins du monde, à cette représentation de la folie humaine que figure Achterloo, sa dernière pièce.
FRIEDRICH LE GRAND. - Génie de l’espèce volcanique, Friedrich Dürrenmatt écrivait comme un écolier follement appliqué, dont chaque paragraphe de sa petite écriture carrée était essayé et repris, révisé cent et mille fois au point qu’à son œuvre comptant trente volumes il faudrait en rajouter trente autres au moins de brouillons. Des récits fantastiques de La Ville aux romans policiers à double fond tels que Le Juge et son bourreau ou Le Soupçon, ou des pièces radiophoniques (la fameuse Panne) aux écrits récents mêlant paraboles et réflexions, en passant par l’essai politique (sur Israël ou sur la Suisse), les dessins à la plume et la peinture virulemment expressionnistes, cet immense bonhomme n’aura cessé d’approfondir les thèmes qui le hantent depuis ses jeunes années : l’individu perdu dans le grand labyrinthe, la corruption du pouvoir et de la justice par l’argent, la dilution de toute responsabilité dans le chaos de l’Histoire, l’entropie cosmique et l’autodestruction de l’humanité. Autant de thèmes qui traversent son théâtre, de l'increvable Visite de la vieille dame, qui continue de se jouer aux quatre coins du monde, à cette représentation de la folie humaine que figure Achterloo, sa dernière pièce.
Pessimiste paysan, Dürrenmatt n’a jamais cru aux lendemains qui chantent du communisme, pas plus qu’il ne cédait aux sirènes d’aucune autre idéologie que la sienne, critique, de fabuliste à traits acérés. Comme il le disait avec son goût du paradoxe, ce rebelle plantureux, amateur de bons vins et de cigares Brissago, était devenu écrivain en Suisse « précisément parce qu’on n’y a pas besoin de littérature ».
À l’époque où les grands de ce monde se moquent de la littérature tout en la citant dans leurs discours pour se faire bien voir, le grand Fritz était arrivé, en présence de Vaclav Havel, dans un mémorable discours mêlant la plus folle exagération et la plus juste perception du conformisme helvétique, à défier nos édiles au point qu’ils lui battirent froid au terme de la cérémonie. Nul hommage plus mérité !
Convaincu qu’il est impossible désormais de démêler la culpabilité des fauteurs de tragédies, ce moraliste panique visait essentiellement à réveiller ses contemporains doublement menacés par la mort spirituelle et l’Apocalypse planétaire, avec les moyens d’un Jérôme Bosch à la sauce bernoise.
VERTU DES ONCLES. - Qu’une famille ait des pères est une chose appréciable pour sa stabilité, mais jamais elle ne vivra vraiment sans oncles, ni sans tantes qui sont des oncles féminins. Blaise Cendrars l’a prouvé huit fois. Je contresigne.
Une photo de ma famille maternelle est la preuve par l’argentique que les oncles avaient déjà de l’avenir avant notre venue au monde. Je regarde cette photo regroupant un géant chercheur d’or, une institutrice vouée à l’alphabétisation de la jeune fille chinoise, deux champions de lutte à la culotte, trois élus du peuple paysan des hautes terres, une couturière vouée plus tard au désespoir par un Italien félon, tous debout autour du couple jubilaire de mes arrière-grands-parents maternels lucernois, et je me réjouis à mon tour d’être un oncle irrégulier, car c’est cela même qui distingue le père, régulier, de l’oncle : c’est sa position diagonale et défaussée, qui le fait avancer comme le cavalier des échecs - le meilleure exemple de style de progression pour une jeunesse refusant de marcher au pas…
 PARLER À DIEU. - Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-mêmes. Mais savoir quand on prie vraiment...
PARLER À DIEU. - Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-mêmes. Mais savoir quand on prie vraiment...
Ou bien il y a cette parole involontaire que j’ai toujours cherché à retrouver, à l’image d’un Rozanov, dans son marmonnement unique, ou d’un Cingria quand il s’abandonne à son inspiration - cette parole qui porte elle aussi au-delà des mots, captée en deça de tout discours et modulant ce qu’on pourrait dire à la fois l’indicible et le tout-dire…
DE LA FRONTIÈRE. - S’il est un exercice sensible qui me captive à chaque fois que je passe une frontière, c’est bien le repérage de tel ou tel détail qui signale qu’on vient de passer d’un pays à l’autre. Du train descendant en grinçant la farouche vallée des Centovalli, qu’on atteint de Domodossola où tout exhale à l’évidence l’Italie du nord, l’observation nécessite une attention particulière, tant l’amont et l’aval semblent semblables par la densité des pentes forestières et l’herbe d’après la neige et les pluies, l’élancement et les bulbes des clochers également catholiques, la pierre des maisons anciennes et le béton des maisons plus récentes, et pourtant quelque chose s’est passé au passage de la frontière mais exactement quoi ? En entrant chez les gens cela ne ferait pas un pli : on le verrait à la forme des poignées de portes des cabinets ou à la forme particulière d’iceux. Critère basique de l’habitus, ainsi que le relevait Henri Calet à Territtet dans  Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train.
Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train.
Ce qu’on voit maintenant du train ce sont des villas jumelles comme il y en a désormais partout dans les provinces urbanisées d’Europe parvenue, et pourtant déjà se marque une nuance dans cette apparence de standardisation, perceptible comme est perceptible la différence de la ferme jurassienne suisse, à l’Auberson, et de la même ferme jurassienne française vers les Fourgs. Aussi les façons de finir le crépi d’un mur ou la taille d’une haie se modifient à vue d’œil, et c’est peut-être cela qui marque la différence : le fini. L’Helvète entend donner du fini à toute chose, et l’orgueil national en a fait un constat de longue date relevant pour ainsi dire de ce fait établi: que le travail swiss made est mieux fini. Sur la côte suisse du Léman, tout est joliment fini. En Savoie d’en face, au contraire: cela pèche du côté des finitions, mais c’est plus vivant je trouve, plus harmonieusement disharmonieux, cela ondule, cela ondule comme en Italie, et c’est pourquoi j’ai tant besoin d’Italie et de France pour mieux supporter la trop parfaite finition suisse.
 QUELQU’UN ÉCRIT. - Dans le texte intitulé Trois jours, Thomas Bernhard lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes au fil desquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, « et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ». Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ « en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit ».
QUELQU’UN ÉCRIT. - Dans le texte intitulé Trois jours, Thomas Bernhard lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes au fil desquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, « et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ». Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ « en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit ».
Quelqu’un qui écrit. On entend : quelqu’un, mais on n’entend pas qu’il écrit, parce qu’on est dedans, à la cave, dans le souffle, dans le corps de l'esprit mortel, au rythme de son pied vif qui bat la mesure, dans son âme exécrant d’amour, et c’est parti pour la musique...
Depuis Céline, Faulkner, Thomas Wolfe ou Robert Walser, il n’y a pas au monde une musique pareille, un pareil souffle, une pareille voix. J’ai mis un certain temps à percevoir toute la mélancolie et la pureté, toute la douleur et le sérieux de Thomas Bernhard, agacé par la secte de ses adulateurs aussi pâmés que les adulateurs de Robert Walser et Céline et Faulkner, et je ne crois pas être un inconditionnel pour autant de TB, son théâtre et sa poésie ne me touchent pas du tout autant que sa prose et dans sa prose bien de ses romans me semblent forcés par moments, à tout le moins inégaux, alors que les récits «autobiographique» me prennent par la gueule et ne me lâchent pas avant de me ramener à ma propre solitude et à ma rage et à ma haine du crayon et de la plume, au poids du monde et au chant du monde…
Celui qui trouve sa paix en répétant les mêmes gestes à longueur de journée / Celle que fascine le vol des martinets dans le ciel orageux de Cortone / Ceux qui errent à travers bois sur des chemins en pente, etc.
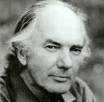 SALZBOURG, 1944. - En lisant L’Origine de Thomas Bernhard, et plus précisément l’évocation des bombardements de Salzbourg, en 1944, on voit mieux comment l’exagération, chez cet écrivain de l’outrance, tend à une sorte de vérité poétique d’épopée, un peu comme chez Céline – et je pense plus précisément à sa fuite à travers l’Allemagne et au fabuleux épisode de la traversée des ruines de Hanovre dans Nord.
SALZBOURG, 1944. - En lisant L’Origine de Thomas Bernhard, et plus précisément l’évocation des bombardements de Salzbourg, en 1944, on voit mieux comment l’exagération, chez cet écrivain de l’outrance, tend à une sorte de vérité poétique d’épopée, un peu comme chez Céline – et je pense plus précisément à sa fuite à travers l’Allemagne et au fabuleux épisode de la traversée des ruines de Hanovre dans Nord.
Quant à TB, sa remémoration n’est pas moins saisissante, avec le même genre de montées en crescendo aboutissant à des visions faites pour s’imprimer dans la mémoire du lecteur : «Dans les galeries elles-mêmes, où la plupart avaient déjà leurs places par droit héréditaire, c’était toujours les mêmes qui étaient ensemble, les gens avaient formé des groupes, ces centaines de groupes étaient assis tant bien que mal sur le sol pierreux durant des heures et maintes fois, quand l’air manquait et quand les gens s’évanouissaient par rangées entières tous se mettaient à crier puis il se refaisait souvent aussi un tel silence que l’on croyait que ces milliers de gens dans les galeries étaient déjà morts. Sur de longues tables de bois disposées pour cet usage on étendait les gens évanouis avant qu’on les traîne hors des galeries et il me souvient encore des nombreux corps de femmes entièrement nus sur ces tables que les secouristes, hommes et femmes, massaient et que très souvent nous-mêmes massions sous leur direction pour les maintenir en vie. Toute cette société des galeries, pâle, affamée et promise à la mort était de jour en jour et de nuit en nuit plus fantomatique. Accroupie dans les galeries, dans une obscurité uniquement remplie d’angoisse et sans aucun espoir, cette société promise à la mort parlait par surcroît toujours de la mort et de rien d’autre. Toutes les terreurs de la guerre dont ils avaient eu connaissance et qu’ils avaient personnellement vécues, des milliers de messages de mort arrivés de toutes les directions, de toute l’Allemagne et de toute l’Europe étaient discutés par tous dans ces galeries avec une grande insistance. Pendant qu’ils étaient assis dans ces galeries, ils répandaient librement dans l’obscurité qui régnait ici leur conviction de la ruine de l’Allemagne, de l’évolution toujours plus marquée du présent vers la catastrophe mondiale la plus grande qu’il y avait jamais eu et ils ne s’interrompaient que totalement épuisés… »
 MON AMI LE LOUP. – L’une de mes plus grandes joies, en tant que lecteur, a toujours été d’assister à l’éclosion d’une œuvre nouvelle. Dans un monde qu’Armand Robin disait celui de la «fausse parole», où la dévaluation et la prostitution du langage atteignent aujourd’hui des proportions babéliennes, l’émergence d’une voix réellement singulière, modulée en style sans pareil, me touche toujours autant que la redécouverte de tel ou tel grand livre. C'est dire que je ne cherche pas la nouveauté pour elle-même, mais l’expression, imprévisible à tout coup, d’une perception renouvelée des choses et des mots.
MON AMI LE LOUP. – L’une de mes plus grandes joies, en tant que lecteur, a toujours été d’assister à l’éclosion d’une œuvre nouvelle. Dans un monde qu’Armand Robin disait celui de la «fausse parole», où la dévaluation et la prostitution du langage atteignent aujourd’hui des proportions babéliennes, l’émergence d’une voix réellement singulière, modulée en style sans pareil, me touche toujours autant que la redécouverte de tel ou tel grand livre. C'est dire que je ne cherche pas la nouveauté pour elle-même, mais l’expression, imprévisible à tout coup, d’une perception renouvelée des choses et des mots.
J’aurai vécu un tel choc à la découverte des livres de Thomas Bernhard, puis à celle d’Antonio Lobo Antunes, et plus récemment dans l’amorce d’un livre soudain jailli comme d’une source, sous la plume de mon ami Marius Daniel Popescu qui ne savait pas, il y a dix ans de ça, un mot de français. Or c’est à la cristallisation d’une langue-geste originale, d’un style à la fois limpide et percutant, et d’un art de la narration jouant sur l’expression orale et l’alternance de multiples strates vocales, qu’on assiste dans La Symphonie du loup, à la naissance de laquelle j’ai assisté de tout près après avoir entendu, au fil de nos virées nocturnes, cent et mille esquisses orales de ce qui, selon moi, devait faire un vrai livre, m’incitant alors à enjoindre mon ami de « casser le morceau ».
Or le miracle s’est produit, car bien plus qu’un «récit de vie» ordinaire, c’est la transmutation d’un regard, à la fois candide et grave, et l’affirmation, tendre et violente, d’une perception poétique de la vie que représente ce livre enfin abouti après sept ans.
A propos des quatre premiers recueils de Marius Daniel Popescu parus en Roumanie, les auteurs d’une anthologie de la poésie roumaine écrivaient que «l’idéal de cette poésie transparente est de révéler la métaphysique des faits de chaque jour». Or ce qui frappe en effet, chez Popescu, tient à sa façon de «sacraliser» la plus humble réalité sans la désincarner pour autant, avec les mots les plus usuels. Les mots sont pour lui les signes rituels d’une sorte de baptême où chaque chose serait requalifiée au plus simple et au plus juste, dans une lumière épurée.
Dès l’ouverture, limpide et poignante, de La Symphonie du loup, le lecteur est saisi par la puissance expressive et narrative de l’auteur, évoquant initialement la scène capitale de son adolescence, au jour où lui fut annoncée la mort accidentelle de son père. D’emblée aussi, la modulation vocale du récit, par le truchement de la voix du grand-père paternel, figure tutélaire faisant pendant à celle du père disparu, inscrit cette remémoration dans le flux et les rythmes d’une véritable épopée personnelle au temps du Parti unique. Dans cette Roumanie de la dictature du « socialisme réel » dont nous découvrons peu à peu le décor déglingué et la vie quotidienne, avec une frise de personnages hauts en couleurs dont la vitalité expansive colore et réchauffe un univers teinté d’absurde, l’écrivain puise une substance romanesque effervescente, que son talent de romancier fixe en visions inoubliables, comme celle de tel cheval littéralement crucifié par des ouvriers désœuvrés.
En contrepoint de ces rhapsodies « gitanes » proches parfois de la transe, se dessine enfin le motif tout de douceur et de délicatesse de la vie présente de l’écrivain, où le fils éperdu se reconstruit dans son rôle de père attentionné et de « loup » pacifié.
 LE BALZAC DE SIMENON. – Formidable raccourci que le Portrait-souvenir de Balzac par Simenon. En une trentaine de pages claires et concentrées (écrites à Echandens en 1960, probablement d’une traite, en un jour), Simenon dit l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’auteur de La Comédie humaine que rien, en somme, ne prédisposait à aligner un chef-d’œuvre après l’autre et à donner au monde cette somme extraordinaire, conquise contre la frustration affective initiale et la patauderie de l’enfant-éléphant, la difficulté de vivre et de survivre, la maladie chronique (Simenon formule une hypothèse clinique précise) et les ennuis à n’en plus finir…
LE BALZAC DE SIMENON. – Formidable raccourci que le Portrait-souvenir de Balzac par Simenon. En une trentaine de pages claires et concentrées (écrites à Echandens en 1960, probablement d’une traite, en un jour), Simenon dit l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’auteur de La Comédie humaine que rien, en somme, ne prédisposait à aligner un chef-d’œuvre après l’autre et à donner au monde cette somme extraordinaire, conquise contre la frustration affective initiale et la patauderie de l’enfant-éléphant, la difficulté de vivre et de survivre, la maladie chronique (Simenon formule une hypothèse clinique précise) et les ennuis à n’en plus finir…
Je suis épaté par l’effort que tant d’auteurs consacrent à de si vains ouvrages, qui constituent la masse de la production des temps qui courent - vraiment cet effort de ne rien dire est impressionnant.
VOILÀ. - On entend beaucoup de «voilà» dans le discours actuel, comme en d’autre temps on a entendu des «j’veux dire» ou des «tu vois ce que j’veux dire ?». Or ce « voilà », plus catégorique, est significatif d’une époque où l’on ne se soucie plus tant de savoir si son interlocuteur « vois » ou pas ce que nous voulons lui dire. Chacune de nos phrases est ainsi ponctuée d’un « voilà » et voilà : c’est à prendre ou à laisser.
Le metteur en scène Untel, sur France Culture, présente ce matin sa nouvelle réalisation donnée pour un must du festival d’Avignon. Et de préciser en toute simplicité et modestie : ce que j’ai voulu faire c’est simplement ceci, voilà. C’est simplement ceci et cela qu’il me semble important de faire aujourd’hui. Voilà. Je ne sais pas si nous y avons réussi, mais l’équipe y a mis toute son énergie, voilà. Et dans la foulée la comédienne Unetelle, qui tient le rôle-titre dans le spectacle d’Untel, témoigne à son tour : moi aussi je pense que c’est important aujourd’hui de dire ceci et cela et de donner du sens au faire. Voilà. Voilà : c’est le sens du spectacle de jean-Fabrice. C’est ce que nous avons tenté de montrer, modestement, mais avec toute notre énergie, voilà. C’est vraiment ça que nous avons voulu montrer en toute modestie et simplicité. Voilà…
MUSIQUES PENSANTES. - Il y a chez Wittgenstein une pensée continue dont je me sens proche, parce qu’elle est à la fois une musique dans le temps, ce qui n’est pas le cas de Ludwig Hohl. Il y a cela aussi chez Rozanov et chez Buzzati, de même qu’on le trouve chez Annie Dillard: il y a chez ces écrivains une sorte de basse continue qui marque la présence d’une intimité fondamentale, et ce n’est pas autre chose que je cherche pour ma part à faire résonner.
Celui dont on a traité la vocation artistique aux électrochocs / Celle dont les yeux pers ont troublé divers gars du bourg / Ceux qui s’endorment dans le cinéma désert, etc.
 GREGUERIAS. - On revient à Gomez de La Serna comme à un inépuisable brocanteur d'images poétiques jamais en mal de nous étonner à tout moment comme à tout moment il s’étonne, et c’est précisément cela qui saisit le lecteur de ses Greguerias: c’est que ces petit fragments colorés d’un immense kaléidoscope semblent refléter toutes les heures du jour et des quatre saisons, et tous les goûts, toutes les humeurs de tous les âges de la vie: de la gaîté primesautière de l’écolier du matin, qui remarque par exemple que «les bœufs ont l’air de sucer et de resucer constamment un caramel », à la songerie mélancolique de l’homme vieillissant notant que « bien souvent nous nous lèverions pour faire notre testament, malgré que cela soit inutile, malgré que nous n’ayons rien à léguer à personne, mais uniquement pour faire notre testament; faire son testament; l’acte pur et sincère ».
GREGUERIAS. - On revient à Gomez de La Serna comme à un inépuisable brocanteur d'images poétiques jamais en mal de nous étonner à tout moment comme à tout moment il s’étonne, et c’est précisément cela qui saisit le lecteur de ses Greguerias: c’est que ces petit fragments colorés d’un immense kaléidoscope semblent refléter toutes les heures du jour et des quatre saisons, et tous les goûts, toutes les humeurs de tous les âges de la vie: de la gaîté primesautière de l’écolier du matin, qui remarque par exemple que «les bœufs ont l’air de sucer et de resucer constamment un caramel », à la songerie mélancolique de l’homme vieillissant notant que « bien souvent nous nous lèverions pour faire notre testament, malgré que cela soit inutile, malgré que nous n’ayons rien à léguer à personne, mais uniquement pour faire notre testament; faire son testament; l’acte pur et sincère ».
Il y a, chez ce fou de littérature à la production balzacienne, et touchant à tous les genres, un noyau doux et tendrement lumineux qui me semble le caractériser pour l’essentiel et le relier occultement au Rozanov des Feuilles tombées ou au Jules Renard du Journal, avec cette aptitude commune à décanter ce que Baudelaire, et Georges Haldas dans sa foulée, appellent les « minutes heureuses ».
Ce sont comme des épiphanies profanes, où nous est soudain révélé comme un surcroît de présence: « Dix heures du matin est une heure argentine, très riche en sonneries argentines et encourageantes... Dix heures du matin est une heure pleine d’un soleil diaphane, fluide et adolescent, même les jours nuageux, une heure pleine de clochette d’argent ». Ou bien: « Le soir, quand le jour baisse, on voit que la page blanche a sa propre lumière, sa propre lumière véritable ».
Ou encore: « Il y a un moment, à la tombée de la nuit, où quelqu’un ouvre les fenêtres des glaces, les dernières fenêtres de l’après-midi, ces fenêtres qui donnent une lumière plus vive que tout le reste, la suprême lumière ».
Ce que Michel Serres appelle « la libido d’appartenance » qui fait « aussi mâle rage que chez les rats », je l’ai vue à l’œuvre de tout près et je crois en avoir été guéri pour jamais.
 DE L’ÉTAT DE POESIE. - C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre.
DE L’ÉTAT DE POESIE. - C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre.
Nul «journal», sauf peut-être celui d’Amiel, ne nous plonge dans un tel état d’immersion, mais Amiel ne nous implique pas du tout de la même façon que les carnets d’Haldas. Nous pouvons aimer Amiel ou en être excédé, trouver admirable sa langue, sublimes ses évocations de paysages ou de moments du jour, pénétrantes ses analyses de caractères et ses portraits de femmes ou ses plongées en lui-même, passionnantes ses vues sur l’Histoire ou les œuvres des écrivains et des philosophes qu’il lit plume à la main, émouvants et parfois même bouleversants ses aveux candides, mais jamais Amiel ne nous porte à la présence, et même à l’«hyper-présence», pour citer Haldas lui-même, avec l’intensité et l’ardeur que suscite la lecture de L’Etat de Poésie.
C’est que nous touchons, avec ces carnets, à une expérience limite de la littérature. Maintes fois, Haldas a répété qu’il ne s’agissait pas d’un journal intime, précisant que ces carnets figurent l’«atelier intérieur» d’un «scribe voué à l’essentiel». Mais là encore on pourrait se tromper. Après tout, un Paul Nizon lui aussi nous plonge en état d’immersion et tient ses carnets d’atelier. Rien à voir cependant! Et rien non plus avec le Journal littéraire de Léautaud ni avec les Journaliers de Jouhandeau. Et ce n’est pas parce que la préoccupation religieuse, évangélique plus précisément, est de plus en plus présente dans les notes quotidiennes d’Haldas que celles-ci s’apparentent avec les journaux de Charles du Bos ou de Claudel, de Bloy ou de Calaferte. Pour la tentative de saisir à tout moment l’indicible, de capter le souffle même de la présence, de rendre une sorte de parole immédiate, nous pourrions évoquer les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, et pourtant L’Etat de Poésie est encore autre chose. Qu’est-ce alors? Disons que c’est une sorte d’exercice de présence continue, au gré d’un travail incessant d’absorption et de combustion. «Dans L’Etat de Poésie, il ne s’agit nullement de fournir des informations», explique le scribe pour la énième fois, «mais d’apporter une nouvelle manière de voir, de sentir et de dire ce que l’on voit et sent».
A tout moment Haldas se démarque du penseur («Dès que la souffrance entre en jeu, les théories s’effacent») ou du maître spirituel («le pire qui puisse nous arriver, c’est de donner dans l’élévation spirituelle»), comme il n’en finit pas de fustiger les littérateurs et leurs vanités, sans oublier le diablotin qui gigote en lui («On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même»), les pions qui parasitent ce qu’il y a de vivant dans la littérature et même la «haute foutaise» d’écrire, jamais content de ce qu’il fait lui-même (et l’on sent bien que ce n’est pas de la coquetterie, d’ailleurs la critique peut le faire tempêter aussi bien), mais non du tout par dépit esthétique (il est du genre à écrire mal pour mieux écrire vrai), bien plutôt par conscience de ne rendre qu'une infime partie de ce qu’il ressent ou pressent.
Et pourtant! Pourtant quel inépuisable filtre de vie que L’Etat de Poésie. Ainsi, pour ne citer qu’un jour, ces quelques notes: «Le sentiment parfois d’être un tronc vieillissant et creux mais grondant d’abeilles. Dont quelques-unes seules parviennent à s’échapper» - «Ces passages d’un train dont la rumeur, dans la campagne, le soir, lentement décroît - et c’est chaque fois un peu ma vie, avec l’enfance, qui se déchire» - «Il y a une douceur des choses qui par moments confine à la torture» - «Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».
Cependant, mais cela seul le lecteur peut le dire, ce «minable» nous désaltère et nous revigore. Lui qui dit n’avoir «rien écrit qui vaille» note tel matin ceci: «L’émotion devant une cour abandonnée, un vieux vélo contre un mur. Ainsi le bruit d’une fontaine, un ciel de novembre, la voix d’un être cher disant simplement «Quelle heure est-il?» (mais surtout l’intonation de cette voix)». Et toujours et encore ces «minutes heureuses», à l’opposé de l’exaltation convenue, qui nous surprennent aux moments les plus inattendus et diffusent leur douce lumière d’éternité, comme en cette aube où, après un séjour en Grèce, le scribe attend le bus qui l’emmènera à l’aéroport – et la lumière de Céphalonie lui restitue alors «un monde», comme on dit. Ou ces thèmes de plus en plus présents, évidemment liés à ses méditations évangéliques, du corps intime et de l’eau vive. Et cette consumation de tout instant: «Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».
DE LA POSTURE. - De quel peintre invisible sommes-nous les modèles ? De quel photographe de mode, les top models ? De quel concepteur d’events les intervenants prenant la pose ?
Ces graves questions, je me les pose en considérant la notion de posture intellectuelle qui s’est introduite dans le langage courant de ces dernières années.
Il y a une trentaine d’années de ça, la question qu’on nous posait sur un ton plus ou moins péremptoire était : d’où parlez-vous ? On ne parlait pas alors de posture mais au plus de position : il fallait préciser sa position. C’était certes moins cool qu’aujourd’hui, mais enfin on était supposé faire corps avec sa position : dire d’où on parlait signifiait qu’on se situait intellectuellement ou politiquement parlant. J’ai toujours refusé, quant à moi, de dire d’où je parlais, mais c’était mon affaire personnelle et vitale, contre ce que je croyais une police de la pensée et de la parole.
Or nous n’avons plus à dire, désormais, d’où nous parlons. Ce que nous disons ne fait plus corps avec ce que nous pensons ou ce que nous sommes: nous n’avons plus qu’à nous positionner en fonction de l’image que nous souhaitons donner durant notre quart d’heure ou notre quart de siècle de célébrité: nous nous réduisons à des postures.
Celui qui sait parler des blancs de Cézanne / Celle qui sent la peinture comme personne / Ceux qui rêvent en couleurs noircies au bitume de l’angoisse, etc.
 DE L’IDÉOLOGIE. - Je ne suis pas un homme d’idéologie mais un homme d’idées et d’expérience. Je vis d’expériences-idées. Les idées me viennent de l’expérience. L’idéologie m’a toujours serré aux entournures. Je n’y ai jamais été vraiment à l’aise. C’est pourquoi des idéologues comme Philippe Muray, malgré tout, me rebutent. M’intéressent sans me convaincre jamais, tant je reste attentif à la complexité de la vie. Lire le dernier roman de François Emmanuel, Regarde la vague, parallèlement à la lecture d’ Après l’Histoire, me rappelle assez où est mon camp.
DE L’IDÉOLOGIE. - Je ne suis pas un homme d’idéologie mais un homme d’idées et d’expérience. Je vis d’expériences-idées. Les idées me viennent de l’expérience. L’idéologie m’a toujours serré aux entournures. Je n’y ai jamais été vraiment à l’aise. C’est pourquoi des idéologues comme Philippe Muray, malgré tout, me rebutent. M’intéressent sans me convaincre jamais, tant je reste attentif à la complexité de la vie. Lire le dernier roman de François Emmanuel, Regarde la vague, parallèlement à la lecture d’ Après l’Histoire, me rappelle assez où est mon camp.
CEUX QUI VONT EN JUSTICE. - Celui qui réapparaît menottes aux poings / Celle qui a porté plainte contre le Prince Charmant / Ceux qui voient la vie de leur enfant exposée aux regards du Tribunal / Celui qui se demande ce qu’il serait devenu avec un père ivrogne dans un pays en guerre et plus ou moins douze frères et sœurs si l’accusé n’a pas menti sur cela aussi / Celle qui regarde la mère de la victime de son point de vue de juge déjà grand-mère / Ceux qui violent et violentent tous les jours que Dieu fait en toute impunité / Celui qu’émeut l’humanité de la Cour / Celle qui sent la glace de la réalité la transir / Ceux qui découvrent que leur enfant est une femme / Celui qui tourne en rond dans la cage du non-langage / Celle qui se fait arracher les derniers aveux de son aveugle passion de jeune fille / Ceux qui se rappellent leurs vingt ans / Celui qui plaide en tennis / Celle qui constate que les transcriptions de ses dépositions n’ont rien retenu de l’essentiel de ce qu’elle a enduré / Ceux que choque le trop jeune avocat stagiaire qui taxe son client de salaud et de lâche pour le disculper de l’accusation d’être un violeur / Celui qui a ouvert sa maison au barbare en connaissance de cause / Celle qui a ouvert son cœur au barbare avant de ramasser ses slips sales / Ceux qui trouvent toutes les excuses au barbare / Celui qui estime que sa cause est jugée d’avance vu qu’il est né du mauvais côté / Celle que le barbare a fascinée avant de sentir la pointe de son couteau sur sa gorge / Ceux qui se barricadent dans le déni / Celui qui estime avec ses compères du Bar 421 que toutes les femmes sont des putes et des salopes à dresser sauf leur mère / Celle qui souffre de se rappeler tout ce qu’elle a aimé de ce nul / Ceux qui envient cette passion de jeunesse tout à fait stupide selon les critères de la Raison / Celui qui se réjouit de remonter sur son voilier de 18m. après avoir jugé ce pauvre type mal barré à vie selon son expérience / Celle que la tristesse terrasse à l’instant où justice lui est rendue / Ceux qui se réjouissent de tourner la page / Celui qui s’est reconstruit en taule / Celle qui estime que cette cause qu’elle a défendue en tant que substitut du procureur devait l’être bec et griffes pour le bien des petites écervelées qu’abusent encore des machos à couilles rabattues / Ceux qui ramènent tout à un excès de testostérone comme au Tour de France enfin tu vois quoi / Celui qui espère sans se faire trop d’illusions que trois ans de travaux agricoles et horticoles adouciront cette petite brute / Celle qui redoute de revoir un jour l’Homme de Sa vie au coin d’une rue / Ceux qui se sont faits à l’idée que les frasques les plus cuisantes du père seront répétées par le fils, et que la fille ne sera pas une oie moins blanche que la mère, etc.
(Notes prises au tribunal, avec les miens, les 15 et 16 juillet)
 LE VOYAGEUR ÉMERVEILLÉ. - Au commencement, le jeune Vernet (il a vingt-six ans et laisse une fiancée à Genève, prénommée Floristella) voyage tout seul en Croatie puis en Bosnie, jusqu’à l’arrivée de son ami « Nick » qui le rejoint à Belgrade en juillet. D’emblée, cependant, se manifeste un don d’observation et d’expression qui rompt pour le moins avec la gravité calviniste, évoquant tantôt Cingria par sa fantaisie et la découpe de sa phrase, ou Vialatte par sa faconde cocasse et son bon naturel. S’il lui faut bien quelque temps pour larguer vraiment les amarres (la moindre lettre des siens est attendue avec fébrilité), c’est ensuite avec une curiosité et un enthousiasme de (presque) tous les jours qu’il découvre les lieux et les gens, vivant autant qu’il peint et écrivant pour le revivre en le racontant. Son mot d’ordre est vite trouvé : « Le secret du bon moral : SORTIR DE SOI-MÊME », écrit-il ainsi avec son solennel humour. Et de fait, le contact avec les gens, l’observation du monde, l’aquarelle ou ces lettres, tout le porte à sortir de la contention solitaire.
LE VOYAGEUR ÉMERVEILLÉ. - Au commencement, le jeune Vernet (il a vingt-six ans et laisse une fiancée à Genève, prénommée Floristella) voyage tout seul en Croatie puis en Bosnie, jusqu’à l’arrivée de son ami « Nick » qui le rejoint à Belgrade en juillet. D’emblée, cependant, se manifeste un don d’observation et d’expression qui rompt pour le moins avec la gravité calviniste, évoquant tantôt Cingria par sa fantaisie et la découpe de sa phrase, ou Vialatte par sa faconde cocasse et son bon naturel. S’il lui faut bien quelque temps pour larguer vraiment les amarres (la moindre lettre des siens est attendue avec fébrilité), c’est ensuite avec une curiosité et un enthousiasme de (presque) tous les jours qu’il découvre les lieux et les gens, vivant autant qu’il peint et écrivant pour le revivre en le racontant. Son mot d’ordre est vite trouvé : « Le secret du bon moral : SORTIR DE SOI-MÊME », écrit-il ainsi avec son solennel humour. Et de fait, le contact avec les gens, l’observation du monde, l’aquarelle ou ces lettres, tout le porte à sortir de la contention solitaire.
Par ailleurs, Thierry Vernet n’est pas qu’un peintre qui écrit : l’expression, naturellement « littéraire », quoique spontanée, souvent familière (il multiplie les genevois « c’est bonnard ! »), est à la fois élégante et très précise, originale, consciente d’elle-même aussi : « Ce grand voyage sera un peu comme un roman passionnant dont le début est difficile. Chaque page tournée, chaque jour passé m’engage un peu plus dans l’action. Persévérer. » Et plus il écrira, meilleur écrivain il se révélera au fil des mois, avec des pages d’anthologie évidemment en « prise directe » sur les péripéties du « grand voyage».
De ce grand voyage, on connaît le récit quintessencié que représente L’usage du monde de Nicolas Bouvier, devenu le « livre culte » de beaucoup de voyageurs contemporains. A cet ouvrage combien stylisé, décanté à travers les années et travaillé, tenu et contenu, les lettres de Thierry Vernet apportent aujourd’hui comme un double radieux et profus ; bien plus qu’un « témoignage » qui resterait en somme secondaire : un complément d’une incomparable générosité de couleurs et de saveurs.
 JACQUES ROMAN. - L’image est un peu éculée, du poète considéré comme un veilleur, et pourtant c’est bien cette figure qu’incarne Jacques Roman toutes les nuits dans sa thébaïde solitaire ouverte sur le ciel lémanique, à Lausanne, à poursuivre son Ouvrage de l’insomnie, tissé de fragments où l’émotion tripale, la mémoire, la pensée en alerte et la langue ne cessent de travailler la matière au corps.
JACQUES ROMAN. - L’image est un peu éculée, du poète considéré comme un veilleur, et pourtant c’est bien cette figure qu’incarne Jacques Roman toutes les nuits dans sa thébaïde solitaire ouverte sur le ciel lémanique, à Lausanne, à poursuivre son Ouvrage de l’insomnie, tissé de fragments où l’émotion tripale, la mémoire, la pensée en alerte et la langue ne cessent de travailler la matière au corps.
«J’ai appris à vivre comme un compositeur qui s’entendrait dire chaque jour que son œuvre ne sera jamais jouée », écrit Jacques Roman qui ne cesse pourtant de publier (sa bibliographie compte trente titres…) et d’apparaître sur nos scènes, à dire les textes des autres, mais c’est autre chose qu’il signifie : comme si l’écriture vécue à sa pointe était encore insuffisante: « On eût voulu se faire aimer non pour soi mais pour ce qui nous traversait immense et qui à tous appartenait »…
C’est ainsi comme un auteur anonyme, éminemment personnel mais comme parlant en nos noms multiples, que nous suivons dans ses tâtons éclairés de loin en loin par des éclairs ou des lueurs plus douces, ainsi : « Il y a des êtres et des lieux rencontrés dont je n’ai plus mémoire de noms mais bonheur ! Dans leurs parages je me souviens d’escaliers embaumant la cire, de draps frais, de café au lait, de petit jour et de douce hospitalité ».
Comme dans la remémoration proustienne, mots et objets conjuguent leur magie pour engendrer une nouvelle réalité et « sauver » ce qu’on croyait perdu. Le seul mot de betterave restitue ainsi un monde à l’enfant abandonné par sa mère: « Au lieu où je fus placé en nourrice, le champ des morts, sa place est en plein champ de betteraves. »
Dans le même ordre des épiphanies familières, on relèvera notamment: « Le petit tableautin qu’était l’ardoise : le plaisir de la mouiller à l’aide de l’éponge, en tirer le noir profond puis, lentement, la voir se voiler de gris. L’expression de la pensée a toujours ce gris-là » Ou cela aussi: « Le toucher contient plus de visages qu’un miroir ».
En outre se multiplient les traits d’impatience face à un monde qui s’avilit ou sombre dans l’apathie repue: « J’écris, moi, depuis un pays qui se méfie des pays. La Suisse (c’est le nom du pays où je survis) draine une avarice que masque sa richesse ». Et cela: « Ce pays semble assimiler l’artiste à un « cas social ». Et comme la folie y est répandue, enfin, une folie calme, une folie d’au bout de la route quand la bête est matée (un bon fou y est un fou mou), on se demande si le Suisse ne soupçonne pas l’artiste d’être la cause de toute cette folie et pire ! celui qui pourrait en ébranler la masse folle et molle. L’artiste est donc un dissimulateur dangereux qu’il convient de remettre à sa place : nulle part». Mais le désir et le plaisir ne cessent de relancer l’acte d’écrire ou de transmettre qui anime Jacques Roman, écrivant encore, dans L’Aire des étreintes : « Qu’est cela qui t’étreint et dit oui à ce tremblement de ta vie ? Est-ce cela qui déjà, enfant, d’une merveilleuse ignorance te voyait collé à la cloison des nuits, l’étreinte des questions ?
 VISIONS DE VERNET. - C’était un soir en Provence. Le jour n’en finissait pas de finir. L’on se croyait hors du temps, comme à l’abri de tout. Or de ce moment privilégié, non de béatitude passive mais d’adhésion généreuse au monde alentour, vous vous rappelez à présent la douce musique avec nostalgie en retrouvant ce ciel d’ambre velouté sur les tuiles chaudes et les arbres encore embrumés par la touffeur de fin de journée; et cette lumière orange vous remémore, aussi, vos interminables soirées en enfance, quand la nuit paraissait se retenir d’interrompre vos jeux.
VISIONS DE VERNET. - C’était un soir en Provence. Le jour n’en finissait pas de finir. L’on se croyait hors du temps, comme à l’abri de tout. Or de ce moment privilégié, non de béatitude passive mais d’adhésion généreuse au monde alentour, vous vous rappelez à présent la douce musique avec nostalgie en retrouvant ce ciel d’ambre velouté sur les tuiles chaudes et les arbres encore embrumés par la touffeur de fin de journée; et cette lumière orange vous remémore, aussi, vos interminables soirées en enfance, quand la nuit paraissait se retenir d’interrompre vos jeux.
Ou c’était une nuit dans le jardin de cette villa. A un moment donné, après les réjouissances de l’amitié, vous vous étiez retrouvé seul parmi quelques chaises dispersées sur la pelouse, et là-bas, au bord de la terre, le ciel d’avant l’aube déversait son immensité vertigineuse. Ou encore c’était, émergés d’une brume de limbes, ces murs de Belleville marquant, de leurs bornes friables, le passage d’un monde ou d’un temps à l’autre. Ou c’était dans un bistrot le matin, ce couple au double visage confondu de fresque égyptienne. Ou bien en rase campagne, dans le silence immatériel de midi pile. Ou dans le métro. En forêt. Sur la grève d’Ostende. Ou dans cette chambre de l’Hôtel Universel dont le miroir a tout vu de l’homme. Enfin partout où le mystère affleure dans ces lumières concentrant à tout coup la même présence tissée de mélancolie et de tendresse, d’attente et de reconnaissance.
Plus qu’un peintre de la lumière, au sens de la contemplation seule, Thierry Vernet me paraît un poète du dévoilement dont les visions ponctuent la démarche tantôt somnambulique et tantôt fulgurante. On est là comme dans un grand rêve d’une seule coulée, où les images et les figures du monde présumé réel se trouvent ressaisies et transformées avec ce surcroît d’être qui signale toute alchimie poétique, par le truchement de la seule peinture.
Car cela prime à l’évidence chez Thierry Vernet : ses visions, les événements qui le sollicitent, l’essentiel de ses Riches Heures tiennent d’abord à la peinture. Comme le poème naît des mots surgis de nos profondeurs, la vision de Thierry Vernet semble poussée toute faite, jaillie avec ses couleurs. Ce n’est pas dire que la toile se fasse toute seule, mais souligner un acte qui suppose à la fois une longue patience et une aptitude féline au bond.
Regardez les couleurs du monde : il y a de quoi s’émerveiller à n’en plus finir, et c’est souvent à n’y pas croire. D’ailleurs c’est une constante chez ce peintre de l’étonnement profond : à chaque fois on est surpris, et jusque dans ses visions les plus sereines apparemment. C’est ainsi que de vivre, depuis des années, avec telle toile de Thierry Vernet que j’ai reconnue et aimée au premier regard, m’aura fait éprouver, à chaque fois que je tournais vers elle mon regard, comme à une fenêtre à laquelle on ne se lasserait pas de s’accouder, ce même sentiment mêlé de saisissement et de gratitude devant la beauté des choses. Cela s’intitule La plage le soir, c’est un bord de mer, avec un premier plan de sable ocre doux, un plan d’eau qui entremêle du blanc à nuances vert céladon et toutes sortes de bleus aérés ou délayés, une pinède dont l’olivâtre virant au noir palpite de mystère comme chez Böcklin, enfin un ciel d’un seul gris tendre où flotte un grand poisson-nuage. Mais mes pauvres mots ne disent rien de l’essentiel qui ne peut que se voir, tenant à l’événement de formes et de couleurs et de tons et de rapports de tons et de tensions et d’accords et de touches tour à tour si véhéments et si délicats, dont l’ensemble tisse l’atmosphère de songerie métaphysique de la toile.
Telle est la part contemplative de Thierry Vernet, son côté franciscain en sandales, modeste et ravi. Mais aussi, l’artiste fulgure. Il y a chez lui de l’incendiaire formel et du pyrotechnicien à polychromies effrénées. Est-ce bien le même peintre qui, dans certaines natures mortes ou paysages, touche au dépouillement des silencieux à la Morandi, tandis que, revenant de Java, le coloriste exulte dans la profusion ?
Oui sans doute : il n’y a qu’un peintre chez lui, au sens où sa matière, en se renouvelant sans cesse, reste toujours pétrie de la même pâte fluide à lueurs de sous-bois ou à éclairs, onctueuse ou brûlante, soumise au même geste impérieux, rapide et léger comme un coup d’aile, précipitant, à des vitesses opposées, la même vision.
RENAISSANCE. - Après le moment de noir qui m’accable chaque matin, je reviens à la vie en buvant mon café à la fenêtre d’où je vois le monde émerger lui aussi du noir en beauté ; et ce mot me sauve alors : ce mot de beauté.
Aussi, ces carnets m’aident à me retrouver, chaque jour après l’autre, c’est le bout de bois flotté à quoi je m’accroche pour ne pas sombrer.
Sa qualité de porosité fait de Shakespeare l’écrivain des écrivains, plus encore que Baudelaire qui a pourtant tout senti lui aussi. Mais à la porosité s’allie l’effort de transmutation sans lequel la porosité ne serait qu’une disposition spongieuse et passive. La poésie est un acte.
 JE ME SOUVIENS. – Dans la nuit du 15 août 2002, après avoir appris, au milieu des édéniques jardins de la Casa Hermann Hesse, à Montagnola, que ma mère venait d’être frappée par une attaque cérébrale qui devait lui être fatale après dix jours de coma, je notai, sur la banquette du train, ces bribes de mémoire que j’emporte partout avec moi et que je relis à l’instant :
JE ME SOUVIENS. – Dans la nuit du 15 août 2002, après avoir appris, au milieu des édéniques jardins de la Casa Hermann Hesse, à Montagnola, que ma mère venait d’être frappée par une attaque cérébrale qui devait lui être fatale après dix jours de coma, je notai, sur la banquette du train, ces bribes de mémoire que j’emporte partout avec moi et que je relis à l’instant :
Je me souviens d’elle dans la cuisine de la maison natale, auprès de l’ancien petit poêle à bois, tandis que je regardais les photos du Livre des desserts du Dr Oetker.
Je me souviens d’elle en bottes de caoutchouc, maniant une batte de bois, dans la buée de la chambre à lessive.
Je me souviens de ses photos de jeune fille en tresses.
Je me souviens d’avoir été méchant avec elle, une fois, vers ma quinzième année.
Je me souviens de sa façon de nous appeler à table.
Je me souviens de son assez insupportable entrain du matin, quand elle ouvrait les volets en les faisant claquer.
Je me souviens de sa façon de dire pendant la guerre...
Je me souviens quand elle nous lisait Papelucho, la série des Amadou ou Londubec et Poutillon.
Je me souviens de l’avoir surprise toute nue, une fois, en entrant par inadvertance dans la chambre à coucher des parents: je me souviens de sa forêt...
Je me souviens de nos dimanches matin dans leur lit.
Je me souviens de sa façon de nous seriner l’importance de l’économie.
Je me souviens du grand baquet de bois, pour les grands, et du petit baquet de fer, pour les petits.
Je me souviens de son explication confuse, rapport aux pattes qu’elle suspendait à la lessive: que c'était pour les dames...
Je me souviens de sa discrétion (timidité) et de son indiscrétion (naïveté).
Je me souviens de sa lettre indignée à Kaspar Villiger, ministre des finances, à propos du sort réservée aux vieilles personnes dans ce pays de nantis.
Je me souviens de ses bas opaques.
Je me souviens du cahier noir qu’elle a rédigé après la mort de notre père.
Je me souviens de sa façon de me recommander de ne pas trop travailler.
Je me souviens de sa façon de faire ses comptes.
Je me souviens de sa façon de préparer les salaires de nos filles.
Je me souviens de ses derniers trous de mémoire.
Je me souviens de sa collection de chèques de voyage.
Je me souviens de sa querelle, à propos de la facture de l’entretien d’une pierre tombale de sa belle-mère que sa belle-soeur ne voulait pas l’aider à régler.
Je me souviens des petits repas de nos dernières années, au Populaire, où elle me recommandait toujours de ne pas «faire de folies».
Je me souviens de leur façon de préparer Noël dans la maison, notre père et elle.
(Dans le train de Locarno à Lucerne, ce 14 juin 2007, jour de mes soixante ans)
 CONTRE LES CUISTRES. - Tzvetan Todorov est un grand lettré que sa nature puissante et douce à la fois ne pousse pas aux vociférations pamphlétaires, et pourtant son dernier livre, La littérature en péril, mène un combat très ferme aux arguments à la fois nuancés et clairs qui ouvrent un vrai débat sur la littérature française contemporaine, et plus précisément son enseignement et sa transmission, loin des polémiques parisiennes éruptives qui renvoient les uns et les autres dos à dos sans déboucher sur rien .
CONTRE LES CUISTRES. - Tzvetan Todorov est un grand lettré que sa nature puissante et douce à la fois ne pousse pas aux vociférations pamphlétaires, et pourtant son dernier livre, La littérature en péril, mène un combat très ferme aux arguments à la fois nuancés et clairs qui ouvrent un vrai débat sur la littérature française contemporaine, et plus précisément son enseignement et sa transmission, loin des polémiques parisiennes éruptives qui renvoient les uns et les autres dos à dos sans déboucher sur rien .
Que dit Tzvetan Todorov d’important ? Que la découverte de soi et du monde que vivifie (notamment) la littérature par la lecture et le débat se transforme aujourd’hui en discours de spécialistes « sur » la littérature et plus encore : sur la critique, et plus encore : sur certaines approches critiques réduisant la littérature à tel ou tel objet ou segment d’objet. Ainsi les élèves d’aujourd’hui apprennent-ils «le dogme selon lequel la littérature est sans rapport avec le reste du monde et étudient les seules relations des éléments de l’œuvre entre eux ».
Or, cette approche est-elle à proscrire ? Nullement, sauf à constater qu’elle devient, sous prétexte de scientificité, la seule recevable et l’arme d’un nouveau dogmatisme scolastique qui fait obstacle au libre accès des textes : « La connaissance de la littérature n’est pas une fin en soi, écrit Todorov, mais une des voies royales conduisant à l’accomplissement de chacun. Le chemin dans lequel est engagé aujourd’hui l’enseignement littéraire, qui tourne le dos à cet horizon (cette semaine on a étudié la métonymie, la semaine prochaine on passe à la personnification) risque, lui, de nous conduire dans une impasse – sans parler de ce qu’il pourra difficilement aboutir à un amour de la littérature ».
Voici prononcée l’obscène formule : « l’amour de la littérature ». Horreur horrificque, qui s’oppose absolument aux « perspectives d’étude » qu’annonce le Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale, cité par Todorov, lequel a siégé lui-même au Conseil national des programmes: « L’étude des textes contribue à former la réflexion sur : l’histoire littéraire et culturelle, les genres et les registres, l’élaboration de la signification et la singularité des textes, l’argumentation et les effets de chaque discours sur les destinataires ». Ainsi les études littéraires ont-elles «pour but premier de nous faire connaître les outils dont elles se servent », ajoute Todorov : « Lire des poèmes et des romans ne conduit pas à réfléchir sur la condition humaine, sur l’individu et la société, l’amour et la haine, la joie et le désespoir, mais sur des notions critiques, traditionnelles ou modernes. A l’école, on n’apprend pas de quoi parlent les œuvres mais de quoi parlent les critiques. »
Tel est la première observation de Tzvetan Todorov dans La littérature en péril, qui commence très loyalement par expliciter sa trajectoire personnelle, du structuralisme «dur» de ses débuts, à l’enseigne duquel il a donné ses premiers travaux de spécialiste du formalisme russe, notamment, dans les années 60 en compagnon de route de Barthes ou Genette, jusqu’au moment où, au milieu des années 70, son goût pour les méthodes de l’analyse littéraire, s’est atténué au profit d’une vision beaucoup plus large des textes et du rapport à ceux-ci, qui l’ont conduit à ces grands livres à valeur anthropologique que sont La conquête de l’Amérique, Face à l’extrême ou, tout récemment, Les Aventuriers de l’absolu.
A cet égard, il serait ridicule d’incriminer le « passé » du spécialiste pour dauber sur ses positions actuelles, alors que toute son évolution procède de la même ouverture au monde et du même approfondissement du sens de la littérature, qui se donne en toute simplicité et surtout en toute humilité : « Nous, spécialistes, critiques littéraires, professeurs, ne sommes, la plupart du temps, que des nains juchés sur les épaules des géants », affirme-t-il ainsi, avant d’écrire ceci qui paraîtra d’un «plouc humaniste» aux gardiens du temple doctrinaire et me semble, à moi, l’émanation même d’une passion à partager: «Si je me demande aujourd’hui pourquoi j’aime la littérature, la réponse qui me vient spontanément à l’esprit est : parce qu’elle m’aide à vivre. Je ne lui demande plus tant, comme dans l’adolescence, de m’épargner les blessures que je pourrais subir lors des rencontres avec des personnes réelles; plutôt que d’évincer les expériences vécues, elle me fait découvrir des mondes qui se placent en continuité avec elles et me permet de mieux les comprendre. Je ne crois pas être le seul à la voir ainsi. Plus dense, plus éloquente que la vie quotidienne mais non radicalement différente, la littérature élargit notre univers, nous incite à imaginer d’autres manières de la concevoir et de l’organiser. Nous sommes tous faits de ce que nous donnent les autres êtres humains: nos parents d’abord, ceux qui nous entourent ensuite ; la littérature ouvre à l’infini cette possibilité d’interaction avec les autres et nous enrichit donc infiniment. Elle nous procure des sensations irremplaçables qui font que le monde réel devient plus chargé de sens et plus beau. Loin d’être un simple agrément, une distraction réservée aux personnes éduquées, elle permet à chacun de mieux répondre à sa vocation d’être humain».
Le contenu polémique de La littérature en péril paraîtra trop vague ou trop général à d’aucuns, mais cela tient au fait que Todorov considère essentiellement une idée de fond : à savoir que l’idéologie dominante, dans le milieu littéraire et académique français actuel, consiste à nier le lien de la littérature avec le monde, lequel est soit noirci par les professeurs de désespoir, soit confiné dans le solipsisme et l’autofiction. Tout cela est évidemment contredit pas une quantité de livres, mais Todorov indique une tendance, et comment la nier ? Quel grand roman français accomplit, sur la période de 1945 à nos jours, le travail de ressaisie de la réalité effectué aux Etats-Unis par tant d’auteurs, à commencer par Philip Roth dans sa Trilogie américaine, et avant lui Saul Bellow, ou le Tom Wolfe du Bûcher des vanités, pour ne citer que quelques astres d’une constellation qui ne cesse de se renouveler jusque, récemment, avec Richard Powers ou William Gass ?
Or ce que montre aussi l’auteur de La littérature en péril, c’est que cette idée du découplage de la littérature, par rapport à la réalité, ne date pas d’hier. Et de refaire son historique, du temps où l’art parfait, selon Aristote, était celui qui imiterait le mieux la nature, jusqu’au temps où se ferait jour la conception d’un « art pour l’art », dont l’expression apparaît pour la première fois sous la plume de Benjamin Constant. Celui-ci affirme pourtant, avec Madame de Staël, que la littérature est liée au monde à tous points de vue : « La littérature tient à tout. Elle ne peut être séparée de la politique, de la religion, de la morale. Elle est l’expression des opinions des hommes sur chacune de ces choses. Comme tout dans la nature, elle est à la fois effet et cause. La peindre comme un objet isolé, c’est ne pas la peindre ».
Si, pour les Lumières, la littérature reste une connaissance du monde, Baudelaire le super-esthète hyper-réaliste va plus loin encore, qui dit dans une lettre à Toussenel que « l’imagination est la plus scientifique des facultés parce qu’elle seule comprend l’analogie universelle », ou encore que « L’imagination est la reine du vrai ». Soit dit en passant, l’on relèvera que Maurice G. Dantec ne dit pas autre chose quant il exalte la fiction « plus-que-réelle »…
Baudelaire, donc, aspire encore à une vérité de dévoilement, qui reste entée sur le monde réel, tandis que la volonté de créer une beauté ex nihilo marquera la rupture. Cela a commencé avec l’esthétisme d’un Winckelmann et fera florès dès le début du XXe siècle avec les formalistes russes, entre autre. Ainsi Khlebnikov revendiquera-t-il le « verbe autonome » ou le « mot comme tel ». Cela préludant à une dérive qui aboutira au byzantinisme critique contemporain où les doctes feront la pige aux créateurs, les techniciens réductionnistes la nique aux artisans du verbe.
Après l’hommage de Freud à la littérature, Tzvetan Todorov détaille, exemples émouvants à l’appui (celui de John Stuart Mill sauvé de la dépression par la lecture des poèmes de Wordsworth, ou de Charlotte Delbo trouvant réconfort dans sa prison grâce aux livres), en quoi la littérature nous est aussi vitale que l’air que nous respirons. « Quand je suis plongé dans le chagrin, je ne peux que lire la prose incandescente de Marina Tsvetaeva, tout le reste me paraît fade », écrit-il.
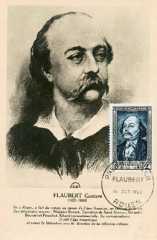 La force de la littérature, qui nous fait participer au sort commun, tient à nous aider à «penser en se mettant à la place de tout autre être humain », selon l’expression de Kant dans la Critique de la faculté de juger. Et c'est vrai aussi pour le dialogue entre écrivains. Dans le dernier chapitre de La littérature en péril, Tzvetan Todorov, citant les lettres échangées par George Sand et Flaubert, montre que deux positions très différentes, voire opposées, peuvent se compléter pour la défense d’une littérature échappant au dogmatisme. « Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le Faux », écrit Flaubert dont l’œuvre ne saurait pour autant, et Sand le sait mieux que quiconque, se réduire à une affaire d’assonances ou de répétitions. Entre Flaubert qui dit avoir « la vie en haine », et Sand qui aime chaque jour un peu plus le présent de la vie, l’échange reste possible car tous deux aspirent à la même connaissance par d’autres chemins – tous deux vivent la littérature sans la réduire à des schémas, et qui dirait que Sand a plus raison que Flaubert ou vice versa ?
La force de la littérature, qui nous fait participer au sort commun, tient à nous aider à «penser en se mettant à la place de tout autre être humain », selon l’expression de Kant dans la Critique de la faculté de juger. Et c'est vrai aussi pour le dialogue entre écrivains. Dans le dernier chapitre de La littérature en péril, Tzvetan Todorov, citant les lettres échangées par George Sand et Flaubert, montre que deux positions très différentes, voire opposées, peuvent se compléter pour la défense d’une littérature échappant au dogmatisme. « Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le Faux », écrit Flaubert dont l’œuvre ne saurait pour autant, et Sand le sait mieux que quiconque, se réduire à une affaire d’assonances ou de répétitions. Entre Flaubert qui dit avoir « la vie en haine », et Sand qui aime chaque jour un peu plus le présent de la vie, l’échange reste possible car tous deux aspirent à la même connaissance par d’autres chemins – tous deux vivent la littérature sans la réduire à des schémas, et qui dirait que Sand a plus raison que Flaubert ou vice versa ?
Ennemi du didactisme en littérature, mais non moins attaché à une littérature liée organiquement à la vie, Benjamin Constant écrivait que « la passion imprégnée de doctrine, et servant à des développements philosophiques, est un contresens sous le rapport artiste ». Ce n’est pas, pour autant, condamner les techniques internes et externes d’approche des textes, mais simplement remettre chaque chose à sa place et le poète, le romancier, le critique, le professeur, le linguiste, le sociologue à la leur, en ramenant finalement le lecteur à l’essentiel : le sens d’un texte, sa beauté, sa polysémie, sa musique, ses échos à n’en plus finir.
Je me rappelle à l’instant une belle conversation avec Jacqueline de Romilly, qui me disait la reconnaissance de nombreux anciens étudiants non-littéraires auxquels les « humanités » avaient donné une assise intellectuelle et affective, morale ou spirituelle que les seules connaissances jugées « utiles » ne leur auraient jamais procurée. Des Médecins, des scientifiques, des juristes, des politiciens, un chorégraphe, tous se réjouissaient d'avoir souffert sur leur version latine ou grecque...
Tzvetan Todorov ne dit pas autre chose : « Quelle meilleure introduction à la compréhension des conduites et des passions humaines qu’une immersion dans l’œuvre des grands écrivains qui s’emploient à cette tâche depuis des millénaires ? Et du coup : quelle meilleure préparation à toutes les professions fondées sur les rapports humains ? Si l’on entend ainsi la littérature et si l’on oriente ainsi son enseignement, quelle aide plus précieuse pourrait trouver le futur étudiant en droit ou en sciences politiques, le futur travailleur social ou intervenant en psychothérapie, l’historien ou le sociologue ? Avoir comme professeurs Shakespeare et Sophocle, Dostoïevski et Proust, n’est-ce pas profiter d’un enseignement exceptionnel ? »
Ces vues sembleront simplistes, voire simplettes, aux spécialistes ès littérature dont les recherches se nourrissent des recherches de chercheurs payés pour chercher ce que d'autres chercheurs citeront dans leurs recherches. Or c’est avec reconnaissance, pour ma part, que j’ai lu La littérature en péril après avoir constaté à quel point, jusque dans une publication destinée au plus large public, le nouvel esprit « scientifique » pouvait desservir, voire dénaturer, asphyxier la littérature vivante.
 Je veux parler des commentaires introductifs aux Œuvres complètes de C.F. Ramuz, en cours d’élaboration aux éditions Slatkine, à Genève, dont un seul échantillon donnera le ton, propre à éloigner tout lecteur non initié aux six fonctions de Jakobson ou aux six actants de Greimas. Cela se trouve dans le paragraphe de l’Introduction sous-intitulé Au rythme de la vie et traite de l'aimable roman-reportage ethno-littéraire intitulé Le village dans la montagne: « Un survol des et de l’écriture ramuzienne conduit à deux constats. La récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité; en même temps, cette instance apparaît comme débordée par les événements, à la fois omniprésente et impuissante donc. Dans ce contraste entre subjectivation de l’énonciation et retrait dans l’organisation, la figure du narrateur du Village dans la montagne se construit comme celle d’un anti-démiurge. »
Je veux parler des commentaires introductifs aux Œuvres complètes de C.F. Ramuz, en cours d’élaboration aux éditions Slatkine, à Genève, dont un seul échantillon donnera le ton, propre à éloigner tout lecteur non initié aux six fonctions de Jakobson ou aux six actants de Greimas. Cela se trouve dans le paragraphe de l’Introduction sous-intitulé Au rythme de la vie et traite de l'aimable roman-reportage ethno-littéraire intitulé Le village dans la montagne: « Un survol des et de l’écriture ramuzienne conduit à deux constats. La récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité; en même temps, cette instance apparaît comme débordée par les événements, à la fois omniprésente et impuissante donc. Dans ce contraste entre subjectivation de l’énonciation et retrait dans l’organisation, la figure du narrateur du Village dans la montagne se construit comme celle d’un anti-démiurge. »
Pauvre Ramuz dont on casse ainsi le « rythme de la vie ». Et qui oserait dire que la littérature n’est pas en péril, quand on la réduit à ces résidus de cuistrerie ?
Celui qui fait taire ses contradicteurs en invoquant le génocide arménien subi par les grands-oncles de sa seconde épouse / Celle qui jette le discrédit sur tous les travaux académique de celui qu’elle sait au courant de ses manipulations fiscales de haute fonctionnaire / Ceux qui ont un dossier au nom du nouveau conseiller Bona qui n’a jamais perdu son accent congolais, etc.
 GRAND LARGE. - Après avoir entrepris, avec un enthousiasme croissant, la lecture du roman de Mikhaïl Chichkine qui vient de paraître sous le titre du Cheveu de Vénus, je me dis que c’est cela que je ne supporte plus dans nos petites largeurs locales ou parisiennes: c’est de ne plus sentir ce souffle de la vraie littérature qui continue.
GRAND LARGE. - Après avoir entrepris, avec un enthousiasme croissant, la lecture du roman de Mikhaïl Chichkine qui vient de paraître sous le titre du Cheveu de Vénus, je me dis que c’est cela que je ne supporte plus dans nos petites largeurs locales ou parisiennes: c’est de ne plus sentir ce souffle de la vraie littérature qui continue.
Ce roman ne pouvait être écrit qu’aujourd’hui, dans la perception panoptique de la réalité, mais il rejoint la vieille tradition des conteurs russes et son courant autobiographique sous-jacent se ramifie en multiples récits recouvrant tout le XXe siècle, de la Révolution à la chute du communisme, non sans faire référence aux chroniques de Xénophon et de Plutarque.
Cela commence dans un office d’accueil des requérants d’asile, à Zurich, pour nous renvoyer aussitôt aux quatre coins de la planète d’où proviennent les réfugiés de toute espèce, dont chacun est un début de roman entremêlant aveux et affabulation. Et c’est là tout l’enjeu du Cheveu de Vénus, que d’interroger la vérité de la fiction.
(Au Buffet de la Gare, mardi 21 août)
Celui qui a appris à se taire pour ne pas blesser / Celle que tout renfrogne / Ceux qui se servent de toi sans que cela te dérange le moins du monde, etc.
REMBRANDT’S CORNER. - Petit bonheur soleilleux au coin du canal, avec ma bonne amie. De sombres prophètes nous annoncent la fin du monde, et nous dégustions nos frites au Rembrandt Corner, dans la rumeur des braves gens, des enfants et des petits canots à moteur qui sillonnent les canaux. Tout à l’heure, il m’a semblé reconnaître la maison de Lieve Joris, et du coup je me suis rappelé notre rencontre et notre virée sur les hauts du col de Jaman où elle m’avait raconté sa rencontre et sa virée à Amsterdam avec V.S. Naipaul, avant de nous retrouver à la terrasse de l’auberge Sonloup où elle avait reçu un appel du Kivu, de son ami chef de guerre à la frontière du Congo…
(Amsterdam, Rembrandt's Corner, ce dimanche 14 octobre)
VOYAGES. - Je ne cesse de vivre deux ou trois voyages en même temps alors que nous nous baladons par les rues d’Amsterdam, et cet après-midi au Rijks où nous sommes restés deux petites heures, avant de nous reposer et de lire dans les cafés. Justement j’ai repris la lecture de Vertiges de W.G. Sebald, constitué de deux ou trois voyages imbriqués où l’errance de Stendhal en quête de bonheur, celle de Sebald lui-même sur les traces du docteur K., et ensuite celle de Kafka lui-même, ne cessent d’interférer ou de diffuser en résonance.
DU VRAI ET DU FAUX. - Je me sens très seul à penser comme je pense, mais ce qui compte est de persévérer en toute sincérité et bonne foi, contre toute distraction et tentation de suivre telle mode ou telle toquade passagère. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est néfaste. Je sens, plus encore que je ne sais, ce qui est vrai et ce qui est du toc, ce qui sonne juste et ce qui sonne faux
LE PETIT PAN DE MUR JAUNE. - Pluie mouillée ce matin sur La Haye, à travers laquelle nous marchons jusqu’au Mauritshuis, l’un des plus jolis musées que j’aie jamais visités. Une exposition consacrée au portrait de l’âge d’or de la peinture hollandaise occupe tout l’étage supérieur, où nous nous attardons longuement après avoir passé pas mal de temps à tourner dans les salles du premier étage où s’alignent d’autres merveilles, du Petit chardonneret de Fabritius à une dizaine de portraits de Rembrandt et, que j’attendais impatiemment de voir, à la Vue de Delft de Vermeer au deuxième plan de laquelle luit humblement le petit pan de mur jaune de Bergotte.
(La Haye, ce mardi 16 octobre)
Celui que le chant du merle aide à supporter sa condition de chômeur en fin de droit / Celle qui aime servir des cafés serrés aux matinaux de la Gare centrale / Ceux qui ont une salive intensément sexuelle, etc.
«MOI ». - Je suis tranquille à proportion de l’amour irradiant ma vie, de moi aux autres et des autres à moi. Mais quand je dis moi ce n’est pas du tout par égoïsme ni même par égotisme, non ce moi est largement ouvert, tout à fait conscient de n’être qu’une parcelle infime d’un Moi plus ample et plus profond, englobant tous les corps et toutes les âmes.
 VENT DU NORD. - Il a fait ce soir un vent a décorner les élans bataves, le long de la dune ondulant sous la haute digue, mais comme elle était bonne et bienvenue, cette formidable gifle a répétition du grand air de mer, après la traversée de l’immense plaine s’étalant sous l’immense ciel de Delft a Bergen, de pacages en bocages et par les forets de chênes de l’arrière-pays de Zandvoort. Je restais encore dans l’émotion du petit pan de mur jaune, retrouvé hier au Mauritshuis de La Haye, puis sous les grands nuages chocolatés de Delft, je me trouvais encore dans cette magie du souvenir quand tout a coup la porte s’est ouverte et toute grande, sur l’infini de sable soufflé et d’écumes arrachées aux croupes des vagues enragées. Le présent rugissait après la vieille mélodie, la vigueur du soir nous redonnait des ailes au lendemain de l’éternelle rêverie devant le petit pan de mur jaune que j’ai découvert pour la première fois tel que Vermeer l’a peint, expose juste en face de la jeune fille a la perle…
VENT DU NORD. - Il a fait ce soir un vent a décorner les élans bataves, le long de la dune ondulant sous la haute digue, mais comme elle était bonne et bienvenue, cette formidable gifle a répétition du grand air de mer, après la traversée de l’immense plaine s’étalant sous l’immense ciel de Delft a Bergen, de pacages en bocages et par les forets de chênes de l’arrière-pays de Zandvoort. Je restais encore dans l’émotion du petit pan de mur jaune, retrouvé hier au Mauritshuis de La Haye, puis sous les grands nuages chocolatés de Delft, je me trouvais encore dans cette magie du souvenir quand tout a coup la porte s’est ouverte et toute grande, sur l’infini de sable soufflé et d’écumes arrachées aux croupes des vagues enragées. Le présent rugissait après la vieille mélodie, la vigueur du soir nous redonnait des ailes au lendemain de l’éternelle rêverie devant le petit pan de mur jaune que j’ai découvert pour la première fois tel que Vermeer l’a peint, expose juste en face de la jeune fille a la perle…
Si souvent j’ai repensé, ces derniers temps, a la mort de Bergotte et au petit pan de mur jaune, et le voici qui m’est apparu comme une infime lucarne dans le grand tableau aux nuages portant l’ombre et aux reflets de quelle présence frémissante… le revoici plus que réel tandis que la nuit monte de la mer sur la dune et la digue et gagne le ciel de son encre…
(Camperduin, ce vendredi 19 octobre.)
William Trevor est de ceux qui nous prouvent, tout tranquillement, qu’il est encore possible d’écrire après Joyce.
 FLEUVE DU TEMPS. - La vieille angoisse d’avant l’aube m’avait repris devant la mer encore noyée dans le noir du nord, une bribe de phrase m’était revenue de la confusion d’un dernier rêve… Eh oui, quand on s’est adossé au fleuve du Temps… Alors je me suis rappelé où nous nous trouvions avec L. dont la mère s’était réfugiée sur une île proche dans une période difficile de sa vie, puis une première clarté s’est délayée dans l’obscur et, comme posées dans la brume, les bêtes en sommeil réapparurent de loin en loin, et le tableau d’une infinie douceur se recomposa tout entier comme un désert aux couleurs montant peu à peu, le vert blanchi de givre des polders, de loin en loin les éclats de miroir de l’eau gelée, là-bas les taches de rouille des petits étangs affleurant le brouillard d’où surgissait à peine les ailes d’un moulin à l’ancienne, la ligne orangée du levant et le bleu laiteux de la grande toile pure de cette aube, et tout proche maintenant ce cheval immense semblant scruter ces deux matinaux, ces flocons de laine des moutons de loin en loin, de temps à autre un vol de canards s’arrachant au petit canal jouxtant le sentier spongieux, enfin cet inimaginable dromadaire bougeant lentement dans la lumière irréelle de ce nouveau jour où notre pas s’accordait à celui du Temps…
FLEUVE DU TEMPS. - La vieille angoisse d’avant l’aube m’avait repris devant la mer encore noyée dans le noir du nord, une bribe de phrase m’était revenue de la confusion d’un dernier rêve… Eh oui, quand on s’est adossé au fleuve du Temps… Alors je me suis rappelé où nous nous trouvions avec L. dont la mère s’était réfugiée sur une île proche dans une période difficile de sa vie, puis une première clarté s’est délayée dans l’obscur et, comme posées dans la brume, les bêtes en sommeil réapparurent de loin en loin, et le tableau d’une infinie douceur se recomposa tout entier comme un désert aux couleurs montant peu à peu, le vert blanchi de givre des polders, de loin en loin les éclats de miroir de l’eau gelée, là-bas les taches de rouille des petits étangs affleurant le brouillard d’où surgissait à peine les ailes d’un moulin à l’ancienne, la ligne orangée du levant et le bleu laiteux de la grande toile pure de cette aube, et tout proche maintenant ce cheval immense semblant scruter ces deux matinaux, ces flocons de laine des moutons de loin en loin, de temps à autre un vol de canards s’arrachant au petit canal jouxtant le sentier spongieux, enfin cet inimaginable dromadaire bougeant lentement dans la lumière irréelle de ce nouveau jour où notre pas s’accordait à celui du Temps…
« PHILOSOPHES ». - La philosophie passe à mes yeux par la création verbale, ou elle me laisse froid. Un philosophe qui ne soit pas en même temps un écrivain, et j’entends par là plus précisément un poète travaillant la langue au corps et à l’âme, ne m’intéresse pas. La philosophie des spécialistes ne m’intéresse pas. La manie actuelle des professeurs de philosophie de se dire philosophes me fait bonnement sourire : des pions qui rêvent du quart d'heure Warhol.
En pensant à Ulysse, je me demande ce qui tout de même me manque là-dedans, pour constater: l’émotion et la simplicité. Le Livre Total de Joyce est une espèce de Tour de Babel, où l’on risque de prendre froid.
 UN VERBE DE CRISTAL. - «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant».
UN VERBE DE CRISTAL. - «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant».
Ce double accent porté, par un immense poète méconnu du grand public qui n’a jamais écrit un seul vers, sur la pureté cristalline et le caractère tonifiant de l’écriture de Maurice Chappaz, pour un texte de haute qualité poétique mais ne ressemblant à rien de ce qu’on attend dans le genre – ni poème versifié, ni prose poétique non plus - vaut aujourd’hui encore et pour toute l’œuvre de Maurice Chappaz, de son premier texte publié, Un homme qui vivait couché sur un banc, à ses derniers écrits de nonagénaire encore vif d’esprit et de plume.
Toute l’œuvre de Maurice Chappaz, qu’on pourrait situer dans un Valais «tibétain » et un temps qui serait à la fois celui des Géorgiques de Virgile et des géniales improvisations de Rimbaud, est aussi bien du même cristal, qu’elle se module en vers libres ou qu’elle se décline en chroniques, en récits épiques ou lyriques, et jusque dans son formidable Evangile selon Judas, paru en 2001 chez Gallimard et passé quasiment inaperçu de la critique française.
De la découpe de cette écriture, de son ton et de sa musique, il faut donner quelques exemples, et du tout début pour commencer, avec ce qu’on pourrait dire l’entrée en lice du jeune poète, dans son premier texte publié en 1939 sous le titre d’ Un homme qui vivait couché sur un banc, d’ailleurs dédié à Cingria: «Il est temps d’entrer dans ce monde, d’allumer une cigarette et de tirer sur la fumée, sur le feuillage tremblant et bleu de l’air maintenant. Il s’agit de s’infuser ce qui est, et cet air du matin on le boit. » Tout de suite on est frappé par le tour physique de la phrase de Chappaz, son recours à des éléments très concerts et sa transmutation simultanée en début de légende dorée. A l’école des poètes ou des chroniqueurs antiques, mais aussi des Riches Heures médiévales et du vélocipédiste Charles-Albert, Maurice Chappaz se présente d’emblée en troubadour anarchisant, passant par là comme le poète de Ramuz et notant cela simplement qui se trouve à sa vue : « Il y a des granges, des entrepôts, le char des paysans et les camions chargés de vivres qui démarrent dans les goudrons, tout un bazar d’étoffes, de charges de légumes, d’enfants des rues et les rudes travailleurs manuels ; la vie du peuple magnifique avec ses odeurs, sa peinture – odeur de foin, peinture de fruits ».
Un élément me semble fondamental dès l’entrée en poésie de Maurice Chappaz, et c’est son attention au détail des moindres choses, qu’il va saisir et « enluminer » par le truchement des mots et des images. Il le répétera d’ailleurs soixante ans plus tard dans son dernier opuscule au titre joyeusement provocant (Hors de l’Eglise pas de salut) par les temps qui courent : «Le péché capital, le seul péché est le manque d’attention. Le temps présent se précipite telle une chute d’eau. Hâte-toi de puiser ! C’est-à-dire : sois attentif». Or l’attention n’est pas que la consommation de la «chose vue» mais sa consumation et sa transmutation, qui fait que le spectacle le plus banal devient un fragment de tableau.
La vocation et le rôle du poète sont assez précisément définis par Chappaz dans ses premiers livres. Un homme qui vivait couché sur un banc évoque d’emblée la vie nouvelle d’un quidam qui se défait de « son habit fort civil » avec quelques jurons bien sentis (des « damned », des « christo », des « morbleu »…), pour revêtir le costume le plus simple. «Il libéra ses souliers d’une secousse et un instant il fut tout nu (rudement étrange, bonnes gens, Cicérons !) et un instant après chaussé d’espadrilles, vêtu d’un pantalon de toile bleue, d’un chandail et d’une vieille casquette, c’est-à-dire comme Jacques et comme Pierrot, ses amis». Et d’ajouter sur le même ton de romantisme bohème : « Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment beau, ce qui est extra, comme disent les enfants et les poètes, c’est la liberté ».
L’œuvre de Maurice Chappaz, dans sa double nature lyrique et prophétique, ne saurait être séparée de la tradition biblique et de la foi catholique. La théologie de Chappaz passe cependant par la poésie et rejoint les chants et les sagesses du monde, de l’Orient arabe aux poètes T’ang, sans diluer ses dogmes pour autant. On pense en outre à la Vita nova de Dante et à l’Amour courtois des troubadours provençaux en lisant Tendres campagnes, où la Dame est à la fois désirée et sublimée par le chant.
Cela étant, loin des tourments de conscience de l’âme romande, à dominante protestante, le catholicisme de Maurice Chappaz et plus encore sa poésie sont tissés de sensualité et de saveur. La langue poétique de Chappaz, jusque dans l’Evangile selon Judas, est une fête.
Mais à la merveille est consubstantiellement liée la « miette d’ombre » symbole de corruption ou de mort, et toute danse de joie se poursuit dans la transe des danses de morts, comme dans la peinture médiévale et ses « grotesques » auxquels renvoie le recueil A rire et à mourir.
La poésie de Maurice Chappaz n’a pas d’âge ni ne s’est altérée d’année en année, dans son chant autant que dans ses récits à multiples ramifications. Bien enracinée dans sa terre d’origine et faisant écho aux préoccupations de notre temps, jusqu’à la ruade polémique, l’œuvre de Chappaz nous transporte à la fois autour du monde et hors du temps, ou plus exactement au cœur de ce noyau temporel que figure l’instant «éternisé» de la poésie. Ernst Jünger écrivait que celui qui touche au cœur de la réalité en atteint tous les points de la circonférence, et c’est exactement la vertu de la poésie à la fois engagée et dégagée de Maurice Chappaz, capable à tout coup, à partir du plus simple objet de tous les jours regardé avec attention, d’atteindre l’essentiel.
CRISTALLISATION. - Chestov s’interroge sur l’origine de la transformation intérieure de Dostoïevski et de Nietzsche, dont il montre l’étroite parenté et ce qui les eût fait se haïr, comme deux frères ennemis: vérité invivable des limites de chaque génie enfermé dans sa chair et son absolutisme conquis de haute lutte, jusque sur le rebord de l’abîme de Pascal. Là que tout converge et divise (apparemment), selon les circonstances. Or, ce moment de la cristallisation d’une pensée personnelle me passionne également, thème de la seconde naissance et de chaque «nouvelle naissance» qui ponctue notre évolution à tous, si nous évoluons.
NIVELLISME. - En reprenant l’Exégèse des nouveaux lieux communs de Jacques Ellul, trente ans après ma première lecture, je vérifie la solidité et la droiture de cette pensée, non du tout de droite mais dressée contre les nouveaux conforts de la gauche bien-pensante. Ce qu’il disait en 1966, à savoir que la bourgeoisie a absorbé tous les lieux communs d’une gauche omnitolérante et humanitaire, alors que le monde ouvrier s’adaptait pour sa part aux lieux communs du confort bourgeois, relance ce que prédisait Witkiewicz dans les années 20, à savoir l’avènement du nivellisme, et je comprends mieux moi-même, avec la distance, contre quoi j’ai toujours réagi en me montrant certes, parfois, trop complaisant envers la droite - mes fréquentations de L'Age d'Homme y étant évidemment pour beaucoup, mais sans jamais me départir d’un sentiment profond de révolte, à tout le moins d’insoumission.
Celui qui fut toujours infoutu de se soucier le moins du monde d’économie / Celle que la seule idée de mettre de l’argent de côté fait gerber (dit-elle) / Ceux qui avaient à cœur de s’acquitter rubis sur l’ongle (disaient-ils) au temps qu’ils situent dans le temps, etc.
LE TEMPS DES CRIS. - Que répondre aux mots de la haine ? En ce qui me concerne, je me sens complètement désarmé devant les mots de la haine. Ou plus exactement : la vie m’a désarmé. Je me souviens évidemment du temps où je criais parfois, moi aussi, à l’époque où tous criaient. Au moindre désaccord: on criait. Et souvent on pleurait aussi : on pleurait après avoir crié. Mais très tôt j’ai ressenti, aussi, le fait que je criais pour moi et pas du tout pour la Cause dont il était question. Les mots de la haine qui me venaient, comme ceux qui venaient à tous, nous éloignaient de ladite Cause bien plus qu’ils ne signifiaient notre désir sincère de la servir.
DIABLERIE. - Tout est à travailler, à travailler et retravailler, me dis-je le matin en songeant à tout ce qui nous menace de dispersion et de décréation par laisser-aller, par paresse ou par ennui. L’esprit d’enfance, c’est à savoir l’esprit de gravité et de conséquence, me tient lieu de raison et de sagesse, de boussole et d’horizon radieux. A tout instant on est menacé de sombrer. A tout instant je suis menacé de sombrer. A tout instant la distraction et la dispersion menacent. Le diable est celui qui disperse, l’anti-créateur et l’AntiSystème.
 L’ESPÉRANCE AU CŒUR DES TÉNÈBRES. - Il n’est pas de roman contemporain plus sombrement désolé que La Route de Cormac McCarthy, et il n’en est pas non plus qui laisse au cœur un tel sentiment de justification de la vie humaine restituée dans sa part sacrée. C’est le livre d’un visionnaire pascalien que cet extraordinaire voyage à travers une Amérique dévastée, dont les évocations de l’hiver nucléaire nous replongent dans les cercles inférieurs de L’Enfer de Dante. Comme celui-ci et son guide, un père et son petit garçon fuient à travers les territoires ravagés, les villes incendiées et pillées, avec pour espoir improbable d’atteindre les rivages de la mer, lesquels se révéleront aussi pourris que la nature contaminée.
L’ESPÉRANCE AU CŒUR DES TÉNÈBRES. - Il n’est pas de roman contemporain plus sombrement désolé que La Route de Cormac McCarthy, et il n’en est pas non plus qui laisse au cœur un tel sentiment de justification de la vie humaine restituée dans sa part sacrée. C’est le livre d’un visionnaire pascalien que cet extraordinaire voyage à travers une Amérique dévastée, dont les évocations de l’hiver nucléaire nous replongent dans les cercles inférieurs de L’Enfer de Dante. Comme celui-ci et son guide, un père et son petit garçon fuient à travers les territoires ravagés, les villes incendiées et pillées, avec pour espoir improbable d’atteindre les rivages de la mer, lesquels se révéleront aussi pourris que la nature contaminée.
Cela étant, chaque nouveau pas sur ce calvaire relance la flamme d’une rédemption possible, liée à un pacte passé entre les deux protagonistes, dont la vocation affirmée est d’être « porteurs de feu ». Formule « bateau » de récit de science fiction spiritualisant ? Et manichéisme de bande dessinée que la division de l’humanité survivante en « méchants » et en « gentils » ? On pourrait le croire à rester en surface de cette road story de fin du monde sans la lire vraiment, alors que chaque page de La Route saisit au contraire le lecteur par sa puissance d’incantation et d’évocation, la lugubre beauté de son lyrisme, sa terrifiante réalité (laquelle renvoie à tout moment aux guerres sectaires et autres misères de notre actualité) et la bouleversante humanité des deux figures de l’homme et de l’enfant.
Liés et livrés l’un à l’autre, le père et le fils se tiennent et se soutiennent au fil d’une relation constituant, dans le froid absolu et le mal régnant sous l’empire de hordes cannibales, une sorte de vestige de lumière et d’énergie vitale que seul le terme d’amour peut qualifier à vrai dire, au sens religieux autant que dans sa dimension affective. De fait, après la fuite de la mère, désespérée et refusant une telle existence de morts-vivants, le père a choisi de protéger coûte que coûte son enfant en lequel il reconnaît un « calice d’or, bon pour abriter un dieu ». A cette foi de révolté (le père demande aussi bien à Dieu s’il a une gorge, afin qu’il puisse l’étrangler, ou une âme, qui lui permette de le maudire) répond l’attente confiante et vigilante du petit, qui surveille son père comme une conscience en alerte, appelant en outre sa miséricorde à la rencontre de plus malheureux, alors que le père ne pense qu’à leur seul salut.
Au fil de leur fuite, les épisodes atroces alternent avec des moments de grâce liés à la survie du monde d’avant: quelques souvenirs de la vie avec « elle », une gorgée d’eau pure, une cannette de Coca retrouvée dans les ruines, l’onction d’un bain dans un torrent, le trésor inespéré de réserves serrées dans un abri souterrain, le son d’une flûte taillée dans un bout de jonc, les sublimes dernières lignes rappelant la nature encore vierge…
Symboliquement, Cormac McCarthy figure en somme le passé et le futur de l’humanité qui cheminent sous le ciel devenu fou à proportion de la démence humaine, où tempêtes de feu et tornades de cendres tourbillonnent à la surface d’une planète dénaturée, dans le gris définitif du jour, la pluie omniprésente, la neige et le froid, la nuit sans fond. Sous l’aspect de personnages guenilleux à la Beckett, l’homme et le petit participent cependant d’une vision moins « plombée » que celle du professeur de désespoir irlandais, tant la théologie de Cormac McCarthy reste liée à l’eschatologie chrétienne. Sans rien de lénifiant, mais dans la pure tradition évangélique, l’amour, la charité et l’espérance filtrent en effet tout au long de La Route, qui se lit comme un récit d’anticipation apocalyptique, à cela prêt que le néant cendreux et la destruction hideuse qu’il figure participent, déjà, de la réalité que nous vivons, autant que demeure l’espérance.
(A La Désirade, 1er janvier 2008)
Ces notes de blog 2005-2008, réunies sous le titre de Riches Heures, ont paru en recueil au début de 2009, aux éditions L'Age d'Homme.
Image de tête: L'Arbre aux cygnes, découpage de Lucienne K.




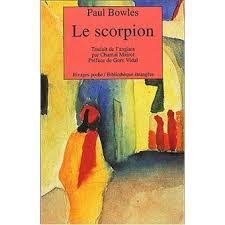



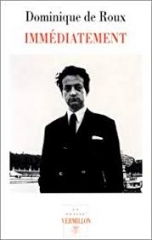

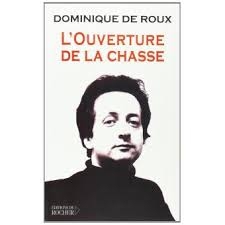




 qui puisse être dit «créateur» ?
qui puisse être dit «créateur» ?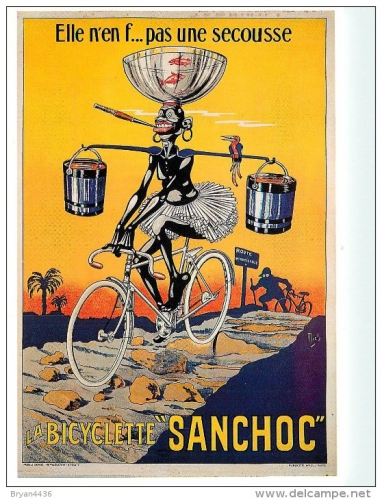
 Le ciel est plein de ces histoires radieuses des débuts de Little Robic ou du Petit Nemo se rêvant en train de valser dans la Constellation du Vélocipédiste. Le bas de la tunique du ciel (naguère de soie, désormais de viscose made in India aux coutures mal finies) est tatoué de tous ces zigzags de tous ces mômes sur les trottoirs du quartier, puis sur la chaussée, à travers la ville, et plus tard autour du lac et des lagons - le ciel adore identifier ces myriades de cicatrices que le corps lui ressort sans se faire prier, tout le menu fretin rose des estampilles à peine visibles, et de temps à autre pourtant la toute belle balafre (un ado lancé à folle vitesse sur les sagaies d’une clôture) ou la déformation à vie (rares mais terrifiques vieilles fractures réduites à la diable, surtout dans les pays chauds), et justement à ce propos le ciel et le corps se rappellent tout soudain les petits cyclistes de la savane africaine, et alors là c’est le top.
Le ciel est plein de ces histoires radieuses des débuts de Little Robic ou du Petit Nemo se rêvant en train de valser dans la Constellation du Vélocipédiste. Le bas de la tunique du ciel (naguère de soie, désormais de viscose made in India aux coutures mal finies) est tatoué de tous ces zigzags de tous ces mômes sur les trottoirs du quartier, puis sur la chaussée, à travers la ville, et plus tard autour du lac et des lagons - le ciel adore identifier ces myriades de cicatrices que le corps lui ressort sans se faire prier, tout le menu fretin rose des estampilles à peine visibles, et de temps à autre pourtant la toute belle balafre (un ado lancé à folle vitesse sur les sagaies d’une clôture) ou la déformation à vie (rares mais terrifiques vieilles fractures réduites à la diable, surtout dans les pays chauds), et justement à ce propos le ciel et le corps se rappellent tout soudain les petits cyclistes de la savane africaine, et alors là c’est le top. Après le goûter, quoi qu’il en soit, toute les bicyclettes sont alignées pour l’inspection à l’entrée de l’allée cyclable de la maison jaune et c’est alors que le Général Dourakine apprend des instances dirigeantes qu’il est privé de vélocipédie au motif de ne s’être pas, une fois de plus, retenu de saluer le Drapeau.
Après le goûter, quoi qu’il en soit, toute les bicyclettes sont alignées pour l’inspection à l’entrée de l’allée cyclable de la maison jaune et c’est alors que le Général Dourakine apprend des instances dirigeantes qu’il est privé de vélocipédie au motif de ne s’être pas, une fois de plus, retenu de saluer le Drapeau.


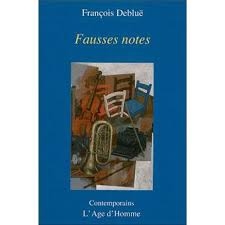 Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.
Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.








 Liste du jeudi 8 octobre.
Liste du jeudi 8 octobre. Liste du vendredi 9 octobre.
Liste du vendredi 9 octobre. Liste du samedi 10 octobre.
Liste du samedi 10 octobre. Liste du dimanche 11 octobre.
Liste du dimanche 11 octobre. Liste du lundi 12 octobre.
Liste du lundi 12 octobre. 1) "Journal intime", d'Henri-Frédéric Amiel.
1) "Journal intime", d'Henri-Frédéric Amiel. Liste du mercredi 14 octobre
Liste du mercredi 14 octobre Liste du jeudi 15 octobre
Liste du jeudi 15 octobre Liste du 16 octobre
Liste du 16 octobre Liste du samedi 17 octobre
Liste du samedi 17 octobre Liste du dimanche 18 octobre.
Liste du dimanche 18 octobre. Liste du lundi 19 octobre
Liste du lundi 19 octobre Liste du mardi 20 octobre.
Liste du mardi 20 octobre. Liste du mercredi 21 octobre
Liste du mercredi 21 octobre





 agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu”.
agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu”.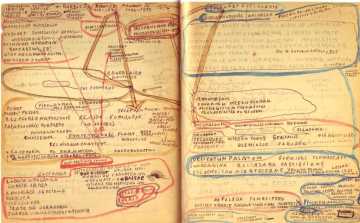
 C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère.
C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère. Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.
Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.
 L’Aventure d’écrire
L’Aventure d’écrire Si la popularité de Maurice Chappaz, figure tutélaire des lettres valaisannes et romandes, au côté de Corinna Bille, culminerait au mitan des années soixante avec le fameux Portrait des Valaisans en Légende et en Vérité, en 1965, relancée en 1968 avec Le Match Valais-Judée, en 1974, avec La Haute Route et en 1976 avec Les maquereaux des Cimes blanches, dont les invectives lyrique firent scandale dans le canton de l’auteur, bien d’autres ouvrages moins connus requièrent aujourd’hui notre attention rétrospective, où se concentre souvent le plus pur de son génie poétique. Ainsi de l’ Office des Morts et de Tendres Campagnes, parus en 1966, ainsi aussi (en 1983) des ballades baroques et sarcastiques d’A Rire et à Mourir, évoquant les sarabandes médiévales, ainsi enfin de nombreux textes épars, desquels se détachent Le Livre de C. (1986) à la mémoire de Corinna Bille (décédée en 1979), les non moins poignante pages de journal d’ Octobre 79 et, plus récemment, Le garçon qui croyait au Paradis, paru en 1989, La Veillée des Vikings (1990) dans laquelle Chappaz évoque les grandes figures de sa famille, L’Océan (1993) relatant un grand voyage et sa découverte de New York ou La Mort s’est posée comme un Oiseau (1993) méditation poétique où se retrouve le plus candide de sa voix.
Si la popularité de Maurice Chappaz, figure tutélaire des lettres valaisannes et romandes, au côté de Corinna Bille, culminerait au mitan des années soixante avec le fameux Portrait des Valaisans en Légende et en Vérité, en 1965, relancée en 1968 avec Le Match Valais-Judée, en 1974, avec La Haute Route et en 1976 avec Les maquereaux des Cimes blanches, dont les invectives lyrique firent scandale dans le canton de l’auteur, bien d’autres ouvrages moins connus requièrent aujourd’hui notre attention rétrospective, où se concentre souvent le plus pur de son génie poétique. Ainsi de l’ Office des Morts et de Tendres Campagnes, parus en 1966, ainsi aussi (en 1983) des ballades baroques et sarcastiques d’A Rire et à Mourir, évoquant les sarabandes médiévales, ainsi enfin de nombreux textes épars, desquels se détachent Le Livre de C. (1986) à la mémoire de Corinna Bille (décédée en 1979), les non moins poignante pages de journal d’ Octobre 79 et, plus récemment, Le garçon qui croyait au Paradis, paru en 1989, La Veillée des Vikings (1990) dans laquelle Chappaz évoque les grandes figures de sa famille, L’Océan (1993) relatant un grand voyage et sa découverte de New York ou La Mort s’est posée comme un Oiseau (1993) méditation poétique où se retrouve le plus candide de sa voix. Une rencontre à l’Abbaye du Châble, le 4 janvier 2007.
Une rencontre à l’Abbaye du Châble, le 4 janvier 2007. Du pays perdu
Du pays perdu D’une guerre l’autre
D’une guerre l’autre Du pays rêvé
Du pays rêvé


 - Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?
- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?






 - Et la fiction là-dedans ?
- Et la fiction là-dedans ? - Quel est l’origine du film sur Kafka ?
- Quel est l’origine du film sur Kafka ?





 Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…
Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus… Claude Delarue. Le bel obèse. Fayard, 357p.
Claude Delarue. Le bel obèse. Fayard, 357p.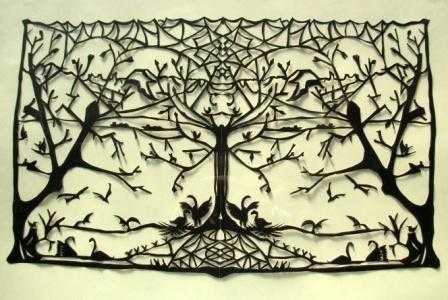

 PLUS NOIR QUE NEIGE. - Un troubadour, en un vers inoublié, pour célébrer l’immaculée blancheur de sa Dame, disait la neige brune, et probablement pensait-il : noire.
PLUS NOIR QUE NEIGE. - Un troubadour, en un vers inoublié, pour célébrer l’immaculée blancheur de sa Dame, disait la neige brune, et probablement pensait-il : noire. Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline.
Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?
En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable? Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase est juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus».
Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase est juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus». DE LA RESSEMBLANCE HUMAINE. - C’est un film poignant d’humanité que les Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, d’une grande beauté d’inspiration et d’image, dont se dégage à la fois l’évidence de la ressemblance humaine et le caractère inéluctable de l’hybris des nations, exacerbé par la guerre. Une scène absolument déchirante marque le sommet de cette expression de la fraternité: lorsque le flamboyant lieutenant-colonel Nishi (Tsuyoshi Iharo), champion olympique d’équitation au Jeux de Los Angeles, en 1932, qui vient d’épargner la vie d’un jeune Marine, succombant cependant à ses blessures, traduit à haute voix une lettre de sa mère au jeune homme, dont les choses toutes simples qu’elle raconte font se lever, l’un après l’autre, les soldats japonais présents, bouleversés et muets.
DE LA RESSEMBLANCE HUMAINE. - C’est un film poignant d’humanité que les Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, d’une grande beauté d’inspiration et d’image, dont se dégage à la fois l’évidence de la ressemblance humaine et le caractère inéluctable de l’hybris des nations, exacerbé par la guerre. Une scène absolument déchirante marque le sommet de cette expression de la fraternité: lorsque le flamboyant lieutenant-colonel Nishi (Tsuyoshi Iharo), champion olympique d’équitation au Jeux de Los Angeles, en 1932, qui vient d’épargner la vie d’un jeune Marine, succombant cependant à ses blessures, traduit à haute voix une lettre de sa mère au jeune homme, dont les choses toutes simples qu’elle raconte font se lever, l’un après l’autre, les soldats japonais présents, bouleversés et muets. NOTRE SEIGNEUR. -Le Christ a représenté, pour nous autres protestants de naissance, une image du Bien. C’est le Sauveur. Le Fils de l’homme, à savoir une personne à notre hauteur, mais également revêtu d’une cuirasse divine. Une espèce de super-Pasteur au sens biblique du berger. Le Bon Berger des vignettes d’école du dimanche. Au quotidien, cette figure nous tenait lieu de repère et de modèle, notamment avec le Sermon sur la montagne.
NOTRE SEIGNEUR. -Le Christ a représenté, pour nous autres protestants de naissance, une image du Bien. C’est le Sauveur. Le Fils de l’homme, à savoir une personne à notre hauteur, mais également revêtu d’une cuirasse divine. Une espèce de super-Pasteur au sens biblique du berger. Le Bon Berger des vignettes d’école du dimanche. Au quotidien, cette figure nous tenait lieu de repère et de modèle, notamment avec le Sermon sur la montagne. POST MORTEM. – Derniers fragments d’un long voyage est un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie, que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible. Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. »
POST MORTEM. – Derniers fragments d’un long voyage est un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie, que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible. Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. » ZOMBIES. - La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur.
ZOMBIES. - La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur. MUNCH À BÂLE. - Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles.Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aînée terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thème est repris de manière obsessionnelle. C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai. Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Philippe Sollers à propos de Francis Bacon: cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir.
MUNCH À BÂLE. - Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles.Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aînée terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thème est repris de manière obsessionnelle. C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai. Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Philippe Sollers à propos de Francis Bacon: cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir.  On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée. C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta.
On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée. C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta. ARLEQUINS DE NABOKOV. - Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.
ARLEQUINS DE NABOKOV. - Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles. VOYOU. - C’est un intense poète que William Cliff, un ange d’innocence que ce vagabond sous les étoiles dont la foulée le porte d’Ostende à Bénarès d’un enjambement d’alexandrin, et du fond d’un fjord à Atlanta, de bouges en bouges ou dans la grande Maison pleine de mauvais garçons comme lui dont les caves abritent de pauvres amours.
VOYOU. - C’est un intense poète que William Cliff, un ange d’innocence que ce vagabond sous les étoiles dont la foulée le porte d’Ostende à Bénarès d’un enjambement d’alexandrin, et du fond d’un fjord à Atlanta, de bouges en bouges ou dans la grande Maison pleine de mauvais garçons comme lui dont les caves abritent de pauvres amours.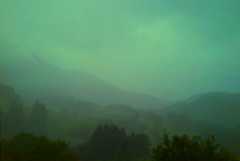 PEINDRE LA PLUIE. - J’aurais aimé peindre ce matin le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme.
PEINDRE LA PLUIE. - J’aurais aimé peindre ce matin le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme. AUDIBERTI. - Je me suis replongé ce matin dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti, pour en tirer une allègre évocation de Sète et de notre fin d’après-midi d’hier à bouquiner sous les frondaisons. De fait, il m’a semblé qu’il y avait, dans l’atmosphère de la petite ville méditerranéenne s’apprêtant à fêter ses origines italiennes, quelque chose de frais et de bigarré qui rappelait le début de Monorail et son tableau de Nice avec ses pédalos sur l’eau qu’il appelle des vagovagues… En tout cas je me promets de revenir, bientôt, à ce prodigieux sourcier de vocables et d’images, de sensations inattendues et de rapprochements fulgurants, d’intuition et de pensées, d’une constante originalité – je me promets de relire d’affilée Monorail et Marie Dubois et de lire enfin Dimanche m’attend.
AUDIBERTI. - Je me suis replongé ce matin dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti, pour en tirer une allègre évocation de Sète et de notre fin d’après-midi d’hier à bouquiner sous les frondaisons. De fait, il m’a semblé qu’il y avait, dans l’atmosphère de la petite ville méditerranéenne s’apprêtant à fêter ses origines italiennes, quelque chose de frais et de bigarré qui rappelait le début de Monorail et son tableau de Nice avec ses pédalos sur l’eau qu’il appelle des vagovagues… En tout cas je me promets de revenir, bientôt, à ce prodigieux sourcier de vocables et d’images, de sensations inattendues et de rapprochements fulgurants, d’intuition et de pensées, d’une constante originalité – je me promets de relire d’affilée Monorail et Marie Dubois et de lire enfin Dimanche m’attend. RÊVER A LA SUISSE. - On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat.
RÊVER A LA SUISSE. - On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat. VOYAGE EN ZIGZAGS. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux. Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu…
VOYAGE EN ZIGZAGS. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux. Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu… SUISSE SAUVAGE. - C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…
SUISSE SAUVAGE. - C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa… Après cette folie fiévreuse, et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’indéfinissable architecture vert-de-gris, que celle de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…
Après cette folie fiévreuse, et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’indéfinissable architecture vert-de-gris, que celle de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…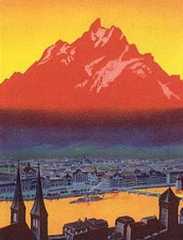 GREETINGS FROM LUCERNE. - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au cœur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés du monde, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais.
GREETINGS FROM LUCERNE. - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au cœur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés du monde, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais. MARTYR ET POÈTE. - L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».
MARTYR ET POÈTE. - L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères». MATER FURIOSA. - Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.
MATER FURIOSA. - Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau. FRIEDRICH LE GRAND. - Génie de l’espèce volcanique, Friedrich Dürrenmatt écrivait comme un écolier follement appliqué, dont chaque paragraphe de sa petite écriture carrée était essayé et repris, révisé cent et mille fois au point qu’à son œuvre comptant trente volumes il faudrait en rajouter trente autres au moins de brouillons. Des récits fantastiques de La Ville aux romans policiers à double fond tels que Le Juge et son bourreau ou Le Soupçon, ou des pièces radiophoniques (la fameuse Panne) aux écrits récents mêlant paraboles et réflexions, en passant par l’essai politique (sur Israël ou sur la Suisse), les dessins à la plume et la peinture virulemment expressionnistes, cet immense bonhomme n’aura cessé d’approfondir les thèmes qui le hantent depuis ses jeunes années : l’individu perdu dans le grand labyrinthe, la corruption du pouvoir et de la justice par l’argent, la dilution de toute responsabilité dans le chaos de l’Histoire, l’entropie cosmique et l’autodestruction de l’humanité. Autant de thèmes qui traversent son théâtre, de l'increvable Visite de la vieille dame, qui continue de se jouer aux quatre coins du monde, à cette représentation de la folie humaine que figure Achterloo, sa dernière pièce.
FRIEDRICH LE GRAND. - Génie de l’espèce volcanique, Friedrich Dürrenmatt écrivait comme un écolier follement appliqué, dont chaque paragraphe de sa petite écriture carrée était essayé et repris, révisé cent et mille fois au point qu’à son œuvre comptant trente volumes il faudrait en rajouter trente autres au moins de brouillons. Des récits fantastiques de La Ville aux romans policiers à double fond tels que Le Juge et son bourreau ou Le Soupçon, ou des pièces radiophoniques (la fameuse Panne) aux écrits récents mêlant paraboles et réflexions, en passant par l’essai politique (sur Israël ou sur la Suisse), les dessins à la plume et la peinture virulemment expressionnistes, cet immense bonhomme n’aura cessé d’approfondir les thèmes qui le hantent depuis ses jeunes années : l’individu perdu dans le grand labyrinthe, la corruption du pouvoir et de la justice par l’argent, la dilution de toute responsabilité dans le chaos de l’Histoire, l’entropie cosmique et l’autodestruction de l’humanité. Autant de thèmes qui traversent son théâtre, de l'increvable Visite de la vieille dame, qui continue de se jouer aux quatre coins du monde, à cette représentation de la folie humaine que figure Achterloo, sa dernière pièce. PARLER À DIEU. - Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-mêmes. Mais savoir quand on prie vraiment...
PARLER À DIEU. - Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-mêmes. Mais savoir quand on prie vraiment... Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train.
Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train. QUELQU’UN ÉCRIT. - Dans le texte intitulé Trois jours, Thomas Bernhard lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes au fil desquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, « et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ». Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ « en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit ».
QUELQU’UN ÉCRIT. - Dans le texte intitulé Trois jours, Thomas Bernhard lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes au fil desquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, « et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ». Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ « en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit ».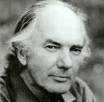 SALZBOURG, 1944. - En lisant L’Origine de Thomas Bernhard, et plus précisément l’évocation des bombardements de Salzbourg, en 1944, on voit mieux comment l’exagération, chez cet écrivain de l’outrance, tend à une sorte de vérité poétique d’épopée, un peu comme chez Céline – et je pense plus précisément à sa fuite à travers l’Allemagne et au fabuleux épisode de la traversée des ruines de Hanovre dans Nord.
SALZBOURG, 1944. - En lisant L’Origine de Thomas Bernhard, et plus précisément l’évocation des bombardements de Salzbourg, en 1944, on voit mieux comment l’exagération, chez cet écrivain de l’outrance, tend à une sorte de vérité poétique d’épopée, un peu comme chez Céline – et je pense plus précisément à sa fuite à travers l’Allemagne et au fabuleux épisode de la traversée des ruines de Hanovre dans Nord. MON AMI LE LOUP. – L’une de mes plus grandes joies, en tant que lecteur, a toujours été d’assister à l’éclosion d’une œuvre nouvelle. Dans un monde qu’Armand Robin disait celui de la «fausse parole», où la dévaluation et la prostitution du langage atteignent aujourd’hui des proportions babéliennes, l’émergence d’une voix réellement singulière, modulée en style sans pareil, me touche toujours autant que la redécouverte de tel ou tel grand livre. C'est dire que je ne cherche pas la nouveauté pour elle-même, mais l’expression, imprévisible à tout coup, d’une perception renouvelée des choses et des mots.
MON AMI LE LOUP. – L’une de mes plus grandes joies, en tant que lecteur, a toujours été d’assister à l’éclosion d’une œuvre nouvelle. Dans un monde qu’Armand Robin disait celui de la «fausse parole», où la dévaluation et la prostitution du langage atteignent aujourd’hui des proportions babéliennes, l’émergence d’une voix réellement singulière, modulée en style sans pareil, me touche toujours autant que la redécouverte de tel ou tel grand livre. C'est dire que je ne cherche pas la nouveauté pour elle-même, mais l’expression, imprévisible à tout coup, d’une perception renouvelée des choses et des mots. LE BALZAC DE SIMENON. – Formidable raccourci que le Portrait-souvenir de Balzac par Simenon. En une trentaine de pages claires et concentrées (écrites à Echandens en 1960, probablement d’une traite, en un jour), Simenon dit l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’auteur de La Comédie humaine que rien, en somme, ne prédisposait à aligner un chef-d’œuvre après l’autre et à donner au monde cette somme extraordinaire, conquise contre la frustration affective initiale et la patauderie de l’enfant-éléphant, la difficulté de vivre et de survivre, la maladie chronique (Simenon formule une hypothèse clinique précise) et les ennuis à n’en plus finir…
LE BALZAC DE SIMENON. – Formidable raccourci que le Portrait-souvenir de Balzac par Simenon. En une trentaine de pages claires et concentrées (écrites à Echandens en 1960, probablement d’une traite, en un jour), Simenon dit l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’auteur de La Comédie humaine que rien, en somme, ne prédisposait à aligner un chef-d’œuvre après l’autre et à donner au monde cette somme extraordinaire, conquise contre la frustration affective initiale et la patauderie de l’enfant-éléphant, la difficulté de vivre et de survivre, la maladie chronique (Simenon formule une hypothèse clinique précise) et les ennuis à n’en plus finir… GREGUERIAS. - On revient à Gomez de La Serna comme à un inépuisable brocanteur d'images poétiques jamais en mal de nous étonner à tout moment comme à tout moment il s’étonne, et c’est précisément cela qui saisit le lecteur de ses Greguerias: c’est que ces petit fragments colorés d’un immense kaléidoscope semblent refléter toutes les heures du jour et des quatre saisons, et tous les goûts, toutes les humeurs de tous les âges de la vie: de la gaîté primesautière de l’écolier du matin, qui remarque par exemple que «les bœufs ont l’air de sucer et de resucer constamment un caramel », à la songerie mélancolique de l’homme vieillissant notant que « bien souvent nous nous lèverions pour faire notre testament, malgré que cela soit inutile, malgré que nous n’ayons rien à léguer à personne, mais uniquement pour faire notre testament; faire son testament; l’acte pur et sincère ».
GREGUERIAS. - On revient à Gomez de La Serna comme à un inépuisable brocanteur d'images poétiques jamais en mal de nous étonner à tout moment comme à tout moment il s’étonne, et c’est précisément cela qui saisit le lecteur de ses Greguerias: c’est que ces petit fragments colorés d’un immense kaléidoscope semblent refléter toutes les heures du jour et des quatre saisons, et tous les goûts, toutes les humeurs de tous les âges de la vie: de la gaîté primesautière de l’écolier du matin, qui remarque par exemple que «les bœufs ont l’air de sucer et de resucer constamment un caramel », à la songerie mélancolique de l’homme vieillissant notant que « bien souvent nous nous lèverions pour faire notre testament, malgré que cela soit inutile, malgré que nous n’ayons rien à léguer à personne, mais uniquement pour faire notre testament; faire son testament; l’acte pur et sincère ». DE L’ÉTAT DE POESIE. - C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre.
DE L’ÉTAT DE POESIE. - C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre. DE L’IDÉOLOGIE. - Je ne suis pas un homme d’idéologie mais un homme d’idées et d’expérience. Je vis d’expériences-idées. Les idées me viennent de l’expérience. L’idéologie m’a toujours serré aux entournures. Je n’y ai jamais été vraiment à l’aise. C’est pourquoi des idéologues comme Philippe Muray, malgré tout, me rebutent. M’intéressent sans me convaincre jamais, tant je reste attentif à la complexité de la vie. Lire le dernier roman de François Emmanuel, Regarde la vague, parallèlement à la lecture d’ Après l’Histoire, me rappelle assez où est mon camp.
DE L’IDÉOLOGIE. - Je ne suis pas un homme d’idéologie mais un homme d’idées et d’expérience. Je vis d’expériences-idées. Les idées me viennent de l’expérience. L’idéologie m’a toujours serré aux entournures. Je n’y ai jamais été vraiment à l’aise. C’est pourquoi des idéologues comme Philippe Muray, malgré tout, me rebutent. M’intéressent sans me convaincre jamais, tant je reste attentif à la complexité de la vie. Lire le dernier roman de François Emmanuel, Regarde la vague, parallèlement à la lecture d’ Après l’Histoire, me rappelle assez où est mon camp. LE VOYAGEUR ÉMERVEILLÉ. - Au commencement, le jeune Vernet (il a vingt-six ans et laisse une fiancée à Genève, prénommée Floristella) voyage tout seul en Croatie puis en Bosnie, jusqu’à l’arrivée de son ami « Nick » qui le rejoint à Belgrade en juillet. D’emblée, cependant, se manifeste un don d’observation et d’expression qui rompt pour le moins avec la gravité calviniste, évoquant tantôt Cingria par sa fantaisie et la découpe de sa phrase, ou Vialatte par sa faconde cocasse et son bon naturel. S’il lui faut bien quelque temps pour larguer vraiment les amarres (la moindre lettre des siens est attendue avec fébrilité), c’est ensuite avec une curiosité et un enthousiasme de (presque) tous les jours qu’il découvre les lieux et les gens, vivant autant qu’il peint et écrivant pour le revivre en le racontant. Son mot d’ordre est vite trouvé : « Le secret du bon moral : SORTIR DE SOI-MÊME », écrit-il ainsi avec son solennel humour. Et de fait, le contact avec les gens, l’observation du monde, l’aquarelle ou ces lettres, tout le porte à sortir de la contention solitaire.
LE VOYAGEUR ÉMERVEILLÉ. - Au commencement, le jeune Vernet (il a vingt-six ans et laisse une fiancée à Genève, prénommée Floristella) voyage tout seul en Croatie puis en Bosnie, jusqu’à l’arrivée de son ami « Nick » qui le rejoint à Belgrade en juillet. D’emblée, cependant, se manifeste un don d’observation et d’expression qui rompt pour le moins avec la gravité calviniste, évoquant tantôt Cingria par sa fantaisie et la découpe de sa phrase, ou Vialatte par sa faconde cocasse et son bon naturel. S’il lui faut bien quelque temps pour larguer vraiment les amarres (la moindre lettre des siens est attendue avec fébrilité), c’est ensuite avec une curiosité et un enthousiasme de (presque) tous les jours qu’il découvre les lieux et les gens, vivant autant qu’il peint et écrivant pour le revivre en le racontant. Son mot d’ordre est vite trouvé : « Le secret du bon moral : SORTIR DE SOI-MÊME », écrit-il ainsi avec son solennel humour. Et de fait, le contact avec les gens, l’observation du monde, l’aquarelle ou ces lettres, tout le porte à sortir de la contention solitaire. JACQUES ROMAN. - L’image est un peu éculée, du poète considéré comme un veilleur, et pourtant c’est bien cette figure qu’incarne Jacques Roman toutes les nuits dans sa thébaïde solitaire ouverte sur le ciel lémanique, à Lausanne, à poursuivre son Ouvrage de l’insomnie, tissé de fragments où l’émotion tripale, la mémoire, la pensée en alerte et la langue ne cessent de travailler la matière au corps.
JACQUES ROMAN. - L’image est un peu éculée, du poète considéré comme un veilleur, et pourtant c’est bien cette figure qu’incarne Jacques Roman toutes les nuits dans sa thébaïde solitaire ouverte sur le ciel lémanique, à Lausanne, à poursuivre son Ouvrage de l’insomnie, tissé de fragments où l’émotion tripale, la mémoire, la pensée en alerte et la langue ne cessent de travailler la matière au corps. VISIONS DE VERNET. - C’était un soir en Provence. Le jour n’en finissait pas de finir. L’on se croyait hors du temps, comme à l’abri de tout. Or de ce moment privilégié, non de béatitude passive mais d’adhésion généreuse au monde alentour, vous vous rappelez à présent la douce musique avec nostalgie en retrouvant ce ciel d’ambre velouté sur les tuiles chaudes et les arbres encore embrumés par la touffeur de fin de journée; et cette lumière orange vous remémore, aussi, vos interminables soirées en enfance, quand la nuit paraissait se retenir d’interrompre vos jeux.
VISIONS DE VERNET. - C’était un soir en Provence. Le jour n’en finissait pas de finir. L’on se croyait hors du temps, comme à l’abri de tout. Or de ce moment privilégié, non de béatitude passive mais d’adhésion généreuse au monde alentour, vous vous rappelez à présent la douce musique avec nostalgie en retrouvant ce ciel d’ambre velouté sur les tuiles chaudes et les arbres encore embrumés par la touffeur de fin de journée; et cette lumière orange vous remémore, aussi, vos interminables soirées en enfance, quand la nuit paraissait se retenir d’interrompre vos jeux. JE ME SOUVIENS. – Dans la nuit du 15 août 2002, après avoir appris, au milieu des édéniques jardins de la Casa Hermann Hesse, à Montagnola, que ma mère venait d’être frappée par une attaque cérébrale qui devait lui être fatale après dix jours de coma, je notai, sur la banquette du train, ces bribes de mémoire que j’emporte partout avec moi et que je relis à l’instant :
JE ME SOUVIENS. – Dans la nuit du 15 août 2002, après avoir appris, au milieu des édéniques jardins de la Casa Hermann Hesse, à Montagnola, que ma mère venait d’être frappée par une attaque cérébrale qui devait lui être fatale après dix jours de coma, je notai, sur la banquette du train, ces bribes de mémoire que j’emporte partout avec moi et que je relis à l’instant : CONTRE LES CUISTRES. - Tzvetan Todorov est un grand lettré que sa nature puissante et douce à la fois ne pousse pas aux vociférations pamphlétaires, et pourtant son dernier livre, La littérature en péril, mène un combat très ferme aux arguments à la fois nuancés et clairs qui ouvrent un vrai débat sur la littérature française contemporaine, et plus précisément son enseignement et sa transmission, loin des polémiques parisiennes éruptives qui renvoient les uns et les autres dos à dos sans déboucher sur rien .
CONTRE LES CUISTRES. - Tzvetan Todorov est un grand lettré que sa nature puissante et douce à la fois ne pousse pas aux vociférations pamphlétaires, et pourtant son dernier livre, La littérature en péril, mène un combat très ferme aux arguments à la fois nuancés et clairs qui ouvrent un vrai débat sur la littérature française contemporaine, et plus précisément son enseignement et sa transmission, loin des polémiques parisiennes éruptives qui renvoient les uns et les autres dos à dos sans déboucher sur rien .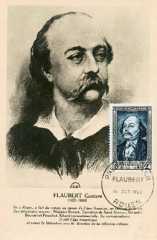 La force de la littérature, qui nous fait participer au sort commun, tient à nous aider à «penser en se mettant à la place de tout autre être humain », selon l’expression de Kant dans la Critique de la faculté de juger. Et c'est vrai aussi pour le dialogue entre écrivains. Dans le dernier chapitre de La littérature en péril, Tzvetan Todorov, citant les lettres échangées par George Sand et Flaubert, montre que deux positions très différentes, voire opposées, peuvent se compléter pour la défense d’une littérature échappant au dogmatisme. « Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le Faux », écrit Flaubert dont l’œuvre ne saurait pour autant, et Sand le sait mieux que quiconque, se réduire à une affaire d’assonances ou de répétitions. Entre Flaubert qui dit avoir « la vie en haine », et Sand qui aime chaque jour un peu plus le présent de la vie, l’échange reste possible car tous deux aspirent à la même connaissance par d’autres chemins – tous deux vivent la littérature sans la réduire à des schémas, et qui dirait que Sand a plus raison que Flaubert ou vice versa ?
La force de la littérature, qui nous fait participer au sort commun, tient à nous aider à «penser en se mettant à la place de tout autre être humain », selon l’expression de Kant dans la Critique de la faculté de juger. Et c'est vrai aussi pour le dialogue entre écrivains. Dans le dernier chapitre de La littérature en péril, Tzvetan Todorov, citant les lettres échangées par George Sand et Flaubert, montre que deux positions très différentes, voire opposées, peuvent se compléter pour la défense d’une littérature échappant au dogmatisme. « Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le Faux », écrit Flaubert dont l’œuvre ne saurait pour autant, et Sand le sait mieux que quiconque, se réduire à une affaire d’assonances ou de répétitions. Entre Flaubert qui dit avoir « la vie en haine », et Sand qui aime chaque jour un peu plus le présent de la vie, l’échange reste possible car tous deux aspirent à la même connaissance par d’autres chemins – tous deux vivent la littérature sans la réduire à des schémas, et qui dirait que Sand a plus raison que Flaubert ou vice versa ? Je veux parler des commentaires introductifs aux Œuvres complètes de C.F. Ramuz, en cours d’élaboration aux éditions Slatkine, à Genève, dont un seul échantillon donnera le ton, propre à éloigner tout lecteur non initié aux six fonctions de Jakobson ou aux six actants de Greimas. Cela se trouve dans le paragraphe de l’Introduction sous-intitulé Au rythme de la vie et traite de l'aimable roman-reportage ethno-littéraire intitulé Le village dans la montagne: « Un survol des et de l’écriture ramuzienne conduit à deux constats. La récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité; en même temps, cette instance apparaît comme débordée par les événements, à la fois omniprésente et impuissante donc. Dans ce contraste entre subjectivation de l’énonciation et retrait dans l’organisation, la figure du narrateur du Village dans la montagne se construit comme celle d’un anti-démiurge. »
Je veux parler des commentaires introductifs aux Œuvres complètes de C.F. Ramuz, en cours d’élaboration aux éditions Slatkine, à Genève, dont un seul échantillon donnera le ton, propre à éloigner tout lecteur non initié aux six fonctions de Jakobson ou aux six actants de Greimas. Cela se trouve dans le paragraphe de l’Introduction sous-intitulé Au rythme de la vie et traite de l'aimable roman-reportage ethno-littéraire intitulé Le village dans la montagne: « Un survol des et de l’écriture ramuzienne conduit à deux constats. La récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité; en même temps, cette instance apparaît comme débordée par les événements, à la fois omniprésente et impuissante donc. Dans ce contraste entre subjectivation de l’énonciation et retrait dans l’organisation, la figure du narrateur du Village dans la montagne se construit comme celle d’un anti-démiurge. » GRAND LARGE. - Après avoir entrepris, avec un enthousiasme croissant, la lecture du roman de Mikhaïl Chichkine qui vient de paraître sous le titre du Cheveu de Vénus, je me dis que c’est cela que je ne supporte plus dans nos petites largeurs locales ou parisiennes: c’est de ne plus sentir ce souffle de la vraie littérature qui continue.
GRAND LARGE. - Après avoir entrepris, avec un enthousiasme croissant, la lecture du roman de Mikhaïl Chichkine qui vient de paraître sous le titre du Cheveu de Vénus, je me dis que c’est cela que je ne supporte plus dans nos petites largeurs locales ou parisiennes: c’est de ne plus sentir ce souffle de la vraie littérature qui continue. VENT DU NORD. - Il a fait ce soir un vent a décorner les élans bataves, le long de la dune ondulant sous la haute digue, mais comme elle était bonne et bienvenue, cette formidable gifle a répétition du grand air de mer, après la traversée de l’immense plaine s’étalant sous l’immense ciel de Delft a Bergen, de pacages en bocages et par les forets de chênes de l’arrière-pays de Zandvoort. Je restais encore dans l’émotion du petit pan de mur jaune, retrouvé hier au Mauritshuis de La Haye, puis sous les grands nuages chocolatés de Delft, je me trouvais encore dans cette magie du souvenir quand tout a coup la porte s’est ouverte et toute grande, sur l’infini de sable soufflé et d’écumes arrachées aux croupes des vagues enragées. Le présent rugissait après la vieille mélodie, la vigueur du soir nous redonnait des ailes au lendemain de l’éternelle rêverie devant le petit pan de mur jaune que j’ai découvert pour la première fois tel que Vermeer l’a peint, expose juste en face de la jeune fille a la perle…
VENT DU NORD. - Il a fait ce soir un vent a décorner les élans bataves, le long de la dune ondulant sous la haute digue, mais comme elle était bonne et bienvenue, cette formidable gifle a répétition du grand air de mer, après la traversée de l’immense plaine s’étalant sous l’immense ciel de Delft a Bergen, de pacages en bocages et par les forets de chênes de l’arrière-pays de Zandvoort. Je restais encore dans l’émotion du petit pan de mur jaune, retrouvé hier au Mauritshuis de La Haye, puis sous les grands nuages chocolatés de Delft, je me trouvais encore dans cette magie du souvenir quand tout a coup la porte s’est ouverte et toute grande, sur l’infini de sable soufflé et d’écumes arrachées aux croupes des vagues enragées. Le présent rugissait après la vieille mélodie, la vigueur du soir nous redonnait des ailes au lendemain de l’éternelle rêverie devant le petit pan de mur jaune que j’ai découvert pour la première fois tel que Vermeer l’a peint, expose juste en face de la jeune fille a la perle… FLEUVE DU TEMPS. - La vieille angoisse d’avant l’aube m’avait repris devant la mer encore noyée dans le noir du nord, une bribe de phrase m’était revenue de la confusion d’un dernier rêve… Eh oui, quand on s’est adossé au fleuve du Temps… Alors je me suis rappelé où nous nous trouvions avec L. dont la mère s’était réfugiée sur une île proche dans une période difficile de sa vie, puis une première clarté s’est délayée dans l’obscur et, comme posées dans la brume, les bêtes en sommeil réapparurent de loin en loin, et le tableau d’une infinie douceur se recomposa tout entier comme un désert aux couleurs montant peu à peu, le vert blanchi de givre des polders, de loin en loin les éclats de miroir de l’eau gelée, là-bas les taches de rouille des petits étangs affleurant le brouillard d’où surgissait à peine les ailes d’un moulin à l’ancienne, la ligne orangée du levant et le bleu laiteux de la grande toile pure de cette aube, et tout proche maintenant ce cheval immense semblant scruter ces deux matinaux, ces flocons de laine des moutons de loin en loin, de temps à autre un vol de canards s’arrachant au petit canal jouxtant le sentier spongieux, enfin cet inimaginable dromadaire bougeant lentement dans la lumière irréelle de ce nouveau jour où notre pas s’accordait à celui du Temps…
FLEUVE DU TEMPS. - La vieille angoisse d’avant l’aube m’avait repris devant la mer encore noyée dans le noir du nord, une bribe de phrase m’était revenue de la confusion d’un dernier rêve… Eh oui, quand on s’est adossé au fleuve du Temps… Alors je me suis rappelé où nous nous trouvions avec L. dont la mère s’était réfugiée sur une île proche dans une période difficile de sa vie, puis une première clarté s’est délayée dans l’obscur et, comme posées dans la brume, les bêtes en sommeil réapparurent de loin en loin, et le tableau d’une infinie douceur se recomposa tout entier comme un désert aux couleurs montant peu à peu, le vert blanchi de givre des polders, de loin en loin les éclats de miroir de l’eau gelée, là-bas les taches de rouille des petits étangs affleurant le brouillard d’où surgissait à peine les ailes d’un moulin à l’ancienne, la ligne orangée du levant et le bleu laiteux de la grande toile pure de cette aube, et tout proche maintenant ce cheval immense semblant scruter ces deux matinaux, ces flocons de laine des moutons de loin en loin, de temps à autre un vol de canards s’arrachant au petit canal jouxtant le sentier spongieux, enfin cet inimaginable dromadaire bougeant lentement dans la lumière irréelle de ce nouveau jour où notre pas s’accordait à celui du Temps… UN VERBE DE CRISTAL. - «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant».
UN VERBE DE CRISTAL. - «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant». L’ESPÉRANCE AU CŒUR DES TÉNÈBRES. - Il n’est pas de roman contemporain plus sombrement désolé que La Route de Cormac McCarthy, et il n’en est pas non plus qui laisse au cœur un tel sentiment de justification de la vie humaine restituée dans sa part sacrée. C’est le livre d’un visionnaire pascalien que cet extraordinaire voyage à travers une Amérique dévastée, dont les évocations de l’hiver nucléaire nous replongent dans les cercles inférieurs de L’Enfer de Dante. Comme celui-ci et son guide, un père et son petit garçon fuient à travers les territoires ravagés, les villes incendiées et pillées, avec pour espoir improbable d’atteindre les rivages de la mer, lesquels se révéleront aussi pourris que la nature contaminée.
L’ESPÉRANCE AU CŒUR DES TÉNÈBRES. - Il n’est pas de roman contemporain plus sombrement désolé que La Route de Cormac McCarthy, et il n’en est pas non plus qui laisse au cœur un tel sentiment de justification de la vie humaine restituée dans sa part sacrée. C’est le livre d’un visionnaire pascalien que cet extraordinaire voyage à travers une Amérique dévastée, dont les évocations de l’hiver nucléaire nous replongent dans les cercles inférieurs de L’Enfer de Dante. Comme celui-ci et son guide, un père et son petit garçon fuient à travers les territoires ravagés, les villes incendiées et pillées, avec pour espoir improbable d’atteindre les rivages de la mer, lesquels se révéleront aussi pourris que la nature contaminée.

