

 En lisant Cavalier seul de Jérôme Garcin et Vous dansez de Marie Nimier
En lisant Cavalier seul de Jérôme Garcin et Vous dansez de Marie Nimier
Le style est la pointe de la discipline et si possible invisible, si possible naturel en apparence, l’effort s’effaçant dans la grâce du geste, comme il en va de la danseuse ou du cavalier, et c’est exactement ce qu’on vit, à l’instant de le lire, à travers deux livres déliés de Marie Nimier et de Jérôme Garcin avec lesquels, en deux bonds élégants, on passera d’une année à l’autre, et qui parlent incidemment de la même chose, à savoir du rapport exact, approprié, supposant un drill rigoureux mais se donnant sans peine, entre la chose vécue et sa transmutation par le verbe.
Marie Nimier se déplace comme sur les pointes dans les nouvelles et autres tableautins de Vous dansez, où sa légèreté de touche, parfois jusqu’à l’évanescece, va de pair avec la concentration et le mordant de l’expression. Prêt à être portés au théâtre (comme plusieurs l’ont d’ailleurs été), ces dialogues oscillent entre l’évocation lyrique et la satire, comme celui qui oppose le journaliste et la ballerine ou le discours in petto de celle qui passe un casting drillé par un expert à formules toutes faites. Même un peu mince, tout ça est très finement filé dans une belle écriture.
Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion. Or Cavalier seul est bien plus que cela, et d’abord par son style magnifique, dont la tenue reproduit en somme celle de l’écrivain en selle, au double sens du terme.
Ce début l’annonce à merveille : « Deux heures de promenade sur la plage désertée de Deauville et sous un ciel bas d’apocalypse. La mer est en colère, elle a sorti son beau gris métal. En guise de prélimnaires, les pieds fouettés par les vagues, Eaubac léchouille l’eau salée comme s’il lapait du champagne. C’est un cheval distingué, un peu gourmé. Ensuite, on trotte face au vent et à une fine bruine. Les mouettes s’envolent sur notre passage, Au loin tanguent les bateaux qui rentrent en procession au havre. Eaubac trépigne, à qui la Manche donne des envies de rodéo : la marée est très basse, le sable compact, l’air abrasif. Un char à voile nous croise, et le voici parti en coups de cul et autres figures de gymnastique. Je tends à peine les rênes. On s’installe alors dans un galop puissant et cadencé qui n’en finit pas. Extase matérielle »...
C’est cela même : extase matérielle. Quand une novice débarquait au couvent d’Avila pour y assouvir son besoin d’élévations mystiques, Thérèse lui désignait aussitôt le seau et la serpillière qu’il y avait là et le grand dallage qu’il y avait là-bas, pour premier exercice spirituel. Dans le même esprit, la danseuse de Marie Nimier et le cavalier de Jérôme Garcin bossent un max pour la seule beauté du geste et de l’art, sans parler du tonifiant plaisir du lecteur. Dans l’un et l’autre cas, la classe du style s’impose, le pied-léger…
Marie Nimier, Vous dansez. Gallimard, 2005.
Jérôme Garcin, Cavalier seul. Gallimard, 2006.






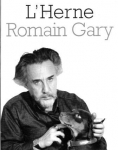


 jusqu’à l’agriculture est devenue quasi virtuelle. Le tableau est noirci à souhait, la France du Nord-Est a des airs de Bronx rural post-nucléaire, et le premier contact du charmant lettré, qui prépare une thèse sur la rhétorique de la destruction dans les pamphlets du XVIIIe, avec ses camarades Animateurs de la Communauté Educative (ACE) n’est pas piqué des charançons…
jusqu’à l’agriculture est devenue quasi virtuelle. Le tableau est noirci à souhait, la France du Nord-Est a des airs de Bronx rural post-nucléaire, et le premier contact du charmant lettré, qui prépare une thèse sur la rhétorique de la destruction dans les pamphlets du XVIIIe, avec ses camarades Animateurs de la Communauté Educative (ACE) n’est pas piqué des charançons…
 son Mélancolie de François Nourissier
son Mélancolie de François Nourissier







 La diffamation de Christophe Dufossé
La diffamation de Christophe Dufossé 



