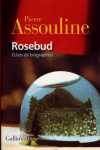Microfictions de Régis Jauffret, ou le réel fantasmé
Dans La littérature en péril, Tzvetan Todorov stigmatise la triple tendance marquée, dans le roman français contemporain, au formalisme tournant à vide, au nihilisme et au solipsisme. J’ai regretté, pour ma part, que l’essayiste n’ait pas illustré son propos par des exemples, mais on peut admettre, aussi, que le caractère surplombant et général de son propos suffise à l’amorce d’un débat qui se fera « sur pièces », comme y engage par exemple la lecture du dernier « roman » de Régis Jauffret, fort bien accueilli par le milieu médiatico-littéraire parisien et qui me semble, à moi, la parfaite illustration d’une littérature creuse, coupée du réel et modulant le solipsisme de l’auteur à proportion inverse de son intention affichée
L’idée du dernier livre de Régis Jauffret était pourtant intéressante, consistant à déployer une sorte de chronique kaléidoscopique qui modulerait tous les états de l’humanité sous forme de brefs récits sans liens apparents mais tenus ensemble par le pari fou de l’auteur de parler au nom de tout un chacun : « Je suis tout le monde ». Or dès le premier exergue, «Je est tout le monde et n’importe qui», cette nuance du « n’importe qui » annonce bel et bien la catastrophe, liée au fait qu’aux yeux de Jaufret «n’importe qui» est interchangeable, à commencer par ce type qui découvre un jour qu’il est Arthur Monin et qui s’évertue, dès lors, à le devenir, c’est-à-dire forcément rien.
Si c’est être forcément rien que de naître Arthur Monin, tous les «forcément» en découlent, qui relèvent non pas de l’observation de la vie mais d’un décret initial de l’auteur concluant à la nullité non seulement de tous les Arthur Monin mais de tous les profs et de tous les flics - forcément tarés et tortionnaires comme ce prof qui déteste ses élèves et baise sa collègue aux chiottes et ce flic américain dont le père est forcément du Ku Klux Klan et la mère forcément black battue -, de tous les pères et de tous les grands-pères, tel ce papy gentil qui recueille sa petite-fille maltraitée avec des attentions rares pour mieux se branler sur sa couette…
Ce n’est pas la noirceur de cet univers, bien entendu, qui me dérange et m’ennuie, mais le caractère absolument artificiel de cette noirceur. La noirceur est partie du monde, qu’on trouve à tous les coins de rue de la grande ville Littérature, chez James Ellroy ou chez Robin Cook, chez Patricia Highsmith ou chez James Lee Burke, mais tous ces auteurs disent la noirceur parce qu’ils en souffrent et la suent parce qu’ils la sentent, tandis que Régis Jaufret ne fait que noircir le réel pour se faire peur sans communiquer rien d’aucun sentiment de la réalité. Microfictions se veut un arpentage du monde et de ses milles horreurs et douleurs. Il n’est que le dégueuloir d’un littérateur dont le dégoût de la vie et des gens ne communique que le plus morne ennui. Bien entendu, ce livre a l’air de parler du réel, ainsi que le fantasment ceux qui restent claquemurés chez eux et se penchent à la fenêtre pour voir, là-bas, le miséreux ou la malvivante, et comme Régis Jauffret a l’air d’un écrivain (il l’a été et pas des moindres, dans ses premiers livres), et que son livre paraît dans le saint des saints de l'édition française, qui oserait dire que Microfictions n’est pas le top du top ?
Dans un entretien récent du Figaro sur l’état de la littérature française, Richard Millet, directeur de collection chez Gallimard, l'a d’ailleurs proclamé: que Régis Jauffret est des rares auteurs français dignes d'estime. Ceci en même temps, rappelons-le, que le même Millet (excellent homme de lettres lui aussi) déclarait qu’un Philip Roth écrit mal !
Eh bien, cher Tzvetan, voici très exactement où nous en sommes: à célébrer un livre pléthorique qui ne dit rien du réel (et par réel il va de soi qu’on entend tout le réel, qui englobe le dit du réel et tous les imaginaires connectés) et à stigmatiser le « mal écrire » d’un romancier dont tout l’effort depuis quarante ans a été de travailler sa réalité au corps et à la lettre en étendant de plus en plus le spectre de sa perception, de son petit moi masturbateur à ses couples puis à tous les milieux et tous les cercles concentriques de l’histoire réelle ou rêvée de l’Amérique contemporaine. Chers littérateurs du Quartier latin: comme vous écrivez bien, et combien vous nous rasez…
Régis Jauffret passe, depuis ses premiers livres, pour un écrivain à l’écoute des vies ordinaires, mais je vois de plus en plus, pour ma part, dans sa vision de la réalité, la seule projection systématique d’une maussaderie dépressive qui réduit ses personnages à des schémas, voire à des clichés. C’était déjà bien pénible dans Asile de fous, où la haine des familles perdait toute vraisemblance faute de nuances et de détails, et ce l’est plus encore dans ces Microfictions qui manquent également de nuances et de détails, mais aussi de vraie compassion et de vraie curiosité pour la vie des gens. Ceux-ci sont systématiquement moches, violents, abjects, ou au contraire victimisés par toutes les formes de pouvoir, mais jamais surprenants, jamais émouvants, jamais une chose et son contraire, jamais sentis réellement de l’intérieur, jamais vraiment libres ni vraiment vibrants de leur voix propre - les éléments contrapuntiques du dialogue étant eux-mêmes signes d'impersonnalité mortifère. Cela donne donc un livre surabondant en apparence et d’une étonnante pauvreté de réelles observations et de réelles émotions, pauvre en outre en sensations physique, pauvre en plaisir d'écriture – un livre écrit avec la tête qui ne pulse donc ni ne bande ni ne pue ni ne diffuse aucun parfum. Mille pages de trop ?
Régis Jauffret. Microfictions. Gallimard, 1027p.
En français dans le texte - Page 2
-
Mille pages de trop
-
Grâce et tremblement

Heisei de Béatrice Rateboeuf
C’est au fond d’une tasse de porcelaine contenant son thé au lait du matin, et à la surface de laquelle elle a cru voir flotter un cheveu, lequel a peut-être coulé ensuite (« les cheveux coulent donc ? » se demande-elle aussi bien) puisqu’elle ne le voit plus, là au fond qu’elle découvre la calligraphie japonaise signifiant heisei, c’est à savoir calme, paix, sérénité, et ensuite on voit des mésanges et un début de jardin zen fait de lentilles et de cailloux jouxtant un pied de giroflée, il est question de pins nains et de feuilles miniatures, et tout aussitôt cette évocation rappelle à celle qui écrit que vers la fin d’une guerre « à bout de carburant, les villageois japonais récoltaient des quantités de racines de pin afin d’en extraire, dans la vapeur des cabanes dressées au bord des torrents, un mystérieux élément destiné à fabriquer une huile pour moteurs d’avion ». Dans la foulée on lit ce qui suit qui se précipite. « La vie d’un homme pèse le poids d’une plume », répétaient les gradés en électrisant à coups de formules bushido et de saké les pilotes sommairement entraînés, des kamikazes de 18 ans qui, à bord des vieux Zeke de Mitsubishi, se décrocheraient d’un point d’altitude et chuteraient vers la cible avec l’abandon d’un pétale qui tombe ».Puis on revient au bord du jardin zen aux mésanges : «Les aiguilles frappent à la vitre, les piafs picorent tout en appelant les autres, dès qu’ils sont cinq ou six ils se volent dans les plumes. Si sans lever les yeux je me déplace pour remplir à nouveau la théière, ils restent, si je fais un seul geste en les regardant ils s’enfuient. Homme ou animal, nous savons toujours si notre regard en a croisé un autre, même le temps d’une seconde, même dans la pénombre, même de loin. Mais à 9000 mètres d’altitude, les équipage des B-29 américains n’ont rien vu du visage des civils tournés vers le bleu limpide d’une matin de guerre ». Et le pilote de s’extasier : « Il faisait un temps de rêve ». On connaît la suite. Ou plutôt non : on sait les dates et le nombre des calcinés et des irradiés, mais le souvenir s’est perdu depuis longtemps, et plus précisément celui du nom de code de la nouvelle de ce 16 juillet 1945 : « Naissance bébé réussie ».
Béatrice Rateboeuf pratique une espèce d’écriture sacrée, en cela que le mystère de la présence s’y confond indissolublement avec l’évidence du pire, qui fait des quelque cinquante pages de ce petit livre une sorte de cristal physique et métaphysique à la fois, d’une forme étrangement aléatoire et surexacte dans la distribution musicale de ses séquences, de son rythme et de sa découpe verbale.
Il neige et des masseurs aveugles traversent le jour en même temps que reviennent des noms et des images, Little Boy est une bombe et les syllabes crues de Nagasaki claquent plus facilement que celles d’Hiroshima - mais allez, on ne fait que passer, juste une trace en passant sur son Mac : « Sur la blancheur de plume des pelouses, une cigogne en pièces détachées, ailes noires et long bec orange, s’anime au ralenti syncopé d’une paire de baguettes vermillon ».
Béatrice Rateboeuf. Heisei. Inventaire/Invention, 55p.
www.inventaire-invention.com -
Un amour de père
Le père adopté de Didier van Cauwelaert
Il est au monde d’heureuses natures, et tel est sans doute Didier van Cauwelaert, longtemps considéré comme le gendre idéal par ces dames après avoir prétendu, dans sa cour de récréation, n’être autre que le fils naturel du roi Baudoin de Belgique, auquel il est d’ailleurs possible que s’apparentent ses ancêtres plus ou moins comtes ou barons.
C’est cependant à un démocrate avéré préférant le surnom de « Vanco» à sa particule, avocat au civil et romancier manqué côté jardin secret, que son fils Didier, qui a réalisé son rêve littéraire (une œuvre très prisée du public et très primée, notamment par le Goncourt 1994) rend ici un éclatant hommage. De toute évidence, René van Cauwelaert fut un type formidable, qui « mourut » une première fois lorsque son fils avait sept ans, ayant déclaré à sa femme, au su de l’enfant, qu’il se tirerait une balle dans la tête plutôt que de faire subir sa déchéance de vieille peau aux siens. Ce même jour, le garçon décidait de devenir écrivain, et cinq ans plus tard, il « adoptait » solennellement son père, à vie cette fois, qui n’avait cessé par ailleurs, au contraire de sa mère plus sourcilleusement critique, de se poser en premier « fan » inconditionnel de son romancier de fils.
« Je sais par expérience que l’invention précède souvent la vie », écrit le romancier, « et j’ai toujours eu à cœur de percevoir et transmettre ce que la réalité présentait de plus inimaginable ». Or le fils va trouver, dans les cahiers que lui transmet son père, la matière merveilleuse d’une galerie de portraits de famille qu’il prolonge ici à la mémoire de René.
Affectueux et drôle, affabulateur passé maître dans le mentir vrai, Didier raconte aussi la belle histoire d’amour de René et de sa Paule, grande bringue adorable qui vivra douloureusement, dans son coin, la perte d’un tel amour de jules…
Didier van Cauvelaert. Le père adopté. Albin Michel, 280p. -
Un amour sans retour

Tous les enfants sauf un, lumineux essai de Philippe Forest
Après les deux romans d’émotion et d’implication que furent L’Enfant éternel, premier exorcisme déchirant, et Toute la nuit, tentative de rapport clinique achoppant au scandale de la mort d’un enfant, Philippe Forest revient « encore » à cet événement que fut, pour lui et sa jeune femme Hélène, la perte de la petite Pauline, trois ans, il y a dix ans de ça.
Un de ses amis a beau le lui avoir rappelé: qu’en d’autres lieux, d’autres cultures, d’autres temps, pareil drame n’eût été que péripétie, lui citant Montaigne qui ne se rappelait pas, dit-on, le nombre exact de ses enfants, tant il en avait perdus…
Or ce nouveau livre, cet essai plus précisément, n’a rien de ressassant ni de complaisant dans la déploration. Si Philippe Forest est trop sévère avec lui-même en écrivant qu’il a « mal dit » et « mal fait » avec ses romans, on comprend bien ce qu’il veut dire aujourd’hui qu’il constate que rien n’a changé par le truchement de ces livres, si tant est qu’ils n’aient pas entretenu certain malentendu.
« Quelle leçon de vie », lui aura-t-on seriné en croyant bien faire, alors que tout a été « appris » autrement qu’on croit ou qu’on dit sans avoir vécu la chose dans sa chair ; et c’est de cet apprentissage, de cet approfondissement de la connaissance de la douleur, du repérage de ce qui a été vraiment ressenti loin des consolations convenues, qu’il s’agit dans Tous les enfants sauf un.
Au coeur du livre, un chapitre capital stigmatise tout ce qui est dit et fait aujourd’hui autour du « travail de deuil », que Philippe Forest remet en cause en dénonçant ce qui est trop souvent une opération d’évacuation de l’objet de la souffrance, pour ne pas dire une technique de l’oubli et du rebondissement. Alors même qu’on valorise à l’extrême ce « travail de deuil », l’entourant de moult coachings et autres cellules de soutien psychologique, sur un ton d’autant plus emphatique et sentimental que le deuil touche à l’« enfance innocente», le processus lui-même est un leurre selon Forest, qui aboutit à la substitution de l’ « objet » aimé par telle ou telle « raison d’espérer ». Cas de figure idéal : le petit ange avait une petite sœur : vivez donc pour elle !
Or, aux « travaux forcés du deuil », qui évacuent la réalité de la mort comme on évacue la réalité de la maladie tant que faire se peut, dans notre société de bien portants et bien produisants, Philippe Forest oppose une alternative qu’il a construite pour lui-même à partir de la lecture du Rameau d’or de Frazer, à l’imitation des primitifs, introduisant la notion de sacrifice dans la relation des (sur)vivants et de leurs défunts. Et de citer aussi l’ Erotique du deuil au temps de la mort sèche de Jean Allouch: « Envisager le deuil en termes de travail revient à considérer que les objets du désir sont interchangeables, qu’ils sont comme les fétiches indifférents à l’aide desquels, les substituant les uns aux autres, l’individu recouvre le vide insupportable qui se creuse devant lui. Mais le concevoir comme sacrifice – comme y invite Allouch – consiste à considérer ce trou et à comprendre que c’est depuis sa profondeur incomblable que se lève la féerie d’une vision fidèle à la vérité ».
Féerie et vérité : tels sont aussi bien les deux pôles entre lesquels ce livre de pensée incarnée, ce livre de titubant amour, ce livre d'intuition affective et d'intelligence acérée ne cesse d’osciller. Dès les premières pages le double constat est tombé, sur « l’extraordinaire immobilité du chagrin » et « l’effarement inaltérée devant la vérité ».
L’évacuation de la maladie et de la mort revient, dans la société occidentale contemporaine, à l’évacuation du vivant. Le malade inquiète tant qu'il ne se décide pas pour la vie ou la mort, et l'handicapé fait tache. Du sidéen ou du cancéreux, on invoquera même la faute d'un air entendu... A ce propos, de très fortes pages sont consacrées par Philippe Forest aux mythes liés au cancer, trop souvent assimilé à une défaillance de la vitalité, sinon à un suicide différé. Combien ainsi un Fritz Zorn, endossant, avec la société mauvaise, la Faute dont son cancer était en somme le symptôme punitif, a-t-il fasciné avec son Mars relevant, en réalité, de la « vengeance » et de la littérature…
Pauline avait un nom, tandis que Fritz Zorn ne dit jamais qu’il a un frère, que celui-ci aussi avait un nom et point de cancer. Du côté de la vie, et boiteuse, et salope, Philippe Forest rend son nom à sa fille et à sa femme Hélène, pour les ramener dans ce lieu où l'amour porte lui aussi nom et visage. Tous les enfants sauf un est également une belle méditation sur la mélancolie de l’hôpital englobant soignants et patients, sur le sadisme et la sainteté cohabitant dans le ghetto de l’hôpital qui est aussi un refuge (et l’auteur rend hommage à l’hôpital français), sur la sidération de la douleur et l’impossible retour à ce que la mort salope nous arrache, une dernière évocation de ce qui fut avec Pauline et sans elle jusqu'à la folie errante, alors que le nom de l'enfant perdu se trouve enfin prononcé par delà le sacrifice symbolique.
Philippe Forest. Tous les enfants sauf un. Gallimard, 174p. -
Que la lecture est irremplaçable

A propos de Perla de Frédéric Brun et de Fracas de Pascale Kramer.
Je viens de lire ce matin gris un petit livre en une heure, le premier d’un auteur du nom de Frédéric Brun, paru sous le titre de Perla, et, resongeant aux arguties de Pierre Bayard sur la non-lecture, je me dis que malgré tout rien ne vaut la lecture et complète, d’un livre, et que parler de celui-ci sans l’avoir lu serait une absurdité. Je me faisais la même réflexion hier à propos d’un autre livre, de mon amie Pascale Kramer, intitulé Fracas et dont pas une miette ne doit être perdue sous peine de passer à côté. Que maintes gens passent à côté de Perla ou de Fracas ne m’inquiète pas autrement, je suis bien conscient qu’on peut vivre et survivre sans avoir lu Fracas ou Perla, mais ce n’est qu’en lisant ces livres d’un bout à l’autre qu’on peut se parler à soi-même d’eux en connaissance de cause, en démêler les qualités et les éventuels défauts, surtout s’en incorporer la substance puisque substance il y a - étant entendu que les livres sans substance, on les laisse tomber après deux trois pages et voilà tout.
Perla est un livre de deuil, comme on dit, un livre de larmes et limpide, comme nettoyé par la douleur et l’effort de la surmonter en écrivant, un livre clair et lumineux. Frédéric Brun a rêvé qu’il brûlait son manuscrit après être revenu à Auschwitz, soixante ans après que sa mère Perla y a séjourné quelques mois, déportée dans le dernier convoi parti de Drancy, en juillet 1944. Frédéric Brun n’a pas détruit son manuscrit en réalité et nous lui en savons gré car son récit, vital sans doute pour lui, mérite aussi d’être lu et « vécu » par chacun. C’est l’histoire d’un homme qui va devenir père au moment où sa mère, Perla, disparaît après des années à la fois brillantes (elle s’est refaite une belle situation, comme on dit, au retour des camps) et régulièrement marquées par la dépression. Tandis que le fœtus de son enfant grandit dans le ventre de Manon, Frédéric évoque, en alternance, les faits liés à la Shoah, dont sa mère lui a très peu parlé mais qu’il documente avec tous les livres qui en témoignent, et les motifs de l’apprentissage existentiel qu’il découvre dans les Bildungsromanen des romantiques allemands. D’aucuns hausseront les épaules et diront sans lire : lu et relu, vu et revu. Or précisément, la vraie lecture de vrais livres ne relève jamais du « déjà vu ». Cela tient à des riens, dont un Pierre Bayard ne dit rien : cela tient à la voix de l’auteur, à la forme de ses phrases, à la musique de celles-ci, à ce qui fait l’unicité de chaque personne, que l’art exprime corps et âme. Parler en ville de Perla ne nous donnera aucun prestige, mais lire ce livre est un cadeau qu’on se fait. Pareil pour Fracas, en plus fouillé, complexe, tordu et captivant, pour autant qu’on lise sans en perdre une miette. Pascale Kramer est une romancière tout à fait originale, dont la substance de l'écriture, si poreuse, est unique. Il ne se passe apparemment presque rien dans Fracas, qui se donne sans dialogue « extérieur ». Or ce livre hypertendu bruisse de voix et les événements minuscules s'y bousculent. Il s’agit d’une famille franco-américaine qui se retrouve dans une maison perdue, au bord d’un canyon californien ravagé par une tempête, avec la menace latente d’un bloc de rocher en suspension au-dessus de son toit. Au déchaînement récent des éléments fait pendant la sourde tempête intérieure qui tourmente les membres adultes de la famille (mais les mômes aussi s’agitent alentour) après un accident dont vient d’être victime la jeune Cindy, probable maîtresse du père, mais celui-ci et sa femme, à cran, font tout pour verrouiller ce secret.
Pareil pour Fracas, en plus fouillé, complexe, tordu et captivant, pour autant qu’on lise sans en perdre une miette. Pascale Kramer est une romancière tout à fait originale, dont la substance de l'écriture, si poreuse, est unique. Il ne se passe apparemment presque rien dans Fracas, qui se donne sans dialogue « extérieur ». Or ce livre hypertendu bruisse de voix et les événements minuscules s'y bousculent. Il s’agit d’une famille franco-américaine qui se retrouve dans une maison perdue, au bord d’un canyon californien ravagé par une tempête, avec la menace latente d’un bloc de rocher en suspension au-dessus de son toit. Au déchaînement récent des éléments fait pendant la sourde tempête intérieure qui tourmente les membres adultes de la famille (mais les mômes aussi s’agitent alentour) après un accident dont vient d’être victime la jeune Cindy, probable maîtresse du père, mais celui-ci et sa femme, à cran, font tout pour verrouiller ce secret.
Lu et relu, vu et revu ? Sans doute, s’il n’était question que du « sujet », mais quel est-il en réalité ? Et qui a jamais observé comme ça, forgé de telles métaphores et trouvé de tels adjectifs, dit tant de choses sur ce qui ne se dit pas à l’ordinaire ? Une telle lecture ne m’est pas plus vitale, dans l’absolu, que celle de Don Quichotte, que je n’ai jamais lu en entier (ça viendra) ou de La Divine Comédie, dont je n’ai jamais lu en entier Le Paradis, mais ces jours Fracas, comme Tumulte de François Bon, lu en parallèle, ou Perla, m’ont apporté des choses que la non-lecture ne m'apportera jamais. C’est affaire, une fois encore, de voix plus que de savoir, de peau et de regard, de ce je ne sais quoi qui fait que chaque vrai livre a un bout de vérité unique in the world à nous transmettre…
Frédéric Brun. Perla. Stock, 2007.
Pascale Kramer. Fracas. Mercure de France, 2007. -
Tumulte à la Place des Pensées
En lisant François Bon et Richard Millet
« J‘écris sur écran, c’est un cadre pour voir : qui lit devrait voir », écrit François Bon dans l’une des séquences de Tumulte, mais je n’ai pas voulu lire ce texte sur écran, je le lis depuis quelques jours au fil des pages qui se tournent lentement, chacune ouvrant à des rêveries sans fin et voici que je vois « simplement une rue, l’enfilade d’une rue terne et ce qu’on voit en voiture la nuit, éclat partiel dans la lumière et rien qu’on retienne que formes, géométries grises : cela ne fait pas une histoire, mais vous donne envie d’une histoire, il suffit alors de s’arrêter, d’attendre »…
L’univers de François Bon m’est absolument étrange, je ne dis pas étranger mais étrange, comme je pourrais le dire des journées d’un géomètre islandais ou des pensées d’un traducteur du coréen qui me parleraient d’eux sur un ton qui me mettrait aussitôt en confiance et en confidence, mais pas tant avec eux qu’avec la nuit autour de nous, comme si François Bon dans les pages de ce livre labyrinthique feuilletait un livre qui serait à la fois une lecture du monde et ce que nous écrivons mentalement en le lisant. « Depuis si longtemps tu rêvais de ce livre, tu es au bord, tu l’ouvres », et là-bas, dans la nuit se dresse la plateforme Hibernia que m'évoquent ses souvenirs offshore et qui me rappelle, à moi, les stations météorologiques de haute montagne où nous allions nous réfugier pendant quelque tempête au fond de laquelle les voix semblaient comme en mer, proches et lointaines, comme celles des naufragés de la sublime fin de L’homme qui rit me rappelant soudain telle figuration du Déluge de Bill Viola…
« Je danse avec moi-même, et lui c’est un mort », lit-on ensuite dans la séquence intitulée Proust dansait avec Kafka, qui me ramène à la collection de mes propres morts, le plus tendre me regardant lire ce livre avec le regret de me voir triste de ne pouvoir en parler avec lui, et pourtant j’en parle avec lui et je sais que cela sera de longs bons jours comme avec Le poids du monde de Peter Handke dont nous avons tant parlé ou quelque autre de ces livres à murmures dont il est si difficile de parler à d’autres qu’à ceux qu’on aime…
J’alterne ces soirs et ces aubes la lecture de Tumulte de François Bon et celle de Place des Pensées de Richard Millet, évoquant sa visite à la maison de Maurice Blanchot. On est en pleine littérature, avec ces deux-là, me dis-je, mais je ne fais attention qu’à ce murmure, chez l’un et l’autre, aux beaux et sombres espaces qu’ouvre Tumulte, à la très pure musique de la mémoire immanente en cette Place des Pensées du veilleur janséniste, l’un et l’autre personnels et impersonnels, explorateur exhaustif ou arpenteur des sables de l’après-midi en petite banlieue, et cette musique où tout ce qui monte converge…
L’étrange paire que voilà, me dis-je alors en voyant la neige dans la nuit de la fenêtre, deux vrais écrivains dans la gravité, mais je les regarde avec la même distance candide de l’enfant qui ne verrait d’eux que certaine beauté de concentration chez le géomètre coréen ou le traducteur de l’islandais, leurs mots ne servent qu’à me faire mieux écouter le murmure de mon propre sang, de ma propre angoisse et de je ne sais quelle nostalgie commune à ces deux-là, tumulte à la place des pensées…
François Bon, Tumulte. Fayard, 2006.Richard Millet, Place des pensées. Gallimard, 2007
-
Mille pages de trop ?

Microfictions de Régis Jauffret.
L’idée du dernier livre de Régis Jauffret est intéressante, consistant à déployer une sorte de chronique kaléidoscopique qui modulerait tous les états de l’humanité sous forme de bref récits sans liens apparents mais tenus ensemble par le pari fou de l’auteur de parler au nom de tout un chacun : « Je suis tout le monde ».
Dès la première centaine de pages de Microfictions, qui en compte plus de mille, l’intérêt vif et la curiosité ne tardent pourtant à s’émousser, tant le sentiment que chacun des personnages que Jauffret fait parler n’est en somme qu’une projection fantasmatique de l’auteur en telle ou telle figure, sans voix personnelle, sans épaisseur, sans nuances, sans aura en un mot. A tel point que l’impression dominante se réduit, à quelques exceptions près où la voix de l’auteur lui-même filtre plus simplement, à cet autre constat plus morne : « Je ne suis personne ».
Régis Jauffret passe, depuis ses premiers livres, pour un écrivain à l’écoute des vies ordinaires, mais je vois de plus en plus, pour ma part, dans sa vision de la réalité, la seule projection systématique d’une maussaderie dépressive qui réduit ses personnages à des schémas, voire à des clichés. C’était déjà bien pénible dans Asile de fous, où la haine des familles perdait toute vraisemblance faute de nuances et de détails, et ce l’est plus encore dans ces Microfictions qui manquent également de nuances et de détails, mais aussi de vraie compassion et de vraie curiosité pour la vie des gens. Ceux-ci sont systématiquement moches, violents, souvent abjects, ou au contraire victimisés par toutes les formes de pouvoir, mais jamais surprenants, jamais émouvants, jamais une chose et son contraire, jamais sentis réellement de l’intérieur, jamais vraiment libres ni vraiment vibrants de leur voix propre. Cela donne donc un livre surabondant en apparence et d’une étonnante pauvreté de réelles observations et de réelles émotions, pauvre en outre en sensations physique – un livre écrit avec la tête qui ne pulse ni ne bande ni ne pue ni ne diffuse aucun parfum. Mille pages de trop ?
Régis Jauffret. Microfictions. Gallimard, 1027p. -
Les amours différées

La disparition de Richard Taylor, le nouveau roman tendre et noir d’Arnaud Cathrine
On ressort de ce beau roman polyphonique avec l’impression d’avoir traversé plusieurs vies ou reçu autant de confidences, toutes de femmes, s’entrecroisant pour composer le portrait en creux d’un homme perdu, mélange d’enfant et d’artiste qui aurait renoncé à jouer le rôle que les autres attendaient qu’il tînt.
Richard Taylor, en ses jeunes années, aimait peindre et jouer du piano, à quoi il renonça pour couper aux foudres paternelles, avant de se conformer en apparence à une existence petite-bourgeoise, au côté de sa femme Susan, qu’il exècre en réalité. Or, comme le Monsieur Monde de Simenon, voici qu’il disparaît tout à coup en ne laissant à sa mère et sa femme qu’une lettre leur révélant qu’il se sent «à leurs griffes » et qu'il a décidé de casser net et de se casser: qu’elles ne le reverront plus, en partance qu'il est fissa pour Tokyo. Sa dérive ne le mènera pas si loin, que nous suivons tout au long du roman, évoquée par les femmes qui le rencontrent, le recueillent momentanément, l’aiment et le perdent comme il semble que lui-même se soit perdu à jamais, n’était un bonheur revenu à peindre ou des essais de retour dont le plus douloureux est celui qui lui fait découvrir la fin tragique de sa femme et de leur enfant.
Si le protagoniste, qui se juge lui-même lâche, imposteur et indigne d’intérêt, nous touche par sa fragilité et son intégrité, c’est à travers le regard des femmes qu’il nous intéresse à vrai dire et, dans la foulée, c’est à ce que vivent ces femmes que nous nous intéressons plus encore, comme à autant de modulations de l’amour espéré et le plus souvent différé.
De l’amour terre à terre de Susan, l’épouse conformiste, à la passion complexe de Rebecca, collègue de Richard à la BBC, en passant par l’attachement charnel et affectif de la jeune Lydia O’Lear, la gamme des sentiments est riche, qui se déploie plus largement encore à l’approche d’autres beaux personnages féminins chez lesquels le protagoniste trouve refuge ou ne fait que passer. Ainsi de l’attachante Molly Hunter, chez laquelle il se pointe car elle vit dans la maison où il a passé son enfance, qui imagine un instant que « quelque chose » pourrait se passer entre eux, tout en devinant qu’il n'en sera rien. Sur les traces du fugitif, on croise également la trajectoire de la dramaturge Sarah Kane, amie de la transsexuelle Vanessa, qui croit rencontrer l’amie rêvée dans le métro avant de tomber par hasard, en pleine crise de désarroi, sur Richard qui a l’air aussi perdu qu’elle. Dans la foulée, Sarah se fait la réflexion que, dans ses pièces, elle n’aura jamais en somme fait que parler d’amour…
On pourrait en dire autant de ce roman à multiples voix, dont les dialogues signalent d’ailleurs un grand talent théâtral virtuel, et que sa densité émotionnelle et sa pénétration intuitive, sa vivacité d’observation et son tonus interne tirent du côté de la vie en dépit de sa noirceur. Rien cependant de complaisant en celle-ci, qui relève plutôt de la lucidité et de l’honnêteté de l’auteur, d’une impressionnante maturité à tous égards.
Arnaud Cathrine. La disparition de Richard Taylor. Verticales, 194p. -
Pseudo et son double

Sur La berlue de Véronique Beucler
On sourit à tout moment, et parfois même on éclate de rire à la lecture de La Berlue de Véronique Beucler, qui rappelle le meilleur Nothomb ou les romans et certaines nouvelles de Marcel Aymé, particulièrement Le romancier Martin où les personnages de celui-ci se pointent chez lui pour se plaindre du sort qu’il leur réserve. Véronique Beucler pratique une langue claire et sonnante, fruitée et charnue comme l’était celle d’Aymé, avec un rythme, un allant narratif et des trouvailles de langue et d’imagination qui ne sont qu’à elle. Très original, très amusant, réussi dans les grandes largeurs, son deuxième livre (après L’amour en page, paru en 2003) s’emberlificote un peu sur la toute fin, mais sa lecture n’en est pas moins un régal.
Je ne vais pas en dévoiler l’intrigue, sous peine de gâcher le plaisir de la découverte. Disons que ça se passe entre le merveilleux jardin d’une prof de lettres bordelaise impatiente de voir paraître son premier livre, la table d’un romancier à succès qui entrera dans sa vie après qu’un couteau lui eut été planté dans les entrailles par un ado un peu maladroit (ce sont des choses qui arrivent aujourd’hui aux dames et aux ados), les bureaux d’un éditeur très mufle et de son rival qui ne l’est pas moins, et quoi dire encore si ce n’est que les embrouilles de Romain Gary et d’Emile Ajar sont toutes simples à côté de ce qui se passe dans La Berlue, jouant sur le caractère absolument unique et personnel de ce que vous écrivez dans votre coin, que nul ne saurait concevoir et surtout pas les 666 aspirants romanciers qui se voient publiés à votre place alors que vous lanternez entre anémones du Japon, aristoloches et lettres de refus de 666 éditeurs vous baillant le même babil dilatoire. Tout cela corsé de digressions épatantes, comme celle-ci qui évoque le désarroi légitime des personnages de romans emportés dans le flot actuel: « L’époque, depuis plus de vingt ans, célébrait, en toute grégarité, le voyeurisme, le déballage, le besoin de se lâcher, de s’épancher; on se répandait. La population romanesque en faisait les frais. Violentée, abusée, souillée, décimée, hagarde, elle rendait l’âme. Les survivants avaient perdu tout souvenir des corps heureux, des corps en fêtes. (...) Le roman, hydre aux huit cents titres annuels, se réduisait à une petite affaire privée, un gratouillage de nombril ou d’entre-fesses, jeté sur la place publique »…
Véronique Beucler. La Berlue. Albin Michel, 203p. -
Le barbare «communique»
Sur Le dieu du carnage de Yasmina Reza
Après que le jeune Ferdinand, onze ans et des bricoles, a bastonné le non moins jeune Bruno, qui refusait de l’admettre dans sa bande et se retrouve avec deux incisives amochées et le visage en semi-compote, les parents des deux lascars se réunissent chez Véronique et Michel Houillié, géniteurs de la victime. Lui est un commercial sans trop d’états d’âme et elle fait dans la littérature humanitaire – son prochain écrit traitera du Darfour. En face, Annette et Alain Reille plaident coupables, mais on verra que leur tolérance aux charge moralisantes de Véronique ont des limites. Plus précisément, les relations de celle-ci et d’Alain, avocat d’affaires très sûr de lui et qui ne cesse de communiquer sur son portable avec les relations publiques de la firme pharmaceutique qu’il représente, ne vont pas tarder à se crisper avant de plus graves éclats, quand le conflit généralisé mettra fin à la séance de conciliation dont la nouvelle pièce de Yasmina Reza détaille les tenants et aboutissants.
En gros, ce qui y est révélé n’est un secret pour personne, relevant même du lieu commun d’époque : c’est que le barbare est toujours prêt à bondir de sous le masque du civilisé et qu’il faut peu pour faire, de parents dits adultes et responsables, piqués dans leur susceptibilité de classe, de genre ou de couple, des sauvages pires que leur progéniture. Dans le cas de cette double paire, le conflit opposant initialement les conjoints se corse au moment où l’entente entre mecs et la fureur des chipies fait apparaître les failles de chaque couple, jusqu’à l’horreur vomitive et les gestes fous dont un portable « vital », jeté dans l’eau des tulipes, fera les frais avant celles-ci…
On se rappelle la verve satirique d’Art, qui fit un des premiers succès un peu convenus de la dramaturge, mais ici c’est du plus grave et du plus subtil aussi, du plus douloureusement significatif : ça fait vraiment mal, avec la même verve endiablée, sur fond de révolte légitime, que dans le récit tendrement dévastateur d’Une désolation…
Je préfère, quant à moi, le versant tchékhovien de Yasmina Reza, dans Conversations après un enterrement ou L’Homme du hasard. Mais Le dieu du carnage est à lire vite pour le méchant plaisir qu’il procure, avant de le découvrir toutes griffes dehors sur une ou l’autre scène…
Yasmna Reza. Le dieu du carnage. Albin Michel, 124p. -
Murènes de l’édition

Les sœurs de Prague, le nouveau roman de Jérôme Garcin
Une lettre d’injure carabinée marque le départ de ce nouveau roman de Jérôme Garcin, dans laquelle une frénétique Klara, de la paisible station alpine suisse de Mürren (d’où l’on découvre le panorama « majestueux et emmerdant » de la sainte trinité que forment l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau), vomit toute sa hargne et son ressentiment à l’adresse d’un jeune interlocuteur, probablement écrivain, qu’elle traite de « parangon de connerie » après lui avoir reproché son arrivisme, son conformisem et son égoïsme. On croit comprendre qu’elle l’a aidé et protégé et qu’au moment où elle-même a été victime d’un certain complot, ce « frétillant et stupide caniche » s’est montré lâche et n’a pas fait un geste pour la défendre. Invoquant son « putain de saloperie de métier », dont on suppose qu’elle a été écartée, ladite Klara écrit encore qu’elle y a aimé surtout les tournages de films tirés des livres qu’elle gérait au titre d’agente littéraire : « J’aimais l’odeur de la caméra. Oui, imbécile, les caméras ont une odeur. Elles sentent le renfermé, le bois de cercueil, le cadavre encore chaud, les draps défaits, les derniers jours de l’été. Elles filment ce qui va disparaître. Mais ça t’échappe forcément. Et l’aimable épistolière de conclure sa lettre sur ces mots : « Avec ce qu’il me reste de salive, je te crache à la gueule »»
Cette Klara est immédiatement intéressante, dont nous allons découvrir les menées dans le récit qui suit, dont le narrateur est un jeune écrivain du genre « loser » parisien, juste remarqué pour le « succès accidentel » d’un roman intitulé La tête froide, qui lui vaut d’être abordé par cette Klara Gottwald, d’origine tchèque, déjà surnommée la « rottweiler du gotha » pour les méthodes prédatrices qu’elle applique dans le monde de l’édition et du cinéma. Lorsqu’elle l’entreprend, au Lutetia, il lui avoue qu’il est en train de poireauter sur une adaptation moderne d’Armance de Stendhal, entre autres activités mercenaires de critique pigiste de cinéma. Le dynamisme flatteur de Klara ne tarde pas, dans la foulée, à lui faire signer un contrat, au dam de ses amis l’éditeur Jean-Claude et l’agent Alexandre qui voient les raids de la Gottwald d’un très mauvais œil. Plus rude pour lui : sa compagne Laetitia le raille de se prendre ainsi pour un écrivain arrivé alors qu’elle est la mieux placée pour apprécier quel glandeur il est en réalité.
Comme on s’en doute, ce nouveau statut ne sera pour le jeune romancier qu’un leurre et un poids. Son remake d’ Armance n’intéressera Klara que pour son éventuelle transposition cinématographique, et dans l’immédiat c’est en chien-chien qu’on le traite. Klara s’en servira notamment pour accueillir sa sœur Hilda à Paris, qui la rejoint pour la seconder dans ses affaires. Or ladite Hilda, prof de français jusque-là, va se métamorphoser en femme d’affaires aussi redoutable que sa sœur.
Et le narrateur de commenter : « Dieu sait que j’en ai vu, dans mon milieu, des femmes et des hommes que je croyais connaître et qui, du jour au lendemain, ont été défigurés par l’usage du pouvoir, amaigris par le régime de la tyrannie, tordus par la jalousie, déformés par la vanité, ulcérés par la faculté, à laquelle ils n’étaient pas préparés et qu’ils ne soupçonnaient pas, de nuire pour construire, d’écraser pour briller, de tuer pour survivre »… Il n’en est pas moins étonné par la transformation d’Hilda, qui se montrera bientôt à la hauteur de Klara… jusqu’à la chute du brillant tandem àla suite d'un scandale retentissant.
Le roman de Garcin, tout proche des réalités nouvelles de l’édition, est intéressant à la fois par le portrait « en creux » de son narrateur, du genre veule mais sensible et parfois sensé, et par celui des deux sœurs (Klara surtout, qui à débarqué de Prague après divers ratages existentiels - elle y a abandonné un jeune fils -, et avec une intense volonté de revanche) dont le lecteur a cependant quelque peine à concevoir ce qu’il appelle leur « tragédie ». Excellent aperçu de l’évolution des mœurs et pratiques dans un monde parisien qu’il connaît, évidemment, comme sa poche, Jérôme Garcin multiplie les effets de réel (de telle rencontre de Sollers à tel enregistrement du Masque et la plume) et c’est en invoquant son ami Jacques Chessex qu’il amène Klara à se jeter du pont aux suicidés sis en plein Lausanne, au pied duquel une pancarte mettait naguère le passant en garde : « Attention chute d’espoir»…
Un peu rapide et trop en surface à certains égards (notamment en ce qui concerne le passé et le drame de Klara), Les sœurs de Prague épate du moins par son écriture, son mordant, son allant narratif et cette vacherie noire bien « bourgeoisie française » que nuancent en douceur de belles pages rêveuses que l’auteur « offre » pour ainsi dire à son personnage, moins médiocre alors qu’il ne semblait. Le roman en perd un peu en crédibilité ce qu’il y gagne de finesse dans l’analyse et de charme dans le climat doux-amer, d’élégance aussi dans l’écriture, proche de Théâtre intime ou de Cavalier seul.
Jérôme Garcin, Les sœurs de Prague. Gallimard, 174p. En librairie le 4 janvier 2007. -
Mort à table
 Dernière révérence à Bernard Frank
Dernière révérence à Bernard Frank
Je me demande souvent pourquoi je continue d’acheter Le Nouvel Observateur depuis près de quarante ans, chaque semaine ou presque, alors que tant des aspects de cet hebdo de la gauche caviar m’y agace, parfois même m’y horripile, mais j’y reviens malgré tout pour quelques plumes de style, et la première était celle de Bernard Frank dont j’aimais le ton et le rythme des chroniques, quoi qu’il racontât, parfois presque rien, mais toujours au fil d’une espèce de soliloque nonchalant et vif à la fois, un peu snob ou superficiel les jours « sans », et qui ouvrait cependant à tout coup, dans la masse et la presse du tout-venant, la parenthèse de propos fleurant bon Paris et la France et la conversation telle que la société littéraire française l’a modulée comme nulle part ailleurs, des salons aux cafés.
Je reviens sans cesse au Journal littéraire de Léautaud, dont une ou deux pages, même de celles où il n’y écrit que des observations de tous les jours, suffisent à m’aérer et me tonifier, et c’est un peu de ça qu’on trouvait dans les chroniques (je ne suis jamais arrivé au bout d’aucun de ses romans) de Bernard Frank, à plus forte raison dans les recueils de ses chroniques. Son Pense bête fait ainsi écho aux morceaux réunis de Passe-temps de Léautaud. Plus que Léautaud, cependant, dont il n’avait pas en revanche la pureté de ligne, Bernard Frank était attentif à l’actualité littéraire, ou à l'actualité tout court, dont il parlait en toute liberté, se fichant de plaire ou de détoner.
L’ensemble de ses livres a été récompensé, en 1981, par le prix Roger Nimier, ce qui semble aller de soi pour l’inventeur du groupe improbable des « hussards » qu’on pourrait dire de la droite littéraire anarchisante ou bohème, avec Nimier précisément, Blondin ou Laurent, dans la filiation de Drieu ou de Chardonne.
Bernard Frank écrivait ses chroniques à la main, dans une manière qui n’était pas désuète pour autant, qu’on pourrait dire de la ligne claire. On lira cette semaine son dernier envoi dans le Nouvel Obs, après quoi l’on reviendra à sa géographie parisienne des Rue de ma vie, nourrie par une trentaine de déménagements, à Mon siècle ou En soixantaine, à La panoplie littéraire ou à Solde où se distille le mieux son talent de gourmet des lettres mort au restaurant à l’âge-limite des lecteurs de Tintin… -
Rosebud's Memory
Dans Rosebud, Pierre Assouline scrute la part secrète de quelques vies (Citizen Kane, Kipling, Cartier-Bresson, Celan, Jean Moulin, Picasso, Bonnard) pour en tirer un livre très riche de résonances.
Le nom de Rosebud, soupiré par Citizen Kane à l’instant de sa mort, et signifiant « bouton de rose », est lié à l’image d’une « boule à neige » tombant de la main du mourant, symbole fracassé d’une enfance perdue. L’ultime vision d’une luge de bois ensevelie sous la neige suffit à l’amorce d’une remémoration comparable à celle de Proust retrouvant un monde dans la saveur d’une petite madeleine. De la même façon, il arrive qu’un simple objet, une odeur, le son d’une voix nous évoquent tel personnage, telle époque, tel fragment d’histoire que nous nous efforçons d’arracher aux brumes de la mémoire, comme pour conjurer notre propre disparition. Or c’est précisément à cette démarche que se livre Pierre Assouline dans cet essai très personnel où le biographe engage un peu plus de sa personne dans une sorte de conversation sur la vie et ses aléas, l’art et ses enjeux, le siècle et ses tribulations, l’amour et la mort, dont chaque épisode cristalliserait en «rosebud».
Une Rolls figure alors l’impériale situation d’un Kipling, nationaliste impatient d’envoyer son fils à la guerre, lequel y crève en effet et jette le malheureux paternel sur les routes de France en quête de la moindre trace de son « héros ». Et l’auteur d’exhumer cette phrase d’un roman français de l’époque pour dire ce que vit alors Kipling : «Il pénétra dans ces régions illimitées de la douleur, où l’imbécile et l’homme de génie ne se distinguent pas ». Ou c’est la canne-siège de son ami le photographe Cartier-Bresson, qui l’entraine au musée et lui fait voir ce que Goya a vu du tréfonds de la souffrance humaine : «Regarde bien, il n’y a que Goya qui ait vraiment compris la vie, la mort… »
Une montre arrêtée sera le rosebud de Paul Celan, le grand poète foudroyé par un désespoir qu’Assouline évoque dans l’un de ses plus beaux chapitres, et c’est une écharpe au cou de Jean Moulin qui l’amène à dévoiler les stigmates d’une tentative de suicide coïncidant avec le premier acte de révolte du futur résistant.
Les objets de curiosité d’Assouline sont multiples, du mariage de Lady Diana auquel il assiste en anglophile ironique, à cet antre parisien qui fut à la fois l’atelier de Picasso et le lieu de réunion des peintres du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. A tout coup, cependant, plus que l’anecdote, c’est la relation du détail à l’ensemble qui déclenche la réflexion ou la rêverie de l’écrivain, incluant sa propre expérience sensible et sollicitant celle du lecteur, jusque dans le pur bonheur partagé des toiles d’un Bonnard taiseux incapable jamais de les finir - étant entendu que le « bouton de rose » de la beauté reste à jamais inatteignable…
Pierre Assouline. Rosebud. Gallimard, 299p.
 « L’essentiel est dans les détails »
« L’essentiel est dans les détails »
- Quel a été le déclencheur de ce livre ?
- Le point de départ, c'est le goût du détail qui me poursuit depuis longtemps. Là-dessus s'est greffé il y a quelques années un flash sur la photo de Jean Moulin, des réminiscences sur certains tabous le concernant, l'envie secrète de tout raconter à travers son écharpe. J'ai laissé mûrir. Jusqu'au jour où un autre flash m'a poussé plus avant : la lecture d'une brève dans Libération, faisant état de la découverte de vieux carnets de guerre inédits dans un tiroir de l'éditeur de Kipling... Vous connaissez la suite. Cela s'est fait naturellement. Et difficilement. En fait, cela m'a pris deux fois plus de temps que prévu car pour chaque détail, j'ai mené une enquête aussi approfondie que si je devais écrire toute une biographie. Et c'est la condensation du matériau qui me permet de parvenir à en tirer un jus si dense.
- Le biographe se découvre ici lui-même. L’aviez-vous prémédité ?
- Je savais que des éléments personnels se grefferaient sur le texte en cours d'écriture. Je me suis laissé emporter comme toujours. Ce n'était pas prémédité, je n'y suis presque pour rien. Impossible d'en écrire plus ou moins. Ce fut agréable de pouvoir écrire des chapitres indépendants les uns des autres. On y entre et on en sort comme et quand on veut. Mais l'aspect Mon coeur mis à nu ne se vit pas toujours facilement pour quelqu'un qui a plutôt l'habitude de s'effacer devant ses héros.
- Ces destinées si différentes ont-elle un point commun ? Et qu’aimeriez-vous transmettre par vos livres ?
- Le fil rouge ? La disparition, l'absence, le suicide, la mort. Le tout à travers une réflexion sur la biographie et l'art du biographe. Ce que je trouve m'apprend ce que je cherche : c'est donc en lisant les lettres de lecteurs que j'apprends ce que je voulais transmettre. L'essentiel des êtres que nous croisons, que nous rencontrons, que nous aimons parfois est dans les détails, les petits riens qui forment le tout d'une vie...
Ancien directeur de la rédaction de Lire, chroniqueur au Nouvel Observateur et au Monde 2, biographe (de Simenon, Gallimard, Hergé, Jean Jardin, Albert Londres, etc.) et romancier (Lutetia, a obtenu le prix Maison de la Presse 2005), Pierre Assouline, a 53 ans, est à la fois écrivain et passeur-lecteur, notamment sur son blog littéraire de La République des livres.
Cet article a paru dans l’édition de 24Heures du 28 novembre 2006. -
Reconnaissance en filiation
Pierre Charras rend hommage au « perdant » dont il est le fils
C’est un livre émouvant et vrai que Bonne nuit, doux prince, à la fois tendre et dur, âpre et pourtant généreux, qui rétablit un lien posthume à double valeur d’exorcisme personnel et de témoignage sur un certain type d’hommes dans une certaine France d’une certaine époque. Né en 1911, neuvième enfant d’une famille de montagnards, aspirant vite à fuir le plus tôt possible son bled natal (dont 15 appelés sur 16 tomberont à la Grande Guerre) pour la ville, cet homme marqué à vie par la mort prématurée de sa sœur jumelle, à douze ans, que l’auteur dit peut-être mort lui-même à ce moment-là, est le type du sans-grade qui s’est toujours senti méprisé, tenu pour rien, et qui fera de son effacement et de sa résignation un style de vie « à bas bruit ».
Comme souvent dans ces cas, la défaite du père lui fait reporter sur le fils l’espoir de la Réussite, via le baccalauréat et une carrière qu’on espère exceptionnelle. Devenu professeur et écrivain, l’auteur ne sera pas moins rejeté par son père lorsque celui-ci apprendra sa « différence », accréditant le sentiment de Pierre Charras que « l’amour a toujours été associé aux larmes ».
Rien cependant de larmoyant dans ce petit livre noble d’inspiration et vibrant de douloureuse reconnaissance, beau portrait d’un père en « enfant stupéfait » et, finalement, en « doux prince » du plus humble royaume.
Pierre Charras. Bonne nuit, doux prince. Mercure de France, 114p. -
A la vie à la mort

Dans Etranger au paradis, Philippe Lafitte conjugue lyrisme et vérité.
Certains livres semblent marqués au sceau du vrai, et c’est cela même qui distingue, dans le tout-venant de la rentrée, l’âpre et superbe troisième roman de Philippe Lafitte (déjà remarqué pour Mille amertumes et Un monde parfait), qui rappelle les premiers récits d’un Louis Calaferte. Entre une première évocation de la frénétique course à l’ovule marquant la conception d'un individu, et les remémorations d’un vieillard reposant dans une chambre avec vue sur les tours d’une ville immense, le récit d’Etranger au paradis ressaisit à la fois les péripéties de la vie du narrateur, qui a juste le temps d’entrevoir mai 68 avec ses parents profs avant que ceux-ci ne se tuent accidentellement, et toute une époque ressaisie avec une foison de détails merveilleusement évocateurs, où les premières présences féminines (de Petite Couette qui deviendra championne de France à Grands Carreaux ou Ventre Rond) vont de pair avec les Pifs Gadget, les premiers disques des Beach Boys, les Carambar ou les Pieds Nickelés…
Tandis qu’une douce Kiyoko s’efforce de rendre sa vitalité érotique au vieux grabataire, le souvenir de l’orphelinat se trouve irradié par la figure du compère « à la vie à la mort » de l’adolescent, Gitan supervivant au prénom de Lotr, qui lui fait entrevoir une vie plus vraie, où les livres ont leur place, avant que sa propre course se poursuive sur les rails de l’époque, course de rat ou disons plutôt : de quidam de son temps.
Or la grande force d’Etranger au paradis, avec son mélange de dureté et de tendresse, tient à la balance qu’il établit entre une destinée individuelle et le siècle que nous vivons, de grandes espérances juvéniles en bilans crépusculaires. Le ton est à la mélancolie, mais également à la reconnaissance fraternelle et à la célébration, par le truchement d’une écriture magnifiquement rythmée, des belles et bonnes choses de la vie.
Philippe Lafitte. Etranger au Paradis. Buchet/Chastel, 201p.
Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du mardi 19 septembre 2006. -
Le tueur et la demoiselle

Le dernier roman d’Amélie Nothomb
Quinze ans et quinze titres après Hygiène de l’assassin, qui révéla son talent atypique et tout à fait original, n’en déplaise aux vigiles du littérairement correct qui la snobent à qui mieux mieux, Amélie Nothomb en revient à un tueur propre sur lui que le goût des sensations neuves, révélé par un morceau de Radiohead (Pulk/Pull revolving Doors) alors qu’il se sentait « châtré de partout » après la fin d’un fol amour bête, lance dans une nouvelle carrière de tueur à gages « expérimental » mettant en valeur son ton inné de tireur d’élite.
Après avoir « explosé » un commercial de l’alimentaire, un journaliste évidemment inutile à la société, un ministre et une directrice de centre culturel non moins offensants par leur seule existence, avec une volupté virginale (« Rien n’est vierge comme un tueur ») et croissante, cet onaniste de l’acte semi-gratuit (et doublement payé) se trouve piégé dans une embrouille plus compliquée que ses exécutions impeccables à deux-coups, où telle jeune fille sauvage, comme les aimait Anouilh, le prend de vitesse et au dépourvu, ayant, elle, une raison supérieurement motivée de tuer : le viol, par son salaud de père, de son plus personnel secret.
Vif et incisif, superbement enlevé, truffé comme à l’ordinaire de digressions pénétrantes (sur les cinq sens comparés, le sexe, la rencontre, l’intimité, les textes sacrés), ce Journal d’Hirondelle, après un Acide sulfurique controversé, d’ailleurs assez injustement, et un peu bâclé tout de même sur la fin, relève de la meilleure veine de la romancière pêchant ici dans les eaux perverses d’un Mishima qu’elle admire, entre conte (a)moral et méditation paradoxale, au fil d’une écriture cinglante et truffée de trouvailles d’un humour sardonique assez irrésistible.
Citations au vol :
« C’est le corps qui rend gentil et plein de compassion pour le prochain ».
« Rien n’emporte autant l’adhésion que le cliché de zinc ».
« Le corps n’est pas mauvais, c’est l’âme qui l’est ».
« C’est le gras du cerveau qui a inventé le mal ».
« Un tueur est un individu qui s’investit davantage dans ses rencontres que le commun des mortels ».
« Si Proust avait assassiné Joyce dans ce taxi, on serait moins déçu, on se dirait que ces deux-là s’étaient trouvés ».
« Les petites dindes qui forment la majorité des vierges, sont aussi dépourvues de mystère que leurs aînées. Mais il y a ces cas de demoiselles silencieuses qui, elles, sont ce que la nature humaine a produit de plus étranger».
« On entend beaucoup moins bien la musique les yeux fermés. Les yeux sont les narines des oreilles ».
« Aucune fleur ne fleurit autant que la pivoine. Comparées à elle, les autres fleurs ont l’air de maugréer entre leurs dents ».
Amélie Nothomb. Journal d’Hirondelle. Albin Michel, 136p. -
L'éditeur et son double
 Quartier général du bruit, de Christophe Bataille
Quartier général du bruit, de Christophe Bataille
« Pourtant la langue d’or échappe aux vers », écrit ici Christophe Bataille. « Les follets dansent au cimetière. Ça crépite. Ça grimace. »
Tout est perdu fors les mots : «Je songe qu’au moins, pour la forme et les larmes qui montent en moi, brûlantes, dangereuses, il me reste comme à l’enfant un carquois de ferraille fouaillant le monde, l’histoire, le spectacle, la beauté, le diable et l’empire, pour vous abolir puis vous rédimer, car il le faut, vous tous. Vous ? Mais qui ? Mais quoi ? Les mots »…
Ainsi s’achève, à coups de mots cinglants et cinglés, ce Quartier général du bruit qui rend le son noir et sonore, fringant, canaille en élégance, d’une aventure qui est celle à la fois de la passion de faire des livres et de les lire, de la littérature et du commerce tel que l’incarna le surnommé Patron, prénom Bernard comme l’ermite ou le saint mais en plein Paris faisandé où il régnait dans son bain de la rue des Saints-Pères, son nom étant Grasset et l’une des formules de son goût : « L’édition, c’est l’électricité + les mots ».
Dans la partie électrique de la syntaxe et du vocabulaire Bataille est ferré à bloc, parfois un peu trop porté sur l’effet à mon goût mais enfin : vieille passion française. Dès la phrase deuxième la « Seine cruelle » est dite « serpe de limon » et ça craint, comme on dit, mais la suite prouvera que le sujet mange tout, à la lettre, jusqu’au cadavre et au papier du testament : « C’est le destin des livres, cette longue course d’une eau à une eau chiffonnant le crâne de l’enfant mort, le corsage d’une jeune fille, les nuits mauvaises ».
Le destin, la vie des livres, le petit et le grand négoce, l’esthète et le requin, le squale lettré à moustache imitant celle du Kanzler Hitler et prenant son bain entouré de putains qui écrivent ou salivent, tout cela kif kif : « C’était le même mouvement : une grande passion humaine, et un grand mépris ».
De grands voyous à la ville et de petits saints au coin de la cheminée, avec pour Grasset quelques séjours de repos au milieu des toqués à Meudon, d’un fou l’autre : tels sont les grands éditeurs, et Gaston Gallimard passe au cocktail, « beau à damner un ange », flanqué de sa « poule inouïe », ou là-bas c’est Pétain « vert et sucre » ou encore on reconnaît Godfather le marchand d’armes embusqué à Lausanne (on est vers 1934), et passent aussi les ombres non moins archangéliques de ces salopes de Proust et de Céline…
C’est l’éternel factotum de l’éditeur, le double damné qui partage manuscrits, maîtresses et mépris du maître, ici nommé Kobald, qui tient le fil du récit. Bataille s’avançant masqué ? On peut le penser tout en laissant le roman se faire sur deux temps en un même mouvement : « J’aimais ce métier de lire. Lire sans fin, le jour, la nuit. Comme cogneraient les décors à coulisse, lire et chercher, fébrile, porter chaque soir son lit de papier, barque serpentine, mastaba, jonque, sarcophage. Et l’œil sale au matin méditer le motto : Regarde longtemps les abîmes ».
Christophe Bataille. Quartier général du bruit. Grasset, 114p. En librairie: août 2006
-
Les copains d'abord

Cinquante ans passés, de Jean-Marc Roberts
On se dit une fois de plus que Jean-Marc Roberts se la joue facile, brodant sur le canevas de sa vie qui va, comme depuis Les petits Verlaine, en 1973, ou plus exactement dès Samedi, dimanche et fêtes, son premier livre paru en 1972.
Et puis voilà, et puis non: comme toujours il y a cette petite musique, c’est vraiment ça même si ça fait cliché, cette petite musique qui est à la fois la modulation d’un sentiment de l’existence et le faufil d’une écriture nette faite d’ellipses, de petits points, de traits, de fusées parfois, de touches blanches et noires comme d’un piano de Bill Evans ou de Michel Berger jouant debout, c’est selon.
Donc c’est reparti pour la suite d’un autoportrait en creux aux copains d’abord, où le mieux dessiné est celui qui a le mieux raté sa vie aussi, juste bon à se souvenir de ses belles années et à donner son point de vue sur la chose politique, autant dire du remplissage dans une vie dont on ne saura presque rien mais qui dégage la douce mélancolie d’un modeste, Richard Hermann de son nom, que le narrateur et son ami Jean-Louis n’avaient plus revu depuis trente ans.
A l’époque yéyé et même avant : à celle de Minou Drouet et de Joselito, les enfants-stars première volée, Richard a failli devenir chanteur et même l’a été sur quatre 45 tours, les deux derniers chez Barclay.
Or trente ans plus tard les compères du lycée Carnot se retrouvent pour aller, prétexte bientôt différé, fêter l’anniversaire d’un certain Gavotti qui n’a jamais vraiment été de la bande. En chemin donc, dans la Mercedes deux portes de Jean-Louis (notaire en vue), se repassant les disques du beau temps (comme on dit), on dévie bientôt sur Calais avec l’idée de pousser une pointe sur l’Angleterre. Ce sont des lubies qu’on peut avoir, passé cinquante balais, avec les moyens et la liberté de ses les accorder.
Peu importe au demeurant, et pas grave si le projet anglais tombe à Calais au lendemain d’une soirée passé à picoler et se raconter des choses, histoire de recoller quelques morceaux.
Tout cela fait-il un livre ? Un petit livre, oui-da. Et même un petit film, genre Sautet en plus velléitaire et bluesy. Et le portrait de Richard (poids lourd existentiel à dégaine de Michael Moore sans la barbe), les souvenirs évoqués qui en font revenir d’autres kyrielles au lecteur, l’allant doux acide, surtout le climat, l’atmosphère, la fine mailledu filet de mots à repêcher le passé sont d’un écrivain racé, ça ne fait pas un pli…
Jean-Marc Roberts. Cinquante ans passés. Grasset, 103p.
-
Une si douce oppression
A propos du Club des pantouflards de Christian Cottet-Emard
Le double talent de poète et de conteur de Christian Cottet-Emard s’exerce ici dans le genre du polar politico-fantastique dont le climat rappelle à la fois le réalisme magique italien et certaines fables latino-américaines, notamment d’un Juan Carlos Onetti.
Après le lyrisme diffus du Grand variable, déjà remarquable par sa vision autant que par la fine découpe de son écriture, l’auteur se fait ici plus mordant et plus inquiétant, dans une narration à la fois somnambulique et parfaitement filée où nous voyons le chômeur en fin de droit Effron Nuvem pris au piège d’un mécanisme étrange non moins qu’implacable, à relents totalitaires et jouant sur le consentement en douce des plus démunis. Sous des dehors pourtant placides, les membres du Club des pantouflards auprès desquels un notable apparemment bien disposé à son égard introduit le protagoniste et en fait son obligé, évoquent une société secrète aux occultes pouvoirs de contamination, que le sans-emploi candide va subir à son corps à vrai dire peu défendant. Mais n’est-ce pas ainsi que prolifère le soft goulag dans les têtes ? L’apparition d’un petit blindé noir, au tournant du récit, va d’ailleurs cristalliser une menace bientôt omniprésente, que le lecteur ressent presque physiquement. A préciser que cet engin fait office de distributeur de cartes de crédit dans un système verrouillé par l’informatique qui réduit l’existence du porteur à la validité de l’objet…
Dans la lumière crépusculaire des Ames mortes de Gogol, que le protagoniste lit en dégustant sardines à l’huile et tartines, ce petit roman épate à la fois par sa verve caustique et son atmosphère, son délire très contrôlé, son discours politique implicite et son aura poétique.
Christian Cottet-Emard. Le club des pantouflards. Editions Nykta. Coll. Petite Nuit, 85p.
-
Gondole de rentrée
Notes avant parution
La vague précédente n’est pas retombée que déjà la prochaine déferle avec, en point de mire, 683 nouveaux romans à paraître à l’automne. Des piles de livres ne cessant de s'amonceler, je tirerai sept titres après sept autres, d’abord en survol puis de manière plus détaillée. Or tel est mon premier choix :
1. Christophe Bataille. Quartier général du bruit. Grasset, 115p. Révélé par Annam, un premier roman paru chez Arléa et aussitôt distingué (prix du Premier roman et prix des Deux Magots, 1994), l’auteur a de la patte et l’on est curieux de le voir évoquer ici la figure de Bernard Grasset sous le regard d’un certain Kobald, à la grande époque des Saints-Pères.
2. Annie Saumont. Qu’est-ce qu’il y a dans la rue qui t’intéresse tellement ? Joëlle Losfeld, 77p. Par la nouvelliste la plus abondante et parfois la plus attachante « au niveau du quotidien », un nouveau petit recueil en forme de triptyque.
3. Jean-Marc Roberts. Cinquante ans passés. Grasset, 103p. L’auteur, directeur littéraire de Stock, est lui aussi un écrivain racé, qui dit bien les choses de la vie, comme on dit, avec la nonchalante complaisance des désabusés
4. Alain Mabanckou. Mémoires de porc-épic. Seuil, 229p. Après Verre cassé , l’auteur congolais le plus en vue du moment à Paris poursuit une œuvre alternant la pleine pâte du roman et les pointes de la réflexion. Il réinvestit ici l’esprit du conte à la manière africaine.
5. Pierre Charras. Bonne nuit, doux prince. Mercure de France, 115p. Dans un texte de pure sensibilité, voilé de pudeur, l’auteur de Comédien (prix Valery Larbaud 2000) rend ici un bel hommage à son père, du genre à ne jamais se mettre en avant.
6. Ariel Kenig. La pause. Denoël, 145p. Son premier roman, Camping Atlantic, s’était distingué du tout-venant de l’an dernier par son écriture mordante et sa façon de moduler la révolte sensuelle d’un adolescent. Du camping, on passe ici à la cité HLM.
7. Nancy Huston. Lignes de faille. Actes Sud, 487p. C’est le roman dont, pour ma part, j’attends le plus dans la nouvelle donne. Après son fameux Professeurs de désespoir, la romancière traverse un demi-siècle d’histoire contemporaine en entrecroisant les voix de quatre enfants (Sol, Randall, Sadie et Kristina) dont chacun est le parent du précédent.
-
Lectures de rentrée (2)

Qu’est-ce qu’il y a dans la rue qui t’intéresse tellement ?, trois nouvelles d’Annie Saumont
Annie Saumont, nouvelliste remarquable dont l’œuvre (couronnée par l’Académie française en 2003) se constitue en fresque kaléidoscopique de la vie des gens ordinaires, n’a pas son pareil pour saisir, à fleur de mots et de formules toutes faites, la détresse et le désir de s’échapper de ses personnages, le plus souvent pris au piège.
Le meilleur exemple en est l’homme résigné de la première nouvelle, éponyme, de ce triptyque, littéralement encagé par les petites phrases de sa femme, du genre « qu’est-ce que tu regardes ? », « tu as des pellicules j’en parlerai au pharmacien », « tu n’écoutes rien », « tu mangeras aussi une petite grillade c’est facile d’être raisonnable », et qui se rappelle de radieuses scènes de sa jeunesse en regardant par la fenêtre.
Sans peser, avec des ellipses qui supposent l’attention vive et même la participation active du lecteur, l’écrivain s’attache à capter les divers réseaux de parole qui s’entrecroisent, ici de l’épouse au sens pratique écrasant, de l’homme qui aimerait tant décider quelque chose mais n’en a plus l’énergie, de ce qu’on pourrait dire le langage des choses et de la poésie suggérant une autre vie plus harmonieuse et plus claire.
Ou c‘est, dans le métro (Ce serait un dimanche), Thérèse qui évoque in petto sa vie de paumée avec Ada, entre petits négoces de couture et petites fauches, sales mecs comme son père qui tentait de la forcer, échappées de tout ce qui pourrait advenir un dimanche au conditionnel des chimères et retour au foyer des sœurs de la Pitié. Enfin c’est (dans Méandres) le soliloque lancinant d’un homme que blesse la vulgarité du monde, et qui revient dans la ville de son enfance après un long séjour en prison.
A chaque fois, l’art de la nouvelliste aboutit, à sa manière très particulière où tout semble vocalisé « mentalement » sans rien perdre de sa densité physique et de sa charge émotionnelle, à restituer trois univers plombés par le poids du monde, avec autant de douce attention que d’âpre lucidité.
Annie Saumont. Qu’est-ce qu’il y a dans la rue qui t’intéresse tellement ? Editions Joëlle Losfeld, 77p. Ce recueil est déjà disponible en librairie.
-
Entre le cri et le chant

A propos de Quelle nuit sommes nous ? d’Hafid Aggoune
Le paradoxe absolu de la vie mortelle, dont l’oxymore se prolonge dans le désespoir ardent et la folle sagesse de Samuel Tristan, protagoniste de ce limpide et lancinant deuxième roman de Hafid Aggoune, s’ancre dans l’intransigeance de l’adolescence, ce temps de la vie « où il faut choisir entre vivre et mourir », à l’enseigne de cette «incommensurable solitude que vit chaque adolescent, cet espace de fureur sans nom. »
Le vrai nom du personnage n’est jamais prononcé, ni dévoilé tout à fait le secret de son désespoir. Il est Personne et chacun de nous, ou plus exactement : il incarne nos extrêmes invivables, il a rompu toutes les attaches pour être mieux relié au monde ; il s’est montré inhumain avec les siens pour mieux résister à « cette longue nuit d’inhumanité » que représente à ses yeux le monde.
Une fugue, à quinze ans, l’a arraché au petit clan familial où il a lancé un soir à sa mère, son père et son frère: « Je veux voyager, travailler à être le meilleur possible parce que le monde est plus grand que cette cuisine, plus grand que cette télé, plus grand que toi, papa. Seul un livre est plus grand que le monde ! », avant de les quitter pour toujours en feignant de se rendre au judo, dormant sa première nuit au sommet d’un hêtre et gagnant l’Espagne puis l’Afrique du Nord où il est devenu Samuel Tristan, puis Salih (intègre,vertueux) dans les monts kabyles, Saleh à Djerba, Salim (qui a le corps pur et droit) sur les routes lybiennes, Salman (parfaitement sain) à Alexandrie, Saji à Beyrouth où il perd sa virginité, fuyant de vies brèbves en vies brèves, tanné et boucané par le travail, allégé par le cannabis, apprenant l’arabe et l’hébreu pour en devenir le traducteur, enfin rêvant de l’Aden de Rimbaud sans y toucher, commençant lui aussi d’écrire mais ne faisant à vrai dire que lire en trimballant avec lui son sac de bouquins.
Autant dire que, lorsque commence le roman, à Venise où il débarque de Paris, à l’âge du Christ, Samuel Tristan a fait déjà le tour de lui-même, vivant de rien (à Paris, garçon au pair) et ne faisant rien que lire et vivre, comme un ascète ou un oiseau. Appelé en ces lieux pour aider une Française, femme sculpteur, qui a la garde de l’ancien hôpital de sainte Marie-des-Grâces, jouxtant l’asile désaffecté de San Clemente de sinistre mémoire, Samuel, qui est la porosité affective et poétique incarnée, ne peut supporter de cohabiter avec les fantômes de ceux qui ont souffert en ces lieux, dont les cris le poursuivent. Du moins aura-t-il aidé Emeline en nettoyant la place de ses ronces envahissantes, avant de trouver refuge momentané dans un atelier d’artiste du Ghetto, d'où il accomplit son dernier voyage d'amant de la nuit, trouvant sa paix dans les eaux industrielles de la lagune.
Le lecteur posé sourira peut-être de la révolte de Samuel Tristan, quand il dit : « J’ai peur d’un monde sans différence. J’ai peur des religions qui tuent beaucoup plus que les guerres, parce qu’elles n’ont pas de fin et ne sont plus ce qui nous relie mais ce qui nous sépare ». La lectrice réaliste haussera peut-être les épaules en lisant : « Jamais je ne voudrais être de ceux qui pourrissent, détruisent, polluent, réduisent cette planète ». D’aucuns lui objecteront comme toujours : « cela te passera avant que ça nous reprenne », et la cause sera entendue.
Mais Quelle nuit sommes-nous ? va bien au-delà de la protestation d’un adolescent inadapté. Ce petit livre, comme la peinture de Francis Bacon citée au début, dit la beauté arrachée à la laideur : «Son regard nous traverse, nous taille. Il nous ouvre au scalpel. La peau s’écarte sans résistance. Les os craquent. Nos visages se tordent. Nos êtres montrent les affres, les peurs, les cicatrices, la beauté cachée de notre plus belle humanité. Défigurés, nous existons enfin ».
Ce livre existe en effet, dans son elliptique simplicité, et nous existons de concert sur cette île de la lagune où s’effondre à n’en plus finir toute construction de notre plus bel art, dans le voisinage des inadaptés absolus que sont ceux que nous appelons fous. « Donne à qui sait lire ton âme, fuis qui la déchire », se recommande Samuel à lui-même, comme à tous ses semblables. Et ceci qu’il se murmure à Venise avant de se laisser glisser dans son linceul liquide : « Venise est un masque derrière lequel se cache l’effondrement de tout ce que l’homme a fait depuis sa première œuvre d’art. Seule est admirable la lumière, éternelle présence survivant aux vanités du temps, architecture de l’architecture, corps des corps, esprit des courbes, véritable essence de toute chose. Mon regard se perd à l’intérieur des songes. La beauté est un miracle de l’instant. Rien ne dure, sinon le renouvellement de nos regards en soi, sur le monde, sur autrui. Rien ne me console plus que de me savoir pierre, eau, branche, lumière, vent, regard. C’est pour cela que j’aime tant les livres : l’instant de la lecture est un absolu fait de rien et de tout, une concentration de tous les possibles posée sur la légèreté d’une feuille »…
Hafid Aggoune. Quelle nuit sommes-nous ? Editions Farrago, 121p.
-
Petite musique du soir
En lisant Le club des pantouflards de Christian Cotttet-Emard
Je me demandais si j’aurais le temps, avant le match, de lire ce petit livre reçu ce matin, mais à peine l’ai-je commencé que la question valdinguait: le bouquin paru à l’enseigne de la collection Petite Nuit m’a bel et bien scotché. Ainsi sont les véritables écrivains, qui vous tiennent par le bout de la phrase et ne vous lâchent plus que vous ne les ayez lus jusqu’au bout.
C’est au charme que Christian Cottet-Emard nous attrape : je l’avais ressenti une première fois dans un livre sentant bon la littérature, le réalisme magique des Italiens ou des Belges, quelque chose de peu français en tout cas, sauf le délié de la phrase et cette musique précise mais un peu voilée de nostalgie. Le grand variable était à vrai dire une espèce de roman-poème, entre le rêve et l’irréalité, et déjà le lyrisme mélancolique et la fantaisie inventive de l’auteur m’avaient séduit tout en douceur.
Or on retrouve, avec sa neige lyonnaise, cette atmosphère dans Le club des pantouflards, d’une ligne pourtant plus claire et d’un humour plus enjoué à l’anglaise (on pense évidemment à Jerome K. Jerome et au Chesterton du Club des métiers bizarres), où tout semble s’arranger mais pour la perte du chômeur Effron Nuvem qu’a gravement compromis un notable en l’introduisant au club des pantouflards alors que, jusque-là, il se contentait de lire Gogol en savourant ses sardines portugaise Roses de France.
On n’est pas loin de Vialatte non plus mais avec un ton qui n’est que de Cottet-Emard, autant que ses phrases et ses détails, ses malices et sa tendre attention aux choses et aux gens, aux saveurs et aux bonheurs que ménagent l’apéro Suze-cassis ou le cigare de fin de matinée.
Tout à l’heure il y aura le match à la télé. J’espère sincèrement que la France se fera brosser par les Togolais. Je le dis en clignant de l’œil à l’ami Bona Mangangu, dont je parlerai demain du livre remarquable qu’il a publié de son côté, évoquant le pays de son enfance avec un lyrisme de vrai poète et une virulence d’amant déçu, dans une langue flamboyante et sans s’aveugler sur les douleurs de son cher Congo.
D’un absurde l’autre, nous revoici, un quart d’heure avant le délire national et multi, chez Gogol « à Vaise et ailleurs », dans ce drôle de monde où se faire avaler sa carte de crédit par une machine suffit à vous priver d’identité. Nous autres, nous savons pourtant qui nous sommes, avec ou sans carte de crédit, nous les empantouflés de la vie…
Christian Cottet-Emard. Le club des pantouflards. Editions Nykta, coll. Petite nuit, 73p. -
Dans l'esprit de Zazie

Editrice responsable de l’originale collection littéraire de Buchet-Chastel, Pascale Gautier est également écrivain. Son dernier livre, Fol accès de gaîté, est un régal d’humour acidulé à la Queneau.
Une édition littéraire de qualité peut-elle survivre à Paris hors des grandes maisons ? Constituer un nouveau catalogue affirmant une « patte » reconnaissable est-il encore possible ? Et la fonction de directeur littéraire peut-elle se concilier avec le travail de l’écrivain ? A ces trois questions, Pascale Gautier répond sans ostentation, à la fois par les livres qu’elle édite et par ceux qu’elle écrit. Si la littérature – lecture et écriture alternées – est une passion personnelle de longue date chez elle, dans une optique qui n’a jamais été académique, c’est en outre « sur le tas » qu’elle a appris son métier d’éditrice, à des enseignes plutôt « commerciales » puisqu’elle a passé, notamment, de Fixot au Rocher, où le premier critère de la (sur)production relevait de la rentabilité plus que de la qualité littéraire. Autant dire que se voir confier, au tournant de l’an 2000, la responsabilité d’une nouvelle collection de littérature dans une maison à la vénérable enseigne (Buchet-Chastel) mais en voie de complète restauration par la volonté d’une bonne fée… suissesse (Vera Michalski), aura représenté à la fois un beau cadeau et un sacré défi.« J’avais envie de défendre, à l’écart des modes et d’un certain maniérisme désincarné, une littérature qui soit à la fois savoureuse et de qualité, jouant sur l’esprit du conte et la fantaisie, l’imagination et la vitalité, l’insolence et les constructions originales, dans l’esprit de Raymond Queneau dont je me suis toujours sentie proche. »Saluant au passage la pleine liberté de choix que lui laisse Vera Michalski, Pascale Gautier souligne également la satisfaction que représente le fait de ne pas être harcelée en sorte de « faire du chiffre ». Dans la foulée, rappelons que le nouveau Buchet-Chastel, comme les éditions Phébus et Noir sur Blanc, fleurons du groupe Libella que dirige Vera Michalski, bénéficient des moyens personnels considérables de celle-ci (héritière de l’empire Hoffman-Laroche), qui prouve du moins qu’on peut être très riche et non moins attaché à la défense de la meilleure littérature.
De fait, les connaisseurs auront tôt fait de reconnaître à la fois l’air de famille et la variété, mais surtout les qualités de style propres aux écrivains découverts et défendus par Pascale Gautier dans sa collection vert pâle. « Nos auteurs sont souvent des raconteurs d’histoires autant que des amoureux de la langue française », poursuit-elle en citant au passage les noms de Joël Egloff, qu’elle a emmené avec elle en quittant Le Rocher et qui a décroché le Prix du Livre Inter en 2005 pour L’étourdissement, de Cookie Allez dont Le ventre du président ou La soupière ont révélé un talent de romancière d’une grinçante malice à la Marcel Aymé, ou encore de Xavier Houssin, prosateur d’une étincelante âpreté, de Marie-Hélène Lafon dont Le soir du chien a été très remarqué et qui revient avec de vibratiles Organes, ou enfin de Philippe Ségur, autre révélation de la collection avec sa superbe Poétique de l’égorgeur. Plus récemment arrivé, Daniel de Roulet n’a certes pas donné, avec L’homme qui tombe, intéressant mais un peu mince, un roman aussi original que ceux de Ségur, pas plus que le « coup médiatique » de son Dimanche à la montagne n’annonce un virage sensationnaliste de la collection. Cela étant, avec un grain de sel et le clin d’œil de Zazie, l’éditrice ne va pas cracher dans la soupe même si l’on sent bien, sous son front têtu, que l’obsession du grand tirage n’est pas sa priorité…
Une belle échappée
Nom de Zeus quelle envolée ! Quel feuilleton carabiné sur l’écran de la page : quelle Odyssée chez les Dubout revisités façon Reiser ou Deschiens, quelle Iliade déjantée ! On rit on pleure, et dès l’exergue puisqu’on y apprend par l’auteur que ce « fol accès de gaîté » annoncé par le titre est la définition donnée, par le Petit dictionnaire des mots retrouvés, à la digne et non moins redoutable pratique de l’hara-kiri japonais, rarement suivie d’un happy end… Ici, tout au contraire, c’est sur fond de journée bleue que l’état de la cata s’envisage par le détail avec force péripéties joyeusement désespérées : et tous à la fin s’envoleront comme de gracieuses baudruches au ciel, évoquant autant de bons bedons gazeux à la Devos… Mais revenons sur terre en attendant, dans la foulée philosophe d’un Monsieur Ploute, issu de la résidence en banlieue des Bégonias et choisi pour une occulte Mission que le lecteur, en sa candeur, suppose bénéfique à l’Humanité. En chemin saluons une Armande Du Perron De La Première Manche, produit typique genre Vieille France à chignon serré ; un Monsieur Félix qui n’en finit pas de perdre son chien Julien ; une jeune Agata à l’avenir sentimental prometteur; enfin, parmi bien d’autres, cet adorable Achille Ploute, fils du précédent à casque de poilu doublé d’un écouteur à musique qui, devant notre monde tel qu’il est, ne pense qu’à se faire la belle, au double sens qu’on verra. Passons sur mille autres détails et trouvailles cocasses, pour dire l’essentiel : que cet envol est d’abord celui d’une écriture à la fois élégante et follement rythmée, plus grave aussi qu’il n’y paraît, souriante en sa désespérance et brodant sur le vertige d’un trou noir (notre sort mortel) une délirante histoire à gamberger en rêvant, puis rebondir en turlutant au ciel épico-poétique de Zazie.
Pascale Gautier. Fol accès de gaîté. Editions Joëlle Losfeld, 170p.
-
Eros aux doigts de rose
 Entretien avec Alina Reyes
Entretien avec Alina Reyes
Alina Reyes, dont le talent fut révélé en 1988 par Le boucher, et qui a publié depuis lors plus d’une vingtaine d’autres ouvrages, conjugue l’érotisme et la littérature avec un bonheur rare, mélange de délicatesse hardie, de poésie et de malice aussi. Le dernier exemple, étincelant, nous en est donné par Le carnet de Rrose, petit livre de 69 séquences en 69 pages (si,si) très denses, parfois très crues mais néanmoins pleines de grâce. Echo d’une rencontre à Paris, dans la lumière de la place Saint-Sulpice.
- Quel a été le déclencheur du Carnet de Rrose, et quelle place particulière ce livre tient-il dans la suite de vos écrits ?
- De temps en temps, j'éprouve le désir d'écrire un livre purement érotique ; c'est le motif, comme on dit en peinture, qui m'inspire le mieux, me donne le plus de plaisir et pour lequel sans doute je suis le plus douée. J'étais très contente du précédent, Sept nuits, écrit en sept nuits dans une parfaite solitude comme je l'aime - cette fois-là je logeais dans des bureaux vides qu'un ami m'avait prêté à Paris, dormant sur le canapé parmi des tas d'ordinateurs éteints et sous une verrière qui laissait entrer tout le ciel. J'ai eu envie de refaire un livre très court, encore plus court, encore plus condensé, tout en trouvant une nouvelle formule pour m'approcher au plus près de la vérité. Rien n'est plus artistique et excitant, pour l'esprit comme pour le corps, que la simple vérité, mais c'est justement le plus difficile à atteindre. Pour l'érotisme en particulier les auteurs sont toujours tentés d'en « rajouter » beaucoup, multipliant les exploits ou les situations extraordinaires, le nombre de partenaires etc. Tout cela ne dit au final qu'une chose : la difficulté à jouir (ou à écrire, cela revient au même), qui entraîne à la surenchère ou bien à la destruction du sujet. Ce Carnet de Rrose est le livre qui m'a le plus coûté en vérité, c'est le seul d'ailleurs que je n'ai pas encore osé offrir à mes fils aînés. Il m'est arrivé d'être beaucoup plus obscène ou violente dans mes écrits, mais la fiction justifiait l'affaire. Ici on est dans un registre cru compensé par une très grande douceur, il n'empêche que c'est moi au plus près, d'où ma pudeur quand il s'agit d'offrir ce livre. Pourtant je l'aime encore mieux que le précédent : le désir désespéré de parvenir à peindre une rose, qui était celui de la narratrice de mon premier roman Le boucher, j'ai le sentiment de l'avoir assez bien satisfait, de sentir de près le parfum du réel.
- Comment travaillez-vous ? Quelle place l’écriture occupe-t-elle dans votre vie ?
- Toute la place. Je ne fais que ça, même si bien sûr à 99% du temps ça se passe dans ma tête. J'ai deux enfants à la maison, je dois donc m'adapter à leur rythme et au rythme scolaire pour trouver le temps du travail, c'est-à-dire du silence. J'y arrive assez bien, notamment en me réservant toutes mes soirées. Autant à Paris que dans ma grange des Pyrénées c'est ce dont j'ai besoin avant tout, silence et solitude.
- Avez-vous le sentiment d’être « classée » dans le rayon érotique, et cela vous gêne-t-il ?
- Oui bien sûr je suis "classée", c'est une tare du temps, tout doit être à sa place, c'est flagrant en librairie ou les rayons sont de plus en plus spécialisés. Autrefois on me trouvait au rayon de littérature générale, maintenant même mes livres de littérature générale sont au rayon érotique. D'un autre côté c'est un beau défi de penser : vous aurez beau faire, vous ne m'aurez pas, et je continue, plus que jamais, d'écrire à ma guise, dans tous les "rayons" à la fois, et puis vous allez voir ce que vous allez voir !
- De quels auteurs vous sentez-vous proche ? Les auteurs érotiques vous intéressent-ils plus que d’autres ?
- « Auteurs érotiques », cela n'a pas grand sens il me semble. La seule distinction qui me paraisse intéressante n'est pas celle des genres mais celle qui consiste à lire en se demandant ce qui est littéraire, et pourquoi, et ce qui ne l'est pas. Je suis une grande lectrice et depuis longtemps, souvent depuis l'adolescence, je vis avec Nietzsche, Rimbaud, Kafka, Artaud entre autres. Cette année j'ai été très admirative du dernier roman de Houellebecq, La possibilité d'une île, j'ai beaucoup aimé aussi les derniers livres de Haruki Murakami et de Bret Easton Ellis, entre autres. La littérature au niveau mondial se porte très bien, voilà la meilleure nouvelle.
- Comment ressentez-vous l’érotisation actuelle à toutes les sauces, de la publicité aux médias, et le déferlement de pornographie qui s’observe notamment sur internet ?
- Comme une raison supplémentaire de ne pas abandonner l'image de notre corps et de notre sexualité à l'industrie, à la publicité, au porno en général, ce serait dramatique. J'apporte ma pierre blanche comme je peux, en montrant autre chose, quelque chose qui comporte du sens et de l'amour, voire une possibilité de transcendance.
- Qu’avez-vous essentiellement envie de transmettre, en tant qu’écrivain ?
- La vérité, par le moyen de la poésie. Je n'y suis pas encore, mais j'y travaille. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus mensonger, face au mensonge de masse jamais nous n'avons eu autant besoin d'expressions de vérités personnelles. Ce seul objectif doit suffire à créer une oeuvre, avec tout ce qu'elle peut avoir de révolutionnaire tant sur un plan politique que sur un plan poétique. Je voudrais dire à chacun : vivez en esprit de poésie, et vous changerez, nous changerons le monde !
- Quel rapport y a-t-il, selon vous, entre érotisme et sacré ?
- Les deux sont indissociables. Et indissociés dans toutes les religions, d'ailleurs. L'érotisme c'est l'origine, et l'origine le sacré. Nous vivons un temps violemment déspiritualisé, les religions agonisent ou sont instrumentalisées par la politique, de même que les corps humains sont instrumentalisés par le commerce (publicité, industrie du porno, trafic d'êtres humains, industrie de la fringue et de la beauté), la technique (médecine, chirurgie esthétique, trafic d'organes), la politique (corps des sportifs et des kamikazes). La pornographie, c'est-à-dire la marchandise, est partout, mais en réalité il n'y a presque plus d'érotisme, parce que l'érotisme demande de l'esprit. Ce que nous pouvons nous offrir de mieux est gratuit, c'est la conquête de l'esprit et de l'amour.
Parole d’origine
L’idée géniale du r doublé, suavement roulé comme à la russe ou à l’orientale, mimant le rugissement d’un petit fauve tapi ou le ronflement d’un minuscule rotor (toutes images d’ailleurs à venir dans l’évocation de cette « mécanique d’une femme »), ce double r très doucement enragé suffit à distinguer le nom de Rrose, dont on lit ici le Carnet, de la fleur du poète. Comme les enfants naissent dans les roses, la rrose, elle, est ce qui fait naître ici l’écriture d’Alina Reyes, figure individualisée de L’origine du monde selon Courbet, sexe féminin vécu et dit comme est vécu et dit le sexe masculin assimilé à une tige.
Si «tige » et « trésor » font plus joli que la b… et les c… ordinaires, Alina Reyes ne se gêne pas pour autant d’utiliser les mots requis pour dire son plaisir de se branler ou de branler ses huit jules sauf un, sa plus troublante passion platonique. Oui, le sexe, écrit et décrit tel qu’il est, reste cru. Mais rendu à lui-même il contient aussi toute la vie possible, et c’est la grandeur de ce petit Carnet de Rrose de l’illustrer avec une sensualité qui est d’abord celle d’un style parfait, puis avec une malice mutine, une gourmandise rabelaisienne au meilleur sens du terme, une tendresse aussi, une profondeur enfin qui s’ouvre à l’entière Création belle et bonne.
c’est la grandeur de ce petit Carnet de Rrose de l’illustrer avec une sensualité qui est d’abord celle d’un style parfait, puis avec une malice mutine, une gourmandise rabelaisienne au meilleur sens du terme, une tendresse aussi, une profondeur enfin qui s’ouvre à l’entière Création belle et bonne.
Alina Reyes, Carnet de Rrose. Robert Laffont, 69p.
A consulter aussi, son blog littéraire : http://amainsnues.hautetfort.com/
Cette publication constitue la version complète de l’entretien paraissant dans 24Heures le 6 juin, avec un portrait de Florian Cella. -
L’enfance de l’art

Butor et les clichés (3)
Un poète qui se prenait au sérieux, au début du XXe siècle, décida de tordre le cou à la rhétorique. Cela partait sûrement d’un bon sentiment et ne manqua pas, non plus, de faire le lit d’un nouvelle convention langagière . Ainsi en a-t-il été de la chasse aux clichés.
A la fin du même XXe siècle, rares furent les poètes qui osaient encore célébrer la bluette printanière ou le joyeux sentier, et telle ou tel qui se fussent permis d’intituler leur poème Vers l’été pour l’amorcer avec ces vers :
« Les nuages se séparent
avec regrets
Les plaques de neige se fendillent
pour laisser perler un torrent »,
eussent été montrés du doigt comme de probables ringards. Non, décidément, un poète ne pouvait pas écrire cela à la fin du XXe siècle :
«Une à une
dans les stations de ski
les remontées mécaniques
se taisent
«Les cascades
par contre
font éclater leurs fanfares »…
Michel Butor ose écrire « par contre » dans un poème. Il est un peu gonflé, Michel Butor, qui ose écrire dans Vers l’été :
« Le sentier a décidé
De nous faire une surprise
Non seulement l’échappée
Sur des cimes encore neigeuses
Mais le faufilement d’une couleuvre »…N’est-ce pas la niaiserie même ? Non ce ne l’est pas : ce lait fleure l’enfance de l’art. Cela fleure l’aigre petit lait d’une enfance à l’époque du Front populaire.
Le troisième (1936) du recueil de Seize lustres renvoie en effet aux cours de récréation de l’écolier de dix ans et telle image en découle malicieusement :
« Le grand-père ingénieux
installe un petit moulin
à aubes
dans une rigole »
Moulin à paroles…
-
Butor instamatic
 Attention: chute d'anges (2)
Attention: chute d'anges (2)
On se prend à vibrer et songer à tout moment à la lecture du deuxième des Seize lustres de Michel Butor, qui évoque des chutes d’anges à Venise en rapprochant les figures de la Bible et les choses vues lui apparaissant au fil de ses balades par les venelles, enfants et gondoliers, ouvriers sur leurs échafaudages (protégés de la chute par des filets) et autres Japonais égarés, à la sempiternelle recherche des Tintoret…
Cette poésie de l’instant ne m’était pas vraiment apparue jusque-là, sauf dans Mobile et dans Gyroscope aussi, à l’état déployé, mais ici, avec ce qu’une récapitulation autobiographique peut avoir de plus dense et de plus personnel, l’aspect tout à fait original et novateur, nettoyeur, de cette démarche m’apparaît mieux avec son ping-pong ludique de l’observation et de la réflexion, du chant et de l’hors-champ à la Godard, en moins intello phraseur, me séduit et me captive même.
La méthode de Butor me rappelle l’Instamatic par son immédiateté compacte, non pas le polaroïd grisâtre mais le petit autofocus avant la lettre de la note immédiatement envisagée dans son utilisation prochaine.
C’est le contraire du poète posant entre deux chandeliers en gilet coin-de-feu, sans jouer pour autant le maudit ou l’ensauvagé. C’est un honnête homme en salopette d’artisan à tout faire qui passe par là avec son stylo et sa bibliothèque ambulante, son bon naturel et sa ruse, son génie des lieux et son ambition toute modeste de lire et de dire le monde à n’en plus finir. -
Poésie de Michel Butor

Le monde vu de l’Ecart
Le nom de Butor appelle ordinairement, comme par automatisme pavlovien, l’immédiate mention scolaire du Nouveau Roman et de deux livres incontournables, de L’Emploi du temps et de La Modification, à quoi se réduit pour beaucoup une œuvre aussi prolifique (plus de 1000 titres en bibliographie) qu’inaperçue, à quelques îlots près dont une série de lectures fameuses, de Balzac à Rimbaud.
Or il y a à la fois du lecteur universel chez Michel Butor, du critique éclairant et du poète de la même espèce poreuse, à la parole toute directe en apparence, mais lestée de sens, aux divers sens du terme, et diffusant une musique faisant elle aussi sens et pour les cinq sens pourrait-on dire en redondant doucement.
Une parfaite illustration, et peut-être la meilleure en ce moment précis où l’écrivain fête ses 80 ans, en est alors donnée par ce recueil récapitulatif de Seize lustres (seize lustres font juste 80 ans, selon la mesure romaine fixant les cinq ans de magistrature romaine ponctués chaque fois par un sacrifice) où, plus qu’une sage anthologie, l’on trouve le relevé poétique d’un parcours touchant à peu près tous les points de la circonférence terrestre (de Venise au Sahel ou des States au jardin de Bécassine) et dont le moyeu reste A l’écart, la maison du poète à Lucinges, non loin d’Annemasse et de Genève (Genève « où même la poussière est propre », tandis qu’à Annemasse « même le savon est sale »), à partir de laquelle se développe d'ailleurs un texte liminaire intitulé Ce qu’on voit depuis l’Ecart, qui ne dit pas autre chose : savoir qu’à l’Ecart on est au centre du monde, entre la plume du scribe et l’encrier des étoiles…
Michel Butor est virtuellement entré en poésie en 1926, « quand mon papa et ma maman faisaient l’amour entre leurs draps », et c’est sur le déclencheur magique de La baguette du sourcier, datant de 1990 (l’époque où il dispensait ses cours à Genève) qu’il ouvre ce recueil avec l’évocation du geste de l’ange bouclant les portes du Jardin d’Eden d’une main, sur ordre du dieu jaloux, pour bénir de l’autre le couple en faisant « lever un pain à chaque goutte répandue »…
La poésie de Michel Butor ne fait rien pour avoir l’air d’en être, ce qu’elle est pourtant, tandis que la poésie de Dominique de Villepin, qui fait tout pour en avoir l’air, n’en est pas l’ombre d’un semblant.
Or on lit, dans Passe et repasse, ces vers très peu villepiniens :« Le fer du trafic ferroviaire
écrase les plis des talus
et celui des camions-citernes
roussit les parkings d’autoroutes
où les vacanciers font des tresses
tentant de doubler les copains
avant de s’enfiler aux peignes
qui les délestent de leurs sous »…C’est une poésie qu’on pourrait dire, pour faire la nique aux mânes de Mallarmé, positivement journalistique, à cela près qu’elle est de la poésie et non du journalisme, disant par exemple encore ceci dans L’Arrière-automne :
« Et l’on était suspendu aux nouvelles
il y avait des menaces de guerre
dans un autre continent il est vrai
mais s’il y avait mondialisation
c’était bien dans l’appesantissement
de ces ailes ténébreuses partout
Les arbres suffisamment à l’abri
gardaient leur feuilles approfondissant
leurs couleurs et l’on avait l’impression
qu’elles disaient individuellement
écoutez-moi contemplez-moi sauvez
la formule que je vous ai trouvée »C’est cela même : comme l’arbre, le poète trouve des formules. Or je sens que, ce livre-là, je vais me le garder ces jours à portée de main, car il va de soi que Seize lustres ne parle pas que d’autoroutes et de mondialisation et que la poésie c’est tous les jours…
Michel Butor. Seize lustres. Gallimard, 273p. 2006.
-
Putain d’amour caraïbe

Les dollars des sables de Jean-Noël Pancrazi
Les belles âmes moralement et politiquement correctes s’effaroucheront peut-être du fait que Jean-Noël Pancrazi, romancier français du meilleur style (l’Académie français a décerné son Grand Prix du roman à Tout est passé si vite, en 2003) raconte ici sans masque les amours tarifées qui l’unissent à un jeune métis marié de République dominicaine, disparaissant chaque nuit après l’effusion des corps et dont il ne connaît d’abord que le prénom de Noeli.
Ce « roman », au titre à la fois poétique et ambigu, ne se réduit-il pas à l’esthétisante sublimation d’un épisode de tourisme sexuel ? Tel n’est pas le sentiment du lecteur sans préjugés, attendant de la littérature à la fois un aperçu des multiples aspects de la condition humaine et la ressaisie d’une expérience vécue par la transmutation d’une écriture personnelle. Autant d’éléments qui font précisément l’intérêt de ce livre dont la musique de la langue envoûte, avec ses phrases roulant comme des vagues sous le vent et l’évocation très physique du climat des Caraïbes.
Si Jean-Noël Pancrazi rend nettement les occurrences terre à terre, voire sordides, gage en tout cas d’humiliations bien partagées, d’un « commerce » sexuel et affectif sur fond de pauvreté, son récit relève plutôt de l’amitié réelle et d’un amour quasi filial. Le romancier tend-il à enjoliver ou à magnifier l’espèce d’adoption à laquelle aboutit cette relation ? Rien en tout cas de convenu ou d’édulcoré dans la prise en compte de la réalité violente et souvent dangereuse, voire soumise à persécution officielle (la traque des homos à Cuba est évoquée au passage) des relations entretenues par le narrateur et ses semblables avec leurs amis respectifs et leur entourage. Reflet des rapports Nord-Sud, la prostitution occasionnelle des mecs fait ici figure d’ « extra » plus ou moins jovialement toléré, dans une société qui reste massivement machiste et homophobe. Autant dire qu’un climat de menace plane sur ce livre, que l’écriture crépusculaire de Jean-Noël Pancrazi restitue avec autant de lyrisme que d’intensité tragique au fil de certains épisodes.
En fin de compte, c’est pourtant un sentiment d’authentique fraternité qui se dégage de ce récit aussi sensible que sensuel, diffusant un mélange de fataliste mélancolie et de tendresse blessée.
Jean-Noël Pancrazi. Les dollars des sables. Gallimard, 169p.
-
Volodine le magicien

Dans Nos animaux préférés, l’écrivain poursuit son exploration poético-polémique
Il y a quelque chose de paradoxalement jubilatoire dans la lecture des romans d’Antoine Volodine, dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne dorent pas la pilule. Participant à la fois des conjectures de la science fiction (où il a d’ailleurs fait ses premières armes) et de l’imaginaire fantastique, quelque part entre les fables contre-utopiques d’un Orwell et les contes baroques d’un Cortazar, avec un humour cocasse rappelant aussi les voyages oniriques d’un Henri Michaux, la quinzaine de romans de cet auteur tout à fait singulier constitue désormais un univers parallèle d’une remarquable cohérence, avec ses fictions proliférantes et son « programme » sous-jacent, ses thèmes récurrents, ses habitants aux noms insolites et son bestiaire, dont Nos animaux préférés propose la dernière et réjouissante illustration.
C’est à pas d’éléphant instruit des risques liés à la présence humaine, autant dire sur la pointe des pattes, et d’ailleurs en terrain miné à la suite de terribles événements, que Wong entre dans le livre pour tomber vite fait sur une humaine malodorante et porteuse d’un lance-roquettes RPG7, qui lui demande de l’engrosser après l’avoir sommé de décliner son nom et son sexe. Contraint d’écraser la fâcheuse d’une patte défensive, Wong (qu’on retrouvera au dernier chapitre) laisse sa place à Sa Majestable Balbutiar CCCXV, siégeant nu dans le varech et s’apprêtant à pondre un « sauveur »… Dans la foulée défileront noblement Sept Reines Sirènes, dont le chroniqueur détaillera la «shaggå», de l’insurrection dites des Grandes Vases à l’exécution de Barbille VII, d’autres avatars de la dynastie des Balbutiar et une seconde Shaggå du ciel péniblement infini dont les enseignements à la fois poétiques et parodiques rappellent les vieux textes sacrés, non sans beauté, musique et sens plus ou moins profond.
Sous des aspects parfois loufoques, voire délirants, les récits de Volodine correspondent aussi bien à une sorte d’esthétique de la résistance ressortissant à toute une mythologie « post-exotique », qu’il redéfinit ici dans un Commentaire à la Shaggå du ciel péniblement infini. Il y est notamment dit que ses « vociférateurs emprisonnés » tendent à « une rêverie susceptible de briser encore ça et là le réel, l’inexorable réel de la marchandise et de la guerre ; un territoires d’exil ; une parole chamane ».
De la même génération qu’un Houellebecq, qui a choisi de s’enfoncer dans ledit « réel » jusqu’au cou pour en mimer les pouvoirs mortifères, Antoine Volodine, non moins pessimiste et en butte au même désarroi que l’amer Michel, a choisi les voies plus jouissives du conte et de l’humour pour constituer un univers-gigogne en constante résonance avec le nôtre, où l’écriture fait figure d’éventuel recours contre la barbarie.
Dans son quatrième roman, Des enfers fabuleux, Volodine imaginait un personnage féminin du nom significatif de Lilith, claquemuré dans un gouffre, qui inventait des mondes aussi dévastés que le nôtre puis imaginait un autre narrateur faisant d’elle un personnage de fiction... D’une façon analogue, par un incessant jeu de miroirs et d’échos, le conteur Volodine crée des personnages qui en engendrent d’autres, sous des « entrevoûtes » où se confondent ères et espèces, dans une féerie de mots et d’images dont le paradoxe, une fois encore, consiste à désillusionner autant qu’à réenchanter…
Antoine Volodine. Nos animaux préférés. Seuil, coll. Fiction & Cie, 151p.
Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 10 janvier.