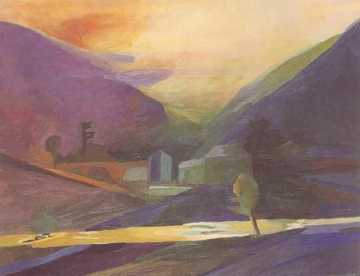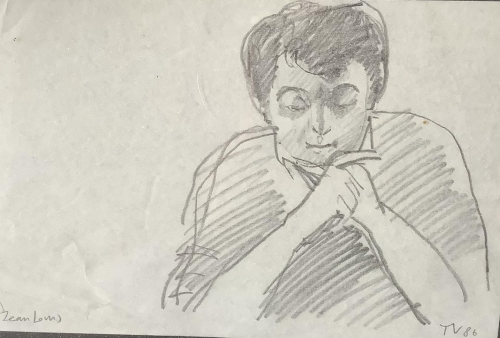Carnets de JLK
-
La hache de l'Histoire
 Ce 20 février. _ Je ne l’écrirai pas à la Petite, mais c’est bel et bien le 20 février (1601) que son homonyme, Elizabeth 1re d’Angleterre fit décapiter à la hache le comte d’Essex, son favori de naguère, constatant que la différence d’âge était devenue pour elle trop cruelle – elle avait plus de soixante ans, il en avait moins de trente… ou du moins est-ce l’explication qu’on retient pour les magazines pipoles.En réalité, l’exécution de Robert Deverreux, comte d’Essex, éminent politicien et lettré aux dispositions poétiques rares, marquait le dénouement certes brutal mais non moins prévisible d’un long affrontement aux dehors de complot majeur ponctué de multiples trahisons et coups tordus réciproques.Pour dicton du jour, je relève dans l’Almanach : « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », et la femme le prendra pour elle aussi. Et demain le dicton sera : «Le temps ne pardonne pas ce que l’on fait sans lui ».Ce qui m’amène à ma lettre d’aujourd’hui au jeune Anthony, huit ans, à propos du roman de 600 pages qu’il m’a offert récemment, intitulé Les deux royaumes et dont les protagonistes ont plusieurs milliers d’années quand ils ne sont pas immortels, à commencer par le druide Tibor, collectionneur de coquillages (entre autres objets de mémoire ou d’exorcisme futur) comme l’a été (et le reste, pour les timbres et monnaies diverses) Anthony lui-même.Je ne dirai pas à Anthony le peu de goût que j’ai pour les écrits pléthoriques d’Eric-Emmanuel Schmitt, le type à mes yeux du faiseur à succès qui « écrit bien » mais sans palpite, et dont la prétention à raconter l’histoire de l’humanité en « digest » me semble absolument dénuée d’ancrage émotionnel, de sens réel du tragique et pire: du moindre humour. Toutes choses que je me garderai bien de dire au petit garçon, qui aura le temps, justement, de décider s’il apprécie ou non cet auteur archi-convenu , mais je vais achopper aux détails éventuellement plaisants ou intéressants de ce feuilleton mondial globalement inepte à mes yeux, en commençant par expliquer ce qu’est un roman, ce que permet l’imagination ou la fantaisie, ce qu’est un druide (Tibor) et combien il est ennuyeux de se retrouver immortel, surtout vers la fin...
Ce 20 février. _ Je ne l’écrirai pas à la Petite, mais c’est bel et bien le 20 février (1601) que son homonyme, Elizabeth 1re d’Angleterre fit décapiter à la hache le comte d’Essex, son favori de naguère, constatant que la différence d’âge était devenue pour elle trop cruelle – elle avait plus de soixante ans, il en avait moins de trente… ou du moins est-ce l’explication qu’on retient pour les magazines pipoles.En réalité, l’exécution de Robert Deverreux, comte d’Essex, éminent politicien et lettré aux dispositions poétiques rares, marquait le dénouement certes brutal mais non moins prévisible d’un long affrontement aux dehors de complot majeur ponctué de multiples trahisons et coups tordus réciproques.Pour dicton du jour, je relève dans l’Almanach : « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », et la femme le prendra pour elle aussi. Et demain le dicton sera : «Le temps ne pardonne pas ce que l’on fait sans lui ».Ce qui m’amène à ma lettre d’aujourd’hui au jeune Anthony, huit ans, à propos du roman de 600 pages qu’il m’a offert récemment, intitulé Les deux royaumes et dont les protagonistes ont plusieurs milliers d’années quand ils ne sont pas immortels, à commencer par le druide Tibor, collectionneur de coquillages (entre autres objets de mémoire ou d’exorcisme futur) comme l’a été (et le reste, pour les timbres et monnaies diverses) Anthony lui-même.Je ne dirai pas à Anthony le peu de goût que j’ai pour les écrits pléthoriques d’Eric-Emmanuel Schmitt, le type à mes yeux du faiseur à succès qui « écrit bien » mais sans palpite, et dont la prétention à raconter l’histoire de l’humanité en « digest » me semble absolument dénuée d’ancrage émotionnel, de sens réel du tragique et pire: du moindre humour. Toutes choses que je me garderai bien de dire au petit garçon, qui aura le temps, justement, de décider s’il apprécie ou non cet auteur archi-convenu , mais je vais achopper aux détails éventuellement plaisants ou intéressants de ce feuilleton mondial globalement inepte à mes yeux, en commençant par expliquer ce qu’est un roman, ce que permet l’imagination ou la fantaisie, ce qu’est un druide (Tibor) et combien il est ennuyeux de se retrouver immortel, surtout vers la fin... -
Ce que dit le silence
« Qui sait, dit Euripide, il se peut que la vie soit la mort et que la mort soit la vie »(Léon Chestov, Les révélations de la mort)La suprême ignorance est là,de ne plus savoir side la nuit avant l’heure,ou du jour et ses leurressont ce qu’ils sont ou ne sont pas…L’étrange chose qu’une rosequi ne parle qu’en soiet dont jamais aucune foin’osa dire qu’elle dispose…Les mots ne voulaient dire que ça:qu’ils savent qu’ils ignorentque le silence dort,et que la mort n’existe pas…Peinture JLK: Al Devero. -
Le top du taf
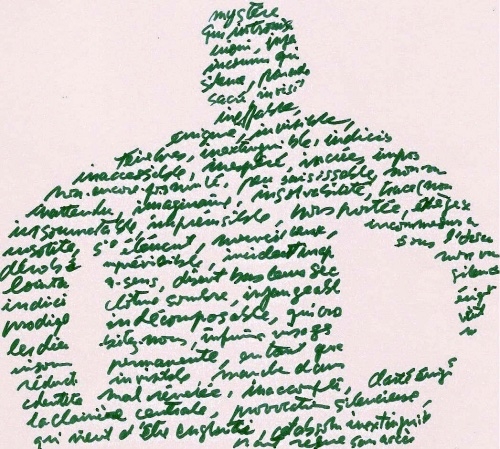 À la Maison bleue, ce jeudi 19 février. – L’excellent Pasteur, meilleur conseiller que la plupart des pasteurs, le disait tranquillement : « Travaillons ! Il n’y a que cela qui amuse… », et c’est tout à fait ce que je pense et vis tous les jours pour me désennuyer de l’ennui, le travail étant à mes yeux l’opposite de l’image punitive que s’en font les pasteurs (pas tous) et les idéologues, ou les nazis qui l’avaient compromise avec le cynisme des esclavagistes en affirmant que l’Arbeit macht frei.Oui le travail libère : écrire ce matin à ma petite Elizabeth de trois ans constituera un premier amusement spécial en ce jour marqué par l’entrée du soleil dans les Poissons à 13h02, en outre jour anniversaire du débarquement de Cortez au Mexique à la tête de 600 hommes, en 1519.La Mémoire universelle rappelle en outre que, ce jour de la mort de Carnaval, Carson Mc Cullers s’aventure à naître à Columbus Georgia (en 1927) tandis qu’André Gide décède décidément à Paris (en 1951) à l’âge de 81 ans après avoir envoyé un télégramme à Paul Claudel se résumant en ces mots : « L’Enfer n’existe pas, faites suivre à Jean-Paul Sartre »…
À la Maison bleue, ce jeudi 19 février. – L’excellent Pasteur, meilleur conseiller que la plupart des pasteurs, le disait tranquillement : « Travaillons ! Il n’y a que cela qui amuse… », et c’est tout à fait ce que je pense et vis tous les jours pour me désennuyer de l’ennui, le travail étant à mes yeux l’opposite de l’image punitive que s’en font les pasteurs (pas tous) et les idéologues, ou les nazis qui l’avaient compromise avec le cynisme des esclavagistes en affirmant que l’Arbeit macht frei.Oui le travail libère : écrire ce matin à ma petite Elizabeth de trois ans constituera un premier amusement spécial en ce jour marqué par l’entrée du soleil dans les Poissons à 13h02, en outre jour anniversaire du débarquement de Cortez au Mexique à la tête de 600 hommes, en 1519.La Mémoire universelle rappelle en outre que, ce jour de la mort de Carnaval, Carson Mc Cullers s’aventure à naître à Columbus Georgia (en 1927) tandis qu’André Gide décède décidément à Paris (en 1951) à l’âge de 81 ans après avoir envoyé un télégramme à Paul Claudel se résumant en ces mots : « L’Enfer n’existe pas, faites suivre à Jean-Paul Sartre »… -
And so what ?
 Ni chair ni poisson malgré l’apparence: rien que la stupéfaction ressaisie de l’Être au monde constatant soudain qu’il est ici et maintenant (« Il est maintenant » lui répondit un jour une sirène à laquelle il demandait l’heure ), avec la conscience lancinante réitérée qu’il est lui-même et pas un autre et le vertige métaphysique qui en découle…Gouache JLK: carnets du 18 août 2018.
Ni chair ni poisson malgré l’apparence: rien que la stupéfaction ressaisie de l’Être au monde constatant soudain qu’il est ici et maintenant (« Il est maintenant » lui répondit un jour une sirène à laquelle il demandait l’heure ), avec la conscience lancinante réitérée qu’il est lui-même et pas un autre et le vertige métaphysique qui en découle…Gouache JLK: carnets du 18 août 2018. -
Molière ce matin
 À la maison bleue, ce mardi 17 février 2026.–Toujours à l’écoute des Almanachs divers et autres Livres d’heures, je me rappelle ce matin de Mardi Gras, en découvrant l’inexorable progrès des cals de mes pauvres pieds secs et bleutés de bientôt octogénaire (il me reste à peu près 471 jours jusque-là) que l’excellent Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est mort ce jour-là dans son lit, peu après avoir pris le temps de se démaquiller de son masque de malade imaginaire, et c’est avec une exultation joyeuse que je compisse le souvenir du déni de l’Eglise de lui refuser l’inhumation, et me réjouis de me rappeler le cortège des milliers d’amis vrais bon chrétiens du poète défilant dans cette nuit de 1673 à la lumière des torches…Or, j’ai choisi d’entreprendre ce matin, dans l’esprit de Molière, la rédaction de lettres quotidiennes à mes enfants petits, que j’enverrai alternativement au joli trio pour les divertir, encourager leur curiosité de ceci et ou de cela, les faire rire ou rêver…
À la maison bleue, ce mardi 17 février 2026.–Toujours à l’écoute des Almanachs divers et autres Livres d’heures, je me rappelle ce matin de Mardi Gras, en découvrant l’inexorable progrès des cals de mes pauvres pieds secs et bleutés de bientôt octogénaire (il me reste à peu près 471 jours jusque-là) que l’excellent Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est mort ce jour-là dans son lit, peu après avoir pris le temps de se démaquiller de son masque de malade imaginaire, et c’est avec une exultation joyeuse que je compisse le souvenir du déni de l’Eglise de lui refuser l’inhumation, et me réjouis de me rappeler le cortège des milliers d’amis vrais bon chrétiens du poète défilant dans cette nuit de 1673 à la lumière des torches…Or, j’ai choisi d’entreprendre ce matin, dans l’esprit de Molière, la rédaction de lettres quotidiennes à mes enfants petits, que j’enverrai alternativement au joli trio pour les divertir, encourager leur curiosité de ceci et ou de cela, les faire rire ou rêver… -
Que de l'ordre
 Vous faites erreur les ménagères progressistes et les nouveaux influenceurs à sentences: les fleurs ne sont pas plus insoumises que disposées à l’anarchie décorative des médias: elles sont fleurs à fleur d’épines et ça valse sous les jupons ou grandes et petites lèvres se font pétales et sépales à la coule, bref on raffole de ce tumulte de corolles où rien de ce qui est prévu n’est imprévu…Aquarelle JLK: carnets de 2018.
Vous faites erreur les ménagères progressistes et les nouveaux influenceurs à sentences: les fleurs ne sont pas plus insoumises que disposées à l’anarchie décorative des médias: elles sont fleurs à fleur d’épines et ça valse sous les jupons ou grandes et petites lèvres se font pétales et sépales à la coule, bref on raffole de ce tumulte de corolles où rien de ce qui est prévu n’est imprévu…Aquarelle JLK: carnets de 2018. -
Le Fils, le Père et un petit bout de femme


 À la Maison bleue, ce dimanche 15 février. – Je me suis trouvé l’autre nuit pour ainsi dire embarqué dans un rêve excessivement contrariant, où j’étais supposé incarner le Seigneur ressuscité et chanter un solo de Messe d’action de grâces de la voix de soprane colorature qui était la mienne à neuf ans, mais tout en moi se refusait à cette comédie insane, plus ridicule encore que sacrilège, ordonnée par une sorte de femme-capitaine qui me surveillait à tout moment de son recoin en trépignant d’irritation à me voir hésiter, et qui a dû imploser de colère froide après ma disparition – car je me suis dérobé, je me suis littéralement envolé, je ne sais comment cela s’est fait mais je l’ai fait comme cela m’est arrivé quelques fois dans ma vie de septuagénaire avancé (il me reste un peu plus de 1000 jours avant le tournant des 80 ans que je doute de jamais atteindre), j’ai obéi de toute mon âme, tripes comprises, au refus d’obéir à la battante furieuse en laquelle j’ai cru reconnaître le Petit bout de femme de la fameuse nouvelle de Kafka en qui l’ami Pierre Gripari voyait une représentation du Dieu méchant de l’Ancien Testament…
À la Maison bleue, ce dimanche 15 février. – Je me suis trouvé l’autre nuit pour ainsi dire embarqué dans un rêve excessivement contrariant, où j’étais supposé incarner le Seigneur ressuscité et chanter un solo de Messe d’action de grâces de la voix de soprane colorature qui était la mienne à neuf ans, mais tout en moi se refusait à cette comédie insane, plus ridicule encore que sacrilège, ordonnée par une sorte de femme-capitaine qui me surveillait à tout moment de son recoin en trépignant d’irritation à me voir hésiter, et qui a dû imploser de colère froide après ma disparition – car je me suis dérobé, je me suis littéralement envolé, je ne sais comment cela s’est fait mais je l’ai fait comme cela m’est arrivé quelques fois dans ma vie de septuagénaire avancé (il me reste un peu plus de 1000 jours avant le tournant des 80 ans que je doute de jamais atteindre), j’ai obéi de toute mon âme, tripes comprises, au refus d’obéir à la battante furieuse en laquelle j’ai cru reconnaître le Petit bout de femme de la fameuse nouvelle de Kafka en qui l’ami Pierre Gripari voyait une représentation du Dieu méchant de l’Ancien Testament…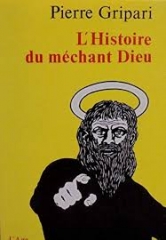 Or le hasard ( ?) a voulu que je retombe hier sur ladite nouvelle, dans le recueil intitulé Un Jeûneur (traduit par Bernard Lortholary, en poche Flammarion), et j’ai été supris d’en retrouver les dix pages très annotées au crayon, puis je me suis rappelé la remarque de Gripari (en 1974, lors de nos stations dominicales rituelles au Jardin des Plantes où nous nous racontions nos lectures de la semaine) et me suis dit qu’il fallait tout de même avoir l’esprit tordu par l’athéisme vengeur pour établir le moindre lien entre la jalousie tribale du Grand Méchant Dieu, toujours selon Gripari, et la fureur hystérique de la petite bonne femme souffrant à mort de voir le Narrateur en vie.Il est vrai qu’on pourrait voir en elle une projection de la mauvaise conscience kafkaïenne, si manifeste dans la Lettre au père du cher Franz, mais faire de cette petite personne énervée une incarnation du Dieu teigneux de la Bible - toujours selon l’auteur de l’Histoire du méchant Dieu -, me semble aussi aventuré que me demander d’incarner le Fils dans un rêve où frère Lacan se fût usé les dents…
Or le hasard ( ?) a voulu que je retombe hier sur ladite nouvelle, dans le recueil intitulé Un Jeûneur (traduit par Bernard Lortholary, en poche Flammarion), et j’ai été supris d’en retrouver les dix pages très annotées au crayon, puis je me suis rappelé la remarque de Gripari (en 1974, lors de nos stations dominicales rituelles au Jardin des Plantes où nous nous racontions nos lectures de la semaine) et me suis dit qu’il fallait tout de même avoir l’esprit tordu par l’athéisme vengeur pour établir le moindre lien entre la jalousie tribale du Grand Méchant Dieu, toujours selon Gripari, et la fureur hystérique de la petite bonne femme souffrant à mort de voir le Narrateur en vie.Il est vrai qu’on pourrait voir en elle une projection de la mauvaise conscience kafkaïenne, si manifeste dans la Lettre au père du cher Franz, mais faire de cette petite personne énervée une incarnation du Dieu teigneux de la Bible - toujours selon l’auteur de l’Histoire du méchant Dieu -, me semble aussi aventuré que me demander d’incarner le Fils dans un rêve où frère Lacan se fût usé les dents… -
Naufrage
 Vieille peau russe, ça c’est sûr, actrice de renom mais très décatie, ou peut-être cantatrice déchue, je ne sais plus, mais je m’accroche dans les vagues de l’océan de velours, je vois ce que je vois là-bas que vous ne voulez pas voir et je fais avec comme au théâtre ou à l’opéra quand le maquillage faisait ce qu’il fallait pour oublier tout ça…Aquarelle JLK, d’après Czapski.
Vieille peau russe, ça c’est sûr, actrice de renom mais très décatie, ou peut-être cantatrice déchue, je ne sais plus, mais je m’accroche dans les vagues de l’océan de velours, je vois ce que je vois là-bas que vous ne voulez pas voir et je fais avec comme au théâtre ou à l’opéra quand le maquillage faisait ce qu’il fallait pour oublier tout ça…Aquarelle JLK, d’après Czapski. -
Magnificat
 De certains moments l’on pourrait dire qu’ils sont Le Moment, comme sorti du Temps ou devenant l’emblème du Temps à ce moment-là et à nul autre pareil, comme le moment des adieux ou le moment de se rappeler soudain que tout passe, même s’il n’y a rien de soudain quand le jour passe et que le moment paraît même s’éterniser un instant …Peinture Lucia K. , alias Lady L. Coucher de soleil sur le Léman. Huile sur toile 60 x 80 , 2010.
De certains moments l’on pourrait dire qu’ils sont Le Moment, comme sorti du Temps ou devenant l’emblème du Temps à ce moment-là et à nul autre pareil, comme le moment des adieux ou le moment de se rappeler soudain que tout passe, même s’il n’y a rien de soudain quand le jour passe et que le moment paraît même s’éterniser un instant …Peinture Lucia K. , alias Lady L. Coucher de soleil sur le Léman. Huile sur toile 60 x 80 , 2010. -
Sérénité et reconnaissance
 Elle a ressaisi tous ces verts, cette phénoménale et funeste beauté de la montagne en cet été où, se sachant condamnée, elle avait résolu, sans lâcher aiguilles et pinceaux, couleurs et ciseaux, de s’en tenir à ces deux emblèmes de la tranquillité d’âme et de la générosité - et c’est ainsi qu’elle nous parle et nous reste…Peinture Lucienne K., alias Lady L. (1948-2021), Vanil d’Ecri, huile sur toile, 40 x 50. 2021.
Elle a ressaisi tous ces verts, cette phénoménale et funeste beauté de la montagne en cet été où, se sachant condamnée, elle avait résolu, sans lâcher aiguilles et pinceaux, couleurs et ciseaux, de s’en tenir à ces deux emblèmes de la tranquillité d’âme et de la générosité - et c’est ainsi qu’elle nous parle et nous reste…Peinture Lucienne K., alias Lady L. (1948-2021), Vanil d’Ecri, huile sur toile, 40 x 50. 2021. -
Mandarines
 Ensuite si vous aimez l’odeur des mandarines et le toucher tendre et mollement grenu de la peau de mandarine, ne vous gênez pas: mes carnets sont faits pour ça et je vous laisse y goûter pendant que je nous ouvre cette prometteuse bouteille de Vega Sicilia…Aquarelle JLK. Mandarines, d’après Joseph Czapski. Carnets de février 2022.
Ensuite si vous aimez l’odeur des mandarines et le toucher tendre et mollement grenu de la peau de mandarine, ne vous gênez pas: mes carnets sont faits pour ça et je vous laisse y goûter pendant que je nous ouvre cette prometteuse bouteille de Vega Sicilia…Aquarelle JLK. Mandarines, d’après Joseph Czapski. Carnets de février 2022. -
Mystère
 Là encore nous n’étions que de passage, mais à pied va savoir pourquoi et pas le moindre réverbère: juste là-haut ces fenêtres éclairées dans la maison à trois pans à la fois séparés et reliés l’un à l’autre - là encore va savoir pourquoi mais pourquoi faudrait-il que tout s’explique à tout coup alors qu’on ne fait que passer ?Carnets de JLK: aquarelle de mémoire, quelque part de nuit, en Côte d’or.
Là encore nous n’étions que de passage, mais à pied va savoir pourquoi et pas le moindre réverbère: juste là-haut ces fenêtres éclairées dans la maison à trois pans à la fois séparés et reliés l’un à l’autre - là encore va savoir pourquoi mais pourquoi faudrait-il que tout s’explique à tout coup alors qu’on ne fait que passer ?Carnets de JLK: aquarelle de mémoire, quelque part de nuit, en Côte d’or. -
Carnet d'oubli
 Souvenir de quel vue plongeante au gré de quel périple? Copie de quel paysage de quel artiste proche ou inconnu ? La Seine il me semble mais où et quand ? Pas la moindre idée et pourtant le sentiment d’un indéniable déjà vu et revu, même si ma main a perdu la mémoire…Aquarelle JLK, Carnets de l’année 2021.
Souvenir de quel vue plongeante au gré de quel périple? Copie de quel paysage de quel artiste proche ou inconnu ? La Seine il me semble mais où et quand ? Pas la moindre idée et pourtant le sentiment d’un indéniable déjà vu et revu, même si ma main a perdu la mémoire…Aquarelle JLK, Carnets de l’année 2021. -
Comme une épure
 Le regard du peintre tend parfois à la simplification en douceur découlant de son état d’âme au dam de la profusion des lieux, et la c’est une autre vérité qui s’impose comme celle de la barque bleue posée comme en sommeil sur le sable qu’il y a là on sait pourquoi…Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, petit format, Pp LK/ JLK.
Le regard du peintre tend parfois à la simplification en douceur découlant de son état d’âme au dam de la profusion des lieux, et la c’est une autre vérité qui s’impose comme celle de la barque bleue posée comme en sommeil sur le sable qu’il y a là on sait pourquoi…Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, petit format, Pp LK/ JLK. -
Ostende
Attends mais Ostende, le seul nom d’Ostende, le rivage et le soleil couchant d’Ostende, mais c’est que ça dégage de la poésie tout ça, et là tu les vois sur le banc de sable, les deux qu’il y à la, mais mon vieux c’est nous deux à Ostende…Peinture Floristella Stephani, huile sur toile, sans date.Pp LK/ JLK. -
Balbec 83
 Elle a noté les noms de Deauville et de Trouville au dos de sa petite toile, et toi lisant Trouville tu penses direct à Balbec dont l’hôtel est devenu lieu de mémoire mondial et de pèlerinages de Japonais cornaqués par de jeunes Tour Operators, mais ça ne te dérange pas du tout de partager le souvenir d’Albertine, qu’on voit ici se tremper dans un coin, avec toute la bande de tes frères humains dont la moitié sont des sœurs, etc.Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, 1983. Pp LK / JLK.
Elle a noté les noms de Deauville et de Trouville au dos de sa petite toile, et toi lisant Trouville tu penses direct à Balbec dont l’hôtel est devenu lieu de mémoire mondial et de pèlerinages de Japonais cornaqués par de jeunes Tour Operators, mais ça ne te dérange pas du tout de partager le souvenir d’Albertine, qu’on voit ici se tremper dans un coin, avec toute la bande de tes frères humains dont la moitié sont des sœurs, etc.Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, 1983. Pp LK / JLK. -
Nom de bleu !
 Dedieu la trombe: non mais je rêve ! Tout ça qui se mouvemente en même temps, mais c’est de la fronde de tous les vents et c’est sa façon de voir rouge quand tout se démonte !Peinture JLK: Savoie bleue. Huile sur panneau, années 80
Dedieu la trombe: non mais je rêve ! Tout ça qui se mouvemente en même temps, mais c’est de la fronde de tous les vents et c’est sa façon de voir rouge quand tout se démonte !Peinture JLK: Savoie bleue. Huile sur panneau, années 80 -
Au bord du Cher

-
L'Homme qui tombe
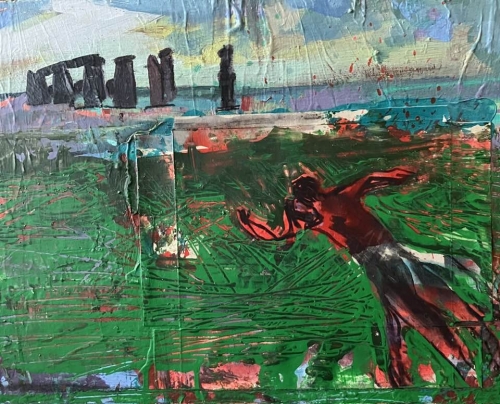 La citation explicite de l’horloge temporelle de Stonehenge fixe évidemment la composante circonstancielle de la péripétie, mais le geste même, le geste furieux, peut-être aveugle ou les yeux béants, en impose plus largement à l’Esprit et au Corps ainsi jeté ou projeté d’une dimension à l’autre - cela aussi est à discuter…Peinture Neil Rands: The falling man. Technique mixte sur papier. Années 90. Pp LK/ JLK
La citation explicite de l’horloge temporelle de Stonehenge fixe évidemment la composante circonstancielle de la péripétie, mais le geste même, le geste furieux, peut-être aveugle ou les yeux béants, en impose plus largement à l’Esprit et au Corps ainsi jeté ou projeté d’une dimension à l’autre - cela aussi est à discuter…Peinture Neil Rands: The falling man. Technique mixte sur papier. Années 90. Pp LK/ JLK -
La beauté sur la terre
Carnets de Thierry Vernet
Thierry Vernet s’est éteint au soir du 1er octobre 1993, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer. Genevois d’origine, le peintre avait vécu à Belleville depuis 1958 avec Floristella Stephani, son épouse, artiste peintre elle aussi. Thierry Vernet avait été le compagnon de route de Nicolas Bouvier durant le long périple que celui-ci évoque dans L’Usage du monde, précisément illustré par Vernet.
A part son œuvre peint, considérable, Thierry Vernet a laissé des carnets, tenus entre sa trente-troisième année et les derniers jours de sa vie, qui constituent une somme de notations souvent pénétrantes sur l’art et la vie.
« La beauté est ce qui abolit le temps »
« Je ne sais pas qui je suis, mais mes tableaux, eux, le savent ».
« Mille distractions nous sollicitent. La radio, le bruit, le cinéma, les journaux Autrefois on devait être face à face avec son démon, on devait patiemment élucider son mystère. Maintenant, vite, entre deux distractions, on doit tout dire, avec brio de chic, faire son œuvre en coup de vent. A moins… à moins de résister aux distractions ».
« L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser ».
« D’heureux malgré le doute, arriver à être heureux à cause du doute ».
« Faire la planche sur le fleuve du Temps ».
« C’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie ».
« Aux gens normaux le miracle est interdit ».
« Il suffit de voir qui réussit, et auprès de qui, pour être rassuré et encouragé ».
« Nous vivons, en ce temps, sous la théocratie de l’argent ; et malgré soi on sacrifie de façon permanente à ce culte hideux ».
« D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».
« Nous qui avons une patte restée coincée dans le tiroir de l’adolescence, nous en garderons toujours, sous nos rides, quelque chose ».
« D’abord la sensation est souveraine, ensuite le tableau est souverain. Entre ces deux souveraientés, il y a la révolution ».
« Dieu est éternel, le diable est sempiternel ». « En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».
« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».
« Quand son corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme ».
« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées ».
« Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites ; Dieu que le monde est beau ! »
« Monsieur Pomarède, mon voisin retraité de la rue des Cascades, me voyant porter un châssis, me dit : « Vous faites de la peinture, c’est bien, ça occupe ! »
« Une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».
« Je me bats, et il est normal qu’à la guerre on prenne des coups ».
« Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».
« Si l’on tue en soi-même l’espérance du Paradis, on n’hérite que de l’Enfer. C’est, me semble-t-il, le choix de notre civilisation ».
« La foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose ».
« Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant ».
« La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement ».
« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer » !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais.
Le 4 septembre 1993, et ce fut sa dernière inscription, Thierry Vernet notait enfin ceci : « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».À lire aussi: Correspondance des routes croisées, de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet (1946-1964), fabuleux "roman" dialogué d'une amitié.
-
Abécédaire romand


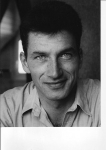

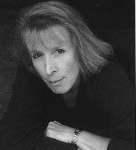
Adolphe – On pourrait dire de ce joyau de la littérature d’analyse, d’inspiration protestante et romantique à la fois, qu’il est celui de l’hésitation. Jeune homme de vingt-deux ans, Adolphe s’ennuie dans une petite ville allemande où il rencontre la Polonaise Ellénore, vivant avec un Comte. Adolphe étant devenu son amant, Ellénore se sépare du Comte, mais Adolphe à son tour voudrait se séparer d’Ellénore, sans s’y résoudre. Incertitudes et tourments entretenus tissent un filet où se débat le protagoniste. Benjamin Constant. Adolphe. Livre de poche G/F.
Alectone – Ce récit poétique aux accents nervaliens constitue l’un des joyaux de l’œuvre à la fois brève et cristalline de Crisinel, dont Pierre-Paul Clément rappelle en préface la destinée tragique et le caractère essentiel des écrits, relevant de la catharsis. A l’ensemble des poèmes et des proses lyriques rassemblés en ce volume s’ajoutent quelques variantes, des proses descriptives de ton plus serein, voire léger, ainsi qu’un extrait du Journal de la Métairie. « Je pense à Crisinel avec déchirement », écrivait Edmond Jaloux, « comme à l’un de ceux qui ont le plus souffert de chercher et de connaître le sens allégorique de la vie ». Edmond-Henri Crisinel. Œuvres. L’Age d’Homme. Poche suisse No 8.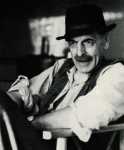 Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.
Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.
L’Amour fantôme – La propension satirique de l’auteur fait florès en ces pages évoquant l’itinéraire initiatique d’un Colin oedipien à outrance dont les tribulations recoupent les expériences « sur soi » de toute une génération. D’un premier séjour en prison (il a fait le fou dans une manif) d’où le tire Maman, à l’amoureuse initiation qui marque sa rencontre avec Rose, fille-fleur se roulant nue dans le sainfoin, avant d’autres étapes de sa réalisation personnelle, de rebirth en séminaire de chanelling, le personnage est joliment épinglé. Jean-Michel Olivier. L’Amour fantôme. L’Age d’Homme, 1999.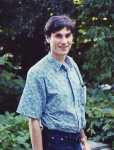 Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.
Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.
Aujourd’hui je ne vais pas à l’école - L’adjectif est galvaudé, mais c’est bel et bien un livre subversif que ce monologue d’un jeune énergumène en bisbille avec les convictions établies et les idées reçues. Il y a du cabarettiste en ce jongleur de mots et de concepts, décidé à rester sur sa scène privée au lieu de reprendre la comédie de l’Ecole (avant celle de l’Eglise et de l’Etat). A l’école « contre la vie » dont parlait Edmond Gilliard, s’oppose ici la classe buissonnière d’un émule de Roorda. C’est frais et vif, sans une ride vingt ans après... Claude Frochaux. Aujourd’hui je ne vais pas à l’école. L’Age d’Homme, 1986.
Les beaux sentiments – Le suicide d’un de ses élèves et l’abus sexuel subi par un autre marquent l’année du bac de la classe de gymnase du professeur François Aubort, double romanesque de l’auteur qui parvient, en évitant les pièges du témoignage direct ou de l’ouvrage « à thèmes », a construire un roman d’émotion portant à la réflexion sans être désincarné. De fait, tous les personnages en sont vibrants de présence, la force du romancier tenant à restituer la fragilité et le désarroi de jeunes gens – le professeur autant que ses élèves - dont il ressaisit aussi la fraîcheur et la générosité. Jacques-Etienne Bovard, Les beaux sentiments. Campiche, 1998.
Cahier de verdure – La partie la plus accessible de l’œuvre de Philippe Jaccottet, et la plus attachante aussi, relève d’une sorte de carnet poétique continu, d’une semaison à l’autre, dont ce recueil, accordé au cycle des saisons, est une belle illustration. L’apparition en gloire d’un grand cerisier en marque l’ouverture symbolique par-delà laquelle on s’engage Sur les degrés montants de la nature saisie dans son effervescence et sa violence vitale, avant les Eclats d’août et les feux de l’automne préludant à la descente vers les plaines de l’hiver et de l’âge. Philippe Jaccottet. Cahier de verdure. Gallimard, 1990.Les chagrins magnifiques – Plus grave de tonalité qu’Une chambre pleine d’oiseaux, premier recueil des chroniques de l’auteur, cet ensemble de proses reprend les thèmes récurrents du malaise existentiel et de la difficulté de communiquer dans le couple et dans la société, avec un regard plus personnel et nostalgique sur les « légères hypothèses d’enfance », et des inflexions mélancoliques accentuant et poétisant à la fois un sentiment de déréliction quasi omniprésent. Du moins les bonheurs d’écriture, et le ton si particulier du chroniqueur-écrivain valent-ils à ce livre sa vertu paradoxalement tonique. Christophe Gallaz. Les chagrins magnifiques. Zoé Poche, 2005 (1986).
Chambre 112 – Le titre de ce récit autobiographique désigne la chambre de l’hôpital tessinois dans lequel le père de l’auteur a vécu ses derniers jours et qui devient le pivot des allées et venues du narrateur entre la Suisse romande où il accomplit sa carrière d’universitaire distingué et le Tessin plus rugueux de son enfance et de sa langue maternelle, de ses premières racines culturelles et de son Padre padrone en train de passer de l’état de chêne familial à celui de roseau fragile, bientôt arraché par le vent de la destinée. Très juste de ton, et d’une empathie généreuse à l’égard de la petite communauté évoquée, cet hommage au père est à la fois la mise en rapport de deux cultures et de deux époques traversées par l’auteur. Daniel Maggetti. Chambre 112. L’Aire, 1997.
Châteaux en enfance – Premier volet du triptyque romanesque englobant Les esprits de la terre et Le temps des anges, ce roman doux-acide marque aussi l’amorce d’une forme narrative novatrice, instaurant une modulation proustienne de la remémoration. Au gré d’un récit non linéaire, soumis aux associations libres de l’évocation, c’est tout un théâtre de bourgeoisie provinciale qui émerge des brumes du passé, dont les figures goyesques contrastent avec quelques personnages « élus » par la romancière à proportion de leur sensibilité, de leur vulnérabilité ou de leur appartenance à un « ailleurs » poétique. Catherine Colomb. Œuvres complètes. L’Age d’Homme, 1993. Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.
Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.
Les circonstances de la vie. – Après les deux premiers romans terriens de Ramuz, celui-ci s’attache à un personnage qui va vivre, à son corps défendant, la mutation de toute une société soudain entraînée dans les mécanismes de l’expansion et de la spéculation, où les affairistes et les arrivistes feront florès. Après un premier mariage malheureux, le notaire Emile Magnenat s’installe en ville afin de satisfaire les ambitions pressantes de la fringante Frieda, qui le pousse à toutes les dépenses avant de le tromper et de l’anéantir. D’une tonalité flaubertienne, ce sombre et poignant roman est tout empreint de la défiance du jeune Ramuz à l’encontre de la ville et d’une société déshumanisée. C.F. Ramuz. Les circonstances de la vie L’Age d’Homme, Poche Suisse No 134.
Comme si je n’avais pas traversé l’été. – C’est là, sans doute, le roman le plus accompli de l’auteur. Il y est question de la peine et de la révolte d’Alia, confrontée en très peu de temps à la mort de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer. Livre de la déchirure intime et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l'enfant pour qu'il vive et lui survive, ce roman est aussi, à l'inverse, un livre de l'alliance des vivants entre eux et du dialogue perpétué avec ceux qui leur ont été enlevés. Janine Massard. Comme si je n’avais pas traversé l’été. L’Aire, 1998.La complainte de l’idiot – On se régale à la lecture de ce livre ludique et foisonnant autant pour l'originalité de sa vision - apparemment dégagée de tout réalisme et renvoyant cependant à notre monde avec une verve critique réjouissante - que pour l'éclat et les chatoiements de son écriture, jamais aussi libre et inventive. Rappelant la douce dinguerie hyperlucide d'un Robert Walser, et d'abord parce qu'il se passe dans un « débarras à enfants » assez semblable au fameux Institut Benjamenta, ce roman évoque également la figure tutélaire de Cendrars par ses dérives épiques, le goût du conte qui s'y déploie et sa faconde verbale. Michel Layaz. La joyeuse complainte de l’idiot. Zoé, 2003.
 Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.
Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.
Le désir de Dieu – D’emblée l’auteur se dit « plein de Dieu » dans ce livre reprenant en fugues et variations les thèmes fondamentaux de son œuvre, à savoir : l’étonnement primordial d’être au monde et la découverte de la poésie, l’intuition précoce de la mort et son expérience tragique au suicide du père, le vertige du sexe et ses turbulences contradictoires, la fascination pour le vide qui serait à la fois une plénitude à la manière extrême-orientale, le miel du monde et ses infinies modulations, le rêve du monumentum artistique cher à Flaubert et la conscience de sa vanité sous le ciel métaphysique. Or il y a, dans ce livre de pure prose, une liberté et une qualité de style qui en font l’un des meilleurs ouvrages de son auteur. Jacques Chessex. Le désir de Dieu. Grasset, 2005.
Le dessert indien – La tonalité qui marque les treize nouvelles de ce recueil, mélange d’épicurisme souriant et de désenchantement indulgent, de flegme frotté de cynisme et de bonhomie frottée d’expérience, relève de la culture anglo-saxonne plus que de la tradition romande, du côté de Somerset Maugham. De la nouvelle policière à la gourmandise érotique, en passant par la rêverie méditative d’Un instant d’éternité, évoquant Barbey d’Aurevilly, le récit fantastique ou la satire, l’auteur excelle à tout coup, en dépassant pourtant l’exercice de style par un vrai bonheur d’écriture et de narration. Marc Lacaze. Le dessert indien. Seuil, 1996.
Le dixième ciel – Comment concilier foi et raison, vérité révélée et connaissance scientifique ? Telle est l’un des questions posées par ce vaste roman au formidable générique, puisque Pic de la Mirandole, le protagoniste, y fréquente Laurent de Médicis ou Marsile Ficin, dans la Florence brillantissime du Quattrocento où apparaissent également le jeune Michel-Ange, Sandro Botticelli ou Savonarole, notamment. Plus que le pittoresque du roman historique, somptueux au demeurant, c’est l’enjeu du débat d’avenir qui nous captive ici, incarné par de beaux personnages. Etienne Barilier. Le Dixième ciel. Julliard/L’Age d’Homme, 1986.
Le droit de mal écrire. – Dans sa fameuse Lettre à Bernard Grasset, Ramuz a magistralement traité le problème des relations liant la Suisse romande à Paris et, plus précisément, les langues périphériques de la francophonie au « bon français ». D’un Rousseau, qui revendiquait la spécificité culturelle et morale du parler romand, tout en s’exprimant en français classique, à un Töpffer émaillant volontiers son écriture de localismes à coloration helvétistes, et jusqu’aux auteurs d’aujourd’hui, le rapport entre la littérature romande et la France reste ambigu, rarement simple. Jérôme Meizoz. Le droit de « mal écrire », Quand les auteurs romands déjouent le « français de Paris ». Zoé, 1998.
Eloge du migrant. – Quelque peu rugueux au premier abord, ce premier livre d’un fils d’immigré en impose bientôt par la justesse de son ton et l’originalité de son écriture, incorporant ici et là des tournures italianisantes qui tiennent lieu d’accent au protagoniste, saisonnier italien se racontant sans trémolos. « Murateur » de métier, il se dit « de rue et d’errance solidaire », non tant « de revendication » que « de fidélité », avec un double sentiment d’être exclu et de participer à la fraternité des matinaux. Il y de l’héritage de Pavese dans cette belle méditation poétique. Adrien Pasquali. Eloge du migrant. L’Aire, 1989.L’enfant secret - Les destinées croisées des aïeux de l’auteur, de la Côte vaudoise à l’Italie de Mussolini, et l’Histoire dramatique du siècle, se vivifient dans cette autofiction constituant sans doute l’un des plus beaux livres de l’auteur. Les personnages d’Emilie et Julien, qui vivent sur les bords du Léman, et le couple formé par Nora et Antonio, assistant (et participant, puisque Antonio est le photographe attitré du Duce) à la montée du fascisme en Italie, constituent le cercle familial multiculturel dans lequel va grandir l’enfant, dont la mémoire restituera ce microcosme si caractéristique de notre pays. Jean-Michel Olivier. L’enfant secret. L’Age d’Homme, 2003.
L’enfant triste. – On retrouve, une génération plus tard, la douloureuse grisaille des Circonstance de la vie, sur fond d’aigre puritanisme, dans ce récit d’une enfance marquée à la fois par le désamour des parents du protagoniste, et par les avanies subies au Collège, où le goût manifesté par le garçon pour un Baudelaire, notamment, est assimilé à un dévoiement. Du moins une tante bonne, à la montagne, va-t-elle donner une autre image de la vie, plus ouverte et généreuse, au narrateur de ce livre d’autant plus marquant qu’il s’en tient aux faits, sans pathos. Michel Campiche. L’enfant triste. L’Aire, 1980.L’été des Sept-Dormants. – Relevant à la fois de l’exorcisme autobiographique, du roman symphonique et du testament spirituel, ce livre allie, étrangement, les fantasmes obsessionnels et presque maniaque, dans leur expression, d’un esthète amoureux des éphèbes, et la ressaisie magistrale, poétique et religieuse la fois, de quelques destinées réunies dans le creuset existentiel et affectif d’un institut de jeunes gens tenu par une maîtresse femme, Maria Laach, et son pittoresque époux. Roman de l’apprentissage à l’ample mouvement de fleuve, ce livre majestueux laisse en mémoire un double souvenir de fraîcheur juvénile et de lancinante mélancolie. Jacques Mercanton. L’Eté des Sept-Dormants, Galland 1974. Réédition en Poche Suisse, Nos 9 et 10.
Ce qui reste de Katharina. – De la misère morale en famille bourgeoise pourrait être le sous-titre de ce roman courant à travers trois générations et constituant un aperçu mordant de l’évolution des mœurs au XXe siècle. Au lendemain de la mort de son fils quinquagénaire, Katharina se repasse le film de sa vie et en établit le bilan, marqué par maints sacrifices sur l’autel de la vie conjugale et de la maternité. Rien pourtant du réquisitoire féministe unilatéral dans ce récit d’une vie gâchée où la complexité humaine est abordée avec empathie. Janine Massard. Ce qui reste de Katharina. L’Aire, 1997.
L’essaim d’or. – Amateur de bonnes choses, à tous les sens de l’expression, l’auteur, ancien bibliothécaire municipal en chef, et fomentateur à ce titre d’une phénoménale collection de bandes dessinées, est également un prosateur gourmand capable de faire partager ses goûts, comme celui du flan caramel, dit ici « mets de fête ». Excellant dans l’évocation ludique ou cocasse (son éloge de la vache ou sa célébration de la poussière de bouquins), cet arpenteur des sentiers écartés de la littérature ajoute, de surcroît, une touche d’humour à notre littérature si souvent si grave… Pierre-Yves Lador. L’essaim d’or. L’Aire, 1998.
Le désarroi – Issu d’une génération héritière de la faillite des idéologies, le protagoniste rompt avec sa vie confinée d’étudiant en lettres à la suite des mises en garde d’un de ses profs vitupérant la standardisation et la déshumanisation de la société. « Confronté à une existence que je ne savais plus comment empoigner, je me sentais usé » remarque-t-il à l’instant où il arrive, après un long voyage, dans un monastère qu’on suppose au Mont Athos, où il chemine sur les traces d’un certain Alexandre, mi-héros mi-ascète en lequel il espère trouver un modèle existentiel. René Zahnd. Le désarroi. L’Aire, 1990. La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.
La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.
La gazelle tartare. – Dernière en date de ses autofictions, ce livre d’Asa Lanova est aussi le plus vibrant d’émotion et le mieux enraciné dans le sol natal de la romancière lausannoise, le plus accompli aussi du point de vue littéraire. Un premier amour, dont la fin prématurée coïncide avec le renoncement à une prometteuse carrière de ballerine, et la mort de la mère de la protagoniste, constituent les deux pôles sensibles de cette remémoration où l’enfance et ses magies, une angoisse maladive et le recours à l’exorcisme des mots, se conjuguent pour rendre le « son » unique d’une vie ressaisie par l’écriture. Asa Lanova. La gazelle tartare. Campiche, 2004. Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.
Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.
L’Homme seul. – Soliloque effréné non moins que stimulant, ce livre a les qualités et les limites de la recherche autodidacte, à la fois passionnant par ses observations et discutable dans ses conclusions, à commencer par celle qui conclut à l’extinction de la culture occidentale dans les années 1960… Matérialiste anarchisant, l’auteur réduit l’histoire de la culture à une suite de déterminations où le rôle de la géographie se trouve revalorisé par rapport à l’analyse historico-économique des marxistes. Sans aucune référence indiquée, mais brassant d’innombrables lectures, cette somme hyper-subjective et péremptoire est marquée par un souffle et un ton uniques. Claude Frochaux. L’Homme seul. L’Age d’Homme. Poche Suisse No 194-195.
Humour. – Tenant à la fois du journal de bord personnel et de l’essai biographique, ce livre est l’une des plus belles illustrations de la pratique singulière de l’auteur, consistant à imbriquer des dessins et des aquarelles dans le corps de son texte. En l’occurrence, celui-ci place la (re)découverte de Joyce, dont la vie se trouve racontée au fil d’un journal imaginaire, sous le signe de la passion juvénile de Pajak et de son ami Yves Tenret, protagonistes d’une histoire se donnant comme en miroir, en résonance à la biographie du génial Irlandais. Frédéric Pajak (avec Yves Tenret) Humour. Une biographie de James Joyce. PUF, 2001. L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.
L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.
Jean-Luc persécuté. – Deuxième roman du jeune Ramuz, cette tragédie montagnarde donne un grand frère farouche à la petite Aline en la personne de Jean-Luc Robille, incessamment humilié par une épouse sensuelle et mauvaise, Christine de son prénom. Type de l’homme simple et droit, le protagoniste découvre les traces de l’adultère dès la fameuse scène première, préludant à tous ses malheurs et à ceux de l’enfant du couple. Le roman, portrait aussi d’un village de montagne, évoque une pyrogravure expressionniste, où la noblesse de cœur de Jean-Luc et la vilenie de ceux qui l’entourent forment un contraste significatif. C.F. Ramuz. Jean-Luc persécuté. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 25.
Je dis tue à tous ceux que j’aime – Après avoir abordé les genres les plus divers, de la science fiction au roman historique, l’auteur lausannois touche ici au symbolisme fantastique autant qu’à l’érotisme homosexuel, dans un roman évoquant les nouvelles de Kafka ou la littérature latino-américaine. Le protagoniste, représentant banal de son état, échoue dans une ville paraissant soudain coupée du temps et du monde ordinaire, où la rencontre d’un jeune homme vaguement angélique, en dépit de conduites sordides, achève de le déstabiliser. Surtout intéressant par son atmosphère, ce roman est d’un conteur avéré. Olivier Sillig. Je dis tue à tous ceux que j’aime. H&O, 2005.
Jette ton pain. – « Je ne suis qu’une vieille orpheline à la recherche de trésors perdus », écrivait Alice Rivaz dans Comptez vos jours, et l’aveu pourrait être aussi celui de Christine Grave, à cela près que cette quinquagénaire est encore en charge de sa mère impotente, qui ne manque de lui rappeler combien elle s’est elle-même « sacrifiée ». Bilan d’une existence de femme souvent « empêchée » dans ses aspirations personnelles, ce roman proche de l’autofiction est à la fois marqué par l’effort d’émancipation et le pari créateur sur lequel s’ouvre sa dernière partie. Alice Rivaz, Jette ton pain, Gallimard/Galland, 1979.
Jonas – Roman de l’alcool et des bilans de la cinquantaine, cette autofiction – l’une des plus fortes de l’auteur – évoque le retour, à Fribourg où il a passé le début de sa jeunesse, de Jonas Carex en quête d’un refuge momentané dans le ventre de la baleine aux souvenirs. De fait, c’est en ces lieux qu’il a vécu le plus intensément, à l’âge des grandes questions et d’un amour qu’il va retrouver avec un mélange de tendresse et de désarroi, qui le confrontera plus durement encore à son naufrage personnel. Jacques Chessex. Jonas. Grasset, 1987.Journal intime – Parangon du genre, ce monument de l’introspection ne se borne pas, loin s’en faut, à la rumination stérile d’un professeur esseulé et velléitaire, mais constitue la chronique extrêmement variée d’une fin de siècle genevoise, vue par un écrivain aussi ouvert à la culture européenne qu’à la nature, à la philosophie et aux nouvelles doctrines sociales, au milieu littéraire local ou parisien. Lecteur et promeneur infatigable, Amiel est surtout un prosateur d’une merveilleuse porosité, du moins quand il échappe au ressassement quotidien et à l’autoflagellation. Ses paysages, ses portraits (notamment de femmes) et ses réflexions de toutes espèces constituent un inépuisable trésor. Henri-Frédéric Amiel. Journal intime, L’Age d’Homme, 12 volumes.
Kriegspiel – A la tête d’une escouade de dragons à l’ancienne, le capitaine Pavel Takac donne l’assaut à une formation de tanks, dont il ressortira seul vivant, témoignant du sacrifice des hommes tombés à ce qu’on pouvait dire encore le champ d’honneur, et faisant revivre l’événement avec panache, mais non sans mélancolie. Le ton et la manière, autant que la vigueur de ce roman sont assez rares en Suisse romande, et c’est en effet un captivant roman d’aventures que cet ouvrage à valeur, aussi, de réflexion sur la guerre et sur le sacrifice des héros, chair à canon de la Realpolitik. Jacques-Michel Pittier. Kriegspiel ou le jeu de la guerre. L’Age d’Homme, 1982,
Les larmes de ma mère - Récit mimétique d'une libération, Les Larmes de ma Mère représente, malgré quelques relents de lyrisme adolescent, un travail de fiction qui dégage ce livre de ce qu'il pourrait avoir d'anecdotique ou de nombriliste. La démarche de Michel Layaz se fonde sur une implication vivante, vécue par le truchement d’une langue qui restitue, dans leurs nuances, tous les désarrois, les humiliations, les infimes mais cuisante blessures, comme aussi les effusions, les petits bonheurs, les premiers troubles sensuels, les échappées dans le sillage d'un magicien ou d'une femme bien en chair, les premiers refus aussi et les premières prises de conscience personnelles. Michel Layaz. Les Larmes de ma mère, Editions Zoé, 2002
Laura – Deuxième roman de l’auteur lausannois, ce livre étincelant concentre les thèmes à venir de l’œuvre, partagée entre une interrogation sur le sens de l’art dans le monde contemporain et la modulation des passions humaines. Dans le décor hautement symbolique de Venise, le protagoniste, jeune artiste peintre cheminant aux frontières du nihilisme métaphysique, aime et fait souffrir Laura que résument les « gestes de la vie ». Limpide et dense, ce roman a conservé sa vibration tendue et sa beauté. Etienne Barilier. Laura. L’Age d’Homme, Poche suisse No 82.
La Malvivante. - Dans son chalet en banlieue du Clos, Tosca remâche sa révolte en observant les gens du quartier au moyen de ses jumelles. Malheureuse en ses premières amours, cette fille d’immigré italien et de Vaudoise terre à terre, mariée à un ouvrier résigné à son sort, est en outre rejetée par ses enfants. Au bord de la rupture psychique et du suicide, Tosca n’en témoigne pas moins d’une vive lucidité sur le monde médiocre qui l‘entoure, où les « petites gens » montrent parfois le plus de grandeur inaperçue. Mireille Kuttel, La Malvivante. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 37.
Le marcheur illimité. – Intéressant par l’allant de son écriture et l’observation des « premiers plans » que lui ménage la marche, Ellenberger le farouche n’a rien du sémillant randonneur à la manière de Töpffer, ni non plus du « performeur » à celle de Daniel de Roulet : il marche à en crever à ce qu’il semble et, de fait, cela devient un récit plein de vie que cette suite d’évocations de longues trottes le long du Doubs ou du Rhône, en Crète ou dans les rues de Paris, lézardant quelque temps au Luxembourg puis se remettant en route du Quartier latin à Saint Germain-en-Laye… Pierre-Laurent Ellenberger. Le marcheur illimité. L’Aire, 1999.Le miel du lac. – En chroniqueur pratiquant un type d’observation et une langue imagée à la Vialatte, son maître avéré, l’auteur évoque, dans cette manière de d’autoportrait étoilé, son passé de gosse levantin aux souvenirs d’enfance à la fois pittoresques et parfois douloureux. Rompant avec le tout-venant du journalisme, il enlumine, avec un mélange de candeur blessée et d’humour souvent cocasse, les heures riches de ses flâneries et de ses rencontres, dans ce pays de Vaud qui est devenu sa terre d’adoption. Gilbert Salem. Le miel du lac. Campiche, 1998.
Mille-feuilles. – En trois volumes très élégants et illustrés avec beaucoup de goût, ce recueil de proses et d’articles, plus encore que les romans autobiographiques de l’auteur, constitue le « trésor » de l’auteur délicieux d’Italiques (L’Age d’Homme, 1969), capable de parler de la peinture de James Ensor ou d’une visite à Gustave Roud, de Picasso en Avignon ou de « Fribourg-la-romaine », du Paradou des Bille ou de la mort de Léautaud avec la même fine justesse et avec le même bonheur. Comme dans Le soleil sur Aubrac (Grasset, 1986), le grappilleur déploie, en ces pages étincelantes, une constante faculté de transmutation. Georges Borgeaud. Milles Feuilles I, II, III. La Bibliothèque des Arts, 1997.
Mon bon ami – L’auteur de ce savoureux recueil de proses, dont le texte intitulé Merveilles indique bien l’orientation et la tournure, se nourrit de tout, circulant de par le monde comme l’enfant au tricycle ou son grand frère en aile delta. De l’oiseau witcha (une sorte de merle blanc) elle dit : « Le merle avait un regard de comptable, de notaire, d’inspecteur, de soliste ». Avec la même alacrité joyeuse et le même bonheur d’expression évoquant tour à tour Vialatte et Cingria, elle parle indifféremment de Lawrence Durrell et de Marco Polo, de sa peur du noir et d’un mazot sur la montagne, des Rolling Stones copulant dans leur jet rivé ou d’une humble vieille dame corse, sans oublier l’âme soeur qui donne son nom au titre du livre… Corinne Desarzens. Mon bon ami. L’Aire, 122p.
Monument à F.B. – Sur le ton apparemment détaché du dandy, ce récit de pure émotion, dont les mouvements de la narration reproduisent les tâtons, hésitations et autres retours amont, digressions ou subites illuminations, tient à la fois de la remémoration sentimentale et de l’exorcisme. Il y est question de la liaison d’un homme marqué par « la saloperie d’usure de la vie quotidienne », auprès duquel F.B., malmenée en ses jeunes années, cherche refuge, pour le faire souffrir à son tour. Du moins cette femme-enfant laisse-t-elle une trace indélébile de « pureté inaliénable ». Roger-Jean Ségalat. Monument à F.B. Hachette-Littérature, 1978.Mortelle maladie - D’une voix encore fragile, mais chaleureuse, nouée par la souffrance, l’auteur exprime à la fois sa révolte contre le mal qui la ronge et contre la société des hommes, où la femme est parfois encore une esclave. La première partie du livre est attente de l’enfant, d’abord intrus, puis vie désirée, jusqu’au jour de l’accident qui laisse la mère de nouveau seule dans le monde des survivants, contrainte de s’inventer de nouvelles raisons de vivre. Mère frustrée, la narratrice devient femme-écrivain tentant d’assumer le sort de ses semblables, en racontant notamment le calvaire d’Annunziata, la mère italienne, pour donner à son propre drame une résonance plus universelle. Anne Cuneo. Mortelle maladie. En Campoche, 2005.
Nains de jardin. – La verve satirique qui se déploie dans ce recueil de nouvelles, dont le succès populaire n’a pas faibli depuis sa parution, s’applique à toute une Suisse moyenne déjà brocardée par un Hugo Loetscher, un Emil ou une Zouc. L’homme aux nains de jardin vit dans une petite maison à soi ou en villa mitoyenne, au milieu d’un univers propre-en-ordre et censé le rester, qu’un rien suffit pourtant à troubler, suscitant alors une vraie fièvre sécuritaire. Multipliant les scènes significatives, l’auteur brosse un portrait-charge de groupe non dénué de malice amicale. Jacques-Etienne Bovard. Nains de jardin. Campoche, 2004.
Ni les ailes ni le bec – Mélange d’humour mordant et de tendresse latente, ce premier recueil de l’auteur constitue, en dix-huit nouvelles, un patchwork attachant et vif, à l’image de la jeunesse qu’il décrit et dont il procède aussi bien. Des rêves de la femme de ménage espagnole compulsant son roman-photo, dans Conchita, à l’évocation de jeunes gens incapables d’apprécier tout ce qui leur est donné, dans Vous les enfants des hautes Villes, le nouvelliste restitue de brèves tranches de vie à valeur parfois significative. François Conod. Ni les ailes ni le bec. Campiche, 1987.
Le pain de coucou. – Plus encore qu’un kaléidoscope de souvenirs d’enfance puisant à la double source de l’univers alémanique du Grossvater et du quartier lausannois des jeunes années de l’auteur, ce livre restitue les premiers émerveillements de celui-ci à la découverte conjointe des choses et des mots. Dans un climat mêlé de tendresse et d’humour, les séquences de cette remémoration évoquent le monde d’une modeste tribu familiale assez typique de la Suisse des années 50, avec ses figures et ses emblèmes dont le relief s’accentue par le double jeu de la distance temporelle et du verbe poétique. Jean-Louis Kuffer. Le pain de coucou. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 44.
Passion. – La beauté et la hideur cohabitent dans ce roman glacial et brûlant à la fois, où s’opposent aussi bien deux univers, de la stérilité et de la création, de l’amour-passion et de la vie par procuration d’un maniaque solitaire. Pierre X., « homme sans passion », le type du quidam sans qualités, vit comme greffé au jeune couple que forment la danseuse Maria F. et le pianiste Frédéric Z., qu’il épie avec des moyens de plus en plus sophistiqués et dont il consigne l’évolution de la relation dans son journal, lequel constitue le roman lui-même, l’un des plus saisissants de l’auteur lausannois. Etienne Barilier. Passion. L’Age d’Homme, Poche suisse No 7.
Les passions partagées. – Sur la base de carnets tenus quotidiennement et de notes fixant chaque nouvelle découverte, l’auteur recompose une chronique kaléidoscopique à valeur de « lecture du monde » où alternent aussi rencontres, voyages et autres expériences personnelles formatrices. Vingt ans (1973-1992) de vie littéraire en Suisse romande, des balades en Toscane ou en Andalousie, la découverte des Etats-Unis et du Japon, l’amitié et l’amour, la naissance d’un enfant et l’arrachement aux êtres aimés constituent la trame de l’ouvrage. Jean-Louis Kuffer. Les Passions partagées. Campiche 2005.
Le pays de Carole. – Peu de romans romands témoignent, mieux que ceux de cet auteur, de l’état et de l’évolution des mentalités et des moeurs dans notre pays, ici dans la rupture de continuité de la séculaire vie paysanne et dans le vacillement généralisé des relations de couples, notamment entre la trentième et la quarantième années. La crise vécue ici par Paul, homme au foyer qui se découvre une passion pour la photographie, et Carole que suroccupe sa carrière de médecin, aboutit à une nouvelle forme de liberté qui accentue par contraste, les médiocres accommodements où trop de vies s’enlisent. Avec autant de lucidité que d’empathie, Bovard campe des personnages vivants et attachants. Jacques-Etienne Bovard. Le pays de Carole. Campiche, 2002.
Prendre d’aimer – Fuyant la disette qui sévit en Valais, Séverine cherche ailleurs de quoi vivre, des bains de Loèche à Lausanne et Fribourg en passant par Villeneuve, découvrant le pays en ces années 1820, et multipliant les rencontres également significatives pour le lecteur. La fresque d’époque, nourrie par une documentation précise, est rehaussée par une écriture également marquée par le souci de reconstitution, mais sans artifice pour autant, savoureuse et sympathique autant que le portrait de la protagoniste. Gisèle Ansorge. Prendre d’aimer. Campiche, 1988.Un prince perdu. – Tenant à la fois du conte épique et du roman en prise directe avec les tribulations du monde contemporain, ce roman évoque fortement les destinées de l’Afghanistan, que l’auteur connaît bien pour y avoir été délégué du CICR, sans que le pays ne soit jamais nommé. Le jeune Jahan, unique rescapé du massacre de la famille royale du Karaba, entreprend le récit de sa vie à l’initiative de son ami portugais Jorge, afin de laisser témoignage et d’affirmer une identité remise en cause. A la fois tendre et amer, pétri d’humanité et impressionnant par ses évocations de la nature et du chaos de la guerre civile, ce livre est de ceux qui marquent. Jean-François Sonnay. Un prince perdu. Campiche, 1999.
Rapport aux bêtes. – Dès les premières pages de ce roman se révèle un talent singulier, tant par le choix singulier des mots que par les rythmes, la couleur, le modelé, la pâte du langage. Si la voix de la romancière manifeste aussitôt une indéniable originalité, cela ne va pas sans sophistication de style tournant, parfois, au maniérisme. Le fait est d’autant plus gênant que le livre est censé représenter l’existence d’un paysan de montagne et ses rapports avec sa jeune femme Vulve, son valet de ferme portugais et ses vaches. Noëlle Revaz. Rapport aux bêtes. Gallimard, 2002.
Le rendez-vous de Thessalonique. – Ce premier livre de l’auteur fixe d’emblée un espace romanesque et développe, au fil d’une écriture précise, concrète et rapide le récit des désarrois d’un quadragénaire, architecte de son état, dont la disparition soudaine de son meilleur ami exacerbe sa propre remise en question. Voyage vers soi-même recoupant l’errance des damnés de la terre, ce périple surtout existentiel ressaisit les rejets et autres tâtons d’une génération en perte de repères, dans un roman qui a valeur à la fois de symptôme et de fondation personnelle. Nicolas Verdan Le rendez-vous de Thessalonique. Campiche, 2005.
Le roseau pensotant – L’humour palliant la bêtise, l’esprit grégaire et pédant ou le conformisme du bourgeois encaqué dans ses préjugés, est la marque du ton et du style de Roorda, pédagogue et chroniqueur dont les titres de quelques œuvres sont assez explicites, à commencer par Le débourrage de crâne est-il possible ? ou Le pédagogue n’aime pas les enfants… Plus que tel ou tel essai séparé, c’est l’ensemble des Œuvres de Roorda, réunies en deux volumes, qu’il faut recommander à l’amateur de vues originales et roboratives, marquées du sceau d’un sens commun authentiquement démocrate et vivifiant. Henri Roorda. Œuvres, 2 vol. L’Age d’Homme, 1970.
Les sept vies de Louise Croisier née Moraz. – Mémorialiste patiemment documentée de ses familles paternelle et maternelle, Suzanne Deriex s’attache ici à la peinture d’une tribu vigneronne à Lavaux, dès la fin du XIXe siècle et sur une durée avoisinant le siècle, où s’entremêlent les tribulations personnelles de la protagoniste, Louise Moraz devenue Croisier, les multiples petites histoires de famille et les grands événements des époques successives. Portrait d’une femme et des siens, l’ouvrage fait également figure de chronique document la vie et les mentalités en mutation d’une région. Suzanne Deriex. Les sept vies de Louise Croisier née Moraz. L’aire, 1986. Poche Suisse, Nos 105-106.Le sourire de Mickey – Il y a quelque chose de panique dans le regard que l’auteur promène sur nos semblables plus ou moins empêtrés dans les embrouilles de la société contemporaine, où les modèles du battant et de la superwoman font figure de référence. Les personnages décrits dans ces nouvelles peinent à telle identification, à moins de s’aliéner comme ce couple pour lequel la naissance d’un enfant fait figure de péripétie « non appropriée ». Observateur redoutable des tics de comporteent ou de langage, dans la parenté d’un Michel Houellebecq, Antonin Moeri excelle à ressaisir, sous forme narraative, les névroses et les psychoses de l’homme actuel, sans trop le caricaturer. Antonin Moeri, Le Sourire de Mickey. Campiche, 2003.
La Suisse romande au cap du XXe siècle. – Le gai savoir a trouvé, en Alfred Berchtold, son plus généreux représentant helvétique, dont cette somme (avant une fresque consacrée à la civilisation bâloise et un livre exhaustif sur Guillaume Tell) est la première, éclatante illustration. Des sources protestantes, essentielles dans ce pays, à l’émergence de l’helvétisme, marqué par les courants romantiques européens, et jusqu’au tournant fondateur des Cahiers vaudois, l’historien se fait tour é tour conteur et critique littéraire pénétrant. Jamais sec ou pédant, ce livre aux synthèses magistrales et aux inoubliables portraits n’a pas pris une ride ! Alfred Berchtold. La Suisse romande au cap du XXe siècle. Payot, 1964.
Les Têtes – Ce pourrait n’être qu’une galerie de portraits littéraires, alors que l’art du prosateur à son extrême pointe, et la matière physique et psychique brassée font de cette suite de figures une admirable danse des vifs. D’un Henry Miller juste entrevu dans un café parisien, avec son museau de loup, au souvenir recomposé de Charles-Albert Cingria se relevant d’une chute en vélocipède, le front tatoué de bitume, l’auteur s’éloigne le plus souvent de la chose vue ou de l’anecdote contenue pour restituer chaque personnalité en vérité plus qu’en légende, sans se priver pour autant de l’invention révélatrice. Aux magnifiques évocations d’écrivains encore vivants (François Nourissier ou Maurice Chappaz) font pendant nombre de portraits posthumes. Or c’est aussi bien sous le signe de Yorick que l’écrivain se place, en quête de la « tête » essentielle de chacun. Jacques Chessex. Les têtes. Grasset, 2003.
Tout-y-va – Les derniers mots de ce petit ouvrage, tenant à la fois du journal (entre 1960 et 1962) et des mémoires, témoignent du regret de l’écrivain de n’avoir pu établir ses œuvres complètes, et c’est une mélancolie semblable qui imprègne cette suite très révélatrice de souvenirs (notamment sur la période des Cahiers vaudois) et de propos sur la vie et ses aléas. Alors que les écrits polémiques de Gilliard, tel L’école contre la vie, donnent l’impression d’une grande solidité, ce livre reflète plutôt la sensibilité complexe de l’homme se rappelant son enfance et ses multiples expériences. Edmond Gilliard. Tout-y-va. Trois collines, 1963.
Trois hommes dans une Talbot – On se rappelle la nonchalante navigation de Jerome K. Jerome en suivant Monsieur Paul et ses compères (Ramuz et le peintre Bischoff) à travers la France profonde, dont l’écrivain évoque les charmes avec autant de bonheur qu’il en a mis à croquer les multiples aspects de la Suisse. Cette pérégrination débonnaire se prolonge, aujourd’hui, grâce à la publication des Œuvres de Budry en trois forts volumes, à travers une foison de textes injustement oubliés et qui valent à la fois par leur contenu et la haute qualité de leur écriture. Paysages et artistes, littérature et motifs historiques ou contemporains, contes et chansons : tout fait miel à l’essayiste à la fois gourmand et raffiné, ondoyant et pénétrant, au poète et au prosateur. Paul Budry. Œuvres, 3 vol. Cahiers de la renaissance vaudoise, 2000.
La Venoge – Ce poème, illustrissime en nos régions, évoquant une douce et indécise rivière toute semblable à la mentalité vaudoise moyenne, ne saurait confiner son auteur dans la vaudoiserie complaisante à quoi d’aucuns réduisent son œuvre de chansonnier. L’ensemble de ses écrits permet en effet de (re)découvrir un conteur délicieux, toujours attentif à l’humanité bonne et au génie des lieux (son Paris est aussi présent que son pays de Vaud), un poète populaire aux merveilleux tableautins, mais également un critique virulent et un chroniqueur non moins vif de la vie contemporaine. Jean-Villard Gilles. Œuvres.
Le visage de l’homme – Au tournant de la quarantaine, l’auteur excelle dans le genre de la digression en mêlant notations très personnelles, voire privées, et considérations sur la culture ou sur le monde comme il va. Qu’il parle de la cervelle au beurre noir du Café Romand, du piano de Chopin que les cosaques jetèrent par la fenêtre (à propos de l’enterrement de Brejnev), d’un raid en avion sur le musée de Bale ou d’un malheureux croisé dans un café, bref de ce qui le remplit de joie, l’inquiète ou le révolte, le chroniqueur fait montre de la même maîtrise ressortissant à l’équilibre intérieur. Jil Silberstein. Le visage de l’homme. Le Temps qu’il fait, 1988.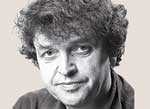 Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.
Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.(Cet abécédaire constitue la partie conclusive du livre intitulé Impressions d'un lecteur à Lausanne, paru en 2007 aux éditions Bernard Campiche)
-
Confidences
 Ils n’ont fait que murmurer à voix basse mais l’Artiste a tout entendu et tout retenu, tout démêlé qui restait avoué à demi-mot et tout ressenti comme il l’avait vu et saisi malgré les ombres demeurées, mais rien n’est expliqué pour autant et c’est ainsi et pas autrement que l’Artiste l’entend…Peinture Jean Fournier: Nature morte, huile sur toile 50 x 61, 1990. Pp LK / JLK.
Ils n’ont fait que murmurer à voix basse mais l’Artiste a tout entendu et tout retenu, tout démêlé qui restait avoué à demi-mot et tout ressenti comme il l’avait vu et saisi malgré les ombres demeurées, mais rien n’est expliqué pour autant et c’est ainsi et pas autrement que l’Artiste l’entend…Peinture Jean Fournier: Nature morte, huile sur toile 50 x 61, 1990. Pp LK / JLK. -
L'Ouvroir
(Trésor de JLK, II)«Il y a encore quand même beaucoup de bonté et de bonheur dans les coins».(Marcel Jouhandeau)°°°«La prose doit être un vers qui ne va pas à la ligne».«Il a un large nez au milieu du visage. C’est comme un coup de pied qu’on lui aurait donné, et dont il lui serait resté le pied».«Une phrase solide, comme construite avec des lettres d’enseigne en plomb découpé».(Jules Renard, Journal)°°°«Écris comme si tu étais en train de mourir. En même temps, dis-toi que tu écris pour un public uniquement composé de malades au stade terminal. Après tout, c’est le cas. Que commencerai-tu à écrire si tu savais que tu allais mourir bientôt ? Que pourrais-tu dire à un mourant pour ne pas le faire enrager par ta trivialité ? ».(Annie Dilllard)°°°« Ceux qui voient la moindre différence entre l’âme et le corps ne possèdent ni l’un ni l’autre ».(Oscar Wilde)°°°« Le pédalo est un trône à pédales, qui distingue l’homme du XXe siècle des Romains de l’Antiquité. Le pédalo permet au penseur de réaliser son double rêve : de ressembler à Louis XIV en même temps qu’à Louison Bobet ».(Alexandre Vialatte)°°°« Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».(Ludwig Wittgenstein)°°°« On dit des choses solides lorsqu’on ne cherche pas à en dire d’extraordinaires ».(Lautréamont)°°°« Là-haut » est une petite chambre sous le toit. Ce n’est qu’un matelas de quatre-vingts centimètres de large sous un Velux. Et ce n’est qu’un vieux corps nu qui, chaque jour, au milieu de la nuit, se glisse sous le drap, se glisse sous le ciel, se glisse sous la lune, se glisse sous les nuages qui passent, se glisse sous l’averse qui crépite. Si un jour je ne me rends pas là-haut, si un jour je ne me retranche pas des autres hommes, des malaises surviennent et l’envie de mourir remplace l’envie de fuir. Si je ne vais ne serait-ce qu’une seule heure là-haut, dans mon lit de silence, ne voyant que l’immense profondeur céleste par l’espèce de chien assis qui offre sa lumière à la page, mes maux se dissolvent, la paix gagne, l’âme s’ouvre, je ne souffre plus de rien, je m’oublie, l’intérieur de la tête non seulement se dégrise mais s’effrite, mon âme devient transparente, translucide, sinon lucide, sinon devineresse.Siècles, familles, enfants, nations se dissolvent là-haut. Page du ciel toujours lisible entre les tuiles et les rebords de zinc ».(Pascal Quignard)°°°« Tâchons de voir un peu clair en Dieu ».(Jules Renard, Journal)°°°« Grand-mère et petits-enfants : pas la plus profonde, mais la plus belle, la plus humaine des relations sur terre ».(Peter Sloterdijk)°°°« L’éducation est une chose admirable. Mais il est bon de se souvenir de temps à autre que rien de ce qui mérite d’être su ne peut s’enseigner ».(Oscar Wilde)°°°« Pensé une fois de plus, hier soir, au lit, que la bonté est peut-être la plus haute forme de poésie ».« Cette vieille paysanne disant à sa fille, au moment de mourir : «Sois tranquille, on se téléphonera ».(Georges Haldas)°°°« Je ne souffle mot Je regarde par la fenêtre Venise. Venise. Reflets insolites dans l'eau de la lagune. Micassures et reflets glissants dans les vitrines et sur le parquet en mosaïque de la Bibliothèque Saint-Marc. Le soleil est comme une perle baroque dans la brume plombagine qui se lève derrière les façades des palais du front de l'eau et annonce du mauvais temps au large, crachin, pluies, vents et tempête. Je ne souffle mot».(Blaise Cendrars, Bourlinguer)Aquarelle JK: Solitude. -
Ceux qui sont partout chez eux
 Celui qui se sent partout étranger y compris dans son lit quand il est seul / Celle qui vous dit faites comme chez vous sans se douter que ça risque de craindre / Ceux qui pigent l'accent de partout où ils jactent /Celui qui a appris à se concentrer sur ce qu'il apprend / Celle qui lit quelque part que "la rue dit la vérité" / Ceux qui pensent que la rue "dit la rue" / Celui qui se laisse volontiers dérouter par les indications erronnées comme ce matin-là à Tôkyo tu t'es fais envoyer à Okinawa alors que tu demandais ton chemin pour Ginza / Celui qui passe sa journeé de retraité coréen à ramener à la maison des enfants perdus dans la gare de Shinjuku /Celle qui fait du strip-éclair dansle métro de Shangai où son oncle a juste le tems de faire la quête / Ceux qui suspendus à leur poignée avaient l'air de chauve-souris ce matin-là dans le métro de Tôkyo / Celui (prénom Philippe,de père égyptien) qui constate que "les heures glissent du gris vers un gris plus sombre" / Celle qui se rappelle que le smog de Los Angeles te colle aux dents comme un vieux caramel / Ceux qui se disent qu'avec tant de câbles le ciel ne va pas s'envoler / Celui qui a cru voir Jésus-Christ au coin de la rue où il a disparu / Celle qui remarque que ce qui rassure chez Bouddha est son ventre à rebonds / Ceux qui s'attardent dans le quartier de la Goutte d'or à l'observation de détails curieux genre le griot en vélosolex / Celui qui se demande comment un homme peut en arriver à poignarder son enfant chéri de pas un an / Celle qui a vu le déploiement des "collaborateurs" de l'unité spéciale du DARD dans le quartier où rien n'était censé se passer comme à la télé mais aujourd'hui faut s'attendre à tout dit-elle à Madame Paccaud sortie sur le palier / Ceux qui se passent un clip de Madonna sur leur smartphone /Celui qui a appris à se faire des cataplasmes de blancs d'oeufs chez le même initié qui lui a rappelé les vertus de la compresse de feuille de chou / Celle qui constate que l'homme dégradé est aussi biodégradable que certains produits quoique laissant quelques déchets carnés / Ceux qui voient la mégapole s'éteindre à 21 heures pile / Celui qu'on emporte dans une housse grise et lisse comme la nuit de Kafka / Celle qui se rappelle le goût particulier des lèvres du jeune Gustav Janouch / Ceux qui préfèrent se taire faute de pouvoir aider, etc.
Celui qui se sent partout étranger y compris dans son lit quand il est seul / Celle qui vous dit faites comme chez vous sans se douter que ça risque de craindre / Ceux qui pigent l'accent de partout où ils jactent /Celui qui a appris à se concentrer sur ce qu'il apprend / Celle qui lit quelque part que "la rue dit la vérité" / Ceux qui pensent que la rue "dit la rue" / Celui qui se laisse volontiers dérouter par les indications erronnées comme ce matin-là à Tôkyo tu t'es fais envoyer à Okinawa alors que tu demandais ton chemin pour Ginza / Celui qui passe sa journeé de retraité coréen à ramener à la maison des enfants perdus dans la gare de Shinjuku /Celle qui fait du strip-éclair dansle métro de Shangai où son oncle a juste le tems de faire la quête / Ceux qui suspendus à leur poignée avaient l'air de chauve-souris ce matin-là dans le métro de Tôkyo / Celui (prénom Philippe,de père égyptien) qui constate que "les heures glissent du gris vers un gris plus sombre" / Celle qui se rappelle que le smog de Los Angeles te colle aux dents comme un vieux caramel / Ceux qui se disent qu'avec tant de câbles le ciel ne va pas s'envoler / Celui qui a cru voir Jésus-Christ au coin de la rue où il a disparu / Celle qui remarque que ce qui rassure chez Bouddha est son ventre à rebonds / Ceux qui s'attardent dans le quartier de la Goutte d'or à l'observation de détails curieux genre le griot en vélosolex / Celui qui se demande comment un homme peut en arriver à poignarder son enfant chéri de pas un an / Celle qui a vu le déploiement des "collaborateurs" de l'unité spéciale du DARD dans le quartier où rien n'était censé se passer comme à la télé mais aujourd'hui faut s'attendre à tout dit-elle à Madame Paccaud sortie sur le palier / Ceux qui se passent un clip de Madonna sur leur smartphone /Celui qui a appris à se faire des cataplasmes de blancs d'oeufs chez le même initié qui lui a rappelé les vertus de la compresse de feuille de chou / Celle qui constate que l'homme dégradé est aussi biodégradable que certains produits quoique laissant quelques déchets carnés / Ceux qui voient la mégapole s'éteindre à 21 heures pile / Celui qu'on emporte dans une housse grise et lisse comme la nuit de Kafka / Celle qui se rappelle le goût particulier des lèvres du jeune Gustav Janouch / Ceux qui préfèrent se taire faute de pouvoir aider, etc. -
La musique des jours
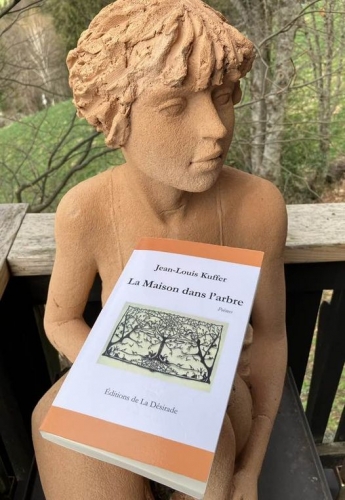 À propos de La Maison dans l'Arbre, triptyque poétique de JLK.par Francis Vladimir« La maison bleue adossée à la colline que chantait Maxime Le Forestier. L’enfant bleu, le roman de Henri Bauchau. La chambre du fils, film de Nanni Moretti, l’incompris, film de Luigi Comencini, L’innocent Film de Luchino Visconti, Amarcord, film de Fédérico Fellini, et sans raison apparente, Le goût de la cerise, film d’Abbas Kiarostami pour sa chronique d’une mort annoncée comme la diagonale du fou sur le grand échiquier. Du pouvoir des mots, de leur persuasion et de leur dissuasion, de leur transmutation sur l’écran de nos nuits blanches. La ligne de crête d’un si bien nommé « La maison dans l’arbre » de JLK.1. La chambre de l’enfant. - Entrons en poésie à la faveur du souvenir, de l’enfance, des lieux inspirants de la mémoire, des déambulations au pays de l’innocence dont le livre est un cheminement vers la source, l’origine, le trou noir, le centre de gravité d’où tout s’en vient et s’en revient, un peu comme le marcheur solitaire arpente les mêmes sentes en partant de chez lui, de sa propre maison, pour s’émerveiller, se rembrunir et chialer les perles de la transparence, jusqu’à se retrouver en un pays familier et lointain, reconnaissable et inconnu à la fois. En ce que je nommerai son premier tiers, par malice, la randonnée dans l’intime, mais que sait autrement faire le poète que de se dire maintes et maintes fois, se redire et se dédire, dans l’acuité de ses mots et au bout de lui-même, à bout de souffle, la poitrine creusée, haletante, le front froncé, les yeux emplis d’horizon. Ce qui pourrait être repli sur soi devient ouverture, remontée à la source et l’on entend le filet d’eau en jaillir « La musique, la poésie/ la pensée incarnée/ campent aux quatre vents/ de la terre et des feux /des sourciers inspirés… » Le sang du poète pulse dans cette ferveur accordée aux éléments, dans leur tourment, tornade, séisme, incendie et au bout dans le rû d’eau… claire, la première eau du monde, celle du premier jour. Comme un voleur de feu, capteur de mots, le poète se révèle à nous, à ses enfants qu’il aura observés dans leur mutines et polissonnes échappées, dans l’enfance, retournée comme un linge de corps, vers laquelle il revient, pas à pas, muet et contrit car dire ses premières années c’est tomber dans les orties, y sentir les picotements, les menues brûlures, pour estourbir sa douleur, serrer les dents et se relever car « tu ne sais ce qui t’a élu/ le sacré est en toi/ et les mots peut-être advenus/ ne te trahirons pas… ».Et l’enfant va en chemin inconnu « dans la patience sans raison/ de ce qu’il ne sait pas ». On ne saurait mieux dire l’enfant, son insatiable demande du monde et son observance têtue des adultes. Et le poète s’obstine à dire cette enfance recluse dans la mémoire, dans les images lointaines déposées dans l’écrin si lourd des secrets enfouis parce qu’à les effleurer serait s’y perdre à nouveau. Ce nécessaire du poète, il lui faudra le dire, tremper sa plume dans l’encrier des mots : « L’encre est en somme la mer/ aux cheveux bleus et verts/ plus vieille que le vieil Homère/ Plus légère que l’air… » Mais c’est, qui sait, revenir vers soi, se retrouver soi quand «Tout se transforme à vue/ la joie m’est fortin de douceur ».Car la joie n’est jamais aussi proche dans cette alliance du mot et du dire, dans l’apaisement : « Crois-donc en moi dit le nuage à l’enfant qui repose/ et je ferai de toi le sage ami de toute chose ». Et si le poème estampille les choses de la vie, c’est pour cerner la déraison, notre douce folie, notre songeuse éternité. Les jeux interdits de l’enfance, sacrés comme un vieux film tant aimé, une escapade au pays des indiens, comme dans les livres d’images, ces premières Bandes dessinées décolorées par le temps « On remonte le long du ruisseau/ avec les indiens bleus/ les camarades saligauds / les cavaliers de feu / fringants et fumants aux naseaux… » on part sans boussole lorsqu’on est un enfant « Une boussole nous manquait/ à tous deux ce matin/ d’aube neuve au lancer du chemin… ».Feu-follet ou Ariel, « il a été et il sera… il sourit à la vie comme elle est. » De l’enfance, que gardons-nous dans la poitrine, là où naît la rébellion ou la gêne, cette respiration altérée, prise en défaut de souffle égal et apaisé ? Nos premières révoltes, nos premières expériences sensuelles, la découverte des autres, leur amitié et leur inimitié, les attirances et les rejets, la peur de l’inconnu, les premières douleurs, la fierté bravache, la honte bue, la fugue de nous-mêmes. Et la parole dans tout ça, celle de l’enfant prodigue ou de l’enfant sauvage « Je ne sais que te dire/ il n’y a pas d’explication : ce n’est qu’un fait divers/ pas plus que la beauté cela n’est défini… sais-tu si l’arbre s’en souvient ? » Et nous irons par les chemins d’infortune « Partout où je suis retombé/ dans mes jours vagabonds/ du ciel des mots rêvés/ au quotidien banal/ de Balbec à Cabourg/ j’aurai recomposé/ mon désordre vital… ».Une pincée de surréalisme n’est jamais de trop pour le poète démis de sa sagesse antique « Le sage ne fait que songer/ à l’insu des horaires/ et comme l’ancien initié/ qui préférait se taire/ il ne fait qu’éprouver/ l’étrange apesanteur/ des oiseaux dont rêve le chien/ quand il nage entre les nuages… » Aux agités de la vie JLK recommande dans le rêve du chien : « la paisible assurance/ de la divine indifférence ». Rêver à perdre la raison, ce serait rêver par temps de chien, perdre sa tête dans un nuage en pantalon…Trouver sa place, sa juste place « Je navigue à l’étoile/ sur le clavier muet/ où dès enfant je m’exerçais/ à l’écart de l’écart/ au milieu juste du milieu ». Passager de la nuit, ange ou démon en sommeil, que sont donc les enfants d’aujourd’hui, qu’était l’enfant d’hier, la chambre en son miroir dit que « les enfants, là-bas, en chemin/ savent que dans les bois/ le mal rôde, et que le cœur humain/ se trempe dans la fraude/ ou plus qu’ils ne le savent, au vrai/ ils le sentent et pressentent/ le faux sous le masque du vrai… »Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille….2. La maison dans l’arbre. – « Ma douceur, il n’est que toi pour me délivrer/ de cette peur ancienne de je ne sais trop quoi… » De la cabane au fond des bois à la maison dans les arbres. La maison suspendue entre ciel et terre. La maison refuge, la maison antre, la maison des délices, la maison des caprices, la maison carioca… ou la maison du bonheur, la maison rêvée. La vie rêvée des anges. Ceux qui adviennent à tout âge et en toute saison et en tout lieu où que nos pas nous portent et où la vie incertaine toujours nous dépose. Sur la grève, dans un pré, au milieu des labours, face à la mer, sur la crête, au bord de l’abîme, le temps d’une vie se décompte quand « le sombre et le clair tissent nos instants ».Une tapisserie, la vie à monter sur sa trame avec l’ardeur de Pénélope, son doux sourire grave, son espoir en miettes, son désespoir donc sans lequel l’histoire d’amour eût été incomplète. Et passent les saisons, les années et les cœurs qui s’envolent, l’oiseau qui vient du large et qui, à tire- d’aile, tournoie en bon augure ou en tragique signe. Dans ce balancement, cette constante hésitation de l’être qui fulmine ou de l’être qui danse, avec son cœur, avec son corps, au tambour de son âme et se rappelle « Le cœur à vif, les mots fous, les années Rimbaud… » Et le poète ajoute« Notre savoir est en Lambeaux/ dans le roncier des preuves ».La matinée s’éveille pourtant sur tout ce qui a été glané au fil des ans avec sa récolte de souvenirs, de teintes ravivées, les couleurs vives de l’été, le nuancier de l’ailleurs, le détail d’une scène comme un tableau impressionniste, et des poèmes ramassés à la pelle dans le souvenir heureux ou les lambris du temps. Ainsi, dans sa maison dans les arbres, voici que le poète tire sa corbeille emplie à ras bord de toutes les années passées avec leur montagne de souvenirs, de rencontres, de regards, dans l’ici et l’ailleurs, dans le cercle de l’intime et dans l’au-delà de soi. Et le poète toujours aime à en rajouter, c’est qu’il tient la corde de son arc, celui du désir de dire, pour tendre ses mots et les lâcher sans autre forme de procès, sans avertissement. Et s’il y a pêche miraculeuse comme un enfant désarçonné il se dit : « Que faire de tout cela ? / se demande-t-il donc/ en scrutant du regard/ ce pays de Lui-même… ». La matinée s’estompe dans les ombres claires du poème là où « les arbres sans attente/ veillent aux nuits d’été… » et « on ne saura jamais/ d’où vient le chant du soir ».Le poète se joue de lui et s’amuse du temps passé et du temps retrouvé et dans une recherche toute proustienne, assumée sans ambages, avec cette coquetterie inavouable que tout bel et tendre et rude écrivain garde comme un joker « La terrible douleur/ de n’être pas aimé/ ou tout faire pour ne l’être pas/ quand ce ne serait pas assez » car, comment dire, sous le bourru parfois, pointe la tendresse, toute en retenue comme une pointe de fleur de sel amertumise à peine les choses de la vie, les rendant plus proches, plus amicales, plus caressantes, une petite pincée pour accompagner et s’accompagner, rendre moins fade.C’est à cela que s’essaye JLK. Il se tient là, au bas de son arbre, la tête dans le feuillage, invitation muette lancée à qui veut l’entendre, pour visiter sa maison dans les arbres. Et qu’elle ne soit qu’une imagination suspendue où cachée dans une forêt touffue, à l’orée des regards indiscrets, qu’importe si le lecteur en decouvre dans le ravissement qu’aurait pu en avoir Lol V. Stein, le portail d’entrée, l’échelle suspendue, le toit canopée.Dans sa longue marche vers le poème JLK ouvre grand les bras, décille nos regards, désencombre nos âmes, désarticule nos paresses. De bruit et de fureur, le monde s’enkyste et saigne. Charlie, Le Bataclan, Nice… « C’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain ». Et l’on se prend à croire en des lieux d’amitié naturelle, des lieux de rencontres mêlées, des lieux de doux apaisements.Et le poète, ce sourcier du regard va de l’avant, toujours – « Tu ne te lasses pas/ ni ne cèdes à l’oubli…/ Tout noter, tout noter/ ce grand nègre princier/ c’est l’homme simplement/ sur la terre exilé/ ou la vieille esseulée/ Tout noter : les objets/ qui nous cachent du temps / Tout ce qui est caché/ ce qu’on voit sans le voir/ Tout ce qui est usé/ ton regard le répare…/ Tout noter : la lumière/ et l’humble vérité/ l’aura de ce mystère ». Tout noter, tout noter, absorber le monde pour en dire l’infime et son immensité, ses silences et ses terreurs, sa présence et son néant. D’où que vienne le poème, d’où qu’il s’écrive, de son rapport à l’autre, de son rapport à soi, dans la chair et la sueur, dans la joie ou l’amertume, il y aura ailleurs ou sous nos yeux, la maison dans les arbres plongée dans la pénombre, soumise aux grands éclairs. Le poète transi y trouvera refuge, protection, réparation. Cathédrale de la douleur où le dit redevient baume, souffle, brise, parfum, effluve d’amour « je me sens si léger de me savoir à toi.» Et j’ajouterai de mon fait : je me sens si heureux d’être dans ta présence.3.Le chemin sur la mer. – Ou le dernier chemin, celui que suivit Walter Benjamin de Port-Vendres à Port-bou en Espagne, un 25 septembre 1940, retrouvé ici dans Sans issue.Ce troisième volet du recueil recentre le poète dans ses amitiés inaltérables, celles qu’il s’est choisies, en dépit des années qui vont passant et qui, par le jeu de la mémoire et de l’affect, renforcent la présence de nos chers disparus.Au jeu de la ressouvenance l’aimée s’inscrit en creux dans la caresse du poème, dans l’incertitude de la séparation « Le moment n’était pas venu/ de nous dire au-revoir/ Le moment se tenait sur ce quai de hasard/ où le temps attendait/ quelque train de retard… » Et la mémoire si elle se joue de nous convoque des lieux magiques, des lieux de retrouvailles et de promenades pour toujours partagées « À Venise nous étions trois/ à nous tourner autour/ la solitude, l’amitié et l’amour… » Et le cœur se cadence au clapotis de l’eau et sur le quai, face aux embruns déchirés dans le miroir de l’eau, l’ironie, la moquerie de soi « Tu m’avais dit que tu m’attendais chez Florian/ mais il n’était pas dans l’annuaire/ et tu t’es moqué… »De cette fragilité, de cette timidité dénuée de rouerie, naît la mélancolie, la rêverie « Le vieux flûtiste est mort/ on n’entendra plus dans les bois/ le temps de le pleurer/ les roulades du rossignol ». Le rossignol se tait à l’aube, le dernier livre d’Elsa Triolet. Un livre tourné vers le silence. Il y a dans ce Chemin sur la mer, une annonciation mortelle, indécente presque, d’un ordre qui nous emportera tous, un jour prochain.La mort, la malnommée, la calomniée, le virus indécent, qui dans la déraison de son propre nom, taraude le poème, le porte ailleurs de ce qu’il ose dire ou entreprendre, le transplante, plus loin que la ville, plus loin que la forêt, plus loin que la mer, au-dessus des montagnes. Cette particularité de la poster tout près, et prête à tout, en embuscade, cela clarifie, dénude, désosse la poésie de JLK qui a ses côtés sombres, ses affinités électives, ses accrocs, ses écorchures, ses saignements, sa douleur éclatée, ses attentes et ses absences, mais aussi des joies souveraines, simples et arborées comme un gamin s’amuse à parader pour qu’on le reconnaisse.Il y a, nonobstant la diversité des poèmes et le brassage du temps, une unité, une colonne vertébrale, une arborescence qui soutient le tout afin que la maison dans les arbres, si elle tangue au plus fort des tempêtes, ne sombre jamais.Et c’est le cœur chaviré qui souvent s’invite chez JLK, dans cette poésie de l’approche amicale, de l’exigence du dire, de l’affleurement et de l’agencement des mots qui eux, toujours, se plaisent à s’égarer, à partir autre part, là où on ne les attend pas et s’il plaît à JLK d’avoir son art poétique, il précise en un clin d’œil à Arthur « Le plus simple et le plus limpide/ sera notre façon…».Par tant de mots lâchés à la lisière de notre entendement, sous nos yeux fureteurs à l’envi, des bleus à l’âme au bleu des mots, la grâce est intranquille, indécise ou inquiète, un rien émerveillée « Rien n’est sûr que cette inquiétude/ qui les tient éveillés/ rien ne dit que cet interlude/ entre le tout et les riens/ à la fin ne les résumait/ amoureux et sereins… »Sérénité retrouvée à laquelle JLK aspire et ce faisant il nous embarque dans ses voyages, au trot et au trop du poème, sur sa barque traversière, en toute béatitude et mansuétude pour que l’arbre et la maison reste dans le bleu, la couleur bleue qui colore le recueil, à sa suite harmonique avec les menues indications qu’il sème de ci de là en légères dédicaces participant ainsi, pour le lecteur, d’une reconnaissance, d’une main tendue, d’une tablée commune, que le poète toujours se plaît à ne pas refuser. « Nous serons comme des lucioles/ dans vos prochaines villes/ à l’orée des grands bois/ où survivent les oubliés/ et puissiez-vous entendre/ de nos voix le murmure/ puissent nos mots vous apaiser… »F.V.Jean-Louis Kuffer, La Maison dans l'arbre. Editions de La Désirade, 276p.
À propos de La Maison dans l'Arbre, triptyque poétique de JLK.par Francis Vladimir« La maison bleue adossée à la colline que chantait Maxime Le Forestier. L’enfant bleu, le roman de Henri Bauchau. La chambre du fils, film de Nanni Moretti, l’incompris, film de Luigi Comencini, L’innocent Film de Luchino Visconti, Amarcord, film de Fédérico Fellini, et sans raison apparente, Le goût de la cerise, film d’Abbas Kiarostami pour sa chronique d’une mort annoncée comme la diagonale du fou sur le grand échiquier. Du pouvoir des mots, de leur persuasion et de leur dissuasion, de leur transmutation sur l’écran de nos nuits blanches. La ligne de crête d’un si bien nommé « La maison dans l’arbre » de JLK.1. La chambre de l’enfant. - Entrons en poésie à la faveur du souvenir, de l’enfance, des lieux inspirants de la mémoire, des déambulations au pays de l’innocence dont le livre est un cheminement vers la source, l’origine, le trou noir, le centre de gravité d’où tout s’en vient et s’en revient, un peu comme le marcheur solitaire arpente les mêmes sentes en partant de chez lui, de sa propre maison, pour s’émerveiller, se rembrunir et chialer les perles de la transparence, jusqu’à se retrouver en un pays familier et lointain, reconnaissable et inconnu à la fois. En ce que je nommerai son premier tiers, par malice, la randonnée dans l’intime, mais que sait autrement faire le poète que de se dire maintes et maintes fois, se redire et se dédire, dans l’acuité de ses mots et au bout de lui-même, à bout de souffle, la poitrine creusée, haletante, le front froncé, les yeux emplis d’horizon. Ce qui pourrait être repli sur soi devient ouverture, remontée à la source et l’on entend le filet d’eau en jaillir « La musique, la poésie/ la pensée incarnée/ campent aux quatre vents/ de la terre et des feux /des sourciers inspirés… » Le sang du poète pulse dans cette ferveur accordée aux éléments, dans leur tourment, tornade, séisme, incendie et au bout dans le rû d’eau… claire, la première eau du monde, celle du premier jour. Comme un voleur de feu, capteur de mots, le poète se révèle à nous, à ses enfants qu’il aura observés dans leur mutines et polissonnes échappées, dans l’enfance, retournée comme un linge de corps, vers laquelle il revient, pas à pas, muet et contrit car dire ses premières années c’est tomber dans les orties, y sentir les picotements, les menues brûlures, pour estourbir sa douleur, serrer les dents et se relever car « tu ne sais ce qui t’a élu/ le sacré est en toi/ et les mots peut-être advenus/ ne te trahirons pas… ».Et l’enfant va en chemin inconnu « dans la patience sans raison/ de ce qu’il ne sait pas ». On ne saurait mieux dire l’enfant, son insatiable demande du monde et son observance têtue des adultes. Et le poète s’obstine à dire cette enfance recluse dans la mémoire, dans les images lointaines déposées dans l’écrin si lourd des secrets enfouis parce qu’à les effleurer serait s’y perdre à nouveau. Ce nécessaire du poète, il lui faudra le dire, tremper sa plume dans l’encrier des mots : « L’encre est en somme la mer/ aux cheveux bleus et verts/ plus vieille que le vieil Homère/ Plus légère que l’air… » Mais c’est, qui sait, revenir vers soi, se retrouver soi quand «Tout se transforme à vue/ la joie m’est fortin de douceur ».Car la joie n’est jamais aussi proche dans cette alliance du mot et du dire, dans l’apaisement : « Crois-donc en moi dit le nuage à l’enfant qui repose/ et je ferai de toi le sage ami de toute chose ». Et si le poème estampille les choses de la vie, c’est pour cerner la déraison, notre douce folie, notre songeuse éternité. Les jeux interdits de l’enfance, sacrés comme un vieux film tant aimé, une escapade au pays des indiens, comme dans les livres d’images, ces premières Bandes dessinées décolorées par le temps « On remonte le long du ruisseau/ avec les indiens bleus/ les camarades saligauds / les cavaliers de feu / fringants et fumants aux naseaux… » on part sans boussole lorsqu’on est un enfant « Une boussole nous manquait/ à tous deux ce matin/ d’aube neuve au lancer du chemin… ».Feu-follet ou Ariel, « il a été et il sera… il sourit à la vie comme elle est. » De l’enfance, que gardons-nous dans la poitrine, là où naît la rébellion ou la gêne, cette respiration altérée, prise en défaut de souffle égal et apaisé ? Nos premières révoltes, nos premières expériences sensuelles, la découverte des autres, leur amitié et leur inimitié, les attirances et les rejets, la peur de l’inconnu, les premières douleurs, la fierté bravache, la honte bue, la fugue de nous-mêmes. Et la parole dans tout ça, celle de l’enfant prodigue ou de l’enfant sauvage « Je ne sais que te dire/ il n’y a pas d’explication : ce n’est qu’un fait divers/ pas plus que la beauté cela n’est défini… sais-tu si l’arbre s’en souvient ? » Et nous irons par les chemins d’infortune « Partout où je suis retombé/ dans mes jours vagabonds/ du ciel des mots rêvés/ au quotidien banal/ de Balbec à Cabourg/ j’aurai recomposé/ mon désordre vital… ».Une pincée de surréalisme n’est jamais de trop pour le poète démis de sa sagesse antique « Le sage ne fait que songer/ à l’insu des horaires/ et comme l’ancien initié/ qui préférait se taire/ il ne fait qu’éprouver/ l’étrange apesanteur/ des oiseaux dont rêve le chien/ quand il nage entre les nuages… » Aux agités de la vie JLK recommande dans le rêve du chien : « la paisible assurance/ de la divine indifférence ». Rêver à perdre la raison, ce serait rêver par temps de chien, perdre sa tête dans un nuage en pantalon…Trouver sa place, sa juste place « Je navigue à l’étoile/ sur le clavier muet/ où dès enfant je m’exerçais/ à l’écart de l’écart/ au milieu juste du milieu ». Passager de la nuit, ange ou démon en sommeil, que sont donc les enfants d’aujourd’hui, qu’était l’enfant d’hier, la chambre en son miroir dit que « les enfants, là-bas, en chemin/ savent que dans les bois/ le mal rôde, et que le cœur humain/ se trempe dans la fraude/ ou plus qu’ils ne le savent, au vrai/ ils le sentent et pressentent/ le faux sous le masque du vrai… »Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille….2. La maison dans l’arbre. – « Ma douceur, il n’est que toi pour me délivrer/ de cette peur ancienne de je ne sais trop quoi… » De la cabane au fond des bois à la maison dans les arbres. La maison suspendue entre ciel et terre. La maison refuge, la maison antre, la maison des délices, la maison des caprices, la maison carioca… ou la maison du bonheur, la maison rêvée. La vie rêvée des anges. Ceux qui adviennent à tout âge et en toute saison et en tout lieu où que nos pas nous portent et où la vie incertaine toujours nous dépose. Sur la grève, dans un pré, au milieu des labours, face à la mer, sur la crête, au bord de l’abîme, le temps d’une vie se décompte quand « le sombre et le clair tissent nos instants ».Une tapisserie, la vie à monter sur sa trame avec l’ardeur de Pénélope, son doux sourire grave, son espoir en miettes, son désespoir donc sans lequel l’histoire d’amour eût été incomplète. Et passent les saisons, les années et les cœurs qui s’envolent, l’oiseau qui vient du large et qui, à tire- d’aile, tournoie en bon augure ou en tragique signe. Dans ce balancement, cette constante hésitation de l’être qui fulmine ou de l’être qui danse, avec son cœur, avec son corps, au tambour de son âme et se rappelle « Le cœur à vif, les mots fous, les années Rimbaud… » Et le poète ajoute« Notre savoir est en Lambeaux/ dans le roncier des preuves ».La matinée s’éveille pourtant sur tout ce qui a été glané au fil des ans avec sa récolte de souvenirs, de teintes ravivées, les couleurs vives de l’été, le nuancier de l’ailleurs, le détail d’une scène comme un tableau impressionniste, et des poèmes ramassés à la pelle dans le souvenir heureux ou les lambris du temps. Ainsi, dans sa maison dans les arbres, voici que le poète tire sa corbeille emplie à ras bord de toutes les années passées avec leur montagne de souvenirs, de rencontres, de regards, dans l’ici et l’ailleurs, dans le cercle de l’intime et dans l’au-delà de soi. Et le poète toujours aime à en rajouter, c’est qu’il tient la corde de son arc, celui du désir de dire, pour tendre ses mots et les lâcher sans autre forme de procès, sans avertissement. Et s’il y a pêche miraculeuse comme un enfant désarçonné il se dit : « Que faire de tout cela ? / se demande-t-il donc/ en scrutant du regard/ ce pays de Lui-même… ». La matinée s’estompe dans les ombres claires du poème là où « les arbres sans attente/ veillent aux nuits d’été… » et « on ne saura jamais/ d’où vient le chant du soir ».Le poète se joue de lui et s’amuse du temps passé et du temps retrouvé et dans une recherche toute proustienne, assumée sans ambages, avec cette coquetterie inavouable que tout bel et tendre et rude écrivain garde comme un joker « La terrible douleur/ de n’être pas aimé/ ou tout faire pour ne l’être pas/ quand ce ne serait pas assez » car, comment dire, sous le bourru parfois, pointe la tendresse, toute en retenue comme une pointe de fleur de sel amertumise à peine les choses de la vie, les rendant plus proches, plus amicales, plus caressantes, une petite pincée pour accompagner et s’accompagner, rendre moins fade.C’est à cela que s’essaye JLK. Il se tient là, au bas de son arbre, la tête dans le feuillage, invitation muette lancée à qui veut l’entendre, pour visiter sa maison dans les arbres. Et qu’elle ne soit qu’une imagination suspendue où cachée dans une forêt touffue, à l’orée des regards indiscrets, qu’importe si le lecteur en decouvre dans le ravissement qu’aurait pu en avoir Lol V. Stein, le portail d’entrée, l’échelle suspendue, le toit canopée.Dans sa longue marche vers le poème JLK ouvre grand les bras, décille nos regards, désencombre nos âmes, désarticule nos paresses. De bruit et de fureur, le monde s’enkyste et saigne. Charlie, Le Bataclan, Nice… « C’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain ». Et l’on se prend à croire en des lieux d’amitié naturelle, des lieux de rencontres mêlées, des lieux de doux apaisements.Et le poète, ce sourcier du regard va de l’avant, toujours – « Tu ne te lasses pas/ ni ne cèdes à l’oubli…/ Tout noter, tout noter/ ce grand nègre princier/ c’est l’homme simplement/ sur la terre exilé/ ou la vieille esseulée/ Tout noter : les objets/ qui nous cachent du temps / Tout ce qui est caché/ ce qu’on voit sans le voir/ Tout ce qui est usé/ ton regard le répare…/ Tout noter : la lumière/ et l’humble vérité/ l’aura de ce mystère ». Tout noter, tout noter, absorber le monde pour en dire l’infime et son immensité, ses silences et ses terreurs, sa présence et son néant. D’où que vienne le poème, d’où qu’il s’écrive, de son rapport à l’autre, de son rapport à soi, dans la chair et la sueur, dans la joie ou l’amertume, il y aura ailleurs ou sous nos yeux, la maison dans les arbres plongée dans la pénombre, soumise aux grands éclairs. Le poète transi y trouvera refuge, protection, réparation. Cathédrale de la douleur où le dit redevient baume, souffle, brise, parfum, effluve d’amour « je me sens si léger de me savoir à toi.» Et j’ajouterai de mon fait : je me sens si heureux d’être dans ta présence.3.Le chemin sur la mer. – Ou le dernier chemin, celui que suivit Walter Benjamin de Port-Vendres à Port-bou en Espagne, un 25 septembre 1940, retrouvé ici dans Sans issue.Ce troisième volet du recueil recentre le poète dans ses amitiés inaltérables, celles qu’il s’est choisies, en dépit des années qui vont passant et qui, par le jeu de la mémoire et de l’affect, renforcent la présence de nos chers disparus.Au jeu de la ressouvenance l’aimée s’inscrit en creux dans la caresse du poème, dans l’incertitude de la séparation « Le moment n’était pas venu/ de nous dire au-revoir/ Le moment se tenait sur ce quai de hasard/ où le temps attendait/ quelque train de retard… » Et la mémoire si elle se joue de nous convoque des lieux magiques, des lieux de retrouvailles et de promenades pour toujours partagées « À Venise nous étions trois/ à nous tourner autour/ la solitude, l’amitié et l’amour… » Et le cœur se cadence au clapotis de l’eau et sur le quai, face aux embruns déchirés dans le miroir de l’eau, l’ironie, la moquerie de soi « Tu m’avais dit que tu m’attendais chez Florian/ mais il n’était pas dans l’annuaire/ et tu t’es moqué… »De cette fragilité, de cette timidité dénuée de rouerie, naît la mélancolie, la rêverie « Le vieux flûtiste est mort/ on n’entendra plus dans les bois/ le temps de le pleurer/ les roulades du rossignol ». Le rossignol se tait à l’aube, le dernier livre d’Elsa Triolet. Un livre tourné vers le silence. Il y a dans ce Chemin sur la mer, une annonciation mortelle, indécente presque, d’un ordre qui nous emportera tous, un jour prochain.La mort, la malnommée, la calomniée, le virus indécent, qui dans la déraison de son propre nom, taraude le poème, le porte ailleurs de ce qu’il ose dire ou entreprendre, le transplante, plus loin que la ville, plus loin que la forêt, plus loin que la mer, au-dessus des montagnes. Cette particularité de la poster tout près, et prête à tout, en embuscade, cela clarifie, dénude, désosse la poésie de JLK qui a ses côtés sombres, ses affinités électives, ses accrocs, ses écorchures, ses saignements, sa douleur éclatée, ses attentes et ses absences, mais aussi des joies souveraines, simples et arborées comme un gamin s’amuse à parader pour qu’on le reconnaisse.Il y a, nonobstant la diversité des poèmes et le brassage du temps, une unité, une colonne vertébrale, une arborescence qui soutient le tout afin que la maison dans les arbres, si elle tangue au plus fort des tempêtes, ne sombre jamais.Et c’est le cœur chaviré qui souvent s’invite chez JLK, dans cette poésie de l’approche amicale, de l’exigence du dire, de l’affleurement et de l’agencement des mots qui eux, toujours, se plaisent à s’égarer, à partir autre part, là où on ne les attend pas et s’il plaît à JLK d’avoir son art poétique, il précise en un clin d’œil à Arthur « Le plus simple et le plus limpide/ sera notre façon…».Par tant de mots lâchés à la lisière de notre entendement, sous nos yeux fureteurs à l’envi, des bleus à l’âme au bleu des mots, la grâce est intranquille, indécise ou inquiète, un rien émerveillée « Rien n’est sûr que cette inquiétude/ qui les tient éveillés/ rien ne dit que cet interlude/ entre le tout et les riens/ à la fin ne les résumait/ amoureux et sereins… »Sérénité retrouvée à laquelle JLK aspire et ce faisant il nous embarque dans ses voyages, au trot et au trop du poème, sur sa barque traversière, en toute béatitude et mansuétude pour que l’arbre et la maison reste dans le bleu, la couleur bleue qui colore le recueil, à sa suite harmonique avec les menues indications qu’il sème de ci de là en légères dédicaces participant ainsi, pour le lecteur, d’une reconnaissance, d’une main tendue, d’une tablée commune, que le poète toujours se plaît à ne pas refuser. « Nous serons comme des lucioles/ dans vos prochaines villes/ à l’orée des grands bois/ où survivent les oubliés/ et puissiez-vous entendre/ de nos voix le murmure/ puissent nos mots vous apaiser… »F.V.Jean-Louis Kuffer, La Maison dans l'arbre. Editions de La Désirade, 276p. -
Enfantaisie du mardi

À la Maison bleue, ce mardi 27 janvier. – L’enfant sérieux, de tout le sérieux de pontife pédant de ses huit ans, me fixe et me balance comme ça sans donner du tout l’impression d’une répétition ou pire : d’une citation servile : «Je regrette les temps de l’antique jeunesse », et tout à coup je me dis qu’il n’y a pas de miracle, sauf au gré de l’enfantaisie qui tout à l’heure lui a fait ouvrir tel petit livre posé là et déchiffrer l’alexandrin et le mémoriser aussitôt et le servir comme en miroir au vieux veilleur que je suis à ses yeux, alors dans la foulée j’entre dans son jeu et d’un temps en trois mouvements je lui chantonne :
«Je regrette les temps où la sève du monde, l’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts, dans les veines de Pan mettaient un univers ». Et l’enfant à son tour et d’un coup de revolver imaginaire : « Pan ! »
Sur quoi l’Enfant nous propose (il y a là tout un petit public réuni pour la célébration du troisième annivesaire de la Petite) sa dernière Présentation, où l’Art et la Numismatique seront illustrés de concert à renfort d’objets de splendeur, à commencer par la Vierge aux yeux levés vers le Ciel, que pédant à mon tour je situe dans la lignée maniériste de Guido Reni, et l’Enfant scrupuleux de me demander de préciser : Guido Reni dernière période, GranDaddy ?
L’enfantaisie non plus n’est pas une lubie vague : c’est la première pointe de l’Attention Sensible, la première Monnaie du Cœur dont l’Enfant s’est improvisé le collectionneur sans se douter de la profondité de ce gisement dont je crois juste et lucide, adéquat et limpide de préciser qu’il figure « le pur ruissellement de la vie infinie »… -
Fantaisies du lundi
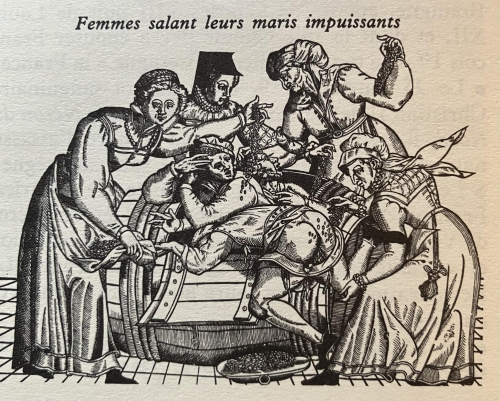
À La Désirade, ce lundi 26 janvier. - Ce jour dédié par la Mémoire à Sainte Paule, veuve à 32 ans et cinq fois mère, fondatrice de deux monastères à Jérusalem avant de remonter au Père en l’an 404, mais aussi célébrant les bienfaits de Saint Polycarpe toujours invoqué par les durs d’oreille - ce jour ou les princes à marier d’antan exigeaient l’épilation de leurs promises alors que les épouses salaient de concert les parties défaillantes de leurs conjoints, l’idée m’est venue de m’interroger sur une question majeure, comme on dit, relative à la mystérieuse apparition de la Fantaisie - et j’y viens ce matin grâce à l’observation rapprochée de trois enfants dont la petite dernière au prénom de Liza fête aujourd’hui même sa troisième année…
La Fantaisie, telle que je l’entends, la subodore et l’expérimente sans discontinuer, aux lisières ou aux clairières du sommeil, comme au plein jour lucide, n’a rien d’une lubie anodine. Elle est respiration plus encore qu’inspiration - comme on la prêtait mollement aux muses diaphanes des récits surannés -, elle est initiale et surprenante à tout coup, elle est source et un peu sorcière, il y a en elle une douce folie d’avant toute Explication, comme au premier chant – comme au premier saut.
La Petite invente ce matin sa langue : « Viens donc, maîtressier, allons faire de l’écrition ! ». Mais d’où cela vient-il ? Comment, de l’imitation en vient-on à l’invention ? Qui suggère à la Petite de danser soudain autour du « poteau de tortue » ? Quel génie malin ?
-
Nouvelles de l'étranger
Les poèmes nous arrivent comme des visiteurs, bientôt reconnus, aussi notre porte ne saurait-elle se fermer à ces messagers de nos propres lointains… (en forêt, 1986)Dessin de Thierry Vernet: esquisse d’un portrait de JLK, en 1986. -
La vie aux Oiseaux
 Monsieur Muller lave son Opel Rekord le samedi(Ragots de quartier et autres histoires rosses)D’aucuns ont parlé de lui comme d’un libre-penseur et plus tard d’un type menant une double vie à l’insu du voisinage, mais imaginer que Monsieur Muller puisse laver sa voiture un dimanche, ça non.Monsieur Muller votait-il ? Nul n’en avait la moindre idée, même pas moi durant ma brève période communiste. Il se disait (les femmes à l’épicerie du quartier) que son épouse Monique n’avait pas désiré leur fils aîné, qui s’est jeté sous le train plus tard, mais ce que lui-même en pensait restait sous le couvercle de la marmite, selon l’expression de son voisin Maillefer, sauf pour moi qui savait que son père refusait à Philippe le droit de laver l’Opel Rekord à cause de son penchant, et moins encore le modèle Kapitän qui a suivi avec la promotion de Monsieur Muller au titre de fondé de pouvoir de sa banque.Lorsque Philippe s’est jeté sous le train, sa mère a fait remarquer à la nôtre, par-dessus la haie séparant nos jardins, qu’elle n’avait jamais pensé que cette petite nature aurait le courage d’aller jusque-là, mais à l’époque Monsieur Muller semblait occupé ailleurs même le samedi, et tout avait bien changé dans le quartier que j’avais probablement déjà quitté, pour autant que je me souvienne…Madame Duflon reçoit l’après-midiL’ouvrier restera toujours l’ouvrier, disait-on dans le quartier, où l’employé était la norme, avec deux fondés de pouvoir qui auraient pu viser plus haut que nos lotissements subventionnés typiques de l’apès-guerre, mais d’ouvrier nous n’en savions qu’un seul et ça se voyait au survêtement gris marqué de la lettre Z (on savait qu’il travaillait aux ateliers mécaniques Zorn) qu’il portait le soir et même les dimanches sans se départir de son air buté, ou plus exactement rebutant, Duflon ne parlant à vrai dire à personne d’autre qu’aux habitués du Café du Mouton jouxtant les ateliers où il venait de passer contremaître au dam de son rival l’Italien Marti.« Il n’a pourtant pas de quoi faire le fier », disait-on à propos de sa façon de se détourner même sans être salué, mais le jugement s’atténuait avec un semblant de compassion à l’évocation sous-entendue que résumait l’expression « avec ce qui l’attend chez lui », et là je ne vous dis pas l’odeur de soupe tiède et la vision de Madame Duflon en robe de chambre de pilou bleu pâle, avant et après qu’elle avait reçu...Car Madame Duflon recevait. Personne n’en savait plus, les voisines les plus futées ignoraient combien elle prenait – on disait jusqu’à des cent francs tu te rends compte, mais sans la moindre preuve -,et tout ça ne faisait pas que le fils et la fille Duflon, treize et onze ans, fussent mieux allurés en matière de vêtements et de souliers, et surtout moins fuyants, comme le père.Quant à Verge d’or, notre facteur bicandier, il avait dit une fois que du quartier seule la maison des Duflon était mal habitée, jusqu’au jour où il s'y était attardé en fin de matinée…À l'ombre des pétales
Monsieur Muller lave son Opel Rekord le samedi(Ragots de quartier et autres histoires rosses)D’aucuns ont parlé de lui comme d’un libre-penseur et plus tard d’un type menant une double vie à l’insu du voisinage, mais imaginer que Monsieur Muller puisse laver sa voiture un dimanche, ça non.Monsieur Muller votait-il ? Nul n’en avait la moindre idée, même pas moi durant ma brève période communiste. Il se disait (les femmes à l’épicerie du quartier) que son épouse Monique n’avait pas désiré leur fils aîné, qui s’est jeté sous le train plus tard, mais ce que lui-même en pensait restait sous le couvercle de la marmite, selon l’expression de son voisin Maillefer, sauf pour moi qui savait que son père refusait à Philippe le droit de laver l’Opel Rekord à cause de son penchant, et moins encore le modèle Kapitän qui a suivi avec la promotion de Monsieur Muller au titre de fondé de pouvoir de sa banque.Lorsque Philippe s’est jeté sous le train, sa mère a fait remarquer à la nôtre, par-dessus la haie séparant nos jardins, qu’elle n’avait jamais pensé que cette petite nature aurait le courage d’aller jusque-là, mais à l’époque Monsieur Muller semblait occupé ailleurs même le samedi, et tout avait bien changé dans le quartier que j’avais probablement déjà quitté, pour autant que je me souvienne…Madame Duflon reçoit l’après-midiL’ouvrier restera toujours l’ouvrier, disait-on dans le quartier, où l’employé était la norme, avec deux fondés de pouvoir qui auraient pu viser plus haut que nos lotissements subventionnés typiques de l’apès-guerre, mais d’ouvrier nous n’en savions qu’un seul et ça se voyait au survêtement gris marqué de la lettre Z (on savait qu’il travaillait aux ateliers mécaniques Zorn) qu’il portait le soir et même les dimanches sans se départir de son air buté, ou plus exactement rebutant, Duflon ne parlant à vrai dire à personne d’autre qu’aux habitués du Café du Mouton jouxtant les ateliers où il venait de passer contremaître au dam de son rival l’Italien Marti.« Il n’a pourtant pas de quoi faire le fier », disait-on à propos de sa façon de se détourner même sans être salué, mais le jugement s’atténuait avec un semblant de compassion à l’évocation sous-entendue que résumait l’expression « avec ce qui l’attend chez lui », et là je ne vous dis pas l’odeur de soupe tiède et la vision de Madame Duflon en robe de chambre de pilou bleu pâle, avant et après qu’elle avait reçu...Car Madame Duflon recevait. Personne n’en savait plus, les voisines les plus futées ignoraient combien elle prenait – on disait jusqu’à des cent francs tu te rends compte, mais sans la moindre preuve -,et tout ça ne faisait pas que le fils et la fille Duflon, treize et onze ans, fussent mieux allurés en matière de vêtements et de souliers, et surtout moins fuyants, comme le père.Quant à Verge d’or, notre facteur bicandier, il avait dit une fois que du quartier seule la maison des Duflon était mal habitée, jusqu’au jour où il s'y était attardé en fin de matinée…À l'ombre des pétales La toute vieille Eulalie Coton a les pieds secs, les pieds blancs, les pieds froids.Le jeune Docteur Plastron, d’une voix aussi blanche que son caleçon, lui prend les mains et lui explique en douceur qu’on va lui couper ses pieds pourris si elle est d’accord , mais la toute vieille se rebiffe car elle tient à ses pieds morts et montre ses griffes au gamin.Et de lancer au carabin: «Fiston, sans pieds comment voulez-vous que je foule encore l’ombre des pétales, et qu’en serait-il donc , même pourri, d’un monde sans poésie ? »Or on le sait trop peu aux Oiseaux : que la Poésie aura résumé pour ainsi dire la destinée de la grabataire, au motif que Les Ormeaux fleuris, avant le placement d’Eulalie plus que nonagénaire à l’Institut médico-social Au clair matin par ses descendants indirects, et la vente de la maison constituant l’ornement hors d’âge du quartier en style Art Nouveau classé, ont relevé longtemps du haut-lieu de conservation musicale (avec le Quatuor mémorable dont elle était l’alto et parfois la flûte) et les rendez-vous littéraires illustrés par ses Groupages Vespéraux de poètes et de conteurs – tout cela ayant marqué ce qu’on pourrait dire le passé glorieux du quartier à vrai dire ignoré des actuels habitants.
La toute vieille Eulalie Coton a les pieds secs, les pieds blancs, les pieds froids.Le jeune Docteur Plastron, d’une voix aussi blanche que son caleçon, lui prend les mains et lui explique en douceur qu’on va lui couper ses pieds pourris si elle est d’accord , mais la toute vieille se rebiffe car elle tient à ses pieds morts et montre ses griffes au gamin.Et de lancer au carabin: «Fiston, sans pieds comment voulez-vous que je foule encore l’ombre des pétales, et qu’en serait-il donc , même pourri, d’un monde sans poésie ? »Or on le sait trop peu aux Oiseaux : que la Poésie aura résumé pour ainsi dire la destinée de la grabataire, au motif que Les Ormeaux fleuris, avant le placement d’Eulalie plus que nonagénaire à l’Institut médico-social Au clair matin par ses descendants indirects, et la vente de la maison constituant l’ornement hors d’âge du quartier en style Art Nouveau classé, ont relevé longtemps du haut-lieu de conservation musicale (avec le Quatuor mémorable dont elle était l’alto et parfois la flûte) et les rendez-vous littéraires illustrés par ses Groupages Vespéraux de poètes et de conteurs – tout cela ayant marqué ce qu’on pourrait dire le passé glorieux du quartier à vrai dire ignoré des actuels habitants.Autant dire qu’en amputant Eulalie Coton l’on eût coupé définitivement les derniers rameaux de mémoire du quartier, mais l’ironie de la vie veut que la Dame en noir ait réglé le sort de la ronchonneuse l’autre soir sans que personne aux Oiseaux n’en soit avisé, n’était le jeune Gaétan son dernier soignant, slameur à ses heures…
Différent
(en mémoire de P.-A. de M.)
La cravate lavallière à rubans de soie vieux rouge, en joli contraste avec le noir côtelé de son costume bohème chic, ne laissa de faire sourciller Père quand son fils Pierre-Marie, ce matin-là, se présenta à lui qui prenait son premier café matinal en compagnie de Mother, mais le vénérable prof s’interdit toute remarque sur ce qu’il y avait à ses yeux de par trop maniéré dans cette tenue, toujours inquiet des réactions vives de son épouse à tout ce qui froissait ou risquait de peinaer son fils préféré à l’extrême sensibilité de poète, d’ailleurs accordée au fait qu’il écrivait bel et bien des poèmes, certes moqués et même persiflés par ses persécuteurs du Collège, mais que Père lui-même avait reconnus en leur pureté de cœur et leur profondeur de pensée, dans l’indéniable lignée lyrique des plus estimables noms du canton.
La Revue des Lettres, dont le dernier exemplaire paru figurait à tout coup sur le présentoir de la Salle des Maîtres, rappelait d’ailleurs à ses collègues l’estime partagée que suscitaient les poèmes de Pierre-Marie, et l’on fermerait donc les yeux sur la cravate western en espérant que le garçon s’en tiendrait là en son ostentation de dandysme déjà raillée dans le quartier (la démarche un peu guindée du jeune homme, remarqué aussi pour sa façon de tenir son parapluie comme un cierge dans les processions)...
« Vous ne me tiendrez point rigueur de me sentir différent », avait dit Pierre-Marie à Mother au tournant déjà de ses douze ans, donc avant les poèmes, quand il passait le plus clair de son temps à lire les aventures d’Ulysse et ses forbans, dont Père était LE spécialiste du Collège – Pierre-Marie donc à l’écart des autres jeunes gens du quartier, n’était celui qu’il appelait (déjà !) l’Enfant mystérieux, seulement dix ans et lui aussi solitaire, dont il se disait lui-même l’Ami secret…
Et le frère aîné là-dedans ? Comme les autres, mais jamais pour les suivre sur la voie de la ressemblance la pire qui ne donne du galon qu’au Mesquin, ce démon de l’informe et de l’envie de rien.
Que tu les appelles De Mestral ou Mestral revient en somme au même, convient un passant neutre qui ne voit dans l’aristocratie que la part naturelle. Baptiste l’aîné, ingénieur des forêts, Pierre-Marie trop tôt disparu ou le prof de grec & latin regretté, auteur d’une grammaire oubliée avec l’enseignement éponyme – Mother on n’en parle même pas par surcroît de respect -, tous ils sont alignés aujourd’hui au cimetière de l’autre bout de la ville, mais les trois recueils parus du poète ont bel et bien quelque chose d’autre qu’on ne saurait dire… -
L'Ouvroir

Trésor de JLK (I)
«Toutes les religions passeront et cela restera : simplement être assis sur une chaise et regarder au loin. »(Vassily Rozanov, Esseulement)°°°« Nous vivons parmi des idées et des choses infiniment plus vieilles que nous ne pensons. Et en même temps, tout bouge ».(Teilhard de Chardin)°°°« Pourquoi y a-t-il quelque chose ici et non rien ? Et pourquoi cette question nous vient-elle à l’esprit – nous autres particules qui tournons indéfiniment autour de cette pierre noire ? Pourquoi nous vient-elle à l’esprit ? »(Annie Dillard)°°°« La mort des autres nous aide à vivre. »(Jules Renard)°°°« Quand l’homme se laisse aveugler par les choses, il se commet avec la poussière. Quand l’homme se laisse dominer par les choses, son cœur se trouble. »(Shitao)°°°« J’aime éperdument ce qui est schématique, aride, salin, perpendiculaire. »(Charles-Albert Cingria)°°°« Je pique indifféremment de petits faits, et je me suis habitué à leur morphine. »(Jules Renard)°°°« Est-ce possible que tous ceux qui passent par la rue mourront eux aussi ? Quelle horreur. »(Vassily Rozanov, Feuilles tombées)°°°Si je meurs à la poésie, c’est pour avoir vécu trop loin de moi-même(1967)°°°« J’avais vingt ans. Je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie. »(Paul Nizan)°°°«A good gook is a dead gook. »(Vietnam, 1967)°°°« Je vais moins à la vérité que je ne pars de la vérité. »(Nicolas Berdiaev)°°°« Aujourd’hui, n’est-ce pas, il faut être son propre grand-père. »(Vladimir Dimitrijevic, 1968)°°°« J’ai joué avec une coupe d’enfantEt découvert la grotte de l’azurEst-il possible que j’existe pour de bonEt que la mort me prendra vraiment ? »(Ossip Mandelstam)°°°En hiver, les jardins publics sont comme de vastes églises désaffectées.(1974)°°°« C’est cela, la vie. On travaille, on fait des livres, avec des tas de salutations à Pierre et à Paul. On attend la gloire, la fortune – et on claque en chemin. »(Paul Léautaud)°°°« Il est tellement laid qu’on dirait que la figure lui fait mal. »(L’abbé V., en 1974)°°°«Arrivée ce matin à Venise. Balade dans les venelles. Deux tableaux au musée Correr : une Pietà de Cosme Turra, de tour expressionniste, avec le diable dans l’arbre sous la forme d’un singe ; et Les courtisanes de Carpaccio, d’une beauté précieuse où me surprend, imperceptible sur les reproductions, la douceur mystérieuse des tons. De l’intérieur du musée, l’on entend un accordéon sur la place voisine.(1974, 3 mai)°°°« Laissez parler votre subconscient. »(Dimitri, en 1974)°°°Littérature romande : la fuite dans l’Ailleurs. Jaccottet, Roud et consorts : une poésie qui ne porte pas, ici et maintenant, à conséquence. Rose bleue selon Dürrenmatt…(1974)°°°« Ce qui se révolte en moi, c’est la langue elle-même, véhicule de ce que la vie recèle de plus révoltant. La langue se révolte contre ce contenu même. Elle persifle, grince et se secoue de dégoût. La vie et la langue s’empoignent impitoyablement et se disloquent peu à peu ; il ne restera, pour finir, qu’un mélange inarticulé, le véritable style de notre époque. »(Karl Kraus)°°°« Anna Akhmatova écrit des vers comme si un homme la regardait ; or il faut les écrire comme si Dieu nous regardait en transcendant la partie primitive de nous-même, la partie condamnable. Comme devant Dieu – en Sa présence. »(Alexandre Blok)°°°« On sent dans le chant des oiseaux le regret de la verdure . »(Charles-Albert Cingria)°°°« J’aime ceux qui ne savent vivre que pour disparaître : ce sont eux qui passent au-delà »(Nietzsche).