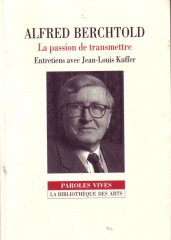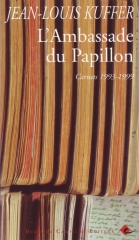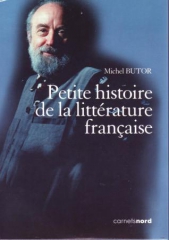Souvent interviewé, le grand écrivain portugais se contente volontiers, en ponctuant ses propos de sourires aussi amicaux que désabusés, de resservir les mêmes réponses aux mêmes questions. Tout autre est l'accueil qu'il a réservé à Maria Luisa Blanco, qui a pris la peine de se déplacer à Lisbonne et l'a soumis durant plusieurs jours à de longues séances d'entretiens auquel l'écrivain s'est prêté « avec la discipline d'un collégien ».
Abordant successivement son éducation stricte dans une grande famille aussi cultivée qu'affectivement glaciale, sa folle passion de lire, l'expérience bouleversante de la guerre en Angola (qui lui inspira Le cul de Judas), son premier livre (Mémoire d'éléphant), la séparation catastrophique (et peut-être nécessaire à sa liberté créatrice) d'avec sa première femme qui le soutint toujours et à laquelle il revint trop tard, entre cent autres thèmes, ces conversations sont d'un grand intérêt pour qui suit le développement d'une des œuvres littéraires les plus fascinantes de l'époque.
Inventeur d'une écriture souvent difficile (il est le premier à le relever), Antonio Lobo Antunes est le contraire d'un homme de lettres coupé de la vie, et tout ce qu'on apprend ici de la sienne, avec un entretien final chez ses (redoutables) parents, enrichit les résonances de ses livres tissés d'innombrables éléments relevant de l'autofiction.
Maria Luisa Blanco. Conversations avec Antonio Lobo Antunes. Traduit de l'espagnol par Michelle Giudicelli Editions Christian Bourgois, 298 pp.
Un nouveau roman d’Antunes est à paraître à la rentrée chez Christian Bourgeois, sous le titre de Bonsoir les choses d'ici-bas.
Carnets de JLK - Page 81
-
Antunes en son labyrinthe
-
Toni Morrison dixit

Après la victoire de Donald Trump, Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, déclarait sur Twitter: “C’est précisément maintenant que les artistes doivent se remettre au travail. Il n’y pas de place pour le désespoir, l’auto-apitoiement, le silence ou la peur”...
En 1998, cinq ans après le Prix Nobel, la romancière noire américaine publiait un livre magnifique, intitulé Paradis. Je l’avais rencontrée.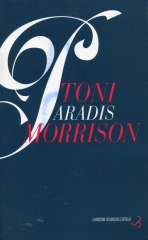 Ne laissez pas toute espérance au seuil de ce roman dont les premiers mots annoncent la couleur: «Ils tuent la jeune Blanche d'abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps.» Non: ce n'est pas dans l'enfer de Dante que vous pénétrez, mais le Paradis annoncé par le titre du dernier roman de Toni Morrison (qui l'avait d'abord appelé Guerre, avant de céder à son éditeur craignant d'effaroucher le public...), n'a rien non plus d'une angélique prairie.
Ne laissez pas toute espérance au seuil de ce roman dont les premiers mots annoncent la couleur: «Ils tuent la jeune Blanche d'abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps.» Non: ce n'est pas dans l'enfer de Dante que vous pénétrez, mais le Paradis annoncé par le titre du dernier roman de Toni Morrison (qui l'avait d'abord appelé Guerre, avant de céder à son éditeur craignant d'effaroucher le public...), n'a rien non plus d'une angélique prairie.
Dernier volet d'un triptyque consacré (notamment) aux dérives extrêmes de l'amour, amorcé il y a dix ans de ça avec un chef-d'oeuvre, Beloved (1988), et poursuivi avec Jazz (1992), Paradis aborde à la fois les thèmes de l'utopie terrestre et de la guerre entre races et sexes, tantôt apaisée et tantôt exacerbée par le recours à un dieu que chacun voudrait à sa ressemblance.Rien du prêchi-prêcha, pour autant, dans cette double chronique de la ville «élue» de Ruby, aux tréfonds de l'Oklahoma, exclusivement habitée par des Noirs, et d'une petite communauté de femmes dont la rumeur a fait des sorcières, expliquant aussi bien le massacre purificateur initial. Rien non plus de schématique là-dedans. Comme toujours chez Toni Morrison, c'est dans la complexité du coeur et de la mémoire, sur la basse continue d'une sorte de blues lancinant, que tout se joue au fil d'une suite d'histoires terribles et émouvantes que la narratrice imbrique dans un concert de voix à la Faulkner.
Littérairement parlant, le rapprochement n'est d'ailleurs pas aventuré, entre la romancière du Chant de Salomon (1978), qui a entrepris un grand travail de mémoire et de ressaisie verbale à la gloire des siens, et le patriarche sudiste du Bruit et la fureur. Jouets d'une sorte de fatum tragique, dans une Amérique tiraillée entre puritanisme et vitalité, violence et douceur évangélique (la belle figure du révérend Misner), références religieuses traditionnelles ou libres pensées, les personnages de Paradis dégagent finalement, comme les «innocents» de Faulkner, une rayonnante lumière. Lumineuse, aussi, la présence de Toni Morrison. Point trace de morgue satisfaite chez cette descendante d'esclaves, issue d'une famille ouvrière où la défense de sa dignité et l'aspiration au savoir passaient avant la réussite sociale. Malgré sa brillante carrière universitaire, le succès international de ses livres, et le Prix Nobel, Toni Morrison a gardé toute sa simplicité bon enfant, son humour et son attention aux autres.
Lumineuse, aussi, la présence de Toni Morrison. Point trace de morgue satisfaite chez cette descendante d'esclaves, issue d'une famille ouvrière où la défense de sa dignité et l'aspiration au savoir passaient avant la réussite sociale. Malgré sa brillante carrière universitaire, le succès international de ses livres, et le Prix Nobel, Toni Morrison a gardé toute sa simplicité bon enfant, son humour et son attention aux autres.
- Toni Morrison, que diriez-vous à un enfant qui vous demanderait de lui expliquer ce que représente Dieu?
- J'essaierais de lui montrer que l'image de Dieu dépend essentiellement de la représentation que s'en font les hommes. Dieu devrait être l'expression de ce qu'il y a de meilleur en nous. Mais la première représentation biblique montre aussi un Dieu jaloux, exclusif, paternaliste, oppressant. Le Christ devrait être l'image par excellence de l'amour du prochain, et l'on en a fait une arme de guerre. De même, l'Eglise a joué un rôle essentiel pour le rassemblement de la communauté noire et la lutte pour les droits civiques, comme elle s'est faite complice de l'exclusion et du massacre. Cette guerre, qui se livre au coeur de l'homme et de toute société, forme d'ailleurs le noeud de mon roman. La ville de Ruby est pareille à ces cités construites à la fin du siècle passé par d'anciens esclaves décidés à réaliser le paradis sur terre. Or, dès le début, je l'ai découvert dans certains documents, cet idéal a été marqué par l'exclusion de certains, des plus déshérités. A l'idée traditionnelle du paradis est d'ailleurs associée celle de l'exclusion.
- Quelle représentation vous faites-vous de l'enfer?
- Qui disait encore que «l'enfer c'est les autres?» Ah oui, Sartre! Eh bien, ce n'est pas du tout mon avis! En fait, j'ai toujours été étonnée de voir que les écrivains se montraient beaucoup plus talentueux dans leur description de l'enfer comme Dante, où Milton et sa femme condamnée à accoucher éternellement de chiens féroces, que dans leurs évocations du paradis, suaves ou assommantes. Pour ma part, je ne tiens pas à en rajouter...
- Votre personnage de Mavis, qui abandonne son ménage après la mort de ses deux plus jeunes enfants, semble bel et bien connaître un enfer...
- Oui, mais elle a contribué elle aussi à cet enfer par son incompétence. Les femmes qui se retrouvent dans cette espèce de couvent ont d'ailleurs toutes quelque chose de déficient. Cela d'ailleurs nous les rend d'autant plus attachantes.
- Vous dites écrire pour témoigner. Le roman en est-il le meilleur moyen?
- Le roman ne cherche pas à expliquer ou à démontrer, comme on le ferait dans un essai, mais plutôt à faire sentir, de l'intérieur, en multipliant les points de vue. Dans Paradis, il n'y pas une vérité proférée par une voix, mais une suite de récits dont chacun modifie la vision d'ensemble. Que s'est-il réellement passé sur les lieux du drame? Toutes ces femmes ont-elles été massacrées? Comment l'histoire s'écrit-elle? C'est ce que je n'ai cessé de me demander en composant Paradis, ignorant où j'allais et cherchant à pénétrer un secret après l'autre...Le paradis «ici-bas»
Ce que nous pouvons ajouter, en conclusion, c'est que Paradis se lit aussi comme le déchiffrement d'un secret. Qu'on n'attende point une «révélation lénifiante», mais plutôt une image à la fois lucide et émouvante de la destinée humaine, dont la magnifique dernière scène symbolise la très terrestre espérance. Deux femmes, la plus âgée tenant dans ses bras la plus jeune, comme dans un tendre groupe sculptural, au milieu des détritus d'un rivage quelconque, évoquent un navire revenant au port avec ses passagers «perdus et sauvés», qui vont maintenant «se reposer avant de reprendre le travail sans fin pour lequel ils ont été créés, ici-bas, au paradis». Toni Morrison. Paradis. Traduit de l'anglais par Jean Guiloineau. Christian Bourgois, 365 pages.
Toni Morrison. Paradis. Traduit de l'anglais par Jean Guiloineau. Christian Bourgois, 365 pages.
Toni Morrison est née en 1931 à Lorain, dans l'Ohio industriel. Après des études à l'Université de Howard (thèses sur le suicide chez William Faulkner et Virginia Woolf), elle a longtemps travaillé dans l'éditionm chez Random House. Mariée en 1958, mère de deux enfants, elle a divorcé et s'est installée à New York en 1967. Son premier livre, L'oeil le plus bleu parut en 1970. Entre autres distinctions, Sula, paru en 1975, obtint le National Book Award, et Beloved le Prix Pulitzer en 1988, salué en outre par un immense succès. Toni Morrison fut la première lauréate noire du Prix Nobel de littérature, en 1993. -
Ceux qui votent avec leur trompe

Celui qui s'exclame avec le poète :"Écrasons les pauvres !" / Celle qui a une effigie de Donald sur son string / Ceux qui se la jouent Mickey Mahousse dans sa housse / Celui qui a gagné son premier million sous Clinton & Lewinsky / Celle qui n'est pas clintonidienne / Ceux qui préfèrent un milliardaire au pouvoir vu que les sans-abris n'ont même pas les moyens de leur faim / Celui qui à la Maison Blanche sera servi par des Noirs / Celle qui n'aime que les éléphants à quatre pattes / Ceux qui auront tous une perruque orange à la fin de la journée / Celui qui rase Poutine / Celle qui trompe le temps quand il a ri / Ceux qui se la jouent Mouse of cards / Celui qui est de mèche avec le nez rond / Celle qui fera une première dame de seconde main / Ceux qui estiment que le type n'a pas encore fait ses preuves et que c'est là que ça craint, etc.
-
Pour tout dire (75)

À propos de lecture et d'interprétation. Qu'un grand texte requiert votre attention s'il vous plaît, et votre collaboration gracieuse. Aveuglement occasionnel de Jules Renard, Tolstoï ou Antonin Artaud concernant Shakespeare. Des hauts et des bas de siècles de mise en scène. Et de la reconnaissance de Claudel ou Léautaud, entre tant d’autres...
C'est un truisme que de constater qu'il n'y a pas de théâtre sans théâtre, ou plus exactement: que la plus grande pièce qui soit reste incomplète sans incarnation, quitte à se trouver mal comprise ou même trahie par ses interprètes. De la même façon, l'écrivain ne fait que la première moitié du chemin d'un livre, dont le reste du parcours appartient au lecteur.
Or, s'agissant du théâtre (ou de l'opéra, ou de toute partition musicale), la question de l'interprétation vaut pour le meilleur et le pire, comme je me le répète ces jours en regardant, l'une après l'autre, et pour le meilleur jusque-là, les 37 pièces de Shakespeare montées et filmées par la BBC.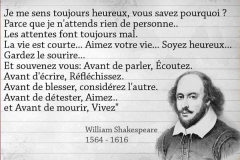
Regarder "tout Shakespeare" sur le petit écran de sa télé ou de son Mac peut sembler une aberration, et pourtant l'exercice est recommandable à qui veut voir "tout ça" de plus près scène par scène, avec arrêts sur images éventuels et version bilingue à portée de main - le Théâtre complet de Shakespeare à La Pléiade propose d'excellentes traductions - , et ces outils de lecture complémentaires que constituent Les feux du désir de René Girard ou Le petit Shakespeare où se trouve documentée, entre cent autres thèmes liés à la vie et aux œuvres du Big Will, l'histoire, précisément, de la réception de Shakespeare à travers les siècles, et celle de ses interprétations au théâtre ou au cinéma.

Un tableau synoptique de ce petit bréviaire rappelle que Shakespeare est mort au printemps 1616, la même année qu'un certain Cervantes et que la mise à l'Index de la peu catholique doctrine de Copernic, mais ce matin je reviens aux énormités proférées sur Shakespeare par quelques présumés auteurs éclairés, plutôt andouilles en l'occurrence.
Jules Renard, très esprit français, convenant qu'aucun auteur de son genre se risquerait à écrire comme Ibsen, note dans son Journal de l’année 1896: "Shakespeare m'embête toujours". Mais il faudrait en savoir plus sur ce qu'il a vu au théâtre en ces années où il donne lui-même Le plaisir de rompre au théâtre et fréquente Sarah Bernhardt allongée sur sa peau d'ours blanc, incarnation présumée du génie. On imagine la chère dame en Lady Macbeth, et l’on ne verra pas en Poil de carotte un cousin d’Hamlet même avec deux mères salopes.A
Autre grand écrivain aveuglé: Tolstoï: "Tout Shakespeare ne vaut pas une paire de bottes!" Et pour aggraver son cas:"J'ai lu les tragédies, les comédies et les pièces historique plusieurs fois, et invariablement j'ai éprouvé les mêmes sentiments: répulsion, ennui et ahurissement ".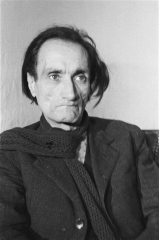
Mais le plus ahuri est peut être Antonin Artaud, qui a pourtant quelque chose du fou à lier shakespearien. Dans une lettre à Jean Paulien intitulée Il faut en finir avec les chefs-d’oeuvre,l’apôtre du théâtre de la cruauté écrit: “Shakespeare lui-même est responsable de cette aberration et de cette déchéance, de cette idée désintéressée du théâtre qui veut qu’une représentation théâtrale laisse le public intact, sans qu’une image lancée provoque son ébranlement dans l’organisme, pose sur lui une empreinte qui ne s’effacera pas”.
Là encore, cette vision absolutiste découle probablement de représentations édulcorées “à la française”, et pourtant Jacques Copeau dit le contraire à la même époque: “Il est probable que si le public français montre aujourd’hui plus de compréhension de Shakespeare et de goût pour ses oeuvres, c’est grâce à l’effort accompli par nos metteurs en scène pour retrouver la vie du texte et le mouvement de l’action en se rapprochant d’une tradition scénique longtemps négligée”.
On l'a vu plus récemment, dès les années 60: que Shakespeare reste d'une modernité sidérante, même si les interprétations qui se voulaient précisément les plus à la page sacrifiaient parfois le sens profond de ses pièces à des effets de scène relevant de la trop fameuse déconstruction et autres chichis scénographiques. Je me souviens ainsi de la réplique "Ainsi passe le train du monde" illustrée, sur la scène de Vidy, par un train miniature traversant celle-ci. Et les jobards de trouver ça génial, comme furent adulées tant de réalisations d’une époque où le metteur en scène et le scénographe comptaient souvent plus que l’auteur. Dans la série de la BBC, Anthony Hopkins en Othello noir aux yeux bleus, Jonathan Pryce en Timon d'Athènes ou Michael Hordern en Roi Lear n'ont pas besoin de costumes de chefs de guerre punks ou de politiciens à dégaines de mafieux pour actualiser leurs personnages, mais la compréhension de Shakespeare est bien là avec les merveilleux comédiens anglais formés à cette informelle “école”...
"Être ou ne pas être devrait être dit devant une bouteille de whisky et un siphon d'eau gazeuse", écrivait Paul Claudel, l’un des poètes et dramaturges français qu’on pourrait dire aussi shakespeariens sous divers aspects.
Et Paul Léautaud qui fut un grand critique de théâtre sous le pseudo de Maurice Boissard, de signer ce magnifique éloge dans le Mercure de France du 1er mai 192o, à propos d’une mise en scène de Jacques Copeau: “Le Théâtre du Vieux-Colombier a fait sa réouverture avec le Conte d’hiver de Shakespeare. Vais-je vous faire l’éloge de Shakespeare ? Vous ririez ! Il n’est rien chez lui qui ne soit touchant, plaisant, émouvant, profond, léger, comique, pathétique, bouffon, tragique tour à tour ou tout à la fois. Il a toujours quelque chose à dire, toujours il dit quelque chose. Il est le dramaturge universel. Pas un homme d’aucun pays qui ne puisse trouver dans son oeuvre quelque chose de lui-même, s’y reconnaître à un endroit ou à un autre. C’est la poésie la plus aérienne, la réalité la plus exacte, le comique le plus bouffon, l’émotion la plus pénétrante, le rire et le sanglot, l’ironie et la plainte, le sarcasme et l’élégie, le drame et la comédie, la fantaisie et l’observation, la vérité et la fable, le mystère et le fantasque, la tragédie et la farce, l’effroi et la joie, la noblesse et la trivialité, tantôt l’art leplus raffiné, tantôt le plus peuple, un monde de personnages de tous les aspects, de tous les tons, de tous les rangs, jetés, assemblés, mêlés par une plume prodigue et passionnée, partout avec l’accent le plus humain”.
-
Jacques Chessex s'interroge
 Dans un Interrogatoire posthume incisif et très explicite, mélange de franchise, d’émotion et d’ironie, l’écrivain livre un dernier autoportrait.
Dans un Interrogatoire posthume incisif et très explicite, mélange de franchise, d’émotion et d’ironie, l’écrivain livre un dernier autoportrait. La mort subite et stupéfiante de Jacques Chessex, au soir du 9 octobre 2009, restera dans les annales comme un événement quasi mythique, évoquant celle de Molière au théâtre. Venu à Yverdon-les-Bains pour une soirée consacrée à La Confession du pasteur Burg, premier récit fameux de ses jeunes années (paru en 1967 à Paris) où il est question des amours coupables d’un homme de Dieu avec une très jeune fille, Jacques Chessex fut interpellé au sujet de Roman Polanski, dont il avait pris la défense dans les médias. Or l’écrivain allait répondre au généraliste vaudois qui lui demandait de justifier sa position sur le viol d’une mineure par le cinéaste ; il eut juste le temps d’ironiser sur le fait que ce généraliste «généralise» à propos d’une affaire selon lui « minime », puis s’effondra soudain.
Or, deux mois plus tard paraissait Le dernier crâne de M.de Sade, évoquant lui aussi une relation scandaleuse entre le vieux marquis et une adolescente, où les grands thèmes de l’œuvre de Chessex revenaient en force. À savoir : l’opposition du désir et de la loi, l’antagonisme de la luxure et de la mort, le conflit aussi entre individu et société, artiste et morale. D’un style étincelant, le livre parut sous « préservatif » de cellophane avec la mention Réservé aux adultes, alors même que Sade est librement accessible en librairie…
Coïncidences et prémonitions (Chessex imagine Sade pressentant sa fin à 74 ans, alors que lui-même sera foudroyé à 75 ans) ont donc marqué la fin de Jacques Chessex, dont nous apprenons aujourd’hui, dans L’Interrogatoire , qu’il s’est vu mort lui-même au jour de sa naissance (le 1er mars), en 2009, quand défilèrent les chars du Carnaval à travers les rues de Payerne, sur l’un desquels le héros tragique d’Un Juif pour l’exemple, Arthur Bloch, se trouvait tourné en dérision, et le romancier cloué lui-même au pilori.
Au début de ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau se figure comparaissant devant l’Être suprême avec son livre pour justification. Quant à l’auteur du Désir de Dieu, il aura pris les devants en répondant, de son vivant, à une voix qu’on pourrait dire celle de sa conscience, mais aussi d’un juge moral ou social, inquisiteur, parfois agressif, parfois complice, comme un double qu’il manipule parfois à son gré : jusque dans les esquives ou la mauvaise foi, du pur Chessex !
Mais très intéressant dans l’exposé du « tissu de contraires » dont sont faites sa vie et son œuvre. Le sexe y déboule illico sous forme d’images. Mais plus que le sexe : le corps, le corps de la femme, le corps d’une femme aimée, beaucoup plus jeune que lui, sa compagne pendant ces quinze dernières années, qui devient ici une personne de la plus grande importance, plus qu’aucun personnage de ses romans. Le sexe s’y incarne alors, mais aussi la tendresse et le partage. Et tout afflue dans la foulée : l’amour et la jalousie, la vie et les livres, le père et la mort, la peur et le désir, l’orgueil, l’obsession curieuse de la sainteté, le retour à la mère sévère mais douce, la littérature vécue comme une guerre mais aussi comme une délivrance, avec d’étonnantes fulgurances : du meilleur Chessex !
Dans la foulée, l’interrogé remarque qu’« on n’est jamais interrogé que par soi-même ». Et c’est le pacte indéniable, et tenu, de ce livre. Post mortem, Jacques Chessex se dévoile une dernière fois. Même brut de décoffrage, ce livre vibre et vit : sacré Maître Jacques !
Jacques Chessex. Interrogatoire. Grasset, 153p.
-
Autour de Jacques Chessex

En mémoire de Maître Jacques, le Café littéraire de Vevey lui rendra un hommage à plusieurs voix ce vendredi 4 novembre prochain. Il y sera question de la vie et de œuvres du Goncourt 73, avec les contributions de Myriam Matossi Noverraz, Janine Massard, Pierre-Yves Lador, JLK, Jean-Michel Olivier et Gilbert Salem.
À l’instigation de Philippe Verdan, qui représente la nouvelle génération et s’est passionné pour cette œuvre, les amis et/ou pairs de plume de Jacques Chessex témoigneront de leurs rapports à l’écrivain et à l’œuvre selon leur expérience personnelle.
Avec JLK pour modérateur surveillant sévère mais juste du temps de parole, ils aborderont les thèmes relatifs aux sources existentielles et littéraires de Maître Jacques (le drame personnel d’origine, l’amour et la nature, le conflit entre érotisme et puritanisme, la poésie et l’inquiétude métaphysique), et seront également évoqués les rapports de Jacques Chessex avec les femmes et avec Paris, son personnage public et son écriture, le rayonnement de son œuvre et sa postérité.
Chaque intervenant présentera brièvement un livre de Chessex de sa préférence, quelques extraits seront lus et des airs de jazz ont été choisis par l’hôte des lieux, où les amateurs de fins plats trouveront aussi leur content.
Vevey, Café littéraire, 33 quai Perdonnet. Le 4 novembre 2016, dès 20h. -
Mémoire vive (105)

À La Désirade, ce mercredi 31 août. – J’ai comme l’impression que mes variations sur la lecture de Knausgaard, données en suite sous le titre de Pour tout dire, sont en train de devenir un texte en soi, distinct de ces carnets. Je vais donc leur réserver un espace propre, qui pourrait bien devenir un livre de plus.
Quant à mes carnets, je vais continuer à les tenir avec cette légère distance qui marque tout ce que j’écris désormais par rapport à mon « vécu », comme on dit, etc.
°°° Ce qui m’intéresse chez Knausgaard est la part de réalité inaperçue (ou non dite) qu’il éclaire, qui m’a toujours semblé, à moi aussi, une composante importante de la réalité, le plus souvent négligée, voire occultée. Ce que Jean Vuilleumier appelait les interzones, qu’il a explorées à sa façon dans son propre rêve éveillé.
Ce qui m’intéresse chez Knausgaard est la part de réalité inaperçue (ou non dite) qu’il éclaire, qui m’a toujours semblé, à moi aussi, une composante importante de la réalité, le plus souvent négligée, voire occultée. Ce que Jean Vuilleumier appelait les interzones, qu’il a explorées à sa façon dans son propre rêve éveillé.
La lecture de La mort d’un père me renvoie presque à chaque page à des périodes ou des épisodes de ma propre vie. Il est ridicule de prétendre que ce livre est écrit n’importe comment, sans composition ni style particulier, comme le prétend Pierre Assouline, mais il est vrai qu’il semblera banal ou plat à ceux qui attendent d’un livre action et rebondissements. Or très curieusement, le récit de Knausgaard établit bel et bien une tension et presque un suspense, en tout cas le désir de savoir la suite même si tout ce qui se passe est d’ordre sensitif et affectif.
°°°
La suite de chroniques que j’ai entreprise avec Pour tout dire sera peut-être une alternative au projet de Mémoire vive, dans la mesure où elle travaille la matière de mémoire d’une façon plus directe et dynamique, avec toutes les occurrences, existentielles ou littéraires, mais aussi artistiques (peinture et cinéma), sociales ou politiques, du TOUT DIRE quotidien. La lecture de Knausgaard en a été le point de départ, mais je vais multiplier les développements et les digressions tous azimuts en variations « hélicoïdales » ou diachroniques, etc.
°°°
Jusqu’à quel point s’humilie-t-on, en tant qu’individu de sexe mâle, à participer aux tâche ménagères et aux soins requis par de petits enfants ? En ce qui me concene, même si j’y ai consacré infiniment moins de temps que Lady L., jamais je n’ai eu le sentiment de perdre mon temps ni de me trouver rabaissé à m’occuper des petites ou de la vaisselle.
°°°
La lecture d’Un homme amoureux me confronte à tout moment à ce que j’aurai fait de ma liberté, et plus précisément à la question d’un éventuel « sacrifice » de celle-ci.
Or plus j’y pense et plus je me félicite d’avoir fait quelques « concessions », par rapport à ma liberté antérieure, au nom de notre vie partagée, de la cohabitaion avec ma bonne amie et de l’accompagnement de nos enfants. Seul petit regret parfois : d’avoir liquidé mon antre des escaliers du Marché, mais ce luxe bohème eût peut-être paru une entame à ma nouvelle « fidélité », par conséquent, etc.
Cap d’Agde ce samedi 10 septembre. – Je notais, il y a plus de vingt-cinq ans, cette phrase de je ne sais qui (Jouhandeau peut-être, ou Chardonne ?) que je trouvais belle : « Tout est bonheur pour cet innocent, cette sorte d’ange qui n’a jamais touché à la vie », mais ce que j’en pense à soixante-neuf ans se résume à ceci : littérature…
°°°
Sur quoi je recopie ici les notes de ce petit carnet à spirales non daté, qui doivent se situer autour des années 90 au vu de mes lectures du moment, notamment Le Temps du mal de Dobrica Cosic.
Par exemple ceci que je contresigne aujourd’hui : « Il est clair que l’amour est une affaire de peau, mais c’est ne rien comprendre que d’en déduire qu’il est seulement épidermique et superficiel. Ce qu’il faut reconnaître au contraire, c’est la profondeur de la peau. »
A contrario, je note, ce 10 septembre 2016, que le dévoilement des peaux ne va pas de pair avec un surcroît de vérité même érotique, ni moins encore ( !) d’un supplément d’âme.
°°°
Ou ceci que j’aurais pu écrire ce matin : « Le spectacle de nos congénères n’est pas toujours encourageant selon les lieux que nous fréquentons. Ainsi de l’humanité des supermarchés ou des aires d’autoroutes, ou celle qu’on voit s’agiter à la télé et celle qu’on imagine plantée devant sa télé – tout cette multitude à la fois repue et inassouvie, qui tourne en rond et s’ennuie ».
°°°
On dit souvent qu’il ne faut pas juger mais comprendre – devise de Georges Simenon -, mais qui comprend sans juger, même Simenon ?
°°°
“Il est difficile d’échapper au sentiment-sensation de schizohprénie quand on s’exprime quotidiennement dans un journal de grande audience. En ce qui me concerne, en tout cas, je constate qu’une fois sur deux je ne dis pas la moitié de ce que je pense dans mes papiers de 24Heures. Ce n’est pas que je mente, même par omission, mais bien plutôt que le milieu – le journal lui-même, et la considération du lecteur – me contraigne à un certain relativisme ou, souvent, une réserve de pondération qui bride ma nature naturelle…”
°°°
“Compte non tenu des enfants et des âmes simples, il n’y a peut-être de regard innoncent que dans nos rêves, et l’on voit alors quel chaos cela signifie, où l’on régresse à l’état limbaire ou subaquatique dont on ne peut rien tirer. Le sexe sans amour, ou plus généralement : le sexe stérile, n’est-il pas qu’asservissement ?”
°°°
Ce 10 septembre 2016, je le dirais autrement : que ce qu’on appelle « le sexe », à savoir le culte du corps et de la jouissance sexuelle, est devenu un véritable bouillon de sous-culture, à la fois dégradée et surdéveloppée du point de vue commercial, dont un lieu comme le village naturiste, dans sa zone échangiste, de Cap d’Agde, figure une « tête de gondole » européenne.
°°°
“Il ne faut juger qu’en connaissance de cause, pièces en mains, sinon tu t’abstiens”.
°°°
“Situation à la Houellebecq : la collègue qui invite le bureau chez elle et se dénude sous l’effet de l’alcool, sans que personne ne comprenne pourquoi - juste certains qui se demandent si elle a un secret, etc.”
°°°
“Portrait de l’arriviste froid impatient de prouver qu’il en a : le nouveau rédacteur en chef qui se pointe une fin de soirée à la rédaction où nous sommes tous plus ou moins crevés et, triomphant, sort une culotte de femme de son baise-en-ville !”
°°°
En Suisse ont dit « bonne fin de matinée » ou « bon début de soirée », on dit « merci, merci bien » et « service, pas de quoi », on dit tout ça comme pour empêcher que rien ne soit dit, etc.
°°°
On est (parfois) entouré de bruit et sans la moindre possibilité de faire cesser ce tapage. Il faut qu’il soit dit que « ça bouge » et donc que « ça vit ». Or ce boucan n’est qu’une turbulence rythmée du vide - rien que du chaos.
°°°
“J’aimerais arriver à faire plus court, plus net et plus dense, plus direct et plus vrai. Il s’agit de simplifier et de plus en plus. Hélas...”
°°°
“Il y a en moi un moine franciscan, un stoïcien à la romaine, un mystique matinal et un bluesman du soir, un cousin de Tchékhov et d’Oblomov, une âme sensible et un sanglier qui cohabitent tant bien que mal – à vrai dire plutôt bien que mal”.
°°°Situation paradoxale et assez typique du moment (vers 1990), où Dimitri publie les discours de Slobodan Milosevic et Le Temps du mal de Dobrica Cosic, ancien dignitaire communiste désormais considéré comme un « père de la nation » et qui aurait très bien pu siéger dans le comité central à l’époque où celui-ci envoyait le père de notre ami en prison…
°°°
“La déception que nous inspirent nos amis les plus chers est plus riche d’enseignements que toutes les avanies que nous subissons de la part de nos « ennemis ». De même est-ce par lucidité sur soi-même qu’on peut accéder au respect de soi. Du moins l’aurai-je vécu comme ça”.
°°°
“Les histoires qui m’intéressent le plus, plus que les réalistes, sont les plus réelles. Des histoires qui communiquent, physiquement et métaphysiquement, le double sentiment-sensation du réel et du plus-que-réel. Constante de mes préoccupations : la littérature qui me communique le sentiment-sensation de l’accablement et, en même temps, la force de lui résister sous l’effet de l’émerveillement”.
°°°
La métaphore de Dürrenmatt, selon laquelle la Suisse serait une prison sans barreaux, dont les habitants seraient les gardiens, tient-elle la route ? À vrai dire, je la trouve excessive, mais juste. Vérité de poète, évidemment plus vraie que celles du sempiternel « oui, mais »…
À propos de Vivre près des tilleuls, signé par dix-huit jeunes auteurs romands de l’AJAR.
On s’est peut-être dit, avant de lire Vivre près des tilleuls que c’était mission impossible. Enfin quoi : un livre à dix-huit pattes, pour traiter d’un sujet aussi délicat que la mort d’un enfant, et lancé par un buzz d’enfer genre coup médiatique, non mais !
Et puis on s’est payé le livre, on l’a ouvert et, commençant par la postface en manière de déclaration d’intention, intitulée La fiction n’est pas le contraire du réel, on a mieux cadré le projet ; on a mieux vu les kids en réunion avec leurs ordis persos, et passant ensuite de la théorie joliment filée au travail littéraire via l’Avant-propos, on a commencé de sentir la bonne vieille odeur de la littérature en basculant doucement dans le cercle magique de la fiction tandis qu’apparaissait le personnage d’Esther Montandon, cette imaginaire romancière romande (née en 1923) évoquant un peu Alice Rivaz ou plus tard Anne Cuneo, sortie de la « cuisse » des dix-huit jeunes auteurs romands et nous rejoignant par le truchement de carnets « oubliés » dans une enveloppe marquée FACTURES où se trouve relaté, sur des petits feuillets épars, le drame qui l’a foudroyée à quarante ans passés, quand sa petite Louise de quatre ans, vainement attendue pendant des années lui fut arrachée par accident…
La vérité d’un texte ne se mesure pas avec d’autres instruments que la sensibilité de chacun, donc je ne parle que pour moi, plein de doute et de questions a priori sur la démarche de l’AJAR, et ensuite supris contre toute attente. Pas un instant, cependant, je n’aurai regimbé à l’idée que de jeunes auteurs nés dans les années 80 se mêlassent (comme ça se prononce) d’évoquer les années 60, ni d’avoir vécu personnellement le drame affreux de la mort d’un enfant.
Mon scepticisme portait ailleurs : sur un résultat par trop fabriqué, sans épaisseur ni fibre personnelle. Or la surprise est là : que les 63 séquences constituant les carnets d’Esther Montandon s’agencent, comme par miracle, dans une suite bel bien marquée par un ton particulier, accordé à un vrai regard, passant de l’abattement à la rage ou du désarroi à l’égarement. Nulle forte secousse d’émotion pour autant, qui prendrait le lecteur aux tripes, mais de multiples tremblements intimes marquant cette traversée du chagrin jusqu’au désespoir qu’un Peter Handke figurait dans une sorte de brume de tristesse atteignant les objets eux-mêmes. D’une réelle qualité littéraire, le texte ne pêche jamais par excès de pathos ni d’esthétisme. Tout m’y semble juste. Edgar Degas, peintre et écrivain, dit quelque part que l’art consiste à faire du vrai avec du faux, et cela marque le passage des faits à la fiction.Du côté des faits éprouvés dans sa chair vive par un individu, on pourra lire le récit déchirant d’Antoine Leiris, dans Vous n’aurez pas ma haine, témoignage d’un homme dont la femme a été assassinée au Bataclan.
Tout autre, on l’a compris, est la démarche de l’AJAR, dont les auteurs, par delà l’astuce « en abyme » des carnets d’Esther Montandon, ont accumulé les trouvailles narratives appropriées. Un exemple : lorsque Esther, effondrée après l’accident qui vient de coûter la vie à Louise, cherche les mots qu’elle va adresser à sa mère au téléphone, avant de se rappeler soudain que celle-ci est morte depuis des années… Ou cet autre épisode de l’invitation à un mariage, que lui envoient des amis connus au Rwanda, qui la convient avec son mari et Louise…
Plus encore, avec de constants glissements entre temps et lieux, le kaléidoscope narratif reconstitue le cadre de vie d’Esther, qui change en cours de route, et l’évolution de sa douleur, apaisée par des voyages ou la rencontre d’un autre homme, etc.
J’imaginais, au mieux, un exercice de style relevant de la création collective, mais Vivre près des tilleuls est plus que ça : un vrai livre. Passons donc sur le buzz antérieur et les (joyeuses) gesticulations post partum des kids, relevant de la Star Ac littéraire d’époque, puisque Esther Montandon, que nous avons rencontrée, existe…
°°°
Le cinquième tome du Manifeste incertain de Frédéric Pajak, consacré à Van Gogh, me passionne autant par sa façon de résumer-concentrer le vie de Vincent, dans un récit très limpide et à la fois très nourri des faits les plus significatifs (et parfois inaperçus), que par ses dessins en contrepoint, parfois d’une grande force expressive. Or je ne suis pas loin de penser que Pajak, en Suisse romande, est l’auteur qui, actuellement, m’intéresse le plus et dont je me sens émotionnellement le plus proche.
Lettre à Maître Jacques entre la mer, le ciel et la forêt.
Mon cher Jacques, Je ne serai pas là quand notre ami Jean-Michel Olivier lira cette lettre à l’assistance réunie à Ropraz pour célébrer le vingtième anniversaire du prix Edouard-Rod que tu as fondé, mais toi non plus n’y sera pas, et cependant je l’écris comme si tu allais la lire toi-même, de même que je continue de lire tes livres comme si tu étais encore de notre côté de la vie. En me rappelant nos relations parfois houleuses, que m’évoque à l’instant la mer assez agitée de ce matin d’arrière-été quelque peu orageux, je me dis que, par delà les eaux sombres, les livres seuls auront été entre nous ces messagers ailés, hors du temps, semblables à ces oiseaux dont un de tes recueils de nouvelles que je préfère se demande où ils vont mourir, si tant est que les oiseaux meurent jamais dans l’imagination des poètes.
De ton côté, tu m’as dit avoir beaucoup aimé l’un de mes textes, intitulé Tous les jours mourir, dans lequel je raconte nos adieux à notre père, qui nous convia un dimanche matin à une dernière journée en famille, et nous quitta en fin de soirée. Ce que je me rappelle d’Où vont mourir les oiseaux est une certaine grâce et une certaine lumière qui te sont propres, et cette une lumière semblable, dans l’évocation de la dernière journée de mon père, qui t’a touché, m’as tu dit dans la plus belle lettre que j’ai reçue à propos du livre qui nous a rapprochés, intitulé Par les temps qui courent, dans laquelle tu louais un autre récit du même ensemble autobiographique évoquant mes errances aux Etats-Unis, où je m’étais trouvé d’ailleurs à cause de toi puisque tu avais refusé une première invitation de présenter, au Texas ( !) le merveilleux Charles-Albert.
Or le texte en question s’intitulait Nus et solitaires, c’était une sorte de blues bleu sombre et comme l’un de tes autres textes que je préfère, dans L’Imparfait, célèbre le blues avec grâce et lumière, nous ne quittons pas la clairière de nos meilleures rencontres. Je reviendrai à ce très beau moment que nous aurons vécu ensemble ici même, à Ropraz, à l’occasion de la remise du premier Prix Edouard-Rod attribué à Par les temps qui courent en 1996, mais j’aimerais évoquer d’abord un autre moment de grâce et de lumière vécu un matin de mai de je ne sais plus quelle année, sur une petite place de Saint-Maurice, en présence d’une centaine de collégiens plus ou moins du même âge que tes fils, au pied des falaises marquées VIVE CHAPPAZ où, à l’occasion d’un festival philosophique, tu avais été convié à prononcer ton Credo.
Nous étions alors à couteaux tirés pour je ne sais plus quelle raison, mais je n’en étais pas moins présent et ce que tu as dis alors aux jeunes gens qu’il y avait là m’a si profondément touché que je suis venu, en fin de séance, te remercier et te serrer la main ; tu m’as dit que mon geste te touchait particulièrement et nous en sommes restés là, sous la belle lumière oblique qui tombait du haut des Dents du Midi, dans la grâce d’un instant. Au moment où tu a fondé le prix Edouard-Rod avec quelques amis écrivains et le syndic de Ropraz, l’auteur romand le plus célèbre à Paris, au début du XXe siècle, était pratiquement retombé dans l’oubli, et je dois avouer que je n’avais pas lu un seul de ses trente romans ni aucun de ses essais quand j’ai appris que j’allais être le premier lauréat de ce nouveau prix littéraire.
Je connaissais la bienveillante attention qu’Edouard Rod avait manifestée à Ramuz en ses jeunes années, mais j’ignorais que l’écrivain avait été proche de Zola et qu’il avait refusé d’entrer à l’Académie française pour garder sa nationalité suisse. Or ce qui m’a touché plus particulièrement, dans la définition que tu as établie du prix, c’est qu’il devait récompenser un auteur à ses débuts (ce que je n’étais plus au moins depuis vingt ans) ou à un moment de renouveau de son travail, ce que j’étais à l’évidence puisque Par les temps qui courent a été pour moi un livre-charnière, et le début de ma collaboration avec Bernard Campiche, qui en a immédiatement accepté le manuscrit et avec lequel j’ai noué des liens d’amitié et publié ensuite huit livres en moins de dix ans, dans les meilleures conditions.
L’émulation entre écrivains de générations différentes est un phénomène assez courant, mais les vraies complicités sont plus rares entre les bêtes d’écriture que nous sommes, selon ton expression, et le rapport qui s’est établi entre nous quelque temps, entre la composition de mon roman Le Viol de l’ange, que tu as suivie de très près, et la parution de L’Imparfait, l’un de tes plus beaux livres, est lié dans mon souvenir à un mémorable moment de partage.
Plus récemment, assistant à la remise du prix Rod à Antoine Jaquier, j’ai repensé avec reconnaissance à la cérémonie de 1996 ; et brassant, ces dernières semaines, cinquante ans de courrier et de documents de toute sorte que je m’apprête à remettre aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale, suivant ton exemple, ce souvenir a été revivifié par les nombreuses cartes et autres lettres de félicitations qui m’ont été adressées à cette occasion.
Moi qui me suis souvent montré critique, dans les journaux où je sévissais, envers le système parisien des prix, j’ai trouvé très bien en revanche, vraiment très bien, de recevoir ce prix Rod décerné, de surcroît, par des écrivains, sans parler de la pincée de billets qui nous a permis de surprendre nos petites filles en leur annonçant, un beau matin de février 1997, à Cointrin, que nous nous envolions pour La Guadeloupe ! Vingt ans plus tard, alors que l’un de tes derniers livres revit sur les écrans par le truchement d’une adaptation où tu es censé revivre, alors que tu me reste infiniment plus présent par la seule magie de ton verbe, la littérature de qualité et ce que tu appelais les « saintes écritures » survivent tant bien que mal dans le chaos du monde où la fausse parole submerge trop souvent celle des poètes.
J’ai dit longuement, devant le nombreux public qui t’a entouré à Berne pour la remise de tes archives, la reconnaissance que nous te devons, et je ne vais pas me répéter, d’autant que c’est à tous ceux qui défendent encore la littérature, soit en écrivant de nouveaux livres de qualité, comme Pierre Béguin aujourd’hui, soit en les défendant ou n’était-ce qu’en les lisant, que j’aimerais dire merci.
Il est possible que, me pointant tout à l’heure à l’Hyper U d’à côté, je ne trouve pas un seul de tes livres, pas plus que ceux d’aucun des lauréats du prix Rod de ces vingt dernières années. Qu’à cela ne tienne : tes livres te survivent, comme ceux de Georges Haldas ou d’Yvette Z’graggen que le prix Rod a couronnés, et d’autres œuvres d’écrivains lauréats se poursuivent avec Jacques Roman ou Janine Massard, Jil Silberstein ou François Debluë, pour n’en citer que la moitié…
De ce bord de mer à ta lisière de forêt, cher Jacques, que les oiseaux de la poésie nous survivent…
(Cap d’Agde, en la Cité du Soleil, ce 15 septembre 2016)
Aux yeux des échotiers médiatiques, qui jugent sur les on-dit et les photos de Keystone, Knausgaard passe pour un frimeur alors que c’est au contraire un type plutôt timide et gêné par son extrême sensibilité, capable de pleurer quand il est bouleversé, comme à la mort de son père ou lorsque Linda se montre par trop dure avec lui.
Or ce qui me frappe, au fur et à mesure que j’avance dans la lecture d’Un homme amoureux, c’est son extrême porosité et l’intensité de son amour qui explique la beauté du portrait que, peu à peu, comme en creux, il fait de Linda. Les pages d’Un homme amoureux relatives aux éclats marquant la vie du couple durant les mois qui précèdent l’accouchement de Linda, ou la soirée de la saint Sylvestre 2003 entre amis où chacun y va de son autocritique, à la manière de la « nuit des conteurs » de Peter Handke, sont tout ce que j’aime en matière d’observation quotidienne nuancée, d’une assez féroce drôlerie.
Aussi, je suis impressionné par le mélange de douceur et de force expressive de cet auteur. J’ai lu ce soir la longue scène de l’accouchement de Linda, qui touche presque au fantastique tellement elle est intense, alors qu’il s’agit d’un épisode banal de la vie ordinaire, et juste après il évoque la longue période durant laquelle, contre l’avis de Linda, et presque jusqu’au point de rupture, il consacre tous ses jours et ses nuits au roman qu’il a promis à son éditeur et qui passe par moult formes et tribulations, enfin il fait le portrait de son beau-père bipolaire qui est également une sorte de ronde-bosse romanesque, bref tout ça représente un rare bonheur de lecture.
Ce lundi 19 septembre. - Je passe en revue les magazines de gauche et de droite que notre vieux voisin nous a filés (une douzaine de Figaro-Magazine et de Marianne) et relève quelques faits qui m’intéressent, plus précisément : l’aveuglement des autorités françaises devant la progression de l’islamisme plus ou moins radical (Jacques Julliard, naguère modéré, affirme maintenant que l’islam est radical par définition, ce qui se discute…), l’impunité des élus et autres élites plus ou moins corrompues, la situation désastreuse des migrants et plus particulièrement le sort des miliers de requérants d’asile qui s’entassent dans la « jungle » de Calais; la Realpolitik des deux potentats rivalisant de cynisme en Turquie et en Russie, la résurgence des croyances de masse dont témoigne par exemple le succès mondial de la secte de Falun gong, rappelant autant les pratiques de la scientologie que celles de la secte Moon; les assassinats sur les autoroutes et les débats à n’en plus finir sur la place du religieux dans notre société, entre autres tendances vestimentaires, documentaires nostalgiques sur la bonne vieille France d’antan (de Jeanne d’Arc à Jaurès) ou nouvelles recette du terroir genre couille d’âne de la cougnette façon berrichone, etc.
°°°
La façon de restituer la vie quotidienne en scènes dialoguées entrecoupées d’évocations de moments significatifs ou de paysages, de réflexions sur la vie ou sur l’art, entre autres portraits de proches ou d’amis et de gros plans sur Linda ou Vanja, fait d’Un homme amoureux une espèce de roman d’amour et d’amitié d’un ton de plus en plus personnel et attachant, autant qu’il est stimulant pour le lecteur-écrivant que je suis.
Dans les pages que je viens de lire, où il est question de la neige et d’un séjour chez la mère de Linda, le récit est reconstruit avec une telle grâce qu’il devient tout naturellement scène de roman. Knausgaard est attentif, autant qu’un Peter Handke, à ce que celui-ci appelle « l’heure de la sensation vraie », comme l’illustre l’évocation d’un après-midi de février, relevant soudain de l’épiphanie profane.
Ce vendredi 23 septembre. – Intrigués par un article paru il y a quelques jours dans les pages culturelles de l’édition sétoise du Midi libre, où il était question des oeuvres d’un artiste chinois du nom de Yan Pei-Meng, exposées jusqu’au 25 septembre au Centre Régional d’Art Contenporain (CRAC) de Sète, nous nous sommes pointés cet après-midi sur le quai où se trouve le haut-lieu artistique en question, dans d’anciennes halles frigorifiques du marché au poisson magnifiquement réaménagées par un architecte en vue et entièrement investies par les immenses toiles de Yan Pei Weng.
De cet artiste d’origine chinoise mais naturalisé français, très en vue dans l’establishment culturel et politique (Fabius était d’ailleurs présent au vernissage sétois), je ne savais rien en dépit de son passage au Louvre et autres cimaises prestigieuses, et l’aperçu que m’en ont donné les images de Google m’ont fait craindre le faiseur pseudo-rebelle à la mode (genre assez couru chez les Chinois occidentalisés), dans la mouvance du réalisme-post-pop surfant sur les vagues plasiques de Warhol ou de Lucian Freud à grand renfort de portraits plus ou moins déformés de célébrités (d’Obama au pape François) et autres scènes d’actu si possibles trash, mais d’emblée, dès la première salle réunissant deux immenses toiles « citant » Le Caravage à vigoureux coups de brosse-balai, dans un camaïeu de nuances grises entre le noir et le blanc reproduisant pour ainsi dire les couleurs et le clair-obscur du génial Rital, nous avons été saisis ; puis ce furent les variations colorées plus convenues (m’a-t-il semblé) sur le fameux pape Innocent de Francis Bacon, déjà démarqué de Velasquez, et déjà me demandai : est-ce encore de la peinture, et quoi de nécessaire et d’unique dans ces répliques plastiques de photos d’actualité où la découverte du cadavre d’Aldo Moro voisine avec l’attentat contre Jean-Paul II, et cette virtuosité, ce savoir-faire magistral ne font-ils pas que relancer les prouesses techniques du réalisme socialiste (première inspiration de l’artiste né à Shanghai en 1960 et formé à l’époque de la révolution dite culturelle) ou du pompiérisme bourgeois de la fin du XIXe siècle.
Je me suis posé la question en me rappelant nombre de démarches similaires, aux quatre coins de l’Occident artistique, puis nous sommes tombés en arrêt devant tel cauchemar pictural rappelant de loin Goya ou Saura, qui nous confronte à un vaste charnier nocturne où des chiens se disputent la pauvre chair humaine, tel portrait de Kadhafi dont la tête du cadavre semble réduite à un cri réduisant à rien le jugement des Justes, ou tel grand singe à figure rouge, au milieu d’autres décombres, paraissant se demander ce qui est arrivé au monde en proie à ses cousins inventeurs de la poudre et du tout-nucléaire, etc.
°°°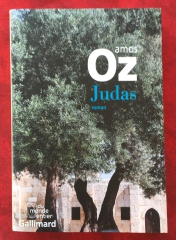
Les questions que pose le Judas d’Amos Oz sont des plus intéressantes, liées à la fois à l’attitude des Juifs par rapport à Jésus, et à la fondation de l’Etat hébreu. La grande réussite du roman, à mes yeux, tient à l’équilibre tenu entre ces deux thèmes réellement incarnés par le truchement des trois protagonistes, combinant plusieurs générations et plusieurs points de vue et modulant, de surcroît, divers aspects de la trahison pour le moins inattendus. Or tout se fond dans un récit très vivant, aux pesonnages et au décor extrêmement présents, sans compter la langue très imagée et très évocatrice de l’écrivain-poète.
°°°
Au fil d’un entretien paru ce matin dans Le Monde avec un des grands idéologues de l’islamisme pur et dur, proche d’Al Quaida, la journaliste s’évertue à faire passer pour un type fréquentable. Deux pleines pages pour dire quoi ? Que ce barbu « frais et rieur » s’est distancé de son ami terroriste Al-Zarkawi ! Quel soulagement, n’est-ce pas !
Quant à moi, je n’y ai vu qu’un nouvel avatar de l’idiotie utile volontiers relayée par le grand journal français qui, à l’époque glorieuse de Mao et de ses gardes rouges, montrait la pire complaisance au nom d e l’objectivité, etc.
Bref, j’ai composé une liste assez carabinée, intitulée Ceux qui prônent le djihadisme bio, que j’ai illustrée avec l’effrayante grande toile de Yan Ping-Mei représentant un front noir de femmes en burkas, etc.
°°°
La description très précise et, surtout, très plastique, du monde de l’enfance, dès les premières pages de Jeune homme, troisième tome de l’autobiographie de Knausagaard, a quelque chose de très évocateur, et pour chacun je crois ; en tout cas je ne cesse, en découvrant ce monde de l’île de Tromlyø, pourtant si différent du nôtre mais dont chaque détail est grossi comme sous une loupe, de me retrouver soit dans les hauts de Lausanne, dans le quartier de notre enfance, soit au Wesemlin, à Lucerne, où je ne me suis jamais senti à l’aise mais où j’ai éprouvé des sensations d’autant plus vives, à vrai dire inoubliable, comme j’en ai égrenées dans Le pain de coucou.
°°°
Ne rien attendre de personne, ne faire que donner et n’espérer rien en retour : c’est une règle correspondant à la fois à mon expérience de l’inattention et de l’indifférence de tant de gens, mais aussi au sentiment profond que j’éprouve que donner est meilleur que recevoir.
À La Désirade, ce vendredi 30 septembre. – Retour a casa ce soir, après un voyage ralenti par les encombrements routiers, mais agrémenté par la lecture de deux belles nouvelles de Ian McEwan, dont la meilleure constitue une assez superbe évocation de Los Angeles. Cela étant je ne serai pas fâché de retrouver, ce soir, notre maison sur la hauteur et mes travaux divers - ce qu’on appelle nos pénates. -
Pour tout dire (71)

À propos du don et de la réciprocité, de la générosité intéressée, du Charity Business, du mécénat spéculateur et de l'amitié gratuite. Ce que nous dit Timon d’Athènes d’un certain William Shakespeare...
Plus je vais et plus je ressens de joie à donner sans contrepartie, et plus aussi je me sens reconnaissant envers la vie, qui donne elle aussi sans rien demander.
J'ai relevé récemment, dans l'autobiographie de Karl Ove Knausgaard, dont la profondeur à été taxée de superficialité par ceux dont l'inattention trahit la double incapacité d'accueillir et de donner - j'ai relevé donc ce trait qui nous est commun de trouver plus enrichissant de donner que de recevoir.
Il va de soi que j'aime bien, comme un peu tout le monde, les cadeaux. Ceux qui me font le plus plaisir sont les carnets que m'offrent nos filles ou Lady L. à leurs retours de voyages plus ou moins lointains. J'ai beaucoup aimé aussi recevoir un magnifique paysage de Karl Landolt de la part de mon cher Alfred Berchtold, le plus grand historien (environ 2 mètres quand il se tient debout même un peu penché) que je connaisse, doublé d'un homme à la pénétration spirituelle rare, resté l'enfant qu'il fut à Montmartre où son paternel représentait la firme suisse Landis & Gyr, et que ses petits condisciples de la communale surnommaient Pingouin. Monsieur Berchtold m'a énormément donné, notamment lors de la préparation du livre issu de nos entretiens que j'ai intitulé La passion de transmettre, publié à la Bibliothèque des Arts, mais je sais que l'attention respectueuse que je lui ai offerte lui a aussi été un don précieux.
Nous parlions hier soir, avec de jeunes amis décidés à s'engager dans une action "humanitaire", du don sans contrepartie. Cette idée défendue par la trentenaire Marine, qui n'a rien pour autant d'une sainte nitouche, m'intéresse dans la mesure où elle privilégie le désintéressement personnel pour se concentrer sur le don réel. Dans la même conversation, il a été question des millions récoltés par une organisation caritative suisse pour les victimes du séisme de Katmandou, jamais distribués aux intéressés pour des raisons politico-administratives, entre autres motifs chaotiques.
Alors quoi ? Donner pour donner ? Ou donner pour rien, si n'est entretenir sa bonne conscience ? Donner les yeux fermés pour la seule beauté du geste ? Bullshit !
Le don qui me remplit de joie se fait les yeux et le cœur grand ouverts, et compte sur moi pour vérifier que tu l'as bien reçu. Si je t'envoie gratos mon dernier livre, ce n'est pas pour que tu me remercies comme d'une boîte de truffes ni que tu m'en fasses des compliments plus ou moins sincères, mais parce que ce don me fait le même plaisir que celui d'avoir écrit ce livre et que cette joie-la ne se comptabilise pas; et si le livre est content de se savoir lu, moi ça ne me regarde plus, sauf que je tiens à l’oeil notre amitié qui exige une autre forme de réciprocité. Poil au nez.
Autant dire que l'art de recevoir est aussi une forme de don, et qu'il n'y a pas d'amitié ou d'amour sans accueil ni reconnaissance en partage.
La générosité intéressée prend aujourd'hui de multiples formes, exacerbée par l'omniprésente obsession du profit ou du retour sur investissement, et ce qu'on appelle le Charity Business en est le plus douteux avatar.
La pièce de Shakespeare intitulée Timon d'Athènes illustre la double face, claire et sordide, d'une folle prodigalité aboutissant à une non moins folle misanthropie au motif que sa largesse a été sans retour.
Un mec hyper-riche du nom de Timon, hyper-généreux avec ses amis poètes fauchés et autres artistes dans le besoin, achète pour ainsi dire l'amitié de tout le monde en régalant les uns et les autres à sa table, jusqu'au jour prochain où son intendant, à qui on ne la fait pas, lui annonce que ses dons insensés ont vidé les caisses et les coffres de sa maison. Alors, à peine affolé, sûr que ses amis vont le tirer de son hyper-endettement, l'adorable Timon découvre la déplorable réalité en constatant que tous se défilent avant de se défouler contre lui en belles paroles bien morales de faux-culs stigmatisant sa coupable imprévoyance et sa damnable imprudence, etc.
Sur quoi le tendre Timon, le doux amis des arts et de la culture, le sponsor de tous les projets hyper-cools se réveille dans le froid du monde et, réfugié sous un rocher sauvage, loin d'Athènes la pute et de ses flatteurs pourris, se déchaîne dans un discours anti-social et anti-tout aussi follement lucide (et vain) que l'a été son fol aveuglement.
Ce qu'il y a de bien avec Shakespeare, c'est qu'il n'est jamais moralisant, où plutôt que les plus sages paroles qu'il nous balance ne sont pas le fait de pères sourcilleux ou de mères avisées, de conseillers graves, d'experts psychologues ou de théologiens multitâches, mais de foldingues joyeux et de bouffons inspirés.
L'amitié vraie a les yeux ouverts et ne se paie ni de mots ni de monnaie de singe, et l’amour à l’avenant. Si tu exiges que je trahisse mes sentiments ou mon idée du monde par amitié, je vais t’envoyer faire ami-ami ailleurs; et si tu me la joues à l'Amour-Toujours ou me fais du chantage à la Moi-ou-Personne, je saurai, ma douce Lady L., que ce n’est pas toi qui parles mais qu’on a piraté ton profil sur Facebook, etc. -
Ceux qui ont des principes

Celui qui par principe ne prête qu'aux pauvres peu dépensiers / Celle qui dit que le vice d'Archimède déplaît aux boulons de la paroisse des essieux / Ceux qui en principe sont plutôt centre gauche mais qui si Trump passe se remettront au minigolf / Celui qui sort du bus quand un sculpteur y coule un bronze / Celle qui a gardé sa mentalité de lutteuse à la culotte après que ce sport fut déclaré l'apanage des Alémaniques blonds et fessus / Ceux qui impriment des sentences optimistes sur des bandes de calicot qu'ils brandissent devant la prison des Visitandines / Celui qui valide le ticket du cheval misant sur le nouveau pape sympa / Celle qui rue dans les brancards syriens au motif qu'ils provoquent des bouchons sur l'autoroute du Fun / Ceux qui font un safari dans la jungle de Calais / Celui qui clame "Plus jamais ça" avant de remonter dans le tank de la paix / Celle qui demande aux droits de l'homme s'ils sont clean / Ceux qui retombent toujours sur leurs pieds de biches / Celui qui affirme que les principes doivent être adaptés à la nouvelle situation et ça mon gars ça se négocie pas ou alors on va au procès qui a un prix comme tu sais / Celle qui en tant que néo-bas-bleu attitré de la fac des lettres de Geneva Airport ne saurait décrier la poésie de Joan Baez qu'on a dit la Desdémone des campus de la grande époque où elle-même portait des colliers de coquillages peints à la main et autres signes de libération à tous les niveaux / Ceux qui accoutument de voir tout en noir quand le soleil rit jaune / Celui qui reste droit dans ses bottes à l'instant d'ouvrir son parachute doré / Celle qui a toujours vu le beau côté des choses quand ses amants socialistes l'emmenaient aux Bahamas ou aux îles Caïmans / Ceux qui de Donald Trump disent que ce n'est même pas un Mickey, etc. -
Pour tout dire (61)

À propos des gradations d'âge et de qualité finement distinguées dans le roman autobiographique de Karl Ove Knausgaard. De la régression actuelle dans la puérilité narcissique des immatures égalitaires. Du bien que ça fait d'admirer une tulipe ou de buter sur le mystère d'Hamlet.
L'esprit du temps, ou plus exactement son manque total d'esprit, se caractérise par la tendance à niveler toute différence et toute gradation dans le repérage des qualités de tel objet ou de telle personne, ce qui équivaut à nier la réalité du temps et donc de toute expérience.
Je n'ai cessé de penser à ce phénomène actuel, qui fait que certains jeunes gens de ce temps se font d'autant plus agressifs, envers ceux qui en savent plus ou ont vécu plus qu'eux, qu'ils sont ignares et s'en vantent par devant tout en se le reprochant au fond - je n'ai cessé d'y penser en lisant les quelque 1800 pages des trois premiers des six volumes du "roman" autobiographique de Karl Ove Knausgaard, véritable creuset d'observations fines en la matière.
Reconnaître une gradation entre son inexpérience, tout à fait naturelle et possiblement sympathique, et le savoir acquis de ses aînés, revient à déroger au conformisme ambiant entretenant l'illusion que nous sommes tous égaux point barre.
Au demeurant il ne s'agit pas que de savoir et de diplômes, mais d'abord de peaux et d'os, du point de vue de la nature, et d'éducation, d'initiation et d'évolution dans les acquisitions de la culture, de la tribu à la pacification planétaire.
Knausgaard, autour de sa trentaine tardive, et plutôt dans sa quarantaine, a autant de recul sur ses âges et mues successifs que le Proust de la grande synthèse, même s'il n'a pas du tout le génie océanique de l'auteur de la Recherche et que la société nivelée de nos jours est peu comparable avec celle du début du XXe siècle, mais la même gradation précise distingue les univers de l'enfant Karl Ove de celui de ses parents et grands-parents, semblable à celle que le Narrateur marque par rapport aux siens, dont il importe peu qu'il les craigne (peur constante et même panique des colères du père) ou les aime, comme il distingue les groupes se formant et se transformant au fil de l'âge.
Il n'est aucun auteur contemporain de la génération suivant la nôtre - laquelle à marqué une nouvelle mise en valeur hégémonique de la jeunesse devenue clientèle - à part un Michel Houellebecq, qui m'ait immédiatement et continûment autant intéressé que cet écrivain norvégien dont l'écriture est cependant loin de se hisser au niveau d'inventivité formelle et de musicalité d'un Proust, d'un Céline ou d'un Joyce.
Là encore, le rétablissement des critères graduels s'impose, qui empêche de comparer tout et n'importe qui, Knausgaard et Proust, ou Shakespeare et Bob Dylan...
À un moment donné, Karl Ove Knausgaard constate en observant ses grands-parents paternels , qu'ils détonent dans le cadre familial. Comme si l’on incrustait des personnages en noir et blanc dans une photo en couleur !
Ou voici Karl Ove ruer dans les brancards: “Dans ma chambre, je n’avais qu’une hâte, celle de devenir adulte. De pouvoir décider librement de ma vie. Je haïssais papa, mais j’étais entre ses mains, pas moyen d’échapper à son pouvoir. Impossible de me venger autrement qu’en pensée et en imagination, mais là je pouvais l’écraser. Là je pouvais grandir, le dépasser en taille, lui saisir le visage d’une main et le serrer pour que ses lèvres aient la même forme que ma bouche, si ridicule à cause de mes dents qui avançaient et qu’il avait imitée tant de fois”...
Mais du temps à passé et notre vie à connu des mues successives constituant autant de "moi " plus ou moins liés ou séparés, dont une seule voix rend compte chez un écrivain de qualité.
Notre insignifiante biographie , dans le gracieux ballet ondulatoire des étoiles et des particules, est pourtant digne d'autant de récits que nous sommes de personnes distinctes. Par delà nos enfances et nos amoureuses initiations, nos travaux et nos journées, nous n'en finissons pas de lire l'avenir dans les mains ouvertes des livres de jadis et de tout à l'heure.
Le jour se lève sur les couleurs de l'automne et nous allons faire avec nos vieilles osses . Un ami m'annonçait hier soir la mort de son père alors que je venais de rire de bon cœur à la lecture de son dernier livre. L'une de nos filles peaufine la nouvelle association humanitaire qu'elle et quelques amis ont fondée pour venir en aide aux orphelins du Cambodge relevé de son martyre. Sa sœur aînée s'adapte courageusement à la vie américaine avec son conjoint de non moins bonne volonté. Lady L. se remet tout aussi crânement de sa fracture du péroné et la vie continue - gracias a la vida.
Sur quoi je tire ma révérence à Knausgaard que je ne retrouverai que l'an prochain dans le quatrième volume traduit de son long fleuve intranquille, or perhaps should I read it in the english version of Dancing in the dark, but just now it's time to ask us again the very very question for a champion: to be or not to be, so back to Hamlet, after le toubib ce matin à 11h, etc.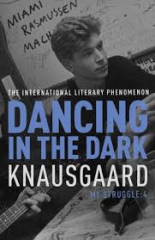
-
Ceux qui n'aiment rien
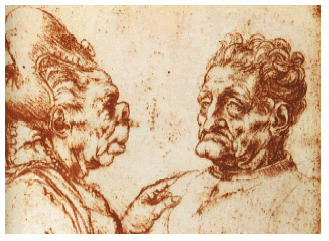
Celui qui enrage d'avoir à se retrouver ce matin dans le miroir avec sa gueule d'hier / Celle qui fesse son fils au dam du Conseil psychologique du jardin d'enfant syndiqué / Ceux qui lisent le prochain Goncourt avant de savoir le nom de son auteur / Celui qui ramène tout ce qui le dépasse à la hauteur de son tabouret / Celle que tu agaces quand tu lui dis ton admiration pour un tableau qu'elle n'a pas peint elle-même alors qu'on est tous égaux comme l'a dit François Hollande le chef de rayon qui a fait des études / Ceux qu'une estime de soi défaillante fait détester qu'on les critique pour la marque de leur portable / Celui qui aimerait tuer son père par conformité au complexe d'Oedipe qu'a décelé chez lui le psychiatre de Maman qui la tringle par ailleurs à sa place / Celle qui nous a fait un complexe d'Electre juste après avoir "mis ses dents" puis est rentrée dans le rang des majorettes / Ceux qui vont voir la rétrospective de Bernard Buffet qu'on a dit le Goya de l'époque Pompidou / Celui qui n'ose jamais formuler le moindre jugement personnel sur quoi que ce soit pour s'en tenir à l'avis des experts de Facebook où là t'es sûr de partager / Celle qui a vu une fois une pièce de Shakespeare à la télé sans oser dire qu'elle s'est endormie pendant la publicité / Ceux qui ne voient pas ce qui distingue Shakespeare de Bob Dylan vu que les deux sont de vieux croûtons / Celui qui cite parfois Socrate au bureau en remarquant que lui au moins sait qu'il ne sait rien sans s'aviser de cela que tous l'avaient remarqué sans le lui balancer vu que l'Entreprise conseille la discrétion / Celle qui propose un selfie à Marc Lévy dont les histoires la concernent personnellement / Ceux qui restent vides faute de rien donner, etc. -
Sous le regard de Dieu

Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre petit texte de rien du tout dans une grande partition chaotiquement harmonieuse. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, mais je n’en suis même pas sûr. Il n’est pas d’un croyant, ou pas au sens des églises et des sectes, mais cela aussi se discute. Il oscille entre la philosophie non académique, le Grand Récit de la science tel que l’évoque un Michel Serres, l’art et la poésie, l’Eros et la tragédie, Apollon et Dionysos, Rabelais et Pascal, le Christ et le Zen, mais je le voudrais à l’instant sans référence aucune.
J’écris tous les jours « sous le regard de Dieu », mais je n’écris que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux. Je ne suis personne en cet instant, mais je suis à la fois un gosse de sept ans jouant au parc Monceau, une vieille femme assise sur un banc à Cracovie, un prostitué californien du nom de Dale Bradley, un collectionneur des autographes de Purcell, un âne immobile dans le champ fleuri d'à coté, l’organisatrice des concerts de clavecin du quartier de la Muette, un punk des faubourgs de Belfast, Roméo et Juliette, Paul Cézanne ou Louis Soutter qui ne signent pas leurs tableaux, le modèle damné de Monsieur Ouine que je relis pour la énième fois, ma bonne amie et nos filles chéries actuellement en Colombie et en Jordanie, les cendres de mes parents dans leur humble tombe commune.
Ecrire « sous le regard de Dieu » ne se réduit pas à une soumission peureuse mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».Peinture JLK: Arrière-pays, huile sur panneau, 2007.
-
Ceux qui font le joint

Celui qui sait de source sûre que la pâtisserie préférée de Bob Dylan est l'Hamlet norvégienne / Celle qui a lu TOUT Shakespeare en écoutant Homesick blues en boucle mais ne se rappelle plus ni ceci ni cela vu qu'elle a rencontré Jésus en écoutant Alain Finkielkraut sur France-culture / Ceux qui signalent la pléthore du signifié dans l'œuvre de William Shakespeare que Bob Dylan ne surdétermine que par l'oreille / Celui qui n'a pas lu Annie Ernaux par l'oreille et suspend donc son jugement tandis que le wind blows dans le feuillage automnal / Celle qui constate que Pierre Assouline dégomme Bob Dylan le Shakespeare à Fender comme il l'a fait de Knausgaard le Proust norvégien à Stratocaster comme quoi y a une logique même chez les académiciens Goncourt / Ceux qui rappellent que Dylan a écrit plus de 500 chansons donc plus que Shakespeare de pièces considérées de sa seule main et encore c'est pas sûr / Celui qui explique que le sampling est le propre de Bob Dylan autant que de DJ Shakespeare qui mixait des masses de vieilles pièces pour en faire de neuves / Celle qui attend le discours de Stockholm pour se faire une idée / Ceux qui voient en Renaud un Zola avec accordéon / Celui qui affirme que Bob Dylan est le Walt Whitman du blues alors que celui-ci préférait la gymnastique suédoise et les beaux marins / Celle qui a fait du jogging avec un autre Robert Zimmerman blond et bien découplé dans les parcs arborés de Houston Texas / Ceux qui répètent qu'il faut absolument lire les Chronicles de Bob Dylan même sans savoir l'anglais / Celui qui reconnaît qu'y comprend rien aux paroles des chansons de Dylan pas plus qu'au sous-texte des tragédies de Shakespeare qui d'ailleurs finissent trop mal / Celle qui se dit la Lady Macbeth du rock industriel / Ceux qui rappellent que la tradition des bardes remontent à des temps immémoriaux genre l'époque viking avec les slips de peau de renne et les vierges nattées style Björk / Celui qui fait valoir à ses élèves de terminale que comparaison n'est pas raison tout en les invitant à plancher sur ce qui relie Raymond Carver le Tchékhov américain et Patrick Modiano le Tourgueniev français, etc.
-
Le gag du Nobel

(Dialogue schizo)
Bob Dylan rejoint Sully Prudhomme. Quand le gâtisme se la joue jeunisme attardé. À quand le Nobel de la BD et du tag ou de la sitcom ? Un bel hommage du poète italien Erri De Luca…
Moi l’autre : - Alors compère, le Prix Nobel de littérature à Bob Dylan, tu kiffes grave ?
Moi l’un : - C’est peu dire : je me sens cinquante berges de moins ! J’me revois à Woodstock. Je plane à l’île de Wight ! Non mais j’y crois pas : j’ose pas croire qu’ils aient osé ! J’les croyais vieux jeu c’te bande, enfin quoi Modiano c’était quasiment la France de l’Occupation et les boutiques obscures, et v’là le coup de djeune. Notre vieux camarade Dario Fo se tire en douce et v’là Tambourine Man le dealer ! Tu veux quoi de plus, blaireau ?
Moi l’autre : - Je sens comme un relent d’ironie dans ton propos… Non mais vraiment, littérairement parlant, tu trouves que les chansons de Dylan tiennent la route à côté, j’sais pas moi, de Dante ou de Shakespeare ?
Moi l’un : - T’as dis quoi : littérairement parlant ? Mais tu sors d’où ? T’oserais expliquer à des kids, littérairement parlant, ce que racontent les chansons de Dylan dont aucun ne connaît aucune ? Et d’ailleurs Dante et Shakespeare, tu crois qu’ils auraient eu le Prix Nobel de littérature, même s’ils assurent littérairement parlant ?
Moi l’autre : - Ah mais tu biaises. Je vais donc de te le demander frontalement: les chansons de Bob Dylan, dont je sais que tu en aimes pas mal, relèvent-elles de la littérature, ou disons de la poésie psalmodiée, et méritent-elles d’être placées plus haut que les plus hautes œuvres présumées de la littérature américaine contemporaine, puisque c’est les States qu’on galonne enfin ?
Moi l’un : - Tu connais Sully Prudhomme ?
Moi l’autre : - Euh, oui, enfin, euh, non, pas vraiment…
Moi l’un : - Ecoute ça, je ferme les yeux et te le récite par cœur :
Le vase où meurt cette verveine
D'un coup d'éventail fut fêlé ;
Le coup dut l'effleurer à peine :
Aucun bruit ne l'a révélé.
Mais la légère meurtrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D'une marche invisible et sûre,
En a fait lentement le tour.
Son eau fraîche a fui goutte à goutte,
Le suc des fleurs s'est épuisé ;
Personne encore ne s'en doute,
N'y touchez pas, il est brisé.
Voilà, mon cher, les vers du premier prix Nobel de Littérature, en 1901. Un poète de l’Académie française de l’époque, que les académiciens suédois d’aujourd’hui eussent snobé, ça ne fait pas un pli.
Maintenant je ferme les yeux et je me pince le nez pour te chuinter cette ballade :
Come gather 'round people
where ever you roam
And admit that the waters
around you have grown
And accept it that soon
you'll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin'
Then you better start swimmin'
or you'll sink like a stone,
For the times they are a' changin'!
Moi l’autre : - En somme d’après toi, y aurait que les académiciens suédois à ne pas changer avec le temps ?
Moi l’un : - Je ne serais pas aussi catégorique. Ce que je dirais plutôt, c’est qu’ils se sont montrés extraordinairement académiques en 1907 et qu’ils ne l’auront pas été moins cette année, même en consacrant un poète populaire non-académique selon nos codes. C’est leur choix qui est archi-convenu. Entre deux, il leur est arrivé de faire mieux...
Moi l’autre : - Ah bon, voilà que tu sors du bois ! Donc tu ne penses pas, au tréfonds de toi, que ce choix soit si cool ?
Moi l’un : - Je pense que c’est une totale foutaise qui apparaît dès que tu mets une chanson de Bob Dylan à côté d’un poème de Dylan Thomas, et quelque intérêt et charme qu’on puisse trouver aux ballades de celui-là. Les chansons de Dylan traduisent l’esprit et la rage, l’envie de vivre et la douleur de toute une génération confrontée, notamment, au matérialisme triomphant de l’après-guerre, au racisme et au carnage du Vietnam. De surcroît, et c’est bien moins connu, les Chronicles de Dylan révèlent bel et bien une patte d’écrivain, mais consacrer cette « œuvre » pour écarter une fois de plus celle de Philip Roth, qui aurait dû être nobélisé il y a dix ans au moins, fait figure de gag. Dans la foulée, on attend le Nobel du tag, du rap ou de la sitcom...
Moi l’autre : - Ceci dit, notre compère JLK nous disait, l’autre jour, que l’auteur italien Erri De Luca fait le plus bel éloge de Bob Dylan dans son dernier livre, Le plus et le moins…
Moi l’un : - Auquel je souscris - les yeux fermés une fois de plus…
Moi l’autre : - Ah bon, parce que tu l’as lu ?
Moi l’un : - Non seulement je l’ai lu mais je l’ai appris par cœur et le voici en bribes : « La révolte n’était pas seulement politique : il n’était pas seulement question du funeste et détestable Vietnam où étaient anéanti pour rien un pourcentage énorme de la jeunesse américaine, prise et envoyée crever et s’aigrir dans les marécages du Mékong ».
Voilà ce que De Luca écrit d’abord, et ensuite : « Dylan sifflait le départ d’un train, en appelant dehors une génération vaste comme elle ne l’avait jamais été auparavant à l’échelle mondiale. Le monde était devenu un. Une jeunesse chantait Dylan et s’affrontait à toutes les polices, de Prague à Berlin, à Paris, à Rome, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Les mêmes couplets et des airs identiques : être du même âge, avoir une même musique à jouer dans la rue ou dans un pré, donnaient des frissons. Aujourd’hui, le monde est un marché unique, à cette époque-là c’était une seule jeunesse »…
Moi l’autre : - Et tu ne trouve pas que ça vaut un Nobel autant que celui de Kissinger ?
Moi l’un : - Ne mêle pas les serviettes immaculées (hum) de la littérature et les torchons de la politique. D’ailleurs je continue à citer Erri De Luca les yeux fermés : «Mais lui, Dylan, ne pouvait se contenter de la politique, de l’amour. Il chantait et il passait son chemin. Il ne voulait pas, n’a jamais voulu être le guide de personne : il voulait la liberté de se perdre ».
Moi l’autre : - Oui, c’est un bel hommage, et qu’on pourrait faire aussi de Fabrizio De André, de Jacques Brel ou de Georges Brassens et Léo Ferré…
Moi l’un : - Dans les plus étroites largeurs, tu as raison. Mais qui aurait l’idée loufoque de les proposer au Nobel à titre posthume ?
Moi l’autre : - Donc ta réaction n’est pas vraiment élitiste ?
Moi l’un : - Absolument pas, et je ne crois absolument pas, non plus, à la sincérité des académiciens suédois, dont on sait qu’ils se sont battus comme des chiffonniers pour ne pas consacrer ces grands écrivains de portée internationale que sont Philip Roth (la bête noire de certains d’entre eux) ou Amos Oz l’Israélien magnifique, le poète libanais Adonis (qui a eu le front de s’en prendre à la barbarie islamiste !), Haruki Murakami le Japonais ou Antonio Lobo Antunes le Portugais, etc. Donc on te sort Dylan du chapeau et tout le monde est content d’être mécontent, en parfaite démagogie pseudo-moderne.
Moi l’autre : - Ce qui ne vas pas nous empêcher, compère, de nous passer Desolation row en nous désolant pour plus grave que ça.
Moi l’un : - Let’s go, it ain’t me Babe…
-
Wajda pour mémoire

À propos de Katyn l’un des films du grand réalisateur polonais Andrzej Wajda, témoin de l’Histoire du XXe siècle, qui vient de s’éteindre à l’âge de 90 ans. L’auteur du magnifique Cendres et diamants et de L’Homme de fer, entre tant d’autres oeuvres de premier plan, fut l’un des initiateurs du Musée Czapski de Varsovie, à la mémoire de son ami Joseph Czapski, qui consacra sa vie à rétablir la vérité sur le charnier.

J'ai vu ce soir les corps tomber l'un après l'autre dans la fosse, après les balles tirées à bout portant dans chaque tête, et je revoyais le vieil homme dans sa mansarde de Maisons-Laffitte, à la fin des années 70, qui pleurait pendant que je lui lisais des pages de Nuits florentines.
Ensuite le film de Wajda m'a laissé comme abattu, physiquement lessivé, sans voix. Je savais pourtant à peu près tout de Katyn, et d'abord de vive voix par Czapski, avant même la lecture de ses livres; je savais que tout ce qui était raconté là s'était réellement passé. Je le savais par l'esprit, mais le cinéma parle au corps, les images parlent aux sens et aux nerfs, le matraquage est réel et le fait est qu'il m'a semblé vivre ce soir dans mon corps, tout bien assis dans mon fauteuil que je fusse, l'atroce fin de ces hommes massacrés l'un après l'autre par les sbires de Staline.
Je savais pour l'essentiel ce que signifiait le nom de Katyn et tout ce qui l'entourait, bien au-delà du seul charnier désigné par ce nom. Je savais tout ce que, désormais, tout quidam soucieux d'en savoir plus sur cette "tragédie parmi d'autres" survenues entre 1939 et 1945: je connaissais le détail de la manipulation soviétique et l'opération de propagande longtemps entretenue en France et en Occident, visant à attribuer le massacre aux nazis. Je savais les circonstances de ce crime de masse occulté et comment, par exemple, le major-général du NKVD Vassili Mikhailovitch Blokhine en personne, vêtu d'un tablier de boucher et armé d'un pistolet allemand Walther PPK, avec l'aide de deux exécuteurs fameux, les frères Ivan et Vassili Jigarev, "traita" 7000 hommes en 28 nuits pendant que des millions de pères de famille soviétiques (présumée bons) crevaient sur le front de la même mort que des millions de pères de famille allemands (présumés méchants), et je revoyais Joseph Czapski, dont une partie de la vie avait été consacrée à rétablir la vérité sur l'assassinat des 25.000 officiers et étudiants polonais assassinés par les Soviétiques, qui pleurait ce jour-là sur une page des Nuits florentines de Heinrich Heine que je lui lisais dans sa modeste soupente où voisinaient ses toiles récentes et les centaines de carnets reliés de son légendaire journal.
Les bras réunis autour de ses immenses jambes pliées, ses immenses mains jointes comme pour une prière, la voix haut perchée d'un vieil enfant, Czapski m'avait donc demandé de lui lire deux ou trois pages des Nuits florentines que notre ami Dimitri aimait tant lui aussi et qu'il rééditerait des années plus tard, mais je ne me rappelle pas ce qui avait tant ému, ce jour-là, l'artiste octogénaire revenu de toutes les horreurs du XXe siècle - des bombardements de Varsovie où l'essentiel de son oeuvre avait été détruit, à la bataille de Monte Cassino où les Polonais avaient appris la forfaiture des Alliés les livrant à une nouvelle dictature. Je ne me souviens pas de la source de cette émotion si vive, mais celle-ci me rappelle, à l'instant, les mots que Varlam Chalamov consacre à la rosée du matin dont les perles scintillent au soleil, derrière les barbelés du goulag...
Un homme est trop fragile pour résister à une balle qu'on lui tire à bout portant dans la tête. Mais le même homme fragile est capable de résister à la violence par son art ou par ses larmes. -
Pour tout dire (48)
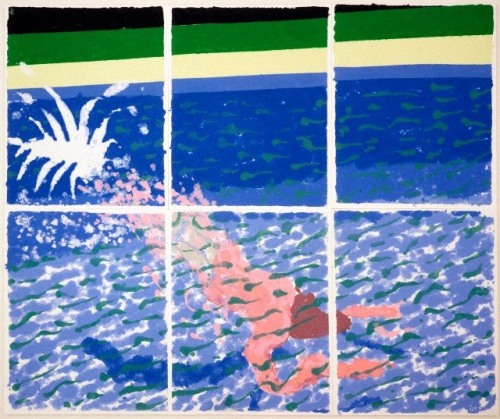
À propos de l'appareillage sensible particulier de l'écrivain et de l'artiste, du genre capteur multisensoriel à réfraction différenciée. De la distillerie proustienne, de l'orchestration des orages beethoveniens et des machines à coudre à la Jean Sébastien Bach. Sur une topologie norvégienne de l'enfance universelle et des vertus de l'observation panoptique.
Certains démagogues égalitaires voudraient que tout un chacun et chacune fût un Rimbaud ou une Rimbalde potentiels, en attendant que les mecs accouchent par l'oreille comme les mères facétieuses de Rabelais. La maladie de l'époque est une sorte d'envie mondiale d'être tous pareils en clones gris et d'apparaître uniformément aux écrans en réseau dont la webcam serait l'outil transitionnel parfait. Par dela le quart d'heure de célébrité selon Andy Warhol , voici la minute heureuse de Baudelaire à portée de tout humanoïde connecté. Y a plus photo: ya plus que photomaton !

Seulement voilà: Lascaux résiste au nivellement. Tu peux gesticuler dans ta caverne après t'être shooté à la coke ou aux cookies: l'Artiste de la horde n'est pas tout le monde. En revanche tout le monde peut reconnaître l'unique beauté des figures d'Altamira et fermer les yeux à l'écoute de Mozart ou changer de point de vue après Cézanne ou le conte sous les étoiles du griot de la tribu.
Voilà ce que je pianotais cette nuit à 2 heures du mat' sous l'effet d'une insomnie postopératoire, juste avant un rêve durant lequel je surprenais la très belle Anielka, Gitane dans la vingtaine au sourire enjôleur et vaguement sournois, dans mon antre artiste du Vieux Quartier lausannois des escaliers du Marché, où elle s'était manifestement installée depuis quelque temps au point de transformer le lieu en campement à l'orientale chatoyant avec ses tentures murales et ses objets de cuivre et autres carafes ou brûle-parfums saturant ma trappe d'odeurs de musc et de santal - quel souk digne de notre amie la romancière érotomane Asa Lanova !
Sur quoi je découvrais qu'Antocha ( elle avait changé de prénom à mon insu) avait fait sauter le fragile verrou d'entrée pour investir mon lieu de vie. Effraction criminelle ! Et moi qui allais proposer à la charmeuse (elle m'avait pour ainsi dire bouleversé par le récit misérabiliste de sa pauvre vie de Cosette moldo-valaque) de se considérer comme chez elle dans ma thébaïde inoccupée depuis 35 ans. Donc je pique une rouge colère et lui crie soudain RAUS comme un vrai Suisse de bunker, tout en me détestant d'en arriver là alors que je prône sur les toits l'accueil des migrants et vitupère l'abominable égoïsme de l'Europe xénophobe - et voilà que je me réveille pour me rappeler que j'ai rendu les clefs de mon bien-aimé repaire bohème à la fin de l'hiver 1982 pour suivre Lady L dans sa 2CV bleue, destination notre nouvelle vie.
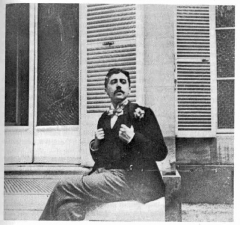
L'immense rêve éveillé de Proust est unique dans les archives françaises de l'onirologie littéraire, à quoi ne peut se comparer que le corpus des 1001 nuits.
L'extravagant appareillage sensitif de Proust, combinant des multicapteurs physiques à variables ondulatoires et corpusculaires rarissimes dans le climat feutré de la bourgeoisie, explique en amont la génialité particulière de cet emmerdeur aux yeux de biche et aux exigences de prince pervers porté sur les chauffeurs de taxis fous d'aviation. D'aucuns s'ankylosent à lire ce snob hystérique, mais le fait est là: l'enfant Marcel a rêvé le plus grand roman du XXe siècle et l'extraordinaire fraîcheur de son brocart - tant au niveau du signifié que du signifiant, comme le relèverait ma coiffeuse linguiste - reste sans égale même dans le nuancier pictural d’un Bonnard ou la volière mystique d’un Messiaen.
La lecture de Proust est un apprentissage de lenteur attentive, et c'est fort de celle-ci que je me suis remis l'autre jour à celle de L'enfer de Dante dans une nouvelle traduction versifiée ( à moi la peur !) et ce matin à la suite du Jeune homme de Karl Ove Knausgaard, qui parle de notre enfance des années 50-70, en zone de nouvelles urbanisations ouvertes à la classe moyenne occidentale, comme personne.
Le petit Karl Ove a été amoureux, à l'âge de sept ans, avec autant de folle intensité que d'innombrables enfants normalement anormaux, capables égalitairement de dessins fabuleux pleins d'arbres bleus et de chevaux verts à crinières de feu, captant la merveille et l'effroi d'être au monde - comme personne.
Banale au possible au premier regard: sa façon de raconter la panique mortelle qui le saisit quand il s'est enfilé, avec son copain Geir, dans un tuyau de ciment au milieu duquel il s'est senti soudain coincé et paralysé . Or un million de fois vous avez fait le même cauchemar tétanisant, évidemment lié à un souvenir de votre entrée au monde, n'est-ce pas Herr Doctor Sigmund ?
Ou bien cet enchantement: quand, délivré par son camarade de l'obscur conduit, le petit garçon découvre le ciel immense et les arbres qui parlent tout seuls !
Et l'amour à la première flamme ! Quand la délicieuse Anne Lisbet propose: "Vous êtes des marins, et vous rentrez à la maison chez nous, et on s'est pas vus depuis longtemps. On joue à ca ?"
Défi relevé. Alors les deux filles de se poster sur la terre ferme et de héler les marins:"Vous pouvez venir maintenant !" Et les marins de jeter les amarres et de rejoindre le plus vite possible les impatientes épouses. Et l’ardente Anne Lisbet de s'exclamer comme à la télé : "Ô mon cher mari tu m'as tellement manqué !" Et après un premier enlacement joue contre joue: "Encore une fois !"
Ce matin les nouvelles du monde ne sont pas terribles (d'Alep au tribunal criminel de Genève en passant par la côte Est des States où la nature fait rage autant que la mauvaise créature un peu partout ), mais on va "faire avec". La situation n'est pas pire qu'au temps des aurores aux doigts de rose du toujours jeune Homère, même si tel ou tel psychopathe peut décider de mettre un terme, d’un clic nucléaire, à notre long récit commun.
Carpe diem en attendant et va que je vous je balance ces lignes douces et dures sur Facebook & Co via Cloud, etc.
Aquarelle ci-dessus: David Hockney. -
Ceux qui gèrent leur bronzage
 Celui qu'insupportent les airs supérieurs de la médiéviste en paréo se situant à la gauche de la gauche au bar du Glamour / Celle qui se vexe de n'être point assez regardée ou trop / Ceux qui sont un peu justes et se prennent donc un Mojito pour trois / Celui qui offre un reste de homard aux témoins de Jéhovah qui le refusent poliment d'une seule voix avant de passer au mobilhome des Alsaciens / Celle dont le sourire soleilleux irradie l'allée Bel Horizon du camping de Palavas désormais enclos de barbelés / Ceux qui ont vu l'eau vrombir d'écluse en écluse avant de s'écouler plus tranquillement dans la plaine où l'on voyait les péniches au ras des champs de coquelicots / Celui qui te fait un cours sur les cathares dans les dunes qui ne se souviennent de rien les connes / Celle qui est toujours de mauvais poil en constatant que son bronzage prend du retard sur celui de sa voisine du studio Manhattan / Ceux que le début de canicule fait râler autant que la dernière entrée maritime / Celui qui se sent abeille dans la ruche conviviale de la Grande Motte dont il envisage l'achat d'un studio d'où se voit la grande bleue au bout du parking hélas éclairé toute la nuit / Celle qui s'exclame "tous ces zobs" en se risquant pour la première fois sur la plage naturiste où se remarquent également "toutes ces mottes" / Ceux qui oublient qu'ils bossent au McDo de Pézenas quand ils se retrouvent a pelos sur la plage de Cap d'Agde où se mêlent toutes les classes sociales et même des amis anglais des Giscard d'Estaing / Celle qui le premier jour a lu la première page du denier livre de Marc Musso et ensuite elle s'est concentrée sur son bronzage et maintenant qu'elle va repartir elle va se mettre au deuxième chapitre où il y a paraît-il un passage osé / Ceux qui n'ont bronzé que d'un côté cette année et se finiront l'année prochaine / Celui qui a félicité la patronne du Lagon bleu pour ses moules frites aussi correctes que celles de Belgique et là j'exagère pas / Celle qui a gardé le moral grâce à son wi-fi / Ceux qui lisent du Huysmans avant de s'enfiler dans le Jul's si bien décrit par Michel Houellebecq à l'époque où sa peau supportait le soleil de Cap d'Agde / Celui qui se finira aux U.V. dans son 2 pièces sur cour de Vesoul / Celle qui dit "à l'année prochaine" à la Grande Bleue qui compte ses noyés de la nuit dernière / Ceux qui ne seront pas au soleil cet après-midi mais à Roland-Garros, etc.
Celui qu'insupportent les airs supérieurs de la médiéviste en paréo se situant à la gauche de la gauche au bar du Glamour / Celle qui se vexe de n'être point assez regardée ou trop / Ceux qui sont un peu justes et se prennent donc un Mojito pour trois / Celui qui offre un reste de homard aux témoins de Jéhovah qui le refusent poliment d'une seule voix avant de passer au mobilhome des Alsaciens / Celle dont le sourire soleilleux irradie l'allée Bel Horizon du camping de Palavas désormais enclos de barbelés / Ceux qui ont vu l'eau vrombir d'écluse en écluse avant de s'écouler plus tranquillement dans la plaine où l'on voyait les péniches au ras des champs de coquelicots / Celui qui te fait un cours sur les cathares dans les dunes qui ne se souviennent de rien les connes / Celle qui est toujours de mauvais poil en constatant que son bronzage prend du retard sur celui de sa voisine du studio Manhattan / Ceux que le début de canicule fait râler autant que la dernière entrée maritime / Celui qui se sent abeille dans la ruche conviviale de la Grande Motte dont il envisage l'achat d'un studio d'où se voit la grande bleue au bout du parking hélas éclairé toute la nuit / Celle qui s'exclame "tous ces zobs" en se risquant pour la première fois sur la plage naturiste où se remarquent également "toutes ces mottes" / Ceux qui oublient qu'ils bossent au McDo de Pézenas quand ils se retrouvent a pelos sur la plage de Cap d'Agde où se mêlent toutes les classes sociales et même des amis anglais des Giscard d'Estaing / Celle qui le premier jour a lu la première page du denier livre de Marc Musso et ensuite elle s'est concentrée sur son bronzage et maintenant qu'elle va repartir elle va se mettre au deuxième chapitre où il y a paraît-il un passage osé / Ceux qui n'ont bronzé que d'un côté cette année et se finiront l'année prochaine / Celui qui a félicité la patronne du Lagon bleu pour ses moules frites aussi correctes que celles de Belgique et là j'exagère pas / Celle qui a gardé le moral grâce à son wi-fi / Ceux qui lisent du Huysmans avant de s'enfiler dans le Jul's si bien décrit par Michel Houellebecq à l'époque où sa peau supportait le soleil de Cap d'Agde / Celui qui se finira aux U.V. dans son 2 pièces sur cour de Vesoul / Celle qui dit "à l'année prochaine" à la Grande Bleue qui compte ses noyés de la nuit dernière / Ceux qui ne seront pas au soleil cet après-midi mais à Roland-Garros, etc. Peinture: Terry Rodgers
-
Devant les ruines

Sur une exposition, à Sète, de l’artiste Yan Pei-Ming, Chinois naturalisé français, dont le regard sur les décombres du monde actuel a quelque chose de saisissant...
Ce vendredi 23 septembre. – Intrigués par un article paru il y a quelques jours dans les pages culturelles de l’édition sétoise du Midi libre, où il était question des oeuvres d’un artiste chinois du nom de Yan Pei-Ming, exposées jusqu’au 25 septembre au Centre Régional d’Art Contenporain (CRAC) de Sète, nous nous sommes pointés cet après-midi sur le quai où se trouve le haut-lieu artistique en question, dans les anciennes halles frigorifiques magnifiquement réaménagées par un architecte en vue et entièrement investies par les immenses toiles de Yan Pei-Ming.
De cet artiste d’origine chinoise mais naturalisé français, très en vue dans l’establishment culturel et politique (Fabius était d’ailleurs présent au vernissage sétois), je ne savais rien jusque-là en dépit de son passage au Louvre et autres cimaises prestigieuses, et l’aperçu que m’en ont donné les images de Google m’ont fait craindre le faiseur pseudo-rebelle à la mode (genre assez couru chez les Chinois occidentalisés), dans la mouvance du réalisme-post-pop surfant sur les vagues plastiques de Warhol ou de Lucian Freud à grand renfort de portraits plus ou moins déformés de célébrités (d’Obama au pape François) et autres scènes d’actu si possibles trash; mais d’emblée, dès la première salle réunissant deux immenses toiles « citant » Le Caravage à vigoureux coups de brosse-balai, dans un camaïeu de nuances grises entre le noir et le blanc reproduisant pour ainsi dire les couleurs et le clair-obscur du génial Rital, nous avons été saisis.

Puis ce furent les variations colorées plus convenues (m’a-t-il semblé) sur le fameux pape Innocent de Francis Bacon, déjà démarqué de Velasquez, et du coup je me demandai : est-ce encore de la peinture, et quoi de nécessaire et d’unique dans ces répliques plastiques de photos d’actualité où la découverte du cadavre d’Aldo Moro voisine avec l’attentat contre Jean-Paul II, et cette virtuosité, ce savoir-faire magistral ne font-ils pas que relancer les prouesses techniques du réalisme socialiste (première inspiration de l’artiste né à Shanghai en 1960 et formé à l’époque de la révolution dite culturelle) ou du pompiérisme bourgeois de la fin du XIXe siècle ?

Je me suis posé la question en me rappelant nombre de démarches similaires, aux quatre coins de l’Occident artistique, puis nous sommes tombés en arrêt devant tel cauchemar pictural rappelant de loin Goya ou Saura, qui nous confronte à un vaste charnier nocturne où des chiens se disputent la pauvre chair humaine, tel portrait de Khadafi dont la tête du cadavre semble réduite à un cri réduisant à rien le jugement des Justes, ou tel grand singe à figure rouge, au milieu d’autres décombres, paraissant se demander ce qui est arrivé au monde en proie à ses cousins inventeurs de la poudre et du tout-nucléaire…
(À voir jusqu’au 25 septembre 2016, au CRAC de Sète) -
Lettre à Jacques Chessex

Lettre à Maître Jacques entre la mer, le ciel et la forêt, à l'occasion de la remise du prix Edouard-Rod à Pierre Béguin, marquant les vingt ans de cette distinction littéraire.
Mon cher Jacques,
Je ne serai pas là quand notre ami Jean-Michel Olivier lira ce matin cette lettre à l’assistance réunie à Ropraz pour célébrer le vingtième anniversaire du prix Edouard-Rod que tu as fondé, mais toi non plus n’y sera pas, et cependant je l’écris comme si tu allais la lire toi-même, de même que je continue de lire tes livres comme si tu étais encore de notre côté de la vie.
En me rappelant nos relations parfois houleuses, que m’évoque à l’instant la mer assez agitée de ce matin d’arrière-été quelque peu orageux, je me dis que, par delà les eaux sombres, les livres seuls auront été entre nous ces messagers ailés, hors du temps, semblables à ces oiseaux dont un de tes recueils de nouvelles que je préfère se demande où ils vont mourir, si tant est que les oiseaux meurent jamais dans l’imagination des poètes.
De ton côté, tu m’as dit avoir beaucoup aimé l’un de mes textes, intitulé Tous les jours mourir, dans lequel je raconte nos adieux à notre père, qui nous convia un dimanche matin à une dernière journée en famille, et nous quitta en fin de soirée. Ce que je me rappelle d’Où vont mourir les oiseaux est une certaine grâce et une certaine lumière qui te sont propres, et cette une lumière semblable, dans l’évocation de la dernière journée de mon père, qui t’a touché, m’as tu dit dans la plus belle lettre que j’ai reçue à propos du livre qui nous a rapprochés, intitulé Par les temps qui courent, dans laquelle tu louais un autre récit du même ensemble autobiographique évoquant mes errances aux Etats-Unis, où je m’étais trouvé d’ailleurs à cause de toi puisque tu avais refusé une première invitation de présenter, au Texas (!) le merveilleux Charles-Albert Cingria. Or le texte en question s’intitulait Nus et solitaires, c’était une sorte de blues bleu sombre et comme l’un de tes autres textes que je préfère, dans L’Imparfait, célèbre le blues avec grâce et lumière, nous ne quittons pas la clairière de nos meilleures rencontres.
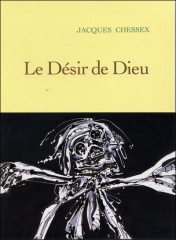
Je reviendrai à ce très beau moment que nous aurons vécu ensemble ici même, à Ropraz, à l’occasion de la remise du premier Prix Edouard-Rod attribué à Par les temps qui courent en 1996, mais j’aimerais évoquer d’abord un autre moment de grâce et de lumière vécu un matin de mai de je ne sais plus quelle année, sur une petite place de Saint-Maurice, en présence d’une centaine de collégiens plus ou moins du même âge que tes fils, au pied des falaises marquées VIVE CHAPPAZ où, à l’occasion d’un festival philosophique, tu avais été convié à prononcer ton Credo.
Nous étions alors à couteaux tirés pour je ne sais plus quelle raison, mais je n’en étais pas moins présent et ce que tu as dis alors aux jeunes gens qu’il y avait là m’a si profondément touché que je suis venu, en fin de séance, te remercier et te serrer la main ; tu m’as dit que mon geste te touchait particulièrement et nous en sommes restés là, sous la belle lumière oblique qui tombait du haut des Dents du Midi, dans la grâce d’un instant.

Au moment où tu a fondé le prix Edouard-Rod avec quelques amis écrivains et le syndic de Ropraz, l’auteur romand le plus célèbre à Paris, au début du XXe siècle, était pratiquement retombé dans l’oubli, et je dois avouer que je n’avais pas lu un seul de ses trente romans ni aucun de ses essais quand j’ai appris que j’allais être le premier lauréat de ce nouveau prix littéraire.
Je connaissais la bienveillante attention qu’Edouard Rod avait manifestée à Ramuz en ses jeunes années, mais j’ignorais que l’écrivain avait été proche de Zola et qu’il avait refusé d’entrer à l’Académie française pour garder sa nationalité suisse. Or ce qui m’a touché plus particulièrement, dans la définition que tu as établie du prix, c’est qu’il devait récompenser un auteur à ses débuts (ce que je n’étais plus au moins depuis vingt ans) ou à un moment de renouveau de son travail, ce que j’étais à l’évidence puisque Par les temps qui courent a été pour moi un livre-charnière, et le début de ma collaboration avec Bernard Campiche, qui en a immédiatement accepté le manuscrit et avec lequel j’ai noué des liens d’amitié et publié ensuite huit livres en moins de dix ans, dans les meilleures conditions.
L’émulation entre écrivains de générations différentes est un phénomène assez courant, mais les vraies complicités sont plus rares entre les bêtes d’écriture que nous sommes, selon ton expression, et le rapport qui s’est établi entre nous quelque temps, entre la composition de mon roman Le Viol de l’ange, que tu as suivie de très près, et la parution de L’Imparfait, l’un de tes plus beaux livres, est lié dans mon souvenir à un mémorable moment de partage.
Plus récemment, assistant à la remise du prix Rod à Antoine Jaquier, j’ai repensé avec reconnaissance à la cérémonie de 1996 ; et brassant, ces dernières semaines, cinquante ans de courrier et de documents de toute sorte que je m’apprête à remettre aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale, suivant ton exemple, ce souvenir a été revivifié par les nombreuses cartes et autres lettres de félicitations qui m’ont été adressées à cette occasion. Moi qui me suis souvent montré critique, dans les journaux où je sévissais, envers le système parisien des prix, j’ai trouvé très bien en revanche, vraiment très bien, de recevoir ce prix Rod décerné, de surcroît, par des écrivains, sans parler de la pincée de billets qui nous a permis de surprendre nos petites filles en leur annonçant, un beau matin de février 1997, à Cointrin, que nous nous envolions pour La Guadeloupe !
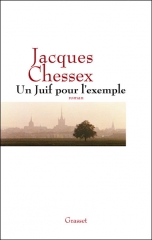
Vingt ans plus tard, alors que l’un de tes derniers livres revit sur les écrans par le truchement d’une adaptation où tu apparais à divers âges, alors que tu me reste infiniment plus présent par la seule magie de ton verbe, la littérature de qualité et ce que tu appelais les « saintes écritures » survivent tant bien que mal dans le chaos du monde où la fausse parole submerge trop souvent celle des poètes.
J’ai dit longuement, devant le nombreux public qui t’a entouré à Berne pour la remise de tes archives, la reconnaissance que nous te devons, et je ne vais pas me répéter, d’autant que c’est à tous ceux qui défendent encore la littérature, soit en écrivant de nouveaux livres de qualité, comme Pierre Béguin aujourd’hui, soit en les défendant ou n’était-ce qu’en les lisant, que j’aimerais dire merci.

Il est possible que, me pointant tout à l’heure à l’Hyper U d’à côté, je ne trouve pas un seul de tes livres, pas plus que ceux d’aucun des lauréats du prix Rod de ces vingt dernières années. Qu’à cela ne tienne: tes livres te survivent, comme ceux de Georges Haldas ou d’Yvette Z’graggen que le prix Rod a couronnés, et d’autres œuvres d’écrivains lauréats se poursuivent avec Jacques Roman ou Janine Massard, Jil Silberstein ou François Debluë, pour n’en citer que la moitié…
De ce bord de mer à ta lisière de forêt, cher Jacques, que les oiseaux de la poésie nous survivent…
Cap d’Agde, en la Cité du Soleil, ce 14 septembre 2016.
-
Passeurs de livres
L'Arche du critique littéraire
Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscures servitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assez semblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses.
Cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu. Sans doute ne s’étonne-t-on pas, au jardin zoologique, de ce que tel formidable Sénégalais commis au ravitaillement du tigre royal entretienne, à la fois, un sentiment délicat à l’égard de la gazelle de Somalie ou de la tourterelle rieuse. Mais voit-on assez quel amour cela dénote ? De même paraît-il naturel qu’un passeur de livres défende à la fois la ligne claire de Stendhal ou de Léautaud et les embrouilles vertigineuses de Proust ou l’épique dégoise de Céline, ou qu’il célèbre les extrêmes opposés de la nuit dostoïevskienne et des journées fruitées de Colette. Or cela va-t-il de soi ?
L’on daube, et non sans raison, sur le flic ou le pion, le médiocre procustéen, l’impuissant enviard à quoi se réduit parfois le critique. Mais comment ne pas rendre justice, aussi, à tous ceux-là qui s’efforcent, par amour de la chose, d’honorer le métier de lire ?
Car il n’est pas facile de distribuer ses curiosités entre toutes les espèces sans tomber dans l’omnitolérance ou le piapia au goût du jour, puis de maintenir une équanimité dans l’appréciation qui pondère à la fois l’égocentrisme de l’Auteur, le chauvinisme non moins exclusif de l’Editeur et les tiraillements de sa propre sensibilité et de son goût personnel. Cet équilibrage des tensions relève du funambulisme, mais c’est bel et bien sur ce fil qu’il s’agit d’avancer pour atteindre le Lecteur.Image: Claude Verlinde.
-
Vivre avec sa douleur

À propos de Vivre près des tilleuls, roman à dix-huit pattes relevant le défi d’évoquer, d’une seule voix, le drame d’une femme foudroyée par la perte d’un enfant. Coup médiatique à base de démagogie doloriste, de la part du collectif des jeunes auteurs romands de l’AJAR, ou réussite littéraire avérée ?
On s’est peut-être dit, avant de lire Vivre près des tilleuls, que c’était mission impossible. Enfin quoi : un livre à dix-huit pattes, pour traiter d’un sujet aussi délicat que la mort d’un enfant, et lancé par un buzz d’enfer genre coup médiatique, non mais ! Et puis on s’est payé le livre, on l’a ouvert et, commençant par la postface en manière de déclaration d’intention, intitulée La fiction n’est pas le contraire du réel, on a mieux cadré le projet: on a mieux vu les kids en réunion avec leurs ordis persos.
Ensuite, passant de la théorie joliment filée au travail littéraire proprement dit, via l’Avant-propos de l’archiviste Vincent König, on a commencé de sentir la bonne vieille odeur de la littérature en basculant doucement dans le cercle magique de la fiction tandis qu’apparaissait le personnage d’Esther Montandon, cette imaginaire romancière romande (née en 1923) évoquant un peu Alice Rivaz ou plus tard Anne Cuneo, sortie de la « cuisse » des dix-huit jeunes auteurs romands et nous rejoignant par le truchement de carnets « oubliés » dans une enveloppe marquée FACTURES où se trouve relaté, sur des petits feuillets épars, le drame qui l’a foudroyée à quarante ans passés, quand sa petite Louise de quatre ans, vainement attendue pendant des années lui fut arrachée par accident…
La vérité d’un texte ne se mesure pas avec d’autres instruments que la sensibilité de chacun, donc je ne parle que pour moi, plein de doute et de questions a priori sur la démarche de l’AJAR, et ensuite supris contre toute attente. Pas un instant, cependant, je n’aurais regimbé à l’idée que de jeunes auteurs nés dans les années 80 se mêlassent (comme ça se prononce) d’évoquer les années 60, ni d’avoir vécu personnellement le drame affreux de la mort d’un enfant. Mon scepticisme portait ailleurs : sur un résultat par trop fabriqué, sans épaisseur ni fibre personnelle. Or la surprise est là : que les 63 séquences constituant les carnets d’Esther Montandon s’agencent, comme par miracle, dans une suite bel bien marquée par un ton particulier, accordé à un vrai regard, passant de l’abattement à la rage ou du désarroi à l’égarement.Nulle forte secousse d’émotion pour autant, qui prendrait le lecteur aux tripes, mais de multiples tremblements intimes marquant cette traversée du chagrin jusqu’au désespoir qu’un Peter Handke figurait dans une sorte de brume de tristesse atteignant les objets eux-mêmes. D’une réelle qualité littéraire, le texte ne pêche jamais par excès de pathos ni d’esthétisme. Tout m’y semble juste.
L’art de « faire vrai »…
Edgar Degas, peintre et écrivain, dit quelque part que l’art consiste à faire du vrai avec du faux, et cela marque le passage des faits à la fiction. Du côté des faits éprouvés dans sa chair vive par un individu, on pourra lire le récit déchirant d’Antoine Leiris, dans Vous n’aurez pas ma haine, témoignage d’un homme dont la femmne a été assassinée au Bataclan. Tout autre, on l’a compris, est la démarche de l’AJAR, dont les auteurs, par delà l’astuce « en abyme » des carnets d’Esther Montandon, ont accumulé les trouvailles narratives appropriées.
Un exemple : lorsque Esther, effondrée après l’accident qui vient de coûter la vie à Louise, cherche les mots qu’elle va adresser à sa mère au téléphone, avant de se rappeler soudain que celle-ci est morte depuis des années…
Ou cet autre épisode de l’invitation à un mariage, que lui envoient des amis connus au Rwanda, qui la convient avec son mari... et Louise dont ils ignorent le décès.
Plus encore, avec de constants glissements entre temps et lieux, le kaléidoscope narratif reconstitue le cadre de vie d’Esther, qui change en cours de route, et l’évolution de sa douleur, apaisée par des voyages ou la rencontre d’un autre homme, etc.
J’imaginais, au mieux, un exercice de style relevant de la création collective, mais Vivre près des tilleuls est plus que ça : un vrai livre. Passons donc sur le buzz antérieur et les (joyeuses) gesticulations post partum des kids, relevant de la Star Ac littéraire d’époque, puisque Esther Montandon, que nous avons rencontrée, existe…
L’AJAR, Vivre près des tilleuls. Flammarion, 127p.
Antoine Leiris. Vous n’aurez pas ma haine. Fayard, 138p. -
Ceux qui ferrent les cigales
Celui qui brise ses chaînes en rêve / Celle qui milite pour la libération de la liberté / Ceux qui se savent en enfer mais ne désespèrent pas / Celui qui a pris la tangente dès ces années-là / Celle qui ajoute au poids du monde / Ceux qui ne voient que les défauts de la réfugiée / Celui qui se blesse aux tessons de l’enceinte / Celle qui se coupe en parlant / Ceux que leur surpoids achève / Celui qui lit Les âmes mortes et se demande quelle créature a pu écrire ça / Celle qui évite les vampires même dans les soirées habillées / Ceux qui savent qu’une goutte de fiel peut gâcher un pot de miel / Celui qui doit beaucoup à l’âme russe / Celle dont le corps est tiède et l’esprit froid / Ceux qui ricanent quand ils entendent le mot « âme » / Celui dont le Moqueur bafoue la dignité muette / Celle dont le prénom reste secret / Ceux que toute violence insupporte / Celui que l’insouciance du beau gosse importune / Celle que toute discordance intrigue d’où sa passion pour Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski / Ceux qui découragent les alizés / Celui qui bat les buissons ardents / Celle qui charme le grutier taciturne / Ceux qui gâtent l’ambiance par envie / Celui qui n’écoute que les tousseux influents / Celle qui tance ses pensées inappropriées en société choisie / Ceux qui se morfondent loin des clairières / Celui qui réfute le sermon rabat-joie / Celle qui jette un froid dans l’effusion de la party fleurie / Ceux qui vendent leur fils ingénieur à leurs voisins introduits chez Ernst & Young / Celui qui sacrifie les tourments de sa conscience sur l’autel de la productivité marchande dont il espère des rentrées propres à satisfaire le Seigneur / Celle qui se perd en conjectures après s’être trouvée enceinte / Ceux qui nous veulent trop de bien / Celui qui décide ce matin de moraliser son profil Facebook / Celle qui se demande si tu vas bien quand tu ne chattes pas / Ceux qui disent « pouce » quand il y a trop de « like » , etc.
-
Mémoire vive (104)

Annie Dillard: "Pourquoi lisons-nous, sinon dans l'espoir d'une beauté mise à nu, d'une vie plus dense et d'un coup de sonde dans son mystère le plus profond ?"
Ce mercredi 3 août. – Conduisant ce matin Lady L. à l’hôpital, après sa très mauvaise chute dans le sentier de La Désirade, j’ai fait l’acquisition, en me baladant à Montreux, du Dragon du Muveran de Marc Voltenauer, ce polar nordico-préalpin dont on a beaucoup parlé dans nos régions (où il « cartonne » véritablement, ayant dépassé les 20.000 exemplaires) et que je suis curieux de juger par moi-même. Au vu de la moue ou des propos dédaigneux de plusieurs lettreux a priori contrariés par toute forme de succès populaire, et dans la foulée du phénomène Dicker, je m’en fais pour ainsi dire un malin devoir…

(Soir) - Contre toute attente, j’ai tout de suite été « scotché » par la lecture du Dragon du Muveran, aux chapitres brefs et bien ancrés dans le pays, sans trop donner pour autant dans le réalisme terrien pour ne pas dire lourdement terre à terre. L’auteur n’a d’ailleurs rien du littérateur de terroir, en phase (comme on dit) avec la société actuelle, ne serait-ce qu’avec son arrière-fond de classe moyenne émancipée (sur les hauts de Gryon où prolifèrent les résidences secondaires) et son inspecteur gay cultivé lancé dans une enquête carabinée.
°°°
Petits emmerdements physiques de l’âge. Vives douleurs plantaires, soudaines lancées articulaires aux genoux, crampes cruelles la nuit et souffle court le jour en remontant la pente. Eh mais, on se passerait bien de tout ça, pourtant il paraît que « c’est la vie »…
°°°
 Il y a pas mal de temps que j’avais entrepris la lecture du Secret de Tchékhov de Wanda Bannour, puis je l’ai laissé de côté, lui trouvant un air par trop didactique à la russe, mais c’était injuste me dis-je à reprendre cette étonnante reconstitution de la vie littéraire à la fin du XIXe siècle, par le truchement d’un journal fictif de Souvorine et d’écrits non moins fictifs de Tchékhov. Wanda Bannour a visiblement tout lu à propos de l’un et de l’autre, et ce que j’ai cru d’abord le regard d’un bas-bleu recomposant laborieusement un pseudo-journal, se déploie à vrai dire en récit romanesque très documenté et très vivant, que j’ai repris avec autant d’intérêt que de plaisir. Bref, je me suis amendé, et j’aime bien aussi ce mouvement de réexamen qui n’est pas tant de repentir que d’exigence de plus d’attention. J’avais mal regardé, etc.
Il y a pas mal de temps que j’avais entrepris la lecture du Secret de Tchékhov de Wanda Bannour, puis je l’ai laissé de côté, lui trouvant un air par trop didactique à la russe, mais c’était injuste me dis-je à reprendre cette étonnante reconstitution de la vie littéraire à la fin du XIXe siècle, par le truchement d’un journal fictif de Souvorine et d’écrits non moins fictifs de Tchékhov. Wanda Bannour a visiblement tout lu à propos de l’un et de l’autre, et ce que j’ai cru d’abord le regard d’un bas-bleu recomposant laborieusement un pseudo-journal, se déploie à vrai dire en récit romanesque très documenté et très vivant, que j’ai repris avec autant d’intérêt que de plaisir. Bref, je me suis amendé, et j’aime bien aussi ce mouvement de réexamen qui n’est pas tant de repentir que d’exigence de plus d’attention. J’avais mal regardé, etc. °°°
Je suis impressionné par la lecture de Clous, recueil de poèmes d’Agota Kristof publié à titre posthume. Poésie très noire, apparemment désespérée comme l’était celle de Francis Giauque, et pourtant non: il y a là-dedans de la lumière et de la musique, qu’il m’incombera de détailler plus précisément.
°°°
Ce lundi 15 août. – C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de Reynald, le 15 août 1985. J’ai retrouvé récemment le poème que je lui avais consacré, repris et amélioré, dont l’abbé Vincent, à qui je l’ai envoyé, m’a dit qu’il l’avait beaucoup touché.

À l’ami disparu
En mémoire de Reynald.
Ce soir j’avais envie de te téléphoner, comme ça, sans raison,
pour entendre ta voix, comme tant d’autres fois.
Après tout c’était toi, déjà, ces longs silences.
Mais je sais bien, allez vous étiez occupés :
les patients, les enfants, l’éternelle cadence.
Ce n’était plus, alors, le temps de nos virées
au biseau des arêtes ;
ou comme ces années en petits étudiants dans l’étroite carrée :
les rires, avec ta douce, que nous faisions alors !
L’emmerdeur d’en dessous qui cognait aux tuyaux.
tout ce barnum : la vie !Et ce soir de nouveau j’aurais aimé semer
un peu ma zizanie.
Ou parler avec toi, comme tant d’autres fois.
J’avais presque oublié ce dimanche maudit,
cette aube au bord du ciel
au miroir effilé,
la griffe de ta trace
au-dessus des séracs.
Tu vaincras, tu vaincras scandes-tu : tu vaincras!
L’orgueil de ton défi !
Mais soudain à la Vierge là-haut qui te bénit -
à toi sans le savoir est lancé le déni
d’une glace plus noire.
Ce dimanche maudit, juste à ton dernier pas.
Et ce cri ravalé, et ce gouffre creusé.
Et l’effroi des parois – et la mort qui se tait…
Sais-tu que je t’en veux ce soir,
ami, parti tout seul
comme un bandit !
(ce 13 décembre 1987,
après le 15 août 1985)
°°°
Que pèse la douleur en poésie ? Ou plus exactement_ que pèse la poésie devant la souffrance des hommes ? Le philosophe allemand Theodor Adorno a écrit ceci, dont on a fait un usage souvent réducteur, mais il l’a bel et bien écrit : «Plus la société devient totalitaire, plus l’esprit y est réifié et plus paradoxale sa tentative de s’arracher à la réification de ses propres forces. Même la conscience la plus radicale du désastre risque de dégénérer en bavardage. La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes ».
Avec le recul, et après les multiples nuances apportées à cette « interdiction » de la poésie par Adorno, la réflexion sur le rôle et la valeur de la poésie face à la barbarie, autant que celui de l’art, est à reprendre plus sereinement dans la foulée de l’Esthétique hégélienne, etc.
Pour ma part, j’ai toujours préféré la compagnie des poètes à celle des philosophes, exception faite des penseurs qui sont à la fois artistes et poètes, de Pascal à Sloterdijk.
 Ce samedi 20 août. – Il m’est arrivé hier quelque chose que je n’imaginais pas avant-hier, consistant à découvrir un livre d’un écrivain norvégien quadra qui pourrait être mon fils par l’âge, comme je pourrais être le petit-fils de Marcel Proust si la Providence en avait eu la fantaisie, et dont la démarche autobiographique visant l’inatteignable absolu du TOUT DIRE, à la fois courageuse et vouée au scandale, recoupe celle des carnets que je tiens depuis la fin des années 60 - où, précisément, cet auteur du nom de Karl Ove Knausgaard a vu le jour -, dont j’ai publié plus de 2000 pages sur lesquelles seules 500 pages, dans le volume intitulé L’Ambassade du papillon, traduisent cette aspiration au TOUT DIRE puisque je n’y ai fait aucune retouche en dépit de coupes nécessitées par le format du livre, entre autres pages jugées impubliables par l’éditeur
Ce samedi 20 août. – Il m’est arrivé hier quelque chose que je n’imaginais pas avant-hier, consistant à découvrir un livre d’un écrivain norvégien quadra qui pourrait être mon fils par l’âge, comme je pourrais être le petit-fils de Marcel Proust si la Providence en avait eu la fantaisie, et dont la démarche autobiographique visant l’inatteignable absolu du TOUT DIRE, à la fois courageuse et vouée au scandale, recoupe celle des carnets que je tiens depuis la fin des années 60 - où, précisément, cet auteur du nom de Karl Ove Knausgaard a vu le jour -, dont j’ai publié plus de 2000 pages sur lesquelles seules 500 pages, dans le volume intitulé L’Ambassade du papillon, traduisent cette aspiration au TOUT DIRE puisque je n’y ai fait aucune retouche en dépit de coupes nécessitées par le format du livre, entre autres pages jugées impubliables par l’éditeurOr Knausgaard a poussé le bouchon bien au-delà de ce qu’on pourrait dire la ligne rouge de la pudeur ou de la protection de son entourage, et d’emblée la lecture de La Mort d’un père m’a saisi et passionné, mais à la fois conforté dans mon actuelle position de réserve personnelle qui aurait dû m’interdire, en principe, de blesser des personnes vivantes en les nommant dans un livre publié - ce que j’ai pourtant fait dans L’Ambassade du papillon...
Ce qui m’intéresse alors dans le cas de Knausgaard, dont la démarche est aussi radicale et peut-être détestable (lui-même dit détester ce qu’il écrit et regretter de se comporter en « tueur ») que littéraire, c’est précisément que son apparence « brute de décoffrage » va bel et bien de pair avec une démarche littéraire de type proustien transposée dans notre époque de langage avarié et d’indiscrétion généralisée, avec une vivacité narrative, une limpidité et une originalité dans les variations de focale de son observation qui relève de la littérature considérée comme une sorte de journal de bord de l’humanité, ainsi que la définissait John Cowper Powys.
C’est à cause de Proust que j’ai découvert hier Knausgaard, ou plutôt grâce à l’une de mes libraires préférées, du nom de France Rossier, à la librairie La Fontaine de Vevey (on parque sur la Grand’Place et c’est à droite au début de le rue du Lac très prisée ces jours par les touristes de partout), à laquelle j’ai d’abord dit mon peu d’empressement de lire les livres de la rentrée, assez occupé que je suis ces jours à (re)lire l’intégrale de la Recherche du temps perdu à raison de dix pages par jours, et cinq ou sept autres livres de la pile de cinq ou sept cents qui attendent.
Du moins lui ai-je acheté, par curiosité, le roman écrit à dix-huits mains par les kids de l’AJAR, sous le beau titre de Vivre près des tilleuls ; le dernier recueil de textes d’Erri De Luca intitulé Le plus et le moins, deux récits de l’écrivain-voyageur Richard Kapuscinski (Il n’y aura pas de paradis et Le Christ à la carabine) et un roman islandais que m’a recommandé un vieil ami de Facebook, le tout jeune Maveric (moins de 20 ans), D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds, signé Jón Kalman Stefánnson.Or au moment où j’allais payer cette (bonne) pioche, France Rossier me dit « attendez voir ! », et la voici se diriger vers le rayon des poches d’où elle revient avec cette Mort d’un père de Knausgaard qu’elle tenait à m’offrir gracieusement, me promettant la lecture d’une autobiographie tellement hors du commun, voire invraisemblable, qu’on pouvait subodorer une affabulation, mais enfin j’en jugerais, en tout cas si ce n’était pas Proust ça y faisait penser parfois.

Et de fait, deux quarts d’heure plus tard, attablé devant une Suze sur la terrasse du café du Signal (à gauche en montant la route qui conduit au Vallon de Villard par les Bains de l’Alliaz, dont le patron est top sympa), je trouvai, dans les premières pages de La mort d’un père, consacrée à notre façon de planquer les morts sous des draps (au bord de la route en cas d’accident de voiture, ou à la morgue) et d’en évacuer la réalité physique sous terre, etc., puis dans les pages qu’il consacre à l’immuabilité des yeux dans un visage (on vérifie au selfie ou sur les derniers portraits de Rembrant), ou encore à la redoutable réalité que représentent les soins d’une enfant en bas âge et les vacations ménagères d’un père moderne, au détriment de sa passion d’écrire, quelque chose d’effectivement proustien chez cet écrivain qui confesse d’ailleurs avoir « bu la Recherche du temps perdu » et dont un thème de la réflexion narrative porte immédiatement sur notre situation dans le Temps…
°°°
 La façon dont Knausgaard parle, la quarantaine passée, du premier regard porté sur les jeunes filles en fleurs de son adolescence, m’a aussitôt projeté quarante ans en arrière, comme la première apparition de son père, en train de jardiner, m’a rappelé le nôtre retournant un carreau de terre pour y trouver tantôt un tibia et tantôt un crâne – la terre de notre jardin provenant de l’excavation de l’ancien cimetière de la Sallaz sur les hauts de Lausanne…
La façon dont Knausgaard parle, la quarantaine passée, du premier regard porté sur les jeunes filles en fleurs de son adolescence, m’a aussitôt projeté quarante ans en arrière, comme la première apparition de son père, en train de jardiner, m’a rappelé le nôtre retournant un carreau de terre pour y trouver tantôt un tibia et tantôt un crâne – la terre de notre jardin provenant de l’excavation de l’ancien cimetière de la Sallaz sur les hauts de Lausanne… °°°
Les écrivains qui attaquent le roman familial (dont un Philippe Sollers) ou le réalisme prétendument « populiste » (un Charles Dantzig) me font sourire, me rappelant un Alexandre Zinoviev fustigeant l’idéologie soviétique avec une furia d’idéologue soviétique, ou que tous ceux qui brocardent le nombrilisme des autres avant de tout ramener à eux.
°°°
Knausgaard n'écrit pas un roman familial : il écrit la vie.
°°°
Il est clair, à mes yeux, que la meilleure littérature me ramène à moi, mais ce moi est propre à tous. L'on voit ces jours un collectif de jeunes écrivains romands, attroupés sous le sigle de l’AJAR, s'en prendre au moi sempiternel de l'auteur « classique » pour lui opposer leur travail de groupe tellement plus convivial et libéré du nombrilisme, n’est-ce pas.

Or cette niaiserie « jeuniste » à peut-être du bon momentanément, comme tout exercice sportif ou artisanal, classe de violon ou atelier d’écriture à Missoula. Mais ensuite ? Qui fait les vrais livres ? Qui d’autres que des cinglés solitaires, des âmes sensibles perdues sur un atoll au milieu de la foule, un Bouvier ou un Cendrars et pas un collectif de groupies de Bouvier ou de Cendrars, etc. Une chose est de construire une bonne série télévisée, genre Six Feet under, et ça peut se faire en collectif de pros de haut niveau, mais autre chose est d’écrire la première page de La mort d’un père, où se trouve décrit le mécanisme inéluctable de la mort d’un corps humain au milieu des objets qui l’entourent, globalement indifférents au phénomène, ou le début du Voyage au bout de la nuit ou la scène de la mort du prince André dans La guerre et la paix, etc.
°°°
 « La littérature me semble ce qui fait essayer de sortir de soi pour parler de tous », écrit fort justement Charles Dantzig dans Les écrivains et leur mondes, paru récemment dans la collection Bouquins et constituant un exceptionnel creuset de jugements (et parfois de préjugés) sur la littérature précisément, avec le défaut ( ?) de tous les écrits personnels de privilégier les goûts personnels de l’auteur.
« La littérature me semble ce qui fait essayer de sortir de soi pour parler de tous », écrit fort justement Charles Dantzig dans Les écrivains et leur mondes, paru récemment dans la collection Bouquins et constituant un exceptionnel creuset de jugements (et parfois de préjugés) sur la littérature précisément, avec le défaut ( ?) de tous les écrits personnels de privilégier les goûts personnels de l’auteur. °°°
Le TOUT DIRE en matière d'intimité, en cette époque d'exhibition exponentielle, licite et consommable à grande échelle, commercialisable et donc industrialisée, est paradoxalement plus délicat, voire difficile, pour un écrivain d'aujourd'hui, et notamment pour ce qui touche aux sensations et aux sentiments réels éprouvés par un enfant ou un adolescent confronté à l'éveil de la sensualité ou à une première passion, au premier sperme ou au premier sang.
Je note ce qui précède en marge des pages de La mort d'un père consacrées au premier sperme, dont il remarque l’odeur de mer, et au premier délire amoureux du jeune Karl Ove, suscité par une certaine Hanne, officiellement petite amie d'un autre gars de leur âge, par conséquent plus ou moins inatteignable, mais dont l'intensité folle, plus fantasmatique que réellement incarnée, rappelle les sentiments non moins extrêmes éprouvés par le Narrateur de la Recherche à l'égard de la petite Gilberte Swann qui le chambre, le snobe, l'attire et le repousse comme il le fait lui-même pour attiser et désamorcer puis relancer sa jalousie, etc.
°°°
Dire que la mort n'existe pas semble un paradoxe, et pourtant il y là une vérité que j'ai reconnue en lisant les derniers mots d'une grande épopée romanesque serbe intitulée Migrations et que mon ami Dimitri appelait le plus beau roman du monde, à savoir: "Les migrations existent. La mort n'existe pas".
Je dirais plus précisément à l'instant (mon i-Phone indique 9h.14) que la mort n'existe qu'aux yeux de la vie humaine, sans préjuger de ce que ressentira notre chien Snoopy devant mon cadavre si je défunte avant lui comme c’est fort probable...
Karl Ove Knausgaard a vu son premier mort à l'été 1998, alors qu'il allait sur ses trente ans, le cadavre étant celui de son père. Tandis qu'il se trouvait là avec son frère Yngve, le bruit d'une tondeuse à gazon, à côté de la chapelle où reposait le défunt, lui fit craindre un instant que celui-ci ne se réveille, sous le regard vaguement narquois de son frère aîné. Et lui de noter une quinzaine d'années plus tard: « Ce fut un instant horrible: Mais lorsqu’il fut passé et que malgré tout le bruit et les émotions mon père demeura immobile, je compris qu’il n’existait pas, Le sentiment de liberté qui m’envahit alors fut aussi difficile à maîtriser que les vagues de tristesse l’avaient été et il trouva la même échappatoire: un sanglot totalement indépendant de ma volonté ».
Or je me rappelle que le même type de sanglot, irrépressible, m'a secoué au volant de notre voiture quand ma nièce (et filleule) Virginie m'a annoncé, sur mon portable, que mon frère venait de mourir, et c'était en 1997, alors qu'il n'était âgé que de 55 ans.
°°°
La première fois que j'ai vu mon père nu, c'était aux douches du tennis jouxtant l'ancien cimetière de la Sallaz, et la dernière fut après sa mort survenue le 8 mars 1983 dans notre maison natale des hauts de Lausanne, au terme d'une inoubliable journée passée en famille autour du mourant, notamment marquée par une énorme platée de spaghettis au début de l'après-midi, après la dernière entrevue de notre père et de notre première petite fille âgée de 6 mois - tout cela que j’ai détaillé au fil d’une autre litanie intitulée Tous les jours mourir, dans le recueil de récits autobiographiques de Par les temps qui courent, paru en 1994.
Je note ces détails ce matin d'une parfaite limpidité (nous avons la chance de ne pas avoir de parents ou d'enfants sous les décombres de tel village d'Ombrie ou de telle ville de Syrie) en me rappelant les pages de La mort d'un père consacrées à ce que je viens d'évoquer, où Karl Ove Knausgaard parle aussi de son rapport avec un monde dans lequel on taxe d'irréalité ce qui est précisément le plus réel, et de réel ce qui relève du fantasme.
°°°
D'aucuns affirment que le seul amour de Marcel Proust fut sa mère, transformée en grand-mère dans la Recherche. Un biographe moyennement subtil affirme que le cher Marcel était une femme du point de vue sexuel. André Gide, lui, reprocha à Proust de faire de son chauffeur et gigolo hétéro corse Agostinelli une Albertine probablement lesbienne à ses heures. Certains célèbrent le côté fiction de la Recherche. D'autres estiment que Proust n'a rien inventé, etc.

Quant à moi je pense que tout se tient dans cet imbroglio, dont le noyau est un coeur de réacteur atomique auquel sont reliés tous les points de la circonférence personnelle et familiale, sociale et pour ainsi dire universelle de la réalité perceptible puisque l'écrivain est aussi curieux de mode féminine que d'info récente (les avatars de l'affaire Dreyfus ou la visite à Paris du tsar de toutes les Russies), des progrès de la médecine ou de la vie des salons littéraires, des bordels pour messieurs aimant les messieurs ou des goûters de femmes riches parlant stratégie militaire, de tous les parlers populaires ou du snobisme et de l'imbécilité des gens les plus en vue, etc.
°°°
 Le TOUT DIRE de Proust peut être obscène, mais il n'est jamais vulgaire. il en va de même du TOUT DIRE de Knausgaard, qui est plus direct que celui de Proust sans être vulgaire non plus. La langue de Proust, extraordinairement artiste, parfois surchargée comme le salon de Sarah Bernhardt croulant de bimbeloterie plus ou moins exotique au milieu des plantes d'ornement vivantes ou peintes, des meubles tarabiscotés et des brûle parfums ou des oiseaux vivants ou empaillés - la phrase de Proust est fin-de-siècle comme celle de Knausgaard est début-de-siècle, par exemple quand il est avec son grand frère dans la salle d'attente des pompes funèbres (qu'il compare à celle d'un dentiste) en vue de l'enterrement de leur père, avec ce bout de dialogue qui fait court pour en dire long:
Le TOUT DIRE de Proust peut être obscène, mais il n'est jamais vulgaire. il en va de même du TOUT DIRE de Knausgaard, qui est plus direct que celui de Proust sans être vulgaire non plus. La langue de Proust, extraordinairement artiste, parfois surchargée comme le salon de Sarah Bernhardt croulant de bimbeloterie plus ou moins exotique au milieu des plantes d'ornement vivantes ou peintes, des meubles tarabiscotés et des brûle parfums ou des oiseaux vivants ou empaillés - la phrase de Proust est fin-de-siècle comme celle de Knausgaard est début-de-siècle, par exemple quand il est avec son grand frère dans la salle d'attente des pompes funèbres (qu'il compare à celle d'un dentiste) en vue de l'enterrement de leur père, avec ce bout de dialogue qui fait court pour en dire long:"Pauvre papa, dis-je.
Yngve me regarda.
- S'il ya quelqu'un qui ne mérite pas la pitié, c'est lui.
- Je sais, mais tu vois ce que je veux dire.
Il ne répondit pas. D'abord grave pendant quelques secondes, le silence devint tout simplement du silence".
°°°
Définir le genre d'une œuvre littéraire d'envergure est aussi délicat, parfois, que de classer une œuvre d'art. L'un des meilleurs livres de Georges Simenon, Pedigree, est un roman autant qu'une autobiographie, alors que les prétendus romans de nombreux auteurs contemporains ne sont que des auto-fictions ou des journaux intimes déguisés qui accusent une pauvreté d'imagination totale.
Ce qui apparie Proust et Knausgaard est alors peut-être là: dans leur imagination respective, qui leur fait donner vie à des cendriers ou des miettes de brioches, à savoir: la symphonie des sentiments humains et les intermittences du coeur.
Personnellement, je n'ai jamais été obligé par mon père de pêcher le cabillaud avant de foncer à l'école, et mon père n'a pas fini dans la déchéance alcoolique, mais la façon de sensibiliser ces épisodes, comme l'évocation de la campagne norvégienne traversée par les deux frères en début de deuil, me touchent autant que l'incommensurable tristesse de Marcel après la mort de sa grand-mère ou la beauté tout à fait gratuite d'une robe d’une ancienne cocotte se la jouant grande bourgeoise, lorsque le jeune Narrateur vexé de se voir largué par sa petite amie va faire du charme à la mère de celle-ci en lui faisant entendre qu'il ne tient plus du tout à sa fille pour que ça se répète et tourne peut-être à son avantage - enculage de mouches qui aboutit à cette phrase d'anthologie:
“Les jours où Mme Swann n’était pas sortie du tout, on la trouvait dans une robe de chambre de crêpe de Chine, blanche comme une première neige, parfois aussi dans un de ces longs tuyautages de mousseline de soie, qui ne semblent qu’une jonchée de pétales roses ou blancs et qu’on trouverait aujourd’hui peu appropriés à l’hiver, et bien à tort. Car ces étoffes légères et ces couleurs tendres donnaient à la femme - dans la grande chaleur des salons d’alors fermés de portières et desquels les romanciers mondains de l’époque trouvaient à dire de plus élégant, ce qu’ils disaient “douillettement capitonnés” - le même air frileux qu’aux roses qui pouvaient y rester à coté d’elle, malgré l’hiver, dans l’incarnat de leur nudité, comme au printemps”.

Bref, tout ca n'est que littérature, mais c'est la vie même et pour tout dire: c'est le parfum de la vie transformée et quintessenciée, etc.
Ce mercredi 31 août. – J’ai comme l’impression que mes variations sur la lecture de Karl Ove Knausgaard, modulées en suite sous le titre de Pour tout dire, sont en train de devenir un texte en soi, distinct de ces carnets. Je vais donc leur réserver un espace propre, qui pourrait bien devenir un livre en soi…

Quant à ces carnets, je vais continuer à les tenir avec cette légère distance qui marque tout ce que j’écris désormais par rapport à mon « vécu », comme on dit, etc.
°°°
Peter Handke, dans L'heure de la sensation vraie: «Dans la mesure où le monde se remplissait pour lui de secrets, il s'ouvrait et pouvait être reconquis. Lorsqu'il traversa un pont à proximité de la gare de l'Est, il vit en bas, à côté de la voie, un vieux parapluie: il n'était plus une indication pour autre chose, mais un objet en soi, beau ou laid, beau et laid, tout ensemble avec tous les autres».
-
Pour tout dire (17)

À propos de la réalité réelle selon Patricia Higshmith. De ce qu’il y a parfois de pesant dans le manège des enfants, et plus encore des parents d’enfants. Ce qu’il ne faut pas dire sous peine d’être isolé…
Lorsque je lui ai rendu visite dans sa petite maison de pierre du hameau tessinois d’Aurigeno, en février 1988, la fameuse romancière américaine Patricia Highsmith, que Graham Greene a qualifié de « poétesse de l’angoisse », m’a dit que ce qui l’intéressait le plus était la réalité.
Sa réalité à elle, telle que je l’ai perçue dans son environnement tout modeste, alors que ses droits d’auteurs mondiaux lui auraient permis de vivre dans un palais de Malibu, se résumait à un univers tout simple, voire étriqué, au pied des hautes parois de la montagne, avec sa machine à écrire de marque Olivetti et ses vieux jeans, point de télévision (à cause de sa peur du sang, m’a-t-elle avoué) et pas une goutte de scotch à m’offrir après m’avoir fait lanterner trois quarts d’heure derrière sa porte, peut-être pour me punir de mes vingt minutes de retard...
Or, très curieusement, j’ai aimé ça. J’ai aimé sa gueule revêche à terrible lippe d’ancienne jouisseuse, qu’un sourire a éclairé quand je lui ai offert deux dessins de nos filles, une boîte d’Amaretti et un jeu de tarots trouvé la veille à Muralto.
J’ai aimé rencontrer une vieille jeune fille de 67 ans effrayée par la vie, dont les sombres nouvelles de Catastrophes, son dernier recueil qui motivait notre rencontre, disent l’effroi devant la folie des hommes. J’ai aimé qu’elle ait apprécié, en pro, que je lui soumette mes questions dans un courrier préalable. J’ai aimé jouer le rôle de l’emmerdeur qui vient interroger la romancière célèbre détestant parler de ses livres. J’ai aimé que peu à peu elle se radoucisse et dédicace un de ses livres à nos filles. J’ai aimé ses belles réponses à mes questions, notamment quand je lui ai demandé en quel animal elle aimerait être réincarnée et ce qu’elle dirait à un enfant à propos de Dieu. J’ai bien aimé aussi qu’à un moment donné, lasse de parler d’elle-même, elle renverse la situation en m’interrogeant sur Georges Simenon, pour lequel elle avait le plus grand respect d’artisan à artisan, et j’ai aimé retrouver la substance de mes réponses dans la double page qu’elle a oubliée quelque semaines plus tard dans le journal Libération.
Enfin j’aime le ton sans apprêt des quelques lettres que je garde d’elle, où elle revient sur ce qui la révoltait le plus à l’époque et qu’elle me reprochait un peu de n’avoir pas assez mis en valeur dans mes reportages au Matin et au Magazine littéraire, rapport à la politique israélienne en Palestine. J’ai repensé à Patricia Highsmith en lisant les premières pages d’Un Homme amoureux de Karl Ove Knausgaard et plus précisément à une nouvelle de je ne sais plus quel recueil, peut-être intitulé Le réseau (à vérifier) où elle raconte l’exclusion d’un jeune homme débarquant à New York tâchant de se faire accepter dans un certain milieu, lequel le scie bientôt parce qu’il ne dit pas exactement les choses qu’il faut dire ni n’adhère au goût partagé par la « bande » , comme le pauvre Swann se fait exclure du clan des Verdurin… Karl Ove Knausgaard, comme Patricia Highsmith, est d’une hypersensibilité qui fait qu’il a toujours essayé de s’intégrer à des groupes et toujours souffert d’en être plus ou moins écarté faute de dire les choses qu’il faut au moment où. Dans La mort d’un père, on le voit se reposer sur son frère aîné, plus dégourdi que lui, pour se faire une petite place, alors même qu’il va publier son premier livre. C’est un timide, comme souvent les vrais écrivains, et c’est un teigneux, comme Patricia Highsmith.
Karl Ove Knausgaard, comme Patricia Highsmith, est d’une hypersensibilité qui fait qu’il a toujours essayé de s’intégrer à des groupes et toujours souffert d’en être plus ou moins écarté faute de dire les choses qu’il faut au moment où. Dans La mort d’un père, on le voit se reposer sur son frère aîné, plus dégourdi que lui, pour se faire une petite place, alors même qu’il va publier son premier livre. C’est un timide, comme souvent les vrais écrivains, et c’est un teigneux, comme Patricia Highsmith. 
Ce qui est tout à fait étonnant, dans la progression du récit autobiographique de Knausgaard, dans Un homme amoureux, c’est que les scènes enchaînées, dialoguées, remarquablement campées même quand il s’agit d’un banal anniversaire de petite fille un peu chiante entourée de toute sorte de parents confrontant leurs opinions sur le permafrost et la retraite anticipée - on dirait aujourd’hui: l’Etat islamique et le Brexit, participent en somme de la même grande littérature discrète mais tyrannique, nourrie de la tyrannie des petites filles et des mères inquiètes, des petits garçons trop souvent déçus par leurs père et des papas ne sachant plus à quels saints se vouer, qui nous parle à travers Tchékhov et Carver ou Thomas Bernhard et tant d’autres qui refusent d’obtempérer.
Knausgaard se décrit en responsable désigné, par les autres, d’un jardin d’enfants supposé pilote voire exemplaire, et cela lui pèse. Les conversations des bons parents lui pèsent et il le dit alors que d’habitude on évite. De la même façon, Patricia Highsmith dit ce qu’il ne faut pas dire au point de passer pour une vraie chieuse.
D’ailleurs c’était une lesbienne, et sûrement une espèce de communiste outre qu’elle fumait comme une usine. Et puis elle est morte : est-ce que ça se fait d’être mort quand le monde appartient aux jeunes qui disent ce qu’il faut au moment où la caméra tourne ?!
Pour ma part, revenant aux récits de Knausgaard, je constate que je n’ai jamais rien lu de tel, s’agissant du conformisme latent qui nous empêche peu ou prou d’exprimer ce que nous pensons vraiment au milieu de nos proches ou de nos moins proches, qui ne soit ni du sarcasme ni de la satire, mais du constat que seule la vraie littérature, sans préjugé ni parti pris, dévoile pour nous aider, peut-être, à mieux affirmer notre liberté… -
Ceux qui passent les bornes

Celui qui se salit en se torchant avec la dernière couverture de Charlie-Hebdo / Celle qui a perdu deux enfants sous les décombres et réclame leurs corps pour les offrir aux gourmets du néo-Charlie avec la sauce tomate du sang de Cabu / Ceux qui se demandent ce qui serait arrivé si le nauséeux magazine Détective avait publié les photos des corps déchiquetés des martyrs de Charlie-Hebdo en les présentant comme une goûteuse bouillabaisse / Celui qui ne prône pas l'interdiction de Charlie-Hebdo mais sa ruine par le refus de l'acheter sans excuses aux martyrs d'Amatrice / Celle qui n'a jamais entendu parler du torchon qu'est devenu Charlie-Hebdo et n'en pleure pas moins son père écrasé par sa propre maison / Ceux qui n'en deviendront pas mahométans pour autant / Celui qui se rappelle la façon de Pierre Desproges de friser le code sans jamais basculer dans l'abjection / Celle qui n'a jamais vu trace de vulgarité chez Alcofribas Nasier dit Rabelais / Ceux qui ne respectent rien même pas leur propre merde / Celui qui aime les petits nuages pommelés des douces matinées d'Ile-de-France ou de Beaucee ou de Pannonie centrale tant qu'à faire / Celui qui déshonore le si beau prénom de Felix / Celle qui trouve que 300 Ritals de moins c pas grave / Ceux qui rigolent comm des oufs sur le matelas d'euros qu'ils doivent à la mort de leurs camarades / Celui qui gueule que ces Ritals savent pas rire alors que nous en France on a plein de toques et un clown président ah ah / Celle qui pratique l'humour noir en baisant avec des nègres en sang comme au bon temps des colonies / Ceux qui ce matin regardent leurs porcs avec tendresse, etc.
-
Ceux qui mettent tout à plat

Celui qui t’explique que la solution de la question est dans la question point barre / Celle qui affirme qu’au niveau du concret tout indique qu’une incinération fait gagner du temps et de l’argent terminé bâton / Ceux qui coupant les cheveux en quatre finissent par se les arracher / Celui qui harnache la réticence et lui plante aux flancs ses étriers argumentaux scientifiquement prouvés / Celle qui n’y va pas par quatre chemins creux telle Tell le héros qu’a fichu sa flèche en pleine pomme du bailli torve / Ceux qui répètent à la commission de surveillance que celui qui a vu voira / Celui qui couche son idée sur le papier qui le réveille la nuit pour lui faire des petits / Celle qui règle la question par la réponse à tout genre Bricoville / Ceux qui choisissent le cercueil à fond plat avec vue sur les allées bien habitées / Celle qui se fait toute petite dans le caveau de famille où ça sent le vieux comme à l’époque / Ceux qui enterrent la star avec ses perruques selon ses volontés de chauve tardive / Celui qui dit après moi le déluge en constatant que les tornades sur Phûket confirment ses prédictions d’opiomane lucide / Celle qui répète en langue inca classique : « Quand volcan fâché volcan cracher sur lama »/ Ceux qui ont travaillé la question tout l’été pendant que la cigale faisait du karaoké mais qui c’est-y qui va déchanter quand elle voudra se réfugier dans le bunker de la fourmilière eh eh / Celui qui prétend que la clim profite aux femmes alors que sa sœur prétend le contraire comme quoi ça discute dans la famille / Celle qui reproche à Jean-Pa d’émettre trop de gaz carbonique quand il la prend à froid / Ceux qui reprochent au railleur de dérailler alors que la fonte des glaciers concerne nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants des familles recomposées si ça se trouve qu’ils survivent avec tous ces avocats buveurs d’eau / Celui qui regrette de ne plus pouvoir laver des ces aquarelles à la Turner dont les glaciers se vendent encore au Japon / Celle qui estime que sans les Maldives l’océan fera « plus propre » / Ceux qui récusent le droit d’ingérence des ouragans dont les prénoms féminins ne trompent personne / Celui qui propose de mettre la canicule en équations et de convoquer ensuite un congrès d’algébristes fiables / Celle qui ramène la question en termes de genre et propose qu’on discute du féminin de LA crise qui ne procède objectivement (selon son analyse) que de LE dérèglement climatérique / Ceux qui remettent le grabataire à plat vu que ce qu’il dit ne tient pas debout / Celle qui ingambe s’agenouille en pensée devant le Seigneur dont la posture en croix la fait souffrir de même / Ceux qui font un plat froid de l’Avenir tant il est vrai que la Nature se vengera comme l’a dit le poète : « Ô Nature berce-les chaudement »…
-
Tours et détours

Dialogue schizo
Sur les notions de vacances, de profit et de tourisme, évoquées au 21e étage de la Twin Tower Est des Dunes, à Benidorm...
Moi l'autre: - Alors ces vacances, bien profité ?
Moi l'un: - Tu me dis un mot obscène de plus, genre touriste, et je te balance du haut de cette tour de rêve...
Moi l'autre: - Tu nies l'évidence ? Tu te la joue bourgeois-bohème- qui-n'assume-pas ?
Moi l'un: - Absolument pas: je module. D'abord parce que le terme de vacance, synonyme de vide, ne nous ressemble pas, et pas plus à Lady L. qu'à nous deux. Ensuite du fait que cette idée qu'il faut profiter à tout prix me fait gerber. Ce souci d'en avoir "pour son argent" est à mes yeux le comble de l'abrutissement.
Moi l'autre: - Tu nies l'importance du rapport qualité-prix ?
 Moi l'un: - Pas du tout: j'en suis au contraire très soucieux, mais il y a une façon de faire passer l'argent avant la chose qui me rend cette obsession suspecte. Le rapport qualité-prix: c'est la justesse, d'abord, d'une relation équilibrée. Une boutique, comme il en pullule à Benidorm, qui vend tout à 1 euro, c'est déjà la rupture de cet équilibre. J'ai horreur de ça autant que du prix d'une chambre surestimé ou d'un repas de merde correspondant au goût de chiotte de touristes incultes.
Moi l'un: - Pas du tout: j'en suis au contraire très soucieux, mais il y a une façon de faire passer l'argent avant la chose qui me rend cette obsession suspecte. Le rapport qualité-prix: c'est la justesse, d'abord, d'une relation équilibrée. Une boutique, comme il en pullule à Benidorm, qui vend tout à 1 euro, c'est déjà la rupture de cet équilibre. J'ai horreur de ça autant que du prix d'une chambre surestimé ou d'un repas de merde correspondant au goût de chiotte de touristes incultes. Moi l'autre: - Tu fais passer la culture par la table ?
 Moi l'un: - Et comment ! D'ailleurs je t'ai vu te régaler l'autre jour au Puig Campana avec nos amis de La Fuente: une paella qui en soit une, à un prix honnête. Tu sais que je ne suis ni fou de table et moins encore connaisseur, mais un bon repas est le premier signe d'une culture de qualité, et je l'apprécierais de la même façon dans n'importe quelle maison d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Rien à voir avec le luxe. D'ailleurs celui-ci nous indiffère...
Moi l'un: - Et comment ! D'ailleurs je t'ai vu te régaler l'autre jour au Puig Campana avec nos amis de La Fuente: une paella qui en soit une, à un prix honnête. Tu sais que je ne suis ni fou de table et moins encore connaisseur, mais un bon repas est le premier signe d'une culture de qualité, et je l'apprécierais de la même façon dans n'importe quelle maison d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Rien à voir avec le luxe. D'ailleurs celui-ci nous indiffère... Moi l'autre: - Tu ne craches pourtant pas sur le confort...
Moi l'un: - Il me suffit d'une table. Tu as vu combien nous étions coincés à Grenade, dans cet hôtel de charme charmeur du quartier si pittoresque de l'Albayzin, sans table dans la chambre. Pire que la prison !
Moi l'autre: - Avec vue, pourtant sur l'Alhambra...
 Moi l'un: - Je me fous de l'Alhambra, et de la Mezquita de Cordoue, et de tous les hauts-lieux culturels si la culture de base, incluant une table sur laquelle écrire tranquillement dans sa chambre, n'est pas respectée. Mais note qu'un défaut est toujours bon à prendre: c'est ainsi que, pendant que Lady L. subissait elle-même un coup de blues dans cet hôtel au lit surélevé comme le monument à Christophe Colomb dans la cathédrale de Séville, nous avons eu l'occasion d'écrire dans un café popu de la plaza d'à côté où passait, à la télé, un docu sur la chasse au crocodile. Pas grave: il y avait une table...
Moi l'un: - Je me fous de l'Alhambra, et de la Mezquita de Cordoue, et de tous les hauts-lieux culturels si la culture de base, incluant une table sur laquelle écrire tranquillement dans sa chambre, n'est pas respectée. Mais note qu'un défaut est toujours bon à prendre: c'est ainsi que, pendant que Lady L. subissait elle-même un coup de blues dans cet hôtel au lit surélevé comme le monument à Christophe Colomb dans la cathédrale de Séville, nous avons eu l'occasion d'écrire dans un café popu de la plaza d'à côté où passait, à la télé, un docu sur la chasse au crocodile. Pas grave: il y avait une table...Moi l'autre: - Et Benidorm là-dedans ?
 Moi l'un: - C'est comme Dieu et ce voyage que nous poursuivons quarante jours: faut prendre Benidorm sans se laisser piéger par le cliché et en distinguer les multiples aspects comme d'une grande ville actuelle et, plus généralement, comme de l'actuel monde mondialisé
Moi l'un: - C'est comme Dieu et ce voyage que nous poursuivons quarante jours: faut prendre Benidorm sans se laisser piéger par le cliché et en distinguer les multiples aspects comme d'une grande ville actuelle et, plus généralement, comme de l'actuel monde mondialisé Moi l'autre: - C'était intéressant, ce que Ramon nous a raconté hier soir..
 Moi l'un: - Hyper-intéressant d'apprendre, par notre Asturien préféré, qui a lui-même parcouru tous les degrés de l'échelle sociale, et qui a roulé sa bosse de par le monde et acquis une expérience humaine et professionnelle plus conséquente que maints diplômé intellos à grandes prétentions, que l'un des nababs de Benidorm est un ancien cordonnier qui a acquis des terrains et su en faire quelque chose avec des gens du pays avant que le bled de pêcheurs du coin ne devienne une espèce de Miami ou de Rio à l'espagnole
Moi l'un: - Hyper-intéressant d'apprendre, par notre Asturien préféré, qui a lui-même parcouru tous les degrés de l'échelle sociale, et qui a roulé sa bosse de par le monde et acquis une expérience humaine et professionnelle plus conséquente que maints diplômé intellos à grandes prétentions, que l'un des nababs de Benidorm est un ancien cordonnier qui a acquis des terrains et su en faire quelque chose avec des gens du pays avant que le bled de pêcheurs du coin ne devienne une espèce de Miami ou de Rio à l'espagnole Moi l'autre: - En fait c'est ça qui nous a le plus intéressés dans ce voyage, avec les paysages et la forme des robinets: ce sont les gens, à commencer par nos hôtes de La Noiselée en Bourgogne, du compère Beaupère à Noirmoutier, de ceux de La Casona ou de la Vila Duparchy de Luso, des Trindade de Carvoeiro ou des Williams de l'hacienda andalouse, entre autres. Bonnes et braves gens partout...
 Moi l'un: - Evidemment: à commencer par nous. Nicolas Bouvier le dit d'ailleurs dès le début de L'Usage du monde: que le voyage est autant ce qu'il fait de nous que ce que nous faisons de lui, et les gens ne sont pas les figurants affublés de costumes typiques d'un film pittoresque, mais les gens qu'il y a là: toi et moi, Lady L. qui a presque tout pris sur elle de la préparation de nos détours avec Booking et sa tablette, nos mères qui nous accompagnaient à tout moment à titre posthume, nos filles et nos proches et amis par SMS, nos hôtes à chaque étape, et Lady Munro sur la route...
Moi l'un: - Evidemment: à commencer par nous. Nicolas Bouvier le dit d'ailleurs dès le début de L'Usage du monde: que le voyage est autant ce qu'il fait de nous que ce que nous faisons de lui, et les gens ne sont pas les figurants affublés de costumes typiques d'un film pittoresque, mais les gens qu'il y a là: toi et moi, Lady L. qui a presque tout pris sur elle de la préparation de nos détours avec Booking et sa tablette, nos mères qui nous accompagnaient à tout moment à titre posthume, nos filles et nos proches et amis par SMS, nos hôtes à chaque étape, et Lady Munro sur la route... Moi l'autre: - C'est vrai que c'est un monde à elle seule que Lady Munro et ses nouvelles, et que nous avons vécu cette lecture pleine de gens comme un voyage dans le voyage.
Moi l'un: - Alice Munro, tu en es d'accord, est notre découverte de l'année. Cette bonne femme est un sismologue des sentiments et des situations personnelles, sociales, familiales ou historiques, comme il n'y en a pas deux.
Moi l'autre: - Je suis, pour une fois, complètement d'accord avec toi. Cette femme est à la fois une fée et un ours. On l'a comparée à Tchékhov et à Carver, mais c'est tout à fait autre chose.
Moi l'un: - C'est absolument autre chose. C'est l'écrivain qui rend le plus subtilement, avec plus de détachement et de tendresse englobante que Proust, notre rapport avec le temps ou plus exactement: les temps successifs, alternés ou imbriqués de nos vies.
Moi l'autre: - Alice Munro est en somme incomparable...
Moi l'un: - Bah, tu sais bien que la comparaison est toujours une paresse ou un piège. Ce qui n'empêche qu'à tout moment elle nous fait comparer les situations vécues à celle que nous vivons...
Moi l'autre: - Jamais je n'ai rien lu de si fin et de si juste sur les vies bousculées par les séparations et les recompositions dans les générations successives d'après la guerre...
Moi l'un: - Ses nouvelles sont le plus étonnant aperçu de la vie des femmes dans le monde actuel, sans trace de féminisme au premier degré ou d'idéologie quelconque, mais elle fait varier tous les points de vue et le récit de la tyrannie qu'un nourrisson exerce sur sa mère, racontée par l'enfant lui-même, est aussi génial que celui de la sainte femme confrontée à un meurtre, dans La vie d'une honnête femme, qui me semble un pur chef-d'oeuvre du point de vue littéraire et je dirai sans affectation: poétique.
Moi l'autre: - Donc on a pas mal voyagé, aussi, en Ontario, du côté du Lac Huron et sur l'île de Vancouver. Et le voyage va continuer...
Moi l'un: - Pour le moment il faut encore parler des robinets et des chasse d'eau en France, au Portugal et en Espagne. Cela aussi ressortit à la culture.
Moi l'autre: - C'est vrai que l'état des lieux a passablement changé, par exemple à Séville, depuis 1975 où nous y avons zoné pour la première fois...
Moi l'un: - Rien pour autant des chiottes d'aires d'autoroutes française à l'européenne genre combi d'inox sinistre, uniformisées de Malmö à Biarritz. La chasse d'eau portugaise montre autant de dignité que l'espagnole...
Moi l'autre: - En outre j'ai été impressionné par le bel usage du bois dans la maison espagnole, aux Asturies autant qu'en Andalousie. Rien du bois classe moyenne genre Ikea. Du vrai bois massif de vraie grande forêt. Au fil du voyage, les forêts nous ont d'ailleurs impressionné autant que les gens: les forêts domaniales de Touraine, les forêts des hauts de Bayonne, les forêts de Bucaçao ou les oliveraies d'Andalousie. Et puis il faudra parler aussi, plus tard, des parcs naturels d'Espagne, qui montrent un nouveau souci en matière de conservation des patrimoines biosphériques.
Moi l'un: - Les Ibères ont des leçons à donner aux Européens, encore, dans le respect non seulement de la table mais aussi de la maison, des jardins et des douceurs. La maison de tradition basque, comme l'asturienne, et même pas mal de maisons en Algarve, valent moult maisons plus ou moins nordiques de carton-plâtre. Et la pâtisserie de sud surclasse celle du nord, Finlande comprise...
Moi l'autre: - Pour la nomenclature et les détails variés, Lady L. fournira son rapport documenté.
Moi l'un: - Enfin nous nous garderons d'oublier le statut du chien.
Moi l'autre: - De fait, notre voyage en a dépendu pour le choix de chaque auberge, acceptant ou non le corniaud ou la levrette titrée.
Moi l'un: - Snoopy a fait craquer tout le monde, mais ce n'état pas gagné.
Moi l'autre: - On sent évidemment la prévention des Espagnols, qui ont édicté des lois pour éloigner les chiens errants des établissements publics. Mais on voit plus de clebs dans les rues d'Algarve ou d'Andalousie qu'à Blois ou à Berne...
Moi l'un: - Don Ramon n'a pas manqué de nous recommander de ne pas traiter Snoopy comme un enfant, à sa manière un peu sentencieuse, mais ça va tellement de soi qu'on passe à un autre sujet. Ah mais, tu as vu, là-bas, à la fenêtre, ce rocher en pleine mer: on dirait La Désirade...
-
Une géniale rêverie réaliste
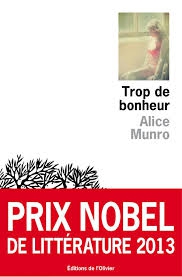
En lisant Trop de bonheur d'Alice Munro. Dix nouvelles modulant une inépuisable observation sur le monde tel qu'il est, avec un talent sans pareil.
Alice Munro avait passé le cap de ses 78 ans lorsqu'elle publia ce recueil de dix nouvelles plus étonnantes les unes que les autres, prouvant une fois de plus son exceptionnelle pénétration de la psychologie humaine et des avatars de la société en constante mutation sur fond de passions sempiternelles et de métamorphoses existentielles. Plus encore: ce recueil, peut-être son meilleur, illustre son inépuisable imagination narrative et l'originalité des projections formelles de celle-ci.
Ce recueil s'ouvre sur une nouvelle nous confrontant à une folie meurtrière et s'achève avec une sorte de bref roman, merveilleux portrait de femme inspiré par la biographie d'une mathématicienne d'origine russe.
1. Dimensions ****
La figure du psychopathe est très présente dans la littérature contemporaine, et pas seulement sous l'égide du polar. Or les gens on beau parler de "fou criminel" à propos de Lloyd, le père de ses trois enfants: la narratrice voit surtout en lui un "accident de la nature" et continue de lui rendre visite dans l'institution où il est incarcéré.
De ce triple infanticide évoqué en cinq lignes quant aux faits précis, la nouvelliste tire un récit d'une trentaine de pages modulant le point de vue de Doree, qui continue de rester attachée à celui qui est taxé de "monstre" par son entourage, sans lui céder en rien pour autant.
Quant à la nouvelliste, elle semble scruter le double mystère de ces deux personnages, non sans se concentrer sur la survie de Doree et sa façon de "retourner" l'horreur, notamment à l'occasion d'un autre drame impliquant un enfant.
2. Fiction ****
Pierre Gripari, lui aussi grand nouvelliste, me déclara un jour qu'il ne suffit pas d'avoir quelque chose à dire: qu'il faut, aussi, avoir quelque chose à raconter.
Or c'est ce qu'on devrait se rappeler en lisant les nouvelles d'Alice Munro, qui non seulement a beaucoup de choses à dire mais raconte souvent deux ou trois histoires en même temps.
Mais que raconte-t-elle donc dans Fiction, et pourquoi ce titre ?
Les titres des derniers recueils ressortissent souvent à l'abstraction, sans que la matière en soit plus cérébrale pour autant. En l'occurrence, Joyce, la prof de piano, devient sujet de fiction à son corps défendant se retrouvant aussi bien dans le roman d'une jeune femme qu'elle a connue enfant et à laquelle elle n'a guère prêté attention.
Là encore, il est question de perception enfantine et de sentiments exacerbés restés secrets, ou simplement inaperçus. Mais on verra que le titre a lui aussi un double fond...
3. Wenlock Edge ***
Il s'établit souvent, dans les familles, des liens plus ou moins inattendus entre personnages apparemment peu faits pour communiquer, cousins disparates ou nièces et oncles devenant soudain complices on ne sait trop pourquoi.
C'est précisément ce type de relation qui rapproche la narratrice, étudiante à London (Ontario) du cousin de sa mère Stevie Potts, qu'elle appelle "le Vieux Popotin" et qui semblée voué à l'état de célibataire.
Rien de particulier ne se passe, pourtant, entre la jeune fille et cet aîné plus ou moins paternaliste, jusqu'à l'apparition de Nina, colocataire de la narratrice qui a déjà plusieurs vies derrière elle et va donner une couleur d'étrangeté au récit, aux confins du conte érotico-fantastique (pour ce qui concerne la narratrice) et de l'accident de parcours existentiel hautement improbable.
4. Trous-profonds *****
Là, c'est carrément la merveille: une espèce d'élégie existentielle, pas loin du chef-d'oeuvre par sa limpidité narrative.
Comme dans les récits de Fugitives, cette histoire d'un ado surdoué, accidenté en ses jeunes années, jamais vraiment reconnu par son père à l'ego envahissant, et qui disparaît pendant des années après avoir plaqué ses étude sans crier gare, reflète quelque chose de profond de notre époque, qu'on pourrait dire le désarroi des immatures de tous âges.
Perdre un enfant, au sens propre, est sûrement l'une des pires épreuves que puissent affronter des parents. Mais le perdre "au figuré", comme on dirait banalement qu'on l'a "perdu de vue", relève également de l'horreur vécue, ici imposée à Sally par son fils Kent, longtemps disparu et qu'elle retrouve, par hasard, des décennies plus tard, transformé en espèce d'apôtre christique tout pareil aux "saints" marginaux qui rejettent le Système et prônent l'altruisme en égoïstes caractérisés. Au passage, on relèvera l'allusion au rejet apparent de Marie par son Christ de fils lui lançant: "Femme, qu'ai-je à faire avec toi ?", parole moult fois interprétée et que Sally prend au premier degré, en femme d'aujourd'hui peu portée à croire que son propre fils va changer de l'eau en vin...
5. Radicaux libres ****
Alice Munro touche parfois au genre noir, comme dans cette nouvelle évoquant la rencontre "à suspense" d'une femme d'un certain âge qui a perdu récemment son conjoint et voit débarquer, dans sa maison isolée, un type qui lui révèle bientôt qu'il est en cavale après avoir lavé, dans le sang, ce qu'il estimait une injustice.
D'une intrigue relevant plus ou moins d'un standard, rappelant tel roman de James Ellroy ou tel autre du Simenon "américain", la nouvelliste tire un argument bien à elle, portant sur le sentiment de culpabilité ancré en chacun de nous.
En l'occurrence, l'éventuelle victime du fuyard se défend en retournant la situation de façon bien inattendue puisqu'elle lui montre sa propre face d'ombre en racontant un meurtre qu'elle aurait commis - ou pu commettre. Et chacun le prendra pour lui en s'interrogeant sur ce qui, en telle ou telle occasion, l'a retenu de passer à l'acte.
6. Visage ****
"Je suis convaincu que mon père ne m'a regardé, ne m'a dévisagé, ne m'a vu qu'une seule fois", affirme le protagoniste de ce récit déchirant dont la seule faute, aux yeux de son père, a été de naître avec ce qu'on appelle une "tache de vin" lui recouvrant la moitié du visage de sa teinte violette.
Par delà la réaction du père, brillant conosaure social rejetant sa femme autant que son fils en digne représentant d'une société où les apparences comptent pour l'essentiel, c'est un autre thème, plus profond, qui retient ici l'attention de la nouvelliste, lié une nouvelle fois à la perception des choses par un enfant ou, plus précisément, par deux enfants.
C'est en effet d'une histoire d'amour entre deux gosses qu'Alice Munro module le développement, jusqu'à une rupture d'autant plus douloureuse qu'elle repose sur un malentendu. Tout cela raconté, une fois de plus, sans le moindre pathos.
7. Des femmes****
Un homme mourant et quatre femmes qui lui tournent autour: telle est la situation vécue dans la grande maison de Mrs Crozier mère, veillant jalousement sur son fils chéri revenu indemne de la guerre où il a servi comme pilote de chasse, mais que la leucémie a rattrapé.
Aux côtés de Mrs Crozier mère, la jeune épouse du malade, Sylvia, assume tant bien que mal son rôle tout en travaillant à l'université, justifiant alors la présence de la narratrice au chevet de Mr Crozier, à laquelle présence s'ajoute celle de l'envahissante Roxanne, masseuse de son état et portée à tout régenter.
Cette histoire de rivalités féminines est racontée, comme souvent chez Alice Munro, avec le recul du temps, qui arrondit évidemment les angles les plus vifs des relations entre personnages. Mais cette distance - et c'est là un autre aspect du grand art de la nouvelliste -, loin d'édulcorer l'observation, l'aiguise au contraire comme il en va souvent de certains souvenirs revivifiés par la mémoire.
8. Jeu d'enfant ****
Un terrible secret lie à jamais la narratrice et son amie d'enfance Charlene, qui ne se sont plus vues depuis des décennies. Le drame affreux, non moins qu'occulté d'un commun accord, est survenu lors d'une "colo" où toutes deux, inséparables, faisaient figure de jumelles, sans l'être en réalité en dépit d'un lien réellement fusionnel - mais tant de temps a passé depuis cette funeste année.
Le temps, précisément, aurait dû effacer jusqu'au souvenir de l'événement, mais voici qu'à l'article de la mort Charlene parvient enfin à faire revenir Marlene.
Le secret n'est dévoilé qu'au terme de la nouvelle, mais les quarante pages de celle-ci, consacrées à la vie que Marlene, la narratrice, a menée jusque-là, n'en sont que plus cruellement significatives de ce qu'on pourrait dire le mensonge d'une vie.
 9. Bois *****
9. Bois ***** Le lecteur qui ne sait pas ce qu'est une forêt en apprendra beaucoup, concrètement et poétiquement aussi, en lisant cette magnifique nouvelle où se manifestent, comme jamais, le sérieux et la compétence d'Alice Munro dans sa façon d'approcher et de décrire tous les milieux, toutes les activités humaines et toute sorte de mentalités.
Roy, tapissier et restaurateur de meubles, s'occupe lui-même de la coupe du bois dont il a besoin, au dam de Léa, son épouse craignant qu'un accident ne lui arrive durant ses travaux solitaires. Cependant, de plus en plus maladive, elle-même a cessé de conduire et de dire quoi que ce soit à Roy quand il repart dans les bois.
On pense à Jack London en lisant cette formidable évocation de la forêt que Roy hante comme un monde dont il connaît le secret des essences, c'est le cas de dire, tout en s'opposant à certaines pratique nouvelles à caractère surtout commercial ou industriel. Enfin, le souffle narratif de la quasi octogénaire stupéfie bonnement...
10. Trop de bonheur*****
Autre et dernière merveille: ce véritable concentré romanesque en cinquante pages, inspiré par le personnage réel de Sofia Kovalevskaïa, mathématicienne et romancière dont Alice Munro relate l'extraordinaire destinée en se fondant sur la biographihe de Don H. Kennedy et son épouse Nina (Little Sparrow: a Portrait of Sophia Kovalevsy, Ohio University Press, 1983).
Comme dans toutes ses nouvelles, le point de vue de la nouvelliste sur une vie compte autant, sinon plus, que le contenu de celle-ci, même si la trajectoire de Sofia, dont le nom a été donné à un cratère de la lune, relève de l'épopée personnelle vécue par "ce petit bout de femme", recoupant les épopées synchrones de la vie scientifique et des événements historico-politiques de l'époque, de Cannes à Stockholm en passant par Saint-Pétersbourg.
Cela pour les événements extérieurs, alors que la nouvelliste fait revivre Sofia dans le frémissement passionné de sa vie personnelle, dont le lecteur partage si fort les émotions que sa mort, apaisant ses derniers tourments physiques et mentaux, lui est un véritable arrachement.
Alice Munro. Trop de bonheur. Traduit de l'anglais (Canada) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso. L'Olivier, 2013, 315 p.
-
Mémoire vive (103)

Simone Weil au lever du jour : « L’attention absolument sans mélange est prière. Toutes les fois qu’on fait vraiment attention on détruit du mal en soi ».
Et ceci la nuit venant : «Solitude. En quoi donc en consiste le prix ? Le prix en consiste en la possibilité supérieure d’attention »,
Ce vendredi 1er juillet. – C’est avec un étonnement joyeux, non moins que fier et reconnaissant, que j’ai trouvé ce soir, en lisant le chapitre de l’Eloge de la ferveur d’Adam Zagajewski consacré à Czapski, de très louangeuse lignes à propos de mon texte d’introduction à la rétrospective de 1992. Or cela m’avait échappé, mais cela tombe bien, car je suis en train de tisser une toile dont les fils relient Zagajewski et Antonio Rodriguez, Cees Nooteboom et William Cliff - tous poètes en lesquels je reconnais des accointances sensibles qu’on pourrait dire à la fois très physiques, ancrées dans la vie des sens et des émotions, ainsi que dans la vie des gens, mais à la fois métaphysiques par leurs résonances à travers le temps et le mystère de l’être.
°°°
 Ce poème m’est venu à partir d’un sentiment éprouvé en Grèce, au musée d’Athènes (en 2001) et de la réflexion de Peter Sloterdijk sur les vers inspirés à Rilke par le fameux torse archaïque d’Apollon de Rodin, qui s’achève sur l’injonction combien inattendue, à cet endroit-là, de Tu dois changer ta vie !
Ce poème m’est venu à partir d’un sentiment éprouvé en Grèce, au musée d’Athènes (en 2001) et de la réflexion de Peter Sloterdijk sur les vers inspirés à Rilke par le fameux torse archaïque d’Apollon de Rodin, qui s’achève sur l’injonction combien inattendue, à cet endroit-là, de Tu dois changer ta vie ! Au corps ignorant
Sur un poème de Rainer Maria Rilke.
L'athlète s'en est allé,
mais je ne sais ce soir
si ce que je déplore
est sa disparition,
le drapeau flamboyant
de son corps exerçant
son art géométrique,
ou ses mains électriques
écrivant des poèmes.
Je ne sais pas, j'hésite ;
réellement ce soir,
la fatigue m'a pris
dans ses bras féminins,
mais ce grand torse à voir
de marbre et remontant
les chemins de l'oubli,
via Rilke et Rodin,
me rend ces beaux matins
de nos corps élancés,
leur grisante sueur
et sur le stade inscrite,
la lettre du poème.
Ignorant de la peur,
l'athlète ainsi demeure.
°°°
« Car la poésie est l’essentiel », écrit Ramuz je ne sais plus où, et les vers du Petit village sont les seuls qu’il ait jamais écrits, mais la poésie est omniprésente dans les romans de Ramuz, autant qu’elle étincèle à chaque page de la Recherche de Proust que je suis en train de (re) lire de part en part. Donc la poésie: mais pas ce que je dirai la poésie poétique qui prend la pose, mélange d’affectation et de vanité ; moins encore celle qui déferle en bave bavarde sur les réseaux sociaux.
Alors quoi ? Je ne sais pas. Je ne parle que pour moi, et chacun le fera à son goût, ou pas. Je parle de ce qui me parle, où je reconnais, en peu de mots, plus de sens et d’existence concentrés. À treize, quatorze ans, j’ai mémorisé des milliers de vers, tous oubliés aujourd’hui. Mais des formes, des rythmes, des images, des musiques m’en sont restés.

« La main d’un maître anime le clavecin des prés » me semble de la poésie comme je l’entends, et tout le vitrail des Illuminations de Rimbaud me revient avec ce seul alexandrin. Des poètes contemporains, beaucoup sont sûrement très éminents (les Jaccottet, Bonnefoy, Du Bouchet, etc.) mais ceux qui, sincèrement, me parlent vraiment en cela qu’ils expriment ce que Cendrars appelait le profond aujourd’hui, sont plus rares, en tout cas en langue française ; du fait de ma génération j’aurai apprécié les vers jazzy de Jacques Réda ou les fantaisies fraîches d’un Guy Goffette ou d’un Yves Leclair, ou plus encore les sourciers sauvages et princiers à la Franck Venaille ou à la William Cliff. Mais ce ne sont là que quelques repères d’un goût qui transcende la séparation des langues et me conduit tantôt vers Umberto Saba et Pavese autant que vers Dylan Thomas et Mahmmoud Darwich, entre autres…

Dans un voisinage plus proche, j’ai mis des mois avant de lire vraiment le recueil qu’Antonio Rodriguez m’a envoyé en novembre dernier, mais tout aussitôt j’ai reconnu, dans le courant fluide et violent, dense et tendre, heurté, mélange de pensée et de sensualité, de Big Bang Europa, ce que plus que jamais j’attends de la poésie actuelle et que je trouve ces temps en lisant et relisant Le visage de l’œil du Batave Cees Nooteboom ou Mystique pour débutants du Polonais Adam Zagajewski, à savoir des éclats de présence dans le chaos et des morceaux du vitrail du monde bombardé à réassembler patiemment.
°°°
Malgré certaine dénégation de ma part (comme quoi je me sens plus jeune qu’à vingt ans), je me sens ces jours une fatigue toute physique qui accuse bel et bien l’âge de mes artères et de mes systèmes nerveux et respiratoire, autant que de mes articulations, et je vois qu’il en est de même pour ma bonne amie, cela ne manquant évidemment de nous situer, tous deux, sur ce qu’elle disait l’autre jour « le début de la fin », dont on espère du moins qu’elle ne sera pas pour demain…
Mais ai-je besoin, au demeurant, de me rappeler ainsi l'éventualité de notre disparition prochaine à tous deux ? Sûrement pas : j’y pense à vrai dire tous les jours, sans le moindre affolement pour autant. Mais c’est là : cela peut désormais arriver à tout moment et c’est devenu, pour mon travail, un horizon qui m’aide à mieux peser chaque mot, et pour notre vie un sujet de plus de reconnaissance…
°°°
La façon de Proust de finir ses phrases par etc. me plaît assez. On amorce une idée, on développe un raisonnement, on met à feu une fusée et celle-ci disparaît dans l’éther de la page blanche, etc.
°°°
Ce vendredi 15 juillet. – Nous apprenons, tôt ce matin, la terrible nouvelle relative au massacre d’une huitantaine de civils innocents, hier soir sur la promenade des Anglais de Nice, par un énorme camion fou lancé à pleine vitesse avec, à son volant, un probable terroriste - ou peut-être même pas d’après les dernières nouvelles. Et qu’en dire ? On reste, comme on dit, sans voix. Du moins ai-je composé, d’une traite, ce poème en hommage aux innocents massacrés en cette belle soirée sur la Côte d’azur:
La baraka
J'étais innocent présumé,
ou peut-être pas, va savoir ?
J'étais un enfant de trois ans,
j'étais un vieil Anglais
familier de la Promenade;
nous, nous étions juste belles,
juste faites pour le bonheur,
et faut-il se méfier aussi
des jeunes filles en fleur ?
Et quelle peur auraient-ils eu
ce soir au bar des retraités
amateurs de karaoké ?
Nous, nous ne faisions que passer.
Ces trois-là étaient Japonais.
Pas mal de gens, aussi,
qui s'étaient dit CHARLIE
en janvier de l'autre année,
l'avaient oublié par la suite
en se pointant au Bataclan...
Mais à présent on se sentait
tellement protégés:
le ciel virant de l'orangé
à l'indigo sur les palmiers;
nous regardions la mer
aux reflets étoilés;
dans ses bras tu t'étais sentie
délivrée des emmerdements;
un autre maudissait la vie
sans savoir pourquoi ni comment;
plusieurs millions plantés
devant l'écran de leur télé
étaient à regarder comment
le monde va ou ne va pas -
on ne sait pas, ça dépendra
peut-être de la baraka ?
Voila ce que ce soir peut-être
ou peut-être pas, va savoir
ils se disaient tous dans le noir
et comme flottant hors du temps:
ah mais quel beau feu d'artifice
ce serait ce soir à Nice...
Lorsque a surgi le camion blanc.
(Ce matin du 15 juillet 2016)
°°°
Je suis vraiment impressionné, ces jours, et beaucoup plus qu’à ma première lecture, peut-être du fait que je suis immergé, parallèlement, dans la Recherche du temps perdu, par ma reprise du Proust contre la déchéance de Joseph Czapski, dont je ne me rappelais pas la densité et la justesse des observations, plus encore : la précision stupéfiante des souvenirs ainsi rapportés par le peintre à ces camarades prisonniers du camp de Griazowietz…
°°°
La suite de me poèmes m’étonne, par le seul fait de leur surgissement. Ils me viennent l’un après l’autre sans crier gare : comme ça ! Je ne m’y attendais pas du tout, mais réellement je sens qu’une nouvelle voie s’ouvre à moi, qui me relie à mon ancien fonds d’adolescent apprenant des centaines de vers par cœur, autant qu’au gymnasien qui a commencé, vers ses dix-huit ans, à écrire des proses poétiques « à la René Char », puis au quadragénaire composant un nouveau début de recueil entre 1986 et 1989, pour le laisser ensuite de côté, avant de les retrouver et, vivifié, d’en recevoir de nouveaux.
Or le premier poème de La maison dans l’arbre sera :
Nouvelles de l’étranger
Les poèmes nous viennent
comme des visiteurs,
aussitôt reconnus ;
et notre porte ne saurait se fermer
à ces messagers de nos propres lointains.
(En forêt, 1986)
°°°
De Léon Bloy qui m’étonne parfois : « Je ne comprends que ce que je devine ».
Ce samedi 23 juillet. – L’on apprend, ce matin, qu’une nouvelle tuerie a eu lieu à Munich, ce qui à l'instant ne me fait ni chaud ni froid, ou disons : pas plus ni moins que les tueries d’Orlando ou de Charlie-Hebdo, du Ba-ta-clan ou de la promenade des Anglais, et cela dit sans aucun cynisme mais parce qu’il est difficile de ressentir vraiment quoi que ce soit, à part une horreur trop évidente, par rapport à ces événements plus ou moins proches, relativement à d’autres événements plus ou moins lointains comme les tueries d’Alep, etc.
Ce qui est sûr, c’est que j’évite les commentaires larmoyants (ou pseudo-larmoyants) qui se multiplient sur les réseaux sociaux, de belles et bonnes âmes qui se consolent elle-mêmes plus qu’elles ne soulagent quiconque.
Cependant, la vision du beau visage du vieux prêtre égorgé récemment en France ne cessant de me hanter, j’ai écrit ce matin ce poème « de circonstance » :
Folie ordinaire
Ta bouche est pleine de sang
quand tu invoques ton dieu de haine:
tu brandis le Coran,
de l'Evangile te fais une arme;
tu invoques le peuple
et tes commissaires politiques
et autres sicaires wahabbites
l'écrasent au Tibet
et le décapitent au Yémen;
tu exiges en UNE de ton tabloïd
l'image du vieux prêtre égorgé;
tu as bondi sur le micro
pour que le sang versé
te fasse réélire...
Tu incarnes le pouvoir démocratique
de George W Ben Laden,
chef de guerre chez Ali Burton,
aux bons soins de la Swiss Bank
du Panama sioniste
tendance sunnite.
Tu es n'importe qui.
Tu es PERSONNE
avec ton oeil unique.
Tu as la gueule des prédateurs associés.
Tu t'agenouilles en foule.
Tu réclames plus de têtes.
Les insectes nuisibles seront traités
à Guantanamo comme à Oslo,
Orlando et autres zones
gazées par Monsanto.
Mon tribunal de droit international privatisé
vous jugera partout selon ma loi
non négociable à Gaza
ni dans les boîtes de gays
ou les savanes d'improductifs affamés africains
d’ailleurs tous contaminés par le péché.
Vous ne comptez pour rien,
peuples soumis,
et le divin or noir me bénit.
Je suis la meute et j'approuve.
Je suis la force et je frappe du ciel.
J'ai gravi les hauteurs béantes
du communisme néo-libéral,
tendance ouverte-au-dialogue.
Je suis la folie de tous
Et crève qui ne s'attroupe !
°°°
 Les développements tâtonnants de l’imagination proustienne sont vraiment incomparables, comme je le constate ces jours à toutes les pages des Jeunes filles en fleurs, notamment à propos du décalage entre la voix du personnage Bergotte, à la table des Swann, et son écriture plus ou moins divinisée par le Narrateur. Or les variations du jugement de celui-ci, comme il en va de son appréciation de la Berma, évoluant selon ce qu’on lui en dit, me rappellent bien d’autres revirements typiques du caméléonisme de nos goûts, souvent influencés par des éléments extérieurs. Cela m’est arrivé bien souvent au même âge, mais quasiment plus depuis la trentaine où je suis devenu résolument personnel…
Les développements tâtonnants de l’imagination proustienne sont vraiment incomparables, comme je le constate ces jours à toutes les pages des Jeunes filles en fleurs, notamment à propos du décalage entre la voix du personnage Bergotte, à la table des Swann, et son écriture plus ou moins divinisée par le Narrateur. Or les variations du jugement de celui-ci, comme il en va de son appréciation de la Berma, évoluant selon ce qu’on lui en dit, me rappellent bien d’autres revirements typiques du caméléonisme de nos goûts, souvent influencés par des éléments extérieurs. Cela m’est arrivé bien souvent au même âge, mais quasiment plus depuis la trentaine où je suis devenu résolument personnel…°°°
Coleridge à qui on ne la fait pas : « Dans tout homme, il y a l’âme d’un poète. Mais le plus souvent ce sont de bien mauvais poètes ».
Ce dimanche 31 juillet. – Ma liste du jour sera consacrée à Ceux qui broient du noir, histoire d’évoquer la prolifération des séries criminelles et autres polars, et la nécessité d’en sortir pour couper à l’intoxication. Il y a à vrai dire pas mal de temps que je n’ai plus lu de romans policiers, en revanche j’ai fait une intense consommation de séries américaines et nordiques, dont certaines m’ont d’ailleurs captivé et « enrichi » autant que des romans ordinaires, mais qui n’échappent que rarement aux motifs répétitifs et autres stéréotypes de base, tant du point de vue des intrigues et des thèmes que sur le plan de la forme, etc.
-
Butor le grappilleur
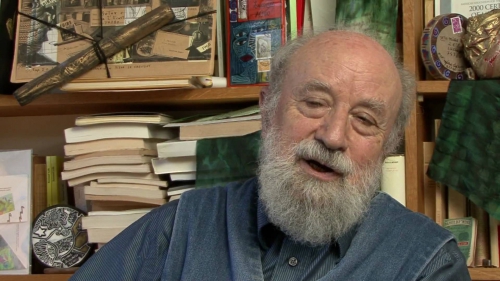
En 2006, pour ses 80 ans, paraissait chez Gallimard un livre intitulé Seize lustres, illustrant la poétique de Michel Butor, qui vient de quitter sa maison À l’écart pour un dernier voyage. Flash-back et révérence au vieux trouvère...
Le nom de Michel Butor appelle ordinairement, comme par automatisme pavlovien, l’immédiate mention scolaire du Nouveau Roman et de deux livres incontournables, de L’Emploi du temps et de La Modification, à quoi se réduit pour beaucoup une œuvre aussi prolifique (plus de 1000 titres en bibliographie) qu’inaperçue, à quelques îlots près dont une série de lectures fameuses, de Balzac à Rimbaud.

Or il y a à la fois du lecteur universel chez Michel Butor, du critique éclairant et du poète de la même espèce poreuse, à la parole toute directe en apparence, mais lestée de sens, aux divers sens du terme, et diffusant une musique faisant elle aussi sens et pour les cinq sens pourrait-on dire en redondant doucement.
Une parfaite illustration, et peut-être la meilleure en ce moment précis où l’écrivain fête ses 80 ans, en est alors donnée par ce recueil récapitulatif de Seize lustres (seize lustres font juste 80 ans, selon la mesure romaine fixant les cinq ans de magistrature romaine ponctués chaque fois par un sacrifice) où, plus qu’une sage anthologie, l’on trouve le relevé poétique d’un parcours touchant à peu près tous les points de la circonférence terrestre (de Venise au Sahel ou des States au jardin de Bécassine) et dont le moyeu reste A l’écart, la maison du poète à Lucinges, non loin d’Annemasse et de Genève (Genève « où même la poussière est propre », tandis qu’à Annemasse « même le savon est sale »), à partir de laquelle se développe d'ailleurs un texte liminaire intitulé Ce qu’on voit depuis l’Ecart, qui ne dit pas autre chose : savoir qu’à l’Ecart on est au centre du monde, entre la plume du scribe et l’encrier des étoiles…
Michel Butor est virtuellement entré en poésie en 1926, « quand mon papa et ma maman faisaient l’amour entre leurs draps », et c’est sur le déclencheur magique de La baguette du sourcier, datant de 1990 (l’époque où il dispensait ses cours à Genève) qu’il ouvre ce recueil avec l’évocation du geste de l’ange bouclant les portes du Jardin d’Eden d’une main, sur ordre du dieu jaloux, pour bénir de l’autre le couple en faisant « lever un pain à chaque goutte répandue »…
La poésie de Michel Butor ne fait rien pour avoir l’air d’en être.
Or voici ce qu’on lit, dans Passe et repasse:
« Le fer du trafic ferroviaire
écrase les plis des talus
et celui des camions-citernes
roussit les parkings d’autoroutes
où les vacanciers font des tresses
tentant de doubler les copains
avant de s’enfiler aux peignes
qui les délestent de leurs sous »…
C’est une poésie qu’on pourrait dire, pour faire la nique aux mânes de Mallarmé, positivement journalistique, à cela près qu’elle est de la poésie et non du journalisme, disant par exemple encore ceci dans L’Arrière-automne :
« Et l’on était suspendu aux nouvelles
il y avait des menaces de guerre
dans un autre continent il est vrai
mais s’il y avait mondialisation
c’était bien dans l’appesantissement
de ces ailes ténébreuses partout
Les arbres suffisamment à l’abri
gardaient leur feuilles approfondissant
leurs couleurs et l’on avait l’impression
qu’elles disaient individuellement
écoutez-moi contemplez-moi sauvez
la formule que je vous ai trouvée »C’est cela même : comme l’arbre, le poète trouve des formules. Or je sens que, ce livre-là, je vais me le garder ces jours à portée de main, car il va de soi que Seize lustres ne parle pas que d’autoroutes et de mondialisation et que la poésie c’est tous les jours.

On se prend à vibrer et songer à tout moment à la lecture du deuxième des Seize lustres de Michel Butor, qui évoque des chutes d’anges à Venise en rapprochant les figures de la Bible et les choses vues lui apparaissant au fil de ses balades par les venelles, enfants et gondoliers, ouvriers sur leurs échafaudages (protégés de la chute par des filets) et autres Japonais égarés, à la sempiternelle recherche des Tintoret…
Butor instamatic...
Cette poésie de l’instant ne m’était pas vraiment apparue jusque-là, sauf dans Mobile, son grand voyage à travers les States, et dans Gyroscope aussi, à l’état déployé, mais ici, avec ce qu’une récapitulation autobiographique peut avoir de plus dense et de plus personnel, l’aspect tout à fait original et novateur, nettoyeur, de cette démarche m’apparaît mieux avec son ping-pong ludique de l’observation et de la réflexion, du chant et de l’hors-champ à la Godard, en moins intello phraseur, me séduit et me captive même.
La méthode de Butor me rappelle l’Instamatic par son immédiateté compacte, non pas le polaroïd grisâtre mais le petit autofocus avant la lettre de la note immédiatement envisagée dans son utilisation prochaine.
C’est le contraire du poète posant entre deux chandeliers en gilet coin-de-feu, sans jouer pour autant le maudit ou l’ensauvagé. C’est un honnête homme en salopette d’artisan à tout faire qui passe par là avec son stylo et sa bibliothèque ambulante, son bon naturel et sa ruse, son génie des lieux et son ambition toute modeste de lire et de dire le monde à n’en plus finir.Michel Butor pour la route...
Littérature en conversations automobiles
Le père-grand à sourire juvénile, jolie salopette et débit à scrupuleuses saccades suspensives nous emmène en voyage. Première destination le Moyen Age en 58 minutes, ce qui fait en voiture un agréable déplacement matinal, histoire de prendre son breakfast dans une autre ville que la sienne.
Ce décentrage initial est exactement ce que propose, dès sa première conversation avec Lucien Giraudo, Michel Butor amorçant sa Petite histoire de la littérature française en 6 CD.On peut évidemment écouter ceux-ci dans un fauteuil Chesterfield ou un hamac, mais l’idéal me paraît de doubler le voyage en partant avec son Butor sur la route. J’ai entendu « Maudit, maudit, maudit ! », l’extraordinaire passage de La légende de Saint Julien l’Hospitalier, où le grand cerf martyr à dix-huit andouillers dit son fait au chasseur giscardien, au coin d’un bois d’Alémanie profonde, le temps que j’avais pris pour parcourir la distance correspondant aux 4 premiers CD, de l’intro de Butor (Faut-il découper l’histoire littéraire ?) à sa lecture de Flaubert succédant juste au thème Réaction et révolution. Un peu plus tard, cent kilomètres plus à l’Est, Butor me lisait cet autre passage prodigieux qu’il a choisi, de Connaissance de l’Est de Claudel, évoquant un crépuscule chinois.
Michel Butor lit admirablement. On dirait Michel Foucault dans sa cuisine blanche en juste un peu moins précieux: nette découpe mais fruitée, al dente comme Les Deux pigeons de La Fontaine.
Et puis Michel Butor est intéressant. Pas exhaustif du tout, ni académique pour un pet: historique et transversal, dans l’immanence surtout à la française, mais ne discontinuant de raconter « sa » littérature qui recoupe évidemment « la » littérature, avec ses éclairages à lui. Par exemple, parlant de Balzac qu’il connaît comme sa poche ventrale, ou de Zola comme sa sacoche, il évoque le passage d’une société à l’autre ou la signification du grand magasin, après avoir expliqué le passage de l’alexandrin à la prose poétique via Châteaubriand.
A qui s’adresse cette «petite histoire» ? A tout le monde, si tant est que tout le monde reste curieux d’un peu tout, mais il faut que ce tout le monde ait déjà son petit bagage, car le propos de Butor est principalement complémentaire.
Lucien Giraudo, très discret, un peu trop même parfois, est le copilote du débonnaire God virtuel. Le conducteur de la voiture audiophone, parfois aussi, reste sur sa faim. Mais c’est la loi de la conversation non systématique quoique suivant son plan. On passe ainsi « autour » de Proust sans y entrer vraiment (sauf qu’on y entre quand même par une brève lecture), mais Proust est situé comme Apollinaire est situé (par rapport à la Grande Guerre et aux peintres) au tournant d’une nouvelle époque elle aussi située par rapport aux six ou sept siècles qui précèdent. Situer est très important. J'entends aujourd'hui, surtout, situer est hyper-important.
Aux dernières nouvelles en effet, neuf étudiants américains sur dix ne savent plus qui est Hitler (Adolf), le dixième affirmant qu’il doit s’agir d’un marchand d’armes du XXe siècle. C’est dire que l’étudiant américain trouvera profit à écouter Michel Butor qui lui permettra de situer Corneille (avec lecture d’une séquence du Menteur) après Rabelais, ou Beckett à l’époque du premier hamburger Happy Meal.
Ceci encore: Un DVD accompagne les 6 CD, où Michel Butor parle de ses livres-objets. Egalement importante : l’anthologie, sous forme de petit livre broché, qui complète le package avec une trentaine de textes constituant autant d’illustrations non convenues, du Testament de Villon ou Des Cannibales de Montaigne aux Adieux du vieillard de Diderot, ou d’un bout de La duchesse de Langeais à La tour Eiffel sidérale de Cendrars. L’ensemble, paru aux éditions CarnetsNord, coûte 72, 50 francs suisses. En euros, c’est donc un peu moins la ruine. L’essence de la Packard (le voyage doit se faire en Packard, comme la Recherche du temps perdu en 111 CD, pour 365 euros, se fera naturellement en Bentley volée) doit être comptée dans l’addition. Chère littérature…