
RANSMAYR Christoph. Atlas d’un homme inquiet. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 458p.
Au bout du monde
- Que les histoires se racontent.
- Sur un bateau à destination de Rapa Nui, l'île de Pâques.
- Navigationmouvementée. Le Pacifique pas du tout calme.
- Tout de suite l’univers physique est très présent.
- Un homme « effroyablement maigre » parle au Voyageur.
- Evoque le peuple de Rapa Nui, qui a peuplé les îles de milliers de statues de pierre.
- Leshabitants étaient sûrs d’être seuls au monde et ne se rappellent pas leurorigine.
- Parle un mélange d’anglais, d’espagnol et d’une langue inconnue. L’île est assimilée, à sa découverte, au séjour d’un dieu.
- Lequel, Tout Puissant, se nomme Maké-Maké…
- Son père est anglais et sa mère Rapa Nui.
- Manger lui est très pénible.
- Les statues s’appellent moaïs.
- Des figures tutélaires d’un culte oublié, qui sont devenues symboles de puissance.
- L’homme très maigre estime que la faim a été le destin de ce peuple.
- Dont les habitants ont épuisé les richesses naturelles et ont fini par s’entre-dévorer. Avant d’être exploités par les Péruviens dans des mines de guano.
- La quête de la faim est assimilée, dit-il, à une quête du corps astral.
- Le Voyageur se concentre ensuite sur la présence des sternes fuligineuses, dont l’homme très maigre dit que ce sont des oiseaux sacrés.
- Ils portent des noms étonnants : le puffin de la nativité, le fou masqué ou le pétrel de castro.
- La présence des oiseaux sera récurrente dans ce livre.
- Le Voyageur-poète y apparaît comme un témoin sensible. « J’étais là, telle chose m’advint ».
- Mélange de récit de voyage et d’évocation poétique mais sans fioritures.
- Chant de territoire.
- Le Voyageur se retrouve sur la muraille de Chine enneigée.
- Où il avise la silhouette d’un type s’approchant.
- Un Mr Fox anglais de Swansea, ornithologue, qui a vécu avec Hong Kong avec sa femme chinoise et répertorie des chants de territoire des merles.
- Classe les chants en fonction des sections de la muraille, chaque territoire ayant samodulation.
- Le chant d’une grive marque l’au revoir des deux hommes.
- Une atmosphère étrange et belle se dégage de cette rencontre. La merveille est partout, très ordinaire en somme et prodigue en histoires.

- Herzfeld
- Chaque récit commence par « Je vis »…
- « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant »…
- Cettefois on est dans l’état fédéral brésilien de Minas Gerais.
- On enterre le Senhor Herzfeld.
- Dont le Voyageur a fait la connaissance deux jours plus tôt.
- Le fils d’un fabricant d’aiguilles à coudre du Brandebourg, exilé à la montée du nazisme.
- Herzfeld a commencé à lui raconter sa vie.
- Puis est mort la nuit suivante.
- L’évocation de la mise en bière du Senhor Herzfeld, et son enterrement, forment le reste de l’histoire.

- Cueilleurs d’étoiles
- Le récit commence par la chute d’un serveur et de son plateau chargé de bouteilles sur une terrasse jouxtant un café des hauts de San Diego.
- Le serveur se retrouve par terre alors que tous alentour scrutent le ciel.
- Ila buté sur le câble d’alimentation d’un télescope électronique.
- Tous scrutent la Comète.
- Dont le passage coïncide, ce soir-là, avec une éclipse de lune.
- Et le serveur, aidé de quelques clients, ramasse les éclats de verre qui sont comme des débris d’étoiles.
- Ce pourrait être kitsch, mais non.
-
- Le pont céleste.
- On voit des cônes de pierre noire sur lesquels déferlent des dunes.
- Le Voyageur se trouve quelque part au Maroc, dans un lieu dominé par les tumulus mortuaires d’une civilisation disparue.
- Là encore, le lien entre un lieu fortement chargé, et le passage des humains, est exprimé avec un mélange de précision et de poésie très singulier.
- Mort à Séville.
- Le dimanche des Rameaux, dans les arènes de Séville, se déroule un dernier combat entre un cavalier porteur de lance et un taureau.
- La suite des figures est marquée par l’hésitation du taureau et la blessure du cheval, puis du public jaillit la demande de grâce, d’une voix unique.
- L’affrontement est évoqué avec une sorte de solennité, sans un trait de jugement de la part duVoyageur.
- C’est très plastique et assez terrifiant.
- Et cela finit comme ça doit finir.
- Sans que rien n’en soit dit.
- Fantômes.
- On passe ensuite en Islande, où le Voyageur croit voir des fantômes.
- Se trouve là en compagnie d’un photographe, familier des légendes islandaises,nourries par les proscrits relégués dans cet arrière-pays.
- Lui raconte celle, saisissante, du bandit à qui le bourreau a coupé une jambe pour l’empêcher de se sauver, et qui a appris a courir en faisant « la roue ». Une roue humaine qui terrifie les passants quand elle leur fonce dessus…
- Où il est question de la peur du noir et des « diables de poussière ».
-
- Extinction d’une ville.
- Le Voyageur se retrouve au sud de Sparte.
- Ila été jeté de sa moto par il ne sait quoi.
- Puis remarque, dans la nuit, que les lumières de la ville de Kalamata sont éteintes.
- Ensuite il rejoint un café en terrasse où il découvre, à la télé, qu’un séisme vient d’avoir lieu dans la région.
- Quia provoqué se chute et l’extinction de la ville.
- Cela encore raconté sans le moindre pathos. J’étais là, telle chose m’advint.
- Maisrien non plus de froidement objectif là-dedans.

À la lisière des terres sauvages.
- Dansun asile psy autrichien, une jeune femme s’apprête à faire du feu avec du papier et des copeaux invisibles.
- On voit la scène, très développée ensuite.
- Sous le regard d’une gardienne dans une cage de verre.
- La jeune femme entend une voix qui lui dit : « Tu ne doit pas tetuer »…
-
- Tentative d’envol.
- Au sud de la Nouvelle Zélande,cen terre maorie, le Voyageur observe un jeunealbatros royal en train d’essayer de s’envoler.
- L’occasiond’une longue et épique digression sur la vie des albatros, telle que la luiévoque un ancien chauffeur d’autocar devenu ornithologue après la mortaccidentelle de sa femme.
- Formidablerécit ponctué de nouvelles diverses en provenance du monde des humains.
- Le Paon.
- À New Delhi, son chauffeur de taxi lui évoque l’imminente pendaison du meurtrier d’Indira Gandhi.
- Une certaine psychose règne, liée àl’attentat qui a provoqué le massacre de milliers de sikhs.
- Atmosphère de pogrom.
- Le Voyageur veut se rendre au Rajasthan et à Jaïpur.
- « Et c’est alors que je vis le paon ».
- Une apparition qui rappelle celle du paon de Fellini, dans Amarcord…
- L’attentat.
- Le Voyageur se retrouve à Katmandou, dont les frondaisons des arbres sur le boulevard central, sont occupées par des milliers de renards volants.
- Plusieurs membres de la famille viennent d’être tués, et le nouveau roi se trouve probablement dans la limousine d’un convoi.
- Au moment de l’attentat auquel assiste le Voyageur, une nuée de renards volants obscurcit le ciel.
- Où le Voyageur croit voir un écho significatif aux événements en cours…
- Attaque aérienne.
- On se trouve maintenant sur les hautes terres boliviennes.
- Où le Voyageur chemine avec des amis, un biologiste bavarois et sa compagne italienne.
- Quand surgissent des chasseurs qui volent en rase-motte au-dessus d’eux, la jeune femme leur lance en espagnol : No pasaran.
- Il faut préciser qu’un nouveau dictateur s’est installé en Bolivie.
- Mais le pilote a vu le geste de défi de la jeune femme et fait demi-tour et canarde le trio.
- Se non è vero… io ci credo purtoppo.

- Plage sauvage.
- Un vieux type au crâne rasé, sur une plage brésilienne, semble rendre un culte privé à une femme dont il tient la photographie près de lui.
- Et soudain son parasol s’envole.
- Le Voyageur va pour l’aider, mais un jeune homme sort de la forêt et secourt le vieux.
- Sur quoi le Voyageur lance « Amen ! Amen ! » à l’océan.
- Toutcela toujours étrange et vibrant de présence.
-
- Homme au bord de larivière
- Untype repose en maillot de bain au bord de la Traun, rivière de haute-Autriche.
- Quelquesenfants veillent sur son demi-sommeil, claquant des mains pour tuer les taonsqui lui tournent autour.
- Les taons morts sont recueillis dans des sachets de feuilles.
- Lorsque le type se réveille, il compte les taons et distribue des piécettes à sesgardiens du sommeil.
- Etrange et belle scène d’été.

- Le souverain des héros.
- Au sommet de l’île d’Ios, dans les Cyclades, le Voyageur découvre les stèles blanches du tombeau d’Homère (92-97) et médite à propos de ce monument au « plus grand poète de l’humanité ».
- Il y voit un monument « à la mémoire d’un chœur de conteurs disparus »,tout en évoquant merveilleusement ce lieu que je me rappelle comme de ce jour-là après la baignade…
- Un chemin de croix.
- Sur la route de Santa Fe, à bord d’une Cadillac bordeaux qu’il a louée, le Voyageur croise une procession entourant un porteur de croix, dont les pèlerins le chassent bientôt à coups de pierre.
- Peu après il rencontre un deputy sheriff qui lui explique que ces penitentes procèdent parfois à de véritables crucifixions, parfois fatales au crucifié volontaire,mais absolument illégales…
- D’outre-tombe.
- À Mexico, le Voyageur observe une petite accordéoniste jouant sur le trottoirdans un entourage de squelettes et de têtes de mort et de cercueils en chocolatmarquant la fête du Jozr des Morts.
- Le voyageur se rappelle alors une jeune Indienne sur une fresque, visiblementdestinée à un sacrifice rituel à l’ancienne cruelle façon. (p.104)
- Chacunde ces récits se constitue en unité, cristallisé par le regard du Voyageur etplus encore par son art de l’évocation, à la fois réaliste et magique.
- On pense à Werner Herzog, en moins morbide, ou à Sebald, en plus profond.
- Déplacement de sépultures
- Sur l’Île de Robinson Crusoë, quatre mois après un tsunami.
- Un homme s’affaire à mettre de l’ordre dans les tombes dévastées par l’eau.
- Le Voyageur se trouve là sur les traces d’Alexandre Selkirk, le boucanier dont s’est inspiré Daniel Defoe.
- Unrécit qui suggère physiquement la mêlée des vivants et des morts.
- L’alerte donnée par une petite fille a permis de limiter le nombre de morts en ces lieux.
- Prise accidentelle
- Suit le récit du sauvetage, par un pêcheur de homards furibond, du bateau à bord duquel le Voyageur se trouvait.
- Le pêcheur maudit le ciel à cause de sa pêche calamiteuse : Un seul homard dans 59 casiers.
- Mais en arrivant au port, de rage, il remet le homard unique à l’eau…
- Dans les profondeurs
- Avec d’autres whale watchers, le Voyageur observe une baleine « timide » qui a l’air de rêver au-dessous de lui, son aile reposant sur son baleineau…
- Ensuiteil éprouve une vraie terreur lorsque la baleine s’approche de lui. On pense àMoby Dick, au fil d’une évocation de ces immensités marines…
-
- La reine de la jungle
- Il voit un veau mort dans une clairière d’herbe entourée de jungle.
- La chose se passe dans l’Etat fédéral brésilien de Sao Paulo.
- Le proprio est un Allemand émigré qui a importé des vaches du Simmental.
- La forêt vierge perçu comme une entité vivante que l’Allemand a combattu pendant des années.
- Récit de ses tribulations.
- Et soudaine apparition d’un anaconda de sept ou huit mètres traversant lentement la route.
- Telle étant la reine de la jungle.
- Dont un train routier lui fonçant dessus aura probablement brisé les vertèbres, quoique le serpent continue d’avancer…
- La transmission
- Histoire du batelier Sang, sur le Mékong, dont le fils conduit depuis trois jours le bateau sur lequel se trouve le Voyageur.
- Quand il y a un danger, son père lui pose la main sur l’épaule, sans un conseil de plus.
- Le fils connaît chaque remous du fleuve par son nom ancien.
- L’histoire de Sang recoupe celle des bombardements sur le Laos, dont l’intensité à dépassé ceux de l’Europe à la fin de la guerre.

- L’Adieu
- Sur un banc de la place du marché d’un bourg autrichien, un vieil homme, prof retraité et veuf, reste là avec une amie et fait parfois semblant de dormir.
- Cette fois pourtant,il peine à se réveiller, jusqu’au moment où l’on constate qu’il ne fait plus semblant du tout.
- À la morgue, une larme versée par le Voyageur nous fait comprendre qu’il vient de perdre son père.
- Dans l’espace cosmique
- Le Voyageur se retrouve couché dans un canot à fond plat, conduit par un Maori dans une sorte de labyrinthe à ciel ouvert.
- Puis le canot s’échoue sur un matelas spongieux formé d’insectes morts.
- On retrouve là les sensations à la fois physiques et et quasi métaphysiques évoquées par Coloane ou Sepulveda au contact de la nature sauvage.
- Drive au Pôle Nord
- Récit d’une tout autre tonalité, dont un joueur de golf de l’Illinois est le sujet.
- Natif de Riga, il a émigré aux States après la déportation de son père par les Soviétiques.
- Débarqué au pôle nord à bord d’un brise-glace atomique, il va tirer dix coups sous le regard interdit du Voyageur, dix balles de golf dans la neige, à proximité du drapeau russe…
- Retour au bercail
- Le long d’une rivière canadienne, en Ontario, le Voyageur assiste à la remontée problématique des saumons qui vont se heurter à l’obstacle d’une cascade asséchée.
- Désignant la« saloperie da cascade », un pêcheur n’en fait pas moins la cueillette de quelques saumons survivants…
- Courants contraires
- Au Cambodge, le Voyageur assiste au feu d’artifice sur le Mékong, à l’occasion de la fête de l’eau à Phnom Penh, avant d’évoquer les effets de la mousson sur les crues des cours d’eau et des lacs.
- Cette évocation recoupe celle des massacres imputables aux Khmers rouges.
- Très remarquable récit là encore.
- Le travail des anges
- Le Voyageur se retrouve à Trebic, près de l’église Saint Martin et non loin du cimetière juif dont s’occupe le vieux Pavlik, ancien instituteur non juif.
- Il est là comme un gardien de mémoire, car il est question de désaffecter ce cimetière où reposentplus de 11.000 Juifs.
- Il est visiblement marqué par la réflexion selon laquelle les anges du Tout Puissant ont regardé passer les trains de déportés vers les camps d’extermination sans broncher.
- Dans la forêt de colonnes
- Devant la citerne géante de Yerebatan, en la basilique souterraine de Justinien, au milieu de la forêt des colonnes, le Voyageur observe le curieux manège d’un visiteur qui s’immerge après avoir jeté une pièce dans l’eau, qu’il entreprend ensuite deretourner.
- Scène étrange en ce lieu, comme beaucoup d’autres scènes de ce livre en d’autres lieux…
- La beauté des ténèbres
- Le Voyageur se décrit lui-même en train de scruter, avec ses instruments d’astronomie, la galaxiespirale de la Chevelure de Bérénice, qui a mis quelque 44 millions d’annéespour arriver du fond de l’espace à cet observatoire pseudo de Haute-Autriche.
- La séquence est assezvertigineuse, finalement traversée par le cri d’une chouette hulotte rappelant que le ciel communique avec la terre…
- Tombé du ciel nocturne
- À Jaipur cette fois,du toit en terrasse de l’hôtel dit Le Palais des Vents, le Voyageur assiste àl’envol de milliers de cerfs-volants à l’occasion de la fin de l’hiver.
- Le récit de la chute d’une roussette, blessée par l’armature aiguisée d’un cerf-volant, corse le récit de manière significative, comme l’épisode des renards volants…
- Le pianiste
- Il y a du conte très plastique, à la japonaise, dans cet épisode faisant intervenir un très petit pianiste, assis comme un enfant à un grand piano, tandis que l’air extérieur vibre au chant des cigales.
- Le reste se ressent plus qu’il ne se décrit, comme souvent au fil de ces pages subtiles, à la fois réalistes et irréelles.
-
- La chance et l’océan calme
- Le Voyageur, dans un quartier populaire de Valparaiso, observe un type qui lui semble un vendeur de billets de loteries au vu du collier de tickets qu’il porte autour du cou.
- Or ces billets ne sont pas à vendre mais représentent la collection des billets non gagnants rassemblés par le type en question.
- Tout cela sur fond de réalité chilienne non détaillée au demeurant…
- Les règles du paradis
- Suit le plus long récit du livre, de presque vingt pages, évoquant la saga fameuse des révoltés du Bounty, alors que le Voyageur se trouve sur l’île perdue de Pitcairn où les mutins ont fini par débarquer et crever après moult tribulations.
- L’on en apprend plus sur l’aventure de Fletcher Christian et de ceux qui l’ont assisté, puis le Voyageur interroge certains des descendants des forbans et se balade le long des falaises à-pic del’île.
- Il y a là-dedans unmélange de souffle épique et de sauvagerie où les fantasmes paradisiaques à la Rousseau en prennent un rude coup.
- Tout cela très fort, toujours inattendu et intéressant, d’une expression limpide et comme nimbée d’étrangeté ou de mystère.
L'on est ici à mi-parcours de ce livre sans pareil.
La face cachée du salut
- L’apparition d’un gilet de sauvetage rouge, au bord d’un champ d’épaves de l’Océan indien, prélude à l’évocation du drame qui a coûté la vie à l’équipage d’un cotre disparu. Dont l’épave seule, intacte, réapparaît ensuite. Geste rituel d’une Hindoue versant de l’eau du Gange dans l’eau où reposent les noyés.
Le non-mort.
- Ensuite on se retrouve sur la Place Rouge, à Moscou, où sept couples de jeunes mariés attendent de se pointer dans le mausolée de Lénine.
- Diverses considérations devant la dépouille irréelle du révolutionnaire devenu dictateur.
- Visiteurs au Parlement.
- Après la visite à la momie russe, le Voyageur observe un vieux type, pieds nus, dans la file des curieux se pressant à l’entrée du Reichstag de Berlin.
- Les pieds nus de l’original intriguent une petite fille et mettent en évidence, sans peser, l’aspect étrange voire absurde de cetteprocession.
Nu dans l’ombre
- De nombreux récits du recueil ont une connotation politique. Sans discours à ce propos.
- Ici, c’est un homme nu, dans la cours d’une prison psychiatrique, à l'époque de la Grèce des colonels.
- Le cri du type déchire et signifie, sans besoin d’autre commentaire.
- Cependant la scène est minutieusement détaillée, avec quelque chose de très oppressant.
 Un requin dans le désert
Un requin dans le désert
- Sur une route côtière de la mer Rouge, le Voyageur remarque un arbre couvert de petits fanions, lui rappelant les drapeaux de prière tibétains. Mais la comparaison s’arrête là car ces chiffons n’ont rien de sacré.
- Puis on se retrouve au marché aux poissons d’Al Hudaydah, et ensuite sur les lieux d’un accident de triporteur dont le conducteur débite le requin qu’il transportait, qu'il revend aux badauds.
- Sang
- Le Voyageur se remémore son enfance en Autriche, après le massacre, par la police, d’un garçon sauvage du lieu.
- Ivre, le lascar avait profané un monument aux morts de la guerre, et les anciens combattants l’ont dénoncé.
- Le Voyageur était alors enfant de chœur, et il évoque le drame à la manière d’un Thomas Bernhardd ans ses récits de faits divers.
- Les traces de sang dans l’église ont marqué la mémoire du narrateur.

- Arche de lumière
- Le Voyageur se retrouve à Sydney où il observe l’ascension de l’arche gigantesque du HarbourBridge, par un type dont il croit qu’il va se suicider.
- Puis la ville est frappée par une panne d’électricité géante.
- Il croit voir« la phase terminale d’un chemin de vie ».
- Mais c’est comme uneerreur d’optique, ou comme une façon d’accommoder la vision, fréquente chez CR.
- Seconde naissance
- À bord d’un brise-glace russe à l’arrêt sur labanquise, un pilote d’hélico convie ingénieurs et matelots à fêter sa seconde naissance après le crash de son appareil.
- Cela se passe vingt ans après le récit de la découverte de la Terre François-Joseph, que CR aévoquée dans Les effrois de la glace etdes ténèbres.
- Très belle évocation d’une ourse polaire et de ses petits (p.274)
- Le dieu de glace.
- Le Voyageur évoque le désarroi d’un petit garçon qui voit fondre la tête d’un bonhomme de neige conservé dans un congélateur.
- La scène se passe devant un manoir du comté de Cork.
- Le père et le fils finissent par éclater de rire à la vision de la tête fondue.
- On n’en saisit pas moins l’importance magique de cette tête de neige…
- Le prêcheur.
- Se la jouant Jésus et les marchands du temple, un prêcheur invective les petits commerçants ukrainiens et caucasiens dont les cahutes envahissent la pelouse du grand stade du Dixième anniversaire, construit en mémoire du soulèvement de Varsovie.
- La scène est assez emblématique, typique de la Polognes de la fin des années 80.
- Je me rappelle une manifestation patriotique monstre dans le même stade, pendant les années de plomb.
- Un photographe.
- Un cantonnier en train de creuser une fouille, devant une maison bleu pâle de la ville dominicaine de Puerto Plata, est prié par une dame de la prendre en photo avec deux types.
- Une pancarte vient d’être posée devant la maison, annonçant l’ouverture d’un cabinet d’hypnotiseur.
- Le cantonnier, après avoir tenu l’appareil de photo en ses mains, se dit que peut-être sa vie auraitpu être tout autre…
- Là encore, la banalitéd’une scène se charge d’étrangeté et de sens plus profond.

- Pacifico, Atlantico.
- Le Voyageur se retrouve à 3400 mètres d’altitude, juste au-dessous du cratère de l’Irazu, le volcan le plus dangereux du Costa Rica.
- Il se trouve là dans l’espoir de voir l’oiseau quetzal, mais le brouillard est au rendez-vous.
- Il est aussi question du pèlerinage à la Vierge noire, la Negrita.
- Love in vain.
- Dans une clairière de la mangrove, sur la côte est de Sumatra, le Voyageur surprend une scène un peu surréaliste de karaoké sans public, dont le chanteur (aveugle) interprète un tube des Rolling Stones,
- Comme à chaque fois, ce n’est jamais le pittoresque qui est recherché par le Voyageur, mais l’étrangeté, le mystère, la magie d’une situation où nature et culture ne cessent de s’interpénétrer. (p.300)
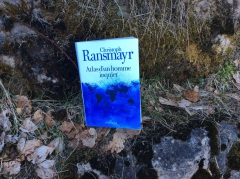
(À suivre)



 Sur l
Sur l Sur la littérature: "L'identité française, ensuite, c'est la littérature. Je m'inquiète qu'elle soit de moins en moins enseignée à l'école. Que les fables de La Fontaine ne soient plus apprises aux enfants. Que Les Châtiments de Victor Hugo prennent la poussière. Et je répète là ce que j'ai écrit dans Marianne: si je devais choisir entre la littérature française et la gauche, si la gauche me donnait l'impression de rompre avec cette nourriture essentielle que sont les livres, je choisirais la littérature. Et ce n'est pas un propos de mandarin. J'ai connu un paysan qui n'avait lu qu'un livre dans sa vie, c'était Les Misérables: il était cultivé.
Sur la littérature: "L'identité française, ensuite, c'est la littérature. Je m'inquiète qu'elle soit de moins en moins enseignée à l'école. Que les fables de La Fontaine ne soient plus apprises aux enfants. Que Les Châtiments de Victor Hugo prennent la poussière. Et je répète là ce que j'ai écrit dans Marianne: si je devais choisir entre la littérature française et la gauche, si la gauche me donnait l'impression de rompre avec cette nourriture essentielle que sont les livres, je choisirais la littérature. Et ce n'est pas un propos de mandarin. J'ai connu un paysan qui n'avait lu qu'un livre dans sa vie, c'était Les Misérables: il était cultivé. ur l'ouverture au monde: "Certes, il y a aujord'hui une désolante tendance identitariste qui fait fi de l'ouverture au monde de notre pays. Cette ouverture que la Révolution a consacrée et qui existait déjà avec certains rois de France. Ce "souci du monde" fat aussi parti de notre identité. Il n'empêche: je ne voispas pourquoi la France serait le seul pays à ne pas avoir droit à une identité"...
ur l'ouverture au monde: "Certes, il y a aujord'hui une désolante tendance identitariste qui fait fi de l'ouverture au monde de notre pays. Cette ouverture que la Révolution a consacrée et qui existait déjà avec certains rois de France. Ce "souci du monde" fat aussi parti de notre identité. Il n'empêche: je ne voispas pourquoi la France serait le seul pays à ne pas avoir droit à une identité"... Celui qui traite son épouse Frieda à moitié paralysée mais encore assez lucide, 87 ans au compteur, de vieille tomate / Celle qui prétend avoir tenu ses promesses faites à Dieu Le Fils le jour de sa communion solennelle à l’église catholique Saint-Christophe jouxtant les studios de Radio-Lausanne à la grande époque de l’inspecteur Picoche / Ceux qui font les quatre cents coups dans le pavillon Les Poulains de l’Etablissement médico-social Au Point du jour / Celui qui se rappelle l’odeur croupie des bras du ruisseau de la Vuachère au printemps des écrevisses / Celle qui a serré son trousseau dans une certaine malle qu’elle a déclarée maudite après que sa mère Fernand née Roduit eut éconduit son septième prétendant / Ceux qui en venaient au mains au cinéma Bio au temps des westerns à 50 centimes / Celui qui se rappelle assez exactement le sentiment de délivrance qu’il a éprouvé lorsqu’il a ouvert la cage des treize perruches qu’on lui a offertes pour son neuvième anniversaire coïncidant avec l’arrivée des réfugiés hongrois / Celle qui faisait payer vingt centimes à ses enfants quand leur échappait le moindre merde-chier / Ceux qui logeaient une quinzaine de saisonniers italiens dans les anciens poulaillers du domaine / Celui qui a vu l’incendiaire Gavillet de près quand on l’a emmené menotté et penaud après que les gendarmes l’eurent localisé dans le bois de la Scie sur dénonciation du taupier Jolidon/
Celui qui traite son épouse Frieda à moitié paralysée mais encore assez lucide, 87 ans au compteur, de vieille tomate / Celle qui prétend avoir tenu ses promesses faites à Dieu Le Fils le jour de sa communion solennelle à l’église catholique Saint-Christophe jouxtant les studios de Radio-Lausanne à la grande époque de l’inspecteur Picoche / Ceux qui font les quatre cents coups dans le pavillon Les Poulains de l’Etablissement médico-social Au Point du jour / Celui qui se rappelle l’odeur croupie des bras du ruisseau de la Vuachère au printemps des écrevisses / Celle qui a serré son trousseau dans une certaine malle qu’elle a déclarée maudite après que sa mère Fernand née Roduit eut éconduit son septième prétendant / Ceux qui en venaient au mains au cinéma Bio au temps des westerns à 50 centimes / Celui qui se rappelle assez exactement le sentiment de délivrance qu’il a éprouvé lorsqu’il a ouvert la cage des treize perruches qu’on lui a offertes pour son neuvième anniversaire coïncidant avec l’arrivée des réfugiés hongrois / Celle qui faisait payer vingt centimes à ses enfants quand leur échappait le moindre merde-chier / Ceux qui logeaient une quinzaine de saisonniers italiens dans les anciens poulaillers du domaine / Celui qui a vu l’incendiaire Gavillet de près quand on l’a emmené menotté et penaud après que les gendarmes l’eurent localisé dans le bois de la Scie sur dénonciation du taupier Jolidon/ 











 En outre, la méthode d’investigation de Claude Lanzmann est aussi exceptionnelle qu’inédite, qui tend a cerner progressivement les faits en faisant se recouper les dépositions. Ainsi, patiemment mis en confiance par l’enquêteur (qui s’est présenté à lui comme un banal chercheur enhistoire), l’ex-SS de Treblinka, Franz Suchomel, va-t-il compléter let émoignage d’Abraham Bomba, coiffeur Juif du camp. Celui-ci, interrogé dans son échoppe, en Israël, mime les gestes avec lesquels, en toute hâte, il rasait les futurs suppliciés. Et celui-là de raconter comment, à l’autre bout de la « chaîne », il réceptionnait les cadavres à la sortie de la chambre à gaz, agglutinés «comme des pommes de terre ».
En outre, la méthode d’investigation de Claude Lanzmann est aussi exceptionnelle qu’inédite, qui tend a cerner progressivement les faits en faisant se recouper les dépositions. Ainsi, patiemment mis en confiance par l’enquêteur (qui s’est présenté à lui comme un banal chercheur enhistoire), l’ex-SS de Treblinka, Franz Suchomel, va-t-il compléter let émoignage d’Abraham Bomba, coiffeur Juif du camp. Celui-ci, interrogé dans son échoppe, en Israël, mime les gestes avec lesquels, en toute hâte, il rasait les futurs suppliciés. Et celui-là de raconter comment, à l’autre bout de la « chaîne », il réceptionnait les cadavres à la sortie de la chambre à gaz, agglutinés «comme des pommes de terre ». La spirale du meurtre
La spirale du meurtre






 Un requin dans le désert
Un requin dans le désert

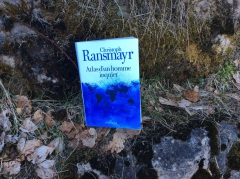

 Oui et non. Car s'il est vrai que celle-ci est un thème nabokovien par excellence, il n'en est pas moins certain que l'art et ses beaux reflets sont plus «réels» aux yeux de Nabokov que le tout-venant du quotidien. C'est d'ailleurs le thème de La Vénitienne, la plus importante de ces nouvelles de jeunesse, qui évoque l'amour fou d'un vilain jeune homme pour une femme à la fois réelle et figurée sur un tableau.
Oui et non. Car s'il est vrai que celle-ci est un thème nabokovien par excellence, il n'en est pas moins certain que l'art et ses beaux reflets sont plus «réels» aux yeux de Nabokov que le tout-venant du quotidien. C'est d'ailleurs le thème de La Vénitienne, la plus importante de ces nouvelles de jeunesse, qui évoque l'amour fou d'un vilain jeune homme pour une femme à la fois réelle et figurée sur un tableau. 
 On ne veut pas le voir, mais je le constate en rééditant sur la Toile, ces jours, des papiers que j’ai égrenés durant ces trois ou quatre dernières décennies dans les journaux auxquels j’ai collaboré : que les rubriques consacrées à la culture, et plus précisément à la littérature, en Suisse romande, se sont dégradées, affadies, étiolées, sous l’effet du conformisme et de l’acquiescement au culte croissant du grand nombre et de la facilité, et ce qui me frappe est la rapidité avec laquelle tout cela s’est produit.
On ne veut pas le voir, mais je le constate en rééditant sur la Toile, ces jours, des papiers que j’ai égrenés durant ces trois ou quatre dernières décennies dans les journaux auxquels j’ai collaboré : que les rubriques consacrées à la culture, et plus précisément à la littérature, en Suisse romande, se sont dégradées, affadies, étiolées, sous l’effet du conformisme et de l’acquiescement au culte croissant du grand nombre et de la facilité, et ce qui me frappe est la rapidité avec laquelle tout cela s’est produit.  La critique américaine a situé les nouvelles du jeune David James Poissant dans la filiation de Raymond Carver et de Tchekhov, mais je demandais à voir, et le fait est que les meilleures des onze nouvelles du recueil intitulé Le Paradis des animaux méritent autant d’attention que d’éloges, même si le rapprochement avec les deux auteurs (surtout Tchekhov) se discute.
La critique américaine a situé les nouvelles du jeune David James Poissant dans la filiation de Raymond Carver et de Tchekhov, mais je demandais à voir, et le fait est que les meilleures des onze nouvelles du recueil intitulé Le Paradis des animaux méritent autant d’attention que d’éloges, même si le rapprochement avec les deux auteurs (surtout Tchekhov) se discute. 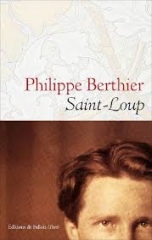 C’est un bonheur immédiat et sans mélange que nous vaut la lecture du Saint-Loup de Philippe Berthier, relevant de l’approche littéraire la plus généreuse et la plus pénétrante, appuyée par d’innombrables citations opportunes, entre autres mises en rapport, d’un personnage majeur de la Recherche proustienne dont on apprend illico, par l’auteur, qu’il a été positivement « oublié » par les auteurs du récent Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, à savoir Jean-Paul et Raphaël Enthoven, qui ne lui accordent pas une entrée…
C’est un bonheur immédiat et sans mélange que nous vaut la lecture du Saint-Loup de Philippe Berthier, relevant de l’approche littéraire la plus généreuse et la plus pénétrante, appuyée par d’innombrables citations opportunes, entre autres mises en rapport, d’un personnage majeur de la Recherche proustienne dont on apprend illico, par l’auteur, qu’il a été positivement « oublié » par les auteurs du récent Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, à savoir Jean-Paul et Raphaël Enthoven, qui ne lui accordent pas une entrée… En (re)lisant Femmes de Philippe Sollers, je me dis que ce n’est pas vraiment un roman mais une espèce de chronique-essai avec quelque chose du plaidoyer pro domo de quelqu’un qui n’a de cesse de se situer au-dessus des autres et de tout, affichant cyniquement son je m’en foutisme et s’en félicitant à tel point que rien ne devrait pouvoir l’atteindre.
En (re)lisant Femmes de Philippe Sollers, je me dis que ce n’est pas vraiment un roman mais une espèce de chronique-essai avec quelque chose du plaidoyer pro domo de quelqu’un qui n’a de cesse de se situer au-dessus des autres et de tout, affichant cyniquement son je m’en foutisme et s’en félicitant à tel point que rien ne devrait pouvoir l’atteindre. 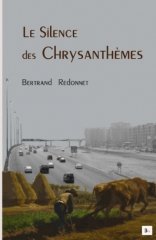 Il y a les livres possibles, et ils sont légion, mais plus rares sont les livres vrais.
Il y a les livres possibles, et ils sont légion, mais plus rares sont les livres vrais.  Sacré Redonnet ! Bien sûr qu’on se fout de toi, mais je te revaudrai ça vu que ton livre, là, je ne vais pas le lâcher de si tôt…
Sacré Redonnet ! Bien sûr qu’on se fout de toi, mais je te revaudrai ça vu que ton livre, là, je ne vais pas le lâcher de si tôt… Ayant découvert la richesse et les qualités, tout à fait insoupçonnées, du point de vue de l’art de la narration ou du dialogue, des meilleures séries télévisées, de The Wire à Breaking bad, ou de Borgen à Six feet under, en passant par Luther, les Soprano ou Twin Peaks, c’est en pays de connaissance que je me suis retrouvé à la lecture de Belleville Shanghai Express , dernier roman de Philippe Lafitte, qui emprunte à l’esthétique et à la stylisation du genre sans cesser de faire de la (bonne) littérature, en professionnel du scénario et en écrivain à part entière.
Ayant découvert la richesse et les qualités, tout à fait insoupçonnées, du point de vue de l’art de la narration ou du dialogue, des meilleures séries télévisées, de The Wire à Breaking bad, ou de Borgen à Six feet under, en passant par Luther, les Soprano ou Twin Peaks, c’est en pays de connaissance que je me suis retrouvé à la lecture de Belleville Shanghai Express , dernier roman de Philippe Lafitte, qui emprunte à l’esthétique et à la stylisation du genre sans cesser de faire de la (bonne) littérature, en professionnel du scénario et en écrivain à part entière. A la Désirade, ce dimanche 17 mai. – En recopiant/collant, sur la Toile, les petites chroniques que j’ai égrenées dans Le Matin entre octobre et novembre 1987,au fil du tour du monde que j’ai eu la chance de faire dans le sillage de l’Orchestre de la Suisse Romande, je constate que j’avais oublié maints détails de nos pérégrinations, que ces notes m’ont permis de ressusciter. C’est ainsique j’ai pour ainsi dire revécu divers épisodes effacés de ce voyage, que mespauvres mots ont fixé dans des conditions souvent compliquées par le décalage horaire ou nos constants déplacement, sans compter les obligations de présence liées à la tournée. Du moins suis-je assez content, à relire ces notes dictées au téléphone (nous ne disposions pas encore de liaisons Internet) à notre chèreArlette ou à quelque autre secrétaire de veille nocturne, de leur trouver un certain ton personnel et une tenue passable.
A la Désirade, ce dimanche 17 mai. – En recopiant/collant, sur la Toile, les petites chroniques que j’ai égrenées dans Le Matin entre octobre et novembre 1987,au fil du tour du monde que j’ai eu la chance de faire dans le sillage de l’Orchestre de la Suisse Romande, je constate que j’avais oublié maints détails de nos pérégrinations, que ces notes m’ont permis de ressusciter. C’est ainsique j’ai pour ainsi dire revécu divers épisodes effacés de ce voyage, que mespauvres mots ont fixé dans des conditions souvent compliquées par le décalage horaire ou nos constants déplacement, sans compter les obligations de présence liées à la tournée. Du moins suis-je assez content, à relire ces notes dictées au téléphone (nous ne disposions pas encore de liaisons Internet) à notre chèreArlette ou à quelque autre secrétaire de veille nocturne, de leur trouver un certain ton personnel et une tenue passable. Dans une lettre détaillée qu’elle m’envoie après sa lecture du Viol de l’ange, mon occulte amie Giovanna B., jamais rencontrée que sur Facebook mais qui m’a déjà envoyé d’excellents biscuits milanais en 3D, me gratifie d’une vraie recension, à la fois sensible et intelligente, précise et sans complaisance (elle a eu quelque peine à traverser les premiers fourrés de ma selva oscura) où elle série d’excellentes observations touchant à la construction arborescente du roman et à ses personnages, au drame rapprochant les protagonistes et au journal du tueur, au crescendo de l’émotion et aux échappées de la troisièmes partie, sans compter divers aspects de la thématique (le viol et le suicide, l’homosexualité et les rencontres salvatrices) qui m’ont remis en mémoire de nombreuses séquence du livre que j’avais oubliées. Or ce qui me touche particulièrement est que Gio s’implique personnellement dans cette lecture et fait ainsi revivre ce livre ailleurs que dans mon oublieuse mémoire…
Dans une lettre détaillée qu’elle m’envoie après sa lecture du Viol de l’ange, mon occulte amie Giovanna B., jamais rencontrée que sur Facebook mais qui m’a déjà envoyé d’excellents biscuits milanais en 3D, me gratifie d’une vraie recension, à la fois sensible et intelligente, précise et sans complaisance (elle a eu quelque peine à traverser les premiers fourrés de ma selva oscura) où elle série d’excellentes observations touchant à la construction arborescente du roman et à ses personnages, au drame rapprochant les protagonistes et au journal du tueur, au crescendo de l’émotion et aux échappées de la troisièmes partie, sans compter divers aspects de la thématique (le viol et le suicide, l’homosexualité et les rencontres salvatrices) qui m’ont remis en mémoire de nombreuses séquence du livre que j’avais oubliées. Or ce qui me touche particulièrement est que Gio s’implique personnellement dans cette lecture et fait ainsi revivre ce livre ailleurs que dans mon oublieuse mémoire… 





 Le 22 novembre 1987, le sieur JLK tirait le bilan du tour du monde de l'Orchestre de la Suisse romande qu'il avait eu l'heur d'accompagner, plus de vingt jours durant, du Japon en Californie, en chroniqueur musicalement à peu près inculte du Matin.
Le 22 novembre 1987, le sieur JLK tirait le bilan du tour du monde de l'Orchestre de la Suisse romande qu'il avait eu l'heur d'accompagner, plus de vingt jours durant, du Japon en Californie, en chroniqueur musicalement à peu près inculte du Matin.  Les plus résistants, dans la foulée, n’auront certes pas manqué de consacrer le peu de temps que leur laissait ce marathon (dix-sept concerts en une vingtaine de jours) a la découverte d’un peu de Japon ou d’un soupçon de Californie. Mais il en est d’autres qui se sont sentis réduits à l’état de «bêtes de concerts», frustrés de l’enrichissement qu’aurait pu signifier un tel voyage dans des conditions moins soumises aux lois de la rentabilité...
Les plus résistants, dans la foulée, n’auront certes pas manqué de consacrer le peu de temps que leur laissait ce marathon (dix-sept concerts en une vingtaine de jours) a la découverte d’un peu de Japon ou d’un soupçon de Californie. Mais il en est d’autres qui se sont sentis réduits à l’état de «bêtes de concerts», frustrés de l’enrichissement qu’aurait pu signifier un tel voyage dans des conditions moins soumises aux lois de la rentabilité...  Nul hasard, ainsi, que les meilleurs concerts de la tournée aient été le premier de la série japonaise, à Matsudo, devant un parterre de lycéennes enthousiastes, et les deux derniers à Tokyo, dans d’admirables salles bondées d’un public rappelant le chef jusqu’à sept ou huit fois.
Nul hasard, ainsi, que les meilleurs concerts de la tournée aient été le premier de la série japonaise, à Matsudo, devant un parterre de lycéennes enthousiastes, et les deux derniers à Tokyo, dans d’admirables salles bondées d’un public rappelant le chef jusqu’à sept ou huit fois.  Et quelle fête, aussi, que d’entrer progressivement dans la substance vive de la musique en détaillant, un peu mieux chaque soir, l’étoffe sonore de telle partie des cordes ou la rutilance de telle sonnerie de cuivres, tel éblouissant dialogue du piano de Martha Argerich et du basson de Roger Birnstingl, ou tel formidable soulèvement d’ensemble de tous les registres soudain empoignés comme une pâte fluide et vigoureuse à la fois, enfin quelle leçon que d’assister au work in progress du chef avouant, sans fausse modestie, son insatisfaction (pour la symphonie de Brahms par exemple) ou ses doutes...
Et quelle fête, aussi, que d’entrer progressivement dans la substance vive de la musique en détaillant, un peu mieux chaque soir, l’étoffe sonore de telle partie des cordes ou la rutilance de telle sonnerie de cuivres, tel éblouissant dialogue du piano de Martha Argerich et du basson de Roger Birnstingl, ou tel formidable soulèvement d’ensemble de tous les registres soudain empoignés comme une pâte fluide et vigoureuse à la fois, enfin quelle leçon que d’assister au work in progress du chef avouant, sans fausse modestie, son insatisfaction (pour la symphonie de Brahms par exemple) ou ses doutes... Souvenir d’une nuit à refaire le monde et à comparer les mérites de l’Europe et de l’Amérique, avec l’ami Kevin Brady et sa dulcinée, avant le lever du soleil sur le Pacifique.
Souvenir d’une nuit à refaire le monde et à comparer les mérites de l’Europe et de l’Amérique, avec l’ami Kevin Brady et sa dulcinée, avant le lever du soleil sur le Pacifique.  Le bilan du Maestro
Le bilan du Maestro
 En 1997 paraissait, sous le titre alléchant de Mille Feuilles, le premier de quatre tomes réunissant les proses éparses (sur la vie, Paris, peintres, romanciers, hauts lieux et riches heures) de l'écrivain, décédé en décembre 1998.
En 1997 paraissait, sous le titre alléchant de Mille Feuilles, le premier de quatre tomes réunissant les proses éparses (sur la vie, Paris, peintres, romanciers, hauts lieux et riches heures) de l'écrivain, décédé en décembre 1998.  Parlant de lui-même dans le Dictionnaire de Jérôme Garcin, où les auteurs étaient appelés à consigner leur propre bilan posthume, Georges Borgeaud notait ceci de bien significatif: «Il avait taillé la flûte dont il jouait dans le concert littéraire dans un roseau des marais de la mémoire d'où il tirait la substance de ses partitions et de ses thèmes parmi lesquels les plus obstinés: l'éloge de la solitude et du silence, de l'indépendance absolue, du vagabondage de l'esprit et du corps.» Et de se comparer au merle «dont le jabot ne contient que de brèves, mélancoliques et répétitives variations sur un ton mineur où l'amour, bien entendu, trouve ses notes mais aussi les accents de la peur, dela colère, de la protestation et les roulades de la moquerie et du rire».
Parlant de lui-même dans le Dictionnaire de Jérôme Garcin, où les auteurs étaient appelés à consigner leur propre bilan posthume, Georges Borgeaud notait ceci de bien significatif: «Il avait taillé la flûte dont il jouait dans le concert littéraire dans un roseau des marais de la mémoire d'où il tirait la substance de ses partitions et de ses thèmes parmi lesquels les plus obstinés: l'éloge de la solitude et du silence, de l'indépendance absolue, du vagabondage de l'esprit et du corps.» Et de se comparer au merle «dont le jabot ne contient que de brèves, mélancoliques et répétitives variations sur un ton mineur où l'amour, bien entendu, trouve ses notes mais aussi les accents de la peur, dela colère, de la protestation et les roulades de la moquerie et du rire».  C'est encore d'oiseaux qu'il est question dans la préface de Frédéric Wandelère, collectionneur d'appeaux comme l'est aussi l'écrivain,qui rappelle que le protagoniste du Préau s'appelle Passereau et souligne la récurrence du thème dans ces chroniques, de merles en buses et jusqu'au crapaud-flûte que le contemplatif du Lot écoute la nuit dans son pigeonnier.
C'est encore d'oiseaux qu'il est question dans la préface de Frédéric Wandelère, collectionneur d'appeaux comme l'est aussi l'écrivain,qui rappelle que le protagoniste du Préau s'appelle Passereau et souligne la récurrence du thème dans ces chroniques, de merles en buses et jusqu'au crapaud-flûte que le contemplatif du Lot écoute la nuit dans son pigeonnier. Or Borgeaud aime beaucoup en détaillant ce qui requiert sa curiosité sous sa loupe d'enfant demeuré: sa visite à «un certain» Ramuz, le dortoir de collège catholique qu'il revisite pour évoquer la crainte romande du bonheur des corps, la balade inspirée (par quelques fioles partagées avec Jacques Chessex) qu'il restitue dans L'Embouchure aux buses, ses belles approches de peintres (Soulages et de Staël, en particulier), ou ses méditations plus personnelles, composent un ensemble frémissant d'intelligence sensible et d'alacrité cocasse, truffé de ces adjectifs inattendus ou de ces trouvailles (ces poules qui traversent le blé en herbe «comme des sampans»...) auxquels on reconnaît l'art de l'oiseleur.J
Or Borgeaud aime beaucoup en détaillant ce qui requiert sa curiosité sous sa loupe d'enfant demeuré: sa visite à «un certain» Ramuz, le dortoir de collège catholique qu'il revisite pour évoquer la crainte romande du bonheur des corps, la balade inspirée (par quelques fioles partagées avec Jacques Chessex) qu'il restitue dans L'Embouchure aux buses, ses belles approches de peintres (Soulages et de Staël, en particulier), ou ses méditations plus personnelles, composent un ensemble frémissant d'intelligence sensible et d'alacrité cocasse, truffé de ces adjectifs inattendus ou de ces trouvailles (ces poules qui traversent le blé en herbe «comme des sampans»...) auxquels on reconnaît l'art de l'oiseleur.J
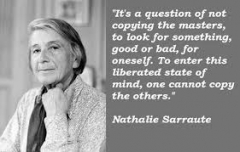 Le trou noir
Le trou noir  Nathalie Sarraute: Ici, Gallimard, 182 pages.
Nathalie Sarraute: Ici, Gallimard, 182 pages.

 Le Luxembourg le matin est une oasis de vitalité radieuse. Tout le monde y court sans considération d’âge. Une très vieille Chinoise vêtue de vert s’y exerce, en compagnie d’un tout frais Occidental glabre, au jeu du sabre de fer-blanc à fulgurant foulard. Un peu plus loin, devant la statue de Blanche de Castille, décédée en 1252 (sa date de naissance est effacée), une autre alerte vieillarde à profil d’Indienne, en tenue de soie vieux rose, se livre elle aussi à toute une gestuelle énigmatique...
Le Luxembourg le matin est une oasis de vitalité radieuse. Tout le monde y court sans considération d’âge. Une très vieille Chinoise vêtue de vert s’y exerce, en compagnie d’un tout frais Occidental glabre, au jeu du sabre de fer-blanc à fulgurant foulard. Un peu plus loin, devant la statue de Blanche de Castille, décédée en 1252 (sa date de naissance est effacée), une autre alerte vieillarde à profil d’Indienne, en tenue de soie vieux rose, se livre elle aussi à toute une gestuelle énigmatique... Ensuite, le long des allées ponctuées de statues de reines et de figures mythologiques, je constate pour la première fois que leurs têtes se hérissent de fines pointes évoquant d’abord des bâtons d’encens et qui sont à l’évidence de métal tenace. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Sont-ce des paratonnerres ? Ou peut-être des antennes permettant à ces êtres d’un autre temps de communiquer avec le nôtre ? Je m’interroge et puis, à considérer l’immaculée blancheur de la reine Mathilde, décédée en 1082 (date de naissance également effacée), me vient l’idée prosaïque que ces aiguilles sont probablement destinées à éloigner les pigeons. Oui, ce doit être cela : le Luxembourg reste très prisé des pigeons dont le roucoulement hante le feuillage des feuillus, mais nul d’entre eux ne se voit à l’instant sur aucun occiput d’aucune reine statufiée…
Ensuite, le long des allées ponctuées de statues de reines et de figures mythologiques, je constate pour la première fois que leurs têtes se hérissent de fines pointes évoquant d’abord des bâtons d’encens et qui sont à l’évidence de métal tenace. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Sont-ce des paratonnerres ? Ou peut-être des antennes permettant à ces êtres d’un autre temps de communiquer avec le nôtre ? Je m’interroge et puis, à considérer l’immaculée blancheur de la reine Mathilde, décédée en 1082 (date de naissance également effacée), me vient l’idée prosaïque que ces aiguilles sont probablement destinées à éloigner les pigeons. Oui, ce doit être cela : le Luxembourg reste très prisé des pigeons dont le roucoulement hante le feuillage des feuillus, mais nul d’entre eux ne se voit à l’instant sur aucun occiput d’aucune reine statufiée…
 Et voilà d’autres images du siècle, devant lesquelles je passe en visant le faune de bronze à la pantomime comme en suspens, dont je note au passage que c’est une copie italienne d’une statue de Pompéi : telle étant la danse de l’humanité sur le volcan de la planète, soudain résumée par ces instantanés de la guerre au Congo ou du Front populaire, des foules en guerre ou des foules en fête, du fameux poulbot à baguette parisienne de Willy Ronis ou de ce gosse au cerf-volant sur un terrain vague de la bande de Gaza - enfin de tant de drames qui perdurent aux quatre vents tandis que nous baguenaudons au Luco dans le soleil candide…
Et voilà d’autres images du siècle, devant lesquelles je passe en visant le faune de bronze à la pantomime comme en suspens, dont je note au passage que c’est une copie italienne d’une statue de Pompéi : telle étant la danse de l’humanité sur le volcan de la planète, soudain résumée par ces instantanés de la guerre au Congo ou du Front populaire, des foules en guerre ou des foules en fête, du fameux poulbot à baguette parisienne de Willy Ronis ou de ce gosse au cerf-volant sur un terrain vague de la bande de Gaza - enfin de tant de drames qui perdurent aux quatre vents tandis que nous baguenaudons au Luco dans le soleil candide…

 Marcel Aymé était-il le meilleur représentant de cette mouvance républicaine et «de gauche» que prétendait illustrer le nouvel hebdo ?Sûrement pas: Marcel Aymé n'était pas «de gauche», il était insituable.
Marcel Aymé était-il le meilleur représentant de cette mouvance républicaine et «de gauche» que prétendait illustrer le nouvel hebdo ?Sûrement pas: Marcel Aymé n'était pas «de gauche», il était insituable.  Marcel Aymé, Du côté de chez Marianne, Gallimard,1989.
Marcel Aymé, Du côté de chez Marianne, Gallimard,1989.


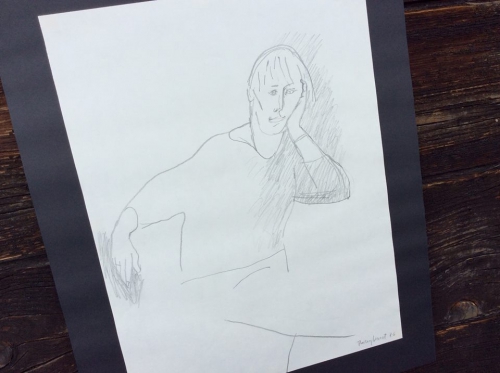


 Au reste, le couple à la fois volage et gentiment complice que forment Olga et Sinteuil dégage un indéniable charme, et cette fraîcheur insolente qui empreint la meilleure partie du livre. Enfin le lecteur sera tout remué de voir notre froide sémanalyste craquer positivement à l'idée de mettre au monde un bambichon producteur de phonèmes.
Au reste, le couple à la fois volage et gentiment complice que forment Olga et Sinteuil dégage un indéniable charme, et cette fraîcheur insolente qui empreint la meilleure partie du livre. Enfin le lecteur sera tout remué de voir notre froide sémanalyste craquer positivement à l'idée de mettre au monde un bambichon producteur de phonèmes.