
Notes critiques sur 30 films vus au Festival de Locarno 2009.
Vitus, de Fredi M. Murer. (Suisse/France) Genre comédie humaine (reprise + concert).
Nous avions découvert les tribulations du petit prodige lors de l’édition de 2006. Nicolas Bideau avait parlé de « film de vieux ». Le même Monsieur Cinéma, avec Pascal Couchepin, remirent ensemble à Fredi M. Murer le Prix du meilleur film suisse à Soleure. En version raccourcie, après une carrière éclatante (nominé aux Oscars), Vitus a été présenté en ouverture avec un concert « live » de Teo Gheorghiu, devenu concertiste international.
(500) Days of Summer, de Marc Webb (USA). Genre comédie humaine. Première européenne. Sur la Piazza.
Certains critiques ont fait la moue à la découverte de ce premier « long » d’un as du court musical. Comédie romantique revisitant les années 90 avec force clins d’oeil, notamment aux Smiths et au Lauréat, la chose est pourtant plaisante, le jeu des deux protagonistes (Zoeey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt) également épatant, et le mode de narration particulièrement efficace, qui consiste à alterner les séquences par appel de dates dans le désordre. Populaire de qualité, comme disait l’autre…
 Unter Bauern – Retter in der Nacht, de Ludi Boeken . (Allemagne) Genre drame historique. Première mondiale. Sur la Piazza.
Unter Bauern – Retter in der Nacht, de Ludi Boeken . (Allemagne) Genre drame historique. Première mondiale. Sur la Piazza.
Moment d’émotion sur la scène de la Piazza Grande, jeudi soir 6 août, lorsque deux très vieilles dames de plus de 90 ans, la Juive allemande Marga Spiegel et la dernière survivante de la famille de paysans de Westphalie qui l’a planquée et sauvée, avec sa fille, entre 1943 et 1945, sont apparues au côté du réalisateur hollandais Ludi Boeken et des acteurs de ce témoignage émouvant d’un acte de solidarité rarissime. Des critiques aussi acerbes qu’injustes, comme à la sortie de La Chute, ont été adressées à ce film pourtant honnête et nécessaire, d’une forme certes toute classique mais qui dégage une réelle émotion. Sans donner du tout dans l’édulcoration du nazisme, le film vaut aussi par son souffle narratif et son interprétation.
 Pom Poko, de Isao Takahata. Genre manga. Hommage. Sur la Piazza.
Pom Poko, de Isao Takahata. Genre manga. Hommage. Sur la Piazza.
Pour entrer dans l’univers des mangas, auquel le festival fait cette année un accueil exceptionnel, cette saga écologisante associe humour, parfois corrosif, et poésie visuelle, sur fond de folklore japonais. Les tanukis (une espèce tenant du chien et du raton laveur) ressortissent en effet aux vieilles légendes, avec leur façon de se métamorphoser à volonté, ici pour essayer d’agir sur les comportements humains globalement déprédateurs. Dans les grandes largeurs, Takahata restitue aussi de merveilleux paysages, et la virtuosité formelle, dans les enchaînements de plans et de séquences, laisse le non connaisseur positivement baba…
 Teheran without Permission, de Sepideh Farsi. (France/Iran). Genre docu créatif. Première mondiale. Section Ici et aileurs.
Teheran without Permission, de Sepideh Farsi. (France/Iran). Genre docu créatif. Première mondiale. Section Ici et aileurs.
Hasard et nécessité : la jeune réalisatrice, plus encore que Pippo Delbono, a tiré le meilleur parti d’un téléphone portable pour documenter la vie quotidienne de son pays sous contrôle. En enchaînant des interviews en voiture, souvent très intéressants, quelques entretiens « frontaux » et de nombreuses choses vues dans les rues et par les places, la cinéaste reconstruit sa ville dont on perçoit la vitalité, notamment de la jeunesse, et le dynamisme général opposés à la lourdeur du régime. Avec un côté brut de décoffrage, le document relève cependant de la narration cinématographique et du témoignage dans l'urgence.
 Shirley Adams, d'Oliver Hermanus et (scénario) Stravros Pamballis. (Afrique du Sud et USA). Genre drame humain. Compétition internationele.
Shirley Adams, d'Oliver Hermanus et (scénario) Stravros Pamballis. (Afrique du Sud et USA). Genre drame humain. Compétition internationele.
Il y a de la Mère Courage en Shirley Adams, qui pote le poids du monde sur ses seules épaules après que son jeune fils Donovan a pris une balle perdue au retour de l'école et s'est retrouvé tétraplégique. Tournlé dans les taudis de Mitchell's Plain, au Cap, ce premier long métrage d' Oliver Hermanus, 25 ans et sorti de la London Film School où il a rencontré son co-scénariste Stavros Pamballis, touche au coeur et aux tripes sans pathos pour autant. Au silence terrible du garçon (Keenan arrison) répondent les gestes de Shirley (Denise Newman, tout à fait admirable) dont le désarroi et la solitude croissent à proportion des malheurs qui s'abattent implacablement sur elle. Très bien construit, très juste aussi dans la modulation dialoguée de tous les sentiments des eprsonnages, le film impose immédiatement la densité émotionnelle des situations et la vérité d'une observation élargie au monde extérieur,jamais caricaturé. Caméra à l'épaule, dans une proximité pure de tout voyeurisme, Shirley Adams dépasse de loin le document social ou psychologique pour incarner un drame représentatif de toutes les détresses liées à la violence aveugle dans le contexte de l'après-Apartheid.
 My sister’s Keeper, de Nick Cassavetes. (USA). Genre comédie humaine. Sur la Piazza.
My sister’s Keeper, de Nick Cassavetes. (USA). Genre comédie humaine. Sur la Piazza.
Pour sauver leur fille Kate (Sofia Vassilieva) atteinte d’une leucémie, Sara (Cameron Diaz) et Brian (Jason patric) ont décidé de concevoir une petite sœur in vitro sur le conseil d’un toubib. Anna (Abigail Breslin) servira donc de « donneur universel » à sa sœur, au fil d’opérations souvent lourdes et douloureuses, jusqu’à ce qu’elle se révolte et refuse de donner un rein à Kate et s’adresse à un grand avocat (Alec Baldwin) pour la défendre. Le mélo, on le devine, n’est pas loin, surtout au fil de séquences kitsch à souhait où la famille, heureuse « malgré tout », bondit de concert dans le ciel plein de bubulles (sic). Mais les comédiens font plus fort que Cassavetes Jr : Cameron Diaz est assez terrifiante dans son rôle de mère acharnée sur la thérapie, Abigail Breslin est d’une présence saisissante de force tranquille et de sensibilité. Le film, évidemment, pose des questions multiples en matière d’éthique médicale, notamment, et son observation des comportements ne manque pas de finesse et de nuances.
 La Guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, d’Amos Gitaï. (France). Genre théâtre capté. Sur la Piazza.
La Guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, d’Amos Gitaï. (France). Genre théâtre capté. Sur la Piazza.
Trop statique et trop long, en dépit de ses qualités esthétiques et de la teneur de son texte : telle a été l’impression laissée par cette reprise, au cinéma, du spectacle présenté en juillet en Avignon par Amos Gitaï, déjà présent l’an dernier sur la Piazza avec Plus tard tu comprendras, un film beaucoup plus approprié à une projection en ce lieu. Frédéric Maire a bien expliqué que les passages transversaux entre cinéma, théâtre et autres formes d’expression intéressaient le festival, mais en fin de soirée jusqu’à point d’heures, comme ça: fatigue et basta…
Men on the Bridge, d’Asli Özge (Turquie/Allemagne). Genre docu-fiction. Cinéastes du présent.
Un fleuve tonitruant de voitures sur le Bosphore, entre deux continents que relie le pont immense, voici se détailler quatre tranches de vie ou de survie. Tel est le canevas de ce film tenant à la fois du document et de la fiction. Quatre lignes de vies représentatives de la classe moyenne et inférieure en Turquie contemporain, sur fond de nationalisme et de difficultés économiques au jour le jour: un jeune couple plombé par les ambitions petites-bourgeoises de Madame mal accordées aux aspirations un peu velléitaires de Monsieur, chauffeur de taxi pour le moment ; un flic gagne-peu rêvant de rencontrer l’âme sœur via les sites de rencontres de la Toile, à chaque fois déçu en revenant à la case réel ; un grand ado à peu près illettré, vendeur de roses sur l’autoroute et préférant finalement ce job à un emploi plus astreignant. Avec beaucoup d’empathie pour ses personnages, qu’elle a rencontrés dans la vie et qui jouent tous leur rôle, dûment « réécrit » cependant, la jeune réalisatrice turque Asli Özge, établie à Berlin, réalise un vrai film de cinéma grâce, aussi, à son formidable chef opérateur, Emre Erkmen. Avec peu de moyens et beaucoup de talent, le tableau est très vivant, servi par un sens plastique remarquable mais jamais esthétisant et un souffle constant dans la narration.
 Les yeux de Simone, de Jean-Louis Porchet. (Suisse). Genre court. Sur la Piazza.
Les yeux de Simone, de Jean-Louis Porchet. (Suisse). Genre court. Sur la Piazza.
En hommage à deux cinéphiles admirables de Pontarlier, qui perpétuent l’amour du cinéma à l’enseigne d’un ciné-club , de rêve, le producteur lausannois Jean-Louis Porchet, fondateur de CAB productions, signe son premier film, petit bijou de 7 minutes dont le rouge est la couleur par référence au film de Kieslowski, avec la visite d’Irène Jacob émouvante sur le dernier plan où, comédeinne sortie de l’écran, elle voit le couple des vieux fous de cinéma Pierre (aveugle depuis vingt ans…) et Simone Blondeau s’éloigner dans la nuit.
 Giulias Verschwinden, de Christoph Schaub. (Suisse). Genre comédie chorale. Sur la Piazza.
Giulias Verschwinden, de Christoph Schaub. (Suisse). Genre comédie chorale. Sur la Piazza.
Après Happy New Year, projeté en salle à Locarno, Christoph Schaub poursuit son observation amicale de la vie des gens avec une comédie écrite par un grand conteur, Martin Suter, pour un grand poète de cinéma, Daniel Schmid, dédicataire de l’ouvrage. La peur du vieillissement est le thème décliné, de multiples façons, par les amis de Giulia qui l’attendent dans le restaurant où ils vont célébrer son anniversaire, et par un groupe de vieillards en EMS qui fêtent les 80 ans d’une vieille chipie merveilleuse. Un troisième élément narratif se greffe à ces deux lignes continues, avec les démêlés d’une jeune voleuse surprise dans un grand magasin et retrouvant ses parents chez les flics. Porté par le dialogue, très incisif, de Suter, le film se charge cependant de densité à la faveur de la rencontre inopinée de Giulia (Corinna Harfouch, merveilleuse interprète) et d’un vieil ange passant par là (Bruno Ganz) qui va l’aider, quitte à faire lanterner ses amis, à accepter la vie comme elle est. Tout cela donnant un beau film qui, sans être du grand cinéma, tient bien la route du meilleur cinéma suisse populaire et de qualité (hum), dans la filiation par exemple de L’Invitation…
 Complices, de Frédéric Mermoud. (Suisse/France). Genre polar social. Compétition internationale.
Complices, de Frédéric Mermoud. (Suisse/France). Genre polar social. Compétition internationale.
Seul film suisse en compétition cette année, le premier « long » de Frédéric Mermoud est une autre bonne surprise de cette édition, tant par le dynamisme et l’inventivité de sa narration purement cinématographique, que par la justesse de son observation portée sur la double dérive d’un jeune couple d’amoureux « borderline ». Quand Vincent (Cyril Descours, tout à fait remarquable) rencontre Rebecca (Nina Meurisse, carrément craquante de présence) dans un cybercafé, c’est le coup de foudre immédiat. Le fait que Vincent se prostitue via internet, choque d’abord Rebecca, ensuite tentée de suivre son ami dans ses rencontres, jusqu’à celle d’un client adepte de jeux violents, qui marqueront d’ailleurs la chute de Vincent. Mais le scénario évite l’écueil d’une fin édifiante, et son intérêt tient aussi au mode de la narration, amorcée par l’enquête policière de l’inspecteur Cagan (Gilbert Melki) et de sa coéquipière Mangin (Emmanuelle Devos) dès les premières séquences du film où paraît le corps de Vincent massacré et jeté dans le Rhône. D’une très belle tenue, Complices pâtit un peu, à notre goût, de son « efficacité » même, sacrifiant aux codes du polar télévisé « à la française ». Reste de la très belle ouvrage et, côté jeunes gens, deux personnages crédibles et magnifiquement interprétés.
Nausicaä of the Valley of de Wind, de Hayao Miyazaki. (Japon). Genre saga manga. Manga Impact.
Par un auteur déjà bien connu du cinéma d’animation japonaise, cette fresque post-apocalyptique, un millier d’années après la destruction de l’écosystème terrestre par une humanité dont il ne reste plus grand-chose non plus, rappelle à le fois la fin de la guerre atomique au Japon, les monstrueux bombardiers américains et l’univers SF de Dune de Frank Herbert, avec son désert toxique de la Mer de la décomposition. Une charmante princesse, du nom de Nausicaä, va tenter de remettre un peu d’ordre et surtout de paix dans le chaos des guerres persistantes, mais ça prendra au moins 117 minutes en l’occurrence. Comme le dessin est somptueux et la « mise en scène » souvent étourdissante, le voyage en vaut assurément la peine même pour quelqu’un qui n’a pas encore attrapé la mangamania…
 Les derniers jours du monde, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. (France/Espagne /Taiwan). Genre drame cata-ludique. Sur la Piazza Grande.
Les derniers jours du monde, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. (France/Espagne /Taiwan). Genre drame cata-ludique. Sur la Piazza Grande.
Le dernier film des frères Larrieu commence par une tempête traversant l’écran horizontalement de part en part. Or ce mouvement latéral s’est communiqué soudain au ciel de Locarno qui a bientôt déversé la plus verticale des pluies sur la Piazza. C’est donc devant un public clairsemé qu’a été projeté Les derniers jours du monde dimanche soir 8 août, alors que la séance de remplacement à la FEVI accueillait le public allergique aux ondées et aux coups de vent. Quant aux perturbations qui plombent le monde dans lequel Matthieu Amalric, protagoniste masculin du film, évolue d’un lieu et d’une femme à l’autre, entre Biarritz et Toulouse également contaminés, elles sont traitées sans effets spéciaux à la mode SF. L’apocalypse joue ici sur les contrecoups d’une angoisse latente et intériorisée, à laquelle les frères opposent les derniers feux du plaisir de chair et de chère. La chose est intéressante, mais un relent de Grande bouffe nous a fait trouver celle-ci moins goûteuse que les rondeurs d’Andrea Ferréol…
 La Paura, de Pippo Delbono. (Italie/France). Genre docu créatif. Hors compétition.
La Paura, de Pippo Delbono. (Italie/France). Genre docu créatif. Hors compétition.
Aux invectives de Pippo Delbono contre son « paese di merda », l’on a envie de répondre, dans sa propre foulée, « carissima Italia », où la rage à la Pasilini reste inventive. Avec rien qu’un téléphone portable, dont les images sont pourtant retravaillées au fil d’un montage cohérent, avec adjonction sonore tantôt intempestive et tantôt poétique (la superbe séquence finale avec Bobô nu se lavant et se relavant de la saleté du monde), ce tableau kaléidoscopique d’une Italie pourrie de publicité et de corruption « douce », où jeux télévisés débiles (l’inénarrable concours de cris d’animaux) et tragédies ordinaires frottés de racisme s’entremêlent sur fond de terrains vague souillés où les Roms vivent « comme des chiens ». La chose a un côté « jeté » mais l’objet impose bel et bien une vision qu’on reliera à toute la démarche de Pippo.
 L’insurgée, de Laurent Perreau (France). Genre drame poétique. Compétition internationale. Première mondiale.
L’insurgée, de Laurent Perreau (France). Genre drame poétique. Compétition internationale. Première mondiale.
Locarno est le lieu par excellence où découvrir de tels films, aussi sensibles qu’exigeants dans leur forme. Comme dans Sous les toits de Paris de Hiner Saleem, en compétition l’an dernier, Laurent Perreau joue de la présence de Michel Piccoli, ici dans le rôle d’un vieil homme dont la petite-fille, blessée par la mort de sa mère et révoltée, se réfugie dans l’immense maison décatie. D’une grande qualité d’image et d’atmosphère, le film vaut autant par sa modulation des relations délicates entre personnes (le lien fragile et pur entre Claire (Pauline Etienne, dont le jeu tout en finesse nous l’attache) et son premier amant Thomas, que par ses échappées lyriques (la nature y très importante) ou… sportives, puisque Claire est une nageuse hors pair. Reverra-ton ce beau film dans les salles ? Cela paraît moins sûr que sa présence dans le palmarès final…
Os famosos e os duendes da morte, d’Ezmir Filho. (Brésil/France). Genre drame poétique. Compétition internationale.
Le blues de l’adolescence est-il en train de devenir un genre en soi du cinéma indépendant contemporain ? C’est la question qu’on se pose une fois de plus avec ce film dont l’intrigue se réduit aux errances d’un garçon sensible dans une petite ville brésilienne, entre ses copains et sa mère. Très belle images frottées de mélancolie, surtout au début, atmosphère intimiste, évocation fine d’un milieu provincial de moyenne bourgeoisie ennuyeuse. Hélas on n’est pas chez Fellini, les « vitelloni » manquent tout de même de relief et le sujet, qui tiendrait sur l’espace d’un court métrage, pâtit d’être tiré ainsi en longueur.
 Ivul, d’Andrew Kötting. Genre drame poétique. Concours Cinéastes du présent.
Ivul, d’Andrew Kötting. Genre drame poétique. Concours Cinéastes du présent.
On nous avait dit grand bien de ce drôle de conte ressaisissant la révolte d’un jeune homme accusé par son père d’inceste, alors qu’il n’a fait que mignoter sa sœur, effectivement adorée, mais qui l’excitait au moment de prendre congé de lui pour un séjour en Russie. Du coup, chassé par son père (Jean-Luc Bideau) « de ses terres », le garçon (Jacob Auzanneau) se réfugie sur les toits et les arbres dont il ne redescendra pas. Hélas, l’étrangeté de cette famille à moitié, dominée par un patriarche envahissant mais peu crédible (la construction des personnages est aussi sommaire que le dialogue), ne suffit pas à faire tenir debout ce long métrage en dépit de la singularité de son décor et de son atmosphère. Comme dans plusieurs films de friction vus ces dernières années à Locarno, la faiblesse du scénario et du dialogue contraste avec l’enjeu du sujet et la qualité potentielle des acteurs, nettement sous-employés dans Ivul…
 The Marsdreamers, de Richard Dindo (Suisse). Genre docu créatif. Concours Cinéastes du présent.
The Marsdreamers, de Richard Dindo (Suisse). Genre docu créatif. Concours Cinéastes du présent.
C’est une des belles surprise de l’édition 2009 que ce grand documentaire passionnant, aux splendides images de déserts et de paysages américains, où la thématique de la conquête de Mars est exposée et débattue avec beaucoup de nuances et d’intelligence par une quinzaine de personnages dont une géologue, un architecte spatial, des membres de la Mars Society, un physicien aux riches vues philosophiques, deux Amérindiens pleins de bon sens terrien, un charmant étudiant en informatique impatient d’être le premier sur la planète rouge, un écrivain et un ingénieur, notamment. Tous sont conscient du fait que la vie sur Mars sera d’abord une espèce de galère glacée en butte aux radiations, mais tous se disent partants illico, quitte à en revenir, étant par ailleurs entendu que d’autres planètes plus habitables feront plus tard de meilleures colonies de la Terre. La Terre est enfin l’objet final de ce film aux profondes résonances écologiques : la Terre qui est parfois si jolie et dont le sert devrait nous faire changer de vie avant que d’aller polluer les galaxies. Rien pour autant de lourdement didactique chez le nouveau Dindo : mais un souffle généreux qui traverse The Marsdreamers.
 Piombo fuso, de Stefano Savona (Italie). Genre docu créatif.
Piombo fuso, de Stefano Savona (Italie). Genre docu créatif.
Une extraordinaire séquence finale, figurant une procession de Palestiniens dans la nuit des ruines de Gaza, avançant vers nous comme un troupeau de damnés de la terre, marque le passage du reportage sur le terrain au grand cinéma. Dès le 14 janvier 2009, Stefano Savona est entré clandestinement à Gaza, d’ou il a envoyé quotidiennemenet des images de sa petite caméra numérique, aussitôt mises en lignes sur internet. Reprises ici et montées par Marzia Mete, avec un travail important sur la bande sonore, ce film relève de la création cinématographique autant que du document à valeur historique et politique. Pas un soldat israélien n’y apparaît, ni la moindre opération militaire. Que des gens dans les ruines, le témoignage d’un directeur d’hôpital, un enterrement de « martyrs » du Hamas martelé par les appels à la haine et à la vengeance des religieux-combattants, un tout petit enfant regardant longuement le ciel d’où le grondement des avions se déverse avec celui des voix de belluaire-muezzins invoquant leur dieu de guerre, enfin tel ministre israélien à fine cravate s’excusant auprès du peuple palestinien pour mieux charger l’ennemi commun du Hamas. Sans un commentaire « off », Stefano Savona est arrivé à cristalliser dans ce pamphlet poème non partisan, l’horreur d’un cercle vicieux. Il y fallait beaucoup de courage et le résultat, d’un haut niveau du point de vue de l’expression artistique, fera date.
 Tiburtino terzo, de Roberta Torre (Italie). Genre docu créatif.
Tiburtino terzo, de Roberta Torre (Italie). Genre docu créatif.
Dans le quartier pourri de la zone romaine du Tiburtino III, ceux que Pasolini appelait les Ragazzi di vita, survivent entre autoroutes et terrains vagues, blocs sinistres et bouges nocturnes, mauvais coups et prison. Glorieux aussi bien, tatoués des orteils aux oreilles, ils parlent en se marrant de leur vie plus ou moins fichues d’avance, dont ils aimeraient sortir sans avoir l’envie de se remuer pour y parvenir. La réalisatrice les met littéralement en scène. Son reportage est un poème éclaté, dense et violent, qui aboutit à un interrogatoire émouvant sur le souvenir de Pasolini. L’un des voyous, le plus affreux-méchant, en fait l’éloge au souvenir d’Accatone, avec une justesse éberluante.
 La notte quando è morto Pasolini, de Roberta Torre. (Italie). Genre docu créatif.
La notte quando è morto Pasolini, de Roberta Torre. (Italie). Genre docu créatif.
Tandis qu’un employé des archives criminelles romaine déballe les sacs de plastique remplis des derniers vêtements portés par Pier Paolo Pasolini la nuit où il fut massacré, un quinquagénaire à gueule carrée et grêlée, du nom de Pelosi, raconte ce qu’il a vécu et vécu en sa qualité de dernier partenaire nocturne du grand cinéaste. On sait aujourd’hui que le personnage n’a pu être seul impliqué dans le meurtre de Pasolini. Sa rétractation complète, après des années de prison, et les accusations qu’il porte aujourd’hui, longtemps après la mort des probables coupables, contre les vrais assassins qui le terrorisèrent avant de le livrer aux flics, reste entourée de mystère. Son témoignage n’est est pas moins troublant et même bouleversant quand il détaille la scène du lynchage de l’artiste maudit. Là encore, l’art de Roberta Torre sublime le seul document.
 Petit Indi, de Marc Recha (Espagne/France). Genre drame poétique. Sur la Piazza Grande.
Petit Indi, de Marc Recha (Espagne/France). Genre drame poétique. Sur la Piazza Grande.
Il y a de la pureté franciscaine dans ce nouveau film de Marc Recha, déjà rencontré à Locarno avec Dies d'agost, met en scène un jeune homme blessé par l’incarcération possiblement injuste de sa mère pour détention de drogue. Tout le film, dans un décor fascinant de la banlieue de Barcelone irrépressiblement urbanisée et polluée par les industries , joue sur la marche solitaire d’Arnau, dont la passion pour les oiseaux (son chardonneret Indi est un champion local de la roulade) va de pair avec la sollicitude qu’il voue à un renard blessé. Par delà la beauté des images et les bonnes intentions d’un conte opposant la pureté d’un jeune homme et la malice des hommes voleurs et pollueurs, le film n’échappe pas au maniérisme esthétique et, finalement, à un kitsch que Sean Penn était arrivé à dépasser dans son mémorable Into the Wild…
 La religieuse portugaise, d'Eugène Green. (Portugal/France). Compétition internationale. Première modiale.
La religieuse portugaise, d'Eugène Green. (Portugal/France). Compétition internationale. Première modiale.
Tout à coup: le miracle. L'Oeuvre attendue. Du grand cinéma, lesté d'une poésie inspirée de part en part. Dans la filiation de Robert Bresson ou d'Alain Cavalier, ce film absolument original, au demeurant, nous arrache immédiatement au temps ordinaire pr un artifice qui pourrait être insupportable d'affectation, imposant aux acteurs un débit de parole relevant d'une sorte de distanciation rituelle, non sans humour doucement hagard. Or ce parti pris s'inscrit le plus naturellement du monde dans la démarche du réalisateur, qui regarde et montre ses personnages comme des êtres absolument uniques, engagés dauns un conte existentiel mystérieux. Le canevas narratif repose sur le tournage, à Lisbonne, d'une variation sur Les Lettres portugaises, roman épistolaire du XVIIe évoquant la passion charnelle d'une religieuse et d'un noble militaire français. Une actrice française (Leonor Baldaque) mais lusophone, aux multiples passions malheureuses, débarque de Paris pour retrouver son metteur en sène (campé par Eugène Green lui-même) et l'acteur unique dont elle devient l'amante d'une nuit. Au fil d'autres rencontres àla fois imprévisible et comme écrites par la main du Destin (un aristocrate fils de salazariste qu'elle sauve du suicide, un enfant, un jeune homme d'une grande beauté) Julie approche de SA vérité en se confiant à une...religieuse portugaise passant toutes ses nuits avec Dieu. Rien pourtant d'un mysticisme conventionnel dans ce voyage déjanté au bout des apparences qui n'a dutre destination, à travers le lumineux labyrinthe de Lisbonne, que la vie, la présence de la vie et la présence àla vie, la révélation de la vie dans sa plénitude d'amours en toutes ses modulations. Merveilleusement pictural et musical, baignée par la mélancolie de la saudade à l'état pur, ce film étrange et doux, mais à la fois transparent et d'une totale fermeté plastique, est la première réelle révélation artistique, à mes yeux de cette édition 2009. Léopard d'or ?
 La Valle delle ombre, de Mihaly Györik. (Suisse/Italie/Hongrie). Genre folk fantastique. Première mondiale sur la Piazza Grande.
La Valle delle ombre, de Mihaly Györik. (Suisse/Italie/Hongrie). Genre folk fantastique. Première mondiale sur la Piazza Grande.
Foule des grands soirs, pour couronner la journée du cinéma suisse, ce mercredi 12 août, avec la projection d'un long métrage du réalisateur suisse d'origine hongroise (né en 1971 à Bâle), Myhaly Györik, qui reconstitue l'atmosphère des contes et légendes de nos régions alpines avec une mise en scène au souffle assez décoiffant, mais qui tend à s'empêtrer faute de clarté narrative. L'idée directrice consiste à révéler le monde archaïque des superstitions et des prodiges nés de la peur (la nature et ses monstres présumés) à un môme de la ville débarquant en ces hauts gazons forestiers coupés de gorges avec son i-pod et son grand-père (Jean-Pierre Balmer). Ledit Matteo est bientôt entraîné par une bande de sauvageons se racontant mutuellement les "menteries" des anciennes veillées, à commencer par celle du village sous les eaux. Si le fil de la narration s'entortille à l'excès, avant de s'embrouiller, notamment avecune digression pénible sur les tribulations d'une écrivaine chic s'installant dans un moulin hanté, l'ensemble de l'ouvrage en impose tout de même par la beauté de ses images autant que par sa façon de revisiter le folklore sans (trop) donner dans le cliché pour Américains et Japonais...
 Summer Wars, de Mamoru Osoda. (Japon). Genre manga. Compétition internationale
Summer Wars, de Mamoru Osoda. (Japon). Genre manga. Compétition internationale
Les connaisseurs du genre parlent d'ores et déjà de chef-oeuvre à propos de ce film d'animation d'une stupéfiante virtuosité formelle, et qui vaut aussi par sa réflexion implicite sur les relations entre mondes réel et virtuel, "vécue" par une famille singulière que domine une granny garante des valeurs ancestrales du Japon japonais... La morale tirée après le dernier souffle de la sourcilleuse nonagénaire pourrait se résumer à un message de respect mutuel et d'amour, mais longue et difficile est la voie pour y parvenir, semée d'embûches, de monstres, de duels propres à faire pâlir les antiques samouraïs, entre autres armes de destruction massive imaginées par la créature humaine et lui retombant du ciel. Le Prométhée de la Sphère Internet a imaginé, en l'occurrence, un nouveau Big Bazar universel, à l'enseigne du réseau Oz, dans lequel le jeune protagoniste Kenji, petit génie des maths, fiche la pagaille par inadvertance. Mais le même Kenji, poursuivi par la police "réelle" comme un vil hacker du virtuel, va participer à la grande réparation qui évitera à l'humanité réelle-virtuelle de subir la cata annocée. Tout cela pour déployer une suite d'épisodes d'une ébouriffante inventivité formelle, relevant à la fois de l'épopée et de la magie poétique frottée d'humour et d'affectivité. Présenté en création mondiale à Locarno, le film fera probablement un tabac mondial et sans doute un Léopard d'or aurait-il été mérité, qui eût rejailli sur le festival.
 To live and die in L.A., de William Friedkin. (USA) Piazza Grande.
To live and die in L.A., de William Friedkin. (USA) Piazza Grande.
Datant de 1985, ce polar noir jouant sur la quasi reversibilité des rôles de flics et de gangsters, a été présenté sur la Piazza par son auteur himself, qui a reçu le Léopard d'honneur de cette année pour son oeuvre. Disant douter un peu de la pérennté de celle-ci, par rapport aux grands maîtres du 7e art, Friedkin s'est montré d'autant plus reconnaissant envers le Festival qui le justifie ainsi au siècle des siècles. Or, même si le thriller qu'il a choisi, dans une nouvelle copie, n'atteint pas les sommets de forme et de contenu de ses homologues digés Scorsese ou Anthony Mann, c'est de la toute belle ouvrage que To live and die in L.A, qui démarre sur les chapeaux de roues, avec un enchaînement magnifiques de plans. L'interprétation du jeune William L. Petersen, bel agent risque-tout qui fera tout pour venger la mort de son vieux coéquipier, de John Pankow en nouvel adjoint et de William Dafoe en très méchant faux monnayeur, compte aussi beaucoup dans l'efficacité de ce film dont la course-poursuite de voitures relève également du morceau d'anthologie...
 Mon Coup de coeur
Mon Coup de coeur
Akadimia Platonos, de Filippos Tsitos. (Grèce/Allemagne). Genre comédie satirico-sociale. Compétition internationale.
Dans le quartier où se situait la fameuse Académie de Platon, un groupe de parfaits glandeurs quadras et quinquas, tous férus de vieux rock, se retrouvent tous les jours devant le kiosque de Stavros (formidable Antonis Kafetzopoulos) pour distiller leur venin contres les Albanais (fidèlement aboyés par le chien Patriote) tandis que les Chinois envahissent méthodiquement le quartier. Or voici que se pointe un jour un Albanais qui se dit le frère de Stavros, auquel sa mère a caché qu'elle parlait parfaitement l'albanais et avait fui en Grèce avec lui en son plus jeunes âge. Avec beaucoup de faconde et de subtilité, sans craindre pour autant le gros trait satirique (ce monument àl'interculturalité que le maire fait construire sous les fenêtres de Stavros), le film décortique les mécanismes de la xénophobie ordinaire comme il pourrait le faire dans n'importe laquelle de nos bonnes villes suisses. Galerie savoureuse de portraits de beaufs vitelloniens de plus en plus attachants, le film illustre une probématique qui éclate dans le cimetière où les deux frères (vrais ou faux, nul n'en a la preuve formelle) en viennent aux mains au-dessus du cercueil de leur mère. On pense à Stephen Frears ou Ken Loach pour l'esprit de ce tableau social drôle et tendre à la fois, sur fond de questionnement identitaire très intelligemment modulé. Bref, Akadimia Platonos aurait fait un Léopard d'or propre à réconcilier cinéphiles exigeants et grand public. Le jury de la Compétition internationale a gratifié Antonis Kafetzopoulos du prix d'interprétation masculine, et le le film a reçu le Prix du Jury oecuménique. À ne pas manquer à sa (probable) sortie !
 A propos d'Ikiru, chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa
A propos d'Ikiru, chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa Telle est la question physique et méta qui se pose au haut fonctionnaire Kenji Watanabe (Takashi Shimura), surnommé « la momie » par ses collègues, lorsque le médecin lui apprend que son cancer de l’estomac ne lui laisse plus guère que quelques mois à vivre.
Telle est la question physique et méta qui se pose au haut fonctionnaire Kenji Watanabe (Takashi Shimura), surnommé « la momie » par ses collègues, lorsque le médecin lui apprend que son cancer de l’estomac ne lui laisse plus guère que quelques mois à vivre. Après un retournement saisissant de la narration, le protagoniste mourant au beau milieu du film, c’est à sa veillée funèbre, passée à grand renfort de saké, qu’on apprend comment le défunt a bonnement ressuscité avant sa mort. Le récit de sa Bonne Action (la B.A. du scout érigée ici au pinacle de l’éthique existentielle, yes Madam) va se faire au fil de la soirée, par une série de témoignages illustrant toute la gamme des sentiments et des caractères humains. Cela commence par le déni des hommes de pouvoir en frac, qui s’attribuent le mérite de l’action de Watanabe, bientôt démentis (l’alcool déliant les langues) par ceux qui ont vraiment connu « la momie » et l’ont vu se transformer sur la fin. Que ferais-tu, mon frère, si demain tu apprenais que tu n’as plus que cent jours à vivre ? Et tous tant que nous sommes, que ferions-nous ?
Après un retournement saisissant de la narration, le protagoniste mourant au beau milieu du film, c’est à sa veillée funèbre, passée à grand renfort de saké, qu’on apprend comment le défunt a bonnement ressuscité avant sa mort. Le récit de sa Bonne Action (la B.A. du scout érigée ici au pinacle de l’éthique existentielle, yes Madam) va se faire au fil de la soirée, par une série de témoignages illustrant toute la gamme des sentiments et des caractères humains. Cela commence par le déni des hommes de pouvoir en frac, qui s’attribuent le mérite de l’action de Watanabe, bientôt démentis (l’alcool déliant les langues) par ceux qui ont vraiment connu « la momie » et l’ont vu se transformer sur la fin. Que ferais-tu, mon frère, si demain tu apprenais que tu n’as plus que cent jours à vivre ? Et tous tant que nous sommes, que ferions-nous ?




 Ce qui est également réjouissant, à relever après les « innovations » de Dogma, c’est que le film de Cassavetes soit si pur de toute idéologie et de tout dogmatisme. Dans les compléments, un passionnant entretien avec Michel Ciment confirme d’ailleurs ses priorités en matière d’observation et de jugement, et la philosophie qui la sous-tend. Il y a du Raymond Carver là-derrière, donc du Tchékhov. Ces auteurs-là ne démontrent pas tant qu’ils montrent. Voici le gâchis de nos vies pourries par des normes trop rigides, trop soumises au Système et à ses règles pseudo-morales ou pseudo-religieuses. À la fin d’Une femme sous influence, Mabel étant revenue de l’asile et des électrochocs, la mère de Nick comprend et semble admettre qu’elle est aussi dingue qu’avant et plus aimante encore et que rien n'y fera. De son côté, le pauvre père se voit rejeté par ses enfants jusqu’à comprendre qu’il ne les retrouvera pas sans passer par l’amour de Mabel - et de proposer alors tranquillement de « ranger ce bordel ». C’est cela même : ce film nous aide à « ranger le bordel ». Cinématographiquement cela se fait par des images simples, intimes et chaleureuse (même un chantier peut sembler intime et chaleureux), des plans alternant plages de tendresse et fureur criseuse en cadrages hyper-rapprochés, des hors- champs pour montrer ce qui se montre sans image, bref un film de purs sentiments-sensations qui fait autant mal au corps et à l’âme qu’il fait du bien au cœur…
Ce qui est également réjouissant, à relever après les « innovations » de Dogma, c’est que le film de Cassavetes soit si pur de toute idéologie et de tout dogmatisme. Dans les compléments, un passionnant entretien avec Michel Ciment confirme d’ailleurs ses priorités en matière d’observation et de jugement, et la philosophie qui la sous-tend. Il y a du Raymond Carver là-derrière, donc du Tchékhov. Ces auteurs-là ne démontrent pas tant qu’ils montrent. Voici le gâchis de nos vies pourries par des normes trop rigides, trop soumises au Système et à ses règles pseudo-morales ou pseudo-religieuses. À la fin d’Une femme sous influence, Mabel étant revenue de l’asile et des électrochocs, la mère de Nick comprend et semble admettre qu’elle est aussi dingue qu’avant et plus aimante encore et que rien n'y fera. De son côté, le pauvre père se voit rejeté par ses enfants jusqu’à comprendre qu’il ne les retrouvera pas sans passer par l’amour de Mabel - et de proposer alors tranquillement de « ranger ce bordel ». C’est cela même : ce film nous aide à « ranger le bordel ». Cinématographiquement cela se fait par des images simples, intimes et chaleureuse (même un chantier peut sembler intime et chaleureux), des plans alternant plages de tendresse et fureur criseuse en cadrages hyper-rapprochés, des hors- champs pour montrer ce qui se montre sans image, bref un film de purs sentiments-sensations qui fait autant mal au corps et à l’âme qu’il fait du bien au cœur…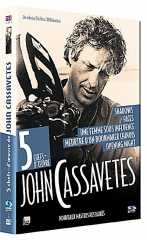 John Cassavetes.
John Cassavetes.










 - Et la fiction là-dedans ?
- Et la fiction là-dedans ? - Quel est l’origine du film sur Kafka ?
- Quel est l’origine du film sur Kafka ?



 Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...
Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...

 Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…
Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…




 Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.
Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.  C'est parti sur le ton doux-acide de
C'est parti sur le ton doux-acide de  l'équipe
l'équipe



 (Cette liste a été inspirée par L'Année des treize lunes de Rainer Werner Fassbinder, film-exorcisme d'une beauté convulsive et d'une insondable vérité émotionnelle sur fond de glaciation sociale, que Werner Schroeter a probablement raison de dire le plus personnel et le plus librement inspiré de son ami l'ange noir)
(Cette liste a été inspirée par L'Année des treize lunes de Rainer Werner Fassbinder, film-exorcisme d'une beauté convulsive et d'une insondable vérité émotionnelle sur fond de glaciation sociale, que Werner Schroeter a probablement raison de dire le plus personnel et le plus librement inspiré de son ami l'ange noir) 





 Un road movie helvète a révélé le nom de Michael Steiner en 2006. Qui signa ensuite le mémorable Grounding sur la capilotade de Swissair. Et qu'on va retrouver à Locarno avec Le Massacre des Miss...
Un road movie helvète a révélé le nom de Michael Steiner en 2006. Qui signa ensuite le mémorable Grounding sur la capilotade de Swissair. Et qu'on va retrouver à Locarno avec Le Massacre des Miss... Michael Steiner, conteur mainstream
Michael Steiner, conteur mainstream
 Alternant les propos lancinants de Kafka (auxquels la voix comme assourdie de Sami Frey convient idéalement), et les témoignages de ses proches, le film de Richard Dindo rend admirablement ce qu’on pourrait dire un climat affectif et spirituel, oscillant entre l’angoisse coupable (l’ombre du père terrible évoquée dans une longue citation de la lettre fameuse) et la possibilité de l’île Littérature, dans laquelle il va mener sa vraie vie. Incompris de ses parents, Kafka trouve en revanche, auprès de Max Brod, un premier lecteur conscient de son génie, et le jeune Gustav Janouch lui montrera une vénération qu’il s’efforcera vainement de décourager. Max Brod dit merveilleusement ce que lui inspire la prose de Kafka, comme l’écrira Milena au lendemain de sa mort, dans un hommage aussi lucide que poignant. Ce que rend également le film, notament avec le témoignage des trois amies de Kafka, c’est le rayonnement extraordinaire de sa personne, et la déchirure vécue par elles de le sentir si peu fait pour la vie, si l’on excepte l’embellie finale auprès de Dora Diamant.
Alternant les propos lancinants de Kafka (auxquels la voix comme assourdie de Sami Frey convient idéalement), et les témoignages de ses proches, le film de Richard Dindo rend admirablement ce qu’on pourrait dire un climat affectif et spirituel, oscillant entre l’angoisse coupable (l’ombre du père terrible évoquée dans une longue citation de la lettre fameuse) et la possibilité de l’île Littérature, dans laquelle il va mener sa vraie vie. Incompris de ses parents, Kafka trouve en revanche, auprès de Max Brod, un premier lecteur conscient de son génie, et le jeune Gustav Janouch lui montrera une vénération qu’il s’efforcera vainement de décourager. Max Brod dit merveilleusement ce que lui inspire la prose de Kafka, comme l’écrira Milena au lendemain de sa mort, dans un hommage aussi lucide que poignant. Ce que rend également le film, notament avec le témoignage des trois amies de Kafka, c’est le rayonnement extraordinaire de sa personne, et la déchirure vécue par elles de le sentir si peu fait pour la vie, si l’on excepte l’embellie finale auprès de Dora Diamant. Epuré, mais riche de détails significatifs (la séquence d’un film d’époque, telle image du ghetto dont Kafka dit qu’il se contenterait de baiser les pieds des habitants, ou tels portraits du père et de la mère, la déclaration finale de Max Brod sur son refus d’obtempérer à l’ordre de brûler les manuscrits inédits, ou enfin le témoignage non moins émouvant de Max Pulver), l’ouvrage du maître documentaliste est à la fois celui d’un connaisseur intime de Kafka et d'un imagier inspiré, qui a su filtrer la douleur et la douceur de Kafka mais aussi sa prodigieuse aptitude à transmuter le plomb du quotidien en or poétique, sans se départir de ce que Max Brod appelle son « sourire métaphysique »…
Epuré, mais riche de détails significatifs (la séquence d’un film d’époque, telle image du ghetto dont Kafka dit qu’il se contenterait de baiser les pieds des habitants, ou tels portraits du père et de la mère, la déclaration finale de Max Brod sur son refus d’obtempérer à l’ordre de brûler les manuscrits inédits, ou enfin le témoignage non moins émouvant de Max Pulver), l’ouvrage du maître documentaliste est à la fois celui d’un connaisseur intime de Kafka et d'un imagier inspiré, qui a su filtrer la douleur et la douceur de Kafka mais aussi sa prodigieuse aptitude à transmuter le plomb du quotidien en or poétique, sans se départir de ce que Max Brod appelle son « sourire métaphysique »…

 Unter Bauern – Retter in der Nacht, de Ludi Boeken . (Allemagne) Genre drame historique. Première mondiale. Sur la Piazza.
Unter Bauern – Retter in der Nacht, de Ludi Boeken . (Allemagne) Genre drame historique. Première mondiale. Sur la Piazza. Pom Poko, de Isao Takahata. Genre manga. Hommage. Sur la Piazza.
Pom Poko, de Isao Takahata. Genre manga. Hommage. Sur la Piazza. Teheran without Permission, de Sepideh Farsi. (France/Iran). Genre docu créatif. Première mondiale. Section Ici et aileurs.
Teheran without Permission, de Sepideh Farsi. (France/Iran). Genre docu créatif. Première mondiale. Section Ici et aileurs. Shirley Adams, d'Oliver Hermanus et (scénario) Stravros Pamballis. (Afrique du Sud et USA). Genre drame humain. Compétition internationele.
Shirley Adams, d'Oliver Hermanus et (scénario) Stravros Pamballis. (Afrique du Sud et USA). Genre drame humain. Compétition internationele. My sister’s Keeper, de Nick Cassavetes. (USA). Genre comédie humaine. Sur la Piazza.
My sister’s Keeper, de Nick Cassavetes. (USA). Genre comédie humaine. Sur la Piazza. La Guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, d’Amos Gitaï. (France). Genre théâtre capté. Sur la Piazza.
La Guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, d’Amos Gitaï. (France). Genre théâtre capté. Sur la Piazza. Les yeux de Simone, de Jean-Louis Porchet. (Suisse). Genre court. Sur la Piazza.
Les yeux de Simone, de Jean-Louis Porchet. (Suisse). Genre court. Sur la Piazza. Giulias Verschwinden, de Christoph Schaub. (Suisse). Genre comédie chorale. Sur la Piazza.
Giulias Verschwinden, de Christoph Schaub. (Suisse). Genre comédie chorale. Sur la Piazza. Complices, de Frédéric Mermoud. (Suisse/France). Genre polar social. Compétition internationale.
Complices, de Frédéric Mermoud. (Suisse/France). Genre polar social. Compétition internationale. Les derniers jours du monde, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. (France/Espagne /Taiwan). Genre drame cata-ludique. Sur la Piazza Grande.
Les derniers jours du monde, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. (France/Espagne /Taiwan). Genre drame cata-ludique. Sur la Piazza Grande. La Paura, de Pippo Delbono. (Italie/France). Genre docu créatif. Hors compétition.
La Paura, de Pippo Delbono. (Italie/France). Genre docu créatif. Hors compétition. L’insurgée, de Laurent Perreau (France). Genre drame poétique. Compétition internationale. Première mondiale.
L’insurgée, de Laurent Perreau (France). Genre drame poétique. Compétition internationale. Première mondiale. Ivul, d’Andrew Kötting. Genre drame poétique. Concours Cinéastes du présent.
Ivul, d’Andrew Kötting. Genre drame poétique. Concours Cinéastes du présent. The Marsdreamers, de Richard Dindo (Suisse). Genre docu créatif. Concours Cinéastes du présent.
The Marsdreamers, de Richard Dindo (Suisse). Genre docu créatif. Concours Cinéastes du présent. Piombo fuso, de Stefano Savona (Italie). Genre docu créatif.
Piombo fuso, de Stefano Savona (Italie). Genre docu créatif. Tiburtino terzo, de Roberta Torre (Italie). Genre docu créatif.
Tiburtino terzo, de Roberta Torre (Italie). Genre docu créatif. La notte quando è morto Pasolini, de Roberta Torre. (Italie). Genre docu créatif.
La notte quando è morto Pasolini, de Roberta Torre. (Italie). Genre docu créatif. Petit Indi, de Marc Recha (Espagne/France). Genre drame poétique. Sur la Piazza Grande.
Petit Indi, de Marc Recha (Espagne/France). Genre drame poétique. Sur la Piazza Grande. La religieuse portugaise, d'Eugène Green. (Portugal/France). Compétition internationale. Première modiale.
La religieuse portugaise, d'Eugène Green. (Portugal/France). Compétition internationale. Première modiale. La Valle delle ombre, de Mihaly Györik. (Suisse/Italie/Hongrie). Genre folk fantastique. Première mondiale sur la Piazza Grande.
La Valle delle ombre, de Mihaly Györik. (Suisse/Italie/Hongrie). Genre folk fantastique. Première mondiale sur la Piazza Grande. Summer Wars, de Mamoru Osoda. (Japon). Genre manga. Compétition internationale
Summer Wars, de Mamoru Osoda. (Japon). Genre manga. Compétition internationale To live and die in L.A., de William Friedkin. (USA) Piazza Grande.
To live and die in L.A., de William Friedkin. (USA) Piazza Grande. Mon Coup de coeur
Mon Coup de coeur

 Le gros et le maigre de Roman Polanski, 1961, 15'
Le gros et le maigre de Roman Polanski, 1961, 15' de Mysterious skin, de KenPark et de Tarnation
de Mysterious skin, de KenPark et de Tarnation Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Tarnation de Jonathan Caouette et de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subis vers leur dixième année de la part, respectivement, de leurs tuteurs et de leur entraîneur de foot.
Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Tarnation de Jonathan Caouette et de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subis vers leur dixième année de la part, respectivement, de leurs tuteurs et de leur entraîneur de foot.


 Le lendemain, émerveillé par les lieux, la magie de la projection nocturne et l’accueil chaleureux des festivaliers, Samuel Benchetrit évoquait les tenants de cet hommage au cinéma et noir et blanc prisé, avant lui, par son père l’ouvrier: «On est actuellement saturé de couleur et de montages précipités, et beaucoup s’imaginent que le noir et blanc relève de la vieillerie chiante, mais ce n’est pas vrai, et je l’ai d’ailleurs expérimenté avec mon fils en lui montrant une quantité de films qui l’ont captivé. Par ailleurs, ma propre mémoire cinématographique est en noir et blanc, du cinéma italien au cinéma japonais des années 60, entre autres».
Le lendemain, émerveillé par les lieux, la magie de la projection nocturne et l’accueil chaleureux des festivaliers, Samuel Benchetrit évoquait les tenants de cet hommage au cinéma et noir et blanc prisé, avant lui, par son père l’ouvrier: «On est actuellement saturé de couleur et de montages précipités, et beaucoup s’imaginent que le noir et blanc relève de la vieillerie chiante, mais ce n’est pas vrai, et je l’ai d’ailleurs expérimenté avec mon fils en lui montrant une quantité de films qui l’ont captivé. Par ailleurs, ma propre mémoire cinématographique est en noir et blanc, du cinéma italien au cinéma japonais des années 60, entre autres». Film à sketches, J’ai toujours rêvé d’être un gangster s’ancre en un lieu fixe évoquant le «nulle part» idéal d’une série B policière: une espèce de cafétéria en zone périphérique où vont se succéder les quatre histoires, avant qu’ont ne découvre, avec des clones des mémorables tontons flingueurs, ce que fut ce lieu à leur bon vieux temps de truands à tractions avant.
Film à sketches, J’ai toujours rêvé d’être un gangster s’ancre en un lieu fixe évoquant le «nulle part» idéal d’une série B policière: une espèce de cafétéria en zone périphérique où vont se succéder les quatre histoires, avant qu’ont ne découvre, avec des clones des mémorables tontons flingueurs, ce que fut ce lieu à leur bon vieux temps de truands à tractions avant.


 - Y a-t-il, entre vos romans et vos films, un fil conducteur ?
- Y a-t-il, entre vos romans et vos films, un fil conducteur ?






 On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému.
On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému.