
En lisant Lignes de faille de Nancy Huston
I. Sol, 2004
On revient du côté de la vie, captée dans toutes ses nuances avec une empathie constante, en se plongeant dans le nouveau roman de Nancy Huston, intitulé Lignes de faille et constituant, par le truchement de quatre voix (Sol l’enfant « prodige », Randall son père, Sadie la mère de celui-ci et Kristina la mère de celle-ci), une remontée du cours du temps, de 2004 à 1944, lancée par le soliloque d’un enfant d’aujourd’hui, né coiffé de parents qu’il estime aussi formidables qu’il l’est-lui-même, avec la bénédiction du Très-Haut et du président Bush Bis.
Solomon, qu’on appelle Sol, ou Solly quand on le chérit et le pourrit autant que Tess sa mère, est à six ans le fils préféré de Dieu et de Google, qui sait déjà tout (par exemple comment les chiens enculent les femmes sur internet, ou que son arrière-grand-mère est lesbienne) et pourtant il reste un petit garçon à beaucoup d’égards, notamment quand il est question du grain de beauté à la tempe qui inquiète tant sa mère que celle-ci a programmé une opération. Cette Tess est intéressante, qui incarne la mère américaine « concernée » par excellence, passant d’un cours sur les relations parents-enfants à un séminaire sur l’estime de soi, entre méditation et réprimandes à son conjoint Randall, dont les jurons et les complaisances (il ne condamne pas immédiatement le scandale d’Abou Ghraïb, qui à elle lui fait si mal) ne sauraient « passer », qu’elle s’affaire à contrer d’une voix toute douce.
Cela se passe en Californie, la boîte du père est engagée dans l’effort de guerre en Irak par ses recherches sur les robots guerriers, ce qui super-excite son fils en mal d’héroïsme, mais on sent bientôt le centre de gravité du roman se déplacer avec l’apparition de deux personnages aussi imposants que dérangeants pour le trio « waspy », à savoir la mère Sadie, débarquée d’Israël au lendemain de la petite opération du gosse, qui n’a pas l’air d’être curative soit dit en passant, infligeant chaque matin au garçon ses deux heures de lecture de l’Ancien Testament au dam de la mère protestant de son protetantisme. La mère de la mère de la mère de Solly n’est pas moins gratinée, qui vit à New York avec une amie après le suicide de son conjoint, et dont on sait qu’elle a passé par « les camps » ou un truc comme ça.
On retrouve, dès les 129 pages du soliloque de Sol, la porosité totale de Nancy Huston, et son mélange de sarcasme et de compassion, de vivacité et de mélancolie, à la hauteur «chorale » de Dolce agonia.
II. Randall, 1982.
C’est une étrange émotion qu’on éprouve en découvrant, avec ce qu’on sait déjà du père de Sol, ce Randall à la fois sympathique et un peu flottant, en butte au moralisme bigot de sa jeune femme, quel enfant il fut lui-même, puisque la suite du roman le fait parler à son tour, en sa sixième année, petit garçon un peu bousculé par les incessantes querelles opposant son père, dramaturge new yorkais plutôt bohême, juif mais indifférent à la religion, et la redoutable Sadie, sa femme convertie au judaïsme et, comme souvent les convertis, poussant le zèle à outrance.
Plus exactement, il y a de l’hystérie en Sadie, qui devient pour ainsi dire une spécialiste du Mal, donnant des conférences sur la Shoah et poussant ses nouvelles recherches du côté des « fontaines de vie » des nazis, ces élevages d’enfants volés en Ukraine, en Pologne et dans les pays baltes, pour être casés dans des familles allemandes et drillés selon les meilleurs principes aryens. Son intérêt n’est d’ailleurs pas fortuit, puisqu’elle découvre que sa mère, la chanteuse Erra que son fils et son conjoint adorent, a précisément connu ce sort avant d’être déportée.
Sous le regard du petit Randall, qui devient ici comme un frère ou un double enfantin du petit Sol, le lecteur assiste ainsi à un début de guerre entre une goy sioniste par raccroc, qui se met à hurler dès qu’on n’est pas d’accord avec elle, et un brave type surtout soucieux de bon temps en compagnie de son fiston. Les recherches de Sadie la poussant à emmener sa famille en Israël, le trio se retrouve à Haïfa où le chemin de l’écolier Randall va croiser celui d’une fille un peu plus âgée, prénommée Nouzha, qui lui apprendra l’histoire de son point de vue de Palestinienne alors même que la haine se déchaîne entre leurs communautés, pour culminer avec le massacre de Sabra et Chatila.
Autant dire que cette lecture, aujourd’hui, prend un relief tout particulier, et pourtant cet aspect, évidemment important, n’est pas essentiel dans le roman, qui me rappelle soudain le grand roman des origines d’Amos Oz, Une histoire d’amour et de ténèbres, et tous ces livres nous confrontant à nos sources mêlées.
On est ainsi parti, avec le premier soliloque du « winner » américain, de l’Empire arrogant de Bush, et nous voici remonter à l’époque du Sharon chef de guerre, en attendant que Sadie, fille d’une créature du nazisme, poursuive le récit. Or le roman de Nancy Huston nous touche d’abord par les voix qui s’y expriment, du côté du plus intime de l’individu.
III. Sadie, 1962.
Le lecture de Lignes de faille évoque le sentiment qu’on peut éprouver en découvrant la photographie d’une personne que nous connaissons lorsqu’elle était enfant. Après avoir rencontré Sadie grand-mère et impotente, en 2004, au fil du premier monologue de Sol, et l’avoir retrouvée dans le personnage hyperactif de la mère de Randall, c’est ainsi en petite fille, âgée de 6 ans comme les deux premiers narrateurs, que nous la voyons réapparaître en 1962 à Toronto, entre une grand-mère autoritaire et conventionnelle, une prof de piano tyrannique et un père-grand psychiatre et prodigue de mauvaises plaisanteries. Mal aimée, complexée, triste d’être le plus souvent séparée de sa mère artiste (le père Mortimer, du genre beatnik, a disparu peu après sa naissance), Sadie entretient une espèce d’horreur d’elle-même que stimule un personnage imaginaire qu’elle surnomme l’Ennemi. Folle de joie lorsque sa mère, qui l’a casée chez ses parents faute de moyens, la reprend chez elle, Sadie séduit aussitôt Peter, l’ami-imprésario de sa mère, qui lui trouve une maturité rare et fera un bon père de substitution quand, la carrière de Kristina décollant, le trio se retrouve ensemble à New York. C’est alors, cependant, qu’après divers indices qui l’ont intriguée, Sadie va entrevoir une part secrète de la vie de sa mère, lorsque débarque un étranger blond et roulant les r et qui demande à voir Erra. D’un récit à l’autre, le puzzle se reconstitue ainsi, dont les parties, à fines touches diachroniques, évoquent autant d’époques et de drames, modulés à chaque fois par une voix d’enfant.
Kristina 1944-1945
L’autobiographie à paraître de Günter Grass s’intitule En pelant les oignons, et c’est au même dévoilement progressif et douloureux que fait penser Lignes de faille de Nancy Huston, dont le dernier chapitre se passe précisément en 1944 (alors que Grass avait juste 17 ans) dans l’ Allemagne de la défaite en proie à la terreur et au chaos.
On connaît déjà l’extravagante Erra, qu’on a vu au diverses étapes de sa vie d’artiste et de femme libre, et qu’on retrouve ici sous le nom de Kristina qui lui a été donné lorsque, à une année, volée en Ukraine par les nazis, elle a été confiée à une famille allemande qu’elle croit la sienne. Il y a là le brave grand-père qui la choie et semble la préférer à sa sœur Greta, plus conventionnelle et jalouse, sa mère qui l’aime fort elle aussi, un frère Lothar aux armées et le père, instituteur, également sous l’uniforme.
D’emblée, le récit de Kristina tourbillonne, immédiatement marqué par son tempérament sensible et généreux d’artiste-néée. L’évocation de la vie plus ou moins insouciante qui va son cours dans cette famille d’Allemands ordinaires, tandis que le ciel rougeoie des proches villes incendiées par les bombardements des Alliés, est marquée par un crescendo dramatique que ponctueront la mort du frère et, dans un accès de colère, la révélation faite à Kristina par sa sœur qu’elle n’est pas un enfant de la famille mais qu’elle a été adoptés. Peu après, un garçon de dix ans, d’abord muet et impénétrable, sera recueilli à son tour dans la famille, qui révélera bientôt à Kristina sa vraie destinée d’enfant volé.
Ainsi s’achève ce roman des origines qui, de l’Amérique des « gagneurs » ne doutant de rien, en remontant les générations et en multipliant les points de vue, déploie une frise de portraits en mouvements d’une vibrante humanité, dont l’insertion dans l’histoire multiplie les résonances et les observations, notamment à propos des enfants « germanisés » de force. L’idée de donner la parole, successivement, à quatre enfants de six ans, pourrait sembler une « contrainte » artificielle, voire « téléphonée », mais il n’en est rien, au contraire : ce parti pris donne à la fois sa forme et son ton à cet ample et beau livre plein du souffle, de la rage et des interrogations, de la compassion, de l’humour et de l’intelligence sensible de Nancy Huston.
Nancy Huston. Lignes de faille. Actes Sud, 484p.
En librairie le 24 août.
Photo: Horst Tappe
 Cormac McCarthy, le film des frères Coen et la critique parisienne. Note de Juan Asensio
Cormac McCarthy, le film des frères Coen et la critique parisienne. Note de Juan Asensio 



 Nobel de littérature
Nobel de littérature

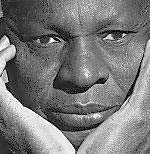
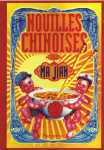





 Rencontre de Boualem Sansal
Rencontre de Boualem Sansal




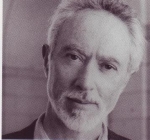
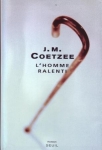







 che, dans la contrition manifestée, et nous nous retrouvons au cabaret du juif Jankiel. Nous prendrons un parti ou l’autre dans les litiges du tribunal local, en présence de l’huissier aux pieds nus. Nous nous rendrons à la foire haute en couleurs, au bourg voisin, puis nous connaîtrons la « double mélancolie des chagrins passés et des soucis d’avenir », dans la tristesse fantomatique des lourdes journées pluvieuses. Puis ce sera jour de noces, avec ses réjouissances que ne tarderont à étouffer les neiges d’hiver. Alors nous suivrons les travaux éreintants des bûcherons. Et viendra Noël, pacifiant jusqu’aux plus terribles conflits.
che, dans la contrition manifestée, et nous nous retrouvons au cabaret du juif Jankiel. Nous prendrons un parti ou l’autre dans les litiges du tribunal local, en présence de l’huissier aux pieds nus. Nous nous rendrons à la foire haute en couleurs, au bourg voisin, puis nous connaîtrons la « double mélancolie des chagrins passés et des soucis d’avenir », dans la tristesse fantomatique des lourdes journées pluvieuses. Puis ce sera jour de noces, avec ses réjouissances que ne tarderont à étouffer les neiges d’hiver. Alors nous suivrons les travaux éreintants des bûcherons. Et viendra Noël, pacifiant jusqu’aux plus terribles conflits.


