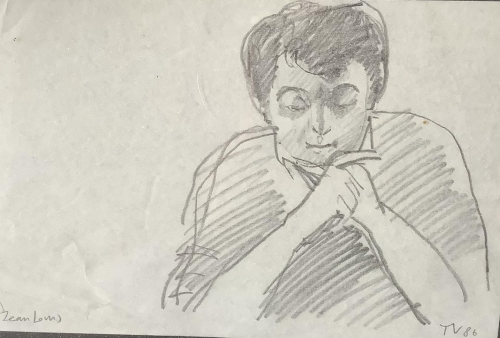Carnets de JLK
-
Au bord du Cher
-
La beauté sur la terre
Carnets de Thierry Vernet
Thierry Vernet s’est éteint au soir du 1er octobre 1993, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer. Genevois d’origine, le peintre avait vécu à Belleville depuis 1958 avec Floristella Stephani, son épouse, artiste peintre elle aussi. Thierry Vernet avait été le compagnon de route de Nicolas Bouvier durant le long périple que celui-ci évoque dans L’Usage du monde, précisément illustré par Vernet.
A part son œuvre peint, considérable, Thierry Vernet a laissé des carnets, tenus entre sa trente-troisième année et les derniers jours de sa vie, qui constituent une somme de notations souvent pénétrantes sur l’art et la vie.
« La beauté est ce qui abolit le temps »
« Je ne sais pas qui je suis, mais mes tableaux, eux, le savent ».
« Mille distractions nous sollicitent. La radio, le bruit, le cinéma, les journaux Autrefois on devait être face à face avec son démon, on devait patiemment élucider son mystère. Maintenant, vite, entre deux distractions, on doit tout dire, avec brio de chic, faire son œuvre en coup de vent. A moins… à moins de résister aux distractions ».
« L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser ».
« D’heureux malgré le doute, arriver à être heureux à cause du doute ».
« Faire la planche sur le fleuve du Temps ».
« C’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie ».
« Aux gens normaux le miracle est interdit ».
« Il suffit de voir qui réussit, et auprès de qui, pour être rassuré et encouragé ».
« Nous vivons, en ce temps, sous la théocratie de l’argent ; et malgré soi on sacrifie de façon permanente à ce culte hideux ».
« D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».
« Nous qui avons une patte restée coincée dans le tiroir de l’adolescence, nous en garderons toujours, sous nos rides, quelque chose ».
« D’abord la sensation est souveraine, ensuite le tableau est souverain. Entre ces deux souveraientés, il y a la révolution ».
« Dieu est éternel, le diable est sempiternel ». « En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».
« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».
« Quand son corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme ».
« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées ».
« Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites ; Dieu que le monde est beau ! »
« Monsieur Pomarède, mon voisin retraité de la rue des Cascades, me voyant porter un châssis, me dit : « Vous faites de la peinture, c’est bien, ça occupe ! »
« Une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».
« Je me bats, et il est normal qu’à la guerre on prenne des coups ».
« Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».
« Si l’on tue en soi-même l’espérance du Paradis, on n’hérite que de l’Enfer. C’est, me semble-t-il, le choix de notre civilisation ».
« La foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose ».
« Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant ».
« La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement ».
« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer » !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais.
Le 4 septembre 1993, et ce fut sa dernière inscription, Thierry Vernet notait enfin ceci : « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».À lire aussi: Correspondance des routes croisées, de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet (1946-1964), fabuleux "roman" dialogué d'une amitié.
-
Abécédaire romand





Adolphe – On pourrait dire de ce joyau de la littérature d’analyse, d’inspiration protestante et romantique à la fois, qu’il est celui de l’hésitation. Jeune homme de vingt-deux ans, Adolphe s’ennuie dans une petite ville allemande où il rencontre la Polonaise Ellénore, vivant avec un Comte. Adolphe étant devenu son amant, Ellénore se sépare du Comte, mais Adolphe à son tour voudrait se séparer d’Ellénore, sans s’y résoudre. Incertitudes et tourments entretenus tissent un filet où se débat le protagoniste. Benjamin Constant. Adolphe. Livre de poche G/F.
Alectone – Ce récit poétique aux accents nervaliens constitue l’un des joyaux de l’œuvre à la fois brève et cristalline de Crisinel, dont Pierre-Paul Clément rappelle en préface la destinée tragique et le caractère essentiel des écrits, relevant de la catharsis. A l’ensemble des poèmes et des proses lyriques rassemblés en ce volume s’ajoutent quelques variantes, des proses descriptives de ton plus serein, voire léger, ainsi qu’un extrait du Journal de la Métairie. « Je pense à Crisinel avec déchirement », écrivait Edmond Jaloux, « comme à l’un de ceux qui ont le plus souffert de chercher et de connaître le sens allégorique de la vie ». Edmond-Henri Crisinel. Œuvres. L’Age d’Homme. Poche suisse No 8. Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.
Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.
L’Amour fantôme – La propension satirique de l’auteur fait florès en ces pages évoquant l’itinéraire initiatique d’un Colin oedipien à outrance dont les tribulations recoupent les expériences « sur soi » de toute une génération. D’un premier séjour en prison (il a fait le fou dans une manif) d’où le tire Maman, à l’amoureuse initiation qui marque sa rencontre avec Rose, fille-fleur se roulant nue dans le sainfoin, avant d’autres étapes de sa réalisation personnelle, de rebirth en séminaire de chanelling, le personnage est joliment épinglé. Jean-Michel Olivier. L’Amour fantôme. L’Age d’Homme, 1999. Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.
Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.
Aujourd’hui je ne vais pas à l’école - L’adjectif est galvaudé, mais c’est bel et bien un livre subversif que ce monologue d’un jeune énergumène en bisbille avec les convictions établies et les idées reçues. Il y a du cabarettiste en ce jongleur de mots et de concepts, décidé à rester sur sa scène privée au lieu de reprendre la comédie de l’Ecole (avant celle de l’Eglise et de l’Etat). A l’école « contre la vie » dont parlait Edmond Gilliard, s’oppose ici la classe buissonnière d’un émule de Roorda. C’est frais et vif, sans une ride vingt ans après... Claude Frochaux. Aujourd’hui je ne vais pas à l’école. L’Age d’Homme, 1986.
Les beaux sentiments – Le suicide d’un de ses élèves et l’abus sexuel subi par un autre marquent l’année du bac de la classe de gymnase du professeur François Aubort, double romanesque de l’auteur qui parvient, en évitant les pièges du témoignage direct ou de l’ouvrage « à thèmes », a construire un roman d’émotion portant à la réflexion sans être désincarné. De fait, tous les personnages en sont vibrants de présence, la force du romancier tenant à restituer la fragilité et le désarroi de jeunes gens – le professeur autant que ses élèves - dont il ressaisit aussi la fraîcheur et la générosité. Jacques-Etienne Bovard, Les beaux sentiments. Campiche, 1998.
Cahier de verdure – La partie la plus accessible de l’œuvre de Philippe Jaccottet, et la plus attachante aussi, relève d’une sorte de carnet poétique continu, d’une semaison à l’autre, dont ce recueil, accordé au cycle des saisons, est une belle illustration. L’apparition en gloire d’un grand cerisier en marque l’ouverture symbolique par-delà laquelle on s’engage Sur les degrés montants de la nature saisie dans son effervescence et sa violence vitale, avant les Eclats d’août et les feux de l’automne préludant à la descente vers les plaines de l’hiver et de l’âge. Philippe Jaccottet. Cahier de verdure. Gallimard, 1990.Les chagrins magnifiques – Plus grave de tonalité qu’Une chambre pleine d’oiseaux, premier recueil des chroniques de l’auteur, cet ensemble de proses reprend les thèmes récurrents du malaise existentiel et de la difficulté de communiquer dans le couple et dans la société, avec un regard plus personnel et nostalgique sur les « légères hypothèses d’enfance », et des inflexions mélancoliques accentuant et poétisant à la fois un sentiment de déréliction quasi omniprésent. Du moins les bonheurs d’écriture, et le ton si particulier du chroniqueur-écrivain valent-ils à ce livre sa vertu paradoxalement tonique. Christophe Gallaz. Les chagrins magnifiques. Zoé Poche, 2005 (1986).
Chambre 112 – Le titre de ce récit autobiographique désigne la chambre de l’hôpital tessinois dans lequel le père de l’auteur a vécu ses derniers jours et qui devient le pivot des allées et venues du narrateur entre la Suisse romande où il accomplit sa carrière d’universitaire distingué et le Tessin plus rugueux de son enfance et de sa langue maternelle, de ses premières racines culturelles et de son Padre padrone en train de passer de l’état de chêne familial à celui de roseau fragile, bientôt arraché par le vent de la destinée. Très juste de ton, et d’une empathie généreuse à l’égard de la petite communauté évoquée, cet hommage au père est à la fois la mise en rapport de deux cultures et de deux époques traversées par l’auteur. Daniel Maggetti. Chambre 112. L’Aire, 1997.
Châteaux en enfance – Premier volet du triptyque romanesque englobant Les esprits de la terre et Le temps des anges, ce roman doux-acide marque aussi l’amorce d’une forme narrative novatrice, instaurant une modulation proustienne de la remémoration. Au gré d’un récit non linéaire, soumis aux associations libres de l’évocation, c’est tout un théâtre de bourgeoisie provinciale qui émerge des brumes du passé, dont les figures goyesques contrastent avec quelques personnages « élus » par la romancière à proportion de leur sensibilité, de leur vulnérabilité ou de leur appartenance à un « ailleurs » poétique. Catherine Colomb. Œuvres complètes. L’Age d’Homme, 1993. Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.
Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.
Les circonstances de la vie. – Après les deux premiers romans terriens de Ramuz, celui-ci s’attache à un personnage qui va vivre, à son corps défendant, la mutation de toute une société soudain entraînée dans les mécanismes de l’expansion et de la spéculation, où les affairistes et les arrivistes feront florès. Après un premier mariage malheureux, le notaire Emile Magnenat s’installe en ville afin de satisfaire les ambitions pressantes de la fringante Frieda, qui le pousse à toutes les dépenses avant de le tromper et de l’anéantir. D’une tonalité flaubertienne, ce sombre et poignant roman est tout empreint de la défiance du jeune Ramuz à l’encontre de la ville et d’une société déshumanisée. C.F. Ramuz. Les circonstances de la vie L’Age d’Homme, Poche Suisse No 134.
Comme si je n’avais pas traversé l’été. – C’est là, sans doute, le roman le plus accompli de l’auteur. Il y est question de la peine et de la révolte d’Alia, confrontée en très peu de temps à la mort de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer. Livre de la déchirure intime et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l'enfant pour qu'il vive et lui survive, ce roman est aussi, à l'inverse, un livre de l'alliance des vivants entre eux et du dialogue perpétué avec ceux qui leur ont été enlevés. Janine Massard. Comme si je n’avais pas traversé l’été. L’Aire, 1998.La complainte de l’idiot – On se régale à la lecture de ce livre ludique et foisonnant autant pour l'originalité de sa vision - apparemment dégagée de tout réalisme et renvoyant cependant à notre monde avec une verve critique réjouissante - que pour l'éclat et les chatoiements de son écriture, jamais aussi libre et inventive. Rappelant la douce dinguerie hyperlucide d'un Robert Walser, et d'abord parce qu'il se passe dans un « débarras à enfants » assez semblable au fameux Institut Benjamenta, ce roman évoque également la figure tutélaire de Cendrars par ses dérives épiques, le goût du conte qui s'y déploie et sa faconde verbale. Michel Layaz. La joyeuse complainte de l’idiot. Zoé, 2003.
 Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.
Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.
Le désir de Dieu – D’emblée l’auteur se dit « plein de Dieu » dans ce livre reprenant en fugues et variations les thèmes fondamentaux de son œuvre, à savoir : l’étonnement primordial d’être au monde et la découverte de la poésie, l’intuition précoce de la mort et son expérience tragique au suicide du père, le vertige du sexe et ses turbulences contradictoires, la fascination pour le vide qui serait à la fois une plénitude à la manière extrême-orientale, le miel du monde et ses infinies modulations, le rêve du monumentum artistique cher à Flaubert et la conscience de sa vanité sous le ciel métaphysique. Or il y a, dans ce livre de pure prose, une liberté et une qualité de style qui en font l’un des meilleurs ouvrages de son auteur. Jacques Chessex. Le désir de Dieu. Grasset, 2005.
Le dessert indien – La tonalité qui marque les treize nouvelles de ce recueil, mélange d’épicurisme souriant et de désenchantement indulgent, de flegme frotté de cynisme et de bonhomie frottée d’expérience, relève de la culture anglo-saxonne plus que de la tradition romande, du côté de Somerset Maugham. De la nouvelle policière à la gourmandise érotique, en passant par la rêverie méditative d’Un instant d’éternité, évoquant Barbey d’Aurevilly, le récit fantastique ou la satire, l’auteur excelle à tout coup, en dépassant pourtant l’exercice de style par un vrai bonheur d’écriture et de narration. Marc Lacaze. Le dessert indien. Seuil, 1996.
Le dixième ciel – Comment concilier foi et raison, vérité révélée et connaissance scientifique ? Telle est l’un des questions posées par ce vaste roman au formidable générique, puisque Pic de la Mirandole, le protagoniste, y fréquente Laurent de Médicis ou Marsile Ficin, dans la Florence brillantissime du Quattrocento où apparaissent également le jeune Michel-Ange, Sandro Botticelli ou Savonarole, notamment. Plus que le pittoresque du roman historique, somptueux au demeurant, c’est l’enjeu du débat d’avenir qui nous captive ici, incarné par de beaux personnages. Etienne Barilier. Le Dixième ciel. Julliard/L’Age d’Homme, 1986.
Le droit de mal écrire. – Dans sa fameuse Lettre à Bernard Grasset, Ramuz a magistralement traité le problème des relations liant la Suisse romande à Paris et, plus précisément, les langues périphériques de la francophonie au « bon français ». D’un Rousseau, qui revendiquait la spécificité culturelle et morale du parler romand, tout en s’exprimant en français classique, à un Töpffer émaillant volontiers son écriture de localismes à coloration helvétistes, et jusqu’aux auteurs d’aujourd’hui, le rapport entre la littérature romande et la France reste ambigu, rarement simple. Jérôme Meizoz. Le droit de « mal écrire », Quand les auteurs romands déjouent le « français de Paris ». Zoé, 1998.
Eloge du migrant. – Quelque peu rugueux au premier abord, ce premier livre d’un fils d’immigré en impose bientôt par la justesse de son ton et l’originalité de son écriture, incorporant ici et là des tournures italianisantes qui tiennent lieu d’accent au protagoniste, saisonnier italien se racontant sans trémolos. « Murateur » de métier, il se dit « de rue et d’errance solidaire », non tant « de revendication » que « de fidélité », avec un double sentiment d’être exclu et de participer à la fraternité des matinaux. Il y de l’héritage de Pavese dans cette belle méditation poétique. Adrien Pasquali. Eloge du migrant. L’Aire, 1989.L’enfant secret - Les destinées croisées des aïeux de l’auteur, de la Côte vaudoise à l’Italie de Mussolini, et l’Histoire dramatique du siècle, se vivifient dans cette autofiction constituant sans doute l’un des plus beaux livres de l’auteur. Les personnages d’Emilie et Julien, qui vivent sur les bords du Léman, et le couple formé par Nora et Antonio, assistant (et participant, puisque Antonio est le photographe attitré du Duce) à la montée du fascisme en Italie, constituent le cercle familial multiculturel dans lequel va grandir l’enfant, dont la mémoire restituera ce microcosme si caractéristique de notre pays. Jean-Michel Olivier. L’enfant secret. L’Age d’Homme, 2003.
L’enfant triste. – On retrouve, une génération plus tard, la douloureuse grisaille des Circonstance de la vie, sur fond d’aigre puritanisme, dans ce récit d’une enfance marquée à la fois par le désamour des parents du protagoniste, et par les avanies subies au Collège, où le goût manifesté par le garçon pour un Baudelaire, notamment, est assimilé à un dévoiement. Du moins une tante bonne, à la montagne, va-t-elle donner une autre image de la vie, plus ouverte et généreuse, au narrateur de ce livre d’autant plus marquant qu’il s’en tient aux faits, sans pathos. Michel Campiche. L’enfant triste. L’Aire, 1980.L’été des Sept-Dormants. – Relevant à la fois de l’exorcisme autobiographique, du roman symphonique et du testament spirituel, ce livre allie, étrangement, les fantasmes obsessionnels et presque maniaque, dans leur expression, d’un esthète amoureux des éphèbes, et la ressaisie magistrale, poétique et religieuse la fois, de quelques destinées réunies dans le creuset existentiel et affectif d’un institut de jeunes gens tenu par une maîtresse femme, Maria Laach, et son pittoresque époux. Roman de l’apprentissage à l’ample mouvement de fleuve, ce livre majestueux laisse en mémoire un double souvenir de fraîcheur juvénile et de lancinante mélancolie. Jacques Mercanton. L’Eté des Sept-Dormants, Galland 1974. Réédition en Poche Suisse, Nos 9 et 10.
Ce qui reste de Katharina. – De la misère morale en famille bourgeoise pourrait être le sous-titre de ce roman courant à travers trois générations et constituant un aperçu mordant de l’évolution des mœurs au XXe siècle. Au lendemain de la mort de son fils quinquagénaire, Katharina se repasse le film de sa vie et en établit le bilan, marqué par maints sacrifices sur l’autel de la vie conjugale et de la maternité. Rien pourtant du réquisitoire féministe unilatéral dans ce récit d’une vie gâchée où la complexité humaine est abordée avec empathie. Janine Massard. Ce qui reste de Katharina. L’Aire, 1997.
L’essaim d’or. – Amateur de bonnes choses, à tous les sens de l’expression, l’auteur, ancien bibliothécaire municipal en chef, et fomentateur à ce titre d’une phénoménale collection de bandes dessinées, est également un prosateur gourmand capable de faire partager ses goûts, comme celui du flan caramel, dit ici « mets de fête ». Excellant dans l’évocation ludique ou cocasse (son éloge de la vache ou sa célébration de la poussière de bouquins), cet arpenteur des sentiers écartés de la littérature ajoute, de surcroît, une touche d’humour à notre littérature si souvent si grave… Pierre-Yves Lador. L’essaim d’or. L’Aire, 1998.
Le désarroi – Issu d’une génération héritière de la faillite des idéologies, le protagoniste rompt avec sa vie confinée d’étudiant en lettres à la suite des mises en garde d’un de ses profs vitupérant la standardisation et la déshumanisation de la société. « Confronté à une existence que je ne savais plus comment empoigner, je me sentais usé » remarque-t-il à l’instant où il arrive, après un long voyage, dans un monastère qu’on suppose au Mont Athos, où il chemine sur les traces d’un certain Alexandre, mi-héros mi-ascète en lequel il espère trouver un modèle existentiel. René Zahnd. Le désarroi. L’Aire, 1990. La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.
La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.
La gazelle tartare. – Dernière en date de ses autofictions, ce livre d’Asa Lanova est aussi le plus vibrant d’émotion et le mieux enraciné dans le sol natal de la romancière lausannoise, le plus accompli aussi du point de vue littéraire. Un premier amour, dont la fin prématurée coïncide avec le renoncement à une prometteuse carrière de ballerine, et la mort de la mère de la protagoniste, constituent les deux pôles sensibles de cette remémoration où l’enfance et ses magies, une angoisse maladive et le recours à l’exorcisme des mots, se conjuguent pour rendre le « son » unique d’une vie ressaisie par l’écriture. Asa Lanova. La gazelle tartare. Campiche, 2004. Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.
Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.
L’Homme seul. – Soliloque effréné non moins que stimulant, ce livre a les qualités et les limites de la recherche autodidacte, à la fois passionnant par ses observations et discutable dans ses conclusions, à commencer par celle qui conclut à l’extinction de la culture occidentale dans les années 1960… Matérialiste anarchisant, l’auteur réduit l’histoire de la culture à une suite de déterminations où le rôle de la géographie se trouve revalorisé par rapport à l’analyse historico-économique des marxistes. Sans aucune référence indiquée, mais brassant d’innombrables lectures, cette somme hyper-subjective et péremptoire est marquée par un souffle et un ton uniques. Claude Frochaux. L’Homme seul. L’Age d’Homme. Poche Suisse No 194-195.
Humour. – Tenant à la fois du journal de bord personnel et de l’essai biographique, ce livre est l’une des plus belles illustrations de la pratique singulière de l’auteur, consistant à imbriquer des dessins et des aquarelles dans le corps de son texte. En l’occurrence, celui-ci place la (re)découverte de Joyce, dont la vie se trouve racontée au fil d’un journal imaginaire, sous le signe de la passion juvénile de Pajak et de son ami Yves Tenret, protagonistes d’une histoire se donnant comme en miroir, en résonance à la biographie du génial Irlandais. Frédéric Pajak (avec Yves Tenret) Humour. Une biographie de James Joyce. PUF, 2001. L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.
L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.
Jean-Luc persécuté. – Deuxième roman du jeune Ramuz, cette tragédie montagnarde donne un grand frère farouche à la petite Aline en la personne de Jean-Luc Robille, incessamment humilié par une épouse sensuelle et mauvaise, Christine de son prénom. Type de l’homme simple et droit, le protagoniste découvre les traces de l’adultère dès la fameuse scène première, préludant à tous ses malheurs et à ceux de l’enfant du couple. Le roman, portrait aussi d’un village de montagne, évoque une pyrogravure expressionniste, où la noblesse de cœur de Jean-Luc et la vilenie de ceux qui l’entourent forment un contraste significatif. C.F. Ramuz. Jean-Luc persécuté. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 25.
Je dis tue à tous ceux que j’aime – Après avoir abordé les genres les plus divers, de la science fiction au roman historique, l’auteur lausannois touche ici au symbolisme fantastique autant qu’à l’érotisme homosexuel, dans un roman évoquant les nouvelles de Kafka ou la littérature latino-américaine. Le protagoniste, représentant banal de son état, échoue dans une ville paraissant soudain coupée du temps et du monde ordinaire, où la rencontre d’un jeune homme vaguement angélique, en dépit de conduites sordides, achève de le déstabiliser. Surtout intéressant par son atmosphère, ce roman est d’un conteur avéré. Olivier Sillig. Je dis tue à tous ceux que j’aime. H&O, 2005.
Jette ton pain. – « Je ne suis qu’une vieille orpheline à la recherche de trésors perdus », écrivait Alice Rivaz dans Comptez vos jours, et l’aveu pourrait être aussi celui de Christine Grave, à cela près que cette quinquagénaire est encore en charge de sa mère impotente, qui ne manque de lui rappeler combien elle s’est elle-même « sacrifiée ». Bilan d’une existence de femme souvent « empêchée » dans ses aspirations personnelles, ce roman proche de l’autofiction est à la fois marqué par l’effort d’émancipation et le pari créateur sur lequel s’ouvre sa dernière partie. Alice Rivaz, Jette ton pain, Gallimard/Galland, 1979.
Jonas – Roman de l’alcool et des bilans de la cinquantaine, cette autofiction – l’une des plus fortes de l’auteur – évoque le retour, à Fribourg où il a passé le début de sa jeunesse, de Jonas Carex en quête d’un refuge momentané dans le ventre de la baleine aux souvenirs. De fait, c’est en ces lieux qu’il a vécu le plus intensément, à l’âge des grandes questions et d’un amour qu’il va retrouver avec un mélange de tendresse et de désarroi, qui le confrontera plus durement encore à son naufrage personnel. Jacques Chessex. Jonas. Grasset, 1987.Journal intime – Parangon du genre, ce monument de l’introspection ne se borne pas, loin s’en faut, à la rumination stérile d’un professeur esseulé et velléitaire, mais constitue la chronique extrêmement variée d’une fin de siècle genevoise, vue par un écrivain aussi ouvert à la culture européenne qu’à la nature, à la philosophie et aux nouvelles doctrines sociales, au milieu littéraire local ou parisien. Lecteur et promeneur infatigable, Amiel est surtout un prosateur d’une merveilleuse porosité, du moins quand il échappe au ressassement quotidien et à l’autoflagellation. Ses paysages, ses portraits (notamment de femmes) et ses réflexions de toutes espèces constituent un inépuisable trésor. Henri-Frédéric Amiel. Journal intime, L’Age d’Homme, 12 volumes.
Kriegspiel – A la tête d’une escouade de dragons à l’ancienne, le capitaine Pavel Takac donne l’assaut à une formation de tanks, dont il ressortira seul vivant, témoignant du sacrifice des hommes tombés à ce qu’on pouvait dire encore le champ d’honneur, et faisant revivre l’événement avec panache, mais non sans mélancolie. Le ton et la manière, autant que la vigueur de ce roman sont assez rares en Suisse romande, et c’est en effet un captivant roman d’aventures que cet ouvrage à valeur, aussi, de réflexion sur la guerre et sur le sacrifice des héros, chair à canon de la Realpolitik. Jacques-Michel Pittier. Kriegspiel ou le jeu de la guerre. L’Age d’Homme, 1982,
Les larmes de ma mère - Récit mimétique d'une libération, Les Larmes de ma Mère représente, malgré quelques relents de lyrisme adolescent, un travail de fiction qui dégage ce livre de ce qu'il pourrait avoir d'anecdotique ou de nombriliste. La démarche de Michel Layaz se fonde sur une implication vivante, vécue par le truchement d’une langue qui restitue, dans leurs nuances, tous les désarrois, les humiliations, les infimes mais cuisante blessures, comme aussi les effusions, les petits bonheurs, les premiers troubles sensuels, les échappées dans le sillage d'un magicien ou d'une femme bien en chair, les premiers refus aussi et les premières prises de conscience personnelles. Michel Layaz. Les Larmes de ma mère, Editions Zoé, 2002
Laura – Deuxième roman de l’auteur lausannois, ce livre étincelant concentre les thèmes à venir de l’œuvre, partagée entre une interrogation sur le sens de l’art dans le monde contemporain et la modulation des passions humaines. Dans le décor hautement symbolique de Venise, le protagoniste, jeune artiste peintre cheminant aux frontières du nihilisme métaphysique, aime et fait souffrir Laura que résument les « gestes de la vie ». Limpide et dense, ce roman a conservé sa vibration tendue et sa beauté. Etienne Barilier. Laura. L’Age d’Homme, Poche suisse No 82.
La Malvivante. - Dans son chalet en banlieue du Clos, Tosca remâche sa révolte en observant les gens du quartier au moyen de ses jumelles. Malheureuse en ses premières amours, cette fille d’immigré italien et de Vaudoise terre à terre, mariée à un ouvrier résigné à son sort, est en outre rejetée par ses enfants. Au bord de la rupture psychique et du suicide, Tosca n’en témoigne pas moins d’une vive lucidité sur le monde médiocre qui l‘entoure, où les « petites gens » montrent parfois le plus de grandeur inaperçue. Mireille Kuttel, La Malvivante. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 37.
Le marcheur illimité. – Intéressant par l’allant de son écriture et l’observation des « premiers plans » que lui ménage la marche, Ellenberger le farouche n’a rien du sémillant randonneur à la manière de Töpffer, ni non plus du « performeur » à celle de Daniel de Roulet : il marche à en crever à ce qu’il semble et, de fait, cela devient un récit plein de vie que cette suite d’évocations de longues trottes le long du Doubs ou du Rhône, en Crète ou dans les rues de Paris, lézardant quelque temps au Luxembourg puis se remettant en route du Quartier latin à Saint Germain-en-Laye… Pierre-Laurent Ellenberger. Le marcheur illimité. L’Aire, 1999.Le miel du lac. – En chroniqueur pratiquant un type d’observation et une langue imagée à la Vialatte, son maître avéré, l’auteur évoque, dans cette manière de d’autoportrait étoilé, son passé de gosse levantin aux souvenirs d’enfance à la fois pittoresques et parfois douloureux. Rompant avec le tout-venant du journalisme, il enlumine, avec un mélange de candeur blessée et d’humour souvent cocasse, les heures riches de ses flâneries et de ses rencontres, dans ce pays de Vaud qui est devenu sa terre d’adoption. Gilbert Salem. Le miel du lac. Campiche, 1998.
Mille-feuilles. – En trois volumes très élégants et illustrés avec beaucoup de goût, ce recueil de proses et d’articles, plus encore que les romans autobiographiques de l’auteur, constitue le « trésor » de l’auteur délicieux d’Italiques (L’Age d’Homme, 1969), capable de parler de la peinture de James Ensor ou d’une visite à Gustave Roud, de Picasso en Avignon ou de « Fribourg-la-romaine », du Paradou des Bille ou de la mort de Léautaud avec la même fine justesse et avec le même bonheur. Comme dans Le soleil sur Aubrac (Grasset, 1986), le grappilleur déploie, en ces pages étincelantes, une constante faculté de transmutation. Georges Borgeaud. Milles Feuilles I, II, III. La Bibliothèque des Arts, 1997.
Mon bon ami – L’auteur de ce savoureux recueil de proses, dont le texte intitulé Merveilles indique bien l’orientation et la tournure, se nourrit de tout, circulant de par le monde comme l’enfant au tricycle ou son grand frère en aile delta. De l’oiseau witcha (une sorte de merle blanc) elle dit : « Le merle avait un regard de comptable, de notaire, d’inspecteur, de soliste ». Avec la même alacrité joyeuse et le même bonheur d’expression évoquant tour à tour Vialatte et Cingria, elle parle indifféremment de Lawrence Durrell et de Marco Polo, de sa peur du noir et d’un mazot sur la montagne, des Rolling Stones copulant dans leur jet rivé ou d’une humble vieille dame corse, sans oublier l’âme soeur qui donne son nom au titre du livre… Corinne Desarzens. Mon bon ami. L’Aire, 122p.
Monument à F.B. – Sur le ton apparemment détaché du dandy, ce récit de pure émotion, dont les mouvements de la narration reproduisent les tâtons, hésitations et autres retours amont, digressions ou subites illuminations, tient à la fois de la remémoration sentimentale et de l’exorcisme. Il y est question de la liaison d’un homme marqué par « la saloperie d’usure de la vie quotidienne », auprès duquel F.B., malmenée en ses jeunes années, cherche refuge, pour le faire souffrir à son tour. Du moins cette femme-enfant laisse-t-elle une trace indélébile de « pureté inaliénable ». Roger-Jean Ségalat. Monument à F.B. Hachette-Littérature, 1978.Mortelle maladie - D’une voix encore fragile, mais chaleureuse, nouée par la souffrance, l’auteur exprime à la fois sa révolte contre le mal qui la ronge et contre la société des hommes, où la femme est parfois encore une esclave. La première partie du livre est attente de l’enfant, d’abord intrus, puis vie désirée, jusqu’au jour de l’accident qui laisse la mère de nouveau seule dans le monde des survivants, contrainte de s’inventer de nouvelles raisons de vivre. Mère frustrée, la narratrice devient femme-écrivain tentant d’assumer le sort de ses semblables, en racontant notamment le calvaire d’Annunziata, la mère italienne, pour donner à son propre drame une résonance plus universelle. Anne Cuneo. Mortelle maladie. En Campoche, 2005.
Nains de jardin. – La verve satirique qui se déploie dans ce recueil de nouvelles, dont le succès populaire n’a pas faibli depuis sa parution, s’applique à toute une Suisse moyenne déjà brocardée par un Hugo Loetscher, un Emil ou une Zouc. L’homme aux nains de jardin vit dans une petite maison à soi ou en villa mitoyenne, au milieu d’un univers propre-en-ordre et censé le rester, qu’un rien suffit pourtant à troubler, suscitant alors une vraie fièvre sécuritaire. Multipliant les scènes significatives, l’auteur brosse un portrait-charge de groupe non dénué de malice amicale. Jacques-Etienne Bovard. Nains de jardin. Campoche, 2004.
Ni les ailes ni le bec – Mélange d’humour mordant et de tendresse latente, ce premier recueil de l’auteur constitue, en dix-huit nouvelles, un patchwork attachant et vif, à l’image de la jeunesse qu’il décrit et dont il procède aussi bien. Des rêves de la femme de ménage espagnole compulsant son roman-photo, dans Conchita, à l’évocation de jeunes gens incapables d’apprécier tout ce qui leur est donné, dans Vous les enfants des hautes Villes, le nouvelliste restitue de brèves tranches de vie à valeur parfois significative. François Conod. Ni les ailes ni le bec. Campiche, 1987.
Le pain de coucou. – Plus encore qu’un kaléidoscope de souvenirs d’enfance puisant à la double source de l’univers alémanique du Grossvater et du quartier lausannois des jeunes années de l’auteur, ce livre restitue les premiers émerveillements de celui-ci à la découverte conjointe des choses et des mots. Dans un climat mêlé de tendresse et d’humour, les séquences de cette remémoration évoquent le monde d’une modeste tribu familiale assez typique de la Suisse des années 50, avec ses figures et ses emblèmes dont le relief s’accentue par le double jeu de la distance temporelle et du verbe poétique. Jean-Louis Kuffer. Le pain de coucou. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 44.
Passion. – La beauté et la hideur cohabitent dans ce roman glacial et brûlant à la fois, où s’opposent aussi bien deux univers, de la stérilité et de la création, de l’amour-passion et de la vie par procuration d’un maniaque solitaire. Pierre X., « homme sans passion », le type du quidam sans qualités, vit comme greffé au jeune couple que forment la danseuse Maria F. et le pianiste Frédéric Z., qu’il épie avec des moyens de plus en plus sophistiqués et dont il consigne l’évolution de la relation dans son journal, lequel constitue le roman lui-même, l’un des plus saisissants de l’auteur lausannois. Etienne Barilier. Passion. L’Age d’Homme, Poche suisse No 7.
Les passions partagées. – Sur la base de carnets tenus quotidiennement et de notes fixant chaque nouvelle découverte, l’auteur recompose une chronique kaléidoscopique à valeur de « lecture du monde » où alternent aussi rencontres, voyages et autres expériences personnelles formatrices. Vingt ans (1973-1992) de vie littéraire en Suisse romande, des balades en Toscane ou en Andalousie, la découverte des Etats-Unis et du Japon, l’amitié et l’amour, la naissance d’un enfant et l’arrachement aux êtres aimés constituent la trame de l’ouvrage. Jean-Louis Kuffer. Les Passions partagées. Campiche 2005.
Le pays de Carole. – Peu de romans romands témoignent, mieux que ceux de cet auteur, de l’état et de l’évolution des mentalités et des moeurs dans notre pays, ici dans la rupture de continuité de la séculaire vie paysanne et dans le vacillement généralisé des relations de couples, notamment entre la trentième et la quarantième années. La crise vécue ici par Paul, homme au foyer qui se découvre une passion pour la photographie, et Carole que suroccupe sa carrière de médecin, aboutit à une nouvelle forme de liberté qui accentue par contraste, les médiocres accommodements où trop de vies s’enlisent. Avec autant de lucidité que d’empathie, Bovard campe des personnages vivants et attachants. Jacques-Etienne Bovard. Le pays de Carole. Campiche, 2002.
Prendre d’aimer – Fuyant la disette qui sévit en Valais, Séverine cherche ailleurs de quoi vivre, des bains de Loèche à Lausanne et Fribourg en passant par Villeneuve, découvrant le pays en ces années 1820, et multipliant les rencontres également significatives pour le lecteur. La fresque d’époque, nourrie par une documentation précise, est rehaussée par une écriture également marquée par le souci de reconstitution, mais sans artifice pour autant, savoureuse et sympathique autant que le portrait de la protagoniste. Gisèle Ansorge. Prendre d’aimer. Campiche, 1988.Un prince perdu. – Tenant à la fois du conte épique et du roman en prise directe avec les tribulations du monde contemporain, ce roman évoque fortement les destinées de l’Afghanistan, que l’auteur connaît bien pour y avoir été délégué du CICR, sans que le pays ne soit jamais nommé. Le jeune Jahan, unique rescapé du massacre de la famille royale du Karaba, entreprend le récit de sa vie à l’initiative de son ami portugais Jorge, afin de laisser témoignage et d’affirmer une identité remise en cause. A la fois tendre et amer, pétri d’humanité et impressionnant par ses évocations de la nature et du chaos de la guerre civile, ce livre est de ceux qui marquent. Jean-François Sonnay. Un prince perdu. Campiche, 1999.
Rapport aux bêtes. – Dès les premières pages de ce roman se révèle un talent singulier, tant par le choix singulier des mots que par les rythmes, la couleur, le modelé, la pâte du langage. Si la voix de la romancière manifeste aussitôt une indéniable originalité, cela ne va pas sans sophistication de style tournant, parfois, au maniérisme. Le fait est d’autant plus gênant que le livre est censé représenter l’existence d’un paysan de montagne et ses rapports avec sa jeune femme Vulve, son valet de ferme portugais et ses vaches. Noëlle Revaz. Rapport aux bêtes. Gallimard, 2002.
Le rendez-vous de Thessalonique. – Ce premier livre de l’auteur fixe d’emblée un espace romanesque et développe, au fil d’une écriture précise, concrète et rapide le récit des désarrois d’un quadragénaire, architecte de son état, dont la disparition soudaine de son meilleur ami exacerbe sa propre remise en question. Voyage vers soi-même recoupant l’errance des damnés de la terre, ce périple surtout existentiel ressaisit les rejets et autres tâtons d’une génération en perte de repères, dans un roman qui a valeur à la fois de symptôme et de fondation personnelle. Nicolas Verdan Le rendez-vous de Thessalonique. Campiche, 2005.
Le roseau pensotant – L’humour palliant la bêtise, l’esprit grégaire et pédant ou le conformisme du bourgeois encaqué dans ses préjugés, est la marque du ton et du style de Roorda, pédagogue et chroniqueur dont les titres de quelques œuvres sont assez explicites, à commencer par Le débourrage de crâne est-il possible ? ou Le pédagogue n’aime pas les enfants… Plus que tel ou tel essai séparé, c’est l’ensemble des Œuvres de Roorda, réunies en deux volumes, qu’il faut recommander à l’amateur de vues originales et roboratives, marquées du sceau d’un sens commun authentiquement démocrate et vivifiant. Henri Roorda. Œuvres, 2 vol. L’Age d’Homme, 1970.
Les sept vies de Louise Croisier née Moraz. – Mémorialiste patiemment documentée de ses familles paternelle et maternelle, Suzanne Deriex s’attache ici à la peinture d’une tribu vigneronne à Lavaux, dès la fin du XIXe siècle et sur une durée avoisinant le siècle, où s’entremêlent les tribulations personnelles de la protagoniste, Louise Moraz devenue Croisier, les multiples petites histoires de famille et les grands événements des époques successives. Portrait d’une femme et des siens, l’ouvrage fait également figure de chronique document la vie et les mentalités en mutation d’une région. Suzanne Deriex. Les sept vies de Louise Croisier née Moraz. L’aire, 1986. Poche Suisse, Nos 105-106.Le sourire de Mickey – Il y a quelque chose de panique dans le regard que l’auteur promène sur nos semblables plus ou moins empêtrés dans les embrouilles de la société contemporaine, où les modèles du battant et de la superwoman font figure de référence. Les personnages décrits dans ces nouvelles peinent à telle identification, à moins de s’aliéner comme ce couple pour lequel la naissance d’un enfant fait figure de péripétie « non appropriée ». Observateur redoutable des tics de comporteent ou de langage, dans la parenté d’un Michel Houellebecq, Antonin Moeri excelle à ressaisir, sous forme narraative, les névroses et les psychoses de l’homme actuel, sans trop le caricaturer. Antonin Moeri, Le Sourire de Mickey. Campiche, 2003.
La Suisse romande au cap du XXe siècle. – Le gai savoir a trouvé, en Alfred Berchtold, son plus généreux représentant helvétique, dont cette somme (avant une fresque consacrée à la civilisation bâloise et un livre exhaustif sur Guillaume Tell) est la première, éclatante illustration. Des sources protestantes, essentielles dans ce pays, à l’émergence de l’helvétisme, marqué par les courants romantiques européens, et jusqu’au tournant fondateur des Cahiers vaudois, l’historien se fait tour é tour conteur et critique littéraire pénétrant. Jamais sec ou pédant, ce livre aux synthèses magistrales et aux inoubliables portraits n’a pas pris une ride ! Alfred Berchtold. La Suisse romande au cap du XXe siècle. Payot, 1964.
Les Têtes – Ce pourrait n’être qu’une galerie de portraits littéraires, alors que l’art du prosateur à son extrême pointe, et la matière physique et psychique brassée font de cette suite de figures une admirable danse des vifs. D’un Henry Miller juste entrevu dans un café parisien, avec son museau de loup, au souvenir recomposé de Charles-Albert Cingria se relevant d’une chute en vélocipède, le front tatoué de bitume, l’auteur s’éloigne le plus souvent de la chose vue ou de l’anecdote contenue pour restituer chaque personnalité en vérité plus qu’en légende, sans se priver pour autant de l’invention révélatrice. Aux magnifiques évocations d’écrivains encore vivants (François Nourissier ou Maurice Chappaz) font pendant nombre de portraits posthumes. Or c’est aussi bien sous le signe de Yorick que l’écrivain se place, en quête de la « tête » essentielle de chacun. Jacques Chessex. Les têtes. Grasset, 2003.
Tout-y-va – Les derniers mots de ce petit ouvrage, tenant à la fois du journal (entre 1960 et 1962) et des mémoires, témoignent du regret de l’écrivain de n’avoir pu établir ses œuvres complètes, et c’est une mélancolie semblable qui imprègne cette suite très révélatrice de souvenirs (notamment sur la période des Cahiers vaudois) et de propos sur la vie et ses aléas. Alors que les écrits polémiques de Gilliard, tel L’école contre la vie, donnent l’impression d’une grande solidité, ce livre reflète plutôt la sensibilité complexe de l’homme se rappelant son enfance et ses multiples expériences. Edmond Gilliard. Tout-y-va. Trois collines, 1963.
Trois hommes dans une Talbot – On se rappelle la nonchalante navigation de Jerome K. Jerome en suivant Monsieur Paul et ses compères (Ramuz et le peintre Bischoff) à travers la France profonde, dont l’écrivain évoque les charmes avec autant de bonheur qu’il en a mis à croquer les multiples aspects de la Suisse. Cette pérégrination débonnaire se prolonge, aujourd’hui, grâce à la publication des Œuvres de Budry en trois forts volumes, à travers une foison de textes injustement oubliés et qui valent à la fois par leur contenu et la haute qualité de leur écriture. Paysages et artistes, littérature et motifs historiques ou contemporains, contes et chansons : tout fait miel à l’essayiste à la fois gourmand et raffiné, ondoyant et pénétrant, au poète et au prosateur. Paul Budry. Œuvres, 3 vol. Cahiers de la renaissance vaudoise, 2000.
La Venoge – Ce poème, illustrissime en nos régions, évoquant une douce et indécise rivière toute semblable à la mentalité vaudoise moyenne, ne saurait confiner son auteur dans la vaudoiserie complaisante à quoi d’aucuns réduisent son œuvre de chansonnier. L’ensemble de ses écrits permet en effet de (re)découvrir un conteur délicieux, toujours attentif à l’humanité bonne et au génie des lieux (son Paris est aussi présent que son pays de Vaud), un poète populaire aux merveilleux tableautins, mais également un critique virulent et un chroniqueur non moins vif de la vie contemporaine. Jean-Villard Gilles. Œuvres.
Le visage de l’homme – Au tournant de la quarantaine, l’auteur excelle dans le genre de la digression en mêlant notations très personnelles, voire privées, et considérations sur la culture ou sur le monde comme il va. Qu’il parle de la cervelle au beurre noir du Café Romand, du piano de Chopin que les cosaques jetèrent par la fenêtre (à propos de l’enterrement de Brejnev), d’un raid en avion sur le musée de Bale ou d’un malheureux croisé dans un café, bref de ce qui le remplit de joie, l’inquiète ou le révolte, le chroniqueur fait montre de la même maîtrise ressortissant à l’équilibre intérieur. Jil Silberstein. Le visage de l’homme. Le Temps qu’il fait, 1988. Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.
Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.(Cet abécédaire constitue la partie conclusive du livre intitulé Impressions d'un lecteur à Lausanne, paru en 2007 aux éditions Bernard Campiche)
-
L'Ouvroir
(Trésor de JLK, II)«Il y a encore quand même beaucoup de bonté et de bonheur dans les coins».(Marcel Jouhandeau)°°°«La prose doit être un vers qui ne va pas à la ligne».«Il a un large nez au milieu du visage. C’est comme un coup de pied qu’on lui aurait donné, et dont il lui serait resté le pied».«Une phrase solide, comme construite avec des lettres d’enseigne en plomb découpé».(Jules Renard, Journal)°°°«Écris comme si tu étais en train de mourir. En même temps, dis-toi que tu écris pour un public uniquement composé de malades au stade terminal. Après tout, c’est le cas. Que commencerai-tu à écrire si tu savais que tu allais mourir bientôt ? Que pourrais-tu dire à un mourant pour ne pas le faire enrager par ta trivialité ? ».(Annie Dilllard)°°°« Ceux qui voient la moindre différence entre l’âme et le corps ne possèdent ni l’un ni l’autre ».(Oscar Wilde)°°°« Le pédalo est un trône à pédales, qui distingue l’homme du XXe siècle des Romains de l’Antiquité. Le pédalo permet au penseur de réaliser son double rêve : de ressembler à Louis XIV en même temps qu’à Louison Bobet ».(Alexandre Vialatte)°°°« Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».(Ludwig Wittgenstein)°°°« On dit des choses solides lorsqu’on ne cherche pas à en dire d’extraordinaires ».(Lautréamont)°°°« Là-haut » est une petite chambre sous le toit. Ce n’est qu’un matelas de quatre-vingts centimètres de large sous un Velux. Et ce n’est qu’un vieux corps nu qui, chaque jour, au milieu de la nuit, se glisse sous le drap, se glisse sous le ciel, se glisse sous la lune, se glisse sous les nuages qui passent, se glisse sous l’averse qui crépite. Si un jour je ne me rends pas là-haut, si un jour je ne me retranche pas des autres hommes, des malaises surviennent et l’envie de mourir remplace l’envie de fuir. Si je ne vais ne serait-ce qu’une seule heure là-haut, dans mon lit de silence, ne voyant que l’immense profondeur céleste par l’espèce de chien assis qui offre sa lumière à la page, mes maux se dissolvent, la paix gagne, l’âme s’ouvre, je ne souffre plus de rien, je m’oublie, l’intérieur de la tête non seulement se dégrise mais s’effrite, mon âme devient transparente, translucide, sinon lucide, sinon devineresse.Siècles, familles, enfants, nations se dissolvent là-haut. Page du ciel toujours lisible entre les tuiles et les rebords de zinc ».(Pascal Quignard)°°°« Tâchons de voir un peu clair en Dieu ».(Jules Renard, Journal)°°°« Grand-mère et petits-enfants : pas la plus profonde, mais la plus belle, la plus humaine des relations sur terre ».(Peter Sloterdijk)°°°« L’éducation est une chose admirable. Mais il est bon de se souvenir de temps à autre que rien de ce qui mérite d’être su ne peut s’enseigner ».(Oscar Wilde)°°°« Pensé une fois de plus, hier soir, au lit, que la bonté est peut-être la plus haute forme de poésie ».« Cette vieille paysanne disant à sa fille, au moment de mourir : «Sois tranquille, on se téléphonera ».(Georges Haldas)°°°« Je ne souffle mot Je regarde par la fenêtre Venise. Venise. Reflets insolites dans l'eau de la lagune. Micassures et reflets glissants dans les vitrines et sur le parquet en mosaïque de la Bibliothèque Saint-Marc. Le soleil est comme une perle baroque dans la brume plombagine qui se lève derrière les façades des palais du front de l'eau et annonce du mauvais temps au large, crachin, pluies, vents et tempête. Je ne souffle mot».(Blaise Cendrars, Bourlinguer)Aquarelle JK: Solitude. -
Ceux qui sont partout chez eux
 Celui qui se sent partout étranger y compris dans son lit quand il est seul / Celle qui vous dit faites comme chez vous sans se douter que ça risque de craindre / Ceux qui pigent l'accent de partout où ils jactent /Celui qui a appris à se concentrer sur ce qu'il apprend / Celle qui lit quelque part que "la rue dit la vérité" / Ceux qui pensent que la rue "dit la rue" / Celui qui se laisse volontiers dérouter par les indications erronnées comme ce matin-là à Tôkyo tu t'es fais envoyer à Okinawa alors que tu demandais ton chemin pour Ginza / Celui qui passe sa journeé de retraité coréen à ramener à la maison des enfants perdus dans la gare de Shinjuku /Celle qui fait du strip-éclair dansle métro de Shangai où son oncle a juste le tems de faire la quête / Ceux qui suspendus à leur poignée avaient l'air de chauve-souris ce matin-là dans le métro de Tôkyo / Celui (prénom Philippe,de père égyptien) qui constate que "les heures glissent du gris vers un gris plus sombre" / Celle qui se rappelle que le smog de Los Angeles te colle aux dents comme un vieux caramel / Ceux qui se disent qu'avec tant de câbles le ciel ne va pas s'envoler / Celui qui a cru voir Jésus-Christ au coin de la rue où il a disparu / Celle qui remarque que ce qui rassure chez Bouddha est son ventre à rebonds / Ceux qui s'attardent dans le quartier de la Goutte d'or à l'observation de détails curieux genre le griot en vélosolex / Celui qui se demande comment un homme peut en arriver à poignarder son enfant chéri de pas un an / Celle qui a vu le déploiement des "collaborateurs" de l'unité spéciale du DARD dans le quartier où rien n'était censé se passer comme à la télé mais aujourd'hui faut s'attendre à tout dit-elle à Madame Paccaud sortie sur le palier / Ceux qui se passent un clip de Madonna sur leur smartphone /Celui qui a appris à se faire des cataplasmes de blancs d'oeufs chez le même initié qui lui a rappelé les vertus de la compresse de feuille de chou / Celle qui constate que l'homme dégradé est aussi biodégradable que certains produits quoique laissant quelques déchets carnés / Ceux qui voient la mégapole s'éteindre à 21 heures pile / Celui qu'on emporte dans une housse grise et lisse comme la nuit de Kafka / Celle qui se rappelle le goût particulier des lèvres du jeune Gustav Janouch / Ceux qui préfèrent se taire faute de pouvoir aider, etc.
Celui qui se sent partout étranger y compris dans son lit quand il est seul / Celle qui vous dit faites comme chez vous sans se douter que ça risque de craindre / Ceux qui pigent l'accent de partout où ils jactent /Celui qui a appris à se concentrer sur ce qu'il apprend / Celle qui lit quelque part que "la rue dit la vérité" / Ceux qui pensent que la rue "dit la rue" / Celui qui se laisse volontiers dérouter par les indications erronnées comme ce matin-là à Tôkyo tu t'es fais envoyer à Okinawa alors que tu demandais ton chemin pour Ginza / Celui qui passe sa journeé de retraité coréen à ramener à la maison des enfants perdus dans la gare de Shinjuku /Celle qui fait du strip-éclair dansle métro de Shangai où son oncle a juste le tems de faire la quête / Ceux qui suspendus à leur poignée avaient l'air de chauve-souris ce matin-là dans le métro de Tôkyo / Celui (prénom Philippe,de père égyptien) qui constate que "les heures glissent du gris vers un gris plus sombre" / Celle qui se rappelle que le smog de Los Angeles te colle aux dents comme un vieux caramel / Ceux qui se disent qu'avec tant de câbles le ciel ne va pas s'envoler / Celui qui a cru voir Jésus-Christ au coin de la rue où il a disparu / Celle qui remarque que ce qui rassure chez Bouddha est son ventre à rebonds / Ceux qui s'attardent dans le quartier de la Goutte d'or à l'observation de détails curieux genre le griot en vélosolex / Celui qui se demande comment un homme peut en arriver à poignarder son enfant chéri de pas un an / Celle qui a vu le déploiement des "collaborateurs" de l'unité spéciale du DARD dans le quartier où rien n'était censé se passer comme à la télé mais aujourd'hui faut s'attendre à tout dit-elle à Madame Paccaud sortie sur le palier / Ceux qui se passent un clip de Madonna sur leur smartphone /Celui qui a appris à se faire des cataplasmes de blancs d'oeufs chez le même initié qui lui a rappelé les vertus de la compresse de feuille de chou / Celle qui constate que l'homme dégradé est aussi biodégradable que certains produits quoique laissant quelques déchets carnés / Ceux qui voient la mégapole s'éteindre à 21 heures pile / Celui qu'on emporte dans une housse grise et lisse comme la nuit de Kafka / Celle qui se rappelle le goût particulier des lèvres du jeune Gustav Janouch / Ceux qui préfèrent se taire faute de pouvoir aider, etc. -
La musique des jours
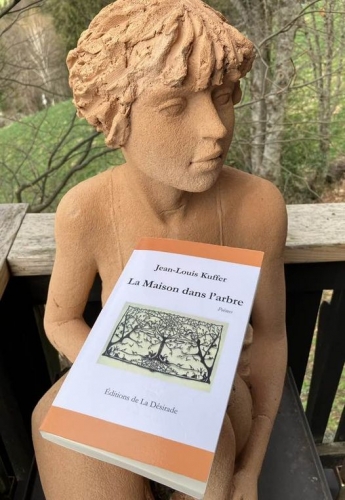 À propos de La Maison dans l'Arbre, triptyque poétique de JLK.par Francis Vladimir« La maison bleue adossée à la colline que chantait Maxime Le Forestier. L’enfant bleu, le roman de Henri Bauchau. La chambre du fils, film de Nanni Moretti, l’incompris, film de Luigi Comencini, L’innocent Film de Luchino Visconti, Amarcord, film de Fédérico Fellini, et sans raison apparente, Le goût de la cerise, film d’Abbas Kiarostami pour sa chronique d’une mort annoncée comme la diagonale du fou sur le grand échiquier. Du pouvoir des mots, de leur persuasion et de leur dissuasion, de leur transmutation sur l’écran de nos nuits blanches. La ligne de crête d’un si bien nommé « La maison dans l’arbre » de JLK.1. La chambre de l’enfant. - Entrons en poésie à la faveur du souvenir, de l’enfance, des lieux inspirants de la mémoire, des déambulations au pays de l’innocence dont le livre est un cheminement vers la source, l’origine, le trou noir, le centre de gravité d’où tout s’en vient et s’en revient, un peu comme le marcheur solitaire arpente les mêmes sentes en partant de chez lui, de sa propre maison, pour s’émerveiller, se rembrunir et chialer les perles de la transparence, jusqu’à se retrouver en un pays familier et lointain, reconnaissable et inconnu à la fois. En ce que je nommerai son premier tiers, par malice, la randonnée dans l’intime, mais que sait autrement faire le poète que de se dire maintes et maintes fois, se redire et se dédire, dans l’acuité de ses mots et au bout de lui-même, à bout de souffle, la poitrine creusée, haletante, le front froncé, les yeux emplis d’horizon. Ce qui pourrait être repli sur soi devient ouverture, remontée à la source et l’on entend le filet d’eau en jaillir « La musique, la poésie/ la pensée incarnée/ campent aux quatre vents/ de la terre et des feux /des sourciers inspirés… » Le sang du poète pulse dans cette ferveur accordée aux éléments, dans leur tourment, tornade, séisme, incendie et au bout dans le rû d’eau… claire, la première eau du monde, celle du premier jour. Comme un voleur de feu, capteur de mots, le poète se révèle à nous, à ses enfants qu’il aura observés dans leur mutines et polissonnes échappées, dans l’enfance, retournée comme un linge de corps, vers laquelle il revient, pas à pas, muet et contrit car dire ses premières années c’est tomber dans les orties, y sentir les picotements, les menues brûlures, pour estourbir sa douleur, serrer les dents et se relever car « tu ne sais ce qui t’a élu/ le sacré est en toi/ et les mots peut-être advenus/ ne te trahirons pas… ».Et l’enfant va en chemin inconnu « dans la patience sans raison/ de ce qu’il ne sait pas ». On ne saurait mieux dire l’enfant, son insatiable demande du monde et son observance têtue des adultes. Et le poète s’obstine à dire cette enfance recluse dans la mémoire, dans les images lointaines déposées dans l’écrin si lourd des secrets enfouis parce qu’à les effleurer serait s’y perdre à nouveau. Ce nécessaire du poète, il lui faudra le dire, tremper sa plume dans l’encrier des mots : « L’encre est en somme la mer/ aux cheveux bleus et verts/ plus vieille que le vieil Homère/ Plus légère que l’air… » Mais c’est, qui sait, revenir vers soi, se retrouver soi quand «Tout se transforme à vue/ la joie m’est fortin de douceur ».Car la joie n’est jamais aussi proche dans cette alliance du mot et du dire, dans l’apaisement : « Crois-donc en moi dit le nuage à l’enfant qui repose/ et je ferai de toi le sage ami de toute chose ». Et si le poème estampille les choses de la vie, c’est pour cerner la déraison, notre douce folie, notre songeuse éternité. Les jeux interdits de l’enfance, sacrés comme un vieux film tant aimé, une escapade au pays des indiens, comme dans les livres d’images, ces premières Bandes dessinées décolorées par le temps « On remonte le long du ruisseau/ avec les indiens bleus/ les camarades saligauds / les cavaliers de feu / fringants et fumants aux naseaux… » on part sans boussole lorsqu’on est un enfant « Une boussole nous manquait/ à tous deux ce matin/ d’aube neuve au lancer du chemin… ».Feu-follet ou Ariel, « il a été et il sera… il sourit à la vie comme elle est. » De l’enfance, que gardons-nous dans la poitrine, là où naît la rébellion ou la gêne, cette respiration altérée, prise en défaut de souffle égal et apaisé ? Nos premières révoltes, nos premières expériences sensuelles, la découverte des autres, leur amitié et leur inimitié, les attirances et les rejets, la peur de l’inconnu, les premières douleurs, la fierté bravache, la honte bue, la fugue de nous-mêmes. Et la parole dans tout ça, celle de l’enfant prodigue ou de l’enfant sauvage « Je ne sais que te dire/ il n’y a pas d’explication : ce n’est qu’un fait divers/ pas plus que la beauté cela n’est défini… sais-tu si l’arbre s’en souvient ? » Et nous irons par les chemins d’infortune « Partout où je suis retombé/ dans mes jours vagabonds/ du ciel des mots rêvés/ au quotidien banal/ de Balbec à Cabourg/ j’aurai recomposé/ mon désordre vital… ».Une pincée de surréalisme n’est jamais de trop pour le poète démis de sa sagesse antique « Le sage ne fait que songer/ à l’insu des horaires/ et comme l’ancien initié/ qui préférait se taire/ il ne fait qu’éprouver/ l’étrange apesanteur/ des oiseaux dont rêve le chien/ quand il nage entre les nuages… » Aux agités de la vie JLK recommande dans le rêve du chien : « la paisible assurance/ de la divine indifférence ». Rêver à perdre la raison, ce serait rêver par temps de chien, perdre sa tête dans un nuage en pantalon…Trouver sa place, sa juste place « Je navigue à l’étoile/ sur le clavier muet/ où dès enfant je m’exerçais/ à l’écart de l’écart/ au milieu juste du milieu ». Passager de la nuit, ange ou démon en sommeil, que sont donc les enfants d’aujourd’hui, qu’était l’enfant d’hier, la chambre en son miroir dit que « les enfants, là-bas, en chemin/ savent que dans les bois/ le mal rôde, et que le cœur humain/ se trempe dans la fraude/ ou plus qu’ils ne le savent, au vrai/ ils le sentent et pressentent/ le faux sous le masque du vrai… »Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille….2. La maison dans l’arbre. – « Ma douceur, il n’est que toi pour me délivrer/ de cette peur ancienne de je ne sais trop quoi… » De la cabane au fond des bois à la maison dans les arbres. La maison suspendue entre ciel et terre. La maison refuge, la maison antre, la maison des délices, la maison des caprices, la maison carioca… ou la maison du bonheur, la maison rêvée. La vie rêvée des anges. Ceux qui adviennent à tout âge et en toute saison et en tout lieu où que nos pas nous portent et où la vie incertaine toujours nous dépose. Sur la grève, dans un pré, au milieu des labours, face à la mer, sur la crête, au bord de l’abîme, le temps d’une vie se décompte quand « le sombre et le clair tissent nos instants ».Une tapisserie, la vie à monter sur sa trame avec l’ardeur de Pénélope, son doux sourire grave, son espoir en miettes, son désespoir donc sans lequel l’histoire d’amour eût été incomplète. Et passent les saisons, les années et les cœurs qui s’envolent, l’oiseau qui vient du large et qui, à tire- d’aile, tournoie en bon augure ou en tragique signe. Dans ce balancement, cette constante hésitation de l’être qui fulmine ou de l’être qui danse, avec son cœur, avec son corps, au tambour de son âme et se rappelle « Le cœur à vif, les mots fous, les années Rimbaud… » Et le poète ajoute« Notre savoir est en Lambeaux/ dans le roncier des preuves ».La matinée s’éveille pourtant sur tout ce qui a été glané au fil des ans avec sa récolte de souvenirs, de teintes ravivées, les couleurs vives de l’été, le nuancier de l’ailleurs, le détail d’une scène comme un tableau impressionniste, et des poèmes ramassés à la pelle dans le souvenir heureux ou les lambris du temps. Ainsi, dans sa maison dans les arbres, voici que le poète tire sa corbeille emplie à ras bord de toutes les années passées avec leur montagne de souvenirs, de rencontres, de regards, dans l’ici et l’ailleurs, dans le cercle de l’intime et dans l’au-delà de soi. Et le poète toujours aime à en rajouter, c’est qu’il tient la corde de son arc, celui du désir de dire, pour tendre ses mots et les lâcher sans autre forme de procès, sans avertissement. Et s’il y a pêche miraculeuse comme un enfant désarçonné il se dit : « Que faire de tout cela ? / se demande-t-il donc/ en scrutant du regard/ ce pays de Lui-même… ». La matinée s’estompe dans les ombres claires du poème là où « les arbres sans attente/ veillent aux nuits d’été… » et « on ne saura jamais/ d’où vient le chant du soir ».Le poète se joue de lui et s’amuse du temps passé et du temps retrouvé et dans une recherche toute proustienne, assumée sans ambages, avec cette coquetterie inavouable que tout bel et tendre et rude écrivain garde comme un joker « La terrible douleur/ de n’être pas aimé/ ou tout faire pour ne l’être pas/ quand ce ne serait pas assez » car, comment dire, sous le bourru parfois, pointe la tendresse, toute en retenue comme une pointe de fleur de sel amertumise à peine les choses de la vie, les rendant plus proches, plus amicales, plus caressantes, une petite pincée pour accompagner et s’accompagner, rendre moins fade.C’est à cela que s’essaye JLK. Il se tient là, au bas de son arbre, la tête dans le feuillage, invitation muette lancée à qui veut l’entendre, pour visiter sa maison dans les arbres. Et qu’elle ne soit qu’une imagination suspendue où cachée dans une forêt touffue, à l’orée des regards indiscrets, qu’importe si le lecteur en decouvre dans le ravissement qu’aurait pu en avoir Lol V. Stein, le portail d’entrée, l’échelle suspendue, le toit canopée.Dans sa longue marche vers le poème JLK ouvre grand les bras, décille nos regards, désencombre nos âmes, désarticule nos paresses. De bruit et de fureur, le monde s’enkyste et saigne. Charlie, Le Bataclan, Nice… « C’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain ». Et l’on se prend à croire en des lieux d’amitié naturelle, des lieux de rencontres mêlées, des lieux de doux apaisements.Et le poète, ce sourcier du regard va de l’avant, toujours – « Tu ne te lasses pas/ ni ne cèdes à l’oubli…/ Tout noter, tout noter/ ce grand nègre princier/ c’est l’homme simplement/ sur la terre exilé/ ou la vieille esseulée/ Tout noter : les objets/ qui nous cachent du temps / Tout ce qui est caché/ ce qu’on voit sans le voir/ Tout ce qui est usé/ ton regard le répare…/ Tout noter : la lumière/ et l’humble vérité/ l’aura de ce mystère ». Tout noter, tout noter, absorber le monde pour en dire l’infime et son immensité, ses silences et ses terreurs, sa présence et son néant. D’où que vienne le poème, d’où qu’il s’écrive, de son rapport à l’autre, de son rapport à soi, dans la chair et la sueur, dans la joie ou l’amertume, il y aura ailleurs ou sous nos yeux, la maison dans les arbres plongée dans la pénombre, soumise aux grands éclairs. Le poète transi y trouvera refuge, protection, réparation. Cathédrale de la douleur où le dit redevient baume, souffle, brise, parfum, effluve d’amour « je me sens si léger de me savoir à toi.» Et j’ajouterai de mon fait : je me sens si heureux d’être dans ta présence.3.Le chemin sur la mer. – Ou le dernier chemin, celui que suivit Walter Benjamin de Port-Vendres à Port-bou en Espagne, un 25 septembre 1940, retrouvé ici dans Sans issue.Ce troisième volet du recueil recentre le poète dans ses amitiés inaltérables, celles qu’il s’est choisies, en dépit des années qui vont passant et qui, par le jeu de la mémoire et de l’affect, renforcent la présence de nos chers disparus.Au jeu de la ressouvenance l’aimée s’inscrit en creux dans la caresse du poème, dans l’incertitude de la séparation « Le moment n’était pas venu/ de nous dire au-revoir/ Le moment se tenait sur ce quai de hasard/ où le temps attendait/ quelque train de retard… » Et la mémoire si elle se joue de nous convoque des lieux magiques, des lieux de retrouvailles et de promenades pour toujours partagées « À Venise nous étions trois/ à nous tourner autour/ la solitude, l’amitié et l’amour… » Et le cœur se cadence au clapotis de l’eau et sur le quai, face aux embruns déchirés dans le miroir de l’eau, l’ironie, la moquerie de soi « Tu m’avais dit que tu m’attendais chez Florian/ mais il n’était pas dans l’annuaire/ et tu t’es moqué… »De cette fragilité, de cette timidité dénuée de rouerie, naît la mélancolie, la rêverie « Le vieux flûtiste est mort/ on n’entendra plus dans les bois/ le temps de le pleurer/ les roulades du rossignol ». Le rossignol se tait à l’aube, le dernier livre d’Elsa Triolet. Un livre tourné vers le silence. Il y a dans ce Chemin sur la mer, une annonciation mortelle, indécente presque, d’un ordre qui nous emportera tous, un jour prochain.La mort, la malnommée, la calomniée, le virus indécent, qui dans la déraison de son propre nom, taraude le poème, le porte ailleurs de ce qu’il ose dire ou entreprendre, le transplante, plus loin que la ville, plus loin que la forêt, plus loin que la mer, au-dessus des montagnes. Cette particularité de la poster tout près, et prête à tout, en embuscade, cela clarifie, dénude, désosse la poésie de JLK qui a ses côtés sombres, ses affinités électives, ses accrocs, ses écorchures, ses saignements, sa douleur éclatée, ses attentes et ses absences, mais aussi des joies souveraines, simples et arborées comme un gamin s’amuse à parader pour qu’on le reconnaisse.Il y a, nonobstant la diversité des poèmes et le brassage du temps, une unité, une colonne vertébrale, une arborescence qui soutient le tout afin que la maison dans les arbres, si elle tangue au plus fort des tempêtes, ne sombre jamais.Et c’est le cœur chaviré qui souvent s’invite chez JLK, dans cette poésie de l’approche amicale, de l’exigence du dire, de l’affleurement et de l’agencement des mots qui eux, toujours, se plaisent à s’égarer, à partir autre part, là où on ne les attend pas et s’il plaît à JLK d’avoir son art poétique, il précise en un clin d’œil à Arthur « Le plus simple et le plus limpide/ sera notre façon…».Par tant de mots lâchés à la lisière de notre entendement, sous nos yeux fureteurs à l’envi, des bleus à l’âme au bleu des mots, la grâce est intranquille, indécise ou inquiète, un rien émerveillée « Rien n’est sûr que cette inquiétude/ qui les tient éveillés/ rien ne dit que cet interlude/ entre le tout et les riens/ à la fin ne les résumait/ amoureux et sereins… »Sérénité retrouvée à laquelle JLK aspire et ce faisant il nous embarque dans ses voyages, au trot et au trop du poème, sur sa barque traversière, en toute béatitude et mansuétude pour que l’arbre et la maison reste dans le bleu, la couleur bleue qui colore le recueil, à sa suite harmonique avec les menues indications qu’il sème de ci de là en légères dédicaces participant ainsi, pour le lecteur, d’une reconnaissance, d’une main tendue, d’une tablée commune, que le poète toujours se plaît à ne pas refuser. « Nous serons comme des lucioles/ dans vos prochaines villes/ à l’orée des grands bois/ où survivent les oubliés/ et puissiez-vous entendre/ de nos voix le murmure/ puissent nos mots vous apaiser… »F.V.Jean-Louis Kuffer, La Maison dans l'arbre. Editions de La Désirade, 276p.
À propos de La Maison dans l'Arbre, triptyque poétique de JLK.par Francis Vladimir« La maison bleue adossée à la colline que chantait Maxime Le Forestier. L’enfant bleu, le roman de Henri Bauchau. La chambre du fils, film de Nanni Moretti, l’incompris, film de Luigi Comencini, L’innocent Film de Luchino Visconti, Amarcord, film de Fédérico Fellini, et sans raison apparente, Le goût de la cerise, film d’Abbas Kiarostami pour sa chronique d’une mort annoncée comme la diagonale du fou sur le grand échiquier. Du pouvoir des mots, de leur persuasion et de leur dissuasion, de leur transmutation sur l’écran de nos nuits blanches. La ligne de crête d’un si bien nommé « La maison dans l’arbre » de JLK.1. La chambre de l’enfant. - Entrons en poésie à la faveur du souvenir, de l’enfance, des lieux inspirants de la mémoire, des déambulations au pays de l’innocence dont le livre est un cheminement vers la source, l’origine, le trou noir, le centre de gravité d’où tout s’en vient et s’en revient, un peu comme le marcheur solitaire arpente les mêmes sentes en partant de chez lui, de sa propre maison, pour s’émerveiller, se rembrunir et chialer les perles de la transparence, jusqu’à se retrouver en un pays familier et lointain, reconnaissable et inconnu à la fois. En ce que je nommerai son premier tiers, par malice, la randonnée dans l’intime, mais que sait autrement faire le poète que de se dire maintes et maintes fois, se redire et se dédire, dans l’acuité de ses mots et au bout de lui-même, à bout de souffle, la poitrine creusée, haletante, le front froncé, les yeux emplis d’horizon. Ce qui pourrait être repli sur soi devient ouverture, remontée à la source et l’on entend le filet d’eau en jaillir « La musique, la poésie/ la pensée incarnée/ campent aux quatre vents/ de la terre et des feux /des sourciers inspirés… » Le sang du poète pulse dans cette ferveur accordée aux éléments, dans leur tourment, tornade, séisme, incendie et au bout dans le rû d’eau… claire, la première eau du monde, celle du premier jour. Comme un voleur de feu, capteur de mots, le poète se révèle à nous, à ses enfants qu’il aura observés dans leur mutines et polissonnes échappées, dans l’enfance, retournée comme un linge de corps, vers laquelle il revient, pas à pas, muet et contrit car dire ses premières années c’est tomber dans les orties, y sentir les picotements, les menues brûlures, pour estourbir sa douleur, serrer les dents et se relever car « tu ne sais ce qui t’a élu/ le sacré est en toi/ et les mots peut-être advenus/ ne te trahirons pas… ».Et l’enfant va en chemin inconnu « dans la patience sans raison/ de ce qu’il ne sait pas ». On ne saurait mieux dire l’enfant, son insatiable demande du monde et son observance têtue des adultes. Et le poète s’obstine à dire cette enfance recluse dans la mémoire, dans les images lointaines déposées dans l’écrin si lourd des secrets enfouis parce qu’à les effleurer serait s’y perdre à nouveau. Ce nécessaire du poète, il lui faudra le dire, tremper sa plume dans l’encrier des mots : « L’encre est en somme la mer/ aux cheveux bleus et verts/ plus vieille que le vieil Homère/ Plus légère que l’air… » Mais c’est, qui sait, revenir vers soi, se retrouver soi quand «Tout se transforme à vue/ la joie m’est fortin de douceur ».Car la joie n’est jamais aussi proche dans cette alliance du mot et du dire, dans l’apaisement : « Crois-donc en moi dit le nuage à l’enfant qui repose/ et je ferai de toi le sage ami de toute chose ». Et si le poème estampille les choses de la vie, c’est pour cerner la déraison, notre douce folie, notre songeuse éternité. Les jeux interdits de l’enfance, sacrés comme un vieux film tant aimé, une escapade au pays des indiens, comme dans les livres d’images, ces premières Bandes dessinées décolorées par le temps « On remonte le long du ruisseau/ avec les indiens bleus/ les camarades saligauds / les cavaliers de feu / fringants et fumants aux naseaux… » on part sans boussole lorsqu’on est un enfant « Une boussole nous manquait/ à tous deux ce matin/ d’aube neuve au lancer du chemin… ».Feu-follet ou Ariel, « il a été et il sera… il sourit à la vie comme elle est. » De l’enfance, que gardons-nous dans la poitrine, là où naît la rébellion ou la gêne, cette respiration altérée, prise en défaut de souffle égal et apaisé ? Nos premières révoltes, nos premières expériences sensuelles, la découverte des autres, leur amitié et leur inimitié, les attirances et les rejets, la peur de l’inconnu, les premières douleurs, la fierté bravache, la honte bue, la fugue de nous-mêmes. Et la parole dans tout ça, celle de l’enfant prodigue ou de l’enfant sauvage « Je ne sais que te dire/ il n’y a pas d’explication : ce n’est qu’un fait divers/ pas plus que la beauté cela n’est défini… sais-tu si l’arbre s’en souvient ? » Et nous irons par les chemins d’infortune « Partout où je suis retombé/ dans mes jours vagabonds/ du ciel des mots rêvés/ au quotidien banal/ de Balbec à Cabourg/ j’aurai recomposé/ mon désordre vital… ».Une pincée de surréalisme n’est jamais de trop pour le poète démis de sa sagesse antique « Le sage ne fait que songer/ à l’insu des horaires/ et comme l’ancien initié/ qui préférait se taire/ il ne fait qu’éprouver/ l’étrange apesanteur/ des oiseaux dont rêve le chien/ quand il nage entre les nuages… » Aux agités de la vie JLK recommande dans le rêve du chien : « la paisible assurance/ de la divine indifférence ». Rêver à perdre la raison, ce serait rêver par temps de chien, perdre sa tête dans un nuage en pantalon…Trouver sa place, sa juste place « Je navigue à l’étoile/ sur le clavier muet/ où dès enfant je m’exerçais/ à l’écart de l’écart/ au milieu juste du milieu ». Passager de la nuit, ange ou démon en sommeil, que sont donc les enfants d’aujourd’hui, qu’était l’enfant d’hier, la chambre en son miroir dit que « les enfants, là-bas, en chemin/ savent que dans les bois/ le mal rôde, et que le cœur humain/ se trempe dans la fraude/ ou plus qu’ils ne le savent, au vrai/ ils le sentent et pressentent/ le faux sous le masque du vrai… »Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille….2. La maison dans l’arbre. – « Ma douceur, il n’est que toi pour me délivrer/ de cette peur ancienne de je ne sais trop quoi… » De la cabane au fond des bois à la maison dans les arbres. La maison suspendue entre ciel et terre. La maison refuge, la maison antre, la maison des délices, la maison des caprices, la maison carioca… ou la maison du bonheur, la maison rêvée. La vie rêvée des anges. Ceux qui adviennent à tout âge et en toute saison et en tout lieu où que nos pas nous portent et où la vie incertaine toujours nous dépose. Sur la grève, dans un pré, au milieu des labours, face à la mer, sur la crête, au bord de l’abîme, le temps d’une vie se décompte quand « le sombre et le clair tissent nos instants ».Une tapisserie, la vie à monter sur sa trame avec l’ardeur de Pénélope, son doux sourire grave, son espoir en miettes, son désespoir donc sans lequel l’histoire d’amour eût été incomplète. Et passent les saisons, les années et les cœurs qui s’envolent, l’oiseau qui vient du large et qui, à tire- d’aile, tournoie en bon augure ou en tragique signe. Dans ce balancement, cette constante hésitation de l’être qui fulmine ou de l’être qui danse, avec son cœur, avec son corps, au tambour de son âme et se rappelle « Le cœur à vif, les mots fous, les années Rimbaud… » Et le poète ajoute« Notre savoir est en Lambeaux/ dans le roncier des preuves ».La matinée s’éveille pourtant sur tout ce qui a été glané au fil des ans avec sa récolte de souvenirs, de teintes ravivées, les couleurs vives de l’été, le nuancier de l’ailleurs, le détail d’une scène comme un tableau impressionniste, et des poèmes ramassés à la pelle dans le souvenir heureux ou les lambris du temps. Ainsi, dans sa maison dans les arbres, voici que le poète tire sa corbeille emplie à ras bord de toutes les années passées avec leur montagne de souvenirs, de rencontres, de regards, dans l’ici et l’ailleurs, dans le cercle de l’intime et dans l’au-delà de soi. Et le poète toujours aime à en rajouter, c’est qu’il tient la corde de son arc, celui du désir de dire, pour tendre ses mots et les lâcher sans autre forme de procès, sans avertissement. Et s’il y a pêche miraculeuse comme un enfant désarçonné il se dit : « Que faire de tout cela ? / se demande-t-il donc/ en scrutant du regard/ ce pays de Lui-même… ». La matinée s’estompe dans les ombres claires du poème là où « les arbres sans attente/ veillent aux nuits d’été… » et « on ne saura jamais/ d’où vient le chant du soir ».Le poète se joue de lui et s’amuse du temps passé et du temps retrouvé et dans une recherche toute proustienne, assumée sans ambages, avec cette coquetterie inavouable que tout bel et tendre et rude écrivain garde comme un joker « La terrible douleur/ de n’être pas aimé/ ou tout faire pour ne l’être pas/ quand ce ne serait pas assez » car, comment dire, sous le bourru parfois, pointe la tendresse, toute en retenue comme une pointe de fleur de sel amertumise à peine les choses de la vie, les rendant plus proches, plus amicales, plus caressantes, une petite pincée pour accompagner et s’accompagner, rendre moins fade.C’est à cela que s’essaye JLK. Il se tient là, au bas de son arbre, la tête dans le feuillage, invitation muette lancée à qui veut l’entendre, pour visiter sa maison dans les arbres. Et qu’elle ne soit qu’une imagination suspendue où cachée dans une forêt touffue, à l’orée des regards indiscrets, qu’importe si le lecteur en decouvre dans le ravissement qu’aurait pu en avoir Lol V. Stein, le portail d’entrée, l’échelle suspendue, le toit canopée.Dans sa longue marche vers le poème JLK ouvre grand les bras, décille nos regards, désencombre nos âmes, désarticule nos paresses. De bruit et de fureur, le monde s’enkyste et saigne. Charlie, Le Bataclan, Nice… « C’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain ». Et l’on se prend à croire en des lieux d’amitié naturelle, des lieux de rencontres mêlées, des lieux de doux apaisements.Et le poète, ce sourcier du regard va de l’avant, toujours – « Tu ne te lasses pas/ ni ne cèdes à l’oubli…/ Tout noter, tout noter/ ce grand nègre princier/ c’est l’homme simplement/ sur la terre exilé/ ou la vieille esseulée/ Tout noter : les objets/ qui nous cachent du temps / Tout ce qui est caché/ ce qu’on voit sans le voir/ Tout ce qui est usé/ ton regard le répare…/ Tout noter : la lumière/ et l’humble vérité/ l’aura de ce mystère ». Tout noter, tout noter, absorber le monde pour en dire l’infime et son immensité, ses silences et ses terreurs, sa présence et son néant. D’où que vienne le poème, d’où qu’il s’écrive, de son rapport à l’autre, de son rapport à soi, dans la chair et la sueur, dans la joie ou l’amertume, il y aura ailleurs ou sous nos yeux, la maison dans les arbres plongée dans la pénombre, soumise aux grands éclairs. Le poète transi y trouvera refuge, protection, réparation. Cathédrale de la douleur où le dit redevient baume, souffle, brise, parfum, effluve d’amour « je me sens si léger de me savoir à toi.» Et j’ajouterai de mon fait : je me sens si heureux d’être dans ta présence.3.Le chemin sur la mer. – Ou le dernier chemin, celui que suivit Walter Benjamin de Port-Vendres à Port-bou en Espagne, un 25 septembre 1940, retrouvé ici dans Sans issue.Ce troisième volet du recueil recentre le poète dans ses amitiés inaltérables, celles qu’il s’est choisies, en dépit des années qui vont passant et qui, par le jeu de la mémoire et de l’affect, renforcent la présence de nos chers disparus.Au jeu de la ressouvenance l’aimée s’inscrit en creux dans la caresse du poème, dans l’incertitude de la séparation « Le moment n’était pas venu/ de nous dire au-revoir/ Le moment se tenait sur ce quai de hasard/ où le temps attendait/ quelque train de retard… » Et la mémoire si elle se joue de nous convoque des lieux magiques, des lieux de retrouvailles et de promenades pour toujours partagées « À Venise nous étions trois/ à nous tourner autour/ la solitude, l’amitié et l’amour… » Et le cœur se cadence au clapotis de l’eau et sur le quai, face aux embruns déchirés dans le miroir de l’eau, l’ironie, la moquerie de soi « Tu m’avais dit que tu m’attendais chez Florian/ mais il n’était pas dans l’annuaire/ et tu t’es moqué… »De cette fragilité, de cette timidité dénuée de rouerie, naît la mélancolie, la rêverie « Le vieux flûtiste est mort/ on n’entendra plus dans les bois/ le temps de le pleurer/ les roulades du rossignol ». Le rossignol se tait à l’aube, le dernier livre d’Elsa Triolet. Un livre tourné vers le silence. Il y a dans ce Chemin sur la mer, une annonciation mortelle, indécente presque, d’un ordre qui nous emportera tous, un jour prochain.La mort, la malnommée, la calomniée, le virus indécent, qui dans la déraison de son propre nom, taraude le poème, le porte ailleurs de ce qu’il ose dire ou entreprendre, le transplante, plus loin que la ville, plus loin que la forêt, plus loin que la mer, au-dessus des montagnes. Cette particularité de la poster tout près, et prête à tout, en embuscade, cela clarifie, dénude, désosse la poésie de JLK qui a ses côtés sombres, ses affinités électives, ses accrocs, ses écorchures, ses saignements, sa douleur éclatée, ses attentes et ses absences, mais aussi des joies souveraines, simples et arborées comme un gamin s’amuse à parader pour qu’on le reconnaisse.Il y a, nonobstant la diversité des poèmes et le brassage du temps, une unité, une colonne vertébrale, une arborescence qui soutient le tout afin que la maison dans les arbres, si elle tangue au plus fort des tempêtes, ne sombre jamais.Et c’est le cœur chaviré qui souvent s’invite chez JLK, dans cette poésie de l’approche amicale, de l’exigence du dire, de l’affleurement et de l’agencement des mots qui eux, toujours, se plaisent à s’égarer, à partir autre part, là où on ne les attend pas et s’il plaît à JLK d’avoir son art poétique, il précise en un clin d’œil à Arthur « Le plus simple et le plus limpide/ sera notre façon…».Par tant de mots lâchés à la lisière de notre entendement, sous nos yeux fureteurs à l’envi, des bleus à l’âme au bleu des mots, la grâce est intranquille, indécise ou inquiète, un rien émerveillée « Rien n’est sûr que cette inquiétude/ qui les tient éveillés/ rien ne dit que cet interlude/ entre le tout et les riens/ à la fin ne les résumait/ amoureux et sereins… »Sérénité retrouvée à laquelle JLK aspire et ce faisant il nous embarque dans ses voyages, au trot et au trop du poème, sur sa barque traversière, en toute béatitude et mansuétude pour que l’arbre et la maison reste dans le bleu, la couleur bleue qui colore le recueil, à sa suite harmonique avec les menues indications qu’il sème de ci de là en légères dédicaces participant ainsi, pour le lecteur, d’une reconnaissance, d’une main tendue, d’une tablée commune, que le poète toujours se plaît à ne pas refuser. « Nous serons comme des lucioles/ dans vos prochaines villes/ à l’orée des grands bois/ où survivent les oubliés/ et puissiez-vous entendre/ de nos voix le murmure/ puissent nos mots vous apaiser… »F.V.Jean-Louis Kuffer, La Maison dans l'arbre. Editions de La Désirade, 276p. -
Enfantaisie du mardi

À la Maison bleue, ce mardi 27 janvier. – L’enfant sérieux, de tout le sérieux de pontife pédant de ses huit ans, me fixe et me balance comme ça sans donner du tout l’impression d’une répétition ou pire : d’une citation servile : «Je regrette les temps de l’antique jeunesse », et tout à coup je me dis qu’il n’y a pas de miracle, sauf au gré de l’enfantaisie qui tout à l’heure lui a fait ouvrir tel petit livre posé là et déchiffrer l’alexandrin et le mémoriser aussitôt et le servir comme en miroir au vieux veilleur que je suis à ses yeux, alors dans la foulée j’entre dans son jeu et d’un temps en trois mouvements je lui chantonne :
«Je regrette les temps où la sève du monde, l’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts, dans les veines de Pan mettaient un univers ». Et l’enfant à son tour et d’un coup de revolver imaginaire : « Pan ! »
Sur quoi l’Enfant nous propose (il y a là tout un petit public réuni pour la célébration du troisième annivesaire de la Petite) sa dernière Présentation, où l’Art et la Numismatique seront illustrés de concert à renfort d’objets de splendeur, à commencer par la Vierge aux yeux levés vers le Ciel, que pédant à mon tour je situe dans la lignée maniériste de Guido Reni, et l’Enfant scrupuleux de me demander de préciser : Guido Reni dernière période, GranDaddy ?
L’enfantaisie non plus n’est pas une lubie vague : c’est la première pointe de l’Attention Sensible, la première Monnaie du Cœur dont l’Enfant s’est improvisé le collectionneur sans se douter de la profondité de ce gisement dont je crois juste et lucide, adéquat et limpide de préciser qu’il figure « le pur ruissellement de la vie infinie »… -
Fantaisies du lundi

À La Désirade, ce lundi 26 janvier. - Ce jour dédié par la Mémoire à Sainte Paule, veuve à 32 ans et cinq fois mère, fondatrice de deux monastères à Jérusalem avant de remonter au Père en l’an 404, mais aussi célébrant les bienfaits de Saint Polycarpe toujours invoqué par les durs d’oreille - ce jour ou les princes à marier d’antan exigeaient l’épilation de leurs promises alors que les épouses salaient de concert les parties défaillantes de leurs conjoints, l’idée m’est venue de m’interroger sur une question majeure, comme on dit, relative à la mystérieuse apparition de la Fantaisie - et j’y viens ce matin grâce à l’observation rapprochée de trois enfants dont la petite dernière au prénom de Liza fête aujourd’hui même sa troisième année…
La Fantaisie, telle que je l’entends, la subodore et l’expérimente sans discontinuer, aux lisières ou aux clairières du sommeil, comme au plein jour lucide, n’a rien d’une lubie anodine. Elle est respiration plus encore qu’inspiration - comme on la prêtait mollement aux muses diaphanes des récits surannés -, elle est initiale et surprenante à tout coup, elle est source et un peu sorcière, il y a en elle une douce folie d’avant toute Explication, comme au premier chant – comme au premier saut.
La Petite invente ce matin sa langue : « Viens donc, maîtressier, allons faire de l’écrition ! ». Mais d’où cela vient-il ? Comment, de l’imitation en vient-on à l’invention ? Qui suggère à la Petite de danser soudain autour du « poteau de tortue » ? Quel génie malin ?
-
Nouvelles de l'étranger
Les poèmes nous arrivent comme des visiteurs, bientôt reconnus, aussi notre porte ne saurait-elle se fermer à ces messagers de nos propres lointains… (en forêt, 1986)Dessin de Thierry Vernet: esquisse d’un portrait de JLK, en 1986. -
La vie aux Oiseaux
 Monsieur Muller lave son Opel Rekord le samedi(Ragots de quartier et autres histoires rosses)D’aucuns ont parlé de lui comme d’un libre-penseur et plus tard d’un type menant une double vie à l’insu du voisinage, mais imaginer que Monsieur Muller puisse laver sa voiture un dimanche, ça non.Monsieur Muller votait-il ? Nul n’en avait la moindre idée, même pas moi durant ma brève période communiste. Il se disait (les femmes à l’épicerie du quartier) que son épouse Monique n’avait pas désiré leur fils aîné, qui s’est jeté sous le train plus tard, mais ce que lui-même en pensait restait sous le couvercle de la marmite, selon l’expression de son voisin Maillefer, sauf pour moi qui savait que son père refusait à Philippe le droit de laver l’Opel Rekord à cause de son penchant, et moins encore le modèle Kapitän qui a suivi avec la promotion de Monsieur Muller au titre de fondé de pouvoir de sa banque.Lorsque Philippe s’est jeté sous le train, sa mère a fait remarquer à la nôtre, par-dessus la haie séparant nos jardins, qu’elle n’avait jamais pensé que cette petite nature aurait le courage d’aller jusque-là, mais à l’époque Monsieur Muller semblait occupé ailleurs même le samedi, et tout avait bien changé dans le quartier que j’avais probablement déjà quitté, pour autant que je me souvienne…Madame Duflon reçoit l’après-midiL’ouvrier restera toujours l’ouvrier, disait-on dans le quartier, où l’employé était la norme, avec deux fondés de pouvoir qui auraient pu viser plus haut que nos lotissements subventionnés typiques de l’apès-guerre, mais d’ouvrier nous n’en savions qu’un seul et ça se voyait au survêtement gris marqué de la lettre Z (on savait qu’il travaillait aux ateliers mécaniques Zorn) qu’il portait le soir et même les dimanches sans se départir de son air buté, ou plus exactement rebutant, Duflon ne parlant à vrai dire à personne d’autre qu’aux habitués du Café du Mouton jouxtant les ateliers où il venait de passer contremaître au dam de son rival l’Italien Marti.« Il n’a pourtant pas de quoi faire le fier », disait-on à propos de sa façon de se détourner même sans être salué, mais le jugement s’atténuait avec un semblant de compassion à l’évocation sous-entendue que résumait l’expression « avec ce qui l’attend chez lui », et là je ne vous dis pas l’odeur de soupe tiède et la vision de Madame Duflon en robe de chambre de pilou bleu pâle, avant et après qu’elle avait reçu...Car Madame Duflon recevait. Personne n’en savait plus, les voisines les plus futées ignoraient combien elle prenait – on disait jusqu’à des cent francs tu te rends compte, mais sans la moindre preuve -,et tout ça ne faisait pas que le fils et la fille Duflon, treize et onze ans, fussent mieux allurés en matière de vêtements et de souliers, et surtout moins fuyants, comme le père.Quant à Verge d’or, notre facteur bicandier, il avait dit une fois que du quartier seule la maison des Duflon était mal habitée, jusqu’au jour où il s'y était attardé en fin de matinée…À l'ombre des pétales
Monsieur Muller lave son Opel Rekord le samedi(Ragots de quartier et autres histoires rosses)D’aucuns ont parlé de lui comme d’un libre-penseur et plus tard d’un type menant une double vie à l’insu du voisinage, mais imaginer que Monsieur Muller puisse laver sa voiture un dimanche, ça non.Monsieur Muller votait-il ? Nul n’en avait la moindre idée, même pas moi durant ma brève période communiste. Il se disait (les femmes à l’épicerie du quartier) que son épouse Monique n’avait pas désiré leur fils aîné, qui s’est jeté sous le train plus tard, mais ce que lui-même en pensait restait sous le couvercle de la marmite, selon l’expression de son voisin Maillefer, sauf pour moi qui savait que son père refusait à Philippe le droit de laver l’Opel Rekord à cause de son penchant, et moins encore le modèle Kapitän qui a suivi avec la promotion de Monsieur Muller au titre de fondé de pouvoir de sa banque.Lorsque Philippe s’est jeté sous le train, sa mère a fait remarquer à la nôtre, par-dessus la haie séparant nos jardins, qu’elle n’avait jamais pensé que cette petite nature aurait le courage d’aller jusque-là, mais à l’époque Monsieur Muller semblait occupé ailleurs même le samedi, et tout avait bien changé dans le quartier que j’avais probablement déjà quitté, pour autant que je me souvienne…Madame Duflon reçoit l’après-midiL’ouvrier restera toujours l’ouvrier, disait-on dans le quartier, où l’employé était la norme, avec deux fondés de pouvoir qui auraient pu viser plus haut que nos lotissements subventionnés typiques de l’apès-guerre, mais d’ouvrier nous n’en savions qu’un seul et ça se voyait au survêtement gris marqué de la lettre Z (on savait qu’il travaillait aux ateliers mécaniques Zorn) qu’il portait le soir et même les dimanches sans se départir de son air buté, ou plus exactement rebutant, Duflon ne parlant à vrai dire à personne d’autre qu’aux habitués du Café du Mouton jouxtant les ateliers où il venait de passer contremaître au dam de son rival l’Italien Marti.« Il n’a pourtant pas de quoi faire le fier », disait-on à propos de sa façon de se détourner même sans être salué, mais le jugement s’atténuait avec un semblant de compassion à l’évocation sous-entendue que résumait l’expression « avec ce qui l’attend chez lui », et là je ne vous dis pas l’odeur de soupe tiède et la vision de Madame Duflon en robe de chambre de pilou bleu pâle, avant et après qu’elle avait reçu...Car Madame Duflon recevait. Personne n’en savait plus, les voisines les plus futées ignoraient combien elle prenait – on disait jusqu’à des cent francs tu te rends compte, mais sans la moindre preuve -,et tout ça ne faisait pas que le fils et la fille Duflon, treize et onze ans, fussent mieux allurés en matière de vêtements et de souliers, et surtout moins fuyants, comme le père.Quant à Verge d’or, notre facteur bicandier, il avait dit une fois que du quartier seule la maison des Duflon était mal habitée, jusqu’au jour où il s'y était attardé en fin de matinée…À l'ombre des pétales La toute vieille Eulalie Coton a les pieds secs, les pieds blancs, les pieds froids.Le jeune Docteur Plastron, d’une voix aussi blanche que son caleçon, lui prend les mains et lui explique en douceur qu’on va lui couper ses pieds pourris si elle est d’accord , mais la toute vieille se rebiffe car elle tient à ses pieds morts et montre ses griffes au gamin.Et de lancer au carabin: «Fiston, sans pieds comment voulez-vous que je foule encore l’ombre des pétales, et qu’en serait-il donc , même pourri, d’un monde sans poésie ? »Or on le sait trop peu aux Oiseaux : que la Poésie aura résumé pour ainsi dire la destinée de la grabataire, au motif que Les Ormeaux fleuris, avant le placement d’Eulalie plus que nonagénaire à l’Institut médico-social Au clair matin par ses descendants indirects, et la vente de la maison constituant l’ornement hors d’âge du quartier en style Art Nouveau classé, ont relevé longtemps du haut-lieu de conservation musicale (avec le Quatuor mémorable dont elle était l’alto et parfois la flûte) et les rendez-vous littéraires illustrés par ses Groupages Vespéraux de poètes et de conteurs – tout cela ayant marqué ce qu’on pourrait dire le passé glorieux du quartier à vrai dire ignoré des actuels habitants.
La toute vieille Eulalie Coton a les pieds secs, les pieds blancs, les pieds froids.Le jeune Docteur Plastron, d’une voix aussi blanche que son caleçon, lui prend les mains et lui explique en douceur qu’on va lui couper ses pieds pourris si elle est d’accord , mais la toute vieille se rebiffe car elle tient à ses pieds morts et montre ses griffes au gamin.Et de lancer au carabin: «Fiston, sans pieds comment voulez-vous que je foule encore l’ombre des pétales, et qu’en serait-il donc , même pourri, d’un monde sans poésie ? »Or on le sait trop peu aux Oiseaux : que la Poésie aura résumé pour ainsi dire la destinée de la grabataire, au motif que Les Ormeaux fleuris, avant le placement d’Eulalie plus que nonagénaire à l’Institut médico-social Au clair matin par ses descendants indirects, et la vente de la maison constituant l’ornement hors d’âge du quartier en style Art Nouveau classé, ont relevé longtemps du haut-lieu de conservation musicale (avec le Quatuor mémorable dont elle était l’alto et parfois la flûte) et les rendez-vous littéraires illustrés par ses Groupages Vespéraux de poètes et de conteurs – tout cela ayant marqué ce qu’on pourrait dire le passé glorieux du quartier à vrai dire ignoré des actuels habitants.Autant dire qu’en amputant Eulalie Coton l’on eût coupé définitivement les derniers rameaux de mémoire du quartier, mais l’ironie de la vie veut que la Dame en noir ait réglé le sort de la ronchonneuse l’autre soir sans que personne aux Oiseaux n’en soit avisé, n’était le jeune Gaétan son dernier soignant, slameur à ses heures…
Différent
(en mémoire de P.-A. de M.)
La cravate lavallière à rubans de soie vieux rouge, en joli contraste avec le noir côtelé de son costume bohème chic, ne laissa de faire sourciller Père quand son fils Pierre-Marie, ce matin-là, se présenta à lui qui prenait son premier café matinal en compagnie de Mother, mais le vénérable prof s’interdit toute remarque sur ce qu’il y avait à ses yeux de par trop maniéré dans cette tenue, toujours inquiet des réactions vives de son épouse à tout ce qui froissait ou risquait de peinaer son fils préféré à l’extrême sensibilité de poète, d’ailleurs accordée au fait qu’il écrivait bel et bien des poèmes, certes moqués et même persiflés par ses persécuteurs du Collège, mais que Père lui-même avait reconnus en leur pureté de cœur et leur profondeur de pensée, dans l’indéniable lignée lyrique des plus estimables noms du canton.
La Revue des Lettres, dont le dernier exemplaire paru figurait à tout coup sur le présentoir de la Salle des Maîtres, rappelait d’ailleurs à ses collègues l’estime partagée que suscitaient les poèmes de Pierre-Marie, et l’on fermerait donc les yeux sur la cravate western en espérant que le garçon s’en tiendrait là en son ostentation de dandysme déjà raillée dans le quartier (la démarche un peu guindée du jeune homme, remarqué aussi pour sa façon de tenir son parapluie comme un cierge dans les processions)...
« Vous ne me tiendrez point rigueur de me sentir différent », avait dit Pierre-Marie à Mother au tournant déjà de ses douze ans, donc avant les poèmes, quand il passait le plus clair de son temps à lire les aventures d’Ulysse et ses forbans, dont Père était LE spécialiste du Collège – Pierre-Marie donc à l’écart des autres jeunes gens du quartier, n’était celui qu’il appelait (déjà !) l’Enfant mystérieux, seulement dix ans et lui aussi solitaire, dont il se disait lui-même l’Ami secret…
Et le frère aîné là-dedans ? Comme les autres, mais jamais pour les suivre sur la voie de la ressemblance la pire qui ne donne du galon qu’au Mesquin, ce démon de l’informe et de l’envie de rien.
Que tu les appelles De Mestral ou Mestral revient en somme au même, convient un passant neutre qui ne voit dans l’aristocratie que la part naturelle. Baptiste l’aîné, ingénieur des forêts, Pierre-Marie trop tôt disparu ou le prof de grec & latin regretté, auteur d’une grammaire oubliée avec l’enseignement éponyme – Mother on n’en parle même pas par surcroît de respect -, tous ils sont alignés aujourd’hui au cimetière de l’autre bout de la ville, mais les trois recueils parus du poète ont bel et bien quelque chose d’autre qu’on ne saurait dire… -
L'Ouvroir

Trésor de JLK (I)
«Toutes les religions passeront et cela restera : simplement être assis sur une chaise et regarder au loin. »(Vassily Rozanov, Esseulement)°°°« Nous vivons parmi des idées et des choses infiniment plus vieilles que nous ne pensons. Et en même temps, tout bouge ».(Teilhard de Chardin)°°°« Pourquoi y a-t-il quelque chose ici et non rien ? Et pourquoi cette question nous vient-elle à l’esprit – nous autres particules qui tournons indéfiniment autour de cette pierre noire ? Pourquoi nous vient-elle à l’esprit ? »(Annie Dillard)°°°« La mort des autres nous aide à vivre. »(Jules Renard)°°°« Quand l’homme se laisse aveugler par les choses, il se commet avec la poussière. Quand l’homme se laisse dominer par les choses, son cœur se trouble. »(Shitao)°°°« J’aime éperdument ce qui est schématique, aride, salin, perpendiculaire. »(Charles-Albert Cingria)°°°« Je pique indifféremment de petits faits, et je me suis habitué à leur morphine. »(Jules Renard)°°°« Est-ce possible que tous ceux qui passent par la rue mourront eux aussi ? Quelle horreur. »(Vassily Rozanov, Feuilles tombées)°°°Si je meurs à la poésie, c’est pour avoir vécu trop loin de moi-même(1967)°°°« J’avais vingt ans. Je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie. »(Paul Nizan)°°°«A good gook is a dead gook. »(Vietnam, 1967)°°°« Je vais moins à la vérité que je ne pars de la vérité. »(Nicolas Berdiaev)°°°« Aujourd’hui, n’est-ce pas, il faut être son propre grand-père. »(Vladimir Dimitrijevic, 1968)°°°« J’ai joué avec une coupe d’enfantEt découvert la grotte de l’azurEst-il possible que j’existe pour de bonEt que la mort me prendra vraiment ? »(Ossip Mandelstam)°°°En hiver, les jardins publics sont comme de vastes églises désaffectées.(1974)°°°« C’est cela, la vie. On travaille, on fait des livres, avec des tas de salutations à Pierre et à Paul. On attend la gloire, la fortune – et on claque en chemin. »(Paul Léautaud)°°°« Il est tellement laid qu’on dirait que la figure lui fait mal. »(L’abbé V., en 1974)°°°«Arrivée ce matin à Venise. Balade dans les venelles. Deux tableaux au musée Correr : une Pietà de Cosme Turra, de tour expressionniste, avec le diable dans l’arbre sous la forme d’un singe ; et Les courtisanes de Carpaccio, d’une beauté précieuse où me surprend, imperceptible sur les reproductions, la douceur mystérieuse des tons. De l’intérieur du musée, l’on entend un accordéon sur la place voisine.(1974, 3 mai)°°°« Laissez parler votre subconscient. »(Dimitri, en 1974)°°°Littérature romande : la fuite dans l’Ailleurs. Jaccottet, Roud et consorts : une poésie qui ne porte pas, ici et maintenant, à conséquence. Rose bleue selon Dürrenmatt…(1974)°°°« Ce qui se révolte en moi, c’est la langue elle-même, véhicule de ce que la vie recèle de plus révoltant. La langue se révolte contre ce contenu même. Elle persifle, grince et se secoue de dégoût. La vie et la langue s’empoignent impitoyablement et se disloquent peu à peu ; il ne restera, pour finir, qu’un mélange inarticulé, le véritable style de notre époque. »(Karl Kraus)°°°« Anna Akhmatova écrit des vers comme si un homme la regardait ; or il faut les écrire comme si Dieu nous regardait en transcendant la partie primitive de nous-même, la partie condamnable. Comme devant Dieu – en Sa présence. »(Alexandre Blok)°°°« On sent dans le chant des oiseaux le regret de la verdure . »(Charles-Albert Cingria)°°°« J’aime ceux qui ne savent vivre que pour disparaître : ce sont eux qui passent au-delà »(Nietzsche). -
Le bouvreuil d'Emily
 "Et je soupire faute de ciel - mais non pas / Le ciel qu'accordent les croyances" (Emily Dickinson)Fragile, opposant l’arme blanchede son sourire tranquille,au lieu d’aucune des revanchesqu’inspirent les désirs,la nuit venue il va parler,à l’insu des vivantsaux disparus des temps récents,dont le silence mêmelui est le plus ardent poème…Baudelaire ce soir est absent,trop princier dans le noir,mais deux yeux comme pris au cield’un pâle immatérielsemblent chercher l’ardent en toi,ou l’autre différent,voici le voyou des vocables,l’ami des écraseurs de poux,le dormeur éveillé –voilà le poète incarné:le Rimbe des illuminés…Aussi pour la mélancolieLeopardi parlaità la nuit que tu écoutais,et Verlaine au cœur le plus purà l’Américaine Emilyperdue dans la nature,parlait de leur petit bouvreuilau rebord des cercueils –douces âmes sans autre défenseque l’innocente transe…
"Et je soupire faute de ciel - mais non pas / Le ciel qu'accordent les croyances" (Emily Dickinson)Fragile, opposant l’arme blanchede son sourire tranquille,au lieu d’aucune des revanchesqu’inspirent les désirs,la nuit venue il va parler,à l’insu des vivantsaux disparus des temps récents,dont le silence mêmelui est le plus ardent poème…Baudelaire ce soir est absent,trop princier dans le noir,mais deux yeux comme pris au cield’un pâle immatérielsemblent chercher l’ardent en toi,ou l’autre différent,voici le voyou des vocables,l’ami des écraseurs de poux,le dormeur éveillé –voilà le poète incarné:le Rimbe des illuminés…Aussi pour la mélancolieLeopardi parlaità la nuit que tu écoutais,et Verlaine au cœur le plus purà l’Américaine Emilyperdue dans la nature,parlait de leur petit bouvreuilau rebord des cercueils –douces âmes sans autre défenseque l’innocente transe… -
Comme en rêvait le Capitaine
 « La grammaires est la base, le fondementde toutes les connaissances humaines ».(Frédéric Rimbaud, père d’Arthur,combattant en Crimée et traducteur du Coran)Je ne vous entends pas très biendans le grand bruit que fonttous vos influenceurs,où toute opinion les vaut toutes,où tout devient déroute,parodie de vaine sapienceou prétexte à haute palabredans la langue de marbre,je veux dire : la langue de boisau fil de sabrede l’imbécile impatienceindifférente aux vraies saveurs…La Machine saura très bienmimer cette grammaire,et moduler tout savoir-fairede l’ancienne parluresans faille ni rature,saura même le point-virgule,secret de la féruledes anciens maîtres littéraires,saura tout n’est-ce pas,sauf le devinez-quoi…Le père de Rimbaud parlait fort,mais rêvait en secretd’un fils lui sortant de la cuisseet parlant comme on dit: en langue,sans éviter l’harangueun peu vulgaire dans les troquets ;un vrai fils quoi, qui bande et pisseau ciel où Dieu raviqu’on Le fasse exister ainsine peut que tout bénirde ce chant et de son soupir…
« La grammaires est la base, le fondementde toutes les connaissances humaines ».(Frédéric Rimbaud, père d’Arthur,combattant en Crimée et traducteur du Coran)Je ne vous entends pas très biendans le grand bruit que fonttous vos influenceurs,où toute opinion les vaut toutes,où tout devient déroute,parodie de vaine sapienceou prétexte à haute palabredans la langue de marbre,je veux dire : la langue de boisau fil de sabrede l’imbécile impatienceindifférente aux vraies saveurs…La Machine saura très bienmimer cette grammaire,et moduler tout savoir-fairede l’ancienne parluresans faille ni rature,saura même le point-virgule,secret de la féruledes anciens maîtres littéraires,saura tout n’est-ce pas,sauf le devinez-quoi…Le père de Rimbaud parlait fort,mais rêvait en secretd’un fils lui sortant de la cuisseet parlant comme on dit: en langue,sans éviter l’harangueun peu vulgaire dans les troquets ;un vrai fils quoi, qui bande et pisseau ciel où Dieu raviqu’on Le fasse exister ainsine peut que tout bénirde ce chant et de son soupir… -
Comme une joie retrouvée
 « La joie exige toujours plus d’abandon,plus de courage que la douleur ». (Hugo von Hofmannstahl)Je suis en somme assez gentildit le Sage à L’Image,tantôt fusain tantôt fourmidans les instants d’éternité,et tantôt adagio ;voici que tu me dévisageset sonde nos présagesau plus pur de mes yeux ;voici le bilan de nos âges :nous serions tout ce que le venten sa confuse rage,n’a su défaire de nos vœux…L’enfant dessine dans son coin :le monde est relevépar son geste réitérantl’Entête en testament,le chaos n’est qu’une illusionà ses yeux innocents :il en sait plus long sur vos crimesque le dit la mémoire infirmede vos aveuglements,et son crayon sera joyeux…Tout au déni de l’euphorie,de la meute repues’agitant en mornes lubies,la plus heureuse compagnieretrouvée loin des troupespratique ses amours en groupeet vous pince le nez…Peinture: Jacques Pajak.
« La joie exige toujours plus d’abandon,plus de courage que la douleur ». (Hugo von Hofmannstahl)Je suis en somme assez gentildit le Sage à L’Image,tantôt fusain tantôt fourmidans les instants d’éternité,et tantôt adagio ;voici que tu me dévisageset sonde nos présagesau plus pur de mes yeux ;voici le bilan de nos âges :nous serions tout ce que le venten sa confuse rage,n’a su défaire de nos vœux…L’enfant dessine dans son coin :le monde est relevépar son geste réitérantl’Entête en testament,le chaos n’est qu’une illusionà ses yeux innocents :il en sait plus long sur vos crimesque le dit la mémoire infirmede vos aveuglements,et son crayon sera joyeux…Tout au déni de l’euphorie,de la meute repues’agitant en mornes lubies,la plus heureuse compagnieretrouvée loin des troupespratique ses amours en groupeet vous pince le nez…Peinture: Jacques Pajak. -
Le viol de l'ange
1
La Cité des Hespérides avait un air de décor de cinéma à l’abandon, ce matin-là, lorsque la porte du parking souterrain du Bloc A s’ouvrit en silence pour livrer passage à la Toyota Fan Cruiser 4x4 mauve fluo de Jo et Muriel Kepler.
Du poste habituel où le tenait l’insomnie, l’observateur avait suivi les faits et gestes des jeunes gens dès leur lever, excité comme à chaque fois par leur complète impudeur. Ainsi, tout en pianotant ses observations sur son Mac, avait-il vu Muriel apparaître nibards à l’air (c’est l’observateur qui qualifie de nibards les seins de Muriel), vaquer de la chambre à coucher à la cuisine où elle s’était activée à sa cadence ordinaire de battante, puis à la salle d’eau et jusque sur le balcon où elle surgit en string pour constater qu’il faisait un temps super comme annoncé le soir précédent à la météo de Natacha.
L’observateur avait concentré toute sa haine en assistant à ces préparatifs de bonheur standard que les Kepler, estimait-il, lui infligeaient comme une provocation personnelle. À ses yeux, le couple incarnait la vie facile et jouissive dont la fatalité l’avait lui-même rejeté. Quoique troublé à chaque fois qu’il les surprenait dans leur intimité, il les considérait comme des créatures vides, incapables de gestes imprévus. C’était en ricanant qu’il observait leur chair sportive dénudée quand ils se livraient, sur le même rythme, à la copulation du soir ou à l’aérobic du matin. Une brève enquête complémentaire lui avait permis de constater la banalité répétitive de leur existence. Jo était employé dans une agence de publicité et Muriel tenait le bar du fitness Hyperforme où son conjoint la rejoignait tous les midis pour leur séance principale de maintien. Le couple n’avait ni progéniture ni compagnie animale. Diverses indiscrétions, au snack du Centre Com, chez le coiffeur Danilo et auprès du concierge Cardoso, avaient appris à l’observateur que la Fan Cruiser n’était pas payée et qu’il y avait depuis quelque temps un problème entre Jo et Muriel, auxquels leur sexologue avait conseillé les soirées-détente du club d’échangistes Gold Beach sis au centre de la ville, juste au-dessus des bureaux de Maître Lefort, le fameux avocat d’affaires. Pour le reste, la vie des Kepler se déroulait en fonction de programmes assez strictement réglés où le fun compensait, pour Jo, le stress de l’agence. Une légère tendance à l’enveloppement le contraignait à se surveiller de très près s’il voulait conserver son look, mais Muriel avait de la ténacité pour deux et jamais elle n’eût toléré un doigt de graisse chez son partenaire – l’observateur avait compris depuis longtemps que c’était Muriel, dans le couple, qui jouait le rôle ascendant, comme il l’inscrivit avec tout le reste dans le fichier nominal des intéressés, à la lettre K du dossier Bloc A.
À l’instant où la 4x4 s’arrêta au sommet de la rampe d’accès au parking du Bloc A, le dernier bulletin de World Info annonçait la prise de l’enclave musulmane de Srebrenica par les Serbes, mais les Kepler, n’ayant pas encore branché leur poste, n’entendirent pas cette nouvelle qu’ils eussent d’ailleurs accueillie avec une ?probable indifférence. Pour lors, l’observateur se livrait à tout un jeu de prédictions tandis que Jo et Muriel, sortis de leur véhicule, procédaient là-bas aux ultimes vérifications d’avant le départ.
Ces cons-là vont remonter dans leur tire de frimeurs, songeait l’observateur, et le type va faire à sa typesse le fameux geste du pouce levé des cracks de séries policières, du style okay let’s go. Ensuite il va faire crisser ses pneus et foncer jusqu’à l’angle du Centre Com, après quoi j’ai plus qu’à fermer les yeux pour les voir.
Et de fait, les Kepler étaient remontés dans la Fan Cruiser, Jo avait fait crisser les pneus et foncé jusqu’à l’angle du Centre Com au-delà duquel, comme le prévoyait l’observateur, il couperait à travers la ville encore déserte jusqu’à la banlieue ouest où il rejoindrait l’autoroute du Sud.
Ensuite, figé dans la pénombre, l’observateur allait poursuivre quelque temps la Fan Cruiser en imagination tout en flairant les émanations de gazole montant de la cour arrière du Bloc A.
Or il les voyait comme s’il y était, tous deux vêtus du même survêtement et dégageant de capiteux effluves d’eau de toilette, aussi lisses et nets que des top models. Et précisément, feuilletant le dernier numéro de la revue Fantasme, Muriel venait de tomber sur l’image d’un couple enlacé dans la lumière émeraude d’une clairière de forêt tropicale, où l’imminence de la volupté se trouvait doublement exaltée par l’ambiance édénique du lieu et la formule de la pub évoquant Un Intense Sentiment de Liberté.
L’observateur avait imaginé que les Kepler accompliraient leur descente à la Grande Bleue en deux trois étapes de deux trois heures ponctuées de deux trois arrêts, et c’était en effet le plan de Jo et Muriel. En revanche, l’observateur avait mal interprété les propos qu’il avait surpris au snack du Centre Com, lorsque Muriel avait claironné, à la table voisine, que la perspective de s’éclater sur le sable du complexe naturiste la branchait complètement. De fait, ce n’était pas à la classique île du Levant que les Kepler se retrouveraient le même soir, mais en l’espace balnéaire d’Héliopolis, au cap d’Agde.
Quoi qu’il en fût, les prévisions de l’observateur concernant les Kepler valaient dans les grandes lignes, logiquement déduites des inscriptions qu’il avait sériées depuis leur installation au septième étage du Bloc A, quelques mois auparavant. Vingt jours durant, les Kepler allaient se consacrer principalement au bronzage intégral en alternant, pour maintenir leur superforme, les séances d’aérobic et les virées en VTT de location sur les routes de l’arrière-pays. Comme le prévoyait l’observateur, ils baiseraient deux trois fois par jour en s’efforçant de solutionner leur problème, liraient deux trois magazines et sortiraient en boîte deux trois fois par semaine. En aucun cas ils ne se diraient quoi que ce soit d’important, pensait l’observateur, et peut-être avait-il raison ? En aucun cas ils ne s’occuperaient d’autre chose que de leur corps et des objets attenant à leurs aises, avait-il également supputé, non sans justesse. Les Kepler estimaient de leur côté que rien ne pouvait leur arriver, et l’observateur considérait lui aussi qu’à de telles gens, dont le fonctionnement évoque celui de machines, la destinée ne saurait faire le cadeau du moindre imprévu. Or il devait, très vite, en aller tout autrement.
Cependant, après que le mur d’angle du Centre Com des Hespérides eut escamoté la Fan Cruiser mauve fluo des Kepler, l’observateur désactiva leur fichier sur l’écran de son Mac et revint au plan d’ensemble des blocs A à C où divers mouvements se manifestaient depuis quelques instants.
Hypertexte. – À l’apparente quiétude de cette splendide matinée d’été se mêlait déjà, pourtant, le sentiment d’un indéfinissable malaise. À quoi cela tenait-il ? C’était pour ainsi dire dans l’air. Peut-être même cela oblitérait-il la lumière ? La netteté particulière des choses, ce matin-là, n’avait pas empêché Muriel Kepler de ressentir la même vague sensation d’être engagée dans une impasse qui oppressait des millions de gens, notamment dans l’ensemble des sociétés tenues pour les plus évoluées. Mais quel sens tout cela diable avait-il ? Une vie vouée au shopping méritait-elle encore d’être vécue ? Dans le cas précis de la Cité des Hespérides, l’architecture même semblait distiller une espèce de torpeur qu’on retrouvait à vrai dire dans toutes les zones de périphérie urbaine. L’impression que les blocs d’habitation qu’il y avait là et que les parkings qu’il y avait là, que les espaces verts qu’il y avait là et que les containers de déchets qu’il y avait là se multipliaient en progression exponentielle sur les cinq continents aboutissait, pour qui en prenait effectivement conscience, à une sorte d’accablement proche de la désespérance que seuls des programmes en tout genre paraissaient en mesure de pallier. Ainsi l’aérobic et la diététique, les thérapies de toutes espèces et la créativité multiforme entretenaient-ils l’illusion d’une activité positive quoique périphérique elle aussi. Or tout devenait périphérique à cette époque. Dans le mouvement s’étaient perdus la notion de centre et jusqu’au sentiment d’appartenance à telle communauté privée ou publique. L’impression dominante que tout était désormais possible se diluait en outre dans une sensation générale d’inassouvissement qui exacerbait le besoin de se distraire ou plus précisément, ce jour-là, le désir de se retrouver sur n’importe quelle plage à ne plus penser à rien. Cependant une femme souffrait réellement, à l’instant précis, dans l’habitacle d’un véhicule lancé à vive allure à destination des simulacres de félicité – Muriel Kepler retenait un cri.
-
Rebond de la prairie
 (Comme un salut matinal)L’indien me rejoint dans l’horloge:le vivant pendulaireaux intuitions de broussea encore des choses à me direen intenses secousses.Une boussole nous manquaità tous deux ce matind’aube neuve au lancer du chemin.Je le vois revenant d’Afrique,mon Sénégalais à sagaies de sagesse,aux yeux tendres de Népalais,aux manières exquisesd’Inuit stylé sur sa banquise...Je l’attendais sur ma poutrelle,là-haut d’où je vous vois tousà toutes vos affaires,en sensibles ribambelles vues de la stratosphère,tellement émouvants, mes vivants,à piétiner les serresoù songent les dormants.Je savais qu’il me viendrait ce matin d’hiver où tout semble exclu,mais l’horloge attendaitce retour de rivière.Et le voici que je salue...
(Comme un salut matinal)L’indien me rejoint dans l’horloge:le vivant pendulaireaux intuitions de broussea encore des choses à me direen intenses secousses.Une boussole nous manquaità tous deux ce matind’aube neuve au lancer du chemin.Je le vois revenant d’Afrique,mon Sénégalais à sagaies de sagesse,aux yeux tendres de Népalais,aux manières exquisesd’Inuit stylé sur sa banquise...Je l’attendais sur ma poutrelle,là-haut d’où je vous vois tousà toutes vos affaires,en sensibles ribambelles vues de la stratosphère,tellement émouvants, mes vivants,à piétiner les serresoù songent les dormants.Je savais qu’il me viendrait ce matin d’hiver où tout semble exclu,mais l’horloge attendaitce retour de rivière.Et le voici que je salue... -
Notre père qui est aux cieux

Notre cher père (1915-1983) aurait fêté aujourd’hu ses 110 ans, digne d’être cité à l’ordre mondial du Transhumanisme, mais en aurait-il demandé autant ? J’en doute. Car il n’était pas du genre champion. Plutôt la crème des bons types, peu porté à la révolte (il s’est efforcé de tempérer mes élans en mai 68) et à l’insoumission, avec les préjugés marqués de sa génération et de sa classe d’Helvète moyen (Arabe et Juifs assimilés à des nez crochus, et Levantins trop lustrés à des macaques) , mais pas idéologue ni vindicatif à aucun égard et jamais amorti après sa retraite des assurances où il finit inspecteur à son dam (les chicanes lui faisant horreur), vivant plutôt heureux en ses dernipres années malgré son crabe à multiples rémissions et rechutes, cultivant son jardin au propre et de façons diverses entre le tissage et la peinture florale sur porcelaine, les voyages avec sa moiti et les petits enfants. À l’opposé du bohème irrégulier que je suis, c’était un régulier cravaté de tous les matins sauf aux jours d’été où les bras de chemise étaient de mise, etc.
-
Ajouter de la vie aux jours...
 Ce samedi 10 janvier.– Le souffle à la peine, et le cœur à l’avenant, j’essaye ce matin gris, ce matin de chagrin persistant par delà ou en deça du grand deuil de nos frères humains, de me relever en lisant De la poésie d’Ossip Mandelstam, poète assassiné qui a dit ce qu’il fallait dire de ladite poésie, à savoir qu’on n’en sait rien...Hier, une belle jeune fille, entre deux camarades aussi beaux et dignes qu’elle, sans une larme en face de l'immense foule recueillie, et devant tous le pays aux écrans, a dit quelques mots qui nous ont laissé sans voix, justement inspirés par les mots de la poésie la plus simple: "On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours », a-t-elle dit, et je pense maintenant à l’énorme défi lancé au désespoir par ces trois jeunes gens au nom des disparus et des vivants de leur âge, mais aussi de nous tous, et voici que des mots me viennent comme à tâtons qui sont mon propre défi aux jours qui viennent :On ne sait pas à quoi ça rimeon ne voit que des mots,on se croit protégé du crime,de garder les yeux clos…La poésie de par le temps,se retrouve au présent,disant partout comme un défi,ce qu'elle sait de la vie...Je sais, moi, que je ne sais rien,qu’elle soit celle qu’on disaitque tous ont oublié,ou qu’elle soit ce qu’elle sera...°°°Une caricature abjecte, relative à la tragédie du 1er janvier, montre à quel niveau de bassesse et de cynisme grossier la rédaction de Charlie Hebdo s'est abaissée désormais, qui fait insulte à la mémoire des bons garçons qu'étaient Cabu et sa tribu. On ne souhaitera pas à ces imbéciles de se faire massacrer à leur tour, mais quelle triste façon de ricaner…
Ce samedi 10 janvier.– Le souffle à la peine, et le cœur à l’avenant, j’essaye ce matin gris, ce matin de chagrin persistant par delà ou en deça du grand deuil de nos frères humains, de me relever en lisant De la poésie d’Ossip Mandelstam, poète assassiné qui a dit ce qu’il fallait dire de ladite poésie, à savoir qu’on n’en sait rien...Hier, une belle jeune fille, entre deux camarades aussi beaux et dignes qu’elle, sans une larme en face de l'immense foule recueillie, et devant tous le pays aux écrans, a dit quelques mots qui nous ont laissé sans voix, justement inspirés par les mots de la poésie la plus simple: "On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours », a-t-elle dit, et je pense maintenant à l’énorme défi lancé au désespoir par ces trois jeunes gens au nom des disparus et des vivants de leur âge, mais aussi de nous tous, et voici que des mots me viennent comme à tâtons qui sont mon propre défi aux jours qui viennent :On ne sait pas à quoi ça rimeon ne voit que des mots,on se croit protégé du crime,de garder les yeux clos…La poésie de par le temps,se retrouve au présent,disant partout comme un défi,ce qu'elle sait de la vie...Je sais, moi, que je ne sais rien,qu’elle soit celle qu’on disaitque tous ont oublié,ou qu’elle soit ce qu’elle sera...°°°Une caricature abjecte, relative à la tragédie du 1er janvier, montre à quel niveau de bassesse et de cynisme grossier la rédaction de Charlie Hebdo s'est abaissée désormais, qui fait insulte à la mémoire des bons garçons qu'étaient Cabu et sa tribu. On ne souhaitera pas à ces imbéciles de se faire massacrer à leur tour, mais quelle triste façon de ricaner… -
La Tragédie du Nouvel-An, du désespoir à la colère
 De l'indicible émotion partagée aux questions qui fâchent, le drame affreux survenu à Crans-Montana a montré le meilleur et le pire : de l’héroïsme, côté sauveteurs, et de la compassion collective sincère d’une part, mais aussi des failles du « trop humain»...Le grand ciel bleu pur du 1er de l’an 2026 se déployait à vos fenêtres à l’enseigne de ce qu’on peut dire le Chant du monde, quand les premiers échos de l’Horreur pure vous sont parvenus par les médias et les réseaux affolés, vous rappelant soudain l’évidence du Poids du monde. Bilan immédiatement communiqué : 40 morts, dont vingt mineurs, brûlés vifs dans un incendie fulgurant, et plus de 100 blessés, dont 80 grands brûlés…Dès le premier jour, la Douleur partagée fut incommensurable. Même inimaginables pour la plupart d’entre nous, les scènes vécues et parfois filmées, cette nuit-là, dans le piège de feu, nous ont permis de visualiser l’horreur. Or à l’horreur pure se sont bientôt mêlé les éléments impurs de la rumeur faisant état de manquements scandaleux, et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignoraient encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on était encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée, et le pur et l’impur se sont confondus au fil des jours, mêlant la compassion et de douteuses curiosités comme toujours à l’entour des scènes d’accidents ou de crimes, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion, aussi, des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ? Celui-ci relevait-il de la fatalité, ou le pire aurait-il pu être évité ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les fraudes particulières, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ? Ainsi la part d’ombre de l’humain s’est-elle révélée en même temps qu’on découvrait les récits bouleversants des sauveteurs et des jeunes survivants dont certains auront risqué leur vie pour aider leurs camarades.Quant aux « questions qui fâchent » liées aux raisons objectives, immédiatement citées ou esquivées par les uns et les autres, elles n’ont rien d’indécent et vont même devenir le cœur du débat à venir « à l’international », au dam de la république locale des petits copains, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.Autre exemple de la double face – ombre et lumière - du réel : l’on a beau répéter que les médias et les réseaux sociaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, vous aurez constaté que c’est bel et bien par maints internautes lucides et avisés, et autant de journalistes respectueux de l’éthique, qu’ont été posées, et alimentées, lesdites « questions qui fâchent »Ainsi le quotidien 24 Heures aura-il consacré à la tragédie, dès le 3 janvier, un dossier de six pages solidement documenté faisant état de manquements significatifs, voire scandaleux, dans la sécurité du bar incendié, entre autres lieux festifs « problématiques ».« À l’évidence, écrit ainsi notre consoeur Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescents les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie générales. »Dans la foulée, l’on se gardera de tout jugement précipité. Mais au chapitre de la précipitation, que dire de cette commune de Crans-Montana qui s’empresse, sur le conseil d’une boîte de conseil marketing zurichois, de se poser en victime en tentant de se porter partie civile, alors que ses responsabilités sont engagées à l’évidence dans le (non)contrôle du bar en question ?Comme le relève très justement (sur Facebook) une habitante de Crans-Montana, du nom de Véronique Madeleine Colagioia-Wisard, « on ne dirige pas une commune à voix basse et portes fermées. Si la présidence n’assume pas la parole publique quand tout brûle, alors elle n’assume pas la fonction, elle en occupe seulement le titre ». Les uns s'empressent d'effacer toute trace, comme s’y est employé le tenancier au passé crapuleux en « épurant » son compte Facebook, les autres se dédouanent à bas bruit, tel politicard genevois suggère que c'est pire à Gaza, tel autre se désole du « déficit d’image » dont va souffrir notre pays au-dessus de tout soupçon. Autant d'insultes aux victimes brûlées vives et à leurs proches...Quand il importe de « rester juste »Les premiers corps des victimes étant rendus aux parents, vous vous figurez l’horreur. Vous pensez à ceux qui restent dans l’attente, vous vous identifiez à eux, et vous vous taisez. Vous pourriez le crier, mais vous vous taisez. Vous restez sans voix. Il y a quatre jours déjà que d’innombrables voix crient en vous, et c’est la première fois que vous souffrez pour autant d’inconnus, vous les entendez comme si chacun était l’un de vos enfants, et de constater que des centaines, des milliers de gens ressentent la même chose que vous n’y change rien: c’est une affaire d’intimité partagée que ce drame atroce qui vous fait vous identifier aux victimes et aux amis des victimes, aux parents de victimes et à tous ceux qui comme vous s’identifient à ceux-là parce qu’ils ont des enfants et sûrement la même peur du feu ; vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas vu que vos enfants y ont échappé, mais vous n’y pensez même pas, à vrai dire il n’y a rien à penser à ce moment-là mais juste à ressentir, sur quoi vous avez constaté que votre ressenti l’avait été par des centaines et des milliers de gens qui, comme vous, auront trouvé quelque chose de révoltant dans les irrégularités avérées, vous voyez maintenant enfler une rumeur de condamnation et de vengeance, mais vous vous dites, une fois de plus et comme toujours, que justice n’est pas vengeance, sur quoi la vision de foules réellement solidaires se recueillant dans les chapelles et par les rues, dont vous ne doutez pas de la sincérité, l’évidente dignité des braves gens opposée au déni des responsabilités, vous aura conforté dans votre position de frère humain, entre ombres et lumière, juste résolu à « rester juste » en attendant que justice agisse dignement, si tant est que...
De l'indicible émotion partagée aux questions qui fâchent, le drame affreux survenu à Crans-Montana a montré le meilleur et le pire : de l’héroïsme, côté sauveteurs, et de la compassion collective sincère d’une part, mais aussi des failles du « trop humain»...Le grand ciel bleu pur du 1er de l’an 2026 se déployait à vos fenêtres à l’enseigne de ce qu’on peut dire le Chant du monde, quand les premiers échos de l’Horreur pure vous sont parvenus par les médias et les réseaux affolés, vous rappelant soudain l’évidence du Poids du monde. Bilan immédiatement communiqué : 40 morts, dont vingt mineurs, brûlés vifs dans un incendie fulgurant, et plus de 100 blessés, dont 80 grands brûlés…Dès le premier jour, la Douleur partagée fut incommensurable. Même inimaginables pour la plupart d’entre nous, les scènes vécues et parfois filmées, cette nuit-là, dans le piège de feu, nous ont permis de visualiser l’horreur. Or à l’horreur pure se sont bientôt mêlé les éléments impurs de la rumeur faisant état de manquements scandaleux, et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignoraient encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on était encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée, et le pur et l’impur se sont confondus au fil des jours, mêlant la compassion et de douteuses curiosités comme toujours à l’entour des scènes d’accidents ou de crimes, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion, aussi, des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ? Celui-ci relevait-il de la fatalité, ou le pire aurait-il pu être évité ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les fraudes particulières, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ? Ainsi la part d’ombre de l’humain s’est-elle révélée en même temps qu’on découvrait les récits bouleversants des sauveteurs et des jeunes survivants dont certains auront risqué leur vie pour aider leurs camarades.Quant aux « questions qui fâchent » liées aux raisons objectives, immédiatement citées ou esquivées par les uns et les autres, elles n’ont rien d’indécent et vont même devenir le cœur du débat à venir « à l’international », au dam de la république locale des petits copains, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.Autre exemple de la double face – ombre et lumière - du réel : l’on a beau répéter que les médias et les réseaux sociaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, vous aurez constaté que c’est bel et bien par maints internautes lucides et avisés, et autant de journalistes respectueux de l’éthique, qu’ont été posées, et alimentées, lesdites « questions qui fâchent »Ainsi le quotidien 24 Heures aura-il consacré à la tragédie, dès le 3 janvier, un dossier de six pages solidement documenté faisant état de manquements significatifs, voire scandaleux, dans la sécurité du bar incendié, entre autres lieux festifs « problématiques ».« À l’évidence, écrit ainsi notre consoeur Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescents les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie générales. »Dans la foulée, l’on se gardera de tout jugement précipité. Mais au chapitre de la précipitation, que dire de cette commune de Crans-Montana qui s’empresse, sur le conseil d’une boîte de conseil marketing zurichois, de se poser en victime en tentant de se porter partie civile, alors que ses responsabilités sont engagées à l’évidence dans le (non)contrôle du bar en question ?Comme le relève très justement (sur Facebook) une habitante de Crans-Montana, du nom de Véronique Madeleine Colagioia-Wisard, « on ne dirige pas une commune à voix basse et portes fermées. Si la présidence n’assume pas la parole publique quand tout brûle, alors elle n’assume pas la fonction, elle en occupe seulement le titre ». Les uns s'empressent d'effacer toute trace, comme s’y est employé le tenancier au passé crapuleux en « épurant » son compte Facebook, les autres se dédouanent à bas bruit, tel politicard genevois suggère que c'est pire à Gaza, tel autre se désole du « déficit d’image » dont va souffrir notre pays au-dessus de tout soupçon. Autant d'insultes aux victimes brûlées vives et à leurs proches...Quand il importe de « rester juste »Les premiers corps des victimes étant rendus aux parents, vous vous figurez l’horreur. Vous pensez à ceux qui restent dans l’attente, vous vous identifiez à eux, et vous vous taisez. Vous pourriez le crier, mais vous vous taisez. Vous restez sans voix. Il y a quatre jours déjà que d’innombrables voix crient en vous, et c’est la première fois que vous souffrez pour autant d’inconnus, vous les entendez comme si chacun était l’un de vos enfants, et de constater que des centaines, des milliers de gens ressentent la même chose que vous n’y change rien: c’est une affaire d’intimité partagée que ce drame atroce qui vous fait vous identifier aux victimes et aux amis des victimes, aux parents de victimes et à tous ceux qui comme vous s’identifient à ceux-là parce qu’ils ont des enfants et sûrement la même peur du feu ; vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas vu que vos enfants y ont échappé, mais vous n’y pensez même pas, à vrai dire il n’y a rien à penser à ce moment-là mais juste à ressentir, sur quoi vous avez constaté que votre ressenti l’avait été par des centaines et des milliers de gens qui, comme vous, auront trouvé quelque chose de révoltant dans les irrégularités avérées, vous voyez maintenant enfler une rumeur de condamnation et de vengeance, mais vous vous dites, une fois de plus et comme toujours, que justice n’est pas vengeance, sur quoi la vision de foules réellement solidaires se recueillant dans les chapelles et par les rues, dont vous ne doutez pas de la sincérité, l’évidente dignité des braves gens opposée au déni des responsabilités, vous aura conforté dans votre position de frère humain, entre ombres et lumière, juste résolu à « rester juste » en attendant que justice agisse dignement, si tant est que... -
Après le feu
(Aux martyrs du 1er janvier)La tristesse les a saisis,tous et tant qu’ils étaient,ceux-là qu’on savait familiers,et soudain, rassemblés,tous les vivants soudain muetsdevant les cendres d’après le feu,les cendres désormaissans visages et sans noms -les cendres enfants du néant …Le chagrin n’est pas convié:il remonte tout seul,tout à coup le voiciqui les étreint tous au même seuil:on leur a rendu les enfants … -
Ô désespoir ! Ô rage !
 De l'indicible émotion aux questions qui fâchent...Au troisième jour la Douleur reste incommensurable, pour la plupart d’entre nous les scènes vécues cette nuit-là dans le piège de feu demeurent inimaginables malgré les atroces bribes de séquences vidéo commençant de se répandre par les médias et les réseaux.Or justement à l’horreur pure se mêlent à présent les éléments impurs de la rumeur et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignorent encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on est encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée et le pur et l’impur se confondent déjà, déjà se mêlent la compassion et sûrement d’abjectes curiosités comme toujours à l’entour des scènes de crime ou de guerre, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les arnaques particulières et le blanchiment en tout genre, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ?Le désespoir va-t-il bientôt engendrer la rage ? C’est plus que probable, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.L’on a beau savoir que les médias et les réseaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, nous voyons ce matin que c’est bel et bien par les réseaux et les médias aussi que les contrefeux s’y manifestent par une juste rage.Ainsi le quotidien 24 Heures consacre-t-il ce matin six pages à la tragédie du Nouvel An, avec cet édito de Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, auquel chacune et chacun ne peuvent que souscrire :L’éditorialCrans-Montana et maintenant ?Par Virginie LenkUn plafond en feu et des jeunes qui filment les flammes en dansant. Ces images du début de l’incendie du bar Le constellation sont tragiques. Tragiques dans l’insouciance de ces jeunes gens pleins de vie qui ne se rendent pas encore compte que l’horreur est en marche. Elle rattrape chaque parent, qui voit dans ces visages celui de leur propre enfant.Combien de fois, ai-je entendu au lendemain du drame, dans les rues de la station, cette phrase terrible : « ç’aurait pu être nous » ?Ça n’aurait dû être personne, et à l’injustice du sort se mêle aujourd’hui notre colère. L’établissement en question était clairement problématique. Les témoignages sur place le montrent et notre enquête. Sans préjuger, car la justice doit avoir tout le temps nécessaire pour lever le moindre doute.Les responsables devront répondre de ces manquements. La question se pose pour d’autres lieux similaires. À l’évidence, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescent les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie général.Mes enfants, vos enfants auraient pu faire la fête au Constellation. Ils retourneront la boule au ventre dans un bar bondé. Et puis, avec le temps, ils oublieront. C’est leur force. La nôtre est de ne pas laisser une telle tragédie se reproduire.(Cf l’édition de 24 Heures du samedi 3 janvier 2026)
De l'indicible émotion aux questions qui fâchent...Au troisième jour la Douleur reste incommensurable, pour la plupart d’entre nous les scènes vécues cette nuit-là dans le piège de feu demeurent inimaginables malgré les atroces bribes de séquences vidéo commençant de se répandre par les médias et les réseaux.Or justement à l’horreur pure se mêlent à présent les éléments impurs de la rumeur et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignorent encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on est encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée et le pur et l’impur se confondent déjà, déjà se mêlent la compassion et sûrement d’abjectes curiosités comme toujours à l’entour des scènes de crime ou de guerre, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les arnaques particulières et le blanchiment en tout genre, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ?Le désespoir va-t-il bientôt engendrer la rage ? C’est plus que probable, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.L’on a beau savoir que les médias et les réseaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, nous voyons ce matin que c’est bel et bien par les réseaux et les médias aussi que les contrefeux s’y manifestent par une juste rage.Ainsi le quotidien 24 Heures consacre-t-il ce matin six pages à la tragédie du Nouvel An, avec cet édito de Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, auquel chacune et chacun ne peuvent que souscrire :L’éditorialCrans-Montana et maintenant ?Par Virginie LenkUn plafond en feu et des jeunes qui filment les flammes en dansant. Ces images du début de l’incendie du bar Le constellation sont tragiques. Tragiques dans l’insouciance de ces jeunes gens pleins de vie qui ne se rendent pas encore compte que l’horreur est en marche. Elle rattrape chaque parent, qui voit dans ces visages celui de leur propre enfant.Combien de fois, ai-je entendu au lendemain du drame, dans les rues de la station, cette phrase terrible : « ç’aurait pu être nous » ?Ça n’aurait dû être personne, et à l’injustice du sort se mêle aujourd’hui notre colère. L’établissement en question était clairement problématique. Les témoignages sur place le montrent et notre enquête. Sans préjuger, car la justice doit avoir tout le temps nécessaire pour lever le moindre doute.Les responsables devront répondre de ces manquements. La question se pose pour d’autres lieux similaires. À l’évidence, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescent les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie général.Mes enfants, vos enfants auraient pu faire la fête au Constellation. Ils retourneront la boule au ventre dans un bar bondé. Et puis, avec le temps, ils oublieront. C’est leur force. La nôtre est de ne pas laisser une telle tragédie se reproduire.(Cf l’édition de 24 Heures du samedi 3 janvier 2026) -
Sorrow
 « Cet étrange chagrin... »(V.S. Naipaul)On ne sait pas à quoi ça tient:tout à coup cela vientde tout au fond de soi;cela te prend comme à l’amour,te saisit et te briseen vague noire de surprise,et vous qui êtes forts,sans peur aucune et sans remords:gare à vous que ce cloudemain vous crucifie debout...Ce n’est parfois qu’un petit chatqui meurt soudain comme çasans la moindre explication;cela ne se fait pas !lui reproche l’enfant déçuavant de lancer vers le ciel:ah mais sabre de bois !le chat n’est-il pas éternel ?Ou c’est une mère qui s’en va ...Où va la mer aux yeux fermésquand elle est triste au soiret se retire dans les ombresdu vert devenu noir ?Or la voici répondre:elle descend au plus profondde ses noires colèressans rimes ni raisonspour écouter au tréfonds d’ellele chant tout lancinantdes naufragés qui se rappellentau souvenir dolentdes eaux dormantes sous le ciel...Peinture: Louis Soutter
« Cet étrange chagrin... »(V.S. Naipaul)On ne sait pas à quoi ça tient:tout à coup cela vientde tout au fond de soi;cela te prend comme à l’amour,te saisit et te briseen vague noire de surprise,et vous qui êtes forts,sans peur aucune et sans remords:gare à vous que ce cloudemain vous crucifie debout...Ce n’est parfois qu’un petit chatqui meurt soudain comme çasans la moindre explication;cela ne se fait pas !lui reproche l’enfant déçuavant de lancer vers le ciel:ah mais sabre de bois !le chat n’est-il pas éternel ?Ou c’est une mère qui s’en va ...Où va la mer aux yeux fermésquand elle est triste au soiret se retire dans les ombresdu vert devenu noir ?Or la voici répondre:elle descend au plus profondde ses noires colèressans rimes ni raisonspour écouter au tréfonds d’ellele chant tout lancinantdes naufragés qui se rappellentau souvenir dolentdes eaux dormantes sous le ciel...Peinture: Louis Soutter -
Que des larmes
 Le fil invisible (105)Je ne l’ai pas dit à l’AB, hier, à notre téléphone de plus d’une heure suivant une interruption de plus d’une année – j’évitais de l’appeler imaginant qu’il désirait qu’on lui foute la paix, comme son ami Jaccottet à la toute fin -, je ne lui ai pas dit que j’avais pleuré comme un malade, mais j’ai bien senti que lui aussi, déjà au courant, avait été bouleversé par la nouvelle atroce de ce premier de l’an au grand ciel menteur…Le ciel grand ouvert de ce matin, au-dessus des forêts encore givrées et des derniers relents de brume au-dessus du lac aux eaux blanc pâle - le ciel de ce 1er janvier 2026 était comme une invite et une promesse, m’étais-je dit au balcon de la Désirade, mais déjà la nouvelle infectait les réseaux, et tout à coup la grande voile du ciel s’affale : je tombe sur les premiers mots annonçant que la fête de la nuit dernière s’est achevée pas loin de chez nous dans les flammes et le chaos de jeunes corps calcinés au milieu des hurlements, et je n’ai pas besoin de voir les premières vidéos de ce carnage : je le vois en moi comme si ça me cramait dans le crémol, comme deux ou trois fois dans ma pauvre mémoire - la mort de Tybalt dans les séracs du Dolent, la mort annoncée de Lady L. frappée en plein coeur par la vie salope ; et maintenant pas besoin de pousser jusqu’à Sabra et Chatila ou au 7 octobre d’il y a deux ans de ça: c’était juste là, à moins de cent bornes d’où je m’extasiais devant le ciel céleste, au bar Le Cosmos de la chic station de glisse, en moins de temps qu’il n'en faut pour se passer une vieille scie genre The Wall de Pink Floyd, un départ d’étincelles et le feu avait tout ravagé dans le piège du local aux étroites largeurs étagées, quasi la quarantaine de morts et plus que la centaine de grands brûlés - donc là moi vieux sanglier en bout de course je me mets à chialer comme à sept ans devant mon chien Plume écrasé par un monstre à mâchoire d’Opel Rekord, mais gaffe de n’en rien dire à l’AB qui me demande comme ça, après tant de temps, comment va son jeune ami alors que lui va sur sa nonante-troisième année en boitant bas, mais j’entame justement la réponse en lui lançant comme ça que mon actuel souci est de me conformer à l’onzième commandement selon sa Loi à lui : TU NE TOMBERAS POINT, donc je ne lui épargne rien de mes faiblesses de chevilles et de rotules, de mon souffle essoufflé, de ma débilité fémorale (malgré les stents installés) et de tout l’appareil cardio-jambaire, vraiment l’âge de nos artères alors que le mental rutile et que je reste aussi vif d’esprit qu’à dix sept ans sous les tilleuls et la sensibilité à fleur de cœur – d’où ces larmes de tout à l’heure dont je ne lui dis rien car un prélat reste un prélat nom de Dieu…Quoique tu y puisses, il y aura toujours une gêne quand tu demanderas à un abbé même rangé des messes comment il va, et l’AB ne déroge pas: il fait comme s’il était déjà de l’autre côté, sans problèmes de femme de ménage et tout le tralala cuisinier – justement sa sœur va passer tout à l’heure l’aider au frichti - , et quand tu lui racontes ta visite à la paroissienne irlandaise qui cherche à te rapprocher des clergés, il s’esclaffe : elle a tout compris, avec vous s’entend, et ce que vous me dites de ses accointances avec mon vieil ami l’abbé Z. ça aussi explique : elle aussi a déjà fait le pas...Et là tu lui dis que tu en es au déchiffrement du XXVe Canto du Purgatoire de Dante où il est question de la transmutation du fiel sexuel en miel immatériel, et tout est dit, sauf que les larmes n’en finiront pas de couler où les mortels n’en finissent pas de vivre, etc.Peinture: Bérard.
Le fil invisible (105)Je ne l’ai pas dit à l’AB, hier, à notre téléphone de plus d’une heure suivant une interruption de plus d’une année – j’évitais de l’appeler imaginant qu’il désirait qu’on lui foute la paix, comme son ami Jaccottet à la toute fin -, je ne lui ai pas dit que j’avais pleuré comme un malade, mais j’ai bien senti que lui aussi, déjà au courant, avait été bouleversé par la nouvelle atroce de ce premier de l’an au grand ciel menteur…Le ciel grand ouvert de ce matin, au-dessus des forêts encore givrées et des derniers relents de brume au-dessus du lac aux eaux blanc pâle - le ciel de ce 1er janvier 2026 était comme une invite et une promesse, m’étais-je dit au balcon de la Désirade, mais déjà la nouvelle infectait les réseaux, et tout à coup la grande voile du ciel s’affale : je tombe sur les premiers mots annonçant que la fête de la nuit dernière s’est achevée pas loin de chez nous dans les flammes et le chaos de jeunes corps calcinés au milieu des hurlements, et je n’ai pas besoin de voir les premières vidéos de ce carnage : je le vois en moi comme si ça me cramait dans le crémol, comme deux ou trois fois dans ma pauvre mémoire - la mort de Tybalt dans les séracs du Dolent, la mort annoncée de Lady L. frappée en plein coeur par la vie salope ; et maintenant pas besoin de pousser jusqu’à Sabra et Chatila ou au 7 octobre d’il y a deux ans de ça: c’était juste là, à moins de cent bornes d’où je m’extasiais devant le ciel céleste, au bar Le Cosmos de la chic station de glisse, en moins de temps qu’il n'en faut pour se passer une vieille scie genre The Wall de Pink Floyd, un départ d’étincelles et le feu avait tout ravagé dans le piège du local aux étroites largeurs étagées, quasi la quarantaine de morts et plus que la centaine de grands brûlés - donc là moi vieux sanglier en bout de course je me mets à chialer comme à sept ans devant mon chien Plume écrasé par un monstre à mâchoire d’Opel Rekord, mais gaffe de n’en rien dire à l’AB qui me demande comme ça, après tant de temps, comment va son jeune ami alors que lui va sur sa nonante-troisième année en boitant bas, mais j’entame justement la réponse en lui lançant comme ça que mon actuel souci est de me conformer à l’onzième commandement selon sa Loi à lui : TU NE TOMBERAS POINT, donc je ne lui épargne rien de mes faiblesses de chevilles et de rotules, de mon souffle essoufflé, de ma débilité fémorale (malgré les stents installés) et de tout l’appareil cardio-jambaire, vraiment l’âge de nos artères alors que le mental rutile et que je reste aussi vif d’esprit qu’à dix sept ans sous les tilleuls et la sensibilité à fleur de cœur – d’où ces larmes de tout à l’heure dont je ne lui dis rien car un prélat reste un prélat nom de Dieu…Quoique tu y puisses, il y aura toujours une gêne quand tu demanderas à un abbé même rangé des messes comment il va, et l’AB ne déroge pas: il fait comme s’il était déjà de l’autre côté, sans problèmes de femme de ménage et tout le tralala cuisinier – justement sa sœur va passer tout à l’heure l’aider au frichti - , et quand tu lui racontes ta visite à la paroissienne irlandaise qui cherche à te rapprocher des clergés, il s’esclaffe : elle a tout compris, avec vous s’entend, et ce que vous me dites de ses accointances avec mon vieil ami l’abbé Z. ça aussi explique : elle aussi a déjà fait le pas...Et là tu lui dis que tu en es au déchiffrement du XXVe Canto du Purgatoire de Dante où il est question de la transmutation du fiel sexuel en miel immatériel, et tout est dit, sauf que les larmes n’en finiront pas de couler où les mortels n’en finissent pas de vivre, etc.Peinture: Bérard. -
Que des larmes et de la compassion devant l'Horreur...

-
Comme en nos beaux jardins
(Dans la lumière de Bonnard)Nos vieilles peaux reposerontau fond du beau jardin,nous vous surveillerons d’un œil,nous serons vos gardiens,désarmés, sur le seuil ;nous ne vous retiendrons point:jamais, dans vos passions,vouées aux fumées qu’on sait,nous ne mettrons l’épée:nous serons de votre secretles alliés discrets,toujours à la plus vive écouteen vous de ce qui doute…Tu m’es plus intime qu’à moidit à Dieu le garçondont la foi est un palefroi;mon fils est médiéval,dit son père jouant l’amiralsur son cheval imaginaire,nous aimons Dieu le Pèreet son épouse jardinière,nous aimons Proust et les sirèneset la douce Chimène…Les Choses étant ce qu’elles sont là,et le Temps qui s’en vavont de pair entre les jardinsqui nous ouvrent les bras ;ce sont comme des passerellesentre l’Instant donnéet l’Éternité qui fredonnesa chanson d’affilée ;quand tu passes avec ton ombrelle,toute trace s’effacecomme rendue aux hirondelles...Peinture: Pierre Bonnard. -
Comme une voix revient
 « La note d’or que fait entendreun cor dans le lointain des bois » (Verlaine)Tu ne me quitteras jamais,au grand jamais des joursdont le sombre tambour là-basdans le lointain des garesassourdit la lumière -jamais je n’ai tant espéréqu’en cet instant perduoù tu m’as reconnu …Les défunts ont pour eux le nombrecomme un lourd océanoù toute voix particulières’oublie ou dégénère -c’est le tombeau des cris,c’est le chaos à tout jamais,c’est la troupe avide du rienque du vide stupide -et c’est là que je t’attendais…Une voix ce n’est presque rien,une voix qui disaitramenée alors par le ventde l’autre bout du temps :il était une fois…
« La note d’or que fait entendreun cor dans le lointain des bois » (Verlaine)Tu ne me quitteras jamais,au grand jamais des joursdont le sombre tambour là-basdans le lointain des garesassourdit la lumière -jamais je n’ai tant espéréqu’en cet instant perduoù tu m’as reconnu …Les défunts ont pour eux le nombrecomme un lourd océanoù toute voix particulières’oublie ou dégénère -c’est le tombeau des cris,c’est le chaos à tout jamais,c’est la troupe avide du rienque du vide stupide -et c’est là que je t’attendais…Une voix ce n’est presque rien,une voix qui disaitramenée alors par le ventde l’autre bout du temps :il était une fois… -
La Palestine des poètes irradie sans être nommée

Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.
D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…
Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…
Frère et sœurs au même « délire »
Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».
Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »
Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…
Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »
Comme autant de destinées personnelles
Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.
Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».
Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».
Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.
Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.
Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…
Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.
Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.
La Palestine des poètes
irradie sans être nommée
Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.
JEAN-LOUIS KUFFER
D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…
Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…
Frère et sœurs au même « délire »
Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».
Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »
Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…
Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »
Comme autant de destinées personnelles
Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.
Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».
Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».
Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.
Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.
Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…
Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.
Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.
La Palestine des poètes
irradie sans être nommée
Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.
JEAN-LOUIS KUFFER
D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…
Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…
Frère et sœurs au même « délire »
Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».
Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »
Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…
Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »
Comme autant de destinées personnelles
Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.
Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».
Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».
Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.
Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.
Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…
Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.
Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.
-
Ceux qui voient quelqu'un
 Celui qui ne la sentait pas venir / Celle qui va à gauche avec un mec du centre droite / Ceux qui se demandent si elles s’en doutent / Celui qui se sent ce matin tout chaud lapin / Celle que sa nouvelle eau de toilette a amenée à se questionner / Ceux qui parlent d’un nouveau potentiel / Celuiqui défie ses cinquante balais / Celle qui ne regrettera pas sa moustache à la Nietzsche / Ceux qui voient double sans l’annoncer à la troisième / Celui qui estime que le harem est une solution à l’amiable intéressante / Celle qui se verrait bien en odalisque préférée du sultan de l’Entreprise open minded / Ceux qui se demandent carrément : et maintenant on fait quoi / Celui qui pense déjà à ce qu’il va emporter genre le nouvel écran plasma / Celle qui zappera la garde de l’enfant s’il lui laisse Iago le doberman / Ceux qui feront étage séparé dans la Villa Nous Deux / Celui qui voit une malvoyante plus sensible à la poésie que Maryvonne / Celle qui affirme que pour que les mecs changent faudrait qu’ils soient différents / Ceux qui prennent sur eux en comptant sur elles / Celles qui prennent sur elles sans se faire trop d’illusions sur eux / Celui qui s’énerve quand ils lui demandent pourquoi Maryvonne les évite / Ceux qui découvrent de nouvelles qualités à leur beaux-parents / Celui dont le beau-père a passé deux fois par là / Celle qui fait celle qui n’a pas compris pour avoir la paix / Ceux qui n’en font pas le début d’un narratif / Celui qui se confesse au père Dominique dont il sait les préférences mais s’ils font ça entre eux ça lui va / Celle qui fait un transfert imprévu sur son avocat réellement sexy / Ceux qui restent fidèles et donc pas de souci « ma fi », etc.
Celui qui ne la sentait pas venir / Celle qui va à gauche avec un mec du centre droite / Ceux qui se demandent si elles s’en doutent / Celui qui se sent ce matin tout chaud lapin / Celle que sa nouvelle eau de toilette a amenée à se questionner / Ceux qui parlent d’un nouveau potentiel / Celuiqui défie ses cinquante balais / Celle qui ne regrettera pas sa moustache à la Nietzsche / Ceux qui voient double sans l’annoncer à la troisième / Celui qui estime que le harem est une solution à l’amiable intéressante / Celle qui se verrait bien en odalisque préférée du sultan de l’Entreprise open minded / Ceux qui se demandent carrément : et maintenant on fait quoi / Celui qui pense déjà à ce qu’il va emporter genre le nouvel écran plasma / Celle qui zappera la garde de l’enfant s’il lui laisse Iago le doberman / Ceux qui feront étage séparé dans la Villa Nous Deux / Celui qui voit une malvoyante plus sensible à la poésie que Maryvonne / Celle qui affirme que pour que les mecs changent faudrait qu’ils soient différents / Ceux qui prennent sur eux en comptant sur elles / Celles qui prennent sur elles sans se faire trop d’illusions sur eux / Celui qui s’énerve quand ils lui demandent pourquoi Maryvonne les évite / Ceux qui découvrent de nouvelles qualités à leur beaux-parents / Celui dont le beau-père a passé deux fois par là / Celle qui fait celle qui n’a pas compris pour avoir la paix / Ceux qui n’en font pas le début d’un narratif / Celui qui se confesse au père Dominique dont il sait les préférences mais s’ils font ça entre eux ça lui va / Celle qui fait un transfert imprévu sur son avocat réellement sexy / Ceux qui restent fidèles et donc pas de souci « ma fi », etc. -
La douceur en partage
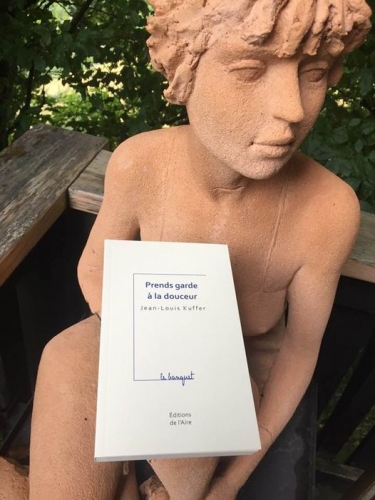
À propos du dernier opuscule de JLK,
par Francis Vladimir
"Dans Arles où sont les Alyscans,
Quans l'ombre est rouge, sous les roses,
Et clair le temps,
prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton coeur trop lourd;
Et que se disent les colombes:
Parle tout bas, si c'est d'amour,
Au bord des tombes."
(Paul-Jean Toulet)
L'exergue de Paul-Jean Toulet pare le livre de JLK d'une ineffable aura. À lire d'un trait, le vertige m'a pris, longue dévalée nocturne avec au bout les mots, les mots, toujours les mots qui cernent et disent tant de la vie passée, en allée, que de celle qui demeure toujours à nos côtés, en embuscade en dépit de sa rosserie, de ses moments de grâce, de ses instants fugaces jouant d'éternité. Dans ce long texte qui se décline page après page en 587 pensées, déclinées à la mode classique, qui se prêtent à l'aube, au cheminement et au soir, l'écrivain ne dévoile rien que nous ne pressentions déjà, une vie d'homme tournée opiniâtrement vers le sens de la vie qui revêt chez lui une interrogation jamais muette, mais assumée par ce que les mots sous sa plume entendent révéler à ceux qui, aveugles ou sourds, en ces temps de misère, sont frappés d'incapacité majeure dans le dévoilement d'eux-mêmes.
Dans l'art d'écrire - ( Tchékhov a su dire :... l'art et surtout la scène est un monde où il est impossible d'avancer sans trébucher)- il y aurait donc ce trébuchement sans lequel l'écriture ne saurait aboutir à la luminosité qui se tient dans chacune des pages du livre de JLK. Pour les lecteurs attentifs et fidèles, l'auteur dresse tout un panorama intérieur où le regard est invité à s'arrêter sur chacun des apophtegmes – nommer ainsi ces courts textes est hasardeux – mais il me faut admettre que l'écho de chacun d'eux, d'une langue lyrique, veloutée, âpre, mordante, déposée, conduit le lecteur à un apaisement de lui-même. Il est drôle de consentir à cet état constaté comme si, finalement, les mots dès lors qu'ils sont plus que choisis, justes et ajustés au pourquoi de la chose, le paysage mental, l'expérience de la vie, le sentiment et la douleur, l'accompagnement, le chaos et la respiration profonde, nous réajustent à nous mêmes, nous ré-assemblent aux autres et au monde. De l'éternel présent . - Ceux qui veillent depuis toujours, veilleuses et veilleurs des quatre coins des nébuleuses, le savent à jamais: qu'il n'y a que le présent des choses qui puisse vous révéler votre éternité... Dans le grand théâtre l'écrivain joue le rôle de sa vie, liant et déliant les mots et leur sens, secrets et publics, se confrontant à son intime conviction, changeante et forte, car nul ne sait ce qu'il en sera de demain, de la prochaine aurore, du chemin se perdant dans les bois, du crépuscule de feu sur le lac, et l'écrivain s'il prend au présent et à bras le corps la destinée du monde, tel qu'il va, cahin-caha, a ce rien de bravache, de foudre de guerre errant ( par les mers et les monts, les vallons et les plaines... et la voix au désert ) le disputant tout à la fois à Don Quichotte et au chevalier inexistant.
« De la page vécue.- Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu'une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j'entrais dans une forêt, j'étais sur la route d'Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d'adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j'avais seize ans sur les arêtes d'Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. » L'écrivain se tiendrait donc à la frontière, cette ligne brisée pour certains ou ligne bleue des Vosges pour d'autres, en-deça de laquelle la pièce retombe pile, au-delà de laquelle elle est face. Au jeu du bonneteau de la vie on y voit que du feu. Dans l'obscurité environnante des grands arbres il faut regarder haut, percer la canopée pour retrouver la lumière. Cet entre-deux constant où se joue l'existence, le livre en ces pages les plus sombres ou en ces pages vives, nous est la meilleure des sources pour s'abreuver, humer, jouer avec la fluidité ou le rocher des mots. Sisyphe montait et remontait sans répit la pente. La gangue, qui enserre, l'écrivain en vient à bout, c'est à dire qu'il commet le premier acte d'apprentissage, l'essentiel, celui de buriner le temps. Et JLK laisse échapper ses volutes d'enfance, ses regains d'adolescence, ses attentes de jeune homme, ses attaches d'homme mûr, cette violence de sang et de violence, toutes choses en elles-mêmes qui font et contrefont le souvenir, le visitant et le revisitant, ne se départant jamais de ce qui tient ce texte de bout en bout, l'émotion, le sourire, la tendreté et la douceur malgré sa mise en garde, le rugueux, la colère rentrée, le deuil.
Les mots, peut-on l'exprimer, fomentent des répits et des transes, déplacent des montagnes, apaisent ou désespèrent, ramènent au silence. Souffles primordiaux sans lesquels l'écriture n'advient pas. Je disais, en aparté de ma lecture de nuit, que l'égrènement de ces courts textes qui font une vraie somme, - à faire des jaloux – relève des abysses et tutoie des hauteurs. Sans doute, le dit-on avec facilité, la catharsis se fait dans l'emploi des mots, dans cette ré-architecture incessante érigeant le propos. Ici il est intime et universel, chuchoté à l'oreille par une voix amie. Il donne à entendre le monde aujourd'hui dans les échos et les accents d'hier, dans l'évidence de l'autre, la toute proche, l'ailée.
« De l'évidence. - Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m'était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d'être révélé en pleine lumière... ». Le livre de JLK se retourne à l'épaule, et nous retourne les sens, nous accablant et nous allégeant, mêlant indistinctement les raisons et les déraisons qui mènent au bout du chemin, à la dernière page du livre. « tu t'en es allée une nuit après nous avoir signifié ton désir de dormir et la nuit depuis lors m'est une autre tombe... De ma tristesse.-Ton visage s'est refermé pendant que tu dormais et pourtant je le savais déjà : que ce n'était pas le sommeil qui l'avait refermé... mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...
Du plus tendre aveu.-Tu m'as manqué dès que j'ai su que je m'en irais, lui dit-elle... » L'omniprésence de l'intime et du fugace confère à ces pages le noir et le blanc, couleurs de deuil, non pour enfouir l'âme endolorie, la triturer à l'excès, mais bien plutôt pour glisser sous les pas de celui qui reste, une autre portée musicale, lui tendre un arc où réapparaîtront les couleurs, les poinçons d'espérance, l'écriture de feu, la réparation. C'est à cela sans doute que s'attache le livre de JLK, hors- champ, mais dans la lumière matinale sur le chemin des bois, s'en revenant au soir. Avec légèreté, sans emphase, avec les mots sacrés pour le dire, ces sacrés mots, l'empyrée et le refuge qu'il s'est choisis, à la Désirade, sur les hauts de Lausanne, pour continuer et faire entendre...
De la permanence.- Ce que nous laissons semble n'être rien, mais c'est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous....
Francis Vladimir, le 09 décembre 2023
Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de l'Aire, 2023.
-
Ce que dit le silence
« Qui sait, dit Euripide, il se peut que la vie soit la mort et que la mort soit la vie »(Léon Chestov, Les révélations de la mort)Pour Emilia, en mémoire de Pierre-Guillaume.La suprême ignorance est là,de ne plus savoir side la nuit avant l’heure,ou du jour et ses leurressont ce qu’ils sont ou ne sont pas…L’étrange chose qu’une rosequi ne parle qu’en soiet dont jamais aucune foin’osa dire qu’elle dispose…Les mots ne voulaient dire que ça:qu’ils savent qu’ils ignorentque le silence dort,et que la mort n’existe pas…Peinture JLK: Al Devero.