
Retouches aux Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis
À l'attention particulière de Max Lobe, mon poulain attitré,
et pour Aude Seigne, Anne-Frédérique Rochat, Isabelle Aeschlimann-Petignat; mes amis Quentin Mouron, Bruno Pellegrino, Daniel Vuataz, Matthieu Ruf, Sébastien Meyer et la jeune bande de l'AJAR

DK. - Cultive le doute à l’égard des idéologies régnantes et des princes.
JLK. - Tâchons de parler ensemble, un de ces soirs, de ce qu'est réellement une idéologie...
DK. - Tiens-toi à l’écart des princes.
JLK. - Toi qui m'a sommé de m'acheter une cravate pour approcher le gouverneur du Katanga, en septembre dernier à Lubumbashi, comment pourrais-je t'en vouloir d'en avoir appris un peu plus, ce jour-là, en observant de près Moïse Katumbi ?
DK. - Veille à ne pas souiller ton langage du parler des idéologies.
JLK. - Si ta langue est vivante elle devrait être assez forte aussi pour intégrer toutes les formes de langage, ne serait-ce que par l'ironie. Même de la novlangue des SMS et de Tweets on peut faire son miel sur Facebook et ailleurs.
DK.- Sois persuadé que tu es plus fort que les généraux, mais ne te mesure pas à eux.
JLK. - Sourions, mon ami, des gendelettres qui se croient "plus fort" tout en craignant de se mesurer à Goliath alors que David l'a fait sans plume...
DK. - Ne crois pas que tu es plus faible que les généraux mais ne te mesure pas à eux.
JLK. - Sourions, mon ami, à ceux qui se disent plus faibles que les divisions de Staline - c'est encore une forme de vanité.
DK. - Ne crois pas aux projets utopiques, sauf à ceux que tu conçois toi-même.
JLK. - À toi qui sais qu'écrire est une utopie en mouvement et le projet de chaque jour, je filerai tantôt la variation claire-obscure de Michel Foucault sur le corps considéré comme une utopie habitable...
DK. - Montre-toi aussi fier envers les princes qu’envers la populace.
JLK. - Nous pourrions aussi parler de cette notion de fierté, un de ces soirs, et de ce qui autorise un écrivain à qualifier les gens de "populace".
DK. - Aie la conscience tranquille quant aux privilèges que te confère ton métier d’écrivain.
JLK. - À toi qui viens d'un pays où la "promotion canapé" et le "piston" font partie des procédures d'avancement, je n'ai pas de conseil à donner, mais cette notion du "privilège" social mérite discussion.
DK.- Ne confonds pas la malédiction de ton choix avec l’oppression de classe.
JLK. - Là, je trouverais intéressant, Maxou, que nous parlions des écrivains africains politiquement engagés genre Mongo Beti et de ce que nous trouvons encore chez eux de bien éclairant en dépit de leur vocabulaire daté et de leurs préjugés de militants - je te vois sourire d'ici en retombant sur les lignes assassines du Rebelle de Mongo Beti contre Ahmadou Kouroma.
DK. - Ne sois pas obsédé par l’urgence historique et ne crois pas en la métaphore des trains de l’histoire.
JLK. - Nous parlions l'autre soir des croisements et autres collisions des trains historiques de l'Europe et de l'Afrique, et nous savons aujourd'hui qu'il est d'autres urgences historiques que les lendemains qui chantent, mais reparlons donc, un autre soir, de ce que signifie une métaphore et son bon usage...
DK. - Ne saute donc pas dans les « trains de l’histoire », c’est une métaphore stupide.
JLK. - Le "train" est aujourd'hui le "trend" et nous n'en sommes pas plus dupes toi que moi, mais on peut faire du "trend" une miniature et jouer avec, non ?
DK. - Garde sans cesse à l’esprit cette maxime : «Qui atteint le but manque tout le reste ».
JLK. - Le mieux serait de penser que toute maxime, comme une médaille, a un revers, en vertu de quoi l'on pourrait dire que "qui rate le but rate aussi tout le reste".
DK. - N’écris pas de reportages sur des pays où tu as séjourné en touriste ; n’écris pas de reportages du tout, tu n’es pas journaliste.
JLK. - C'est un préjugé littéraire d'époque que de décrier, après Mallarmé, l'universel reportage. Balzac est-il écrivain ou journaliste quand il écrit Illusions perdues, géniale peinture de l'expansion industrielle du journalisme ? Les notes respectives que nous avons prises à Lubumbashi sont-elles d'écrivains ou de journalistes ? Le mieux serait de relire les entretiens de Jacques Audiberti avec Georges Charbonnier où l'écrivain-poète-journaliste-dramaturge distingue nettement les degrés divers d'implication de ce qu'il appelle l'écriveur, l'écrivan et l'écrivain.
DK. - Ne te fie pas aux statistiques, aux chiffres, aux déclarations publiques : la réalité est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.
JLK. - Méfions-nous des frilosités esthètes des gendelettres qui ont peur des chiffres et des discours auxquels ils prêtent évidemment trop d'importance.
DK. - Ne visite pas les usines, les kolkhozes, les chantiers : le progrès est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.
JLK. - Pour ma part, mais je n'ai pas besoin d'insister avec un loustic de ton genre, j'irais plutôt fourrer mon nez partout et sans chercher le progrès nulle part puisqu'il va de soi quand on travaille.
DK. - Ne t’occupe pas d’économie, de sociologie, de psychanalyse. Ne te pique pas de philosophie orientale, zen-bouddhisme. etc : tu as mieux à faire.
JLK.- Je ne sais absolument pas ce que tu aurais "de mieux à faire", étant établi que j'ai perdu mon temps à m'occuper l'esprit et le corps de toute sorte de sujets (de l'étude des fourmis à la gnose ou de la poésie t'ang à la webcamologie pathologique) qui m'ont tous apporté quelque chose y compris moult rejets et moult égarements momentanés.
DK. - Sois conscient du fait que l’imagination est sœur du mensonge, et par là-même dangereuse.
JLK.- Méfie-toi des maximes littéraires équivoques style "l'imagination est soeur du mensonge" qui ne rendent compte ni de la réalité de l'imagination ni de celle du mensonge.
DK. - Ne t’associe avec personne : l’écrivain est seul.
JLK. - Georges Haldas me dit, lors de notre premier entretien (j'avais ton âge), qu'il y a "un diable sous le paletot de tout écrivain", donc attention aux associations sans recul ironique. Quant à la solitude, elle est parfois terrifiante (celle de Dostoïevski entouré de sa bruyante et ruineuse parenté) quoique pondérée par une présence douce (ce dragon d'Anna Grigorievna), mais n'en faisons pas un drame puisqu'on choisit d'écrire.
DK. - Ne crois pas ceux qui disent que ce monde est le pire de tous.
JLK. - À la fin de sa vie, ma mère préférait les films d'animaux aux nouvelles, et la cruelle Patricia Highsmith me dit qu'elle n'osait pas regarder la télé à cause du sang. Quant aux généralités sur "le pire" et "le meilleur", ce sont aussi des ingrédients utiles dans le pot-au-feu de l'écrivain.
DK.- Ne crois pas les prophètes, car tu es prophète.
JLK. - Le côté sentencieux de Danilo Kis est assez typique de la société littéraire de l'Europe de l'Est se frottant à la culture française. Mais on pourrait aussi trouver cette emphase chez les adeptes nudistes de certains écrivains-prophètes anglo-américains. Cela dit que me répondrais-tu si je te disais comme ça: "Ne crois pas les griots, car tu es griot".
DK.- Ne sois pas prophète, car le doute est ton arme.
JLK. - Danilo Kis ne doit pas bien connaître les prophètes, qui sont fondamentalement des bêtes de doute...
DK. - Aie la conscience tranquille : les princes n’ont rien à voir avec toi, car tu es prince.
JLK. - Words, words, words, me répète volontiers notre amie la princesse bantoue à qui on ne la fait pas en matière de flatterie et, moins encore, de confusion des grades.
DK. - Aie la conscience tranquille : les mineurs n’ont rien à voir avec toi, car tu es mineur.
JLK. - Dans notre discussion prochaine sur les métaphores, n'oublions pas ces figures du kitsch littéraire: que l'écrivain est un mineur, un veilleur, un allumeur de réverbères, que sais-je encore que n'ont pas écrit Saint-Ex ou l'inénarrable Paulo Coelho.
DK.- Sache que ce que tu n’as pas dit dans les journaux n’est pas perdu pour toujours : c’est de la tourbe.
JLK. - Cette crainte implicite de ce qui serait "perdu" pour n'avoir pas paru dans un journal est un autre signe de l'incroyable vanité littéraire, qui prend ici un relief particulier au vu du bavardage généralisé des médias.
DK. - N’écris pas sur commande.
JLK. - Si la commande du tiers recoupe la tienne, n'hésite pas à écrire même si c'est mal payé ou pas du tout.
DK. - Ne parie pas sur l’instant, car tu le regretterais.
JLK. - Parie au contraire sur chaque instant, car chaque instant participe de l'éternité, surtout vers la fin.
DK. - Ne parie pas non plus sur l’éternité, car tu le regretterais.
JLK. - Parie également sur l'éternité, car c'est sous l'horizon de la mort qu'on écrit de bons livres, dont l'éternité est la plus féconde illusion.
DK. - Sois mécontent de ton destin, car seuls les imbéciles sont contents.
JLK. - Affirmer que "seuls les imbéciles sont contents" est une imbécillité comme nous en proférons tous à tout moment, mais il est vrai que l'insatisfaction est bonne conseillère, sans qu'on en fasse un procès du destin -un jeune écrivain n'a de destin que devant lui.
DK. - Ne sois pas mécontent de ton destin, car tu es un élu.
JLK. - C'est ça mon poney: tu es un élu. Il y a aussi des peuples élus. Et des sentences réversibles aussi creuses dans un sens que dans l'autre.
DK. - Ne cherche pas de justifications morales à ceux qui ont trahi.
JLK. - Cette question de la trahison est délicate, parfois insondable. Dis-moi qui te dit que tu as trahi et je te dirai pourquoi il le dit. Ce n'est pas justifier du tout la trahison. C'est s'interroger sur la complexité humaine, à quoi s'attache la littérature. Iago en est un modèle, mais il en est mille autres aux motifs que la morale pourrait justifier parfois au dam des prétendus "fidèles".
DK. - Garde-toi du « redoutable esprit de suite ».
JLK.- Marcel Proust dit à peu près que le génie est une affaire d'obstination, où l'esprit de suite est requis jusqu'à la bêtise. Tu peux écrire tout le temps sans écrire rien, ou progresser en t'abstenant: peu importe. L'esprit de suite est une fidélité fondamentale à ton "noyau". Tout le reste vient "après" ou "avec" mais ça viendra...
DK. - Crois ceux qui paient cher leur inconséquence.
JLK. - Méfie-toi, Maxou, des préceptes et autres sentences dénués d'exemples. Qui sont ces gens "qui paient cher leur inconséquence" ? Et quel genre d'inconséquence ? Méfie-toi des abstraits !
DK. - Ne crois pas ceux qui font payer cher leur inconséquence.
JLK. - Remarque aussi que les conseils en disent souvent plus sur les conseillers que sur les conseillés.
DK. - Ne prône pas le relativisme de toutes les valeurs : la hiérarchie des valeurs existe.
JLK. - Là c'est la porte ouverte qu'on enfonce ! Mais il est vrai que cette question du relativisme est fondamentale à l'ère du nivellement généralisé - autre "généralité". Donc entendons-nous sur les notions de relativisme, de hiérarchie et de valeurs. À bas les généralités convenues !
DK. - Reçois avec indifférence les récompenses que te décernent les princes, mais ne fais rien pour les mériter.
JLK. - L'écrivain est un caniche, me disait le délicieux Marian Pankowski. Qu'il y ait donc, derrière la haie, un prince ou une accorte jouvencelle lui promettant un biscuit: il jappe et sautille. Quant à ne rien faire pour mériter quoi que ce soit, c'est encore la vanité qui parle. Restons purs: ce genre de postures...
DK.- Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris est la meilleure de toutes, car tu n’en as pas d’autres.
JLK. - Tu m'intéresses, Maxou, parce que tu écris dans plusieurs langues à la fois, que la tienne rassemble en bouquet. Cette idée selon laquelle le bassa (auquel tu n'emprunte que des bribes d'expressions) ou le suisse allemand (dont les téléphones de ma mère m'ont éloigné à sept ans) seraient la meilleure langue du monde est une posture provinciale et finalement assez snob. On sourit déjà quand Sollers déclare que la langue française est la meilleure du monde. Et qui ne se contenterait que d'une langue ?
DK. - Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris est la pire de toutes, bien que tu ne l’échangerais contre aucune autre.
JLK. - Une fois de plus, ces balancements dialectiques entre "le pire" et "le meilleur" nous ramènent à la rhétorique binaire débile du BONUS et MALUS...
DK. - « Parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche » (Apocalypse 3, 16)
JLK. - À quinze ans la parole biblique "les tièdes, je les crache" me bottait pas mal. Mais une digne maîtresse de piano, bien des années avant, m'avait déclaré un jour en penchant son chignon de mon côté: "Et maintenant, jeune homme, nous allons mettre les nuances"...
DK. - Ne sois pas servile, car les princes te prendraient pour valet.
JLK. - Quels princes mon zoulou ? T'as déjà vu des princes ? Et pourquoi cette servilité ? Pour obtenir une subvention d'un fonctionnaire de la culture ? Non mais cette pensée est celle d'un valet !
DK. - Ne sois pas présomptueux, car tu ressemblerais aux valets des princes.
JLK. - La question de la présomption liée à un mimétisme social doit-elle t'inquiéter au moment où tu commences une "carrière" ? Encore heureux que ton bon sens hérité de ta mère te préserve de ces gesticulations.
DK. - Ne te laisse pas persuader que la littérature est socialement inutile.
JLK. - Là, je sais que tu ne risques rien. La littérature des pays nantis devient de plus en plus "socialement inutile", c'est pourtant vrai, mais il y a plus grave puisque la littérature est irréductible à la notion sociale d'utilité
DK.- Ne pense pas que ta littérature est « utile à la société ».
JLK. - Parie au contraire pour l'utilité fondamentale de ta littérature, sans penser à "la société" ou juste "par moments".
DK. - Ne pense pas que tu es toi-même un membre utile de la société.
JLK. - Pense au contraire que tu es un membre aussi utile de la société que le Top Manageur Daniel Vasella qui ne lira pas ton livre.
DK. - Ne te laisse pas persuader pour autant que tu es un parasite de la société.
JLK. - Cette idée des "insectes nuisibles" ressortit à plusieurs idéologies et n'a plus à nous intéresser qu'en tant qu'entomologistes de la langue de bois ou de fer. Matière intéressante pour un écrivain.
DK. - Sois convaincu que ton sonnet vaut mieux que les discours des hommes politiques et des riches.
JLK. - Cela m'amuserait de te voir te mettre au sonnet. C'est une discipline rigoureuse qui vaudrait la peine de sacrifier quelques heures de zumba.
DK. - Sache que ton sonnet n’a aucun sens face à la rhétorique des hommes politiques et des princes.
JLK. - Le président français de droite Georges Pompidou avait une bonne connaissance du mètre poétique, de même que le Président français de gauche François Mitterrand.
DK. - Aie en toute chose ton avis propre.
JLK. - On croit souvent que son avis est d'origine avec brevet déposé, alors qu'on l'a emprunté à tel ou tel qu'on admire ou qu'on aime bien. Quant à être tout à fait personnel, ça peut venir mais pas forcément. Beaucoup se fondent dans la masse, opinent du chef et du sous-chef, mais n'en pensent pas moins parfois.
DK.- Ne donne pas en toute chose ton avis. C’est à toi que les mots coûtent le moins.
JLK. - Montaigne donne son avis sur pas mal de choses, et c'est à lui que les mots coûtent le plus, même si le problème n'est pas là. Donc ne crains pas de lire Montaigne, mais la phrase de Pascal est également digne d'attention, dont chaque mot coûte aussi "le plus". Quant à ceux à qui les mots coûtent le moins, ils opposeront l'un et l'autre, ou joueront Camus contre Sartre.
DK. - Tes mots n’ont pas de prix.
JLK. - C'est le genre d'assertion qui peut te ramener au relativisme aussi bien tempéré qu'un clavecin. Au demeurant, tes mots méritent peut-être un prix, mais n'y pense pas...
DK. - Ne parle pas au nom de ta nation, car qui es-tu pour prétendre représenter quiconque, si ce n’est toi-même ?
JLK. - Si la nation te demande poliment de monter sur le podium pour le prochain discours de la Fête nationale du 1er août, vas-y petit.
DK. - Ne sois pas dans l’opposition, car tu n’es pas en face, mais au-dessous.
JLK. - Que signifie d'être "en face" ou "au-dessous" de l'opposition. Je ne sais pas. Et quelle opposition, à quel moment, comment ? Tout ça relève de la posture et non de la position.
DK. - Ne sois pas du côté du pouvoir et des princes, car tu es au-dessus d’eux.
JLK. - Quel pouvoir et quels princes ? Et quel "au-dessus" ? La princesse bantoue se sent-elle au-dessus du "vacabon" des gadoues ?
DK. - Bats-toi contre les injustices sociales, sans en faire un programme.
JLK. - Ce qu'il y a de terrible avec le "politiquement correct", c'est qu'il soit si souvent moralement correct sans engager le moins du monde.
DK. - Prends garde que la lutte contre les injustices sociales ne te détourne pas de ton chemin.
JLK. .- Mais bon sang, comment envisager le juste chemin d'un écrivain sans attention à toute forme d'injustice ?
DK. - Apprends ce que pensent les autres, puis oublie-le.
JLK. - Garde en mémoire tout ce que les autres t'ont réellement appris et laisse ta mémoire filtrer ce que tu apprendras aux autres sans rien oublier de ce qui compte.
DK. - Ne conçois pas de programme politique, ne conçois aucun programme : tu conçois à partir du magma et du chaos du monde.
JLK. - Là encore le cher Danilo mélange tout, même si Vaclav Havel reste un bon ou un mauvais écrivain comme il a été un bon ou un mauvais chef d'Etat. Pour le magma il n'y a pas de règle. L'atelier de Bacon ou les carnets de Dostoïevski ne sont pas des modèles d'école.
DK. - Garde-toi de ceux qui proposent des solutions finales.
JLK. Suis leur regard: ils vont tous être d'accord! Je sais que tu n'aimes pas ça, moi non plus.
DK.- Ne sois pas l’écrivain des minorités.
JLK. - Et pourquoi pas si tu leur échappes ? Et pourquoi pas l'écrivain des majorités si tu leur échappes ?
DK. - Dès qu’une communauté te fait sien, remets-toi en question.
JLK. - Il y a en effet des assimilations visqueuses, mais il en est d'autres joyeuses, mais nous parlerons un soir de la notion de communauté ou de l'écrivain "bon génie de la Cité".
DK. - N’écris pas pour le « lecteur moyen » : tous les lecteurs sont moyens.
JLK.- Cela signifie-t-il qu'il ne faut pas écrire pour aucun lecteur ?
DK. - N’écris pas pour l’élite ; l’élite n’existe pas : tu es l’élite.
JLK. - Cette notion d'élite est en général un faux-fuyant, soit pour flatter la médiocrité, soit pour se sentir au-dessus du "commun". Le mieux serait d'éviter toute démagogie et toute "cible" sociale quand on écrit.
DK. - Ne pense pas à la mort, mais n’oublie pas que tu es mortel.
JLK. - La mort n'existe pas comme objet de pensée mais elle se vit de phrase en phrase et c'est ce noir qui rehausse les couleurs de nos pages.
DK. - Ne crois pas en l’immortalité de l’écrivain, ce sont là sottises de professeurs.
JLK. - L'expression "sottises de professeurs" est ce qu'on peut dire un "argument massue". Quant à l'immortalité de l'écrivain, c'est une métaphore de plus et ce que j'appelle une "illusion féconde". Disons qu'à ce taux-là Homère résiste au temps plus que les pyramides de crânes de Tamerlan.
DK. -Ne sois pas tragiquement sérieux, car c’est comique.
JLK. - Le comique est par essence lesté par le sérieux du tragique. D'Aristophane à Shakespeare, via l'Afrique du pleurer-rire.
DK. - Ne joue pas la comédie, car les boyards ont l’habitude qu’on les amuse.
JLK. - Quand tu voudras dire le plus tragique de la vie, tu écriras une comédie. C'est en tout cas ce que Brecht conseilla au poète algérien Kateb Yacine.
DK. - Ne sois pas bouffon de cour.
JLK. - Si ta cour est faite des commères de Douala, je n'ai pas de conseil à te donner mais je sais que tu t'en tireras...
DK. - Ne pense pas que les écrivains sont « la conscience de l’humanité » ; tu as vu trop de crapules.
JLK. - Comme je t'ai vu hausser les épaules au défilé des Grands Mots, aucun souci pour toi !
DK.- Ne te laisse pas persuader que tu n’es rien ni personne : tu as vu que les boyards ont peur des poètes.
JLK. - J'aimerais bien t'aider à admettre que tu vaux mieux que tu ne crois, mais faut aussi que je me soigne, et les Boyards on les fume sur le trottoir...
DK. - Ne va à la mort pour aucune idée et ne convainc personne de mourir.
JLK. - Là, ne jurons de rien sans savoir de quelle idée il s'agira. Chacun est facilement d'accord avec Brassens quand il refuse de "mourir pour des idées", mais qui sait ce qui nous attend sous le masque de "l'idée" ?
DK. - Ne sois pas lâche, et méprise les lâches.
JLK. - Là encore, non confronté à l'épreuve, le mépris reste en somme platonique.
DK. - N’oublie pas que l’héroïsme se paie cher.
JLK. - Sinon que serait-ce que le don de sa vie ?
DK. - N’écris pas pour les fêtes et les jubilés.
JLK. - Et pourquoi pas si ce que tu écris pour la fête fait jubiler ?
DK.- N’écris pas de panégyriques, car tu le regretterais.
JLK. - Si le panégyrique est mérité et joliment tourné, tu ne regretteras rien que d'être jalousé par ceux qu'ombrage toute forme d'admiration.
DK. - N’écris pas d’oraisons funèbres aux héros de la nation, car tu le regretterais.
JLK. - Tout dépend là encore de qui on appelle héros. Mais si le héros le mérite vraiment, pourquoi pas ? Et puis le genre littéraire de l'oraison funèbre peut être renouvelé - je vois bien un rap à Sankara...
DK.- Si tu ne peux pas dire la vérité – tais-toi.
JLK. - Non: si tu ne peux pas dire la vérité: dis que tu ne peux pas dire la vérité. Enfin c'est ça qu'il faudrait, n'est-ce pas ?
DK. - Garde-toi des demi-vérités.
JLK. - C'est ce qu'on appelle une demi-vérité.
DK. Lorsque c’est la fête, il n’y a pas de raison pour que tu y prennes part.
JLK. - Et pourquoi pas si ce n'est pas une agitation hyper-festive du genre actuel qui n'a plus rien de la fête ?
DK. - Ne rends pas service aux princes et aux boyards.
JLK. - Pourquoi parler de "boyards" et de "princes" à propos des apparatchiks d'une dictature populaire ? Tout cela n'est-il pas trop littéraire en somme ?
DK. - Ne demande pas de service aux princes et aux boyards.
JLK. - Tu vois le jeune écrivain "demander service" au Politburo ?
DK. - Ne sois pas tolérant par politesse.
JLK. - Et ne craignons pas d'être impolis par souci de tolérance.
DK. - Ne défends pas la vérité à tout prix : « On ne discute pas avec un imbécile ».
JLK. - Défendons au contraire la vérité à tout prix, même en présence de ce que nous croyons un imbécile.
DK.- Ne te laisse pas persuader que nous avons tous également raison, et que les goûts ne se discutent pas.
JLK. - Bah, tout ça va de soi, même si ça se discute.
DK: - « Etre deux à avoir tort ne veut pas dire qu’on soit deux à avoir raison » (Karl Popper )
JLK.- Quand ils sont signés Karl Popper, ces truismes prennent du galon à ce qu'il semble.
DK. - « Admettre que l’autre puisse avoir raison ne nous protège pas contre un autre danger : celui de croire que tout le monde a peut-être raison ». (Popper)
JLK. - Bis repetita. Quand j'admets que tu as raison, Maxou, je dois craindre de croire que le Cameroun et les Pâquis ont également raison. Laissons là ces poppers !
DK. - Ne discute pas avec des ignorants de choses dont ils t’entendent parler pour la première fois ».
JLK. - Quand tu m'as taxé d'ignorance à propos de ton pays, et que j'ai raillé la tienne à propos du mien, nous aurions donc dû cesser de discuter ? Mais quelle étrange maïeutique que celle de cet écrivain pourtant excellent quand il cesse de prêcher !
DK. - N’aie pas de mission.
JLK. - La Suisse t'a chargé d'une mission au Katanga et tu l'a remplie en grappillant mille observations "hors mission". T'en priver eût été une démission d'écrivain.
DK. - Garde-toi de ceux qui ont une mission.
JLK. - Garde-toi plutôt de toute démission.
DK. - Ne crois pas à la « pensée scientifique ».
JLK. - Ne crains pas de lire Bacon et Hobbes et Descartes et Spinoza et Leibniz qui ajoutent tous plus ou moins à la poésie de la connaissance qui n'exclut ni la pensée magique ni le syncopé anglo-nègre ni le baroque italien ni l'art du haï-ku.
DK. - Ne crois pas à l’intuition.
JLK. - Tu devines, comme tu es devin, que ce conseil serait le plus stupide de Danilo Kis s'il traduisait effectivement sa pensée alors que ses livres disent tout le contraire et nous le font vivre.
DK. - Garde-toi du cynisme, entre autres du tien.
JLK. - Un très cher ami de haute spiritualité m'a reproché, de son vivant, de n'être pas assez cynique. À savoir: de ne pas me défendre assez d'une société globalement dominée par le cynisme. Il y a donc cynisme et cynisme. L'important est de ne pas perdre son âme, ce que j'appelais "le noyau".
DK.- Evite les lieux communs et les citations idéologiques.
JLK.- Et voilà qu'on retombe dans les lieux communs !
DK. - Aie le courage de nommer le poème d’Aragon à la gloire du Guépéou une infamie.
JLK. - Chose facile. Plus difficile est de distinguer la part du génie et de la servilité chez un grand écrivain adulé et vilipendé pour les mêmes mauvaises raisons.
DK. - Ne lui cherche pas de circonstances atténuantes.
JLK. - Auquel cas il faudrait renoncer à comprendre une kyrielle d'écrivains égarés, à travers l'Histoire, dans les labyrinthes de l'idéologie et de la politique...
DK. - Ne te laisse pas convaincre que dans la polémique Sartre-Camus les deux avaient raison.
JLK. - Tâchons plutôt de voir en quoi Sartre et Camus dépassent, et de loin, la polémique qui les oppose et le dilemme artificiel d'un choix de l'un contre l'autre (façon Michel Onfray), alors que leurs oeuvres respectives ont encore tant à nous dire à divers degrés.
DK. - Ne crois pas à l’écriture automatique ni au « flou artistique » - tu aspires à la clarté.
JLK. - Cette opposition réductrice entre "obscurité" littéraire (le surréalisme, la poésie vague,etc.) et "clarté" est intéressante et vaut la discussion, comme le classement de Tolstoï du coté "diune" et Dostoèivski du côté "nocturne", mais le ton péremptoire du conseiller accuse la faiblesse de l'exclusivisme.
DK.- Rejette les écoles littéraires qui te sont imposées.
JLK. - À commencer par l'école du rejet...
DK. - A la mention du « réalisme socialiste », tu renonces à toute discussion.
JLK. - Ce refus de la discussion sent terriblement son dogmatisme anti-dogmatique d'époque. Il ya dans le réalisme socialiste, des oeuvres très intéressantes...
DK. - Sur le thème de la « littérature engagée », tu restes muet comme une carpe : tu laisses cela aux professeurs.
JLK. - Quelle erreur ! Et quel mépris pour "les professeurs" ! Même si beaucoup d'entre eux ont une notion étriquée de "l'engagement", la discussion doit s'ouvrir !
DK. - Celui qui compare les camps de concentration à la Santé, tu l’envoies valser.
JLK. - Mais oui, mais oui.
DK. - Celui qui affirme que la Kolyma, c’est différent d’Auschwitz, tu l’envoies au diable.
JLK. - Ce qu'il faudrait au contraire, c'est examiner tranquillement tout ce qui fait différer la Kolyma, et l'ensemble de l'archipel concentrationnaire russe, du plan d'extermination des nazis symbolisé par Auschwitz. On n'envoie pas au diable un ignorant: on discute. On lui fait lire Vie et destin de Vassili Grossman ou les récits de Varlam Chalamov, et déjà l'on voit les différences entre communisme et nazisme, au-delà des similitudes (Grossman les a montrées mieux que personne), après quoi toute la littérature de l'infamie humaine est à explorer, de Primo Levi à Jean Amery ou d'Ety Hillesum RoBert Antelme - des Bienveillantes de Jonathan Littell à la somme consacrée par Hugh Thomas à La Traite des noirs...
DK. - Celui qui affirme qu’à Auschwitz on n’a exterminé que des poux, et non des hommes, tu le jettes dehors.
JLK. - Bien entendu, mais un jeune écrivain a-t-il besoin de tels conseils ?
DK. - Celui qui affirme que tout cela représentait une « nécessité historique », même traitement. « Segui il carro e lascia dir le genti ». (Dante)
JLK.- Voilà donc, Maxou, les conseils que Danilo Kis, écrivain serbe exilé à Paris, tout à fait estimable quoique par trop adulé par d'aucuns, typique en tout cas d'une certaine intelligentsia de la deuxième moitié du XXe siècle, adressait à un jeune écrivain de son vivant. Je te donnerai ses livres et tu en jugeras. Dans l'immédiat, je me réjouis de notre prochaine revoyure de poulain et de parrain, en te remerciant déjà pour tout ce que tu m'as apporté depuis notre rencontre de l'été 2012. Ma génération, qui est celle aussi de Danilo Kis, considère parfois "ceux qui viennent" avec condescendance. Cette attitude me parait regrettable, même si le "djeunisme" me semble non moins débile. Un certain art de la conversation est à relancer. Or il n'est aucune conversation sans réciprocité...






 On pourrait s'étonner, à propos de cette date, que ce film "réaliste" à l'esthétique si peu flatteuse, évoquant parfois les images véristes des séries allemande genre Derrick, fasse suite immédiate au délicat Effi Briest, apparemment plus séduisant avec ses beaux visages léchés et ses belles toilettes, ses beaux intérieurs et ses beaux meubles, ses beaux cadrages et ses beaux fondus au blanc, et pourtant le fonds de désarroi sondé par RWF est le même en dépit de ce qui sépare les univers de la jeune fille "de la haute" et de la femme d'ouvrier au faciès boucané, lequel rappelle en outre la vieille protagoniste du mémorable Alexandra de Sokourov dans le registre des "Mères Courage"...
On pourrait s'étonner, à propos de cette date, que ce film "réaliste" à l'esthétique si peu flatteuse, évoquant parfois les images véristes des séries allemande genre Derrick, fasse suite immédiate au délicat Effi Briest, apparemment plus séduisant avec ses beaux visages léchés et ses belles toilettes, ses beaux intérieurs et ses beaux meubles, ses beaux cadrages et ses beaux fondus au blanc, et pourtant le fonds de désarroi sondé par RWF est le même en dépit de ce qui sépare les univers de la jeune fille "de la haute" et de la femme d'ouvrier au faciès boucané, lequel rappelle en outre la vieille protagoniste du mémorable Alexandra de Sokourov dans le registre des "Mères Courage"...  Et c'est alors qu'on retrouve Tchekhov et son immense frise de personnages également "largués", à divers étages de la société russe d'avant les révolutions ou, dans un registre moins tragique du point de vue individuel, la formidable Alexandra de Sokourov descendue à Grozny pour voir de près comment on accommode la jeune chair à canon, en la personne de son petit-fils.
Et c'est alors qu'on retrouve Tchekhov et son immense frise de personnages également "largués", à divers étages de la société russe d'avant les révolutions ou, dans un registre moins tragique du point de vue individuel, la formidable Alexandra de Sokourov descendue à Grozny pour voir de près comment on accommode la jeune chair à canon, en la personne de son petit-fils. Or il s'agit aujourd'hui, je crois, de relire les pièces et les romans de celui-ci, autant que les essais d'un Pasolini, et de revoir les films de Fassbinder qui continuent décidément de "faire mal", autant que les pièces et les récits de Tchekhov, en se rappelant que la littérature ou le cinéma, non contraints par telle ou telle idéologie plaquée, ont encore des choses importantes à montrer et à dire à propos de la condition humaine...
Or il s'agit aujourd'hui, je crois, de relire les pièces et les romans de celui-ci, autant que les essais d'un Pasolini, et de revoir les films de Fassbinder qui continuent décidément de "faire mal", autant que les pièces et les récits de Tchekhov, en se rappelant que la littérature ou le cinéma, non contraints par telle ou telle idéologie plaquée, ont encore des choses importantes à montrer et à dire à propos de la condition humaine...





 (Cette liste a été inspirée par L'Année des treize lunes de Rainer Werner Fassbinder, film-exorcisme d'une beauté convulsive et d'une insondable vérité émotionnelle sur fond de glaciation sociale, que Werner Schroeter a probablement raison de dire le plus personnel et le plus librement inspiré de son ami l'ange noir)
(Cette liste a été inspirée par L'Année des treize lunes de Rainer Werner Fassbinder, film-exorcisme d'une beauté convulsive et d'une insondable vérité émotionnelle sur fond de glaciation sociale, que Werner Schroeter a probablement raison de dire le plus personnel et le plus librement inspiré de son ami l'ange noir) 
 "D'une incroyable brutalité !". Tel est le SMS que j'ai reçu l'autre soir de mon compère René Zahnd, compagnon de route de plus trente ans qui m'annonçait dans quelles circonstances lamentables lui et Thierry Tordjman venaient d'être "virés" de Vidy dès août prochain. L'esprit de Vidy, insufflé au théâtre au bord de l'eau par René Gonzalez, l'autre René et une belle équipe, mais aussi par un public exceptionnellement fidèle et fervent, survivra-t-il à ce nouvel épisode d'une vilain feuilleton amorcé avec la succession "jouée d'avance" de Gonzalo ? N'en jugeons pas avant l'arrivée du nouveau directeur, Vincent Baudriller, mais le moins qu'on puisse dire est que ce prélude inélégant au possible, manigancé de concert avec la Fondation pour le théâtre, confirme la mauvaise impression laissée par les circonstances de sa nomination. Passons sur le détail d'une politique culturelle à très courte vue...
"D'une incroyable brutalité !". Tel est le SMS que j'ai reçu l'autre soir de mon compère René Zahnd, compagnon de route de plus trente ans qui m'annonçait dans quelles circonstances lamentables lui et Thierry Tordjman venaient d'être "virés" de Vidy dès août prochain. L'esprit de Vidy, insufflé au théâtre au bord de l'eau par René Gonzalez, l'autre René et une belle équipe, mais aussi par un public exceptionnellement fidèle et fervent, survivra-t-il à ce nouvel épisode d'une vilain feuilleton amorcé avec la succession "jouée d'avance" de Gonzalo ? N'en jugeons pas avant l'arrivée du nouveau directeur, Vincent Baudriller, mais le moins qu'on puisse dire est que ce prélude inélégant au possible, manigancé de concert avec la Fondation pour le théâtre, confirme la mauvaise impression laissée par les circonstances de sa nomination. Passons sur le détail d'une politique culturelle à très courte vue... 

 À relire aujourd'hui la pièce, d'Ibsen, on constate toujours sa force critique dévastatrice, qui pourrait s'appliquer aux faux semblants actuels. Or Thomas Ostermeier peine à transposer le puritanisme d'une époque à l'autre. Dans la pièce, le pasteur Manders est évidemment un ecclésiastique norvégien de 1882, mais le même type existe aussi de nos jours, suave et pleutre, moralisant et vicelard. On le sent très fort dans le personnage du pasteur de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, comme chez nombre de romanciers américains contemporains. Mais quoi de commun entre le Manders d'Ibsen et le clergyman fade, lisse, creux et criseux campé par François Loriquet ? Ne chargeons pas le comédien, qui "fait le job", tandis que toute l'attention d'Ostermeier se porte sur la seule relation, oedipienne jusqu'à l'hystérie, liant Madame Alving (Valérie Dréville, remarquable au demeurant) et son fils paumé-cassé Osvald (Eric Caravaca, excellent lui aussi). Dans une optique freudienne réductrice, sur fond de débâcle sociale et psychologique, les deux personnages semblent jouer une pièce à part. Alors qu'Ibsen se défendait d'avoir écrit une pièce nihiliste, c'est bien une dévastation complète qu'illustre en crescendo la mise en scène d'Ostermeier.
À relire aujourd'hui la pièce, d'Ibsen, on constate toujours sa force critique dévastatrice, qui pourrait s'appliquer aux faux semblants actuels. Or Thomas Ostermeier peine à transposer le puritanisme d'une époque à l'autre. Dans la pièce, le pasteur Manders est évidemment un ecclésiastique norvégien de 1882, mais le même type existe aussi de nos jours, suave et pleutre, moralisant et vicelard. On le sent très fort dans le personnage du pasteur de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, comme chez nombre de romanciers américains contemporains. Mais quoi de commun entre le Manders d'Ibsen et le clergyman fade, lisse, creux et criseux campé par François Loriquet ? Ne chargeons pas le comédien, qui "fait le job", tandis que toute l'attention d'Ostermeier se porte sur la seule relation, oedipienne jusqu'à l'hystérie, liant Madame Alving (Valérie Dréville, remarquable au demeurant) et son fils paumé-cassé Osvald (Eric Caravaca, excellent lui aussi). Dans une optique freudienne réductrice, sur fond de débâcle sociale et psychologique, les deux personnages semblent jouer une pièce à part. Alors qu'Ibsen se défendait d'avoir écrit une pièce nihiliste, c'est bien une dévastation complète qu'illustre en crescendo la mise en scène d'Ostermeier. 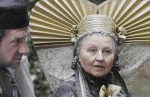

 S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette version, les explications de deux germanistes français de premier plan, l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider.
S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette version, les explications de deux germanistes français de premier plan, l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider.  En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnet) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...
En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnet) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...
 Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir.
Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir. 



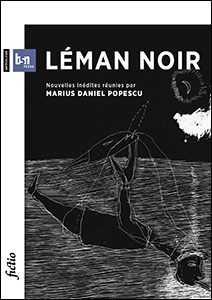






 Lecture de Fugues (1)
Lecture de Fugues (1) De l'admiration. - Ce qu'il y a tout de même d'admirable chez Sollers est son admiration. On le croit entièrement adonné à lui-même et cela peut exaspérer, mais son grand orgueil n'est pas tout vain (à la différence de l'orgueil, la vanité seule est toute vaine, comme nous l'expliquait un jour notre pasteur Serpolet au catéchisme de la paroisse des Oiseaux: "L'orgueil, c'est quand il y a de quoi, et la vanité quand il n'y a pas de quoi") car il réfracte l'orgueil universel de la nature déployé en reflets moirés comme la roue du paon. Or il est établi que Philippe Sollers est lui-même un admirable paon.
De l'admiration. - Ce qu'il y a tout de même d'admirable chez Sollers est son admiration. On le croit entièrement adonné à lui-même et cela peut exaspérer, mais son grand orgueil n'est pas tout vain (à la différence de l'orgueil, la vanité seule est toute vaine, comme nous l'expliquait un jour notre pasteur Serpolet au catéchisme de la paroisse des Oiseaux: "L'orgueil, c'est quand il y a de quoi, et la vanité quand il n'y a pas de quoi") car il réfracte l'orgueil universel de la nature déployé en reflets moirés comme la roue du paon. Or il est établi que Philippe Sollers est lui-même un admirable paon. Je n'ai rien, pour ma part, contre Pierre Michon, tout à fait estimable stylé styliste, et lui-même n'y peut rien non plus d'être adulé par ceux-là qui vouent à la littérature "littéraire" un culte à la fois touchant et comique, dont l'affectation de pureté restreint hélas le champ de ce qu'est réellement la littérature pour ceux qui l'aiment sans arrière-pensée sociale - tellement plus large et vivante!
Je n'ai rien, pour ma part, contre Pierre Michon, tout à fait estimable stylé styliste, et lui-même n'y peut rien non plus d'être adulé par ceux-là qui vouent à la littérature "littéraire" un culte à la fois touchant et comique, dont l'affectation de pureté restreint hélas le champ de ce qu'est réellement la littérature pour ceux qui l'aiment sans arrière-pensée sociale - tellement plus large et vivante! Sollers peut m'expliquer en quoi De Kooning, Picasso ou Manet relèvent de l'art souverain, comme Homère ou Diderot, mais il y a loin de l'explication à l'implication, et cela vaut pour tout le monde. Jusque-là, la porte du Paradis de Sollers m'est restée close. Plus grave: il m'a fallu des années avant de m'impliquer vraiment dans la lecture de la Recherche du temps perdu dont j'étais en mesure d'expliquer l'importance depuis mes dix-huit ans. Par ailleurs, je n'attends pas un mot de Sollers sur Dostoïevski, Tchékhov ou Simenon. Chacun son guichet, comme le disait notre ami Pierre Gripari, qui ne comprenait rien à l'art souverain de Charles-Albert Cingria ni au génie visionnaire de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dieux de ma jeunesse et restés tels.Bref, la guerre du goût continue. Philipe Sollers retrouve donc les dieux de l'Illiade: "Sous eux, la terre divine fait croître des herbes nouvelles, le lotus couvert de rosée, le safran, la jacinthe". Tout cela évidemment "dans un nuage d'or". Pendant ce temps, "dans la plaine mortelle, Diomède et son compagnon "marchent, pareils à deux lions, par la nuit ténébreuse, entre les corps, le carnage. le sang noir, les armes". Et Sollers de conclure: "On lit très jeune ces passages, et, pour la vie, ce ciel des rêves est ouvert"...
Sollers peut m'expliquer en quoi De Kooning, Picasso ou Manet relèvent de l'art souverain, comme Homère ou Diderot, mais il y a loin de l'explication à l'implication, et cela vaut pour tout le monde. Jusque-là, la porte du Paradis de Sollers m'est restée close. Plus grave: il m'a fallu des années avant de m'impliquer vraiment dans la lecture de la Recherche du temps perdu dont j'étais en mesure d'expliquer l'importance depuis mes dix-huit ans. Par ailleurs, je n'attends pas un mot de Sollers sur Dostoïevski, Tchékhov ou Simenon. Chacun son guichet, comme le disait notre ami Pierre Gripari, qui ne comprenait rien à l'art souverain de Charles-Albert Cingria ni au génie visionnaire de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dieux de ma jeunesse et restés tels.Bref, la guerre du goût continue. Philipe Sollers retrouve donc les dieux de l'Illiade: "Sous eux, la terre divine fait croître des herbes nouvelles, le lotus couvert de rosée, le safran, la jacinthe". Tout cela évidemment "dans un nuage d'or". Pendant ce temps, "dans la plaine mortelle, Diomède et son compagnon "marchent, pareils à deux lions, par la nuit ténébreuse, entre les corps, le carnage. le sang noir, les armes". Et Sollers de conclure: "On lit très jeune ces passages, et, pour la vie, ce ciel des rêves est ouvert"... 



 Pour une transmission salutaire
Pour une transmission salutaire
