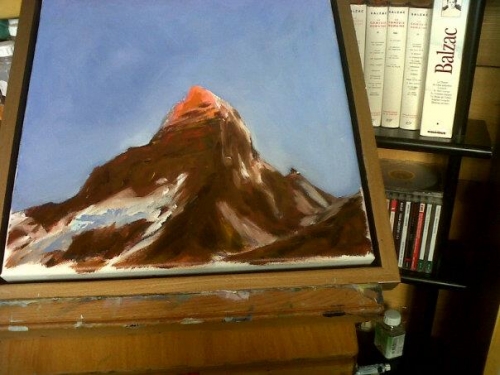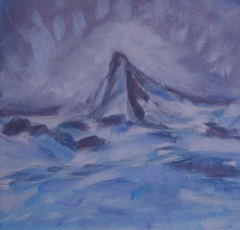Livre - Page 2
-
Le bouvreuil d'Emily
 "Et je soupire faute de ciel - mais non pas / Le ciel qu'accordent les croyances" (Emily Dickinson)Fragile, opposant l’arme blanchede son sourire tranquille,au lieu d’aucune des revanchesqu’inspirent les désirs,la nuit venue il va parler,à l’insu des vivantsaux disparus des temps récents,dont le silence mêmelui est le plus ardent poème…Baudelaire ce soir est absent,trop princier dans le noir,mais deux yeux comme pris au cield’un pâle immatérielsemblent chercher l’ardent en toi,ou l’autre différent,voici le voyou des vocables,l’ami des écraseurs de poux,le dormeur éveillé –voilà le poète incarné:le Rimbe des illuminés…Aussi pour la mélancolieLeopardi parlaità la nuit que tu écoutais,et Verlaine au cœur le plus purà l’Américaine Emilyperdue dans la nature,parlait de leur petit bouvreuilau rebord des cercueils –douces âmes sans autre défenseque l’innocente transe…
"Et je soupire faute de ciel - mais non pas / Le ciel qu'accordent les croyances" (Emily Dickinson)Fragile, opposant l’arme blanchede son sourire tranquille,au lieu d’aucune des revanchesqu’inspirent les désirs,la nuit venue il va parler,à l’insu des vivantsaux disparus des temps récents,dont le silence mêmelui est le plus ardent poème…Baudelaire ce soir est absent,trop princier dans le noir,mais deux yeux comme pris au cield’un pâle immatérielsemblent chercher l’ardent en toi,ou l’autre différent,voici le voyou des vocables,l’ami des écraseurs de poux,le dormeur éveillé –voilà le poète incarné:le Rimbe des illuminés…Aussi pour la mélancolieLeopardi parlaità la nuit que tu écoutais,et Verlaine au cœur le plus purà l’Américaine Emilyperdue dans la nature,parlait de leur petit bouvreuilau rebord des cercueils –douces âmes sans autre défenseque l’innocente transe… -
Comme en rêvait le Capitaine
 « La grammaires est la base, le fondementde toutes les connaissances humaines ».(Frédéric Rimbaud, père d’Arthur,combattant en Crimée et traducteur du Coran)Je ne vous entends pas très biendans le grand bruit que fonttous vos influenceurs,où toute opinion les vaut toutes,où tout devient déroute,parodie de vaine sapienceou prétexte à haute palabredans la langue de marbre,je veux dire : la langue de boisau fil de sabrede l’imbécile impatienceindifférente aux vraies saveurs…La Machine saura très bienmimer cette grammaire,et moduler tout savoir-fairede l’ancienne parluresans faille ni rature,saura même le point-virgule,secret de la féruledes anciens maîtres littéraires,saura tout n’est-ce pas,sauf le devinez-quoi…Le père de Rimbaud parlait fort,mais rêvait en secretd’un fils lui sortant de la cuisseet parlant comme on dit: en langue,sans éviter l’harangueun peu vulgaire dans les troquets ;un vrai fils quoi, qui bande et pisseau ciel où Dieu raviqu’on Le fasse exister ainsine peut que tout bénirde ce chant et de son soupir…
« La grammaires est la base, le fondementde toutes les connaissances humaines ».(Frédéric Rimbaud, père d’Arthur,combattant en Crimée et traducteur du Coran)Je ne vous entends pas très biendans le grand bruit que fonttous vos influenceurs,où toute opinion les vaut toutes,où tout devient déroute,parodie de vaine sapienceou prétexte à haute palabredans la langue de marbre,je veux dire : la langue de boisau fil de sabrede l’imbécile impatienceindifférente aux vraies saveurs…La Machine saura très bienmimer cette grammaire,et moduler tout savoir-fairede l’ancienne parluresans faille ni rature,saura même le point-virgule,secret de la féruledes anciens maîtres littéraires,saura tout n’est-ce pas,sauf le devinez-quoi…Le père de Rimbaud parlait fort,mais rêvait en secretd’un fils lui sortant de la cuisseet parlant comme on dit: en langue,sans éviter l’harangueun peu vulgaire dans les troquets ;un vrai fils quoi, qui bande et pisseau ciel où Dieu raviqu’on Le fasse exister ainsine peut que tout bénirde ce chant et de son soupir… -
Comme une joie retrouvée
 « La joie exige toujours plus d’abandon,plus de courage que la douleur ». (Hugo von Hofmannstahl)Je suis en somme assez gentildit le Sage à L’Image,tantôt fusain tantôt fourmidans les instants d’éternité,et tantôt adagio ;voici que tu me dévisageset sonde nos présagesau plus pur de mes yeux ;voici le bilan de nos âges :nous serions tout ce que le venten sa confuse rage,n’a su défaire de nos vœux…L’enfant dessine dans son coin :le monde est relevépar son geste réitérantl’Entête en testament,le chaos n’est qu’une illusionà ses yeux innocents :il en sait plus long sur vos crimesque le dit la mémoire infirmede vos aveuglements,et son crayon sera joyeux…Tout au déni de l’euphorie,de la meute repues’agitant en mornes lubies,la plus heureuse compagnieretrouvée loin des troupespratique ses amours en groupeet vous pince le nez…Peinture: Jacques Pajak.
« La joie exige toujours plus d’abandon,plus de courage que la douleur ». (Hugo von Hofmannstahl)Je suis en somme assez gentildit le Sage à L’Image,tantôt fusain tantôt fourmidans les instants d’éternité,et tantôt adagio ;voici que tu me dévisageset sonde nos présagesau plus pur de mes yeux ;voici le bilan de nos âges :nous serions tout ce que le venten sa confuse rage,n’a su défaire de nos vœux…L’enfant dessine dans son coin :le monde est relevépar son geste réitérantl’Entête en testament,le chaos n’est qu’une illusionà ses yeux innocents :il en sait plus long sur vos crimesque le dit la mémoire infirmede vos aveuglements,et son crayon sera joyeux…Tout au déni de l’euphorie,de la meute repues’agitant en mornes lubies,la plus heureuse compagnieretrouvée loin des troupespratique ses amours en groupeet vous pince le nez…Peinture: Jacques Pajak. -
Le viol de l'ange
1
La Cité des Hespérides avait un air de décor de cinéma à l’abandon, ce matin-là, lorsque la porte du parking souterrain du Bloc A s’ouvrit en silence pour livrer passage à la Toyota Fan Cruiser 4x4 mauve fluo de Jo et Muriel Kepler.
Du poste habituel où le tenait l’insomnie, l’observateur avait suivi les faits et gestes des jeunes gens dès leur lever, excité comme à chaque fois par leur complète impudeur. Ainsi, tout en pianotant ses observations sur son Mac, avait-il vu Muriel apparaître nibards à l’air (c’est l’observateur qui qualifie de nibards les seins de Muriel), vaquer de la chambre à coucher à la cuisine où elle s’était activée à sa cadence ordinaire de battante, puis à la salle d’eau et jusque sur le balcon où elle surgit en string pour constater qu’il faisait un temps super comme annoncé le soir précédent à la météo de Natacha.
L’observateur avait concentré toute sa haine en assistant à ces préparatifs de bonheur standard que les Kepler, estimait-il, lui infligeaient comme une provocation personnelle. À ses yeux, le couple incarnait la vie facile et jouissive dont la fatalité l’avait lui-même rejeté. Quoique troublé à chaque fois qu’il les surprenait dans leur intimité, il les considérait comme des créatures vides, incapables de gestes imprévus. C’était en ricanant qu’il observait leur chair sportive dénudée quand ils se livraient, sur le même rythme, à la copulation du soir ou à l’aérobic du matin. Une brève enquête complémentaire lui avait permis de constater la banalité répétitive de leur existence. Jo était employé dans une agence de publicité et Muriel tenait le bar du fitness Hyperforme où son conjoint la rejoignait tous les midis pour leur séance principale de maintien. Le couple n’avait ni progéniture ni compagnie animale. Diverses indiscrétions, au snack du Centre Com, chez le coiffeur Danilo et auprès du concierge Cardoso, avaient appris à l’observateur que la Fan Cruiser n’était pas payée et qu’il y avait depuis quelque temps un problème entre Jo et Muriel, auxquels leur sexologue avait conseillé les soirées-détente du club d’échangistes Gold Beach sis au centre de la ville, juste au-dessus des bureaux de Maître Lefort, le fameux avocat d’affaires. Pour le reste, la vie des Kepler se déroulait en fonction de programmes assez strictement réglés où le fun compensait, pour Jo, le stress de l’agence. Une légère tendance à l’enveloppement le contraignait à se surveiller de très près s’il voulait conserver son look, mais Muriel avait de la ténacité pour deux et jamais elle n’eût toléré un doigt de graisse chez son partenaire – l’observateur avait compris depuis longtemps que c’était Muriel, dans le couple, qui jouait le rôle ascendant, comme il l’inscrivit avec tout le reste dans le fichier nominal des intéressés, à la lettre K du dossier Bloc A.
À l’instant où la 4x4 s’arrêta au sommet de la rampe d’accès au parking du Bloc A, le dernier bulletin de World Info annonçait la prise de l’enclave musulmane de Srebrenica par les Serbes, mais les Kepler, n’ayant pas encore branché leur poste, n’entendirent pas cette nouvelle qu’ils eussent d’ailleurs accueillie avec une ?probable indifférence. Pour lors, l’observateur se livrait à tout un jeu de prédictions tandis que Jo et Muriel, sortis de leur véhicule, procédaient là-bas aux ultimes vérifications d’avant le départ.
Ces cons-là vont remonter dans leur tire de frimeurs, songeait l’observateur, et le type va faire à sa typesse le fameux geste du pouce levé des cracks de séries policières, du style okay let’s go. Ensuite il va faire crisser ses pneus et foncer jusqu’à l’angle du Centre Com, après quoi j’ai plus qu’à fermer les yeux pour les voir.
Et de fait, les Kepler étaient remontés dans la Fan Cruiser, Jo avait fait crisser les pneus et foncé jusqu’à l’angle du Centre Com au-delà duquel, comme le prévoyait l’observateur, il couperait à travers la ville encore déserte jusqu’à la banlieue ouest où il rejoindrait l’autoroute du Sud.
Ensuite, figé dans la pénombre, l’observateur allait poursuivre quelque temps la Fan Cruiser en imagination tout en flairant les émanations de gazole montant de la cour arrière du Bloc A.
Or il les voyait comme s’il y était, tous deux vêtus du même survêtement et dégageant de capiteux effluves d’eau de toilette, aussi lisses et nets que des top models. Et précisément, feuilletant le dernier numéro de la revue Fantasme, Muriel venait de tomber sur l’image d’un couple enlacé dans la lumière émeraude d’une clairière de forêt tropicale, où l’imminence de la volupté se trouvait doublement exaltée par l’ambiance édénique du lieu et la formule de la pub évoquant Un Intense Sentiment de Liberté.
L’observateur avait imaginé que les Kepler accompliraient leur descente à la Grande Bleue en deux trois étapes de deux trois heures ponctuées de deux trois arrêts, et c’était en effet le plan de Jo et Muriel. En revanche, l’observateur avait mal interprété les propos qu’il avait surpris au snack du Centre Com, lorsque Muriel avait claironné, à la table voisine, que la perspective de s’éclater sur le sable du complexe naturiste la branchait complètement. De fait, ce n’était pas à la classique île du Levant que les Kepler se retrouveraient le même soir, mais en l’espace balnéaire d’Héliopolis, au cap d’Agde.
Quoi qu’il en fût, les prévisions de l’observateur concernant les Kepler valaient dans les grandes lignes, logiquement déduites des inscriptions qu’il avait sériées depuis leur installation au septième étage du Bloc A, quelques mois auparavant. Vingt jours durant, les Kepler allaient se consacrer principalement au bronzage intégral en alternant, pour maintenir leur superforme, les séances d’aérobic et les virées en VTT de location sur les routes de l’arrière-pays. Comme le prévoyait l’observateur, ils baiseraient deux trois fois par jour en s’efforçant de solutionner leur problème, liraient deux trois magazines et sortiraient en boîte deux trois fois par semaine. En aucun cas ils ne se diraient quoi que ce soit d’important, pensait l’observateur, et peut-être avait-il raison ? En aucun cas ils ne s’occuperaient d’autre chose que de leur corps et des objets attenant à leurs aises, avait-il également supputé, non sans justesse. Les Kepler estimaient de leur côté que rien ne pouvait leur arriver, et l’observateur considérait lui aussi qu’à de telles gens, dont le fonctionnement évoque celui de machines, la destinée ne saurait faire le cadeau du moindre imprévu. Or il devait, très vite, en aller tout autrement.
Cependant, après que le mur d’angle du Centre Com des Hespérides eut escamoté la Fan Cruiser mauve fluo des Kepler, l’observateur désactiva leur fichier sur l’écran de son Mac et revint au plan d’ensemble des blocs A à C où divers mouvements se manifestaient depuis quelques instants.
Hypertexte. – À l’apparente quiétude de cette splendide matinée d’été se mêlait déjà, pourtant, le sentiment d’un indéfinissable malaise. À quoi cela tenait-il ? C’était pour ainsi dire dans l’air. Peut-être même cela oblitérait-il la lumière ? La netteté particulière des choses, ce matin-là, n’avait pas empêché Muriel Kepler de ressentir la même vague sensation d’être engagée dans une impasse qui oppressait des millions de gens, notamment dans l’ensemble des sociétés tenues pour les plus évoluées. Mais quel sens tout cela diable avait-il ? Une vie vouée au shopping méritait-elle encore d’être vécue ? Dans le cas précis de la Cité des Hespérides, l’architecture même semblait distiller une espèce de torpeur qu’on retrouvait à vrai dire dans toutes les zones de périphérie urbaine. L’impression que les blocs d’habitation qu’il y avait là et que les parkings qu’il y avait là, que les espaces verts qu’il y avait là et que les containers de déchets qu’il y avait là se multipliaient en progression exponentielle sur les cinq continents aboutissait, pour qui en prenait effectivement conscience, à une sorte d’accablement proche de la désespérance que seuls des programmes en tout genre paraissaient en mesure de pallier. Ainsi l’aérobic et la diététique, les thérapies de toutes espèces et la créativité multiforme entretenaient-ils l’illusion d’une activité positive quoique périphérique elle aussi. Or tout devenait périphérique à cette époque. Dans le mouvement s’étaient perdus la notion de centre et jusqu’au sentiment d’appartenance à telle communauté privée ou publique. L’impression dominante que tout était désormais possible se diluait en outre dans une sensation générale d’inassouvissement qui exacerbait le besoin de se distraire ou plus précisément, ce jour-là, le désir de se retrouver sur n’importe quelle plage à ne plus penser à rien. Cependant une femme souffrait réellement, à l’instant précis, dans l’habitacle d’un véhicule lancé à vive allure à destination des simulacres de félicité – Muriel Kepler retenait un cri.
-
Rebond de la prairie
 (Comme un salut matinal)L’indien me rejoint dans l’horloge:le vivant pendulaireaux intuitions de broussea encore des choses à me direen intenses secousses.Une boussole nous manquaità tous deux ce matind’aube neuve au lancer du chemin.Je le vois revenant d’Afrique,mon Sénégalais à sagaies de sagesse,aux yeux tendres de Népalais,aux manières exquisesd’Inuit stylé sur sa banquise...Je l’attendais sur ma poutrelle,là-haut d’où je vous vois tousà toutes vos affaires,en sensibles ribambelles vues de la stratosphère,tellement émouvants, mes vivants,à piétiner les serresoù songent les dormants.Je savais qu’il me viendrait ce matin d’hiver où tout semble exclu,mais l’horloge attendaitce retour de rivière.Et le voici que je salue...
(Comme un salut matinal)L’indien me rejoint dans l’horloge:le vivant pendulaireaux intuitions de broussea encore des choses à me direen intenses secousses.Une boussole nous manquaità tous deux ce matind’aube neuve au lancer du chemin.Je le vois revenant d’Afrique,mon Sénégalais à sagaies de sagesse,aux yeux tendres de Népalais,aux manières exquisesd’Inuit stylé sur sa banquise...Je l’attendais sur ma poutrelle,là-haut d’où je vous vois tousà toutes vos affaires,en sensibles ribambelles vues de la stratosphère,tellement émouvants, mes vivants,à piétiner les serresoù songent les dormants.Je savais qu’il me viendrait ce matin d’hiver où tout semble exclu,mais l’horloge attendaitce retour de rivière.Et le voici que je salue... -
Notre père qui est aux cieux

Notre cher père (1915-1983) aurait fêté aujourd’hu ses 110 ans, digne d’être cité à l’ordre mondial du Transhumanisme, mais en aurait-il demandé autant ? J’en doute. Car il n’était pas du genre champion. Plutôt la crème des bons types, peu porté à la révolte (il s’est efforcé de tempérer mes élans en mai 68) et à l’insoumission, avec les préjugés marqués de sa génération et de sa classe d’Helvète moyen (Arabe et Juifs assimilés à des nez crochus, et Levantins trop lustrés à des macaques) , mais pas idéologue ni vindicatif à aucun égard et jamais amorti après sa retraite des assurances où il finit inspecteur à son dam (les chicanes lui faisant horreur), vivant plutôt heureux en ses dernipres années malgré son crabe à multiples rémissions et rechutes, cultivant son jardin au propre et de façons diverses entre le tissage et la peinture florale sur porcelaine, les voyages avec sa moiti et les petits enfants. À l’opposé du bohème irrégulier que je suis, c’était un régulier cravaté de tous les matins sauf aux jours d’été où les bras de chemise étaient de mise, etc.
-
Ajouter de la vie aux jours...
 Ce samedi 10 janvier.– Le souffle à la peine, et le cœur à l’avenant, j’essaye ce matin gris, ce matin de chagrin persistant par delà ou en deça du grand deuil de nos frères humains, de me relever en lisant De la poésie d’Ossip Mandelstam, poète assassiné qui a dit ce qu’il fallait dire de ladite poésie, à savoir qu’on n’en sait rien...Hier, une belle jeune fille, entre deux camarades aussi beaux et dignes qu’elle, sans une larme en face de l'immense foule recueillie, et devant tous le pays aux écrans, a dit quelques mots qui nous ont laissé sans voix, justement inspirés par les mots de la poésie la plus simple: "On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours », a-t-elle dit, et je pense maintenant à l’énorme défi lancé au désespoir par ces trois jeunes gens au nom des disparus et des vivants de leur âge, mais aussi de nous tous, et voici que des mots me viennent comme à tâtons qui sont mon propre défi aux jours qui viennent :On ne sait pas à quoi ça rimeon ne voit que des mots,on se croit protégé du crime,de garder les yeux clos…La poésie de par le temps,se retrouve au présent,disant partout comme un défi,ce qu'elle sait de la vie...Je sais, moi, que je ne sais rien,qu’elle soit celle qu’on disaitque tous ont oublié,ou qu’elle soit ce qu’elle sera...°°°Une caricature abjecte, relative à la tragédie du 1er janvier, montre à quel niveau de bassesse et de cynisme grossier la rédaction de Charlie Hebdo s'est abaissée désormais, qui fait insulte à la mémoire des bons garçons qu'étaient Cabu et sa tribu. On ne souhaitera pas à ces imbéciles de se faire massacrer à leur tour, mais quelle triste façon de ricaner…
Ce samedi 10 janvier.– Le souffle à la peine, et le cœur à l’avenant, j’essaye ce matin gris, ce matin de chagrin persistant par delà ou en deça du grand deuil de nos frères humains, de me relever en lisant De la poésie d’Ossip Mandelstam, poète assassiné qui a dit ce qu’il fallait dire de ladite poésie, à savoir qu’on n’en sait rien...Hier, une belle jeune fille, entre deux camarades aussi beaux et dignes qu’elle, sans une larme en face de l'immense foule recueillie, et devant tous le pays aux écrans, a dit quelques mots qui nous ont laissé sans voix, justement inspirés par les mots de la poésie la plus simple: "On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours », a-t-elle dit, et je pense maintenant à l’énorme défi lancé au désespoir par ces trois jeunes gens au nom des disparus et des vivants de leur âge, mais aussi de nous tous, et voici que des mots me viennent comme à tâtons qui sont mon propre défi aux jours qui viennent :On ne sait pas à quoi ça rimeon ne voit que des mots,on se croit protégé du crime,de garder les yeux clos…La poésie de par le temps,se retrouve au présent,disant partout comme un défi,ce qu'elle sait de la vie...Je sais, moi, que je ne sais rien,qu’elle soit celle qu’on disaitque tous ont oublié,ou qu’elle soit ce qu’elle sera...°°°Une caricature abjecte, relative à la tragédie du 1er janvier, montre à quel niveau de bassesse et de cynisme grossier la rédaction de Charlie Hebdo s'est abaissée désormais, qui fait insulte à la mémoire des bons garçons qu'étaient Cabu et sa tribu. On ne souhaitera pas à ces imbéciles de se faire massacrer à leur tour, mais quelle triste façon de ricaner… -
La Tragédie du Nouvel-An, du désespoir à la colère
 De l'indicible émotion partagée aux questions qui fâchent, le drame affreux survenu à Crans-Montana a montré le meilleur et le pire : de l’héroïsme, côté sauveteurs, et de la compassion collective sincère d’une part, mais aussi des failles du « trop humain»...Le grand ciel bleu pur du 1er de l’an 2026 se déployait à vos fenêtres à l’enseigne de ce qu’on peut dire le Chant du monde, quand les premiers échos de l’Horreur pure vous sont parvenus par les médias et les réseaux affolés, vous rappelant soudain l’évidence du Poids du monde. Bilan immédiatement communiqué : 40 morts, dont vingt mineurs, brûlés vifs dans un incendie fulgurant, et plus de 100 blessés, dont 80 grands brûlés…Dès le premier jour, la Douleur partagée fut incommensurable. Même inimaginables pour la plupart d’entre nous, les scènes vécues et parfois filmées, cette nuit-là, dans le piège de feu, nous ont permis de visualiser l’horreur. Or à l’horreur pure se sont bientôt mêlé les éléments impurs de la rumeur faisant état de manquements scandaleux, et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignoraient encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on était encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée, et le pur et l’impur se sont confondus au fil des jours, mêlant la compassion et de douteuses curiosités comme toujours à l’entour des scènes d’accidents ou de crimes, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion, aussi, des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ? Celui-ci relevait-il de la fatalité, ou le pire aurait-il pu être évité ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les fraudes particulières, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ? Ainsi la part d’ombre de l’humain s’est-elle révélée en même temps qu’on découvrait les récits bouleversants des sauveteurs et des jeunes survivants dont certains auront risqué leur vie pour aider leurs camarades.Quant aux « questions qui fâchent » liées aux raisons objectives, immédiatement citées ou esquivées par les uns et les autres, elles n’ont rien d’indécent et vont même devenir le cœur du débat à venir « à l’international », au dam de la république locale des petits copains, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.Autre exemple de la double face – ombre et lumière - du réel : l’on a beau répéter que les médias et les réseaux sociaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, vous aurez constaté que c’est bel et bien par maints internautes lucides et avisés, et autant de journalistes respectueux de l’éthique, qu’ont été posées, et alimentées, lesdites « questions qui fâchent »Ainsi le quotidien 24 Heures aura-il consacré à la tragédie, dès le 3 janvier, un dossier de six pages solidement documenté faisant état de manquements significatifs, voire scandaleux, dans la sécurité du bar incendié, entre autres lieux festifs « problématiques ».« À l’évidence, écrit ainsi notre consoeur Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescents les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie générales. »Dans la foulée, l’on se gardera de tout jugement précipité. Mais au chapitre de la précipitation, que dire de cette commune de Crans-Montana qui s’empresse, sur le conseil d’une boîte de conseil marketing zurichois, de se poser en victime en tentant de se porter partie civile, alors que ses responsabilités sont engagées à l’évidence dans le (non)contrôle du bar en question ?Comme le relève très justement (sur Facebook) une habitante de Crans-Montana, du nom de Véronique Madeleine Colagioia-Wisard, « on ne dirige pas une commune à voix basse et portes fermées. Si la présidence n’assume pas la parole publique quand tout brûle, alors elle n’assume pas la fonction, elle en occupe seulement le titre ». Les uns s'empressent d'effacer toute trace, comme s’y est employé le tenancier au passé crapuleux en « épurant » son compte Facebook, les autres se dédouanent à bas bruit, tel politicard genevois suggère que c'est pire à Gaza, tel autre se désole du « déficit d’image » dont va souffrir notre pays au-dessus de tout soupçon. Autant d'insultes aux victimes brûlées vives et à leurs proches...Quand il importe de « rester juste »Les premiers corps des victimes étant rendus aux parents, vous vous figurez l’horreur. Vous pensez à ceux qui restent dans l’attente, vous vous identifiez à eux, et vous vous taisez. Vous pourriez le crier, mais vous vous taisez. Vous restez sans voix. Il y a quatre jours déjà que d’innombrables voix crient en vous, et c’est la première fois que vous souffrez pour autant d’inconnus, vous les entendez comme si chacun était l’un de vos enfants, et de constater que des centaines, des milliers de gens ressentent la même chose que vous n’y change rien: c’est une affaire d’intimité partagée que ce drame atroce qui vous fait vous identifier aux victimes et aux amis des victimes, aux parents de victimes et à tous ceux qui comme vous s’identifient à ceux-là parce qu’ils ont des enfants et sûrement la même peur du feu ; vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas vu que vos enfants y ont échappé, mais vous n’y pensez même pas, à vrai dire il n’y a rien à penser à ce moment-là mais juste à ressentir, sur quoi vous avez constaté que votre ressenti l’avait été par des centaines et des milliers de gens qui, comme vous, auront trouvé quelque chose de révoltant dans les irrégularités avérées, vous voyez maintenant enfler une rumeur de condamnation et de vengeance, mais vous vous dites, une fois de plus et comme toujours, que justice n’est pas vengeance, sur quoi la vision de foules réellement solidaires se recueillant dans les chapelles et par les rues, dont vous ne doutez pas de la sincérité, l’évidente dignité des braves gens opposée au déni des responsabilités, vous aura conforté dans votre position de frère humain, entre ombres et lumière, juste résolu à « rester juste » en attendant que justice agisse dignement, si tant est que...
De l'indicible émotion partagée aux questions qui fâchent, le drame affreux survenu à Crans-Montana a montré le meilleur et le pire : de l’héroïsme, côté sauveteurs, et de la compassion collective sincère d’une part, mais aussi des failles du « trop humain»...Le grand ciel bleu pur du 1er de l’an 2026 se déployait à vos fenêtres à l’enseigne de ce qu’on peut dire le Chant du monde, quand les premiers échos de l’Horreur pure vous sont parvenus par les médias et les réseaux affolés, vous rappelant soudain l’évidence du Poids du monde. Bilan immédiatement communiqué : 40 morts, dont vingt mineurs, brûlés vifs dans un incendie fulgurant, et plus de 100 blessés, dont 80 grands brûlés…Dès le premier jour, la Douleur partagée fut incommensurable. Même inimaginables pour la plupart d’entre nous, les scènes vécues et parfois filmées, cette nuit-là, dans le piège de feu, nous ont permis de visualiser l’horreur. Or à l’horreur pure se sont bientôt mêlé les éléments impurs de la rumeur faisant état de manquements scandaleux, et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignoraient encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on était encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée, et le pur et l’impur se sont confondus au fil des jours, mêlant la compassion et de douteuses curiosités comme toujours à l’entour des scènes d’accidents ou de crimes, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion, aussi, des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ? Celui-ci relevait-il de la fatalité, ou le pire aurait-il pu être évité ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les fraudes particulières, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ? Ainsi la part d’ombre de l’humain s’est-elle révélée en même temps qu’on découvrait les récits bouleversants des sauveteurs et des jeunes survivants dont certains auront risqué leur vie pour aider leurs camarades.Quant aux « questions qui fâchent » liées aux raisons objectives, immédiatement citées ou esquivées par les uns et les autres, elles n’ont rien d’indécent et vont même devenir le cœur du débat à venir « à l’international », au dam de la république locale des petits copains, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.Autre exemple de la double face – ombre et lumière - du réel : l’on a beau répéter que les médias et les réseaux sociaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, vous aurez constaté que c’est bel et bien par maints internautes lucides et avisés, et autant de journalistes respectueux de l’éthique, qu’ont été posées, et alimentées, lesdites « questions qui fâchent »Ainsi le quotidien 24 Heures aura-il consacré à la tragédie, dès le 3 janvier, un dossier de six pages solidement documenté faisant état de manquements significatifs, voire scandaleux, dans la sécurité du bar incendié, entre autres lieux festifs « problématiques ».« À l’évidence, écrit ainsi notre consoeur Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescents les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie générales. »Dans la foulée, l’on se gardera de tout jugement précipité. Mais au chapitre de la précipitation, que dire de cette commune de Crans-Montana qui s’empresse, sur le conseil d’une boîte de conseil marketing zurichois, de se poser en victime en tentant de se porter partie civile, alors que ses responsabilités sont engagées à l’évidence dans le (non)contrôle du bar en question ?Comme le relève très justement (sur Facebook) une habitante de Crans-Montana, du nom de Véronique Madeleine Colagioia-Wisard, « on ne dirige pas une commune à voix basse et portes fermées. Si la présidence n’assume pas la parole publique quand tout brûle, alors elle n’assume pas la fonction, elle en occupe seulement le titre ». Les uns s'empressent d'effacer toute trace, comme s’y est employé le tenancier au passé crapuleux en « épurant » son compte Facebook, les autres se dédouanent à bas bruit, tel politicard genevois suggère que c'est pire à Gaza, tel autre se désole du « déficit d’image » dont va souffrir notre pays au-dessus de tout soupçon. Autant d'insultes aux victimes brûlées vives et à leurs proches...Quand il importe de « rester juste »Les premiers corps des victimes étant rendus aux parents, vous vous figurez l’horreur. Vous pensez à ceux qui restent dans l’attente, vous vous identifiez à eux, et vous vous taisez. Vous pourriez le crier, mais vous vous taisez. Vous restez sans voix. Il y a quatre jours déjà que d’innombrables voix crient en vous, et c’est la première fois que vous souffrez pour autant d’inconnus, vous les entendez comme si chacun était l’un de vos enfants, et de constater que des centaines, des milliers de gens ressentent la même chose que vous n’y change rien: c’est une affaire d’intimité partagée que ce drame atroce qui vous fait vous identifier aux victimes et aux amis des victimes, aux parents de victimes et à tous ceux qui comme vous s’identifient à ceux-là parce qu’ils ont des enfants et sûrement la même peur du feu ; vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas vu que vos enfants y ont échappé, mais vous n’y pensez même pas, à vrai dire il n’y a rien à penser à ce moment-là mais juste à ressentir, sur quoi vous avez constaté que votre ressenti l’avait été par des centaines et des milliers de gens qui, comme vous, auront trouvé quelque chose de révoltant dans les irrégularités avérées, vous voyez maintenant enfler une rumeur de condamnation et de vengeance, mais vous vous dites, une fois de plus et comme toujours, que justice n’est pas vengeance, sur quoi la vision de foules réellement solidaires se recueillant dans les chapelles et par les rues, dont vous ne doutez pas de la sincérité, l’évidente dignité des braves gens opposée au déni des responsabilités, vous aura conforté dans votre position de frère humain, entre ombres et lumière, juste résolu à « rester juste » en attendant que justice agisse dignement, si tant est que... -
Après le feu
(Aux martyrs du 1er janvier)La tristesse les a saisis,tous et tant qu’ils étaient,ceux-là qu’on savait familiers,et soudain, rassemblés,tous les vivants soudain muetsdevant les cendres d’après le feu,les cendres désormaissans visages et sans noms -les cendres enfants du néant …Le chagrin n’est pas convié:il remonte tout seul,tout à coup le voiciqui les étreint tous au même seuil:on leur a rendu les enfants … -
Ô désespoir ! Ô rage !
 De l'indicible émotion aux questions qui fâchent...Au troisième jour la Douleur reste incommensurable, pour la plupart d’entre nous les scènes vécues cette nuit-là dans le piège de feu demeurent inimaginables malgré les atroces bribes de séquences vidéo commençant de se répandre par les médias et les réseaux.Or justement à l’horreur pure se mêlent à présent les éléments impurs de la rumeur et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignorent encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on est encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée et le pur et l’impur se confondent déjà, déjà se mêlent la compassion et sûrement d’abjectes curiosités comme toujours à l’entour des scènes de crime ou de guerre, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les arnaques particulières et le blanchiment en tout genre, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ?Le désespoir va-t-il bientôt engendrer la rage ? C’est plus que probable, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.L’on a beau savoir que les médias et les réseaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, nous voyons ce matin que c’est bel et bien par les réseaux et les médias aussi que les contrefeux s’y manifestent par une juste rage.Ainsi le quotidien 24 Heures consacre-t-il ce matin six pages à la tragédie du Nouvel An, avec cet édito de Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, auquel chacune et chacun ne peuvent que souscrire :L’éditorialCrans-Montana et maintenant ?Par Virginie LenkUn plafond en feu et des jeunes qui filment les flammes en dansant. Ces images du début de l’incendie du bar Le constellation sont tragiques. Tragiques dans l’insouciance de ces jeunes gens pleins de vie qui ne se rendent pas encore compte que l’horreur est en marche. Elle rattrape chaque parent, qui voit dans ces visages celui de leur propre enfant.Combien de fois, ai-je entendu au lendemain du drame, dans les rues de la station, cette phrase terrible : « ç’aurait pu être nous » ?Ça n’aurait dû être personne, et à l’injustice du sort se mêle aujourd’hui notre colère. L’établissement en question était clairement problématique. Les témoignages sur place le montrent et notre enquête. Sans préjuger, car la justice doit avoir tout le temps nécessaire pour lever le moindre doute.Les responsables devront répondre de ces manquements. La question se pose pour d’autres lieux similaires. À l’évidence, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescent les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie général.Mes enfants, vos enfants auraient pu faire la fête au Constellation. Ils retourneront la boule au ventre dans un bar bondé. Et puis, avec le temps, ils oublieront. C’est leur force. La nôtre est de ne pas laisser une telle tragédie se reproduire.(Cf l’édition de 24 Heures du samedi 3 janvier 2026)
De l'indicible émotion aux questions qui fâchent...Au troisième jour la Douleur reste incommensurable, pour la plupart d’entre nous les scènes vécues cette nuit-là dans le piège de feu demeurent inimaginables malgré les atroces bribes de séquences vidéo commençant de se répandre par les médias et les réseaux.Or justement à l’horreur pure se mêlent à présent les éléments impurs de la rumeur et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignorent encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on est encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée et le pur et l’impur se confondent déjà, déjà se mêlent la compassion et sûrement d’abjectes curiosités comme toujours à l’entour des scènes de crime ou de guerre, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les arnaques particulières et le blanchiment en tout genre, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ?Le désespoir va-t-il bientôt engendrer la rage ? C’est plus que probable, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.L’on a beau savoir que les médias et les réseaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, nous voyons ce matin que c’est bel et bien par les réseaux et les médias aussi que les contrefeux s’y manifestent par une juste rage.Ainsi le quotidien 24 Heures consacre-t-il ce matin six pages à la tragédie du Nouvel An, avec cet édito de Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, auquel chacune et chacun ne peuvent que souscrire :L’éditorialCrans-Montana et maintenant ?Par Virginie LenkUn plafond en feu et des jeunes qui filment les flammes en dansant. Ces images du début de l’incendie du bar Le constellation sont tragiques. Tragiques dans l’insouciance de ces jeunes gens pleins de vie qui ne se rendent pas encore compte que l’horreur est en marche. Elle rattrape chaque parent, qui voit dans ces visages celui de leur propre enfant.Combien de fois, ai-je entendu au lendemain du drame, dans les rues de la station, cette phrase terrible : « ç’aurait pu être nous » ?Ça n’aurait dû être personne, et à l’injustice du sort se mêle aujourd’hui notre colère. L’établissement en question était clairement problématique. Les témoignages sur place le montrent et notre enquête. Sans préjuger, car la justice doit avoir tout le temps nécessaire pour lever le moindre doute.Les responsables devront répondre de ces manquements. La question se pose pour d’autres lieux similaires. À l’évidence, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescent les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie général.Mes enfants, vos enfants auraient pu faire la fête au Constellation. Ils retourneront la boule au ventre dans un bar bondé. Et puis, avec le temps, ils oublieront. C’est leur force. La nôtre est de ne pas laisser une telle tragédie se reproduire.(Cf l’édition de 24 Heures du samedi 3 janvier 2026) -
Sorrow
 « Cet étrange chagrin... »(V.S. Naipaul)On ne sait pas à quoi ça tient:tout à coup cela vientde tout au fond de soi;cela te prend comme à l’amour,te saisit et te briseen vague noire de surprise,et vous qui êtes forts,sans peur aucune et sans remords:gare à vous que ce cloudemain vous crucifie debout...Ce n’est parfois qu’un petit chatqui meurt soudain comme çasans la moindre explication;cela ne se fait pas !lui reproche l’enfant déçuavant de lancer vers le ciel:ah mais sabre de bois !le chat n’est-il pas éternel ?Ou c’est une mère qui s’en va ...Où va la mer aux yeux fermésquand elle est triste au soiret se retire dans les ombresdu vert devenu noir ?Or la voici répondre:elle descend au plus profondde ses noires colèressans rimes ni raisonspour écouter au tréfonds d’ellele chant tout lancinantdes naufragés qui se rappellentau souvenir dolentdes eaux dormantes sous le ciel...Peinture: Louis Soutter
« Cet étrange chagrin... »(V.S. Naipaul)On ne sait pas à quoi ça tient:tout à coup cela vientde tout au fond de soi;cela te prend comme à l’amour,te saisit et te briseen vague noire de surprise,et vous qui êtes forts,sans peur aucune et sans remords:gare à vous que ce cloudemain vous crucifie debout...Ce n’est parfois qu’un petit chatqui meurt soudain comme çasans la moindre explication;cela ne se fait pas !lui reproche l’enfant déçuavant de lancer vers le ciel:ah mais sabre de bois !le chat n’est-il pas éternel ?Ou c’est une mère qui s’en va ...Où va la mer aux yeux fermésquand elle est triste au soiret se retire dans les ombresdu vert devenu noir ?Or la voici répondre:elle descend au plus profondde ses noires colèressans rimes ni raisonspour écouter au tréfonds d’ellele chant tout lancinantdes naufragés qui se rappellentau souvenir dolentdes eaux dormantes sous le ciel...Peinture: Louis Soutter -
Que des larmes
 Le fil invisible (105)Je ne l’ai pas dit à l’AB, hier, à notre téléphone de plus d’une heure suivant une interruption de plus d’une année – j’évitais de l’appeler imaginant qu’il désirait qu’on lui foute la paix, comme son ami Jaccottet à la toute fin -, je ne lui ai pas dit que j’avais pleuré comme un malade, mais j’ai bien senti que lui aussi, déjà au courant, avait été bouleversé par la nouvelle atroce de ce premier de l’an au grand ciel menteur…Le ciel grand ouvert de ce matin, au-dessus des forêts encore givrées et des derniers relents de brume au-dessus du lac aux eaux blanc pâle - le ciel de ce 1er janvier 2026 était comme une invite et une promesse, m’étais-je dit au balcon de la Désirade, mais déjà la nouvelle infectait les réseaux, et tout à coup la grande voile du ciel s’affale : je tombe sur les premiers mots annonçant que la fête de la nuit dernière s’est achevée pas loin de chez nous dans les flammes et le chaos de jeunes corps calcinés au milieu des hurlements, et je n’ai pas besoin de voir les premières vidéos de ce carnage : je le vois en moi comme si ça me cramait dans le crémol, comme deux ou trois fois dans ma pauvre mémoire - la mort de Tybalt dans les séracs du Dolent, la mort annoncée de Lady L. frappée en plein coeur par la vie salope ; et maintenant pas besoin de pousser jusqu’à Sabra et Chatila ou au 7 octobre d’il y a deux ans de ça: c’était juste là, à moins de cent bornes d’où je m’extasiais devant le ciel céleste, au bar Le Cosmos de la chic station de glisse, en moins de temps qu’il n'en faut pour se passer une vieille scie genre The Wall de Pink Floyd, un départ d’étincelles et le feu avait tout ravagé dans le piège du local aux étroites largeurs étagées, quasi la quarantaine de morts et plus que la centaine de grands brûlés - donc là moi vieux sanglier en bout de course je me mets à chialer comme à sept ans devant mon chien Plume écrasé par un monstre à mâchoire d’Opel Rekord, mais gaffe de n’en rien dire à l’AB qui me demande comme ça, après tant de temps, comment va son jeune ami alors que lui va sur sa nonante-troisième année en boitant bas, mais j’entame justement la réponse en lui lançant comme ça que mon actuel souci est de me conformer à l’onzième commandement selon sa Loi à lui : TU NE TOMBERAS POINT, donc je ne lui épargne rien de mes faiblesses de chevilles et de rotules, de mon souffle essoufflé, de ma débilité fémorale (malgré les stents installés) et de tout l’appareil cardio-jambaire, vraiment l’âge de nos artères alors que le mental rutile et que je reste aussi vif d’esprit qu’à dix sept ans sous les tilleuls et la sensibilité à fleur de cœur – d’où ces larmes de tout à l’heure dont je ne lui dis rien car un prélat reste un prélat nom de Dieu…Quoique tu y puisses, il y aura toujours une gêne quand tu demanderas à un abbé même rangé des messes comment il va, et l’AB ne déroge pas: il fait comme s’il était déjà de l’autre côté, sans problèmes de femme de ménage et tout le tralala cuisinier – justement sa sœur va passer tout à l’heure l’aider au frichti - , et quand tu lui racontes ta visite à la paroissienne irlandaise qui cherche à te rapprocher des clergés, il s’esclaffe : elle a tout compris, avec vous s’entend, et ce que vous me dites de ses accointances avec mon vieil ami l’abbé Z. ça aussi explique : elle aussi a déjà fait le pas...Et là tu lui dis que tu en es au déchiffrement du XXVe Canto du Purgatoire de Dante où il est question de la transmutation du fiel sexuel en miel immatériel, et tout est dit, sauf que les larmes n’en finiront pas de couler où les mortels n’en finissent pas de vivre, etc.Peinture: Bérard.
Le fil invisible (105)Je ne l’ai pas dit à l’AB, hier, à notre téléphone de plus d’une heure suivant une interruption de plus d’une année – j’évitais de l’appeler imaginant qu’il désirait qu’on lui foute la paix, comme son ami Jaccottet à la toute fin -, je ne lui ai pas dit que j’avais pleuré comme un malade, mais j’ai bien senti que lui aussi, déjà au courant, avait été bouleversé par la nouvelle atroce de ce premier de l’an au grand ciel menteur…Le ciel grand ouvert de ce matin, au-dessus des forêts encore givrées et des derniers relents de brume au-dessus du lac aux eaux blanc pâle - le ciel de ce 1er janvier 2026 était comme une invite et une promesse, m’étais-je dit au balcon de la Désirade, mais déjà la nouvelle infectait les réseaux, et tout à coup la grande voile du ciel s’affale : je tombe sur les premiers mots annonçant que la fête de la nuit dernière s’est achevée pas loin de chez nous dans les flammes et le chaos de jeunes corps calcinés au milieu des hurlements, et je n’ai pas besoin de voir les premières vidéos de ce carnage : je le vois en moi comme si ça me cramait dans le crémol, comme deux ou trois fois dans ma pauvre mémoire - la mort de Tybalt dans les séracs du Dolent, la mort annoncée de Lady L. frappée en plein coeur par la vie salope ; et maintenant pas besoin de pousser jusqu’à Sabra et Chatila ou au 7 octobre d’il y a deux ans de ça: c’était juste là, à moins de cent bornes d’où je m’extasiais devant le ciel céleste, au bar Le Cosmos de la chic station de glisse, en moins de temps qu’il n'en faut pour se passer une vieille scie genre The Wall de Pink Floyd, un départ d’étincelles et le feu avait tout ravagé dans le piège du local aux étroites largeurs étagées, quasi la quarantaine de morts et plus que la centaine de grands brûlés - donc là moi vieux sanglier en bout de course je me mets à chialer comme à sept ans devant mon chien Plume écrasé par un monstre à mâchoire d’Opel Rekord, mais gaffe de n’en rien dire à l’AB qui me demande comme ça, après tant de temps, comment va son jeune ami alors que lui va sur sa nonante-troisième année en boitant bas, mais j’entame justement la réponse en lui lançant comme ça que mon actuel souci est de me conformer à l’onzième commandement selon sa Loi à lui : TU NE TOMBERAS POINT, donc je ne lui épargne rien de mes faiblesses de chevilles et de rotules, de mon souffle essoufflé, de ma débilité fémorale (malgré les stents installés) et de tout l’appareil cardio-jambaire, vraiment l’âge de nos artères alors que le mental rutile et que je reste aussi vif d’esprit qu’à dix sept ans sous les tilleuls et la sensibilité à fleur de cœur – d’où ces larmes de tout à l’heure dont je ne lui dis rien car un prélat reste un prélat nom de Dieu…Quoique tu y puisses, il y aura toujours une gêne quand tu demanderas à un abbé même rangé des messes comment il va, et l’AB ne déroge pas: il fait comme s’il était déjà de l’autre côté, sans problèmes de femme de ménage et tout le tralala cuisinier – justement sa sœur va passer tout à l’heure l’aider au frichti - , et quand tu lui racontes ta visite à la paroissienne irlandaise qui cherche à te rapprocher des clergés, il s’esclaffe : elle a tout compris, avec vous s’entend, et ce que vous me dites de ses accointances avec mon vieil ami l’abbé Z. ça aussi explique : elle aussi a déjà fait le pas...Et là tu lui dis que tu en es au déchiffrement du XXVe Canto du Purgatoire de Dante où il est question de la transmutation du fiel sexuel en miel immatériel, et tout est dit, sauf que les larmes n’en finiront pas de couler où les mortels n’en finissent pas de vivre, etc.Peinture: Bérard. -
Que des larmes et de la compassion devant l'Horreur...

-
Comme en nos beaux jardins
(Dans la lumière de Bonnard)Nos vieilles peaux reposerontau fond du beau jardin,nous vous surveillerons d’un œil,nous serons vos gardiens,désarmés, sur le seuil ;nous ne vous retiendrons point:jamais, dans vos passions,vouées aux fumées qu’on sait,nous ne mettrons l’épée:nous serons de votre secretles alliés discrets,toujours à la plus vive écouteen vous de ce qui doute…Tu m’es plus intime qu’à moidit à Dieu le garçondont la foi est un palefroi;mon fils est médiéval,dit son père jouant l’amiralsur son cheval imaginaire,nous aimons Dieu le Pèreet son épouse jardinière,nous aimons Proust et les sirèneset la douce Chimène…Les Choses étant ce qu’elles sont là,et le Temps qui s’en vavont de pair entre les jardinsqui nous ouvrent les bras ;ce sont comme des passerellesentre l’Instant donnéet l’Éternité qui fredonnesa chanson d’affilée ;quand tu passes avec ton ombrelle,toute trace s’effacecomme rendue aux hirondelles...Peinture: Pierre Bonnard. -
Comme une voix revient
 « La note d’or que fait entendreun cor dans le lointain des bois » (Verlaine)Tu ne me quitteras jamais,au grand jamais des joursdont le sombre tambour là-basdans le lointain des garesassourdit la lumière -jamais je n’ai tant espéréqu’en cet instant perduoù tu m’as reconnu …Les défunts ont pour eux le nombrecomme un lourd océanoù toute voix particulières’oublie ou dégénère -c’est le tombeau des cris,c’est le chaos à tout jamais,c’est la troupe avide du rienque du vide stupide -et c’est là que je t’attendais…Une voix ce n’est presque rien,une voix qui disaitramenée alors par le ventde l’autre bout du temps :il était une fois…
« La note d’or que fait entendreun cor dans le lointain des bois » (Verlaine)Tu ne me quitteras jamais,au grand jamais des joursdont le sombre tambour là-basdans le lointain des garesassourdit la lumière -jamais je n’ai tant espéréqu’en cet instant perduoù tu m’as reconnu …Les défunts ont pour eux le nombrecomme un lourd océanoù toute voix particulières’oublie ou dégénère -c’est le tombeau des cris,c’est le chaos à tout jamais,c’est la troupe avide du rienque du vide stupide -et c’est là que je t’attendais…Une voix ce n’est presque rien,une voix qui disaitramenée alors par le ventde l’autre bout du temps :il était une fois… -
La Palestine des poètes irradie sans être nommée

Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.
D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…
Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…
Frère et sœurs au même « délire »
Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».
Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »
Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…
Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »
Comme autant de destinées personnelles
Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.
Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».
Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».
Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.
Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.
Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…
Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.
Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.
La Palestine des poètes
irradie sans être nommée
Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.
JEAN-LOUIS KUFFER
D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…
Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…
Frère et sœurs au même « délire »
Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».
Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »
Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…
Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »
Comme autant de destinées personnelles
Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.
Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».
Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».
Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.
Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.
Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…
Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.
Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.
La Palestine des poètes
irradie sans être nommée
Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.
JEAN-LOUIS KUFFER
D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…
Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…
Frère et sœurs au même « délire »
Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».
Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »
Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…
Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »
Comme autant de destinées personnelles
Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.
Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».
Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».
Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.
Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.
Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…
Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.
Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.
-
Ceux qui voient quelqu'un
 Celui qui ne la sentait pas venir / Celle qui va à gauche avec un mec du centre droite / Ceux qui se demandent si elles s’en doutent / Celui qui se sent ce matin tout chaud lapin / Celle que sa nouvelle eau de toilette a amenée à se questionner / Ceux qui parlent d’un nouveau potentiel / Celuiqui défie ses cinquante balais / Celle qui ne regrettera pas sa moustache à la Nietzsche / Ceux qui voient double sans l’annoncer à la troisième / Celui qui estime que le harem est une solution à l’amiable intéressante / Celle qui se verrait bien en odalisque préférée du sultan de l’Entreprise open minded / Ceux qui se demandent carrément : et maintenant on fait quoi / Celui qui pense déjà à ce qu’il va emporter genre le nouvel écran plasma / Celle qui zappera la garde de l’enfant s’il lui laisse Iago le doberman / Ceux qui feront étage séparé dans la Villa Nous Deux / Celui qui voit une malvoyante plus sensible à la poésie que Maryvonne / Celle qui affirme que pour que les mecs changent faudrait qu’ils soient différents / Ceux qui prennent sur eux en comptant sur elles / Celles qui prennent sur elles sans se faire trop d’illusions sur eux / Celui qui s’énerve quand ils lui demandent pourquoi Maryvonne les évite / Ceux qui découvrent de nouvelles qualités à leur beaux-parents / Celui dont le beau-père a passé deux fois par là / Celle qui fait celle qui n’a pas compris pour avoir la paix / Ceux qui n’en font pas le début d’un narratif / Celui qui se confesse au père Dominique dont il sait les préférences mais s’ils font ça entre eux ça lui va / Celle qui fait un transfert imprévu sur son avocat réellement sexy / Ceux qui restent fidèles et donc pas de souci « ma fi », etc.
Celui qui ne la sentait pas venir / Celle qui va à gauche avec un mec du centre droite / Ceux qui se demandent si elles s’en doutent / Celui qui se sent ce matin tout chaud lapin / Celle que sa nouvelle eau de toilette a amenée à se questionner / Ceux qui parlent d’un nouveau potentiel / Celuiqui défie ses cinquante balais / Celle qui ne regrettera pas sa moustache à la Nietzsche / Ceux qui voient double sans l’annoncer à la troisième / Celui qui estime que le harem est une solution à l’amiable intéressante / Celle qui se verrait bien en odalisque préférée du sultan de l’Entreprise open minded / Ceux qui se demandent carrément : et maintenant on fait quoi / Celui qui pense déjà à ce qu’il va emporter genre le nouvel écran plasma / Celle qui zappera la garde de l’enfant s’il lui laisse Iago le doberman / Ceux qui feront étage séparé dans la Villa Nous Deux / Celui qui voit une malvoyante plus sensible à la poésie que Maryvonne / Celle qui affirme que pour que les mecs changent faudrait qu’ils soient différents / Ceux qui prennent sur eux en comptant sur elles / Celles qui prennent sur elles sans se faire trop d’illusions sur eux / Celui qui s’énerve quand ils lui demandent pourquoi Maryvonne les évite / Ceux qui découvrent de nouvelles qualités à leur beaux-parents / Celui dont le beau-père a passé deux fois par là / Celle qui fait celle qui n’a pas compris pour avoir la paix / Ceux qui n’en font pas le début d’un narratif / Celui qui se confesse au père Dominique dont il sait les préférences mais s’ils font ça entre eux ça lui va / Celle qui fait un transfert imprévu sur son avocat réellement sexy / Ceux qui restent fidèles et donc pas de souci « ma fi », etc. -
La douceur en partage
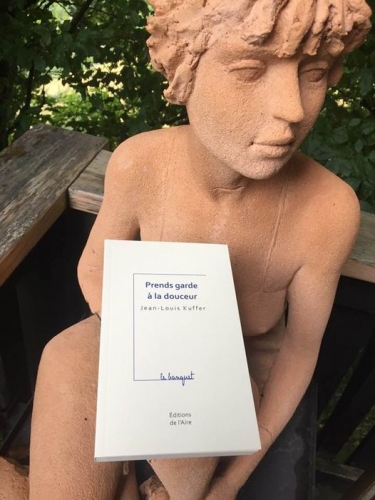
À propos du dernier opuscule de JLK,
par Francis Vladimir
"Dans Arles où sont les Alyscans,
Quans l'ombre est rouge, sous les roses,
Et clair le temps,
prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton coeur trop lourd;
Et que se disent les colombes:
Parle tout bas, si c'est d'amour,
Au bord des tombes."
(Paul-Jean Toulet)
L'exergue de Paul-Jean Toulet pare le livre de JLK d'une ineffable aura. À lire d'un trait, le vertige m'a pris, longue dévalée nocturne avec au bout les mots, les mots, toujours les mots qui cernent et disent tant de la vie passée, en allée, que de celle qui demeure toujours à nos côtés, en embuscade en dépit de sa rosserie, de ses moments de grâce, de ses instants fugaces jouant d'éternité. Dans ce long texte qui se décline page après page en 587 pensées, déclinées à la mode classique, qui se prêtent à l'aube, au cheminement et au soir, l'écrivain ne dévoile rien que nous ne pressentions déjà, une vie d'homme tournée opiniâtrement vers le sens de la vie qui revêt chez lui une interrogation jamais muette, mais assumée par ce que les mots sous sa plume entendent révéler à ceux qui, aveugles ou sourds, en ces temps de misère, sont frappés d'incapacité majeure dans le dévoilement d'eux-mêmes.
Dans l'art d'écrire - ( Tchékhov a su dire :... l'art et surtout la scène est un monde où il est impossible d'avancer sans trébucher)- il y aurait donc ce trébuchement sans lequel l'écriture ne saurait aboutir à la luminosité qui se tient dans chacune des pages du livre de JLK. Pour les lecteurs attentifs et fidèles, l'auteur dresse tout un panorama intérieur où le regard est invité à s'arrêter sur chacun des apophtegmes – nommer ainsi ces courts textes est hasardeux – mais il me faut admettre que l'écho de chacun d'eux, d'une langue lyrique, veloutée, âpre, mordante, déposée, conduit le lecteur à un apaisement de lui-même. Il est drôle de consentir à cet état constaté comme si, finalement, les mots dès lors qu'ils sont plus que choisis, justes et ajustés au pourquoi de la chose, le paysage mental, l'expérience de la vie, le sentiment et la douleur, l'accompagnement, le chaos et la respiration profonde, nous réajustent à nous mêmes, nous ré-assemblent aux autres et au monde. De l'éternel présent . - Ceux qui veillent depuis toujours, veilleuses et veilleurs des quatre coins des nébuleuses, le savent à jamais: qu'il n'y a que le présent des choses qui puisse vous révéler votre éternité... Dans le grand théâtre l'écrivain joue le rôle de sa vie, liant et déliant les mots et leur sens, secrets et publics, se confrontant à son intime conviction, changeante et forte, car nul ne sait ce qu'il en sera de demain, de la prochaine aurore, du chemin se perdant dans les bois, du crépuscule de feu sur le lac, et l'écrivain s'il prend au présent et à bras le corps la destinée du monde, tel qu'il va, cahin-caha, a ce rien de bravache, de foudre de guerre errant ( par les mers et les monts, les vallons et les plaines... et la voix au désert ) le disputant tout à la fois à Don Quichotte et au chevalier inexistant.
« De la page vécue.- Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu'une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j'entrais dans une forêt, j'étais sur la route d'Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d'adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j'avais seize ans sur les arêtes d'Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. » L'écrivain se tiendrait donc à la frontière, cette ligne brisée pour certains ou ligne bleue des Vosges pour d'autres, en-deça de laquelle la pièce retombe pile, au-delà de laquelle elle est face. Au jeu du bonneteau de la vie on y voit que du feu. Dans l'obscurité environnante des grands arbres il faut regarder haut, percer la canopée pour retrouver la lumière. Cet entre-deux constant où se joue l'existence, le livre en ces pages les plus sombres ou en ces pages vives, nous est la meilleure des sources pour s'abreuver, humer, jouer avec la fluidité ou le rocher des mots. Sisyphe montait et remontait sans répit la pente. La gangue, qui enserre, l'écrivain en vient à bout, c'est à dire qu'il commet le premier acte d'apprentissage, l'essentiel, celui de buriner le temps. Et JLK laisse échapper ses volutes d'enfance, ses regains d'adolescence, ses attentes de jeune homme, ses attaches d'homme mûr, cette violence de sang et de violence, toutes choses en elles-mêmes qui font et contrefont le souvenir, le visitant et le revisitant, ne se départant jamais de ce qui tient ce texte de bout en bout, l'émotion, le sourire, la tendreté et la douceur malgré sa mise en garde, le rugueux, la colère rentrée, le deuil.
Les mots, peut-on l'exprimer, fomentent des répits et des transes, déplacent des montagnes, apaisent ou désespèrent, ramènent au silence. Souffles primordiaux sans lesquels l'écriture n'advient pas. Je disais, en aparté de ma lecture de nuit, que l'égrènement de ces courts textes qui font une vraie somme, - à faire des jaloux – relève des abysses et tutoie des hauteurs. Sans doute, le dit-on avec facilité, la catharsis se fait dans l'emploi des mots, dans cette ré-architecture incessante érigeant le propos. Ici il est intime et universel, chuchoté à l'oreille par une voix amie. Il donne à entendre le monde aujourd'hui dans les échos et les accents d'hier, dans l'évidence de l'autre, la toute proche, l'ailée.
« De l'évidence. - Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m'était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d'être révélé en pleine lumière... ». Le livre de JLK se retourne à l'épaule, et nous retourne les sens, nous accablant et nous allégeant, mêlant indistinctement les raisons et les déraisons qui mènent au bout du chemin, à la dernière page du livre. « tu t'en es allée une nuit après nous avoir signifié ton désir de dormir et la nuit depuis lors m'est une autre tombe... De ma tristesse.-Ton visage s'est refermé pendant que tu dormais et pourtant je le savais déjà : que ce n'était pas le sommeil qui l'avait refermé... mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...
Du plus tendre aveu.-Tu m'as manqué dès que j'ai su que je m'en irais, lui dit-elle... » L'omniprésence de l'intime et du fugace confère à ces pages le noir et le blanc, couleurs de deuil, non pour enfouir l'âme endolorie, la triturer à l'excès, mais bien plutôt pour glisser sous les pas de celui qui reste, une autre portée musicale, lui tendre un arc où réapparaîtront les couleurs, les poinçons d'espérance, l'écriture de feu, la réparation. C'est à cela sans doute que s'attache le livre de JLK, hors- champ, mais dans la lumière matinale sur le chemin des bois, s'en revenant au soir. Avec légèreté, sans emphase, avec les mots sacrés pour le dire, ces sacrés mots, l'empyrée et le refuge qu'il s'est choisis, à la Désirade, sur les hauts de Lausanne, pour continuer et faire entendre...
De la permanence.- Ce que nous laissons semble n'être rien, mais c'est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous....
Francis Vladimir, le 09 décembre 2023
Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de l'Aire, 2023.
-
Ce que dit le silence
« Qui sait, dit Euripide, il se peut que la vie soit la mort et que la mort soit la vie »(Léon Chestov, Les révélations de la mort)Pour Emilia, en mémoire de Pierre-Guillaume.La suprême ignorance est là,de ne plus savoir side la nuit avant l’heure,ou du jour et ses leurressont ce qu’ils sont ou ne sont pas…L’étrange chose qu’une rosequi ne parle qu’en soiet dont jamais aucune foin’osa dire qu’elle dispose…Les mots ne voulaient dire que ça:qu’ils savent qu’ils ignorentque le silence dort,et que la mort n’existe pas…Peinture JLK: Al Devero. -
La cueilleuse d’yeux bleus

Elle fait tous les marchés où se retrouvent les jeunes paysans aux pommettes roses et les journaliers en quête d’ouvrage.
Elle les cueille du regard et la transaction se fait à l’ordinaire dans l’heure qui suit. Mais l’accord n’est possible qu’à certaines conditions physiques précises excluant les Nordiques et les Américains de souche allemande.
Il les lui faut glabres et d’un métal tranchant, la barbe de jais quand elle pousse et le front de celui qui pense avec le corps - il est exceptionnel qu’elle ait cueilli des yeux bleus d’intellectuels, sauf durant ses années d’Argentine les étudiants lettrés qui fréquentaient la maison de Lady Ocampo. Il les lui faut baraqués et doux, le bleu d’autant plus émouvant qu’ils sont vigoureux. Il les lui faut clairs et brumeux, le bleu liquide s’ils sont d’airain et le bleu diamant si l’anima prime en eux. C’est presque à fleur de peau qu’elle décide, mais nul d’entre ceux qu’elle a choisis ne l’a jamais repoussée.
Cette manie les fascine à vrai dire chez une femme qui ne devrait être qu’un objet de convoitise. L’idée qu’elle soit demandeuse les sidère. Certains éclatent de rire lorsqu’elle leur fait sa proposition. Elle a remarqué qu’une certaine caresse leur attendrissait le regard sur la photo, pourtant elle évite de passer pour une fille facile aux yeux des plus sévères, pas toujours les moins intéressants. -
Retour à Milan Kundera
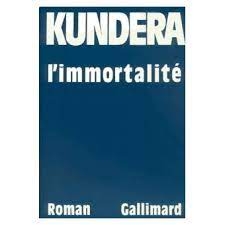 (Le Temps accordé, journal d'une lecture)À La Désirade, ce samedi 15 juillet. – J’amorce ce matin, par temps estival splendide sur la conque verdoyante du vallon boisé et l’immensité du lac au bleu dense strié de vert que surmonte, au-desus des monts de Savoie, l’azur plus doux du ciel céleste, ce que j'entrevois déjà comme un important (pour moi) journal de lecture tout consacré à Milan Kundera, trois jours après sa mort et juste une semaine après avoir trouvé, sur les rayons de la ressourcerie de Chailly sur Montreux - hasard ou nécessité ironique -, un exemplaire de L’Immortalité ayant appartenu à une certaine Tereza, homonyme (à une lettre près) de la dernière compagne de Simenon et de la protagoniste de L’Insoutenable légèreté de l’être que son auteur m’a dédicacé à Paris en 1984.J’ai reçu, hier en fin d’après-midi, un texto de notre médecin traitant, l’excellent Alexandre H. aux chemises toujours très bariolées, me rassurant après la prise du sang du matin en ces termes : vos résultats ne montrent aucune souffrance du coeur après l'épisode d’hier, ni d'anémie, et vos tests hépatiques sont également alignés, parfaits ! Avec mes compliments , etc.Et de fait, je me suis senti rasséréné après mes vacillements vertigineux de la veille et ma sensation d’étouffer - plus une douleur aiguë peut-être liée à la défection de mes quatre stents coronaires ; et Sophie aussi m’a « texté » son soulagement après notre repas de midi à L’Oasis où elle m’a vu tituber pas mal et m’arrêter pour reprendre souffle, etc.Or reprenant, trente-trois ans après ma première lecture, cette Immortalité que Bernard de Fallois me reprochait sarcastiquement d’apprécier sans l’avoir probablement ouvert (Kundera ayant déjà ses laudateurs et ses contempteurs, aussi aveugle les uns que les autres, en 1990), j’ai été saisi, après moins d’une cinquantaine de pages, par l’évolution qualitative de cette nouvelle approche dès l’apparition d’Agnès, la sexa solitaire dont le plus grand amour aura probablement été son père secret et mélancolique – le portrait de la mère dominatrice tient à quelques traits impitoyables -, et ce mélange qui caractérise Kundera pour l’essentiel, comme je l’avais relevé dans mon papier de 1990, d’une hypersensibilité (Anima) constante dans sa perception des êtres qu’il tire de son chapeau de romancier, comme par génération spontanée, et d’une lucidité intelligente (Animus) dans sa façon de lier chaque individu à l’époque et à la société, ici le long plan-séquence sur Agnès à la piscine du fitness parisien, puis dans le sauna et les bruits de la rue, l’obsession de l’image et ce que Kundera taxe ailleurs d’ « eau sale de la musique » ; et voici qu’évoquant la famille d’Agnès et ses liens avec la Suisse, puis citant le petit poème de Goethe que lui récitait encore son père à la veille de sa mort, mes propres souvenirs de septuagénaire n’ont cessé de s’ajouter aux perceptions du quadra que j’étais en 1990 – mais là faut que je me prépare à rejoindre, ce midi, mes amis M. à la terrasse du Major, et sûr que nous allons parler ensemble de tout ça…(Soir) – J’ai retrouvé ce soir les mots, que je n’ai su citer par cœur à mes amis M. , ce midi, sur la terrasse ombragée de Bourg-en-Lavaux, et qu’Antonin eût compris tout de suite en germaniste distingué qu’il est sans que ne s’en doute probablement notre accorte serveuse portugaise Olinda, soit : « Über allen Gipfen / Ist Ruh / In allen Wipfeln/ Spürest du / Kaum einen Hauch ; Die Vögeln schweigen im Walde / Warte nur, balde / Ruhest du auch », ce qui perd toute magie musicale en traduction : « Sur tous les sommets / C’est le silence / Sur la cime de tous les arbres / Tu sens / À peine un souffle ; / Les petits oiseaux se taisent dans la forêt / Prends patience, bientôt / Tu te reposeras aussi», et d’ailleurs la citation, vaguement funèbre sur la fin, aurait tranché sur notre humeur débonnaire ponctuée de rires, lesquels sont la marque de notre vieille amitié si peu pédante et si peu « littéraire » au demeurant malgré le fait qu’Antonin et moi avons publié plus de quarante livres à nous deux – mais Jackie est aussi peu « femme d’écrivain » que l’était Lady L. avec laquelle elle « échangeait » surtout au téléphone…Du moins, en «œil extérieur » à la Kundera, me demandais-je à quoi pouvaient faire penser ces deux vieilles ganaches en chemise de viscose rose (Antonin) et blouse afghane blanche (moi) flanqués de cette frangine a pull orange un peu cassée sur son coin de table avec son sourire en coin de Jurassienne incessamment moqueuse, et je me disais : ni bohème chic ni vieux de la vieille culturelle, même pas boomers atypiques, rien qu’un trio sympa au jugé d’Olinda...Jackie se rappelle en tout cas sa lecture de L’Insoutenable légèreté de l’être, comme de la grande littérature de ce temps-là (elle devait avoir la trentaine), et la souvenir d’Antonin semble plus sporadique, surtout lié aux essais de Kundera, dont il convien qu’il s’agit d’un grand écrivain – il est en train de découvrir La guerre des clichés de Martin Amis…Bref : le vrai sujet « à la Kundera » est ailleurs, et notamment quand nous parlons, avec Jackie, de nos déceptions en matière d’amitié. Sujets de nouvelles, mais nous ne livrerons aucun nom ! D’ailleurs à quoi ça tient : tu passes par une dépression ou une grave maladie, et ça te coûte tant de défections amicales, ou tu fais des enfants, et là « ça craint » aussi...Je me rappelle, de mon côté, que j’ai commencé à faire ami-ami avec Antonin après l’avoir fait avec son père qui était ami-ami avec Charles-Albert Cingria, et c’était alors un éphèbe à longs cheveux et rêves de gloire théâtrale, Antonin au TNS de Strasbourg et à Paris où il créchait dans une mansarde puant la souris malade, avant son virage dans l’écriture et compagnie...Lire Kundera, me dis-je ce soir en revenant à L’Immortalité, c’est lire et relire sa propre vie avec un regard plus distant et plus amical à la fois, et demain je retroverai Agnès et sa sœur Laura en pensant à mes propres sœurs en Espagne et dans le quartier de nos enfances, mais à l’instant c’est notre fille Julie qui m'appelle de Kampot au Cambodge où elle « fait avec » ses trois mioches et sept autres gosses de là-bas très insoucieux des dangers de notre drôle de monde…
(Le Temps accordé, journal d'une lecture)À La Désirade, ce samedi 15 juillet. – J’amorce ce matin, par temps estival splendide sur la conque verdoyante du vallon boisé et l’immensité du lac au bleu dense strié de vert que surmonte, au-desus des monts de Savoie, l’azur plus doux du ciel céleste, ce que j'entrevois déjà comme un important (pour moi) journal de lecture tout consacré à Milan Kundera, trois jours après sa mort et juste une semaine après avoir trouvé, sur les rayons de la ressourcerie de Chailly sur Montreux - hasard ou nécessité ironique -, un exemplaire de L’Immortalité ayant appartenu à une certaine Tereza, homonyme (à une lettre près) de la dernière compagne de Simenon et de la protagoniste de L’Insoutenable légèreté de l’être que son auteur m’a dédicacé à Paris en 1984.J’ai reçu, hier en fin d’après-midi, un texto de notre médecin traitant, l’excellent Alexandre H. aux chemises toujours très bariolées, me rassurant après la prise du sang du matin en ces termes : vos résultats ne montrent aucune souffrance du coeur après l'épisode d’hier, ni d'anémie, et vos tests hépatiques sont également alignés, parfaits ! Avec mes compliments , etc.Et de fait, je me suis senti rasséréné après mes vacillements vertigineux de la veille et ma sensation d’étouffer - plus une douleur aiguë peut-être liée à la défection de mes quatre stents coronaires ; et Sophie aussi m’a « texté » son soulagement après notre repas de midi à L’Oasis où elle m’a vu tituber pas mal et m’arrêter pour reprendre souffle, etc.Or reprenant, trente-trois ans après ma première lecture, cette Immortalité que Bernard de Fallois me reprochait sarcastiquement d’apprécier sans l’avoir probablement ouvert (Kundera ayant déjà ses laudateurs et ses contempteurs, aussi aveugle les uns que les autres, en 1990), j’ai été saisi, après moins d’une cinquantaine de pages, par l’évolution qualitative de cette nouvelle approche dès l’apparition d’Agnès, la sexa solitaire dont le plus grand amour aura probablement été son père secret et mélancolique – le portrait de la mère dominatrice tient à quelques traits impitoyables -, et ce mélange qui caractérise Kundera pour l’essentiel, comme je l’avais relevé dans mon papier de 1990, d’une hypersensibilité (Anima) constante dans sa perception des êtres qu’il tire de son chapeau de romancier, comme par génération spontanée, et d’une lucidité intelligente (Animus) dans sa façon de lier chaque individu à l’époque et à la société, ici le long plan-séquence sur Agnès à la piscine du fitness parisien, puis dans le sauna et les bruits de la rue, l’obsession de l’image et ce que Kundera taxe ailleurs d’ « eau sale de la musique » ; et voici qu’évoquant la famille d’Agnès et ses liens avec la Suisse, puis citant le petit poème de Goethe que lui récitait encore son père à la veille de sa mort, mes propres souvenirs de septuagénaire n’ont cessé de s’ajouter aux perceptions du quadra que j’étais en 1990 – mais là faut que je me prépare à rejoindre, ce midi, mes amis M. à la terrasse du Major, et sûr que nous allons parler ensemble de tout ça…(Soir) – J’ai retrouvé ce soir les mots, que je n’ai su citer par cœur à mes amis M. , ce midi, sur la terrasse ombragée de Bourg-en-Lavaux, et qu’Antonin eût compris tout de suite en germaniste distingué qu’il est sans que ne s’en doute probablement notre accorte serveuse portugaise Olinda, soit : « Über allen Gipfen / Ist Ruh / In allen Wipfeln/ Spürest du / Kaum einen Hauch ; Die Vögeln schweigen im Walde / Warte nur, balde / Ruhest du auch », ce qui perd toute magie musicale en traduction : « Sur tous les sommets / C’est le silence / Sur la cime de tous les arbres / Tu sens / À peine un souffle ; / Les petits oiseaux se taisent dans la forêt / Prends patience, bientôt / Tu te reposeras aussi», et d’ailleurs la citation, vaguement funèbre sur la fin, aurait tranché sur notre humeur débonnaire ponctuée de rires, lesquels sont la marque de notre vieille amitié si peu pédante et si peu « littéraire » au demeurant malgré le fait qu’Antonin et moi avons publié plus de quarante livres à nous deux – mais Jackie est aussi peu « femme d’écrivain » que l’était Lady L. avec laquelle elle « échangeait » surtout au téléphone…Du moins, en «œil extérieur » à la Kundera, me demandais-je à quoi pouvaient faire penser ces deux vieilles ganaches en chemise de viscose rose (Antonin) et blouse afghane blanche (moi) flanqués de cette frangine a pull orange un peu cassée sur son coin de table avec son sourire en coin de Jurassienne incessamment moqueuse, et je me disais : ni bohème chic ni vieux de la vieille culturelle, même pas boomers atypiques, rien qu’un trio sympa au jugé d’Olinda...Jackie se rappelle en tout cas sa lecture de L’Insoutenable légèreté de l’être, comme de la grande littérature de ce temps-là (elle devait avoir la trentaine), et la souvenir d’Antonin semble plus sporadique, surtout lié aux essais de Kundera, dont il convien qu’il s’agit d’un grand écrivain – il est en train de découvrir La guerre des clichés de Martin Amis…Bref : le vrai sujet « à la Kundera » est ailleurs, et notamment quand nous parlons, avec Jackie, de nos déceptions en matière d’amitié. Sujets de nouvelles, mais nous ne livrerons aucun nom ! D’ailleurs à quoi ça tient : tu passes par une dépression ou une grave maladie, et ça te coûte tant de défections amicales, ou tu fais des enfants, et là « ça craint » aussi...Je me rappelle, de mon côté, que j’ai commencé à faire ami-ami avec Antonin après l’avoir fait avec son père qui était ami-ami avec Charles-Albert Cingria, et c’était alors un éphèbe à longs cheveux et rêves de gloire théâtrale, Antonin au TNS de Strasbourg et à Paris où il créchait dans une mansarde puant la souris malade, avant son virage dans l’écriture et compagnie...Lire Kundera, me dis-je ce soir en revenant à L’Immortalité, c’est lire et relire sa propre vie avec un regard plus distant et plus amical à la fois, et demain je retroverai Agnès et sa sœur Laura en pensant à mes propres sœurs en Espagne et dans le quartier de nos enfances, mais à l’instant c’est notre fille Julie qui m'appelle de Kampot au Cambodge où elle « fait avec » ses trois mioches et sept autres gosses de là-bas très insoucieux des dangers de notre drôle de monde…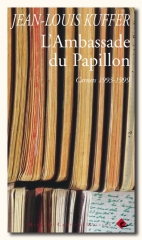 Ce dimanche 16 juillet. – Lorsque je lui ai dit que j’avais découvert que j’étais mortel tel matin d’automne de la venue au monde de notre premier enfant, Milan Kundera a eu un geste de saisissement que je me rappelle, levant soudain ses deux fines mains aux solides attaches et, après un long silence, comme Antonio Lobo Antunes des années plus tard, m’a demandé si moi aussi j’écrivais, puis, se reprenant comme pour s’excuser de cette question peut-être indiscrète, m’a avoué qu’il avait accepté de me rencontrer – ce qu’il faisait de moins en moins - sur la proposition de Vera et se rappelant la tournure personnelle et la vive attention manifestées dans mes papiers consacrés à ses livres.Je ne sais ce que Sophie a pensé du récit que son père a fait de sa naissance, au matin lustral de novembre 1982, dans L’Ambassade du papillon, mais je suis reconnaissant à nos deux enfants, autant qu’à Lady L., d’avoir changé ma vie en destin personnel – ces trois bonnes femmes me révélant puis me confirmant l’évidence occultée jusque-là que j’étais non seulement mortel mais unique, comme le perçoit Agnès devant son miroir, dans L’Immortalité, me ramenant en somme, les pieds sur terre comme les femmes le savent, à la bonne vie simplement vivante et me permettant en somme de mieux moduler mes vérités dans mes Lectures du monde dont L’Ambassade est le premier des sept volumes représentant aujourd’hui quelque 3000 pages…
Ce dimanche 16 juillet. – Lorsque je lui ai dit que j’avais découvert que j’étais mortel tel matin d’automne de la venue au monde de notre premier enfant, Milan Kundera a eu un geste de saisissement que je me rappelle, levant soudain ses deux fines mains aux solides attaches et, après un long silence, comme Antonio Lobo Antunes des années plus tard, m’a demandé si moi aussi j’écrivais, puis, se reprenant comme pour s’excuser de cette question peut-être indiscrète, m’a avoué qu’il avait accepté de me rencontrer – ce qu’il faisait de moins en moins - sur la proposition de Vera et se rappelant la tournure personnelle et la vive attention manifestées dans mes papiers consacrés à ses livres.Je ne sais ce que Sophie a pensé du récit que son père a fait de sa naissance, au matin lustral de novembre 1982, dans L’Ambassade du papillon, mais je suis reconnaissant à nos deux enfants, autant qu’à Lady L., d’avoir changé ma vie en destin personnel – ces trois bonnes femmes me révélant puis me confirmant l’évidence occultée jusque-là que j’étais non seulement mortel mais unique, comme le perçoit Agnès devant son miroir, dans L’Immortalité, me ramenant en somme, les pieds sur terre comme les femmes le savent, à la bonne vie simplement vivante et me permettant en somme de mieux moduler mes vérités dans mes Lectures du monde dont L’Ambassade est le premier des sept volumes représentant aujourd’hui quelque 3000 pages… Tomas et Tereza, dans L’Insoutenable légèreté de l’être, qui dit beaucoup aussi du poids du monde, ont baptisé leur chien du nom de Karénine, et moi je décide ce matin, dans ce récit d’une relecture de Kundera, d’appeler Oblomov mon vieux compagnon baptisé Snoopy par Lady L., histoire de marquer le passage de la réalité à la fiction, comme on constate que les prénoms d’Agnès et de Laura ou de Paul, dans L’Immortalité, nous font passer de la fiction à la réalité de notre lecture…Si je fais « retour à Kundera », qui revient lui-même au mythe nietzschéen de l’éternel retour au début de L’Insoutenable légèreté de l’être, ce n’est pas du tout par soumission à un ressassement plus ou moins nostalgique mais au contraire dans l’esprit de redécouverte du jamais vu, ou du jamais lu comme aujourd’hui, et je pourrais faire retour à Cingria comme à Witkiewicz, mes deux premiers mentors de lecteur de vingt ans et des poussières, à Tchekhov ou à Thomas Wolfe, à Balzac ou à Annie Dillard et Alice Munro – les personnages de celle-ci me restant aussi présents que ceux de Kundera, avec plus de chair souvent et plus de lancinante affectivité, moins aussi de pensée en acte ou de désenchantement hédoniste…À la page 55 de L’Immortalité (première édition de Gallimard en collection Du monde entier), Agnès prend donc conscience d’une double évidence déjà entrevue dans son miroir et vérifiée ce soir-là de « dîner convivial » où elle s’est efforcée de faire bonne figure : qu’elle est unique et qu’elle ne se sent pas solidaire de ses semblables pour l’essentiel même si elle a le cœur sur la main, n’est-ce pas, et combien ça me rappelle ma propre propension à rester à l’écart et mon refus de souscrire jamais à l’expression « il est des nôtres »…Je compte actuellement 5000 « amis » sur le réseau social de Facebook: pure fiction, sinon foutaise, mais l’intuition d’Agnès, que l’image multipliée – vingt-cinq ans avant Instagram - est en train de ruiner la notion même d’individualité, au dam de ce qu’on appelait hier la pudeur et la discrétion, et au risque de voir s’effondrer la représentation de sa propre personne, rejoint à l’instant tout ce que j’ai tenté d’exprimer dans Nous sommes tous des zombies sympas – que j’ose dire un libelle « à la Kundera »…
Tomas et Tereza, dans L’Insoutenable légèreté de l’être, qui dit beaucoup aussi du poids du monde, ont baptisé leur chien du nom de Karénine, et moi je décide ce matin, dans ce récit d’une relecture de Kundera, d’appeler Oblomov mon vieux compagnon baptisé Snoopy par Lady L., histoire de marquer le passage de la réalité à la fiction, comme on constate que les prénoms d’Agnès et de Laura ou de Paul, dans L’Immortalité, nous font passer de la fiction à la réalité de notre lecture…Si je fais « retour à Kundera », qui revient lui-même au mythe nietzschéen de l’éternel retour au début de L’Insoutenable légèreté de l’être, ce n’est pas du tout par soumission à un ressassement plus ou moins nostalgique mais au contraire dans l’esprit de redécouverte du jamais vu, ou du jamais lu comme aujourd’hui, et je pourrais faire retour à Cingria comme à Witkiewicz, mes deux premiers mentors de lecteur de vingt ans et des poussières, à Tchekhov ou à Thomas Wolfe, à Balzac ou à Annie Dillard et Alice Munro – les personnages de celle-ci me restant aussi présents que ceux de Kundera, avec plus de chair souvent et plus de lancinante affectivité, moins aussi de pensée en acte ou de désenchantement hédoniste…À la page 55 de L’Immortalité (première édition de Gallimard en collection Du monde entier), Agnès prend donc conscience d’une double évidence déjà entrevue dans son miroir et vérifiée ce soir-là de « dîner convivial » où elle s’est efforcée de faire bonne figure : qu’elle est unique et qu’elle ne se sent pas solidaire de ses semblables pour l’essentiel même si elle a le cœur sur la main, n’est-ce pas, et combien ça me rappelle ma propre propension à rester à l’écart et mon refus de souscrire jamais à l’expression « il est des nôtres »…Je compte actuellement 5000 « amis » sur le réseau social de Facebook: pure fiction, sinon foutaise, mais l’intuition d’Agnès, que l’image multipliée – vingt-cinq ans avant Instagram - est en train de ruiner la notion même d’individualité, au dam de ce qu’on appelait hier la pudeur et la discrétion, et au risque de voir s’effondrer la représentation de sa propre personne, rejoint à l’instant tout ce que j’ai tenté d’exprimer dans Nous sommes tous des zombies sympas – que j’ose dire un libelle « à la Kundera »…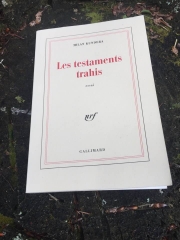 À La Désirade, ce lundi 17 juillet, 4h du matin.- Dans le rêve, un Claudel à stature d’éléphant blanc me sommait de prononcer le mot TUBULURE, et j’ai pensé : Titan. Puis l’image de la bouche d’or m’est revenue malgré son faciès de laboureur aux comices et je me suis réveillé en songeant à sa page lumineuse sur l’Anima de Rimbaud.Mais caramba: seulement 4 heures ! et cette sensation d’avoir les pieds secs, l’âme de dix-sept ans et les pieds froids…Sur quoi je tends le main au hasard, qui me ramène Les Testaments trahis, et je lis ce qu’exactement je devais lire à ce moment-là comme souvent quand je pêche un livre au hasard: «Personne n’est plus insensible que les gens sentimentaux. »Et tout de suite je vois Untel et Unetelle : comme les personnages des romans de Kundera émanent souvent de pensées ou d’intuitions, les pensées et développements de ses essais s’incarnent en personnages...
À La Désirade, ce lundi 17 juillet, 4h du matin.- Dans le rêve, un Claudel à stature d’éléphant blanc me sommait de prononcer le mot TUBULURE, et j’ai pensé : Titan. Puis l’image de la bouche d’or m’est revenue malgré son faciès de laboureur aux comices et je me suis réveillé en songeant à sa page lumineuse sur l’Anima de Rimbaud.Mais caramba: seulement 4 heures ! et cette sensation d’avoir les pieds secs, l’âme de dix-sept ans et les pieds froids…Sur quoi je tends le main au hasard, qui me ramène Les Testaments trahis, et je lis ce qu’exactement je devais lire à ce moment-là comme souvent quand je pêche un livre au hasard: «Personne n’est plus insensible que les gens sentimentaux. »Et tout de suite je vois Untel et Unetelle : comme les personnages des romans de Kundera émanent souvent de pensées ou d’intuitions, les pensées et développements de ses essais s’incarnent en personnages... Au personnage d’Agnès, la sexagénaire que la perte de son visage et de son unicité inquiète, dans la première partie de L’immortalité, j’ai prêté hier soir le visage de Kristin Scott Thomas dans L’ombre d’un soupçon de Sydney Pollack, la femme trompée qui partage son désarroi puis sa tendresse avec Harrison Ford en inspecteur de police dont un certain geste m’a rappelé le vieil acteur rencontré sur le hauts de Lugano en 1993, donc l’année de la parution de la traduction française des Testaments trahis...Autre trahison, me dis-je à propos des deux amants se crashant dans le même avion après avoir menti à leurs conjoints, et tout le côté sensible du film , réellement émouvant et rendu tel par les deux acteurs, fait oublier le sentimentalisme plus factice de la conclusion, typique du kitsch que Kundera a toujours raillé.Et voila qu’au lieu de m’endormir, notant au passage les mots d’affectueuse dévotion que l’écrivain voue à Robert Musil (absolument que je revienne aussi à L’homme sans qualités, me dis-je dans la foulée) je tombe sur ce vif hommage à l’humour de Rabelais à propos du Pantagruel que le jeune Tchèque tenait sous son lit dans son dortoir d’ouvriers: « L’humour : l’éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguité morale et l’homme dans sa profonde incompétence à juger les autres ; l’humour : l’ivresse de la relativité des choses humaines ; le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude. Mais l’humour, pour rappeler Octavio Paz, est « la grande invention de l’esprit moderne ». Il n’est pas là depuis toujours, il n’est pas là pour toujours non plus. Le cœur serré, je pense au jour où Panurge ne fera plus rire »...(À suivre)
Au personnage d’Agnès, la sexagénaire que la perte de son visage et de son unicité inquiète, dans la première partie de L’immortalité, j’ai prêté hier soir le visage de Kristin Scott Thomas dans L’ombre d’un soupçon de Sydney Pollack, la femme trompée qui partage son désarroi puis sa tendresse avec Harrison Ford en inspecteur de police dont un certain geste m’a rappelé le vieil acteur rencontré sur le hauts de Lugano en 1993, donc l’année de la parution de la traduction française des Testaments trahis...Autre trahison, me dis-je à propos des deux amants se crashant dans le même avion après avoir menti à leurs conjoints, et tout le côté sensible du film , réellement émouvant et rendu tel par les deux acteurs, fait oublier le sentimentalisme plus factice de la conclusion, typique du kitsch que Kundera a toujours raillé.Et voila qu’au lieu de m’endormir, notant au passage les mots d’affectueuse dévotion que l’écrivain voue à Robert Musil (absolument que je revienne aussi à L’homme sans qualités, me dis-je dans la foulée) je tombe sur ce vif hommage à l’humour de Rabelais à propos du Pantagruel que le jeune Tchèque tenait sous son lit dans son dortoir d’ouvriers: « L’humour : l’éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguité morale et l’homme dans sa profonde incompétence à juger les autres ; l’humour : l’ivresse de la relativité des choses humaines ; le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude. Mais l’humour, pour rappeler Octavio Paz, est « la grande invention de l’esprit moderne ». Il n’est pas là depuis toujours, il n’est pas là pour toujours non plus. Le cœur serré, je pense au jour où Panurge ne fera plus rire »...(À suivre) -
Elégie au bord de la nuit
 Nous n’avons pas encore fini:de moment en momentnous nous attarderons encoreparmi les éboulisà nous émerveiller de tousces bijoux de vermeil ;le monde est une vraie merveille,lançons nous à l’immondequi serpente en démon sournoissans nous désespérer...Notre faiblesse est un rempartsurmontant la prairieoù survivent les ancolies:bleu profond reflétant le ciel,douces au toucher des yeux,parfumées de musiqueet constellant le noircomme au fond d'un ciboireouvert à la voûte angélique ...Nous tenons le soleil en laisse,et qu’il nous obéissequand des yeux nous le fixeronspour les lui faire baisser;et que de l'astre de la nuitles rayons mélodieuxveuillent éclairer nos mélodiesde leur douce mélancolie.
Nous n’avons pas encore fini:de moment en momentnous nous attarderons encoreparmi les éboulisà nous émerveiller de tousces bijoux de vermeil ;le monde est une vraie merveille,lançons nous à l’immondequi serpente en démon sournoissans nous désespérer...Notre faiblesse est un rempartsurmontant la prairieoù survivent les ancolies:bleu profond reflétant le ciel,douces au toucher des yeux,parfumées de musiqueet constellant le noircomme au fond d'un ciboireouvert à la voûte angélique ...Nous tenons le soleil en laisse,et qu’il nous obéissequand des yeux nous le fixeronspour les lui faire baisser;et que de l'astre de la nuitles rayons mélodieuxveuillent éclairer nos mélodiesde leur douce mélancolie. -
L'évidence mystérieuse de l'être
Pour lire et relire Le Canal exutoire de Charles-Albert Cingria
Le Canal exutoire est à mes yeux le texte le plus mystérieux et le plus sourdement éclairant de toute l’œuvre de Cingria, qu’on ne peut appeler ici Charles-Albert. Nulle familiarité, nul enjouement, nulle connivence non plus ne conviennent en effet à l’abord de cet écrit dont la fulgurance et la densité cristallisent en somme une ontologie poétique en laquelle je vois la plus haute manifestation d’une pensée à la fois très physique et métaphysique, jaillie comme un crachat d’étoiles et aussi longue à nous atteindre dans la nuit des temps de l’esprit, jetée à la vitesse de la semence et lente autant dans son remuement qu’un rêve de tout petit chat dans son panier ou sur son rocher.
Cette image est d’ailleurs celle qui apparaît à la fin du texte, par laquelle je commencerai de le citer, comme un appel à tout reprendre ensuite à la source : « Je viens de voir, dans la maison où je loue des chambres, un chat tout petit réclamer avec obstination un droit de vivre. Il est venu là et il a décidé de rester là. C’est étrange comme il est sérieux et comme ses yeux, malgré son nez tatoué de macadam par les corneilles, flamboient d’une flamme utilitaire. Il a forcé la compréhension. On le lance en l’air, il s’accroche à des feuilles. Il miaule, il exige, on le chasse ; il rentre; une dame qui a des falbalas de peluche bleue l’adopte pour deux minutes. Il ronronne à faire crouler les plâtres. Bien mieux, il fait du chantage. Des gens qui ont une sensibilité arrivent et s’en vont si on le maltraite. Aux heures de bousculade il grimpe sur une colonne et se tient en équilibre sur un minuscule pot de fleurs où un oignon des montagnes lui pique le ventre. Il s’arrondit alors, par-dessous, il fait une voûte avec son ventre. Ainsi, à vrai dire, est ce petit Esquimau qui jette des yeux pleins d’or dévorant sur la vie. La vie est bonne et le prouve. Surtout, cependant, dans la raréfaction glaciaire, ou tout ailleurs, dans le martyre, les affres, les combles. L’être est libre, mais pas égal, si ce n’est par cette liberté même qui ne chante sa note divine que quand la tristesse est sur toute la terre et que la privation ne peut être dépassée. Mais je crois avoir déjà dit cela plusieurs fois ».
C’est cela justement qu’il faut et avec l’obstination ventrale d’un animal au front pur : c’est lire et relire Le Canal exutoire et d’abord mieux regarder ce titre et se compénétrer de sa beauté pratique et de sa raison d’être qu’une notice en exergue explicite : «On appelle canal exutoire un canal qui favorise l’écoulement des eaux, pour empêcher qu’un lac ou une étendue d’eau que remplit par l’autre bout une rivière, ne monte éternellement ».
Il est bel et bon que l’eau monte et fasse parfois des lacs, mais il n’est pas souhaitable qu’elle monte « éternellement » car alors elle noierait tout et bien pire : deviendrait stagnante et croupissante et forcément malsaine à la longue autant qu’une pensée enfermée dans un bocal sans air.
Le canal, comme celui par lequel on pisse, est là comme la bonde qu’on lâche pour l’assainissement des contenus avant le récurage des cuves, des reins et des neurones. Certes on est enfermé dans son corps, et sans doute se doit-on tant soit peu à la société, fût-elle « une viscosité », comme on l’apprendra, ou même une « fiction », mais l’échappée passera par là, sans oublier que la liberté et la tristesse ont partie liée.
Le premier barrage que fait sauter ici le poète est celui d’un simulacre de société perçu comme un empêchement vital de type moralisant, dont le dernier avatar est aujourd’hui l’américaine political correctness, ce politiquement correct que Charles-Albert eût sans doute exécré.
Cette première attaque, et fulminante, du Canal exutoire, vise évidemment ces dames de vigilante vertu dont les ligues agissaient bel et bien dans la Genève bourgeoise et calviniste de ces années-là, mais il faut voir plus largement ce que signifie l’opposition des « ombrelles fanées » et de la vertu romaine qu’invoque le lecteur de Virgile et de Dante et qui fait aussi écho, peut-être, à la fameuse formule de Maurras dont les frères Cingria partageaient le goût en leurs jeunes années: « Je suis Romain, je suis humain : deux propositions identiques».
Sur quoi l’on relit la première page du Canal exutoire avant de penser plus avant :
« Il est odieux que le monde appartienne aux virtuistes – à des dames aux ombrelles fanées par les climats qui indiquent ce qu’il faut faire ou ne pas faire -, car vertu, au premier sens, veut dire courage. C’est le contraire du virtuisme. La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine.
L’homme est bon, c’est entendu. Bon et sourdement feutré, comme une torride chenille noire dans ses volutes. Bon mais pas philanthrope. Il y a des moments où toutes ces ampoules doivent claquer et toutes ces femmes et toutes ces fleurs doivent obéir.
Il suffit qu’il y ait quelqu’un »…
Or cette vitupérante attaque ne serait qu’une bravade rhétorique genre coup de gueule si son geste ne débouchait sur ce quelqu’un qui révèle précisément l’être dans sa beauté et dans sa bonté, son origine naturelle (de femme-fleur ou d’homme tronc, tout est beau et bon) et de ses fins possiblement surnaturelles, on n’en sait rien mais Cingria y croit et bien plus qu’une croyance c’est le chemin même de sa poétique et de sa pensée.
 L’être n’est pas du tout un spectacle, comme l’a hasardé certaine professeure ne voyant en le monde de Charles-Albert qu’un théâtre, pas plus qu’il ne se réduit à une déambulation divagante juste bonne à flatter l’esthétisme dandy d’autres lettrés sans entrailles : l’être est une apparition de terre et d’herbe et de chair et d’esprit dans les constellation d’eau et de feu, et tout son mystère soudain ce soir prend ce visage : « Un archange est là, perdu dans une brasserie ».
L’être n’est pas du tout un spectacle, comme l’a hasardé certaine professeure ne voyant en le monde de Charles-Albert qu’un théâtre, pas plus qu’il ne se réduit à une déambulation divagante juste bonne à flatter l’esthétisme dandy d’autres lettrés sans entrailles : l’être est une apparition de terre et d’herbe et de chair et d’esprit dans les constellation d’eau et de feu, et tout son mystère soudain ce soir prend ce visage : « Un archange est là, perdu dans une brasserie ».La condition de l’être a été précisée : « Il suffit qu’il y ait quelqu’un ». Et pas n’importe qui cela va sans dire. Réduire quelqu’un à n’importe qui fixe à mes yeux le péché mortel qu’on dit contre l’Esprit et qu’évoque cette pensée inspirée des carnets inédits de Thierry Vernet : « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».
L’évidence mystérieuse de l’être se trouve à tout moment perçue et ressaisie par Cingria à tous les états et degrés de la sensation. Tout est perçu comme à fleur de mots et tout découle, et tout informe à la fois et revivifie ce qu’on peut dire l’âme qui n’a rien chez lui de fadement éthéré ni filtré des prétendues impureté du corps.
Voici l’âme au bois de la nuit : « La chouette est un hoquet de cristal et d’esprit de sang qui bat aussi nettement et férocement que le sperme qui est du sang ».
Tout communique !
« Il suffit qu’il y ait quelqu’un », notait-il sur un feuille d’air, et ce quelqu’un fut de tous les temps et partout sans considération de race ou de foi ni de morgue coloniale ni de repentir philanthrope: « Une multitude de héros et de coalitions de héros existe dans les parties noires de la Chine et du monde qui ne supportera pas cette édulcoration éternellement (en Amérique, il y a Chicago). Déjà on écrase la philanthropie (le contraire de la charité). Un âpre gamin circule à Anvers, à qui appartient la chaussée élastique et le monde. Contre la « société » qui est une viscosité et une fiction. Car il y a surtout cela : l’être : rien de commun, absolument, entre ceci qui, par une séparation d’angle insondable, définit une origine d’être, une qualité d’être, une individualité, et cela, qui est appelé un simple citoyen ou un passant. Devant l’être – l’être vraiment conscient de son autre origine que l’origine terrestre – il n’y a, vous m’entendez, pas de loi ni d’égalité proclamée qui ne soit une provocation à tout faire sauter. L’être qui se reconnaît – c’est un temps ou deux de stupeur insondable dans la vie n’a point de seuil qui soit un vrai seuil, point de départ qui soit un vrai départ : cette certitude étant strictement connexe à cette notion d’individualité que je dis, ne pouvant pas ne pas être éternelle, qui rend dès lors absurdes les lois et abominable la société ».
On entend Monsieur Citoyen toussoter. Tout aussitôt cependant se précise, à l’angle séparant « l’être qui se reconnaît » et, par exemple, l’employé de bureau ou la cheffe de projet - de la même pâte d’être cela va sans dire que tout un chacun -, la notion de ce que Cingria définit par la formule d’« homme-humain » qu’il dit emprunter aux Chinois.
Charles-Albert le commensal affiche alors les termes de son ascèse poétique : « L’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. Mais déjà ce domicile est attrayant : il doit le fuir. À peine rentré, il peut s’asseoir sur son lit, mais, tout de suite, repartir. L’univers, de grands mâts, des démolitions à perte de vue, des usines et des villes qui n’existent pas puisqu’on s’en va, tout cela est à lui pour qu’il en fasse quelque chose dans l’œuvre qu’il ne doit jamais oublier de sa récupération. »
Ce mot de récupération est essentiel, mais attention : ne voir en Charles-Albert qu’un grappilleur d’observations ou qu’un chineur de sensations fait trop peu de cas de cette « œuvre », précisément, de transmutation du physique en métaphysique, comme il fait une icône de cette nouvelle apparition du plus banal chemineau: « J’ai vu hier un de ces hommes-humains. En pauvre veste, simplement assis sur le rail, il avait un litre dans sa poche et il pensait. C’est tout, il n’en faut pas plus ».
Grappiller sera merveilleux, c’est entendu, et chiner par le monde des choses inanimées et belles (cette poubelle dont le fer-blanc luit doucement dans la pénombre de la ruelle du Lac, tout à côté) ou bien observer (car « observer c’est aimer ») de ces êtres parfaits que sont les animaux ou des enfants, qui le sont par intermittence, et des dames et des messieurs qui font ce qu’ils peuvent dont le poète récupère les bribes d’éternité qui en émanent - tout cela ressortit à la mystérieuse évidence de l’être qui se reconnaît et s’en stupéfie.
« Une énigme entre toutes me tenaille, à quoi mes considérations du début n’ont pas apporté une solution suffisante. J’ai beau lire – et, puisque je vais vers des livres, c’est encore mon intention –je n’apprends rien. Un mot seulement de Voltaire : Il n’est pas plus étonnant de naître deux fois que de naître une fois, m’apprend que quelqu’un a trouvé étonnant de naître une fois ; mais est-ce que beaucoup, lisant cela, ont été secoués par cette évidence ? Je m’exprime mal : par la nature de cette évidence. Je m’exprime encore mal… il n’y a pas de mots, il n’y en aura jamais. Ou bien on est saisi d’un étonnement sans limites qui est, dans le temps de la rapidité d’un éclair, indiciblement instructif (je crois qu’on comprend quelque chose : on gratte à la caverne de l’énigme du monde ; mais on ne peut se tenir dans cet état ; immédiatement on oublie) ou bien on lit cela sans être effleuré et on passe à autre chose. Comme s’il y avait autre chose ! »
Cette impossibilité, pour les mots, de dire ce qu’il y a entre les mots et derrière les mots, Charles-Albert la ressent à proportion de son aptitude rarissime à suggérer ce qu’il y a derrière les mots et sous les mots. Il note simplement : « Le sol est invitant, fardé, aimable, élastique, lunaire », et c’est à vous de remplir les vides. Mais qui suggère autant au fil de telles ellipses ?
On lit par exemple ceci à la fin du Canal exutoire après de puissants développements qui, comme souvent dans cette œuvre, forment la masse roulante et grommelante d’un troupeau de mots qui vont comme se cherchant, et tout à coup cela fuse : « Ainsi est le cri doux de l’ours dans la brume arctique. Le soleil déchiqueté blasphème. Le chien aboie à théoriques coups de crocs la neige véhémente qui tombe. Les affreuses branches noires s’affaissent. La glace équipolle des fentes en craquements kilométriques. Un vieux couple humain païen se fait du thé sous un petit dôme. Un enfant pleure. C’est le monde ».
« Relire » aujourd’hui Cingria pourrait signifier alors qu’on commence à le lire vraiment. Or le lire vraiment commande une attention nouvelle, la moins « littéraire » possible, la plus immédiate et la plus rapide dans ses mises en rapport (on lira par exemple Le canal exutoire à Shangaï la nuit ou sur les parapets de Brooklyn Heights en fin de matinée, dans un café de Cracovie ou tôt l’aube dans les brumes d’Anvers, pour mieux en entendre la tonne par contraste), à l’écoute rafraîchie de cette parole proprement inouïe, absolument libre et non moins absolument centrée et fondée, chargée de sens comme le serait une pile atomique.
« C’est splendide, à vrai dire, d’entendre vibrer, comme vibre un bocal dangereusement significatif, cet instrument étourdissant qu’est un être. » Or tout un chacun, il faut le répéter, figure le même vibrant bocal que les derviches font vrombir en tournoyant sous le ciel pur.
Lire Cingria est une cure d’âme de tous les matins, après le dentifrice, et ensuite partout, au bureau, au tea-room des rombières poudrées à ombrelles, aux bains de soufre ou de boue, chez la coiffeuse Rita « pour l’homme » ou au club des amateurs de spécialités.
L’injonction de relire Cingria suppose qu’avoir lu Cingria fait partie de la pratique courante, et c’est évidemment controuvé par la statistique. Et pourtant c’est peut-être vrai quelque part, comme on dit aujourd’hui dans la langue de coton des temps qui courent, car il est avéré qu’on lit et qu’on vit cette poésie depuis des siècles et partout et que ça continue: on a lu Pétrarque et Virgile, on a lu Mengtsu et les poètes T’ang, on a lu l’élégie à la petite princesse égyptienne morte à huit ans il y a vingt-cinq siècles et tout le grand récit d’inquiétude et de reconnaissance que module le chant humain, on sait évidemment par cœur Aristote et Augustin de même qu’on lit dans le texte la Commedia de Dante et la Cinquième promenade de Rouseau, on a lu Max Jacob, on a lu Dimanche m’attend de Jacques Audiberti ou Rien que la terre de Paul Morand, plus récemment on a lu Testament du Haut-Rhône de Maurice Chappaz que Charles-Albert plaçait très haut aussi et qui participe également de ce qu’on pourrait dire le chant et la mémoire « antique » du monde, étant entendu que cette Antiquité-là, qui est celle-là même du Canal exutoire et de toutes les fugues de Cingria, est de ce matin.
Baudelaire l’écrit précisément : « Le palimpseste de la mémoire est indestructible ». Or c’est à travers les strates de mille manuscrits superposés et déchiffrés comme en transparence qu’il faut aussi (re) lire Cingria en excluant toute réquisition exclusive et tout accaparement.
Charles-Albert reste et restera toujours l’auteur de quelques-uns qui se reconnaissent dans l’être de son écriture, sans considération de haute culture pour autant. « L’être ne peut se mouvoir sans illusion », écrit-il encore dans Le canal exutoire, mais il a cette secousse : il est de tout autre nature et il est éternel. Je crois même qu’une fille de basse-cour pense ça : tout d’un coup, elle pense ça. Après elle oublie. Tous du reste, continuellement, nous ne faisons qu’oublier ».
On oubliera le Cingria des spécialistes, même s’il fut de grand apport pour ceci et cela. On oubliera le musicologue et l’historien, on oubliera plus ou moins la prodigieuse substance si modestement dispersée par l’écrivain dans cent revues et journaux, de la NRF jusqu’aux plus humbles, mais jamais nulle fille de basse-cour n’oubliera la découpe de cette écriture, sa façon de sculpter les objets, de les révéler sous une lumière neuve, de faire luire et chanter les mots.
On n’a pas encore assez dit, à propos de cette écriture, qu’elle consommait la fusion de l’apollinien et du dionysiaque, du très sublimé et du très charnel avec ce poids boursier sexuel et sa fusée lyrique – on est tenté de dire mystique mais on ne le dira pas, sous l’effet de la même réserve que celle du poète.
C’est encore dans Le canal exutoire qu’on lit ceci, dans la seconde séquence marquée par cette vertigineuse ressaisie de l’être en promenade quelque part en Bretagne. Or il faut tout citer de cette hallucinante prose : «On se promène ; on est très attentif, on va. C’est émouvant jusqu’à défaillir. On passe, on se promène, in va et on avance. Les murs –c’est de l’herbe et de la terre – ont de petites brèches. Là encore, on passe, on découvre. On devient Dante, on devient Pétrarque, on devient Virgile, on devient fantôme. De frêles actives vapeurs, un peu plus haut que la terre, roulent votre avance givrée. Je comprends que pour se retrouver ainsi supérieurement et ainsi apparaître et ainsi passer il faut ce transport, cet amour calme, et ce lointain feutré des bêtes, ce recroquevillement des insectes et cette nodosité des vipères dans les accès bas des plantes ; ces bois blancs, légers, vermoulus ; cette musique tendre des bêtes à ailes : ces feux modiques et assassins d’un homme ou deux arrivés de la mer, qui ont vite campé et qui fuient.
Les arbustes s’évasent, font de larges brasses à leurs bases. Il y a là des places où des oiseaux ventriloques, simplement posés à terre, distillent une acrobatie infinitésimale. C’est à perdre haleine. L’on n’ose plus avancer. Pourquoi se commet-on à appeler ça mystique ? C’est dire trop peu. Bien plus loin cela va et bien plus humainement à l’intérieur, au sens où ce qui est humain nécessite aussi un sang versé des autres, dont le bénéfice n’est pas perdu puisqu’il chante et appelle et charme et lie ; véritablement nous envahissant comme aucune écriture, même celle-là des orvets, cette anglaise pagayante, appliquée, construite, rapide, fervente, au couperet de la lune sur le doux trèfle, n’a le don de le faire. On a cru tout découvrir : on a poétisé la note subtile avec des coulements persuasifs entre les doigts. Ce n’était rien. Le cœur n’était pas en communication avec d’autres attaches profondes, ni le pied avec une herbe assez digne, ni ce cri enfin, ce cri désarçonnant de l’Esprit qui boit l’écho ne vous avait atteint, malgré de démantibulés coups de tambour, faisant véhémente votre âme, marmoréens vos atours, aimable votre marche, phosphorescente votre substance, métallique votre cerveau, intrépide votre cœur, féroce votre conviction, apaisé, concentré, métamorphosé votre être. Il fallait cette avance, ces lieux, cette modestie, ces atténuations, la paix, la mort des voix, l’insatiable fraîcheur du silence et de l’air et de l’odeur de mousse et de terre et d’herbe de ces nuits saintes. Sans retour possible, sans lumière, sans pain, sans lit, sans rien. »
Tel étant l’homme-humain.
Or, nul aujourd’hui n’a élevé l’abstraction lyrique à ces sidérales hauteurs sans s’égarer pour autant dans les fumées ou le glacier cérébral tant le mot reste irrigué de sang et gainé de chair.
Ensuite on retombe de très haut : j’entends à la radio suisse que Cingria serait réactionnaire ? Stupidité sans borne ! J’entends une voix de pédant rappeler qu’autour de ses vingt ans il aurait été maurrassien comme son frère Alexandre ? Ah la découverte et la belle affaire, mais qui fait encore se tortiller certains comme en d’autre temps certaines ombrelles évoquaient ses moeurs. Et quels mœurs ? Y étaient-elles ? L’ont-elle vu de leurs yeux lancer du foutre sur le piano de leur enfant ?
L’être qui se reconnaît échappe aux accroupissements et c’est donc en fugue que doit s’achever cette lecture du Canal exutoire.
 Ce jour d’août 1939 la mode était à la guerre et tout le monde en portait l’uniforme, sauf Charles-Albert qui s’apprêtait, du moins, à quitter Paris pour la Suisse.
Ce jour d’août 1939 la mode était à la guerre et tout le monde en portait l’uniforme, sauf Charles-Albert qui s’apprêtait, du moins, à quitter Paris pour la Suisse.Il avait tout préparé pour partir - « et vous savez ce que c’est émouvant, ce moment terrible »- , il avait hésité « sur le palier du vieil escalier qui craque », il était revenu sur ses pas afin de vider le vieux thé de la théière et de mieux fermer le piano de crainte que des papillons de nuit ne viennent s’étrangler et sécher dans les cordes « comme c’est arrivé la dernière fois », puis un télégramme lui était arrivé pour lui annoncer que des amis le prendraient le lendemain matin à bord de leur « puissante Fiat vermillon réglée pour l’Angleterre », et alors il s’était dit ceci : « Ah mais quel bonheur d’avoir encore un jour pour méditer tranquillement et ranger mieux ses livres. Et puis refaire une de ces fabuleuses sorties le soir dans ces quartiers terribles pleins de chair angoissée très pâle, rue des Rosiers, rue des Blancs-Manteaux, impasse ardente de l’Homme Armé, place des Archive où il y a tant de civilisation farouche et tendre. Là il y a un bar qui sanglote la lumière. J’y retrouve un petit cercle d’amis, un Madrilène racé qui a l’air d’un lévrier découpé dans du papier. Il veut savoir tout. Ah non, je ne veux pas qu’on parle d’art ni de poésie ce soir ! On a le cœur trop plein d’angoisse. La poésie, elle est là tout entière dans les cris qui sonnent de ces gosses qui ressortent après neuf heures pour jouer en espadrilles sur le bitume...
La Désirade, ce 16 septembre 2011.
-
Le Monde d'avant selon Roland Jaccard

 Journal de 1983 à 1988.Sur plus de 800 pages qui se lisent comme un feuilleton au jour le jour, l’Austro-Lausannois de Paris égrène ses plaisirs et ses peines des années 1983 à 1988, dans les coulisses de son journal Le Monde, dont il égratigne passablement le conformisme intellectuel et divers personnages, auprès d’une jeune L. étudiante au nom d’écrivain désormais reconnu, entre la piscine Deligny où il retrouve un certain Gabriel Matzneff - et moult autres rencontres, lectures, passions cinématographiques et réflexions échangées avec Cioran son mentor. Bavardage parisien que tout ça? Bien plus: un vivant témoignage d’écrivain et surtout: un ton, une voix, un style. Journal de lecture…Montreux-Jazz, ce dimanche 18 avril.- La froidure limpide de ces soirées de printemps est un enchantement de bonne vie le long du quai aux fleurs où toute une jeunesse afflue en fin de semaine, et passant tout à l’heure près de la table de ping-pong jouxtant l’auberge de jeunesse, à deux pas des eaux du lac orangées où se détachaient les silhouettes de deux kids amoureux, j’ai souri en pensant au prétendu nihilisme de Roland dans son soft goulag du palace, et je me suis rappelé la goût de Cioran pour le chocolat…À la veille de notre dernière revoyure dans le salon d’accueil du Lausanne-Palace, le 9 mars dernier, Roland Jaccard avait confirmé notre rencard par Messenger en m’annonçant un cadeau, non sans ajouter qu’il pourrait être embarrassant pour moi, et tout de suite je lui ai répondu que si son cadeau-surprise consistait à se suicider en ma présence, je déclinais poliment. Sur quoi, nous étant retrouvés sans masques dans le palace désert, après que je l’eus interrogé sur le cadeau en question, voilà qu’il me répond: c’est un chien. Jaccard allait me fourguer un chien, sûrement dans l’intention de se suicider dans la foulée! Donc je me récrie: pas question! Mais lui: attends! Et de me laisser là tout expectatif pendant qu’il va chercher «le cadeau» dans sa modeste suite à 800 balles la nuit, puis de revenir, non pas avec le doberman ou le caniche redouté, mais avec ce pavé sans collier: Le Monde d’avant!Mais quoi d’embarrassant dans ce cadeau, à part son volume et son poids? Que je me sente obligé de le lire et de lui dire ce que j’en pense et d’en écrire? Hélas Roland le sait: que j’ai toujours apprécié ses journaux, quoique ressentant les choses tout autrement que lui, et que jamais je ne me suis senti contraint de le flatter pas plus qu’il ne m’a fait jusque-là de cadeau empoisonné. Or je lui avais dit combien son Journal d’un homme perdu m’avait touché et intéressé, et voici qu’il m’apprend que ce nouveau volume porte sur les années précédant sa rupture d’avec Gabriel Matzneff et l’effondrement des bains Deligny où, soit dit en passant, je me suis juré de ne jamais mettre les pieds, moi qui ne jure que par les pataugeoires populaires de Pontoise ou de la Butte-aux-Cailles…Enfin voilà que le journal Libération, ces derniers jours, consacre deux pleines pages au Monde d’avant, alors qu’il est de notoriété publique que les journaux d’écrivains n’intéressent personne. Phénomène juste parisien alors, au motif que Jaccard égratigne Le Monde dont il fut le mercenaire pendant des années, et s’attarde ici et là à ses rencontres avec «Gabriel» et ses jouvencelles, dont une certaine Vanesssa, autant dire: papotage mondain? Oh que non! Pas que! Et moi qui n’ai guère apprécié le délayage des derniers journaux de Gabriel Matzneff, précisément, dont le ressassement complaisant de ses menées privées et la vanité narcissique me sont devenus insupportables, j’ai trouvé, au contraire, un intérêt presque constant à la lecture de cette somme que je situe dans la filiation des meilleurs «journaliers» à la Léautaud ou à la Jouhandeau, avec un ton particulier, cynique et tendre à la fois, plus original encore à mes yeux que l’excellent journal de Matthieu Galey...Ce lundi 19 avril, matin. – Comme tous les matins à l’éveil, avant de bricoler mes contrerimes réglementaires sur mon smartphone, je raconte à Lady L. les derniers épisodes, vus cette nuit, de l’étonnante série coréenne «médicale» traitant d’euthanasie et de la maladie-sans-douleurs dont souffre secrètement le protagoniste lui-même (ce Yo-an accusé d’avoir administré une dose létale illégale à un patient violeur d’enfants), je pense aux curiosités sans préjugés de Roland pour l’univers asiatique que je suis en train d’explorer sur le tard – c’est lui qui m’a fait découvrir le jeune poète japonais Ishigawa Takuboku - et plus précisément l’expression de l’intime que modulent les Coréens dans leur cinéma et leurs séries télévisées. Y a-t-il un Amiel dans la littérature coréenne d’aujourd’hui? Voilà la question que je pourrais poser au professeur Kim Jin-ha auquel j’ai écrit hier pour qu’il me fasse connaître le tout-Séoul littéraire et universitaire…Quant au Monde d’avant de notre ami Roland, il me fait revenir à la spécificité du journal, intime ou extime - comme l’a appelé Michel Tournier -, dont la pratique n’a plus rien de sa présumée innocence à l’ère d’Internet.De fait, l’extension prodigieuse du domaine de l’indiscrétion, dont procède évidemment l’étiolement de toute intimité, font que le «pacte» initial du journal intime s’est aujourd’hui complètement modifié. En modèle du genre, le Journal intime d’Amiel, qui ne voyait parfois en celui-ci qu’un produit moite d’onanisme intellectuel, et qu’il avait demandé à ses proches de jeter au feu, représente douze volumes de plus de 1000 pages chacun, que personne probablement n’a lu de A à Z, même pas Roland Jaccard qui en a été un défenseur passionné. Mais d’Amiel aux «montages» de Max Frisch, de ceux-ci aux carnets du cinéaste japonais Ozu ou à ceux d’Andy Warhol, du journal «privé» longtemps censuré de Julien Green aux 583 nouvelles pages du Monde d’avant, comment ne pas voir que le genre a éclaté et avec lui la délimitation des faits «réels» et de la fiction?Soir.- Revenant tout à l’heure de la FNAC où je suis tombé sur un pavé tout neuf d’un certain Kim Un-su, intitulé Sang chaud et dont le bandeau annonce «La Corée, nouveau pays du polar», je me dis que, décidément, je refuse de me cantonner dans le «monde d’avant» à la Roland Jaccard, même si j’en ai fait partie et que mon futur incertain en sera pavé au fil du plus-que-présent à venir, mais j’ai été passeur et le resterai tout en me plaisant à détailler les notes que j’ai prises, parallèlement à ma relecture de Balzac, à celle du journal de Roland dont l’exergue annonce la couleur sous la plume du Goethe de Poésie et Vérité: «Seul l’individuel nous plaît; d’où notre goût pour toutes les révélations personnelles, lettres et anecdotes, même concernant des gens sans importance. Il est parfaitement oiseux de se demander s’il convient d’écrire son autobiographie. Je considère celui qui le fait comme le plus courtois des hommes. S’il communique sa propre expérience, peu importent les motifs qui l’y incitent»...Et mes notes sur l’année 1983 de fixer déjà mille détails, piques ou aphorismes à la Jules Renard, citations, esquisses de portraits, notes sur tel film (Pandora pour commencer) ou telle lecture partagée avec L. (Linda Lê qui lui lit À l’ombre des jeunes filles en fleur à haute voix), pas un jour sans une ligne…Ce mardi 20 avril. - Ce qu’on appelle journal, intime ou débridé de tout secret, n’est-il que la consolation livide de tant de romanciers ratés, comme le pensent tant de romanciers qui se croient arrivés? L’alternative n'est évidemment qu’un leurre de plus, quand ce qu’on attend reste l’étonnement voire l’enchantement tenant aux mêmes sortes de petits riens dont l’écrivain en «musicien» fait un peu tout, dans quelque genre que ce soit.Julien Green l’écrit le 15 juillet 1956 de sa main appliquée, après s’être branlé ou avoir sucé Robert, à moins qu'ils ne viennent tous deux de se partager Jonas le jeune Allemand: «Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes».Ce qui ne signifie pas, cela va sans dire, que Julien Green, plus que Roland Jaccard se contente du n’importe quoi très en cour de nos jours. Au contraire ils prennent très au sérieux le fait d’être écrivain, et même: qu'on le considère comme un écrivain est à peu près la seule chose qui importe à Roland; et qu’on ne doute pas de l’authenticité de son journal écrit d’un jet et publié sans ratures.Donc Roland a mal aux dents, il se rend lundi dans un dispensaire dévolu aux contrôles vénériens et mardi soir il passe à Apostrophes ou chez Michel Polac dont ses amis lui diront merveille ou pis que pendre, il téléphone à Cioran mercredi qui l'impressionne toujours par ses saillies inattendues, et jeudi il se plaint de ses amis Contat et Ben Jelloun dont l’arrivisme social l’énerve même s'il envie leur «avancées», il reproche vendredi au socialisme de Mitterrand d’être le parti de l'envie alors que lui-même dérive de la gauche peu militante à la droite prudente, il revoit samedi un film de Douglas Sirk avec le même bonheur qu’il partage avec L. qu’il n’épousera pas pour autant, en connivence pleinement partagée pendant cinq ou six ans après quoi l’élan faiblira comme aura foiré la passion de cet enfoiré de Gabriel pour cette cinglée de Vanessa, enfin le dimanche après-midi le verra rédiger une belle page consacrée au philosophe russe Léon Chestov, l’un de mes penseurs préférés avec Vassily Rozanov, etc.Soir, au jardin japonais de Burier. – La conception occidentale de l’individu, à laquelle Goethe fait allusion dans le fragment de Poésie et vérité cité en exergue du Monde d’avant, ne serait pas ce qu’elle est sans les Grecs et sans le premier écrivain de la chrétienté que fut l’apôtre Paul, fondateur à cet égard avant le premier «diariste» explicite qu’est Augustin d’Hippone, et j’y repense en assistant à l’envol d’un héron cendré au-dessus de l’étang que franchit un petit pont de bois à la japonaise, me rappelant ce que nous disait, ce midi, notre ami M. au repas que nous avons partagé avec nos chères et tendres, rapport aux multitudes chinoises et à notre méconnaissance de la planète asiatique.«Et moi? Et moi? Et moi?», chantait Antoine en nos années bohèmes, et c’est aujourd’hui l’obsession des internautes, dont certains publient d’ailleurs leur «cher journal» comme l’inepte déballage d’une Anna Todd, vendu à des millions d’exemplaires.Mais là encore je pense que la littérature est «transgenre» et ce qui compte, dans le journal de Roland Jaccard comme dans celui de Klaus Mann ou de Virginia Woolf, de Léon Tolstoï (qui admirait Amiel) ou d’Hervé Guibert, de l’Italien Cesare Pavese ou du poignant Journal d’un homme déçu de Barbellion, c’est la voix particulière de la personne et son rapport «physique» au langage plus que la posture du personnage.À cet égard, les manières de dandy pseudo-désespéré de l’ami Roland, se la jouant cynique alors que le taraudent ses angoisses nocturnes, sa conscience professionnelle de chroniqueur et le souci quasi paternel de coacher sa jeune amante candidate au concours d’une haute école, relèvent d’une esthétique à cosmétique rétro (son culte de Louise Brooks et de John Wayne, d’Egon Schiele ou du génial Otto Weininger cumulant les traits contradictoires du juif antisémite et de l’inverti homophobe…) pas pire que celle d’un Charles Bukowski cultivant sa dégaine de clodo pourri dégueulasse en Léautaud ricain…Ce mercredi 21 avril. – Le Monde d’avant de Roland Jaccard est aussi encombrant, avec ses 843 pages et ses 900 grammes de papier imprimé, qu’un chien de garde autrichien (la mère de l’auteur était Viennoise), impossible à glisser dans la poche revolver d’une nymphette…Stendhal disait qu’un roman est un miroir qu’on promène le long de son propre chemin, et Proust que chaque (bon) lecteur recrée le livre qu’il est en train de lire. Or je (re)découvre, en lisant Le Monde d’avant, tout ce que j’aime, que Jaccard dédaigne ou décrie de bonne ou de mauvaise foi: l’amour des enfants qu’il vomit et l’agrément des chemins de campagne qu’il évite, la vie de famille qu’il hait et qui m’amuse, mon désintérêt total pour le ping-pong et les échecs qu’il pratique en maniaque compulsif, enfin tout ce qui fait qu’il est lui et que j’en suis un autre.Un écrivain est-il plus lui-même dans son «cher journal» que dans un roman? Je ne suis pas sûr que notre ami Roland le pense, ni ne suis sûr du contraire. Mais le fait est que pas mal de romanciers (un Stendhal justement, un Tolstoï ou un Gide) en disent autant ou plus sur eux-mêmes dans leurs romans que dans leurs écrits intimes, alors que le nombrilisme d’Amiel touche à l’universel humain.Conclusion de ce matin nuageux à couvert: Le «monde d’avant» est une fiction autant que nos spéculations sur le temps à venir, et maintenant? Maintenant faut pas que j’oublie mes 12 médics de cardiopathe en rémission de cancer et un peu vacillant entre deux doses de Pfizer, comme Lady L. vient de se tirer avec le chien pour sa consulte à elle, ensuite on aura la visite des deux petits lascars de notre seconde fille qui ont l’air décidés à s’amuser encore quelque temps sur cette planète, mais ça c’est le monde d’après et gaffe de ne pas tirer l’échelle…(Cette chronique a paru à l'enseigne du média indocile Bon Pour La Tête)
Journal de 1983 à 1988.Sur plus de 800 pages qui se lisent comme un feuilleton au jour le jour, l’Austro-Lausannois de Paris égrène ses plaisirs et ses peines des années 1983 à 1988, dans les coulisses de son journal Le Monde, dont il égratigne passablement le conformisme intellectuel et divers personnages, auprès d’une jeune L. étudiante au nom d’écrivain désormais reconnu, entre la piscine Deligny où il retrouve un certain Gabriel Matzneff - et moult autres rencontres, lectures, passions cinématographiques et réflexions échangées avec Cioran son mentor. Bavardage parisien que tout ça? Bien plus: un vivant témoignage d’écrivain et surtout: un ton, une voix, un style. Journal de lecture…Montreux-Jazz, ce dimanche 18 avril.- La froidure limpide de ces soirées de printemps est un enchantement de bonne vie le long du quai aux fleurs où toute une jeunesse afflue en fin de semaine, et passant tout à l’heure près de la table de ping-pong jouxtant l’auberge de jeunesse, à deux pas des eaux du lac orangées où se détachaient les silhouettes de deux kids amoureux, j’ai souri en pensant au prétendu nihilisme de Roland dans son soft goulag du palace, et je me suis rappelé la goût de Cioran pour le chocolat…À la veille de notre dernière revoyure dans le salon d’accueil du Lausanne-Palace, le 9 mars dernier, Roland Jaccard avait confirmé notre rencard par Messenger en m’annonçant un cadeau, non sans ajouter qu’il pourrait être embarrassant pour moi, et tout de suite je lui ai répondu que si son cadeau-surprise consistait à se suicider en ma présence, je déclinais poliment. Sur quoi, nous étant retrouvés sans masques dans le palace désert, après que je l’eus interrogé sur le cadeau en question, voilà qu’il me répond: c’est un chien. Jaccard allait me fourguer un chien, sûrement dans l’intention de se suicider dans la foulée! Donc je me récrie: pas question! Mais lui: attends! Et de me laisser là tout expectatif pendant qu’il va chercher «le cadeau» dans sa modeste suite à 800 balles la nuit, puis de revenir, non pas avec le doberman ou le caniche redouté, mais avec ce pavé sans collier: Le Monde d’avant!Mais quoi d’embarrassant dans ce cadeau, à part son volume et son poids? Que je me sente obligé de le lire et de lui dire ce que j’en pense et d’en écrire? Hélas Roland le sait: que j’ai toujours apprécié ses journaux, quoique ressentant les choses tout autrement que lui, et que jamais je ne me suis senti contraint de le flatter pas plus qu’il ne m’a fait jusque-là de cadeau empoisonné. Or je lui avais dit combien son Journal d’un homme perdu m’avait touché et intéressé, et voici qu’il m’apprend que ce nouveau volume porte sur les années précédant sa rupture d’avec Gabriel Matzneff et l’effondrement des bains Deligny où, soit dit en passant, je me suis juré de ne jamais mettre les pieds, moi qui ne jure que par les pataugeoires populaires de Pontoise ou de la Butte-aux-Cailles…Enfin voilà que le journal Libération, ces derniers jours, consacre deux pleines pages au Monde d’avant, alors qu’il est de notoriété publique que les journaux d’écrivains n’intéressent personne. Phénomène juste parisien alors, au motif que Jaccard égratigne Le Monde dont il fut le mercenaire pendant des années, et s’attarde ici et là à ses rencontres avec «Gabriel» et ses jouvencelles, dont une certaine Vanesssa, autant dire: papotage mondain? Oh que non! Pas que! Et moi qui n’ai guère apprécié le délayage des derniers journaux de Gabriel Matzneff, précisément, dont le ressassement complaisant de ses menées privées et la vanité narcissique me sont devenus insupportables, j’ai trouvé, au contraire, un intérêt presque constant à la lecture de cette somme que je situe dans la filiation des meilleurs «journaliers» à la Léautaud ou à la Jouhandeau, avec un ton particulier, cynique et tendre à la fois, plus original encore à mes yeux que l’excellent journal de Matthieu Galey...Ce lundi 19 avril, matin. – Comme tous les matins à l’éveil, avant de bricoler mes contrerimes réglementaires sur mon smartphone, je raconte à Lady L. les derniers épisodes, vus cette nuit, de l’étonnante série coréenne «médicale» traitant d’euthanasie et de la maladie-sans-douleurs dont souffre secrètement le protagoniste lui-même (ce Yo-an accusé d’avoir administré une dose létale illégale à un patient violeur d’enfants), je pense aux curiosités sans préjugés de Roland pour l’univers asiatique que je suis en train d’explorer sur le tard – c’est lui qui m’a fait découvrir le jeune poète japonais Ishigawa Takuboku - et plus précisément l’expression de l’intime que modulent les Coréens dans leur cinéma et leurs séries télévisées. Y a-t-il un Amiel dans la littérature coréenne d’aujourd’hui? Voilà la question que je pourrais poser au professeur Kim Jin-ha auquel j’ai écrit hier pour qu’il me fasse connaître le tout-Séoul littéraire et universitaire…Quant au Monde d’avant de notre ami Roland, il me fait revenir à la spécificité du journal, intime ou extime - comme l’a appelé Michel Tournier -, dont la pratique n’a plus rien de sa présumée innocence à l’ère d’Internet.De fait, l’extension prodigieuse du domaine de l’indiscrétion, dont procède évidemment l’étiolement de toute intimité, font que le «pacte» initial du journal intime s’est aujourd’hui complètement modifié. En modèle du genre, le Journal intime d’Amiel, qui ne voyait parfois en celui-ci qu’un produit moite d’onanisme intellectuel, et qu’il avait demandé à ses proches de jeter au feu, représente douze volumes de plus de 1000 pages chacun, que personne probablement n’a lu de A à Z, même pas Roland Jaccard qui en a été un défenseur passionné. Mais d’Amiel aux «montages» de Max Frisch, de ceux-ci aux carnets du cinéaste japonais Ozu ou à ceux d’Andy Warhol, du journal «privé» longtemps censuré de Julien Green aux 583 nouvelles pages du Monde d’avant, comment ne pas voir que le genre a éclaté et avec lui la délimitation des faits «réels» et de la fiction?Soir.- Revenant tout à l’heure de la FNAC où je suis tombé sur un pavé tout neuf d’un certain Kim Un-su, intitulé Sang chaud et dont le bandeau annonce «La Corée, nouveau pays du polar», je me dis que, décidément, je refuse de me cantonner dans le «monde d’avant» à la Roland Jaccard, même si j’en ai fait partie et que mon futur incertain en sera pavé au fil du plus-que-présent à venir, mais j’ai été passeur et le resterai tout en me plaisant à détailler les notes que j’ai prises, parallèlement à ma relecture de Balzac, à celle du journal de Roland dont l’exergue annonce la couleur sous la plume du Goethe de Poésie et Vérité: «Seul l’individuel nous plaît; d’où notre goût pour toutes les révélations personnelles, lettres et anecdotes, même concernant des gens sans importance. Il est parfaitement oiseux de se demander s’il convient d’écrire son autobiographie. Je considère celui qui le fait comme le plus courtois des hommes. S’il communique sa propre expérience, peu importent les motifs qui l’y incitent»...Et mes notes sur l’année 1983 de fixer déjà mille détails, piques ou aphorismes à la Jules Renard, citations, esquisses de portraits, notes sur tel film (Pandora pour commencer) ou telle lecture partagée avec L. (Linda Lê qui lui lit À l’ombre des jeunes filles en fleur à haute voix), pas un jour sans une ligne…Ce mardi 20 avril. - Ce qu’on appelle journal, intime ou débridé de tout secret, n’est-il que la consolation livide de tant de romanciers ratés, comme le pensent tant de romanciers qui se croient arrivés? L’alternative n'est évidemment qu’un leurre de plus, quand ce qu’on attend reste l’étonnement voire l’enchantement tenant aux mêmes sortes de petits riens dont l’écrivain en «musicien» fait un peu tout, dans quelque genre que ce soit.Julien Green l’écrit le 15 juillet 1956 de sa main appliquée, après s’être branlé ou avoir sucé Robert, à moins qu'ils ne viennent tous deux de se partager Jonas le jeune Allemand: «Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes».Ce qui ne signifie pas, cela va sans dire, que Julien Green, plus que Roland Jaccard se contente du n’importe quoi très en cour de nos jours. Au contraire ils prennent très au sérieux le fait d’être écrivain, et même: qu'on le considère comme un écrivain est à peu près la seule chose qui importe à Roland; et qu’on ne doute pas de l’authenticité de son journal écrit d’un jet et publié sans ratures.Donc Roland a mal aux dents, il se rend lundi dans un dispensaire dévolu aux contrôles vénériens et mardi soir il passe à Apostrophes ou chez Michel Polac dont ses amis lui diront merveille ou pis que pendre, il téléphone à Cioran mercredi qui l'impressionne toujours par ses saillies inattendues, et jeudi il se plaint de ses amis Contat et Ben Jelloun dont l’arrivisme social l’énerve même s'il envie leur «avancées», il reproche vendredi au socialisme de Mitterrand d’être le parti de l'envie alors que lui-même dérive de la gauche peu militante à la droite prudente, il revoit samedi un film de Douglas Sirk avec le même bonheur qu’il partage avec L. qu’il n’épousera pas pour autant, en connivence pleinement partagée pendant cinq ou six ans après quoi l’élan faiblira comme aura foiré la passion de cet enfoiré de Gabriel pour cette cinglée de Vanessa, enfin le dimanche après-midi le verra rédiger une belle page consacrée au philosophe russe Léon Chestov, l’un de mes penseurs préférés avec Vassily Rozanov, etc.Soir, au jardin japonais de Burier. – La conception occidentale de l’individu, à laquelle Goethe fait allusion dans le fragment de Poésie et vérité cité en exergue du Monde d’avant, ne serait pas ce qu’elle est sans les Grecs et sans le premier écrivain de la chrétienté que fut l’apôtre Paul, fondateur à cet égard avant le premier «diariste» explicite qu’est Augustin d’Hippone, et j’y repense en assistant à l’envol d’un héron cendré au-dessus de l’étang que franchit un petit pont de bois à la japonaise, me rappelant ce que nous disait, ce midi, notre ami M. au repas que nous avons partagé avec nos chères et tendres, rapport aux multitudes chinoises et à notre méconnaissance de la planète asiatique.«Et moi? Et moi? Et moi?», chantait Antoine en nos années bohèmes, et c’est aujourd’hui l’obsession des internautes, dont certains publient d’ailleurs leur «cher journal» comme l’inepte déballage d’une Anna Todd, vendu à des millions d’exemplaires.Mais là encore je pense que la littérature est «transgenre» et ce qui compte, dans le journal de Roland Jaccard comme dans celui de Klaus Mann ou de Virginia Woolf, de Léon Tolstoï (qui admirait Amiel) ou d’Hervé Guibert, de l’Italien Cesare Pavese ou du poignant Journal d’un homme déçu de Barbellion, c’est la voix particulière de la personne et son rapport «physique» au langage plus que la posture du personnage.À cet égard, les manières de dandy pseudo-désespéré de l’ami Roland, se la jouant cynique alors que le taraudent ses angoisses nocturnes, sa conscience professionnelle de chroniqueur et le souci quasi paternel de coacher sa jeune amante candidate au concours d’une haute école, relèvent d’une esthétique à cosmétique rétro (son culte de Louise Brooks et de John Wayne, d’Egon Schiele ou du génial Otto Weininger cumulant les traits contradictoires du juif antisémite et de l’inverti homophobe…) pas pire que celle d’un Charles Bukowski cultivant sa dégaine de clodo pourri dégueulasse en Léautaud ricain…Ce mercredi 21 avril. – Le Monde d’avant de Roland Jaccard est aussi encombrant, avec ses 843 pages et ses 900 grammes de papier imprimé, qu’un chien de garde autrichien (la mère de l’auteur était Viennoise), impossible à glisser dans la poche revolver d’une nymphette…Stendhal disait qu’un roman est un miroir qu’on promène le long de son propre chemin, et Proust que chaque (bon) lecteur recrée le livre qu’il est en train de lire. Or je (re)découvre, en lisant Le Monde d’avant, tout ce que j’aime, que Jaccard dédaigne ou décrie de bonne ou de mauvaise foi: l’amour des enfants qu’il vomit et l’agrément des chemins de campagne qu’il évite, la vie de famille qu’il hait et qui m’amuse, mon désintérêt total pour le ping-pong et les échecs qu’il pratique en maniaque compulsif, enfin tout ce qui fait qu’il est lui et que j’en suis un autre.Un écrivain est-il plus lui-même dans son «cher journal» que dans un roman? Je ne suis pas sûr que notre ami Roland le pense, ni ne suis sûr du contraire. Mais le fait est que pas mal de romanciers (un Stendhal justement, un Tolstoï ou un Gide) en disent autant ou plus sur eux-mêmes dans leurs romans que dans leurs écrits intimes, alors que le nombrilisme d’Amiel touche à l’universel humain.Conclusion de ce matin nuageux à couvert: Le «monde d’avant» est une fiction autant que nos spéculations sur le temps à venir, et maintenant? Maintenant faut pas que j’oublie mes 12 médics de cardiopathe en rémission de cancer et un peu vacillant entre deux doses de Pfizer, comme Lady L. vient de se tirer avec le chien pour sa consulte à elle, ensuite on aura la visite des deux petits lascars de notre seconde fille qui ont l’air décidés à s’amuser encore quelque temps sur cette planète, mais ça c’est le monde d’après et gaffe de ne pas tirer l’échelle…(Cette chronique a paru à l'enseigne du média indocile Bon Pour La Tête) -
Antonin Moeri au conditionnel du plus-que-présent

À propos de L'Homme en veste de pyjama
Le dernier livre d’Antonin Moeri est à mes yeux son premier roman. L’homme en veste de pyjama marque en effet la conclusion provisoire d’une recherche ponctuée par une douzaine d’autres livres, dont trois sont déjà qualifiés de romans, mais ce roman l’est plus que les autres, de même que Le temps retrouvé qui clôt la Recherche proustienne, est le départ reconnu de celle-ci.
L’Homme en veste de pyjama est une espèce de quête des heures de la sensation vraie, une espèce de grappillage de « minutes heureuses », pour citer Haldas citant Baudelaire, une espèce de description des débuts et des développements d’une espèce d’écrivain, une espèce d’histoire de fou qui se jouerait sur la scène d’un vaste asile de dingues parlant à tort et à travers mais gravement, doctement, correctement et pour ainsi dire scientifiquement, sans aucun sens du comique, à l’inverse du discours de L’Homme en pyjama dont la vis comica est la vertu.
Quand le comique ouvre ses vannes
Le comique est rare dans les lettres romandes, et guère plus fréquent dans les lettres françaises - si l’on excepte évidemment Proust et Céline, ou Rabelais et Molière avant ces deux joyeux drilles -, mais les lettres mondiales sont moins avares en la matière, surtout dans leurs souches antiques et populaires. Quant à l’humour, dont la littérature de tous les temps et de partout est pleine, autant que de tendresse (couple sympathique incessamment valorisé dans les prières d’insérer de romans contemporains), il n’est pas à confondre avec le comique en veste de pyjama ou en caleçon long.
Quand je dis que L’Homme en veste de pyjama est à mes yeux le premier roman d’Antonin Moeri, j’entends par là que pour la première fois je lis un roman de cet auteur qui n’est pas spécifiquement un «roman de Moeri» comme les romans de Philippe Sollers, qui ne sont pas à mes yeux de vrais romans, sont spécifiquement des «romans de Sollers». Plus précisément, les personnages de L’Homme en veste de pyjama se sont affranchis, à mes yeux de leur tutelle implicitement autobiographique, comme les personnages des nouvelles d’Antonin Moeri se distinguent des figures de ce qu’on pourrait dire les autofictions de l’auteur.
L’Homme en veste de pyjama est à mes yeux un vrai roman par l’écart soudain que l’auteur marque par rapport à lui-même, et surtout par la modulation nouvelle, théâtrale et poétique, d’une écriture qui se ressaisit elle-même dans les tenants de sa motivation existentielle et se projette dans les aboutissants d’une forme à la fois plus consciente d’elle-même et plus libre – plus librement volubile et plus riche en bifurcations virtuelles et précisions non-dites, de coqs-à-l’âne en points de suspension.
Ceux-ci marquent-ils, chez le Moeri lecteur féru de Céline, l’influence de celui-ci ? Non : c’est autre chose : les points de suspension de L’Homme en veste de pyjama ne sont pas les ponctuations rythmiques d’un discours en flux tendu mais les espaces réservés, les parenthèses entrouvertes au lecteur, les échappées virtuelles, les possibilités de découvrir une autre île derrière la vague de la phrase, les innombrables suggestions perceptibles dans la folâtre et bientôt torrentielle foulée des mots.
Vie et destin de l’homme qualifié
Il y a la vie, qui est une base de données, et le destin qui en fait une affaire personnelle, l’un et l’autre formant une espèce de croix.
De la vie aux multiples avatars, Antonin Moeri n’a cessé d’achopper dans ses douze livres précédents, dès Le fils à maman dont plusieurs analystes, jusqu’au Japon, ont relevé le caractère œdipien, et l’avant-dernier ouvrage de l’auteur, familièrement intitulé Pap’s, marque la rencontre du fils en question avec cet autre fils que fut son père en sa jeunesse, constituant alors, si l’on ose dire, la sortie par le haut de L’homme en pyjama dont le protagoniste est pensé pour la première fois, il me semble, comme un artisan actif de sa petite destinée.
Si j’ai évoqué Le Temps retrouvé à propos de la décision d’écrire du petit fonctionnaire à main potelée destiné à devenir l’homme en veste de pyjama, ce n’est pas pour comparer l’incomparable mais pour indiquer ce moment de la vie
qui fait de l’homme sans autre qualification que celle d’individu quelconque, dit aussi pékin, un potentiel potier, un espion en mission ou un preneur de notes anticipant la formidable, vaniteuse ou peut-être sacrée prétention d’écrire. Pour le Narrateur du Temps retrouvé, l’alternative se réduira implicitement à la formule secrète: devenir Marcel Proust ou s’abstenir. De la même façon, avec le grain de sel du comique d’autodérision bonnement exacerbé dans ce premier roman d’une destinée, si modeste fût-elle, se fonde-t-il sur la décision d’endosser la fameuse veste de pyjama, sinon rien.
Certains analystes, dont un Finlandais notoire, prétendront peut-être que la qualification de l’homme en veste de pyjama, comme celle de la femme à la frange de gamine, découle d’une manière de typologie inspirée par l’homme au loup ou la femme au cigare de Freud lui-même - celui-là même que Vladimir Nabokov qualifiait de « charlatan de Vienne » ? La question est ouverte, mais ce qui est sûr est que le procédé littéraire en question, comme celui des points de suspension, contribue à la meilleure identification des rôles en jeu et des masques portés.
Une story d’époque et ce qui s’ensuit
La lectrice et le lecteur s’impatientent alors, à bon droit, de connaître au moins le pitch de L’Homme en veste de pyjama. Ce qui donne ceci en moins de 280 caractères : «Deux compères, un ancien fonctionnaire fondu en littérature de niche, et un sculpteur connu à l’international, échangent, le temps d’un gros orage, à propos de l’amour fou vécu par le plus empoté et le plus volubile des deux – le futur homme en veste de pyjama. »
À mi parcours de la narration de L’Homme en veste de pyjama, assumée par diverses voix (un Nous semi-divin succédant à un Je aussi mobile que les regards des protagonistes se croisant ou s’inversant), le futur écrivain se reproche de ne pas filer son feuilleton en storyteller soucieux de prendre le lecteur par la main, pure ironie on s’en doute alors que ce qui se raconte là-dedans pourrait se résumer à l’histoire d’une écriture dressant sa vitalité « contre la vie ».
Là encore on retrouve le projet proustien consistant à inventer un langage vivant sans se borner au copier /coller du reportage décrié par Mallarme, et le vivant déferle alors de façon nouvelle, imprévisible parfois et suivant pourtant sa logique narrative comme un cours d’eau à multiples ramifications et rebonds, lesquels proposent autant de suggestions de lecture. C’est la, à mon sens, l’aspect le plus intéressant de L’Homme en veste de pyjama, qui nous force la main plus qu’il ne nous la prend, convoquant notre propre mémoire et nos affects, nos Minutes heureuses et nus vertiges récurrents. Tout cela par les vecteurs de situations et autres scènes, au fil du jeu de rôles et des délires plus ou moins contrôlés par l’attention flottante de l’auteur et du lecteur, personnages à l’appui.
Je ne sais plus qui a dit que tout un pan de la littérature russe du siècle passé était sorti du manteau de Gogol, mais ce que je constate est que d’une veste de pyjama peut aussi sortir une flopée de personnages en mouvement dans le temps.
L’homme en veste de pyjama, lui-même, a passé par divers avatars socialement définis et en évolution. Sa propre story est médiatisée par son ami le sculpteur de boules mobiles, dit aussi l’artiste aux pompes jaunes, conjoint d’une journaliste à la coule portée sur l’opéra wagnérien. Quant aux figures transitionnelles de la story amoureuse du futur homme en veste de pyjama, elles sont typées physiquement en fille de feu pour celle qui a marqué la vie du protagoniste au point de le transformer , et en femme à frange de gamine s’agissant d’une voisine soumise à son voyeurisme actuel de Romancier en pyjama.
Le portrait à facettes de celui-ci se constitue donc, en creux,à partir des regards et des dits ou écrits (les lettres enflammées ou accusatrices de la fille au regard de feu) des intermittents de ce drôle de spectacle en déconstruction, dont le texte romanesque se produit à la débridée.
-
Tous les jours mourir

En mémoire de notre père (1915-1983)
… J’étais resté longtemps les yeux ouverts dans l’obscurité, puis je me suis rendormi et j’ai rêvé que mon père m’appelait dans le dédale de rochers rouges où serpentait le chemin sur la mer que nous empruntions chaque jour; et nous allions nous retrouver, j’allais le rejoindre enfin quand je me suis réveillé et que j’ai compris que quelque chose se passait…
… On eût dit le premier matin du monde. La lumière venait de tourner, comme on dit. On irait désormais vers les beaux jours. Tout évoquait le renouveau, mais c’est alors qu’a retenti la sonnerie du téléphone et que, sans avoir encore entendu la voix de ma mère, j’ai compris que ce jour serait le dernier de la vie de mon père…
… Alors j’ai réalisé, comme on dit, cependant que ma douce amie vaquait auprès de l’enfant. J’ai réalisé que j’avais vécu des années sans penser à cela. C’était comme ça: simplement je n’y pensais pas – je n’y avais jamais pensé. Et voici que cela était…
… Voici que je me levais, comme investi d’une nouvelle dignité, et voici que des gestes nouveaux me venaient. La pensée de Chopin revêtant son plus bel habit pour se mettre au piano m’a fait sourire tant elle me paraissait incongrue, mais ensuite ce fut avec la même solennité que je me préparai…
… La lumière était celle d’un accomplissement, comme à l’aube de la venue au monde de l’enfant la lumière avait été celle d’une attente…
… Le moindre de nos gestes prenait un autre sens qu’à l’ordinaire. Je nous voyais du point de vue de l’Ange: elle, l’enfant, et lui, dans la maison entourée d’autres maisons, et le ciel est limpide, et le silence est celui du dimanche avant les cloches des villages. L’enfant dormait, elle vaquait avec les gestes de la vie, et lui se tenait immobile devant la baie de la chambre haute, à jouer au jeu de ce qu’il y a derrière, comme dans le jardin de son enfance où il imaginait la mer derrière la haie…
… Derrière les arbres maintenant je voyais les toits orange, et derrière les toits s’incurvaient les prés jusqu’aux remblais de l’autoroute, et derrière les bâtiments enfumés de la zone urbaine se devinait la fosse bleue du lac, et derrière l’autre bleu des monts de Savoie le bleu du ciel, et la nuit derrière le ciel, et la vie derrière celui-ci…
… Dans l’odeur du café j’avais fermé les yeux et je voyais la mer et le ciel derrière; et derrière la vie retentissait le pas incertain de mon père dans la maison blanche dominant la pinède. Or je n’étais, cette année-là, qu’un fils un peu perdu ne sachant trop que lui dire…
… Cependant nous avions commencé de parler en marchant le long de la mer. Jamais, quoi qu’il en fût, nous n’avons parlé de cela, mais des couleurs du jour, des livres que nous lisions, des souvenirs que nous avions partagés; et les souvenirs partagés en rappelaient d’autres à la terrasse éclairée de la taverne dans les rochers où nous nous attardions certains soirs, nous laissant aller sous l’effet d’un capiteux rioja; et l’année d’après, sur le Campo de Sienne, une dernière fois je m’étais réjouis de le saouler non sans bousculer les prudences de ma mère – on ne vit qu’une fois sur terre, avais-je protesté…
… Entretemps j’étais devenu père à mon tour, et c’était comme si je fusse à la fois devenu le fils de notre enfant et le père de mon père…
… J’ai rouvert les yeux: il était temps d’aller…
… Trois mois auparavant j’avais traversé la même campagne dans l’appréhension de ce qui adviendrait à l’aube de ce premier jour d’une vie, tandis que c’était comme apaisé que je vivais maintenant l’instant présent du dernier jour de cette autre vie…
… Cependant quelle énormité, me disais-je, quelle énormité pour lui que la pensée qui désigne ce matin toute chose et lui signifie que c’est la fin: que le mot demain n’adviendra plus. Que pour lui maison, jardin: plus rien. Et que cela même dont on se dit que ce n’est rien se révèle au moment de signifier jamais plus. Que mobilier, qu’objets familiers, que portraits de ses parents ou de ses enfants – que tout ça: plus jamais…
… Des voitures de jeunes skieurs dominicaux me dépassaient sur l’autoroute et je songeais à l’énormité que c’était pour lui: allez, gaussez-vous de la cylindrée de rien du tout, faites les fous, jouissez de la vie…
… Là-bas, sur le chemin de la mer, nous avions parlé du prodigieux plouc polac, le vieux Boryna du roman polonais Les Paysans, qui se relève, la dernière nuit de sa vie, et qui s’en va seul dans les champs pour les ensemencer une fois encore – et toutes choses l’appellent alors et le supplient de rester, mais il sait que demain, pour lui, tout sera moissonné…
… L’énormité de penser: jamais plus. De balade dans le quartier: jamais plus. De virée dans les bois ou dans les pays: jamais plus. De beaux jours: plus jamais. Et même plus de journée ratée. Plus même d’encombrements routiers, ni de tant d’autres chers emmerdements…
… Pour la première fois m’est apparue la maison comme sa maison. Et sur le seuil m’attendait celle dont, là-bas, chaque matin il allait s’enquérir des nouvelles, comme d’une fiancée; et tout en l’embrassant, nous pleurant un instant dans le gilet, je pensais à cette énormité: qu’elle non plus, pour lui, jamais…
… Je suis entré, et conformément à la vieille loi maisonnière j’ai retiré mes chaussures, puis sans y penser je me suis emparé des mocassins de mon père; et ma mère me pressait. Cependant il y avait, dans la chambre, une lumière que le temps ne semblait plus entamer, et c’était là qu’il siégeait comme un de ces enfants malades qu’on sait condamnés et qu’on entoure alors de prévenances un peu spéciales, même un peu royales – et c’est vrai que mon père trônait, un peu, ce matin-là de sa dernière journée…
… Et là encore, sur le seuil de la chambre qui avait été successivement, à travers les années, la pièce des petits derniers, puis celle des garçons, la nouvelle salle à manger et enfin la chambre du malade réaménagée pour la commodité des soins, là encore je nous ai vus comme au regard de l’Ange…
… Ils se tenaient comme, au théâtre, dans la scène de l’indicible émotion. Nulle déclamation ni geste plus haut que l’autre, mais cet accablement en douceur et cette enfantine nudité des visages. Regardez la famille sainte: plus de rôle à jouer que celui d’être là…
… Dans le clair-obscur, mon frère aîné m’apparaissait comme un de ces corpulents savants dorés de Rembrandt qui évoquent à la fois le mage et le marchand, le médecin, l’épicier, le géomètre, le boucher, et pour la première fois depuis des années je me suis senti de la même chair que cet homme désarmé…
… J’ai remarqué que tous nous étions habillés du dimanche, comme aux cérémonies de notre enfance, et notre mère elle-même avait retiré son tablier…
… Je me disais: et voilà. Et l’expression de ma petite sœur vers laquelle je me dirigeais pour l’embrasser (pour l’Ange, cette dame dans la trentaine aux yeux cernés, là-bas, en tailleur ton sur ton) signifiait: et voilà. Et tout, autour de nous, les objets familiers, les portraits, tout disait: et voilà; seule notre mère s’activant de l’un à l’autre pour ne pas se laisser submerger, qui m’entraînait à présent vers mon père dont le regard à son tour constatait simplement: et voilà…
… Et voici que, les autres s’étant retirés un instant, enfin nous pouvions nous parler une dernière fois. Mais pour dire quoi ? Devant l’énormité de cela saurais-je seulement trouver un mot ? Et pourrait-il, de son côté, me confier quoi que ce soit de ce que réellement il ressentait ? Ainsi les mots nous échappaient. Nous parlions à l’abandon, levées nos dernières timidités. Et pourtant rien ne serait dit que ce que chacun pourrait trouver en ce moment de son mieux. Des adieux, des promesses, des vœux. Une voix m’appelait par mon nom et je répondais. À l’instant que signifiait jamais plus? Mon père ne me parlait que de confiance. Nulle grande déclaration. On ne sait pas, au fond. On verra. Et le mot le plus juste entre nous: reconnaissance. Encore merci. Et louange à ce monde donné et reconnu. Dire qu’on aurait pu ne pas se rencontrer, comme tant. Tu te rappelles la Costa Brava? Ce bon dieu de rioja ! Ah mais, cela encore: que jamais je n’ai constaté chez toi la moindre chose moche. Pas comme moi! Et lui, d’un filet de voix: tu charries ou quoi ? Alors moi: te fatigue pas, enfin, on tâchera de te mériter, voilà. Et d’autres mots balbutiés. D’autres regards. Et les mains, les voix qui voudraient elles aussi que tout fût exprimé…
… Sur le moment j’ai pensé que cette fois tout était dit; je me suis donc redressé; et d’ailleurs je voyais qu’il partait, ou je le croyais…
… Cependant, gardant ses mains dans les miennes, je me disais que lui aussi aurait pu le proclamer à l’instant: que tout est accompli. Cloué pareillement au poteau de torture, pas moins innocent que l’Innocent, et paraissant s’excuser au demeurant, se gênant de déranger, c’est le cas de dire: je ne fais que passer; et ne pensant pas, assurément, avoir sauvé en rien l’Humanité. Seulement: le fils de son père et faisant à son tour de son mieux…
… Dans les miennes ses mains ne pesaient plus. Tout en lui, ces derniers jours, s’était d’ailleurs comme allégé; et j’ai pensé que ce qui restait ici de lui n’était que pour nous toucher de son aile – il venait encore de réclamer ma grande sœur qui arrivait de l’étranger à l’instant même…
… Vive émotion: penser que l’un d’entre nous eût pu manquer à l’appel ! Et la voici qui se pointe en taxi. Ouf: ils respirent. Tous, à ce moment-là, ont en effet comme un besoin de souffler. Pour un peu, l’Ange les entendrait célébrer la ponctualité du Talgo ! Et de s’embrasser avec des élans inaccoutumés. Puis de se reprendre: ne va donc pas le faire languir…
… J’ai pensé à cette énormité pour lui: cet afflux soudain de parfum et la peau toujours si fraîche de ma grande sœur, mais d’abord cette voix qu’il reconnaît les yeux fermés. Et ensuite tout qui afflue – tout ce qu’il m’avait dit là-bas, dans sa maison à elle, à propos de ce qu’il préférait en chacun de nous…
… Peut-être bien les défauts, avait-il dit. Les qualités, c’est entendu: ça aide; et c’est pourtant vrai que je ne peux pas souffrir certains défauts chez certaines gens, mais chez les siens c’est autre chose… Il se débridait. Nous avions creusé dans le rioja, ce soir-là, beaucoup plus qu’à l’ordinaire, et je me réjouissais de le voir s’emporter contre ceux qui nous empoisonnent, comme il disait – et je le poussais même, convaincu que c’était contre autre chose encore qu’il luttait. Il vitupérait la mesquinerie de certains, la mesquinerie et la grossièreté. Et le pire: lorsque les mesquines épousent les grossiers (il pensait à ceux qu’il appelait les horribles voisins) et qu’on se trouve exposé à leurs menées. Tu te figures la vie de ces gens qui ne pensent du matin au soir qu’à nous empoisonner. Tu te figures le plaisir…
… Et maintenant encore, tandis que ma grande sœur rattrapait le temps et que nous autres, dans la pièce d’à côté, nous attendions comme immergés dans la même tendre torpeur, je songeais, en souriant intérieurement, à ce qu’il arrivait à mon père de saisir, sans trop le rechercher, en une formule. Ainsi ce seul terme de plaisir, s’agissant de la sinistre propension à nuire des gens qui s’ennuient dans la vie, suffisait-il à faire apparaître la mesquinerie et la grossièreté qu’il y avait chez les horribles voisins comme une espèce d’image inversée, et peu s’en fallait alors que nous ne prenions en pitié de si pauvres gens, comme il disait…
… Et d’ailleurs qui n’est pas à plaindre en réalité ? me demandais-je de plus en plus souvent depuis la venue au monde de notre premier enfant. Je me rappelais les horribles voisins et m’efforçais d’imaginer le pourquoi de leur isolement croissant et de leur étriquement, de ce qui les avait aigris et renfrognés jusqu’à la haine ; et j’avais beau m’indigner à l’idée qu’on pût se ratatiner ainsi: plus que tout je voyais leur misère, et si semblable à celle qui s’étalait chaque matin dans les journaux et partout en ce monde privé de beauté. Or nous nous étions rappelé là-bas, mon père et moi, comment les deux tourtereaux chantaient des années plus tôt, elle au piano et lui poussant la romance de sa voix de baryton léger. Et voilà que le temps non fécondé, le temps mornement passé à s’occuper, le temps gâché, le temps piétiné, le temps émietté en grise poussière toute pareille à celle qui neigeait sur le petit écran après que le couple hébété se fut endormi en plein énième feuilleton de sa journée, voilà que le temps les avait desséchés et creusés par-dedans, dévastés et transformés en deux morts-vivants…
… À l’opposé, plus mon père approchait de la fin et plus je l’avais senti présent; et en ce moment même tout me semblait, dans l’apparente familiarité, pour ne pas dire dans la banalité de ce lieu qu’avec les années on s’était pour ainsi dire incorporé, tout me semblait se révéler autrement, tout se dévoilait comme pour laisser entrevoir je ne sais quelle vérité, et puis se repliait, à raison, peut-être, de quelque secret à préserver…
… Je nous revoyais dans la nudité de nos étés en enfance. Qui pense alors que le corps va souffrir ? Toute la smalah n’est en ce temps-là qu’une chair pure et qui bronze de jour en jour. Il n’est en ce temps-là question que de baignade et de limonade. On n’a pas idée en ce temps-là de ce que c’est que de faire l’amour ou d’agoniser. Ce n’est pas qu’on s’imagine immortels : c’est qu’on l’est. Et voilà nos petits dieux de l’été…
… Le plongeur blond pèse maintenant son quintal. La naïade à ses côtés va sur ses quarante ans, et l’autre sirène se teint désormais plus ou moins les cheveux, tandis que le gamin facétieux de naguère, sans y paraître sous ses lourdes paupières, les considère tous tant qu’ils sont du point de vue de l’Ange, consignant chaque détail sur ses invisibles grimoires – et voici que sa mère, qu’il regarde en train de les regarder, s’en aperçoit l’air de penser: et voilà…
… Pour s’en aller en beauté, il avait demandé qu’on lui passe Le Messie et ses non moins inévitables Brandebourgeois qu’il nous avait servis et resservis à travers les années – son goût pas compliqué pour le clair et l’ardent, le sonnant, les fanfares angéliques de Telemann ou les lumières diaprées de Vivaldi – enfin, s’il faut s’en aller, surtout des Chœurs, s’il vous plaît…
… Ils attendaient qu’il se passe quelque chose et pourtant rien n’advenait. Ils attendaient précisément que la vie veuille bien passer, mais la vie s’ajoutait à la vie et le temps se subdivisait; et ce fut le médecin qui passa, l’homme-médecine de la tribu, le sorcier qui disait: tout est bien, je vois que vous êtes réunis, ça devient rare par les temps qui courent, continuez, je repasserai…
… Et tous les regards avaient convergé sur cette masse de compétence sereine que représentait pour les uns et les autres celui qui, d’une certaine façon, avait adopté leurs maux et les conduisait de la vie à la vie, et tous ils avaient pensé: comme toujours, celui-là, il lui suffit de passer et tout paraît s’arranger; puis, ne restant de lui que ce sillage de confiance, ils avaient commencé de parler entre eux tandis qu’un autre bruit de voiture signalait une arrivée; et c’était l’enfant que ma douce amie venait présenter au mourant; et tout aussitôt cette autre énormité: ce petit bout de machin, cette rose chose, cette apparente fragilité et cette inimaginable énergie en puissance, puis de l’autre côté ce visage parcheminé de vieil arbre-livre et cette ultime lumière répondant à la lumière de l’enfant, deux buées qui se mêlent à peine et c’est un monde…
… Dans la nuit de là-bas mon père m’écoutait philosopher sur les nébuleuses et j’avais aux lèvres le goût du sel de mes plongées avec les jeunes gens des rochers, et mon père me disait en souriant que le défaut qu’il préférait chez moi tenait à cette irrécupérable propension à rêvasser…
… Sur la plage j’avais honte, un peu, de ma chair bronzée, mais cela ne m’apparaissait alors qu’à l’état d’idée. À la vérité je ne voyais même pas la plaie vivante qui reposait à mes côtés…
… La plupart du temps on vit ainsi comme séparé de soi-même, dans le reflet des jours et la répétition machinale des occupations. Or je me levais tôt, je m’étais fait tout un programme, cette année il faut que tu avances me disais-je, et le travail était minuté qui en imposait à mon père, et ensuite seulement nous allions à la mer, mais j’étais ailleurs en réalité, je croyais vivre l’instant et je ne faisais que glisser d’une sensation à l’autre, je prétendais concilier et réconcilier l’intellect et la sensualité mais les heures de mes journées se dissociaient, n’étaient celles que je me figurais mesquinement sacrifier à mon père…
… Un jour j’avais reçu là-bas un pli de Paris qui sollicitait de ma firme un papier sur Les Paysans de Ladislas Reymont, à paraître en Fronton. Alors, sans dissimuler ma fierté, j’avais annoncé à mon père que désormais j’avais un pied au Monde, puis je m’étais demandé s’il se moquait de moi quand, après m’avoir félicité, il avait ajouté d’un air quelque peu distrait, voire léger, qu’il espérait que le monde s’en trouverait sauvé par la même occasion, après quoi j’avais constaté que mon père était peu bien ce matin…
… Je savais alors qu’il y avait des milliers de gens qui considéraient qu’il était important d’écrire dans Le Monde, et pourtant la bonhomie de mon père avait éventé ma vanité, aussi saluais-je chaque matin, au miroir, celui dont il n’était pas interdit de penser qu’il allait sauver le monde; et c’était mon père, au demeurant, que je sentais de nous deux le plus soucieux de me voir bien exprimer tout ce qu’il y avait de beau et de vrai, de si poignant dans le roman polonais…
… À l’instant, de l’autre extrémité du quartier nous parvenait la rumeur des cloches du temple protestant; et tant d’autres souvenirs affluaient. Ainsi me revenait tout à coup l’image hurluberlue de ce pasteur collant, dans nos petits bulletins d’aspirants paroissiens, les symboles à colorier du Juste et de l’Égaré…
… L’agonisant reposait sous calmants et peu à peu cela nous révélait à nous aussi l’énormité de ce qui se tramait: ce qu’à l’apparition de l’enfant nous avions éprouvé déjà, et ce qu’on décelait maintenant au regard éperdu de celle qui resterait – mais comment exprimer cela?…
… Tout avait commencé de m’apparaître autrement, trois mois auparavant, lorsque, des entrailles ensanglantées de la mère, des mains gantées de vert avaient tiré l’enfant – et cela vivait et plus rien n’existait de mes pensées de mort que cela…
… Je ne me l’étais dit que plus tard, mais ce fut dès cet instant, aussi, qu’il me parut réintégrer comme un cercle, une place de village, ou comme un cycle, une horloge, comme un symbole, une roue céleste ou une aire à grain, et des songes solennels me le confirmaient…
… Je cheminais dans la neige, je montais vers le ciel, une force me poussait, je me gaussais de l’idée d’Élu mais je faisais tout comme, et bientôt je constatais qu’une foule me suivait, aussi m’écartais-je, et tous me reprochaient de ne jamais prendre part et de bafouer les horaires, puis la multitude se clairsemait et c’était tout seul que je parvenais à la cime où j’éprouvais quelle extase amère – alors j’en appelais à quelqu’un, je me gaussais de l’idée d’Élue mais c’était à elle que la force me conduisait, et finalement j’arrivais à une haute porte qui me semblait celle d’un rêve, et la multitude était là qui m’attendait, et l’Élue, tout le cinéma…
… L’Ange les voyait à présent se détendre un peu. La mère avait servi du café. Le mourant, les yeux clos, ne faisait plus que respirer fort. On était sortis quelques instants au jardin pour prendre l’air et en fumer une, et bien entendu les rideaux des horribles voisins avaient bougé, mais on s’était réjouis de humer, aussi, cette vieille odeur sacrée de rôti qu’exhalait le quartier…
… Je repensais au paysan polonais Boryna dont nous avions souvent évoqué, là-bas avec mon père, la dernière nuit hallucinée, et je me demandais: mais à partir de quel moment a-t-il entendu, lui, les choses et les gens le supplier de rester? À Noël passé? En tout cas j’avais relevé, sur une photo de la soirée, cet air de n’y être déjà plus tout à fait. Et je me rappelais cette autre scène dont nous avions parlé, de l’esseulement déchirant du forestier polonais blessé à mort qui entend de son grabat la rumeur de la fête des vivants tandis qu’il se sait, lui, déjà fauché et moissonné…
… Les choses étaient là, qu’on ne voit pas la plupart du temps, les choses et les gens. Depuis un moment déjà je regardais une lampe qu’il y avait là dans la chambre de devant jouxtant celle où reposait le mourant, et c’était la lampe sous laquelle il aimait lire, et cette lampe, étrangement, me semblait à l’instant comme plongée dans un état de recueillement – pour un peu j’allais me figurer que l’objet priait…
… Il y avait eu ce très long silence dans lequel les frères et sœurs s’étaient immergés, et c’était un intérieur hollandais; et de même que les choses qui étaient là se trouvaient liées entre elles par toutes sortes d’histoires, de même l’Ange remarquait-il que les gens du tableau se parlaient sans parler et qu’eux seuls, détenaient le secret de ce qui liait entre eux les objets…
… Que cette lampe n’avait-elle entendu, que n’avait-elle vu, que ne pouvait-elle parler en ce moment ! Mais l’objet se contentait d’être présent et je me disais: tu verras, ça ne va pas manquer, demain ils reconnaîtront en elle la lampe du père et ce sera classé: le reliquat de musée… … Et la vision d’autres objets inaperçus me revenait. À Venise, une aube morose où rien n’allait, soudain, au pied d’un mur obscur, elles m’étaient apparues: deux poubelles dégueulant leurs déchets, deux guenilles dans un recoin, deux filles de rien, mais soudain, comme un rai sous la porte du ciel, une épée de lumière les avait touchées et c’étaient deux anges, deux beautés. Quelques instants plus tôt, pareil à elles, je me sentais souillé, et voici qu’avec elles je rendais grâces à je ne sais quel ciel…
… Je ne sais quel ciel, tout à l’heure, accueillerait mon père, et cette lampe resterait sous nos yeux, et cela seul m’importait: cette présence habitée – ce qu’en secret j’appelle Dieu, mais je me tais… … Chacun Le brandissant, chacun désignant Le Sien pour seul vrai, chacun fuyant cela pour se réfugier au sommet de sa vanité – Dieu et moi…
… Quand mon père Le tenait simplement pour le bien qu’on fait qui reflète tout bien. Quand mon père n’y voyait que la source de toute beauté. Quand mon père, sans autres mots, n’y trouvait que tout amour…
… Tandis qu’ils se fabriquaient une idole de mots, qu’ils discouraient et qu’ils disputaient à tort et à tuer…
… Les objets nous murmuraient: vous êtes nos hôtes, nous ne sommes rien à qui ne prend garde, mais par qui nous regarde nous nous laissons voir, parfois…
… Ainsi l’Ange les voyait-il ce matin-là dans le salon petit-bourgeois: des gens comme il y en a tant que rassemble le plus banal événement, mais l’Ange sait que tout et rien ce matin se passe entre Rien et Tout…
… Ainsi dès la venue au jour de notre premier enfant m’étais-je dit que désormais tout pouvait arriver, que plus rien désormais n’avait la moindre importance, que désormais tout comptait…
… Je me disais: à quoi bon ? Et au même instant cela me découvrait une évidence: que rien n’a de sens que cela. Non pas la mort, mais le dernier souffle et le premier. Non pas l’après, mais à l’instant ce transport d’un regard aux autres…
… Je me disais: c’est affreux, tu ne sais rien d’eux, et eux non plus, jamais, n’auront montré le moindre souci de savoir qui tu es. Et tous, ainsi, comme isolés dans le froid, c’est ce qu’on dit: la société…
… Là-bas, sur le chemin de la mer, mon père m’avait raconté ses démêlés. Ce que sont les grossiers, les mesquins. Tout cet élan vers le rien, tout ce vain mouvement. Et cependant avec ses mots il célébrait l’Agir humain: il nous faut faire quelque chose de tout ça, disait-il, sous peine de se défaire…
… Il nous laissait ses herbiers, ses tableaux, ses bricoles comme il disait, quelques mots écrits (mais bien peu: quelques souvenirs lumineux de l’enfant empêtré qu’il avait été, quelques aveux contraints), quelques objets talismans, son beau violon depuis longtemps délaissé, tous ses papiers classés… … Je me disais et ça continue, et grâce à lui aussi cela signifie quelque chose. Et je me ressouvenais que tant d’années auparavant il nous arrêtait dans les hautes herbes et nous disait: ah ça, regardez…
… De son côté notre mère ressassait son propre bilan: on a fait son possible. C’est qu’il fallait lutter, dans le temps. Ce qu’on a dû compter. Et toujours et encore à vaquer. À l’instant même, nous voyant ne faire que songer, elle nous proposait un frichti. Alors nous de l’encourager: voilà bien, ça te changera les idées. Des mots comme ça…
… Et tandis que le père s’en allait tout doucement, l’Ange les a vus se rassembler une fois encore autour d’une grande platée de pâtes, comme aux aubes de tant de virées de leur jeunesse, et l’aîné servait le vin, et tous buvaient sans se faire prier. Et la mère a bu son verre aussi, quoique se gênant. Était-ce bien le moment ? Alors tous de l’encourager: que oui !…
… J’imaginais nos anciens villages réunis. Je me figurais le défilé de tous les amis, et pourquoi pas des ennemis ? Et qu’on n’attende pas qu’il soit défunté comme chez les bourgeois ! Mais un vrai dernier repas qui le tienne au moins le temps de passer, et à ceux qui restent: de quoi le regretter…
… La période la plus ancienne (et donc assez naturellement la plus belle à leurs yeux) est celle où il porte tout, le plus gros sac, parfois un des petits qui n’en peut plus, et la marmite d’éclaireur pleine d’eau de la rivière qu’il dispose sur le feu qu’il est également le seul à savoir faire, et sur son torse nu de sachem la terrible balafre de son opération me rappelle l’expression couturé de cicatrices des récits de pirates…
… Nous serions repartis ce matin. Nous aurions pris le tram des prés et là-haut, dans l’arrière-pays, nous aurions remonté la rivière jusqu’à notre piscine naturelle, au pied de la cascade au martin-pêcheur. Et de là les garçons seraient partis en reconnaissance dans les territoires inexplorés – les zones blanches de la carte topographique –, et peut-être y aurait-il eu un drame cette fois encore (leurs souvenirs ne manquent pas de ces plaies et bosses qui donnent son piment à l’existence) et aux odeurs d’ail sauvage et de vase se serait bientôt superposée celle de la chair grillée du bison que figure à jamais l’irremplaçable cervelas…
… Du point de vue de l’Ange ils tournaient en rond, tantôt s’impatientant vaguement (non sans sursauts variés du genre: et si cela se prolongeait comme dans le cas de Franco? puis dans la foulée: mais pousse-le dans la tombe, tant que tu y es!) et tantôt reprenant pied dans l’instant. Et l’après-midi tirait à sa fin, un pasteur a sûrement passé (on ne se rappelle même plus lequel: c’est dire), et plus tard le mourant s’est exclamé «quelle horreur !», mais peu après le médecin de retour les a rassurés, comme quoi ce n’était que l’effet du calmant dont il lui fallait précisément administrer une dernière dose, et cette fois on a compris, le médecin restait, il nous parlait déjà sur un autre ton…
… Et peu après la voix de quelqu’un qui se tenait auprès de l’agonisant a dit que celui-ci était en train de passer, aussi tous se sont approchés, mais cela s’était déjà passé, la vie s’en était allée comme elle était venue, comme en douce…
… On dit alors des choses tandis que le professionnel se livre au constat d’usage. On dit par exemple: il est à présent dans la paix. Mais qu’est-ce qu’on en sait ?…
… C’est d’ailleurs moi qui ai osé la prononcer, cette sentence qui veut tout et rien dire…
… Or nous pleurions, nous nous consolions, d’une part nous ne savions plus trop où nous en étions, d’autre part nous avions désormais de quoi faire et nous nous activions. On croit que c’est toute une affaire, comme l’amour quand on est enfant, et pourtant s’occuper d’un mort n’est pas si compliqué. On s’y est mis les deux fils et la mère, juste conseillés par le médecin. Il ne fallait pas lambiner: le corps était encore un peu chaud, tombé comme une masse de sa croix et cependant si maniable et si léger à ce qu’il semblait. On trouve donc à ce moment les gestes machinaux qu’il faut, et rien n’empêche d’ailleurs de constater ce qui est. Et voici ce qu’on voit alors: voici l’Homme…
… À l’apparition de l’enfant, une première fois je m’étais dit: et voilà. Ma propre vie se résumant d’un coup. Tout se trouvant dévoilé: tel tu fus et c’est ton propre sort scellé. Telle fut et sera la réalité: tous les jours mourir…
… Dans le regard encore trouble de l’enfant j’avais perçu cela que jusque-là je n’avais jamais pris au sérieux, et cela n’était pas la mort mais ce qui nous est imparti comme une flamme, comme une source, comme une terre émergée, comme un souffle…
… Et voilà qu’à la vision du corps défunt de mon père une autre lumière se faisait et que tout me disait: cela ne mourra pas. À l’instant même où tout me disait que cela me serait arraché je m’y attachais comme jamais, tout me disant maintenant que les grandes eaux ne sauraient éteindre tel feu…
… J’avais eu sous les yeux l’innocence un peu trouble de l’enfant nouveau-né, et j’en avais mieux conçu ma propre impureté, mais de celle-ci j’étais lavé par la vision de la douleur du corps défunt de mon père…
… Tous les jours il avait enduré, mais jamais il ne maudissait: il n’y avait trace sur son corps de défi ni de colère. Tous les jours, et la nuit même, le mal le réveillait, mais dans l’obscurité c’était un clair visage d’enfant muet qu’il opposait au mufle sanglant des ténèbres, et tout le jaune de son corps n’y pouvait mais. Tous les jours se resserrait le cercle et tout en lui le niait pourtant sans gémir ni crier, ne protestant que d’un murmure: et quelles portes ferment la mer ?…
… Le corps défunt de notre père gisait devant nous, une fois de plus le Dieu magnifique avait dégringolé dans le sang et la purulence et tout en bas, dans un chaos de clous et de crachats, son cadavre luisait doucement dans cette chambre humaine…
… Si lointain avait été à mes yeux ce qui est, et voici que le voile s’était déchiré et que je voyais ces mains écorchées et ces flancs meurtris, ces pieds endoloris; et voici que le jaune devenait couleur de prière…
… Cependant nulle parole ne me venait. Je n’étais dehors et dedans que regard. Avec les autres j’accomplissais les gestes nécessaires: à présent on avait revêtu le corps défunt de mon père de vêtements élégants, et celle qui restait l’avait coiffé comme un enfant. Le regard d’un ange je nous voyais, je voyais les objets, je voyais le monde – et c’était le monde qui priait...
Ce texte est extrait de Par les temps qui courent, publié en 1995 chez Bernard Campiche, et reéédité en 1996 au Passeur, à Nantes. Il a obtenu le Prix Rod 1996.
Images: extraites de Mère et fils, d'Alexandre Sokourov.
-
Obscure clarté

Obscure clarté
Mon ombre fait comme un nuage
ce clair matin d’été
où, dans le bois secret
de mon cœur, le très doux mirage
de nos jeunes années
me rappelle tant de lumière
au milieu des orages.Mon ombre est claire de te savoir
dans la clairière sans âge. -
Gracq au grand chemin
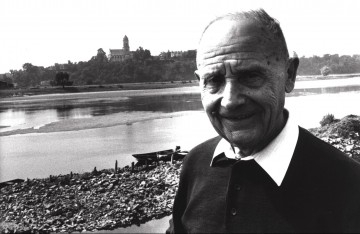
En 1992 paraissaient les Carnets du grand chemin de l'arpenteur du bois sacré. Promeneur au regard inspiré de poète-géographe et de penseur-historien, Julien Gracq vivifie tout ce qu'il touche par la grâce d'un style sans pareil.
C'est un livre qui sent bon la littérature.Tout de suite on y est bien. Les Anglais diraient: cosy. Et pourtant on ne s'y borne pas au pantouflage, même s'il n'a rien de bousculant. En dépit de quelques piques, visant notamment, les «demi-cultivés (ou demi-barbares) de l'ère de l'audiovisuel», le Gracq que nous retrouvons dans ces Carnets du grand chemin n'est pas l'hygiéniste cinglant de La littérature à l'estomac, mais un honnête homme cheminant de par le monde et de par les livres.
D'un écrivain de cette hauteur de pensée et de style, l'un des derniers représentants (avec Green, l'autre Julien) de la fabuleuse pléiade littéraire française du premier demi- siècle, on serait certes en droit d'attendre une nourriture plus essentielle, ou une réflexion plus vigoureusement engagée sur notre temps. Or la lecture du monde de Gracq reste celle d'un homme discret, cultivant même le retrait, sans grands élans et cependant marquée par une singularité du regard et un bonheur d'expression qui ne laissent d'enchanter le lecteur et de faire rebondir sa propre songerie.
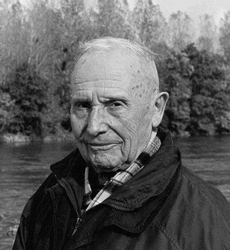 Des «lieux élus»
Des «lieux élus» Sous ses dehors de casanier en douillette, Julien Gracq a beaucoup marché, pas mal voyagé non plus, et l'art avec lequel il restitue le ton de ses «lieux élus» est souvent incomparable. Voici la Sologne aux villages peuplés de «réfractaires minutieux», l'Ornans de Courbet dont «toutes les maisons se serrent pour venir boire ensemble à la rivière si pure avec ses chevelures d'herbes lissées par le courant», Lucerne «sous une noire pluie d'orage» dont il évoque la magie rétro, Richelieu en Touraine qui lui rappelle le gourbi d'Alger par son délabrement, la forêt de Fontainebleau revisitée comme une «cité des arbres» dont il détaille les avenues et les carrefours, ou ce «petit Eden riverain» des bords du lac de Neuchâtel qui lui inspire ces lignes: «Les eaux du Léthé d'Europe se rassemblent là, dans les lacs au bord desquels le troisième âge attend la fin aussi paisiblement que l'appesantissement sans drame d'une dernière saison.»
Un passant profond
Admirable dans l'évocation des lieux, Julien Gracq n'est pas moins heureux dans sa ressaisie des moments d'effusion du passant profond. «Je me sens toujours animé d'une espèce d'allégresse quand je me trouve sur la route à la fin d'un de ces grands coups de vent d'ouest criblés de soleil qui marquent de leur signe sur toute une province la journée époumonée», note-t-il ainsi, et l'on remarquera, d'une façon plus générale, le profond assentiment qui relie l'écrivain au monde et à la vie terrestre, par opposition (c'est lui qui le souligne d'ailleurs) à toute une littérature contemporaine du dénigrement.
Les claviers actionnés dans ces Carnets du grandchemin sont multiples. Le géographe y croise le romancier et son œuvre (à propos d'Un beau ténébreux ou de ses rapports avec le surréalisme), le lecteur pénétrant (de Mandiargues, Nabokov, de Baudelaire à la «sensualité liturgique» ou de l'Evangile dont il affirme l'unité de voix) nous intéresse autant que l'historien ou que l'humaniste. Mais c'est à des observations plus spontanées, ou plus ingénues, que tient aussi l'attrait souvent inattendu de ce livre. Ainsi de ce que Gracq dit, par exemple, de l'évolution de la dégaine des Anglaises, qui n'ont plus rien aujourd'hui de «l'ancien troupeau de cheftaines prudes et fagotées» d'avant-guerre; ou de la fascination exercée par le pin sur les peintres japonais et chinois qui reproduisent «jusqu'à la satiété cette élégance sèche et ligneuse, où la feuille partout régresse vers la branche, la ramure vers le squelette, et qui semble faire un signe de connivence au pinceau encré»...
Toutes notations marquées au sceau d'une écriture dont la haute précision le dispute à l'ondoyante fluidité, avec une espèce d'aura fondant l'unité du livre et le bonheur rare du lecteur.
Julien Gracq. Carnets du grand chemin. José Corti, 308 pages.
(Cet article a paru dans 24 Heures en date du 1o février 1992)
-
Confiance aux artisans
 À présent laisse-moi tranquille,dit la Vieille à son Dieuformant une boule de feuau-dessus de la ville:tes flammes à la fin me fatiguent,ce sont plutôt des ramesqu’il me faudrait ce soirpour naviguer dans l’or du noirquand le soleil décline…Le Seigneur saigne sur sa croix :c’est de la vieille histoirequ’à l’enfant la Vieille serine,et l’enfant tombe sous les bombesau milieu des jouets, moralité : devine !Quant a moi sous ma croix je dorsdebout dans mon cercueil,et ceux-là porteront mon deuilqui me tiennent pour fou…Nous savons réparer les choses,rafistoler les roseset les vieilles en déraison,nous sommes artisans,murmure à la Vieille l’enfantvenu la voir au cimetière,une ortie à la boutonnière;à présent dors tranquille -nos affaires nous requièrent en ville…Image: Claude Paccaud.
À présent laisse-moi tranquille,dit la Vieille à son Dieuformant une boule de feuau-dessus de la ville:tes flammes à la fin me fatiguent,ce sont plutôt des ramesqu’il me faudrait ce soirpour naviguer dans l’or du noirquand le soleil décline…Le Seigneur saigne sur sa croix :c’est de la vieille histoirequ’à l’enfant la Vieille serine,et l’enfant tombe sous les bombesau milieu des jouets, moralité : devine !Quant a moi sous ma croix je dorsdebout dans mon cercueil,et ceux-là porteront mon deuilqui me tiennent pour fou…Nous savons réparer les choses,rafistoler les roseset les vieilles en déraison,nous sommes artisans,murmure à la Vieille l’enfantvenu la voir au cimetière,une ortie à la boutonnière;à présent dors tranquille -nos affaires nous requièrent en ville…Image: Claude Paccaud. -
Les 100 Cervin de JLK

(Dialogue schizo)
Du projet pictural de multiplier par cent le cliché national helvétique par excellence que représente le Cervin. De sa sigification polysémique au niveau conceptuel et de son plan marketing.
 Moi l'autre: - Alors comme ça, c'est décidé.
Moi l'autre: - Alors comme ça, c'est décidé.Moi l'un: - C'est comme si c'était fait. Y a plus qu'à le faire !
Moi l'autre: - Donc on est bien d'accord: c'est au niveau du concept que le projet s'initie à la base, sous le double aspect du signifiant et du signifié, qui s'articule en outre au double point de vue synchronique et diachronique.
Moi l'un: - C'est exactement ça, compère. Nous nous comprenons comme si nous avions gravi ce tas de pierres de concert voire même de conserve. Mais nous ne prendrons point cette peine vu l'état de nos genoux. En revanche nous irons vérifier de temps à autre l'état naturel de la Chose, sans peindre pour autant d'après nature - mais cela reste à discuter pour la question de la lumière.
Moi l'autre: - Tu penses à Cézanne...
Moi l'un: - J'y pense évidemment, mais aussi à Hodler et àTurner...
Moi l'autre: - Qui n'ont jamais peint le Cervin sauf erreur ?
Moi l'un: - En tout cas jamais au niveau conceptuel !
Moi l'autre: - Jamais non plus pour des motifs utilitaires ou touristiques. Mais Kokoschka non plus !
 Moi l'un: - Le Cervin de Kokoschka est plutôt un autoportrait qu'une représentation du Matterhorn. C'est une sacrée peinture et le fait est que le tonitruant Oskar eût pu la reproduire par cent, sans jamais se répéter.
Moi l'un: - Le Cervin de Kokoschka est plutôt un autoportrait qu'une représentation du Matterhorn. C'est une sacrée peinture et le fait est que le tonitruant Oskar eût pu la reproduire par cent, sans jamais se répéter. Moi l'autre: - Notre concept à nous serait de réaliser cent petits ou moyens formats du Cervin en six mois et de les exposer ensemble au même prix. 100 francs suisses les petits formats, et le reste à la tête du client.
Moi l'un: - Mais l'essentiel est ailleurs: c'est la symbolique latente du concept...
Moi l'autre: - Psychanalytique ?
Moi l'un: - Bien évidemment. Comme s'impatientent de l'entendre répéter les dames de la bonne bourgeoisie des tea-rooms dont nous visons les bourses, le Cervin est chargé de tout un symbolisme sexuel qui l'apparente aux idoles priapiques et aux emblèmes pyramidaux des Anciens. Faudra qu'on se trouve un lacanien pour verbaliser le concept.
Moi l'autre: - Blague à part, on va prendre un pied national !
Moi l'un:- De fait nous entrons, avec un concept pareil, en parfaite consonance avec les conceptrices et les concepteurs des milieux économico-culturels et politico-médiatiques qui réinvestissent, depuis quelques années, dans le folklore vintage relooké.
Moi l'autre: - Donc on va faire pisser le Vreneli !
Moi l'un: - Ce sera l'aspect impactant au niveau ducadre. Vu que si nos croûtes se vendent la critique suivra et les collectionneurs, donc les huiles de l'Office de la culture et consorts genre DFAE, cracheront tous au bassinet.
Moi l'autre: - Ce qu'attendant on se les roule...
Moi l'un: - On va peinturer grave et c'est ça qui seul compte !
Moi l'autre: - On va s'en mettre plein les naseaux de cette odeur d'huile d'oeillette...
Moi l'un: - Déjà son odeur divine m'enivre.
Moi l'autre:- Et moi donc ! Enivrons-nous donc, compère...