3.
L’expression se royaumer rendra le mieux, pour ce qui suit, l’atmosphère du jardin dans lequel se passeront nos enfances, qui est en effet un royaume bordé d’une rivière et d’une forêt dont nous savons désormais qu’elle ne s’étend pas jusqu’en Russie sans discontinuité puisque des plaines et des pics nous séparent de la taïga et de la toundra, de même qu’un océan nous sépare des plaines et des pics où se royaument Winnetou et Red Canyon.
Le pommier penché du jardin, nanti du gouvernail de fortune que figure le volant récupéré par le grand Carlos et notre frère aîné sur l’épave d’une Studebaker Champion rose reposant toujours au fond d’un ravin du bois voisin, a présidé à tous nos départs marins, sous-marins, aériens ou même terrestres puisque le pommier n’est parfois qu’un simple trolleybus.
Il y a là, dans les branches, toute une humanité future dont je sais grosso modo ce qu’il adviendra de par l’un des pouvoirs secrets que m’a transmis l’oncle Fabelhaft, consistant à se connecter à la pensée de l’Aigle du Temps au moyen d’une formule. Je vois ainsi, non sans effort extrême de concentration télépathique, plusieurs retraités proprets (dont le pharmacien Perret) qui squattent régulièrement les basses branches les plus confortables, trois fonctionnaires (deux d’entre eux sont décédés) et deux employés (perdus de vue depuis le collège), un mécanicien sur automobile (le fringant Fabio, plus tard séducteur aux jeans ultraserrés qui se tuera au volant l’année de ses vingt ans, à l’instar de son idole James Dean et dans une Porsche comme celui-ci), un ingénieur en aéronautique (Marco) virtuose de guitare classique dès son adolescence et un architecte de renom international (le frère aîné de Marco, le géant Théo qui ne sera présent sur l’arbre que cette fois, très pris ensuite par sa passion précoce pour les échecs), un décorateur-ensemblier (Bruno) dont l’affaire périclitera et qui se lancera dans la restauration de toiles anciennes après le suicide de son frère (le pauvre Jonas au nez en pied de marmite, obstétricien plaqué par ses deux épouses successives), et plusieurs femmes aussi dans leurs transats de première classe, plusieurs ménagères et autres institutrices aux compétences reconnues (ma sœur aînée) ou secrétaires de direction (ma sœur puînée et Mado la crâneuse), j’en passe pour le moment qui est celui de tous les dangers, lorsque la Santa Maria de Don Cristobal traverses les récifs coralliens des Basses Caraïbes.
Comme on en est aux premières chaleurs, juste avant les vacances d’été que certains passeront à la vraie mer, l’équipage a son air le plus corsaire (les bouches et les torses nus dégoulinants du sang des cerises maraudées alentour) et les voyageuses autour de la piscine de bord se font tout un cinéma, au premier jeu des imitations.
Le conditionnel de l’enfance prévaut encore, qui n’est une option chimérique que pour les pieds plats. Même le futur pharmacien Perret peut se voir, alors, en compagnon de Surcouf. Les grands n’ont pas encore de poil, mais des biceps comac. Pour ma part, j’ai déjà la longueur d’avance des mots, qui me vaudra plus tard lazzis et horions des costauds que j’énerverai, mais à l’instant je suis encore reconnu sur l’arbre de cette première utopie. Et les filles roucoulent : se croient déjà dans un film romantique à beaux gars, se voient même trier et choisir celui que Mado la crâneuse, juste neuf ans, ne craint pas de déclarer le plus sexy, dans ce vocabulaire américain fort mal vu par l’épouse du Président, notre grand-mère couturière à la morale de quaker.
Tout sauvageons que nous soyons dans le quartier et environs, nous restons cependant bien innocents. Point de sexe à l’horizon ni de politique dont les oncles font le ragout de leur bagou : ce qui nous électrise est la pure Aventure où le Bon trucide le Méchant sans états d’âme. Au cri de Montjoie, Roland décapite l’infidèle. Le traître Ganelon est écartelé. Le Méchant est légion, mais il y a Bon et Bon. Red Canyon, le cow-boy sans passé, est le Bon que je préfère, je ne sais trop pourquoi, en tout cas je le préfère à Tex Bill. Ce n’est qu’à dix ans que je verrai La Loi du Seigneur au cinéma de quartier Le Colisée, mais dès cinq, sept ans je distingue clairement le Bien du Mal, et dans ceux qui défendent le Bien j’ai mes tendres champions, tels l’ Indien Winnetou, Alix ou Corentin, à part lesquels quelques malandrins suscitent ma faveur secrète, dont les Pieds Nickelés, Mandrin et le Capitaine Crochet.
C’est pourtant au merle blanc que je resonge le plus chèrement en me rappelant le temps des premières lectures qu’on nous fait ou que je ferai, je ne sais plus trop dans quel ordre, derrière quelle fenêtre pluvieuse, et comment l’oiseau est tombé là de sa branche, tout mal fagoté, couleur blanquette et malheureux comme le grand cheval de la route d’en haut.
Les mères et les tantes se ligueront pour dire à l’Enfant Sensible de ne pas sangloter sur le mauvais sort qui est fait à l’oiseau pas comme les autres qu’on chasse et qu’on abandonne et qu’on moque pour sa voix de fausset, mais cette histoire, la première que je sens à moi, me semble bien plus vraie que tant de plates menteries finissant toujours bien.
Dans le Grand Pré, dans le préau de la Petite et de la Grande Ecole, sur les plongeoirs du Lido, en remontant la rivière ou en descendant en ville à travers le cimetière désaffecté dont la terre pleine de crânes et de tibias a été déversée dans le nouveau quartier où nous habitons, partout nous nous livrons à l’exercice intensif de l’imitation.
J’ignore tout de l’identité du Pauvre Yorick, mais j’imite la voix tremblante de mon grand frère, lequel imite la déclamation parodique du Professeur Barker, vieil ami lettré de Mister President, professeur à l’Université rencontré par notre aïeul en Egypte, en brandissant, à la brune, devant le poulailler du jardin, cette tête de mort que notre père à déterrée en bêchant ses carreaux. Poor Yorick! Or mon père, croyant que j’imite le pasteur, affecte de me gronder en imitant Mister President quand il essaie de se montrer sévère, mais ni mon père ni le père de mon père ne seront jamais capables d’imiter le tonnant Jupiter ; et moi non plus, en fin de compte, je ne serai jamais parvenu à bien imiter mon grand frère, dont les propres imitations tourneront également court.
Mes vrais modèles, je les découpe et les colle dans mes trois premiers Cahiers Eagle King Size que, précisément, le professeur Barker m’a offerts après avoir entendu parler de mes collections, m’en promettant trois autres à chacune de ses visites.
En réalisant mes Albums, j’imite assurément mon père aux herbiers alpins et notre oncle Fabelhaft alignant dans son antre têtes de Jivaros et fossiles rouge sang de terre de Feu. Les deux nous ont appris, à tous quatre que nous sommes, à ouvrir les yeux sur le monde, mais je serai le seul à perpétuer leur manie de la collection, et pour l’imitation ce n’est qu’un début.
Ce que je retiens de cet âge est la beauté du geste. On est en deça de la force et de la possession, mais on réalise le premier état de la porosité. C’est en somme le premier âge artiste. Sept ans est l’âge de tous les possibles. C’est l’âge chaste et dauphin : on ne pense pas encore : on vit. On adhère et on bouge bien. On n’est plus le petit saligot ou le requérant de jupes : on est le désir pur. Le Forrestal sera mis à la mer cette année et rien n’empêcherait que j’en fusse le commandant, sauf que je n’y pense même pas : je préfère dessiner le mouvement du chat ou peindre la couleur de la couleur. Je ne fugue plus ou pas encore : je vis exactement pour la première fois en osant dessiner ce que je vois qui est tantôt un chat vraiment vert ou vraiment orange, selon le mouvement et la lumière, dans un ciel vraiment gris taupe ou vraiment sans couleur qui n’est pas un ciel blanc pour autant.
Einstein vit encore, et c’est un des modèles découpés de mes albums comme l’est aussi le professeur Piccard que nous avons rencontré un mercredi après-midi dans le Bois du Pendu à scruter Dieu sait quel végétal sous sa grande loupe. Mon oncle Stanislas m’a d’ailleurs appris ce qu’il fallait savoir de ces deux-là, et ce qui distingue l’artiste du savant, en soulignant que le grand artiste détient une sorte de science, et que le grand savant du genre Einstein ou Piccard est également un artiste à sa façon, d’ailleurs ça se voit à leurs cheveux.
Or les cheveux de l’oncle Stanislas sont aussi du genre artiste, comme ne manqueraient de le relever mes tantes si l’oncle Stanislas existait ailleurs que dans mon imagination.
Mon recours à l’oncle Stanislas s’explique par ce qu’il dit lui-même ma condition solitaire de merle blanc. Ma passion précoce pour les nomenclatures, la vie des fourmis et la cinétique du chat m’isolent autant, à sept ans, que le transit d’Auguste Piccard vers les hautes zones de la stratosphère qui a fait de lui l’homme le plus haut du monde, mais c’est en apprenant qu’il avait un assistant que j’ai jugé juste et bon de m’en adjoindre un en la personne de l’oncle Stanislas, qui m’a rappelé lui-même l’épisode du retour du professeur Piccard et de l’ingénieur Kipfer sur un névé tyrolien, quelques jours après la sortie du film M. le Maudit à laquelle il a assisté à Berlin peu avant la deuxième traversée de la Manche en planeur de son compère Kronfeld.
L’artiste est seul mais il ne s’en plaint pas. L’observation du mouvement du chat, suivie de la tentative de restituer, à la mine de plomb, au fusain ou au fin pinceau de poil de martre, cette manifestation de pure grâce, tout cela l’occupe si intensément et si passionnément que plus rien n’est alors mesurable ni comparable, scellant sa vocation érémitique.
Cependant l’avenir de l’enfant de sept ans reste aléatoire, et pas du tout certain le fait qu’une disposition singulière le destine à la carrière de funambule adulé ou de grand compositeur de musique, fût-ce de fanfare égyptienne. Cette même année 1954 des centaines et peut-être des milliers d’enfants de sept ans périront malencontreusement, certains étouffés par la poussière glacée de la neige (l’avalanche de janvier en Autriche), d’autres écrasés par les murs de leur propre maison (le séisme de septembre en Algérie), mais de la plupart d’entre eux les journaux ni la radio ne parleront, et d’ailleurs qui s’en souviendrait ?
Mes chats bleus aux prunelles rouges et aux reflets émeraude de beautés équatoriennes (selon l’appréciation de l’oncle Fabelhaft qui a voyagé partout), sont à l’origine du soupçon entretenu par certaines de nos tantes, incriminant mon éventuel daltonisme, mais c’est pure insinuation dont je n’aurai vent que trente-trois ans plus tard, et que mes père et mère ont récusée sur le moment sans consulter. Quant à moi, sur le moment, je n’ai à fouetter en bleu que mes chats que je fais bleus parce qu’ils le sont sous une certaine lumière de débâcle printanière et parce que j’aime ce bleu à moires noires et vertes à ce moment-là.
J’aime aussi l’odeur de mon encre verte actuelle et tracer ces lettres actuelles à l’encre verte, ajouter un mot à l’autre en les tirant de la nuit comme d’un chapeau de magicien des foulards verts, sauf parfois un blanc d’apparat, noués l’un à l’autre et se transformant aussitôt en choses nouvelles et, pour ainsi dire, en êtres vivants d’un monde non moins vivant et vibrant, à la fois encre et chapeau, première encre bien noire de la première Petite Ecole à tout imiter comme il faut – et plus de chat bleu qui fasse alors, plus de gaucher non plus ni d’ongles en deuil -, mais c’est d’entre deux traits de cette encre noire que l’appel de la fenêtre se fait soudain plus lancinant, puis l’encre bleue marque le passage à la Grande Ecole et valsent les premiers chapeaux de mes premiers délires personnels en attendant l’unique foulard à long jet blanc par-dessus les haies de la première semence.
Je n’éprouverai jamais le besoin de me tatouer, mais l’action agile, les vifs mouvements de chat de mon frère de treize ou quinze ans, la vitesse de flèche d’Indien de mon frère raillant ma lenteur, me poussent à mon tour dehors, à quoi nous pousse aussi notre mère impatiente de nous voir dans ses jupes ou dans ses jambes - vraiment cette époque est bénie car tout nous pousse dehors, notre grand frère déjà presque aux filles et déjà presque en ville, et nous au jardin ou de par les forêts, nous en paires ou en bandes sur les sentiers menant aux routes et sur les routes menant partout aux quatre pointes de la rose des vents.
Peinture: gouache de Friedrich Dürrenmatt, dans un album peint pour ses enfants.












 Or, pour en revenir au dernier recueil paru, le petit Pierre d’ Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire !
Or, pour en revenir au dernier recueil paru, le petit Pierre d’ Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire !







 A propos de Cormac McCarthy et d'Atiq Rahimi
A propos de Cormac McCarthy et d'Atiq Rahimi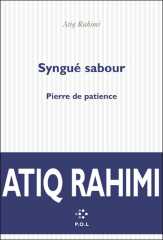 Atiq Rahimi. Syngué sabour – Pierre de patience. P.O.L.,154p.
Atiq Rahimi. Syngué sabour – Pierre de patience. P.O.L.,154p.




 De L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux Déferlantes de Claudie Gallay
De L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux Déferlantes de Claudie Gallay Il peut donc y avoir une vie, pour un bon livre, malgré les ravageuses déferlantes ( !) des rentrées successives, d’où n’émergent que quelques « élus » promus à grand fracas par la machine médiatique parisienne, le plus souvent sous le label des maisons les plus puissantes.
Il peut donc y avoir une vie, pour un bon livre, malgré les ravageuses déferlantes ( !) des rentrées successives, d’où n’émergent que quelques « élus » promus à grand fracas par la machine médiatique parisienne, le plus souvent sous le label des maisons les plus puissantes.









