ben tornati ? Comment se porte la casa, et votre Filou ? Et la Toscane ? Nous étions à Jaffa ce week-end, quelques heures à se dorer la pilule sur la plage. Autant j'aime nager autant la plage m'ennuie profondément. La plage me semble une transition idéale entre terre et mer, un doux entre-deux où le sol commence à se dérober sous les pieds, c'est comme une piste d'envol pour le nageur avide – et il ne me viendrait pas à l'idée d'étendre ma serviette sur une piste d'envol, mais ce n'est pas le cas de tout le monde (suivez mon regard). Et puis c'est plein de sable, tu le sais, il y fait trop chaud, les balles en caoutchouc claquent contre les raquettes, c'est bruyant, parsemé de mégots. Petite spécialité locale : des maîtres nageurs perchés dans leur cabanon hurlent des ordres dans leur mégaphone, à intervalles réguliers : c'est insupportable, et d'autant plus que ces injonctions en hébreu ne peuvent que me rappeler celle des soldats aux check-points.
Triste constatation : cette langue, ni plus ni moins belle qu'aucune autre, riche comme toutes les autres, porteuse d'humanité et de littérature, cette langue me fait froid dans le dos. Je pense à cet ami allemand, qui me disait sa douleur d'entendre parler sa langue, lorsqu'il résidait en France : c'était toujours dans des films de guerre, lorsqu'un soldat réclamait un Ausweiss, et pour beaucoup de Français l'Allemand reste cet idiome barbare de l'Occupant, dont on ignore la douceur possible, les nuances et la finesse. Je sais ces préjugés, la bêtise des généralisations, mais je sais aussi la force de l'instinct, les réactions viscérales de la peur : contre celles-ci l'intellect ne peut pas grand-chose, et en tout cas pas à court terme. Sur la plage, quand le haut-parleur crachait, je serrais les dents.
Je me souviens aussi de mon grand-père, au chalet en Alsace, qui s'était soudain jeté sous la table, en plein milieu du repas. Mon frangin avait eu l'idée d'allumer un pétard, de l'autre côté de la maison, petite blague innocente et mon grand-père de plonger sous la table, et puis de se relever, pâle comme un linge, tentant de répondre par un sourire à nos regards éberlués : quand on a vécu la guerre, le corps réagit plus vite que l'esprit.
Ou plutôt, l'un et l'autre sont mêlés inextricablement, à l'endroit de la blessure, comme les grosses cicatrices font se fusionner la peau et la chair – et c'est dans le corps, paraît-il, qu'on peut retrouver la trace des traumatismes, dans ses muscles contractés, et c'est là qu'on peut en adoucir l'impact, faute de pouvoir l'effacer.
Et c'est aussi là, dieu merci, que se logent les plus beaux souvenirs, les petites madeleines des bonheurs passés, qui ont laissé leur empreinte sur les papilles, au creux de l'odorat, dans les recoins secrets de la peau. Sur la plage soudain est passé un cheval au trot, et puis il est repassé, au pas, et j'espère que ma pupille gardera ça : le petit cheval, son jeune cavalier marchant à ses côtés, leurs silhouettes sur fond de soleil couchant. Le garçon ne tenait pas la bride, ils marchaient côte à côte le long de l'eau, comme de vieux amis.

Ciao ragazzo,
Nous sommes rentrés de Toscane requinqués, malgré le triste état de ce que la télé berlusconienne reflète de la pauvre Italie qu’elle contribue à crétiniser sans y réussir tout à fait. Notre ami le Gentiluomo ne cesse de pester contre les temps qui courent en invoquant la grande Italie de naguère et jadis, mais l’humour n’est jamais absent de ses fulminations, la Professorella le retient de trop exalter le passé, et lui-même est le premier à saluer la Qualité se manifestant au plus que présent, comme celle de Mario del Sarto, le sculpteur « brut » dont je t’ai parlé déjà au début de notre correspondance après avoir découvert ces œuvres, exposées en plein air, et que cette fois j’ai rencontré en chair et en os, sous un beau chapeau blanc. 

Lorsque nous nous sommes pointés dans le vallon, à l’aplomb des grandes carrières de Carrare, où se déploient ses centaines de sculptures, bas-reliefs, bustes, têtes et autres frises et fontaines, Mario, en tablier bleu, était en train de sculpter un énorme bloc de marbre quadrangulaire qu’il ornait de scènes en bas-relief évoquant l’histoire des carrières et la destinée particulière des spartani. Après les présentations, où le gentiluomo lui a révélé ma véritable passion pour son art (je suis resté près d’une heure à photographier ses pièces, en son absence, lors de notre premier passage), et que je lui ai dit ma surprise de voir tant de nouvelles sculptures de tous côtés, il m’a répondu qu’un artiste ne pouvait faire que créer sans discontinuer puisque telle est sa vocation, et d’ailleurs « lavorare riposa », travailler repose, est sa devise, qu’il a inscrite au fronton de son atelier. Sur quoi, voyant mon intérêt, il est allé chercher un morceau de marbre qu’il a commencé de façonner, au moyen d’une petite meule et d’un ciseau, pour lui donner la forme d’une figure au profil évoquant celles des îles de Pâques… et c’est alors que je lui ai dit ma détermination à faire plus qu’un reportage : tout un livre illustrant ses travaux et où il me raconterait sa vie.
Je ne sais trop comment te le dire, mais tout de suite j’ai senti, chez ce grand vieillard de 83 au très beau visage et aux mains très fines, une qualité de rayonnement, de présence et d’attention, de précision dans le langage et de poésie dans l’expression, qui m’ont donné envie de le revoir et de le faire connaître, non du tout pour la gloire qu’il pourrait en tirer (il ne se fait aucune illusion sur les vanités humaines) mais pour le simple bonheur de faire partager éventuellement une belle rencontre.


Ce qu’attendant, sans t’avoir rien dit de tout le bien que nous pensons de ton livre dont j’ai fait la lecture du tapuscrit à ma douce durant tout le voyage, je vous embrasse sans oser vous dire Forza…
Photo : Chanan Getraide, vieille mosquée de Jaffa. Mario del Sarto et ses oeuvres.
Mario del sarto: il Spartano, statue d'environ quatre mètres de hauteur, destinée à se trouver juchée sur un pic dominant la vallée à l'aplomb des carrières du Canal Grande et des Campanili, au-dessus de Carrare.




 Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?
Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?




 Tu le sais, Amira Hass est juive israélienne, elle a vécu à Gaza, elle habite Ramallah depuis dix ans. Elle dit le quotidien de Palestine, elle brocarde l'Autorité Palestinienne, les partis, elle dit ses amitiés, ses colères, elle raconte surtout l'Occupation. Elle est de ceux qui entretiennent le lien fragile entre les peuples, quand les murs et les haines s'échinent à le briser.
Tu le sais, Amira Hass est juive israélienne, elle a vécu à Gaza, elle habite Ramallah depuis dix ans. Elle dit le quotidien de Palestine, elle brocarde l'Autorité Palestinienne, les partis, elle dit ses amitiés, ses colères, elle raconte surtout l'Occupation. Elle est de ceux qui entretiennent le lien fragile entre les peuples, quand les murs et les haines s'échinent à le briser.



 Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.
Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.




















 Les retours sont toujours un peu vertigineux. Le silence vaguement réprobateur des objets qu’on retrouve. Où étiez-vous ? Et le chien Fellow qui s’agite enthousiastique, disons trois minutes, avant de retrouver sa routine. Et les journaux entassés. La chronique du monde qui nous rattrape, tristes images d’Ossétie et qu’en penser mon ami, tu as une idée de quoi faire là-bas pour le bien des Ossètes ?
Les retours sont toujours un peu vertigineux. Le silence vaguement réprobateur des objets qu’on retrouve. Où étiez-vous ? Et le chien Fellow qui s’agite enthousiastique, disons trois minutes, avant de retrouver sa routine. Et les journaux entassés. La chronique du monde qui nous rattrape, tristes images d’Ossétie et qu’en penser mon ami, tu as une idée de quoi faire là-bas pour le bien des Ossètes ?






 A ce propos cela encore : je t’ai dis que ta douce m’évoquait terriblement le cinéma italien des années 40-50, et j’ai montré sa photo à Nanni qui en a été frappé lui aussi. Or il se trouve qu'il a, dans ses projets, un remake d'un fameux mélodrame de Mario Soldati, d'après un roman de Fogazzaro, dont l'héroïne est une jeune Italienne du Nord, et le héros un révolutionnaire romantique slovaque sur les bords. Tout à fait vous en somme, donc il vous contactera dès qu’il sera question du casting. Le film se tournera sur le bord du lac Majeur, où il pleut tout le temps. Ca vous changera un peu de Ramallah...
A ce propos cela encore : je t’ai dis que ta douce m’évoquait terriblement le cinéma italien des années 40-50, et j’ai montré sa photo à Nanni qui en a été frappé lui aussi. Or il se trouve qu'il a, dans ses projets, un remake d'un fameux mélodrame de Mario Soldati, d'après un roman de Fogazzaro, dont l'héroïne est une jeune Italienne du Nord, et le héros un révolutionnaire romantique slovaque sur les bords. Tout à fait vous en somme, donc il vous contactera dès qu’il sera question du casting. Le film se tournera sur le bord du lac Majeur, où il pleut tout le temps. Ca vous changera un peu de Ramallah...






 Et dans la foulée on nous livre une espèce de mode d’emploi ou de manifeste joyeux, intitulé L’Esprit musical, tiré d’une conférence donnée par le compositeur en 1924 dans les villes certifiées belges de Bruxelles et Anvers, dont chaque mot nous touche tandis que la pianiste fait merveille sur son clavier où défilent finalement les inénarrables crustacés de Satie. On se croirait à l’opéra. Rossini n’a pas eu le temps de lire Proust, mais les poissons et les oiseaux se mêlent les pinceaux, et Satie fait mousser le rideau…
Et dans la foulée on nous livre une espèce de mode d’emploi ou de manifeste joyeux, intitulé L’Esprit musical, tiré d’une conférence donnée par le compositeur en 1924 dans les villes certifiées belges de Bruxelles et Anvers, dont chaque mot nous touche tandis que la pianiste fait merveille sur son clavier où défilent finalement les inénarrables crustacés de Satie. On se croirait à l’opéra. Rossini n’a pas eu le temps de lire Proust, mais les poissons et les oiseaux se mêlent les pinceaux, et Satie fait mousser le rideau… 






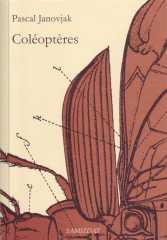






 Celui qui se répète gaiement que la croisière s’amuse non sans travailler à sa traduction en islandais du Pavillon d’or de Mishima/ Celle qui lit Vertiges de W.G. Sebald qui la renvoie à De l’amour de Stendhal puis au Giardino Giusti de Vérone où elle se guérissait d’une rupture en lisant du Leopardi mort en avalant une glace de travers / Ceux qui se sont rappelé leurs anciennes amours et autres haines en lisant l’Histoire de l’amour et de la haineau Prater de Vienne où ils sont revenus pour se rappeler quelques passions et autres désamours / Celui qui (dans un taxi londonien destination Bloomsbury) tombe d’accord avec l’écrivain Dantzig (Charles, pas Jean-Paul) pour estimer que l’humour français n’existe pas sauf ici et là quand il se la joue à la juive ou à l’angalise – ou chez Marcel Aymé ou Chaval et quelque autres / Celle qui apprécie l’ironie française mais à dose comptée /
Celui qui se répète gaiement que la croisière s’amuse non sans travailler à sa traduction en islandais du Pavillon d’or de Mishima/ Celle qui lit Vertiges de W.G. Sebald qui la renvoie à De l’amour de Stendhal puis au Giardino Giusti de Vérone où elle se guérissait d’une rupture en lisant du Leopardi mort en avalant une glace de travers / Ceux qui se sont rappelé leurs anciennes amours et autres haines en lisant l’Histoire de l’amour et de la haineau Prater de Vienne où ils sont revenus pour se rappeler quelques passions et autres désamours / Celui qui (dans un taxi londonien destination Bloomsbury) tombe d’accord avec l’écrivain Dantzig (Charles, pas Jean-Paul) pour estimer que l’humour français n’existe pas sauf ici et là quand il se la joue à la juive ou à l’angalise – ou chez Marcel Aymé ou Chaval et quelque autres / Celle qui apprécie l’ironie française mais à dose comptée /  Ceux qui n’imaginent pas un couple français à la Laurel et Hardy même si Bouvard et Pécuchet forment une paire assez gaie / Celle qui éclate de rire comme on pète - l’odeur en moins / Ceux qui préparent leurs bons mots comme le faisait Cocteau avant les coquetèles / Celui qui se sent tout drôle avant de mourir de rire / Celle qui lit sous la plume de Dantzig (Charles, pas Armand ni Aaron) que « la drôlerie est la poétisation de la vie » / Ceux qui trouvent vraiment drôle et carrrément très très drôle la pratique saoudite (conforme à la grande civilisation wahabite) de crucifier le cadavre d’un jeune décapité au nom de la foi en un monde meilleur où chacun aura toute sa tête pour se féliciter d’être né / Celui qui sans faire d’amalgame se figure que tous les fous de dieu n’ont plus qu’une tête (genre le cheval de Caligula) qu’il lui incombe de trancher - ce qu’il évite par éducation pour se contenter de lui faire un pied de nez / Celle qui prend son pied quand le mécréant le lui fait comme un dieu / Ceux qui à Collioure se rappellent la mort de Walter Benjamin telle que l’évoque Frédéric Pajak dans son Manifeste incertain 3 /
Ceux qui n’imaginent pas un couple français à la Laurel et Hardy même si Bouvard et Pécuchet forment une paire assez gaie / Celle qui éclate de rire comme on pète - l’odeur en moins / Ceux qui préparent leurs bons mots comme le faisait Cocteau avant les coquetèles / Celui qui se sent tout drôle avant de mourir de rire / Celle qui lit sous la plume de Dantzig (Charles, pas Armand ni Aaron) que « la drôlerie est la poétisation de la vie » / Ceux qui trouvent vraiment drôle et carrrément très très drôle la pratique saoudite (conforme à la grande civilisation wahabite) de crucifier le cadavre d’un jeune décapité au nom de la foi en un monde meilleur où chacun aura toute sa tête pour se féliciter d’être né / Celui qui sans faire d’amalgame se figure que tous les fous de dieu n’ont plus qu’une tête (genre le cheval de Caligula) qu’il lui incombe de trancher - ce qu’il évite par éducation pour se contenter de lui faire un pied de nez / Celle qui prend son pied quand le mécréant le lui fait comme un dieu / Ceux qui à Collioure se rappellent la mort de Walter Benjamin telle que l’évoque Frédéric Pajak dans son Manifeste incertain 3 /  Celui qui (Richard Wagner himself) confie à Cosima juste après la mort annoncée d’un ami qu’il a mal compris (le comte de Gobineau) qu’ « à peine a-t-on rencontré quelqu’un qu’il vous coule entre les doigts » / Celle qui passant à Dieulefit (en visite chez son cousin Cheval devenu célèbre pour sa brouette et son palais) n’a pas remarqué dans les cafés les très libres enfantsde l’institut pédagogique de pointe de La Roseraie inspirée par le modèle de Summerhill en non moins foutraque / Ceux qui ont bien tourné en dépit (ou à cause, ça se discute) de leur éducation libertaire / Celui qui s’est conduit très régulièrement en notoire irrégulier non sans prôner la discipline extrême de la calligraphie / Celle qui fugue en faisant suivre ses pianos au galop à travers bois et cuivres / Ceux qui découpent le temps en fines tranches à consommer après l’emploi au présent de l’oblatif / Celui qui sait de source sûre que « se baigner dans mille pleurs inutiles éteint la jeune lumière » tout en restant conscient de cela que « notre soupir se fait vent » et constater enfin « que le ciel change vite de couleur » / Celle qui (cauchemar récent) se fait arrêter en Arabie pour excès de gaieté / Ceux qui de passage à Positano et lisant sur le port le Manifeste incertain 4 de Frédéric Pajak se rappellent l’origine de la Pizza Margherita aux couleurs du drapeau italien et représentant un « chef-d’œuvre de l’histoire humaine » à savourer encore et encore au Campo de Fiori de Rome ou dans les pizzerie mafiose d’un peu partout et jusque sur les terrasses du Purgatoire alors que les Ritals « meurent devant leur télévision », etc.
Celui qui (Richard Wagner himself) confie à Cosima juste après la mort annoncée d’un ami qu’il a mal compris (le comte de Gobineau) qu’ « à peine a-t-on rencontré quelqu’un qu’il vous coule entre les doigts » / Celle qui passant à Dieulefit (en visite chez son cousin Cheval devenu célèbre pour sa brouette et son palais) n’a pas remarqué dans les cafés les très libres enfantsde l’institut pédagogique de pointe de La Roseraie inspirée par le modèle de Summerhill en non moins foutraque / Ceux qui ont bien tourné en dépit (ou à cause, ça se discute) de leur éducation libertaire / Celui qui s’est conduit très régulièrement en notoire irrégulier non sans prôner la discipline extrême de la calligraphie / Celle qui fugue en faisant suivre ses pianos au galop à travers bois et cuivres / Ceux qui découpent le temps en fines tranches à consommer après l’emploi au présent de l’oblatif / Celui qui sait de source sûre que « se baigner dans mille pleurs inutiles éteint la jeune lumière » tout en restant conscient de cela que « notre soupir se fait vent » et constater enfin « que le ciel change vite de couleur » / Celle qui (cauchemar récent) se fait arrêter en Arabie pour excès de gaieté / Ceux qui de passage à Positano et lisant sur le port le Manifeste incertain 4 de Frédéric Pajak se rappellent l’origine de la Pizza Margherita aux couleurs du drapeau italien et représentant un « chef-d’œuvre de l’histoire humaine » à savourer encore et encore au Campo de Fiori de Rome ou dans les pizzerie mafiose d’un peu partout et jusque sur les terrasses du Purgatoire alors que les Ritals « meurent devant leur télévision », etc.








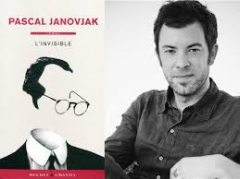

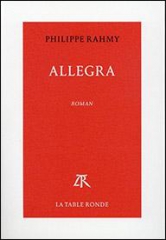 Si le roman de Philippe Rahmy pose, comme on le verra plus loin, des problèmes de vraisemblance au niveau de son ancrage dramatique dans la réalité, Allegra rend un son, pourrait-on dire, qui fait écho à notre époque à la façon d’un cauchemar.
Si le roman de Philippe Rahmy pose, comme on le verra plus loin, des problèmes de vraisemblance au niveau de son ancrage dramatique dans la réalité, Allegra rend un son, pourrait-on dire, qui fait écho à notre époque à la façon d’un cauchemar. 




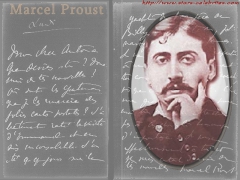


 Pour marquer le coup, il m’écrivait de temps à autre une sentence qu’il estimait digne d’être retenue. J’ai gardé un papier sur lequel il a griffonné au crayon rouge : COMMENT NE PAS RIRE QUAND ON VOIT UN MINISTRE…
Pour marquer le coup, il m’écrivait de temps à autre une sentence qu’il estimait digne d’être retenue. J’ai gardé un papier sur lequel il a griffonné au crayon rouge : COMMENT NE PAS RIRE QUAND ON VOIT UN MINISTRE… Ce soir, cependant, c’est d’une autre rencontre que je reviens, à Genève avec Georges Moustaki dont vient de sortir le dernier disque, intitulé Solitaire et mêlant vieilles bonnes choses, comme Ma solitude (en duo avec China Forbes) et Sans la nommer (très bien enlevée avec Cali) et nouvelles compositions. On est loin, évidemment, des audaces de Bashung, mais j’aime bien cette dernière ligne de la chanson Rive Gauche avec son mélange de poésie de rue à la française et de touches latino, d’émotion délicate et de sensualité, et l’heure que j’ai passée avec le métèque tout chenu m’a rempli de nostalgie souriante, d’autant plus sereine que l’homme, visiblement fragilisé dans sa santé, n’a rien de désenchanté ni d’amer. Nous avons d’ailleurs parlé des cadeaux de la vie plus que de ses misères, évoqué sa vie à travers ses chansons qui, selon lui, en disent bien plus long qu’une biographie. Nous avons parlé de son enfance solaire d’Alexandrie, de sa vie dans les livres, de Kazantzaki et de Cavafy qui participent de sa source grecque, puis d’Albert Cossery dont il a tout lu et d’Henry Miller, toujours dans cette veine des viveurs philosophes qui vivent la paresse comme un art selon Lafargue, auquel il rend également un bel hommage.
Ce soir, cependant, c’est d’une autre rencontre que je reviens, à Genève avec Georges Moustaki dont vient de sortir le dernier disque, intitulé Solitaire et mêlant vieilles bonnes choses, comme Ma solitude (en duo avec China Forbes) et Sans la nommer (très bien enlevée avec Cali) et nouvelles compositions. On est loin, évidemment, des audaces de Bashung, mais j’aime bien cette dernière ligne de la chanson Rive Gauche avec son mélange de poésie de rue à la française et de touches latino, d’émotion délicate et de sensualité, et l’heure que j’ai passée avec le métèque tout chenu m’a rempli de nostalgie souriante, d’autant plus sereine que l’homme, visiblement fragilisé dans sa santé, n’a rien de désenchanté ni d’amer. Nous avons d’ailleurs parlé des cadeaux de la vie plus que de ses misères, évoqué sa vie à travers ses chansons qui, selon lui, en disent bien plus long qu’une biographie. Nous avons parlé de son enfance solaire d’Alexandrie, de sa vie dans les livres, de Kazantzaki et de Cavafy qui participent de sa source grecque, puis d’Albert Cossery dont il a tout lu et d’Henry Miller, toujours dans cette veine des viveurs philosophes qui vivent la paresse comme un art selon Lafargue, auquel il rend également un bel hommage.
 Georges Moustaki. Solitaire. Emi
Georges Moustaki. Solitaire. Emi Cécile Barthélemy. Georges Moustaki. Seghers, Poésie et Chansons, 2008, 227p.
Cécile Barthélemy. Georges Moustaki. Seghers, Poésie et Chansons, 2008, 227p.





