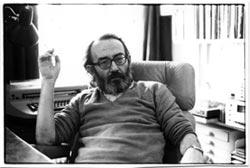Lettres par-dessus les murs (38)
Ramallah, le 26 mai, matin.
Cher JLs,
A propos de rencontre, en voici une autre que je ne regrette pas, celle de Pacha… Hier soir nous étions invités chez lui, c'est toujours un peu étourdissant, quand on revient d'une ballade dans les rues de Dhaka, où les enfants dorment à même le sol, où les mendiants vous agrippent le bas du pantalon – parce que Pacha est terriblement riche, fier de l'être, et heureux de partager ses privilèges, pendant quelques heures. Vous entrez dans un appartement énorme, dans les salons en enfilade vous attendent les gros fauteuils de cuir noir, le piano, d'autres sofas, la grosse boîte à cigares… une enfilade de bouteilles, vin français, gin, whisky, sont posés devant les trois frigos qui trônent dans la cuisine, des portes s'ouvrent sur de luxueuses chambres d'amis (mais les murs sont déjà rongés par l'humidité), une bibliothèque, une salle de musique, un bureau de président, on boit un verre avant de jouer au billard, devant la grande verrière qui donne sur le lac. C'est incroyable, pour qui ne connaît pas Pacha et ses excentricités.

Si vous voulez aller pisser, vous ne demandez pas où sont les toilettes, mais, avec un malin plaisir, lesquelles il vous conseille – et Pacha magnanime vous indique sa salle de bain personnelle, avec douche-jacuzzi-bain turc, que vous trouvez après vous être perdu dans la rangée de costumes du dressing, et l'immensité de sa chambre à coucher, entre le lit queen size et la télé à écran plasma.

Sur les murs des salons est accrochée une belle petite collection d'art (parce que Pacha a du goût), au plafond pendent d'infâmes lustres en cristal (parce que nous n'avons pas le même). Il fait 22 degrés partout dans la maison, sauf dans la pièce qui sert de cave à vin, où le thermomètre indique 14. Avec Bruno on s'était dit que les coupures d'électricité survenaient au moment précis où une personne, parmi plusieurs millions, posait son doigt sur un interrupteur de trop, allumant une ampoule de trop, qui faisait sauter les disjoncteurs de la ville. Nous avons trouvé le vrai coupable hier : c'est Pacha, avec ses innombrables climatiseurs, ses lustres et tout le reste qui reste constamment allumé, satané Pacha, il doit peser autant en kilowatts/heure qu'en dollars/minute. Hier dans la cuisine, Insan disait qu'il avait vu récemment un billet de 500 euros, pour la première fois, 500 euros, dit-il en riant, tu te rends compte, moi j'en ai gagné mille pendant toute l'année dernière, et Pacha qui surprend la conversation de sourire et de dégainer son porte-monnaie, et d'exhiber à la façon d'un magicien cinq autres billets identiques, sa menue monnaie, et Insan rit encore, tout est magique chez Pacha, tout est irréel, les caisses d'eau Evian qu'il importe de France, pourquoi s'emmerder, la glace sans lactose qui arrive de New York, pourquoi se priver, et à chacune de ses folies nous sourions, nous rions de bon cœur, nous le taquinons parfois, ton piano sonne un peu faux, j'ai vu passer un cafard…

Mais nous l'aimons bien. Pacha est indécent, ostentatoire, et pourtant je me sens à l'aise avec lui, à cause du côté enfantin de sa prétention, de sa franchise, et surtout à cause de son absence totale de mauvaise conscience, qui n'est somme toute qu'une invention occidentale. Pacha et Insan sont potes, et pourtant Insan dort dans une chambre de la taille d'un matelas, et cela ne gêne ni l'un ni l'autre. Cette simplicité nous fait paraître meilleur le champagne que Pacha a la générosité de nous offrir, à nous et à tous ceux qui veulent bien être un peu spectateurs de son petit théâtre, de sa gentille décadence.
Dhaka est riche de personnages dans ce genre… j'aurais pu t'envoyer cent portrait, mille, si j'avais eu le temps. Nous partons après-demain, j'ai l'impression que nous avons mal organisé ce séjour, nous pensions venir voir deux amis, on en a retrouvé deux cent... on avait oublié combien de gens, combien de choses il y avait à voir ici… tant pis, on reviendra bientôt, inch allah. A très vite depuis ailleurs…
Cher toi,
Ton évocation du riche Pacha m’a fait rêver, avec son tour de conte oriental, moi qui rêve de rencontrer un vrai riche qui fasse rêver. Parce que c’est vrai que les riches que nous rencontrons ne font pas rêver : ils sont le plus souvent à plaindre. Soit qu’ils plastronnent, et nous les plaignons d’être des plastrons, soit qu’ils ploient sous le poids de la fortune et là encore comment ne pas compatir avec ces infortunés ? Tandis que ton Pacha…
Or le seul nom de Pacha m’a rappelé un pauvre chat que nous avons beaucoup aimé et beaucoup pleuré quand il nous a quittés. Pas que son sort ait été celui d’un vrai pauvre chat : nul chat ne fut à vrai dire plus choyé que Pacha par nos filles. Mais Pacha cumulait déjà toutes les maladies quand nous l’accueillîmes, sans nous en douter évidemment. La vie de Pacha, majestueux abyssin lièvre aux yeux d’or, s’était déroulée comme une vie de Pacha chez un vieil homme richissime dont la seule richesse qui le fît rêver était à vrai dire cet animal absolument baudelairien, incarnant l’insondable mystère de l’être, lorsqu’un mal non moins mystérieux frappa le vieillard, laissant Pacha seul dans sa demeure blanche comme le deuil ; sur quoi le plus triste sort lui fut réservé par les héritiers sans âme du vieil homme, qui le reléguèrent dans une animalerie publique où tous les autres chats abandonnés l’attendaient pour se frotter à lui et le contaminer. Il le fut en une seule nuit : le lendemain nous l’adoptions, sans nous douter qu’il était condamné à ne vivre que le temps de soigner toutes ses maladies, jusqu’à la dernière qui nous l’arracha.
Le pauvre Pacha fut le chat le plus soigné qui se puisse imaginer. Nous n’étions pas riches jusque-là, mais Pacha faillit nous faire connaître la vraie pauvreté. Sans doute eussions-nous encore préféré celle-ci à la perte de cette créature énigmatique et fière, qui ne se laissait jamais caresser que par deux très petites filles dont l’odeur de souris lui rappelait, probablement, celle de son vieux compagnon, mais ainsi en fut-il et voilà pour le pauvre Pacha…













 Les ânes nous sont revenus de la même façon hier, suivant de quelques jours l’éclosion des narcisses et précédant d’autant la lune de mai. La terre tremble au loin, les ânes chinois en pâtissent, mais cette année nous en aurons trois nouveaux à La Désirade qui n’ont rien à craindre : il est helvétiquement établi que la Terre ne tremble qu’à l’étranger. Ils se livrent donc en toute placidité à leur job d’ânes au pré : ils mâchent leur chewing-gum d’herbe en te matant avec l’air de te dire qu’ils ont tout leur temps. On les dirait aussi bien dans le bleu du Temps.
Les ânes nous sont revenus de la même façon hier, suivant de quelques jours l’éclosion des narcisses et précédant d’autant la lune de mai. La terre tremble au loin, les ânes chinois en pâtissent, mais cette année nous en aurons trois nouveaux à La Désirade qui n’ont rien à craindre : il est helvétiquement établi que la Terre ne tremble qu’à l’étranger. Ils se livrent donc en toute placidité à leur job d’ânes au pré : ils mâchent leur chewing-gum d’herbe en te matant avec l’air de te dire qu’ils ont tout leur temps. On les dirait aussi bien dans le bleu du Temps.

 Antonio Rodriguez est né à Lausanne en 1973. Etudes de lettres à Lausanne et Paris. Il a publié deux recueils de poèmes, Saveurs du réel (Empreintes, 2006), En la Demeure (Empreintes, 2007), et de nombreux textes dans des revues suisses et européennes. Mène également une activité de critique universitaire avec des essais : Le pacte lyrique, Modernité et paradoxe lyrique: Max Jacob, Francis Ponge. Son écriture de création le porte également vers des formes interdisciplinaires, notamment avec l'image et la peinture, ou le renouvellement du roman photographique, dans Le Dépôt des rêves (Jean-Michel Place 2006) et une collaboration avec la plasticienne vaudoise Catherine Bolle (Ce qui, noir, prend souffle, Traces 2007). Il réside actuellement en France où il mène à bien l’écriture d’un essai et d’un nouveau recueil. Un nouveau recueil vient de paraître chez Tarabuste, sous le titre Big Bang Europa. Présentation à venir incessamment sous peu.
Antonio Rodriguez est né à Lausanne en 1973. Etudes de lettres à Lausanne et Paris. Il a publié deux recueils de poèmes, Saveurs du réel (Empreintes, 2006), En la Demeure (Empreintes, 2007), et de nombreux textes dans des revues suisses et européennes. Mène également une activité de critique universitaire avec des essais : Le pacte lyrique, Modernité et paradoxe lyrique: Max Jacob, Francis Ponge. Son écriture de création le porte également vers des formes interdisciplinaires, notamment avec l'image et la peinture, ou le renouvellement du roman photographique, dans Le Dépôt des rêves (Jean-Michel Place 2006) et une collaboration avec la plasticienne vaudoise Catherine Bolle (Ce qui, noir, prend souffle, Traces 2007). Il réside actuellement en France où il mène à bien l’écriture d’un essai et d’un nouveau recueil. Un nouveau recueil vient de paraître chez Tarabuste, sous le titre Big Bang Europa. Présentation à venir incessamment sous peu.









 Ce n'est qu'à la fin de cette année-là que j'ai compris que Poe n'allait jamais se coucher, je l'ai surpris qui picolait dans sa chambre en regardant la nuit par la fenêtre ouverte, et dans un fauteuil enfumé, dans le coin, il y avait Mallarmé, et les deux salopards causaient ensemble toutes les nuits, quand ils s'étaient enfin débarrassés de l'étudiant et des ses questions idiotes.
Ce n'est qu'à la fin de cette année-là que j'ai compris que Poe n'allait jamais se coucher, je l'ai surpris qui picolait dans sa chambre en regardant la nuit par la fenêtre ouverte, et dans un fauteuil enfumé, dans le coin, il y avait Mallarmé, et les deux salopards causaient ensemble toutes les nuits, quand ils s'étaient enfin débarrassés de l'étudiant et des ses questions idiotes.
 Plus important : le chien du doreur ne se nomme pas Pierrot mais Poulou, enfin je dis Poulou pour égarer ceux qui se plaisent au jeu des identifications, ces ennemis avérés de la littérature. Quant au cybercat, il va de soi que ce n’est pas le chat du sac : c’est un angora noir et blanc tout semblable à mon adorable Gogol d’il y a bien des années, qui me revint un jour (j’habitais alors dans une espèce de ferme en bordure de champs de blé) se traînant sur quatre pauvres moignons après avoir été amputé de ses pattes par une faucheuse. J’en aurais chialé, mais j’ai dû le conduire au plus vite au refuge animalier voisin, pour le soulager définitivement. Une chose reste exacte dans mon premier petit rapport : le griffon.
Plus important : le chien du doreur ne se nomme pas Pierrot mais Poulou, enfin je dis Poulou pour égarer ceux qui se plaisent au jeu des identifications, ces ennemis avérés de la littérature. Quant au cybercat, il va de soi que ce n’est pas le chat du sac : c’est un angora noir et blanc tout semblable à mon adorable Gogol d’il y a bien des années, qui me revint un jour (j’habitais alors dans une espèce de ferme en bordure de champs de blé) se traînant sur quatre pauvres moignons après avoir été amputé de ses pattes par une faucheuse. J’en aurais chialé, mais j’ai dû le conduire au plus vite au refuge animalier voisin, pour le soulager définitivement. Une chose reste exacte dans mon premier petit rapport : le griffon. Les quais de Vevey, cependant, sont plutôt féminins de tonalité, ou disons qu’ils ont quelque chose d’aquarellé (je ne tarderai d’ailleurs à sortir mes godets) et de tchékhovien, surtout en fin de journée et avec, ces jours, la dernière neige ourlant les créneaux de Savoie. Les gazons sont entretenus et plus encore, mais des jeunes filles n’hésitent pas à les joncher de leurs corps délicats. Quelques cyclistes point impatients zigzaguent entre de vieilles Anglaises se rappelant que leur cher Henry James a passé par là et que, quelque pas plus à l’Ouest, au balcon du château de l’Aile dont je te reparlerai, Paul Morand faisait tous les matins sa gymnastique nordique, torse nu et méthodique en son caleçon aussi joliment plissé que sa phrase. Bref, entre Vladimir Nabokov (à Montreux), Eric Ambler et Noël Coward (aux Avants) ou Ernest Hemingway (vallon que surplombe La Désirade sert de dernier décor à L’Adieu aux armes), Kokoschka (Villeneuve, où vécut aussi Romain Rolland), nous sommes ici bien entourés au point de nous croire au cœur du monde. C’est d’ailleurs exactement ça que je ressens en mon Atelier, mon cœur est ailleurs mais je suis ici au cœur du monde…
Les quais de Vevey, cependant, sont plutôt féminins de tonalité, ou disons qu’ils ont quelque chose d’aquarellé (je ne tarderai d’ailleurs à sortir mes godets) et de tchékhovien, surtout en fin de journée et avec, ces jours, la dernière neige ourlant les créneaux de Savoie. Les gazons sont entretenus et plus encore, mais des jeunes filles n’hésitent pas à les joncher de leurs corps délicats. Quelques cyclistes point impatients zigzaguent entre de vieilles Anglaises se rappelant que leur cher Henry James a passé par là et que, quelque pas plus à l’Ouest, au balcon du château de l’Aile dont je te reparlerai, Paul Morand faisait tous les matins sa gymnastique nordique, torse nu et méthodique en son caleçon aussi joliment plissé que sa phrase. Bref, entre Vladimir Nabokov (à Montreux), Eric Ambler et Noël Coward (aux Avants) ou Ernest Hemingway (vallon que surplombe La Désirade sert de dernier décor à L’Adieu aux armes), Kokoschka (Villeneuve, où vécut aussi Romain Rolland), nous sommes ici bien entourés au point de nous croire au cœur du monde. C’est d’ailleurs exactement ça que je ressens en mon Atelier, mon cœur est ailleurs mais je suis ici au cœur du monde…


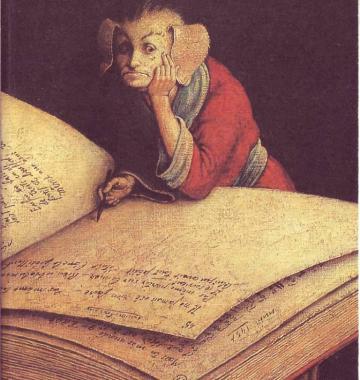
 Celui-ci, que j’ai déniché pour 300 francs par mois dans la vieille ville de Vevey, à cinquante mètres d’Adam Mickiewicz, prince des poètes polonais, et qui se réduit à une chambre donnant sur une cour à ciel ouvert, précédée d’une piécette d’entrée pavée de brique rouge sang de bœuf pourvue d’un évier de pierre à robinet d’eau froide, ce lieu absolument serein à la douce lumière sera ma thébaïde. J’y installe 7000 livres et mon chevalet, rien d’autre, si : un fauteuil à bascule pour lire. Autant dire le monde au cœur du monde, mais loin des rumeurs du monde, et d’autant plus que le réseau Swisscom est coupé net à la porte de la vieille maison dont le parterre est occupé par l’atelier d’un encadreur-doreur, gardé par le chien Pierrot à foulard libertaire, secondé par le chat Cybercat. Tout un autre monde déjà, que je te raconterai en alternance avec ton Amman et ton Bangladesh.
Celui-ci, que j’ai déniché pour 300 francs par mois dans la vieille ville de Vevey, à cinquante mètres d’Adam Mickiewicz, prince des poètes polonais, et qui se réduit à une chambre donnant sur une cour à ciel ouvert, précédée d’une piécette d’entrée pavée de brique rouge sang de bœuf pourvue d’un évier de pierre à robinet d’eau froide, ce lieu absolument serein à la douce lumière sera ma thébaïde. J’y installe 7000 livres et mon chevalet, rien d’autre, si : un fauteuil à bascule pour lire. Autant dire le monde au cœur du monde, mais loin des rumeurs du monde, et d’autant plus que le réseau Swisscom est coupé net à la porte de la vieille maison dont le parterre est occupé par l’atelier d’un encadreur-doreur, gardé par le chien Pierrot à foulard libertaire, secondé par le chat Cybercat. Tout un autre monde déjà, que je te raconterai en alternance avec ton Amman et ton Bangladesh. Dans le jeu des coïncidences, figure-toi qu’une grande et belle édition récente d’Un coup de dé jamais n’abolira le hasard, paru à la Table Ronde l’an dernier, se trouve déposée depuis hier sur le manteau de la cheminée désaffectée de l’Atelier. Plus précisément, il s’agit du recueil des premières et deuxièmes épreuves avec les corrections manuscrites de Mallarmé, complété par un commentaire détaillé de Françoise Morel, la propriétaire de l’ouvrage. L’objet contient, entre autres, le poème en l'état de sa parution dans la revue Cosmopolis du 4 mai 1897 et un texte repris en préface à la première édition en volume. Françoise Morel précise : «Les observations qui suivent n'ont pour objet que l'évocation de possibles, multiples et variables interprétations symboliques. On ne trouvera donc pas une clé ou des clés, mais de nombreux chemins, parfois de traverse, des carrefours, peut-être avant tout une rencontre, une ouverture, un horizon. Et qui mieux que Mallarmé pouvait nous conduire… »
Dans le jeu des coïncidences, figure-toi qu’une grande et belle édition récente d’Un coup de dé jamais n’abolira le hasard, paru à la Table Ronde l’an dernier, se trouve déposée depuis hier sur le manteau de la cheminée désaffectée de l’Atelier. Plus précisément, il s’agit du recueil des premières et deuxièmes épreuves avec les corrections manuscrites de Mallarmé, complété par un commentaire détaillé de Françoise Morel, la propriétaire de l’ouvrage. L’objet contient, entre autres, le poème en l'état de sa parution dans la revue Cosmopolis du 4 mai 1897 et un texte repris en préface à la première édition en volume. Françoise Morel précise : «Les observations qui suivent n'ont pour objet que l'évocation de possibles, multiples et variables interprétations symboliques. On ne trouvera donc pas une clé ou des clés, mais de nombreux chemins, parfois de traverse, des carrefours, peut-être avant tout une rencontre, une ouverture, un horizon. Et qui mieux que Mallarmé pouvait nous conduire… »







 Donc, dans l’immédiat, je vais plutôt revenir en Autriche. Tu me vois venir avec cette autre folie ? Alors tiens-toi bien : moi aussi je la voyais venir, l’histoire de l’attentionné pépère. J’en ai senti l’odeur abjecte dès mon arrivée à la Pension Mozart, il y a treize ans de ça.
Donc, dans l’immédiat, je vais plutôt revenir en Autriche. Tu me vois venir avec cette autre folie ? Alors tiens-toi bien : moi aussi je la voyais venir, l’histoire de l’attentionné pépère. J’en ai senti l’odeur abjecte dès mon arrivée à la Pension Mozart, il y a treize ans de ça.  Eh bien tu oublies, ami Pascal : car ce fut par un dément que je fus reçu, furieux de mon retard (une heure en effet, dont je n’étais aucunement responsable, après un effroyable trajet en train rouillé, de l’aéroport en ville, interrompu par au moins treize accidents de personnes et de vétilleux contrôles de billets. Or au lieu de compatir et de m’offrir une part de la classique Sacher Torte, le Cerbère m’annonça qu’il m’avait d’ores et déjà puni en me reléguant dans la chambre de derrière, dépourvue de la table que j’avais posée comme condition de mon séjour, mesquine et sombre, avec une douche de fortune installée dans la pièce même, évoquant une cabine de téléphone de station balnéaire à l'abandon. Qu’en aurait pensé Amadeus ? Tu sais que cet ange était capable de colères vives. Moi aussi, surtout en fin de matinée autrichienne, quand on me fait chier. Donc j’envoyai paître cet imbécile et m’en fus avec mes treize valises, ne sachant où me réfugier. Treize heures plus tard à marcher sous la neige, j’échouai dans un hôtel du centre historique de la ville dont le concierge, après m’avoir signifié que je le dérangeais, me désigna une chambre certes pourvue d’un escabeau en forme de table, mais donnant sur une cour. De guerre lasse, je m’y posai, attendant d’autres désastres. Il y en eut tous les jours durant le mois sabbatique que je passai en ces murs d’une sournoise joliesse extérieure, jusqu’à ma rencontre d’Hitler.
Eh bien tu oublies, ami Pascal : car ce fut par un dément que je fus reçu, furieux de mon retard (une heure en effet, dont je n’étais aucunement responsable, après un effroyable trajet en train rouillé, de l’aéroport en ville, interrompu par au moins treize accidents de personnes et de vétilleux contrôles de billets. Or au lieu de compatir et de m’offrir une part de la classique Sacher Torte, le Cerbère m’annonça qu’il m’avait d’ores et déjà puni en me reléguant dans la chambre de derrière, dépourvue de la table que j’avais posée comme condition de mon séjour, mesquine et sombre, avec une douche de fortune installée dans la pièce même, évoquant une cabine de téléphone de station balnéaire à l'abandon. Qu’en aurait pensé Amadeus ? Tu sais que cet ange était capable de colères vives. Moi aussi, surtout en fin de matinée autrichienne, quand on me fait chier. Donc j’envoyai paître cet imbécile et m’en fus avec mes treize valises, ne sachant où me réfugier. Treize heures plus tard à marcher sous la neige, j’échouai dans un hôtel du centre historique de la ville dont le concierge, après m’avoir signifié que je le dérangeais, me désigna une chambre certes pourvue d’un escabeau en forme de table, mais donnant sur une cour. De guerre lasse, je m’y posai, attendant d’autres désastres. Il y en eut tous les jours durant le mois sabbatique que je passai en ces murs d’une sournoise joliesse extérieure, jusqu’à ma rencontre d’Hitler.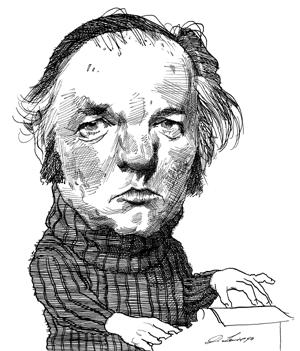


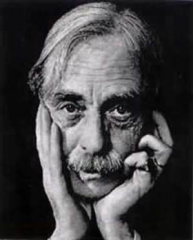



 Nous avons eu plusieurs fois cette discussion-là, parfois sérieusement aussi, et à chaque fois notre utopie se cassait la gueule, notre île implosait. On est tombé d'accord : il est agréable de rêver à des mondes tranquilles, immuables, mais ça ne marche pas. C'est là le gros problème d'Israël, cette volonté de vivre dans un monde qui serait parfait, qui serait clos, avec une population choisie. Ca peut sembler légitime, au départ il s'agit seulement de se tenir « loin des méchants ». Désir de contrôle, comme vous dites, qu'on porte tous au fond de soi, mais qui par essence ne connaît pas de limites, et qui finit par provoquer le pire. Je revois les images de ce sous-sol, que le père incestueux avait aménagé pour sa fille, une petite salle de bains, un lit, tout ce qu'il fallait. Dans sa tête à lui, c'était parfait aussi.
Nous avons eu plusieurs fois cette discussion-là, parfois sérieusement aussi, et à chaque fois notre utopie se cassait la gueule, notre île implosait. On est tombé d'accord : il est agréable de rêver à des mondes tranquilles, immuables, mais ça ne marche pas. C'est là le gros problème d'Israël, cette volonté de vivre dans un monde qui serait parfait, qui serait clos, avec une population choisie. Ca peut sembler légitime, au départ il s'agit seulement de se tenir « loin des méchants ». Désir de contrôle, comme vous dites, qu'on porte tous au fond de soi, mais qui par essence ne connaît pas de limites, et qui finit par provoquer le pire. Je revois les images de ce sous-sol, que le père incestueux avait aménagé pour sa fille, une petite salle de bains, un lit, tout ce qu'il fallait. Dans sa tête à lui, c'était parfait aussi.
 Créchant alors tout seul dans une petite maison de poète de l’arrière-pays, je me pointais tous les matins à sept heures et, tout en buvant notre première cafetière, nous reprenions la conversation de la veille exactement où elle s’était interrompue la veille. Pierre ne me parlait jamais de la couleur du ciel ou de la nature environnante, le temps n’existait pas plus que le monde environnant ou sa vie personnelle, qui était un chaos. Son maître était Pierre Larousse, c’était un rationaliste aussi absolu qu’était irrationnel le comportement de sa jeune maîtresse, alcoolique au dernier degré, planquant ses bouteilles un peu partout et que j’ai vu lui courir après toute nue en brandissant un couteau de boucher.
Créchant alors tout seul dans une petite maison de poète de l’arrière-pays, je me pointais tous les matins à sept heures et, tout en buvant notre première cafetière, nous reprenions la conversation de la veille exactement où elle s’était interrompue la veille. Pierre ne me parlait jamais de la couleur du ciel ou de la nature environnante, le temps n’existait pas plus que le monde environnant ou sa vie personnelle, qui était un chaos. Son maître était Pierre Larousse, c’était un rationaliste aussi absolu qu’était irrationnel le comportement de sa jeune maîtresse, alcoolique au dernier degré, planquant ses bouteilles un peu partout et que j’ai vu lui courir après toute nue en brandissant un couteau de boucher.