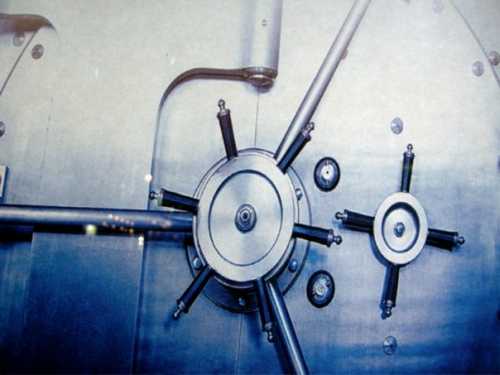Roméo et Juliette à Beyrouth: une nouvelle de Ritta Baddoura
Ritta Baddoura est une jeune poétesse libanaise. Cette nouvelle, premier texte en prose publié, constitua l'ouverture de la 68e livraison du journal littéraire Le Passe-Muraille en février 2006, après avoir obtenu le premier prix de littérature des Jeux de la francophonie. Ritta Baddoura avait ouvert à cette époque un blog où elle racontait sa vie quotidienne sous les bombes. On la retrouve aujourd'hui en pensée quotidienne avec les habitants de Gaza.
http://rittabaddouraparmilesbombes.chezblog.com
Quinze
La nuit, Selwa ne dort pas. Les lieux sont encombrés par les corps alourdis d’attente, impotents, que le rêve même déserte. Son corps à elle est gorgé de désir, sa peau tendue, presqu’écorchée par la vie qu’elle ne peut plus tenir à l’intérieur. Il y a trop de monde alentour: ses voisins, ses aïeux, père et mère, petite sœur et tous ses frères qui regardent. Stupéfaits ils se donnent à la peur qui gronde dans la gorge des canons. Il y a assez de morts. Ils encombrent les escaliers, même ceux qui respirent. Ne rien faire de tout cela. Juste s’ouvrir, fleur soudain écrasée par les coulées de lave. Attendre, les seins collés à l’écho, que la stridence encore s’abatte.
Sifflant tel un oiseau en feu, l’obus touche le sol.
- « Ce soir ils sont très proches », articule Hind. « Cela a dû éclater dans la vallée… ».
Peu à peu, dans l’odeur de poudre brûlée, s’infiltre l’haleine de l’aube et la tendresse tarie des fleurs d’orangers.
- « C’est ça. La vallée flambe » dit Aboulias. « Bientôt ce sera notre tour. Allah. Ya Allah. »
Il met son transistor en marche. Une rumeur s’élève de sa poitrine ruisselante, traverse les corps des veilleurs. Une voix grésille, égrène les noms de blessés et de décédés dans une région proche. Le parfum déchu des orangers persiste. Bûcher des arbres, tout crépite doucement.
Quelques déflagrations s’estompent dans le lointain. On dirait une fête étrange qui s’éteint dans une contrée voisine. Dernier cadavre de l’obscur : le silence s’abat dans sa robe de repentir.
Malkoun se lève. Il s’approche des sacs de sable. Il pousse le grand portail, traverse le rez-de-chaussée et sort de l’immeuble. Il inspire fortement les sutures de l’air, tâte sa poche, trouve son paquet de cigarettes. Il revient vers les sacs de sable et tend la tête vers l’intérieur.
- « Ça y est. Ils se sont arrêtés.»
Il éclate de rire : les dents sont blanches et les yeux petits et fatigués.
- « Je vais faire un tour. J’ai besoin d’un briquet. J’achèterai du lait en poudre pour les gosses, si j’en trouve ». A sa femme : « Je ne tarde pas Dada. Tu devrais sortir un peu aussi, hein ? pour le petit dans ton ventre. Il fait beau dehors… Les orangers ont cramé… »
Ses pas feutrés dans la cour de l’immeuble, crissement du verre pilé. A mesure qu’il s’éloigne, le jour se lève, pénètre jusqu’aux recoins de l’abri qui se vide au profit des hauteurs. Chacun regagne son étage : vérifier l’état des appartements, combien de vitres brisées, partager ce qui reste de fromage, œufs et confitures dans le placard. Douce torpeur de survie, il est difficile de retrouver les gestes familiers. Les meubles, les murs sont comme couverts d’une poussière invisible ; celle des sentiers ravagés par les herbes folles lorsque le temps n’y passe plus.
*
Engouffré dans son plumage, le canari ne prête guère attention à Selwa. Elle le pourvoit d’eau propre, accroche la cage au balcon. Son doigt tendu à travers les barreaux de bois frôle le tendre duvet de Prince. Lui parvient la voix de sa mère qui l’appelle. « Plus tard maman, je n’ai pas faim maintenant! ». Selwa entend profiter autrement de l’accalmie. Son cartable est là, contre le mur. Etendue sur la balançoire, elle feuillette ses livres d’écolière. Elle revoit son pupitre; et de son pupitre la mer : marge bleue derrière les toits de Beyrouth pressés à la fenêtre. La boîte de craies multicolores est peut-être encore sur le bureau de la maîtresse; que d’arc-en-ciels barrés pour dire les mois de captivité. Selwa se lève, sort de chez elle. Discrètement. Elle dévale les escaliers vides. Dehors, la journée est étrangement calme. Il y a des flaques de soleil partout.
Nassim habite dans la rue parallèle. Chez lui, il n’y a pas d’abri. Il vient souvent avec les siens se réfugier dans le sous-sol de l’immeuble où demeure Selwa. C’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Ils ne s’étaient jamais croisés auparavant. Il y a, dans la chambre de Nassim, tout un monde. Des déserts se déroulent à perte de vue, des sources vives jaillissent dans les paumes de Selwa lorsqu’elle y pénètre. Pénombre. Nassim est là. Il regarde un film : sur l’écran, deux épaules. L’une claire, l’autre sombre sont comme couvertes de sueur. Fine nappe d’amertume, une voix de femme murmure: «… Hiroshima se recouvrit de fleurs. Ce n’étaient partout que bleuets et glaïeuls, et volubilis et belles-d’un-jour… ». Selwa pousse aussi et récemment, l’humeur des coquelicots a envahi son entrejambe. Elle n’en a parlé à personne. Même les racines des arbres sont en sang et les hommes, surtout ceux qui tombent, ignorent tout à propos de cela. Nassim parle doucement, de la rencontre de ces deux étrangers, de l’amour qui est en train de naître. Selwa répète : « Hiroshima », comme une olive noire gorgée d’huile se dissout dans la bouche. Les visages du japonais puis de la française envahissent l’écran, collision. Combien y a-t-il de temps d’un grain de peau à un grain de terre ?
Nassim pose sa tête sur les genoux de Selwa. Elle aussi a un peu sommeil. Elle laisse ses doigts errer lentement sur son visage. Elle veut l’apprendre, déchiffrer son mystérieux langage, en garder le sens aux extrémités d’elle-même.
Qu’ils sont lisses et blancs ces os bien ordonnés sur les tables rectangulaires. Des centaines d’os alignés comme pour la prière. Selwa effleure ces navires immobiles sur une mer de bois. Elle regarde autour d’elle : grande salle aux murs hauts presque vacillants. Par la fenêtre, le sol est rouge aux pieds d’un baobab en fleurs. Elle ne peut penser qu’à la chaleur qui pèse sur le silence. Sous la chaux, les murs criblés de cris, de regards tuméfiés se dressent dignement et la plaine dehors semble immense. Selwa choisit deux os longs et fins et se dirige vers la porte. Il y a un tabouret, posé seul, sous le soleil tout-puissant, qui l’attend. Elle s’assied, écarte les jambes, saisit le manche de l’instrument. Sa tête se penche et ses cheveux sombres le long de l’os s’accordent. Frottement de l’archet presque vivant contre les mèches grinçantes. A mesure que le son s’élève, l’air exhale un étrange parfum. Le baobab pleut et la terre à ses pieds est un cimetière.
Les sens de Selwa, peu à peu, s’engourdissent. Elle a beau remuer son archet, elle n’entend plus rien. Ses yeux sont trop étroits pour l’arbre gigantesque, sa peau trop fine pour ce manteau de morts. Seul, l’ordre des os est immuable. Ses yeux clos l’emprisonnent, des branches noires effractent ses paupières. Elle n’échappera pas à ce voyage. Ce lieu désormais la possède. Jusques dans les recoins de sa gorge où le souffle gît inanimé. Ce cri qu’elle ne pousse, l’écartèle. C’est lui qui lui donne naissance, c’est à lui qu’elle doit sa vie. Mais il faut qu’il sorte, il faut pousser au risque de briser les cordes, il faut hurler tout ce noir. Il ne faut que les hyènes abattent la gazelle. Il n’y a plus de place sur les tables.
- « Selwa ?… je suis là. Doucement, oui Selwa, oui, doucement… » chuchote Nassim contre son visage.
Elle se sent comme aspirée par un point lumineux, du fond d’un puits humide, jusqu’à la surface. Elle ouvre ses paupières. Les yeux de Nassim plongent dans les siens. Son rêve est encore tapi dans la pénombre. L’ombre géante du baobab règne. Baisers contre sa joue, creux du poignet, rondeur d’épaule, Nassim l’étreint tendrement. Ils restent là, sans rien dire, pour un moment. L’écran affiche le générique du film. Bientôt il lui faudra rentrer chez elle. Elle a promis d’aider son père à classer les vieux journaux cet après-midi. Il y a aussi le rendez-vous chez Hind qui a invité tout le monde pour une limonade sur la terrasse. En sortant de l’abri ce matin, elle a lancé de sa voix un peu cassée :
- « Je vous attends tous, hein ? pas d’excuses…il y aura des petits g¬âteaux et de la musique ».
Selwa sourit à l’idée de voir Hind remuer, un verre de limonade glacée à la main, au rythme langoureux de vieux succès orientaux. Elle mettra probablement sa robe fleurie, rouge et jaune, qui découvre sa poitrine opulente couverte de médailles miraculeuses.
- « Arrange ces beaux cheveux Selwa et mets quelque chose de spécial » lui a-t-elle dit.
Puis sur le ton de la confidence :
- « Ta mère devrait te maquiller un peu, ce n’est pas tous les jours la fête. Ton amoureux sera là, n’est-ce-pas ? j’ai tout remarqué dès le premier jour…rien n’échappe à Hind, petite! Tu viendras, dis ? »
- « Je viendrai, Tante Hind. Je n’ai jamais raté l’occasion de déguster tes patisseries, tu sais bien que je les aime tant ! ».
Selwa aime surtout se retrouver chez Hind au crépuscule. Elle a souvent pensé que, du haut de sa terrasse, le soleil met plus de temps pour se coucher.
* *
Vue de la terrasse, la vallée offre les corps pétrifiés des orangers en partage. L’horizon en rappelle les teintes ardentes, sanglots écorchés au large de la Méditerranée. Selwa observe les silhouettes qui dansent ; des enfants mangent encore à la table garnie. Le gros rire de Hind ponctue ses allées et venues entre les convives. S’approchant de Selwa, elle vante avec ferveur les délices de la glace musquée fabriquée ce matin. Quelques voisins discutent bruyamment de politique dans un coin. Du fond de la vallée, la petite rivière continue, invisible, d’avancer. Le son clair et perlé de son gosier résonne, porté par les causeries irrégulières de quelques grenouilles. Les touffes odorantes de basilic et de menthe, bordant la balustrade, baignent les premières humeurs du soir. Sous leur habit de chair, les cœurs sont tristes et inquiets. L’heure des autres retrouvailles, celles qui durent toute une nuit dans l’abri, approche.
- « Selwa ! je vais avec Malkoun acheter quelques paquets de bougies. Il n’y en a pas assez pour ce soir. Tu nous accompagnes ? » lance Nassim.
- « Il n’en est pas question! » riposte le père de Selwa . « Il fait déjà assez sombre, les routes ne sont pas sûres…Tu achèteras des bougies demain Malkoun ».
- « Bah, la journée a été calme » répond Malkoun avec sa bonhomie habituelle. « Nous allons chez Hanna, c’est à deux pas. Le magasin doit être encore ouvert à cette heure-ci…ça nous épargnera une veillée dans le noir jusqu’au petit matin. Allez Nassim, on y va ».
Selwa sirote son sirop de mûres. Elle pense que Malkoun a raison, qu’il est préférable d’avoir des bougies tant que le courant électrique reste coupé. Elle espère qu’il n’y aura pas de grand danger cette nuit. Elle essaiera de s’endormir, même si les matelas posés à même le sol, ne sont pas confortables. « On a moins peur quand on dort » lui avait confié sa petite sœur.
Selwa imagine les clichés qui ont porté le visage déchiqueté de son pays sur les écrans télévisés du monde. Au sein de tant de violence, il reste à Beyrouth un toit perdu, parmi tant d’autres, où Nassim peut inviter Selwa à danser. Elle répète à mi-voix leurs deux prénoms : « Nassim et Selwa ». La musique s’est maintenant arrêtée, on débarrasse la table, c’est presque l’heure du couvre-feu.
Des tirs éclatent soudain.
- « Cela n’a pas dû se passer très loin d’ici » énonce faiblement Hind.
L’angoisse envahit les lieux, les cœurs haletants se froissent. Un bruit de pas sourds au bout de la rue puis une ombre émane brusquement de la pénombre, arrive péniblement jusqu’au parking de l’immeuble. Un râle puissant s’élève :
- « Ils l’ont eu ! à moi, à l’aide ! ils nous ont tiré dessus, salopards de francs-tireurs ! je l’ai laissé par terre… »
- « C’est la voix de Malkoun. Malkoun ! mon chéri ! » hurle sa femme, dégringolant les escaliers.
- « Nassiiim… » sanglote Malkoun, l’épaule blessée ; « je n’ai rien pu faire, je l’ai abandonné mort par terre. Nassiiiim ! salopards ! salopards ! saloperie de bougies. Tout est de ma faute, ma faute à moi ! le gosse est mort à cause de moi ».
Les femmes s’assemblent autour d’Oum Nassim. Elle frappe, les yeux révulsés, sa poitrine. Elle frappe fort de ses poings fermés. Les femmes la soutiennent. Selwa n’entend plus rien. Elle se souvient surtout d’Abou Nassim, d’Aboulias et de son fils Elias sortant de l’immeuble en courant, se fondant dans l’obscurité. Elle a dans la tête un point incandescent, un caillou dur avec plus rien autour. Il lui suffit de bouger un peu la tête pour le sentir rouler lourdement.
* * *
Pendant bien des années, Selwa a porté ce caillou en elle et à ses mains deux os longs et lisses et blancs. Des immeubles hauts et laids, une fumante usine, ont poussé depuis dans la vallée, mais la petite rivière roucoule encore. Fraîcheur nocturne de mai, Place des Martyrs : Selwa sourit au public.
- « Combien y a-t-il de temps d’un grain de peau à un grain de terre ? quelle idée Selwa ! » s’était exclamé Nassim. « Attends, je crois savoir : quinze…quinze jours peut-être… »
- « Pourquoi quinze ? »
- « Comme ça…parce qu’il a fallu quinze jours, après le nuage atomique, pour que Hiroshima se recouvre des plus belles fleurs ».
Selwa prend place, se penche sur son violoncelle. Les sons qu’elle égrène coulent jusqu’à la mer, brodent autour de Beyrouth une robe de menthe sauvage et de fleurs d’oranger. Lorsqu’elle finit de jouer, les applaudissements éclatent. Selwa tremble un peu en saluant. Selwa sourit encore. Il lui semble, du bout des lèvres, confusément retrouver une olive noire en sa saveur étrange.
R.B



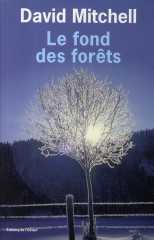 Doux oiseau d’adolescence
Doux oiseau d’adolescence Mon père, cette énigme…
Mon père, cette énigme… Au cœur de l’humain
Au cœur de l’humain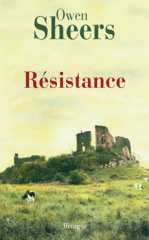 Owen Sheers. Résistance. Traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner. Rivages, 411p.
Owen Sheers. Résistance. Traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner. Rivages, 411p.

 Condamné sans sursis à subir les rincées, en fuite sur mon vélo, poursuivant des moinelles aux virevoltes culbutées et chahutées par les rafales, je cherche refuge dans l’abri de mes amis Sans-logis situé au dessous des structures lourdes et inquiétantes de l’A 4. Longeant à contresens le flux régulier des huit pistes bouchonnées par les multiples candidats aux Castorama et Mammouth du coin, je surgis à bout de souffle et trempé dans le trou béant, sous le courant incessant des bagnoles.
Condamné sans sursis à subir les rincées, en fuite sur mon vélo, poursuivant des moinelles aux virevoltes culbutées et chahutées par les rafales, je cherche refuge dans l’abri de mes amis Sans-logis situé au dessous des structures lourdes et inquiétantes de l’A 4. Longeant à contresens le flux régulier des huit pistes bouchonnées par les multiples candidats aux Castorama et Mammouth du coin, je surgis à bout de souffle et trempé dans le trou béant, sous le courant incessant des bagnoles. Le départ de ses voisins de cloche l’a laissé face à face avec une solitude trop ample à vivre pour lui seul. Ces jours ici, avec cette météo plus personne ne passe sur le quai. Pour la manche c’est comme pour le mercure proche du dessous de zéro.
Le départ de ses voisins de cloche l’a laissé face à face avec une solitude trop ample à vivre pour lui seul. Ces jours ici, avec cette météo plus personne ne passe sur le quai. Pour la manche c’est comme pour le mercure proche du dessous de zéro. Il est debout. Parfois un cartable sous le bras contenant une bibine d’alcool fort. Il est debout. Il sourit quand on le salue ou qu’on lui adresse une pièce ou la parole. Il est debout. Il répond dans un sabir indéchiffrable rappelant un anglais lointain. Il est debout. Au milieu de la nuit il disparaît. Le matin on peut le retrouver à l’entrée ouest de l’Allée Marc Chagall. Il est debout. Et ainsi de suite années après années. Il est debout. Nul ne peut dire s’il se souvient quand il est apparu dans notre entourage pour la première fois. Il est debout. Sans doute il y a longtemps. Il ne manque jamais un jour. Toujours debout. Sentinelle de lui même.
Il est debout. Parfois un cartable sous le bras contenant une bibine d’alcool fort. Il est debout. Il sourit quand on le salue ou qu’on lui adresse une pièce ou la parole. Il est debout. Il répond dans un sabir indéchiffrable rappelant un anglais lointain. Il est debout. Au milieu de la nuit il disparaît. Le matin on peut le retrouver à l’entrée ouest de l’Allée Marc Chagall. Il est debout. Et ainsi de suite années après années. Il est debout. Nul ne peut dire s’il se souvient quand il est apparu dans notre entourage pour la première fois. Il est debout. Sans doute il y a longtemps. Il ne manque jamais un jour. Toujours debout. Sentinelle de lui même.





 Tchatche ou crève, de Dorota Maslowska, au Cabaret Tastemot. Découverte de l'enfant terrible de la nouvelle littérature polonaise. Suivie d'une rencontre avec Vera Michalski.
Tchatche ou crève, de Dorota Maslowska, au Cabaret Tastemot. Découverte de l'enfant terrible de la nouvelle littérature polonaise. Suivie d'une rencontre avec Vera Michalski.
 iante. J’ai pourtant gardé la confiance de Daniel Arsand, directeur de collection, et ma nouvelle directrice, Helène Amalric, travaillera dans la continuité du catalogue de Phébus. Sicre n’est pas le premier « fondateur » à mal vivre la fin de son aventure !
iante. J’ai pourtant gardé la confiance de Daniel Arsand, directeur de collection, et ma nouvelle directrice, Helène Amalric, travaillera dans la continuité du catalogue de Phébus. Sicre n’est pas le premier « fondateur » à mal vivre la fin de son aventure ! ivres difficiles à vendre, malgré leur qualité littéraire, soient « aidés » par des ouvrages de plus large intérêt public. Je ne suis pas contre les « coups » éditoriaux, mais ce n’est pas ma priorité. En fait, je continue à faire de l’édition comme j’y suis venue avec Ian, par goût, par curiosité, par plaisir et en essayant de propager cette passion.
ivres difficiles à vendre, malgré leur qualité littéraire, soient « aidés » par des ouvrages de plus large intérêt public. Je ne suis pas contre les « coups » éditoriaux, mais ce n’est pas ma priorité. En fait, je continue à faire de l’édition comme j’y suis venue avec Ian, par goût, par curiosité, par plaisir et en essayant de propager cette passion.