



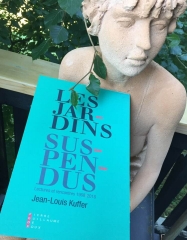
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.




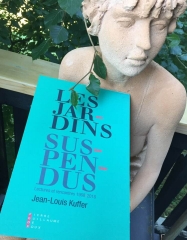

Il se passe de drôles de choses dans les vestiaires de l’usine à glottes de tulipes.
- Surtout dans les vestiaires Messieurs, précise le délateur dont personne ne sait qu’il collectionne les revues spéciales.
Madame la Directrice ne montre rien de son vif intérêt.
- Continuez, Monsieur Thielemans.
- Les jardiniers s’attardent aux douches. On dit qu’il peut y en avoir jusqu’à des équipes entières. Cela fait beaucoup de savon.
Madame la Directrice sent maintenant qu’elle le tient.
- Ne me cachez rien, Thielemans.
- Ils se massent. Parfois il se mêlent aux impubères et se livrent à des concours. C’est dégoûtant.
- N’avez-vous rien oublié, Thielemans, interroge encore la directrice du personnel en fixant sévèrement le jeune complexé qui, tout à coup, rosit comme une très jeune fille des cantons de l'Est.
C’est ainsi que Thielemans se coupe et que Madame la Directrice en fait sa chose.
Sous les dehors d'un clochard atrabilaire, c'était un écrivain raffiné. À lire, réédité en 1986 : son Journal littéraire, et l’évocation de ses rencontres avec Pierre Perret. Ou encore deux joyaux : Le petit ami et In memoriam. Entre autres…
S’il appartient en somme à la catégorie des grands écrivains mineurs qui ne seront jamais reconnus — mais alors avec passion — que par un nombre relativement modeste de lecteurs, au même titre qu’un Fargue ou qu’un Jouhandeau, qu’un Vialatte ou qu’un Cingria, Paul Léautaud n’en connut pas moins la célébrité de son vivant, et ce presque à son corps défendant, par le truchement d’entretiens radiophoniques avec Robert Mallet dont la diffusion, de novembre 1950 à juillet 1951, obtint un succès phénoménal.
 Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .
Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .
Rappelons à ce propos que Léautaud cohabitait en permanence avec une vingtaine de chiens et une trentaine de chats, tous recueillis sur la rue, et qu’il leur a consacré des pages mémorables.
Clarté et naturel
Cela étant, il serait aussi imbécile de se limiter à cette image pittoresque de l’écrivain que de monter en épingle ses pages de libertin, comme s’y sont complaisamment employés d’aucuns l’an dernier, à la parution du Journal particulier évoquant les relations intimes de l’écrivain avec l’indispensable Marie Dormoy ou avec sa maîtresse principale dite Le Fléau. En fait, les « séances » érotiques, assurément très crues (Léautaud, comme toujours, appelle un chat un chat) que l’écrivain consigne dans les marges de son journal, sont plutôt rares, et n’ont d'intérêt que par rapport à l’ensemble de ses observations et, plus encore, à l’économie de son écriture.

« Rien n’a plus de prix pour moi que la netteté, la concision, et c’est si difficile de n’être pas littéraire, le premier mérite à mes yeux », notait- il ainsi tout en reconnaissant qu’il avait « toujours vécu littérairement ».
Un monde en spectacle
Pourtant, que le titre du Journal littéraire de Paul Léautaud n’abuse pas le lecteur, qui lui offre, avec ses quelque 6000 pages, un aperçu de ce que fut la vie a Paris — et non seulement dans le milieu des écrivains —entre 1893 et 1956.


Mais tant qu’à découvrir Paul Léautaud, n’en restez donc pas là. Lisez ses savoureuses chroniques théâtrales (d’admirables pages sur Molière et Shakespeare, notamment), parues chez Gallimard sous le pseudonyme de Maurice Boissard ; lisez Le petit ami, évoquant ses tribulations de garçon abandonné par sa mère ,que les grisettes et les trottins consolent ; enfin lisez illico In memoriam, son chef-d’œuvre qu’il griffonna au chevet de son père à l’agonie, et où l’on trouve la clef de sa personnalité profonde alors que, feignant le cynisme, il observe son paternel "en train de décéder un peu plus"...
 Alceste et Pierrot
Alceste et Pierrot
Pierre Perret avait 20 ans lorsqu’il se pointa, pour la première fois, au portail de la maison délabrée de Léautaud, à Fontenay-aux- Roses. Or il fallait une certaine candeur pour débarquer ainsi chez le vieux misanthrope, d’autant que notre Pierrot lunaire ne connaissait alors, de l’écrivain, que ses fameux « Entretiens ». Cependant sa naïveté, son air pataud et sa ferveur de provincial découvrant Paris, ainsi que leur amour commun de la poésie et du théâtre, auront fait passer aussitôt un courant de complicité entre le jeune artiste et l’écrivain dissimulant son extrême sensibilité sous des allures revêches. À cet égard, le mérite de Pierre Perret est d’avoir perçu, bien mieux que tant de pontes condescendants, que «cet homme pauvre recelait une richesse intérieure insoupçonnée, inconnue de la plupart. Une générosité qu’il dissimulait soigneusement aux yeux de la minorité qui l’approchait. »
La générosité de Léautaud, on la remarque ici dans la curiosité sincère qu’il manifeste envers son jeune visiteur (qui le ravit aux anges en lui révélant les chansons de Brassens) ou quand il l’accompagne un jour dans les librairies du Quertier latin afin del’aider à se constituer un début de bibliothèque.
Hommage amical tout imprégné d’intelligence du cœur, Adieu Monsieur Léautaud est, au surplus, une évocation très vivante de l’écrivain au naturel, sans chichis ni flatterie aucune.
Paul Léautaud, Journal littéraire. Mercure de France, 1986. Entretiens avecRobert Mallet - Le petit ami - In memoriam, Passe-temps, etc. Au Mercure de France.
PierrePerret, Adieu Monsieur Léautaud. Lattès, 1987.
Contrepoint,ce 22 mai 2015.
J’ai découvert le Journal littéraire de Léautaud dans la bibliothèque de la mansarde parisienne que mon ami Germain Clavien m’avait prêtée quelques mois durant, en 1974, rue de la Félicité, dans le quartier des Batignolles. Je gagnais alors un peu de sous en dactylographiant le monumental Journal intime d’Amiel, et je nourrissais une vraie passion pour l’œuvre de Charles-Albert Cingria, qui rencontra maintes fois Léautaud dans le salon de Florence Gould. Si Charles-Albert fut généreux (non moins que lucide) à l’endroit de son pair alcestueux, au point de lui consacrer d’inénarrables portraits (le comparant notamment à une antique tortue broutant sa salade), Léautaud fut plus acerbe,voire injuste, dans son Journal littéraire, à l’égard de ce drôle d’oiseau des îles que figurait à ses yeux Charles-Albert. Après la mort de Cingria, Marcel Jouhandeau évoqua la belle paire qu’il observa lui-même chez dame Gould. Pour ma part, je relis toujours ces trois auteurs avec un égal plaisir.
(Ce texte a paru dans Le Matin en date du 12 février 1987)
À propos de l'auberge espagnole shakespearienne et des multiples entrées du Globe. L'éclatant fronton de Denis Podalydès et la dégaine de tartare du Macbeth d'Orson Welles. La chape des puritains et le recyclage du politiquement correct.
Lire Shakespeare, à tous les sens du terme, autrement dit en déchiffrer les 37 pièces et les monter aussitôt imaginairement ou en 3D si l'on est Peter Brook, relève d'une expérience vitale qui échappe à toutes les écoles et tous les snobismes, à toute revendication nationale ou toute récupération politique ou idéologique, étant entendu (dixit Peter Brook lui-même) que le Barde déploie "une réalité faisant concurrence à notre réalité ", non pas en proposant un point de vue sur le monde mais en nous ouvrant un monde en lequel on voit mieux jusqu'à la plus impénétrable obscurité du monde, évoquée par une poésie à multiples voix.
Denis Podalydès.
Un acteur français peut-il comprendre cela ? Certes il le peut aussi bien qu'un savetier japonais ou qu'un pêcheur norvégien ou qu'une pharmacienne sarde: la preuve rutilante en est donnée par l'inapprecuable commentaire du comédien-auteur-lecteur Denis Podalydes, dont l'introduction au mirifique Album de la Pléiade paru en mars 2016, donc pile 400 ans et quelques minutes après la mort probablement certaine de Shakespeare, est à citer texto: "La lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen que seules permettent les très grandes œuvres. On y fait l'expérience de l'Histoire, du temps et de la diversité humaine, dans le sentiment exaltant de reconnaître l'un ou l'autre d'entre nous, soi-même enfin, d'exister et de se mouvoir dans une réalité objective dotée de toutes les contradictions, tant la vie de ces personnages, rois, princes, clowns, paysans, soldats, bourgeois, esprits, créatures mythologiques, hommes et femmes formant la plus hétéroclite des populations, nous point, nous déborde, nous bouleverse, nous emporte. Au détour d'une scène ou d'une réplique, à la Cour, sur un champ de bataille, dans une taverne, au Danemark, en Ecosse ou à Venise, dans la forêt d'Ardenne ou dans une île imaginaire, nous sommes saisis par un détail, une image, un trait qui ont à la fois la saveur immédiate du réel et là subtilité immatérielle de la poésie ".
C'est entendu: tout le monde aujourd'hui à une opinion et se croit obligé de la produire illico sur Twitter. Mais une opinion n'engage à rien sans examen patient et précis de l'objet. Parler de Shakespeare ou de Proust fait peut être chic dans les salons ou les réseaux sociaux qui en sont un nouvel avatar plus chaotique, mais cela n'a pas plus de sens que de n'en rien savoir et le dire tranquillement vu qu'on a déjà sa vie à vivre. Or Shakespeare est précisément la vie qu'on est en train de vivre ou plus exactement le miroir à la fois externe et intérieur que nous traînons depuis toujours le long de notre bonhomme de temps, de notre enfance ultrasensible et jusqu'à notre mort tout à l'heure.
Tolstoi à proféré l'opinion la plus stupide, même pas digne d'un perroquet numérique, en affirmant qu'il donnerait tout Shakespeare pour une paire de bottes nécessaire à un moujik va- nu-pieds. C'est dire que le cher comte ignorait que les gueux qui assistaient à Londres aux spectacles gratuits des scènes ouvertes construites à côté des bordels et parfois avec passages communicants, comprenaient Shakespeare sans avoir appris le russe.
Ainsi que le rappelle encore Denis Podalydes dans cet indispensable Album, l'histoire des théâtres construits dans les quartiers populaires, au temps de Shakespeare & ci, est indissolublement liée à une production d'époque florissante, en concurrence-opposition directe avec l'Université et l'Eglise, et s'explique autant alors le pseudo mystère de l'immense savoir humain et juridique, moral ou politique, littéraire ou théâtral (au sens de l'artisanat) de Shakespeare, et son succès phénoménal d'auteur bientôt capable d'offrir à ses enfants des play stations dernier cri.
Dans la version d'Orson Welles, Macbeth à la dégaine d'un cavalier tartare et le film semble russe à outrance, mais l'essentiel est là, contrairement à ce qu'ont prétendu les philistins américains ou français à la sortie de ce film "maudit" , et l'essentiel n'est pas moins totalement ressaisi par Akira Kurosawa dans Le château de l'araignée.
La réception de Shakespeare selon les époques en dit plus long sur celles-ci que sur celui-là. Je ne dirai pas que je donnerai tout le puritanisme anglais pour une pièce de Shakespeare, pas plus que celui-ci n'est anticlérical au sens des nouveaux réducteurs de têtes, mais le fait est qu'une terrible chape a pesé sur cette œuvre à mes yeux vitale et même "sainte" en sa profonde bonté, comme le calvinisme en nos régions, avec l'appui massif du Pasteur et du Pion, a congelé les imaginations et surveillé les conduites publiques et privées jusqu'à brûler des corps et traiter des âmes à l'électrochoc. Shakespeare, pas plus que Rabelais d'ailleurs, n'est pourtant obscène ni subversif sauf à s'opposer moralement et politiquement à l'obscénité et au terrorisme étatique des hypocrites et des imposteurs.
Il m'a fallu à peu près un demi-siècle, durant lequel j’aurai vu des quantités de versions de nombreuses pièces du Barde, pour découvrir la simplicité profonde d'une œuvre ressaisissant la complexité humaine dans un langage que ses multiples registres font parler à tous au gré de ses degrés, et sa communicative vitalité. Oui, comme le dit Denis Podalydès, “la lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen” et demain je passerai des tragédies aux comédies, à la rencontre à Venise de Shylock, tout en ne cessant de multiplier les regards latéraux sur le théâtre du monde...

Le Voyage de Bashô, de Richard Dindo.
Avant-première ce mardi 2 avril au cinéma Capitole, à 20h.30, à Lausanne, à l'enseigne de la Cinémathèque suisse
Tenant de l’élégie lyrique, du récit de voyage semé d’incantations contemplatives ou du journal de bord «en miroir», le dernier film de Richard Dindo, après son adaptation mémorable d’Homo faber de Max Frisch, «sonne» plus personnel que ses ouvrages précédents en cela que le réalisateur zurichois, auteur lui-même d’un monumental journal intime rédigé en français, arrive lui aussi à l’âge des bilans, comme le vieux poète Bashô (1644-1694), maître japonais du haïku qui s’est retiré depuis une décennie de la vie publique pour mener une vie d’errance et de méditation.

On sait ce qu’est un haïku, poème bref concentrant en trois vers une image qui oppose, sur fond de sérénité, un subit éclair fixant l’instant, par exemple: «De temps en temps / les nuages nous reposent / de tant regarder la lune», ou bien: «Devant l’éclair / sublime est celui / qui ne sait rien», ou encore: «Dans le vieil étang / une grenouille saute / un ploc dans l’eau».
Ces «minutes heureuses», ou parfois mélancoliques, lues par Bernard Verley, ponctuent un parcours où Matsuo Bashô apparaît (sous les traits de l’acteur Kawamato Hiroati) comme une sorte de moine laïc, juste pourvu de son nécessaire à dormir et écrire, et dans les pas duquel nous cheminons de rivages en monts perdus, de forêts de bambous en temples vénérables, en double symbiose avec la nature et avec la parole du poète, d’une simplicité et d’un naturel parfaits.

Il retrouvera en chemin des amis et des disciples, il se liera d’amitié profonde avec un autre pèlerin plus jeune, il regardera des enfants jouer et des courtisanes se recoiffer, il s’interrogera sur le sens de tout ça et surtout il fera de tout un poème.

«En matière d’art, notera-t-il en passant, il importe de suivre la nature créatrice, de faire de ses quatre saisons des compagnes, pour chasser le barbare, éloigner la bête». Pas un instant cependant il ne posera ou pontifiera, nous précédant sur son cheval ou s’épouillant sur sa couche d'été, rendant grâces aux fleurs ou saluant une araignée, un papillon, un femme en train de lavec des pommes de terre dans la rivière, et la lune là-haut («Rien dans ce monde / qui se compare / à la lune montante») ou l’arrivée de la neige («Matin de neige / Tout seul je mâche / du saumon séché») avant le retour du printemps et le prochain automne scellant le passage du temps non sans humour: «Année après année / le singe arbore / son masque de singe»…

Littérature filmée? Absolument pas: rien que du cinéma dans ce Voyage de Bashô, ou plus précisément de la poésie de cinéma qui fait rimer image et cadrage, et montage et sublime «bruitage» d’un automne à l’autre, jusqu’à la fin sereine et triste à la fois («Rien ne dit / dans le chant de la cigale / qu’elle est près de sa fin»), mais là encore la nature inspire le poète, et cette fois c’est Richard Dindo, prenant le relais de Bashô, qui montre la lune ronde se fondre dans la nuit…


Celui qui se rappelle les hauts de sa ville vers 1963-1973 quand des centaines de stoppeurs s'alignaient chaque jour le long de la route de l'Est destination Florence ou Katmandou / Celle que des tas de mecs ont embarquée à l'époque sans la violer ni même la décapiter / Ceux que tu as retrouvés d'Amsterdam à Vienne et de Pise à Delos / Celui qui a voulu te convertir à la mouvance Hare Krishna au motif que tu l'avais embarqué dans ta 2CV qui doit encore puer le santal et la sueur de pieds / Celle qui a profité de ta distraction pour te faucher ton portefeuille entre Schleswig et Holstein / Ceux qui parlaient politique à poil au bord du lac de Trasimène à l'époque de Pasolini et des Brigades rouges / Celui qui a attendu 7 heures au bord de l'Autoroute du Sud avec son ami grimpeur Anicet en compagnie duquel il s'est ensuite éclaté dans la calanque d'En Vau sur les voies de Vsup / Celle qui a mis du noir aux lèvres pour flasher les routiers punkophiles / Ceux qui ont trouvé refuge dans une container de maquereau au péage de Marseille / Celui qui a traversé l'Andalousie à l'époque de la Movida / Celle qui a rencontré des tas d'amants possibles sur la route du stop mais a dit stop le plus souvent / Ceux qui se reprochent quelques occasions manquées / Celui qui a beaucoup appris en lisant sous les ponts / Celle qui n'a jamais cédé aux sirènes des ambulanciers / Ceux qui sont morts dans l'Europe-Express alors que le stop est si sûr / Celui qui n'est pas monté dans le Van noir du sadique en sweat rilax dont on a vu le faciès sur les tabloïds /
Celui qui a attendu 7 heures au bord de l'Autoroute du Sud avec son ami grimpeur Anicet en compagnie duquel il s'est ensuite éclaté dans la calanque d'En Vau sur les voies de Vsup / Celle qui a mis du noir aux lèvres pour flasher les routiers punkophiles / Ceux qui ont trouvé refuge dans une container de maquereau au péage de Marseille / Celui qui a traversé l'Andalousie à l'époque de la Movida / Celle qui a rencontré des tas d'amants possibles sur la route du stop mais a dit stop le plus souvent / Ceux qui se reprochent quelques occasions manquées / Celui qui a beaucoup appris en lisant sous les ponts / Celle qui n'a jamais cédé aux sirènes des ambulanciers / Ceux qui sont morts dans l'Europe-Express alors que le stop est si sûr / Celui qui n'est pas monté dans le Van noir du sadique en sweat rilax dont on a vu le faciès sur les tabloïds /  Celle qui n'a jamais lâché son tricot pendant les trajets même quand le type lui demandait de le sucer / Ceux qui préfèrent l'Oldsmobile à la Topolino pour des questions de commodité / Celui qui a apris à décrypter les profils droit / Celle qui a bien aimé partager l'ordinaire des routiers / Ceux qui ont fait des feux de camps sympas avec les routiers-c'est-sympa / Celui qui a pêché le Verdon dans le Gardon ou le contraire tant le mec à la Vodka lui a avait fait siffler de l'Alfa ou le contraire / Ceux qui ont participé en bandes au sauvetage de Florence cette année-là /
Celle qui n'a jamais lâché son tricot pendant les trajets même quand le type lui demandait de le sucer / Ceux qui préfèrent l'Oldsmobile à la Topolino pour des questions de commodité / Celui qui a apris à décrypter les profils droit / Celle qui a bien aimé partager l'ordinaire des routiers / Ceux qui ont fait des feux de camps sympas avec les routiers-c'est-sympa / Celui qui a pêché le Verdon dans le Gardon ou le contraire tant le mec à la Vodka lui a avait fait siffler de l'Alfa ou le contraire / Ceux qui ont participé en bandes au sauvetage de Florence cette année-là /  Celui qui n'a jamais répondu aux avances des bourgeoises en manque que voulez- vous cruelle est la jeunesse / Celle qui a fait un peu de voltige dans les roulottes des trapézistes ambulants / Ceux qui ne pensent pas que jeunesse jamais passera / Celui qui fait encoreunpeu de stop dans les vallées reculées / Celle qui a savouré de l'émincé de stoppeur sans s'en douter tant la sauce du Hell's Angel texan était relevée / Ceux qui ont perdu le goût de la liberté en se la jouant libertins / Celui qui se fait arrêter pour avoir dépanné un gosse en retard sur le chemin de l'école / Celle qui voit le mâle partout / Ceux qui estiment que forcément une stopeuse est une pute et un stopeur forcément un pédé / Celui qui continue de lever lepouce sur Facebook / Celle qui se fait encore quelques bons moments comme ça / Ceux qui espèrent que ça reviendra avec la Toute Grande Crise, etc.
Celui qui n'a jamais répondu aux avances des bourgeoises en manque que voulez- vous cruelle est la jeunesse / Celle qui a fait un peu de voltige dans les roulottes des trapézistes ambulants / Ceux qui ne pensent pas que jeunesse jamais passera / Celui qui fait encoreunpeu de stop dans les vallées reculées / Celle qui a savouré de l'émincé de stoppeur sans s'en douter tant la sauce du Hell's Angel texan était relevée / Ceux qui ont perdu le goût de la liberté en se la jouant libertins / Celui qui se fait arrêter pour avoir dépanné un gosse en retard sur le chemin de l'école / Celle qui voit le mâle partout / Ceux qui estiment que forcément une stopeuse est une pute et un stopeur forcément un pédé / Celui qui continue de lever lepouce sur Facebook / Celle qui se fait encore quelques bons moments comme ça / Ceux qui espèrent que ça reviendra avec la Toute Grande Crise, etc.


Rencontre avec Richard Dindoen 2006. À ne pas manquer: la projection de son dernier film, peut-être son chef-d'oeuvre, Le Voyage de Bashô, au cinéma Capitole de Lausanne, le 2 avril à 20h.30.
L’œuvre de Richard Dindo, riche de plus de vingt films, est à la fois très actuelle et « travaillée » par une (re)lecture extrêmement sensible de vies du proche passé, le plus souvent rebelles, du « traître à la patrie Ernst S. » à Che Guevara, ou des combattants suisses dans la guerre d’Espagne aux étudiants contestataires massacrés au Mexique. Si Dindo a participé à la mouvance du cinéma engagé dans l’esprit de mai 68, ses films ne se sont jamais bornés pour autant à cette dimension politique.

L’émotion liée aux destins humainement ou artistiquement exemplaires (Paul Grüninger le sauveteur de Juifs ou Charlotte la merveilleuse imagière déportée, et Max Frisch, Rimbaud ou Kafka, Genet ou le Matisse d'Aragon), la défense de valeurs fondamentales et l’affirmation d’un langage personnel spécifiquement cinématographique, où le sens et la beauté fusionnent, marquent également le travail de ce maître du documentaire qu'il dit lui-même « épique ».

- Quel a été votre premier rêve de cinéma ?
- Je peux dire que je suis un enfant de la littérature et du cinéma. Autodidacte, je me suis fait grâce aux livres, aux films...et aux femmes. J’ai commencé de lire vraiment vers douze ans, pratiquement seul au monde. Ma mère avait quitté la famille, mon père ouvrier n’était jamais présent. Je ne pense pas avoir échangé plus de trente ou quarante phrases avec lui de toute ma vie. Mon cinéma est d’ailleurs marqué par l’absence paternelle. J’étais donc seul, avec un frère, dans une maison vide, et je me suis fait tout seul. C’est ma faiblesse et ma fierté. J’ai donc lu La Guerre et la Paix de Tolstoï à douze ans. A seize ans, j’ai découvert Proust dans une librairie d’occasion. Je vivais dans une maison de jeunes où nous touchions 15 francs d’argent de poche par mois. Je suis tombé sur un texte qui s’intitulait Combray, qui m’a tout de suite fasciné par l’écriture, et je suis assez fier, moi qui n’était qu’un fils d’ouvrier, d’avoir compris cette écriture dont la musique n’a cessé de me hanter depuis lors. Entre Tolstoï et Proust, j’ai été marqué par la lecture d’Hemingway, de Brecht et surtout de Frisch qui figurait le mieux mon rapport à la Suisse. Dès ma vingtième année, lorsque j’ai commencé à rêver de cinéma, j’ai désiré rencontrer Frisch et faire un film avec lui et raconter ce qu’il y a d’autobiographique dans ses romans. Max Frisch était ma figure paternelle. C’est l’homme qui m’a réconcilié avec la Suisse. Le premier Journal m’a tout de suite passionné. Grâce à Frisch je me sentais un peu chez moi à Zurich. Sinon je m’y sentais en exil. Frisch était la personne que j’avais le plus envie de rencontrer dans mon adolescence, comme le père inconnu. Avec Kafka, c’est le seul écrivain de langue allemande avec lequel je me sens absolument familier, dans un rapport filial et fraternel: filial avec Frisch, fraternel avec Kafka. Je crois les comprendre à travers le langage. Sinon je vis dans la littérature française. En langue anglaise, un tel rapport ne s’établit qu’avec Henry Miller. Lorsque je suis allé à Paris, à vingt ans, j’avais deux raisons principales: devenir un enfant de la Cinémathèque et lire Proust en français. J’ai appris le français en lisant Proust. Je n’ai jamais fait d’études.

- Fréquentiez-vous le milieu intellectuel ou artistique zurichois ?
- Absolument pas. J’ai toujours été un sauvage. Lorsque j’ai commencé à faire du cinéma, j’ai rencontré Fredi M. Murer, qui m’a beaucoup aidé au départ. Je n’ai jamais fréquenté aucun milieu. J’ai passé ma vie à faire des films et à courir après les femmes. Mais je vis en dehors de la société. Je lis trop. Par ailleurs, je n'ai aucune ambition sociale.
- Quels ont été vos premiers chocs, question cinéma ?
- Je dirai : Huit et demi de Fellini et Vivre sa vie de Godard, vers l’âge de dix-huit ans. Ces deux fois, en sortant de la salle dans la rue, le monde me semblait avoir changé - la couleur du monde me semblait avoir changé. A partir de là j’ai commencé de rêver de cinéma, de penser cinéma.
- Votre premier rêve a-t-il immédiatement été le documentaire ?
- Oui. Je suis un enfant de la fiction. Mais un fabricant de documentaires. Je ne sais pas inventer une histoire. L’imaginaire ne m’intéresse pas. En plus, je n’avais pas le bac. Aucune formation .Aucune école de cinéma ne m'aurait accepté. Mais j’avais vu Pierrot le fou en allemand. J’ai compris la nouveauté, la radicalité de ce film. Et j’ai décidé de venir à Paris, à cause de Godard. J’ai appris que les cinéastes de la Nouvelle Vague allaient à la Cinémathèque. Donc j’ai décidé d’y aller à mon tour. Sur quoi j’ai rencontré une femme qui m’a nourri et logé. Je n’ai jamais travaillé. Pendant des années, je n’ai fait qu’aller au cinéma et lire. Mon film sur Kafka sort ainsi du cinéma classique : de John Ford et de Hitchcock. Je suis un homme de la deuxième nature. Nietzsche disait qu’il y avait une première nature, fixée par le hasard de la naissance et de l’éducation, après quoi se construisait la deuxième nature, par choix personnel, souvent dans une autre culture. J’ai choisi la culture française et de devenir un autre, d’une certaine manière. A ce propos, mon Rimbaud est maudit en France, parce qu’il va contre le cliché. Sauf à l’anniversaire de Rimbaud, à Charleville, où il a fini par être accepté, mon Rimbaud n’a pas eu une projection publique depuis 1991. Le Kafka aura probablement le même sort en Allemagne. C'est que je détruis l'image convenue de Rimbaud et de Kafka.
 - Et la fiction là-dedans ?
- Et la fiction là-dedans ?
- J’ai raté un film sur la guerre d’Espagne, parce que je n’ai pas suivi ma première idée. Dès qu’on commence à hésiter, on perd sa conviction. En 1982, je suis allé en Espagne avec le fils d’un combattant d’Espagne, Je voulais faire ce film en super-8 et puis j’ai pris un acteur et j’ai détruit ce film avec un acteur. Là j’ai compris que je suis né pour le documentaire. Mais un documentaire débordant, un documentaire qui cherche sa propre fiction. Je crois que le documentaire est limité, qu’on déborde forcément par la fiction.
 - Quel est l’origine du film sur Kafka ?
- Quel est l’origine du film sur Kafka ?
- Durant toute mon adolescence, j’ai eu envie de marcher sur les pas de l’écolier Kafka. Il raconte ce chemin dans une lettre à Milena, et j’aurais toujours voulu le refaire. Cela m’a pris presque quarante ans. Je connais ce chemin par cœur. Lorsque j’ai envie de connaître vraiment quelqu’un, je fais un film sur lui. Pour moi, faire du cinéma consiste à rencontrer des gens et des paysages, puis de mémoriser ces rencontres et ne plus jamais les oublier. Je suis attaché au lieu de mémoire. Le lieu de mémoire est forcément émouvant. C’est pour ça que je dis mon cinéma cinéma de l’émouvance. C’est peut-être bête, mais je suis ému de savoir que Kafka a vécu dans cette maison. Pour moi, la mémoire est fondamentalement émouvante. Je travaille sur cette émotion. J’ai attendu longtemps de faire ce film car j’essaie d’enrichir mon territoire de cinéaste avec chaque film. Chaque fois je vais plus loin. J’ai toujours une vingtaine de projets en tête. Je rêve parfois mes films des décennies à l’avance. Moi qui suis très impatient, j’attends le bon moment pour faire un film juste par rapport à mes moyens. Chaque film est un élément de l’œuvre. Chaque film a sa place dans l’oeuvre. D'ailleurs je commence à ressentir un contentement à l’idée que j’ai créée une œuvre qui tient debout.

- Comment construisez-vous un film comme le Kafka ?
- C’est totalement intuitif, mais j’ai en moi une logique de montage, que j’ai acquis en 35 ans d’expérience. J’ai toujours monté mes films moi-même. L’idée principale du Kafka, c’est les acteurs. L’idée-clef est ici l’acteur. Je travaille sur la parole des morts. Je réveille les morts et les fait mourir. Le jeu des surimpressions mime cette arrivée et cette disparition permanente des protagonistes et correspond à une réflexion sur la résurrection par la parole. « Par où commence le monde, par la parole ou par l’image ? », se demande le poète Edmond Jabès. Les gens du cinéma essaient toujours de nous faire croire que le cinéma se réduit à des images qui bougent, et donc que le monde a commencé par l’image. Moi je crois qu’il a commencé par la parole. Avec Kafka, comme avec Rimbaud, j’ai choisi un certain nombre de phrases qui sont des phrases que je rêve moi-même à travers Rimbaud ou Kafka, qui les définissent. Je travaille comme un analyste écoute son patient. Je pense que l’apprentissage de l’autre commence par la parole. Vous ne sauriez jamais rien de quelqu’un en ne faisant que le regarder. L’image ne dit rien de vous. Mon cinéma est un travail de lecture. Chaque phrase est objet de lecture. L’image devient parlante par tout ce qu’on en sait à travers la parole : ainsi du visage de Kafka. Bien entendu, il y a déjà des images dans le texte, et des paroles dans l’image. Dans un documentaire sur un mort, il n’a que la parole, les paysages et les documents. Comme les témoins oculaires étaient morts, je les ai remplacés par les acteurs. Enfin, je donne des choses belles à entendre et à voir dans le film.
- Qu’est-ce pour vous que la beauté ?
- C’est une longue histoire. Moi, fils d’ouvrier, j’ai compris ce qu’était la culture à Bagdad, il y a très longtemps. Je me suis retrouvé, à vingt ans, au musée national de l’Irak, tout seul. Là j’ai compris ce qu’était la culture en regardant les magnifique figurines d’albâtre de l’époque sumérienne. J’ai compris que la culture signifie fabriquer de beau objets qui sont en même temps des objets de mémoire. C’est ça pour moi la culture : la beauté et la mémoire. Ce que nous pouvons savoir de Sumer tient à cela, Je crois beaucoup aux objets qui ne périssent pas.
- Quels sont vos rapports avec l’écriture ?
- J’écris un journal, à la manière de Léautaud, représentant des milliers de pages et que seules mes filles liront un jour. J’écris beaucoup, en outre, autour de mon travail.
- Qu’est-ce qui lie l’ensemble de vos films si divers ?
- Contrairement à ce qu’on croit, je travaille toujours dans l’émotion, et c’est pourquoi je revendique la filiation d’un John Ford. Par ailleurs, je suis un homme à projets. Je rêve mes films à l’avance. Le moteur de mon existence, à travers toutes les tribulations, c’est le projet : le rêve d’un prochain film. Comme je n’ai aucune ambition sociale, c’est le projet qui me donne de l’énergie.

- Quel est alors votre projet actuel ?
- J’aimerais faire un film grand public, sur des Américains qui pensent qu’il faut coloniser Mars. Ce serait à la fois un constate de situation sur tout ce qui nous attend sur terre, en termes de catastrophes, et l'aperçu de ce rêve fou de recréer une Amérique sur une autre planète Ce ne sera pas une fiction mais un documentaire en partant de portraits de gens que je vais rencontrer aux Etats-Unis. (Zurich, le 12 janvier 2007)
(Cet entretien, à l'état d'émincé, a paru dans l'édition de 24 Heures du 17 janvier 2006. En 2016, Richard Dindo préparait un film sur le poète japonais Bashô.)
Richard Dindo en 10 dates
1944 Naissance à Zurich. Origine italienne. 1964 Débarque à Paris. « Etudie » le cinéma à la Cinémathèque.1970 Premier film : La répétition.1977 L’exécution du traître à la patrie Ernst S, avec Niklaus Meienberg. 1981 Max Frisch Journal (I-III), avec l’écrivain.1986 El Suizo, un Suisse en Espagne. Seule fiction, « raté » selon Dindo…1991 Arthur Rimbaud, une biographie. Film « maudit » en France.1997 L’Affaire Grüninger. Portrait d’un résistant.1999 Genet à Chatila.2003 Ni olvido ni perdon. Dernier film « politique ». Liste à compléter...

Portrait de Claude Frochaux, éditeur et écrivain, auteur de L'Homme seul et de L'Homme religieux suivi de L'Homme achevé.
L’humanité, pour Claude Frochaux, se divise en deux catégories: les simples et les compliqués. Les simples ne croient qu’à la matière; Dieu n’est qu’une création de l’homme, animal évolué dont l’âme meurt avec le corps. Les compliqués, eux, croient en une transcendance, et tout se complique.
Mais Claude Frochaux là-dedans ? S’il se dit du parti des simples, son portrait n’en est pas moins compliqué à tracer simplement. Car il y a de l’aventurier chez cet octogénaire à l’air de père tranquille, et de l’anarchiste jamais rangé des idées subversives en ce fils de marchand de vin du Landeron qui, dans la nuit du 21 février 1961, avec trois compères, réveilla la cité de Calvin en attaquant le consulat de l’Espagne franquiste au cocktail Molotov...

Pas si simple à admettre pour des parents catholiques traditionalistes qui avaient espéré que leur fils aîné reprendrait l’affaire familiale. Dès 18 ans cependant, le très mauvais élève du collège Saint-Michel de Fribourg, plus nul encore au gymnase de Neuchâtel, s’était révélé … simplement compliqué, ajoutant à sa nullité scolaire une crise d’identité carabinée. Du moins sa mère, institutrice et portée sur la lecture, avait-elle flairé un avenir au précoce fou de livres : la librairie…
«J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie !», s’exclame aujourd’hui le libraire-éditeur-écrivain. « J’ai toujours fait les bonnes rencontres au bon moment. De Lausanne, où j’ai appris mon métier de libraire chez Payot, dès 1954, à Zurich et Londres (chez Foyles) ou nous travaillions beaucoup mais dans le bonheur, puis à Genève où j’ai rencontré le plus extravagant ami en la personne de Jean-Jacques Langendorf, à Paris où je me suis plongé dans la bohème de Saint-Germain des Prés comme employé du légendaire Jean-Jacques Pauvert, enfin à Lausanne où j’ai repris la petite librairie des Escaliers du Marché avant de me lancer dans l’aventure des éditions L’Âge d’Homme, au côté du génial Dimitri, j’ai toujours fait ce que je voulais et ce que j’aimais ! »

S’il se dit rationaliste et déterministe, Claude Frochaux n’en est pas moins un romantique à sa façon, intarissable sur ses folies de jeunesse, dont il exalte les années où il partit avec Langendorf sur les traces de Lawrence d’Arabie, fomenta l’attentat de Genève, entre orgies de cinéma et nuits blanches à refaire le monde ou à parler de livres, notamment avec un homme qu’il dirait aujourd’hui le compliqué par excellence : Vladimir Dimitrijevic qu’il accompagna trente ans durant malgré l’opposition totale de leurs opinions politiques et philosophiques. « J’ai vite compris qu’avec ce conservateur anticommuniste et chrétien jusqu’au mysticisme, la cohabitation serait impossible sans réserve mutuelle…» Et l’interlocuteur privilégié des auteurs romands de rappeler l’enjeu de cette aventure : un catalogue au bilan fabuleux, sans pareil en Suisse romande et bien au-delà.
Et l’écrivain Claude Frochaux lui-même, entré en littérature la trentaine passée avec un roman préfigurant une œuvre singulière, intitulé Le lustre du grand théâtre et parrainé par le seigneur du style qu’était André Pieyre de Mandiargues ? « Le lustre représentait bien cette menace magnifique que je sentais au-dessus de moi, qui pourrait me tomber dessus et que j’imaginais me traverser sans me blesser… En fait, je me suis toujours senti vulnérable», ajoute ce doux subversif qui n’en défia pas moins l’ordre établi (dont témoigne le délectable récit d’Aujourd’hui je ne vais à l’école) pour s’en prendre à l’être sans doute le plus compliqué de la Création, identifié sous le nom de Dieu.
«À vrai dire je n’ai rien contre Dieu », précise alors l’auteur de l’immense et dérangeant Homme seul, qui vient d’aggraver son cas avec L’Homme religieux. «Si j’ai perdu la foi à 18 ans, le sujet m’a toujours passionné. J’ai toujours voulu savoir « comment ça marche », et le fait est qu’en tuant nos dieux nous avons réduit nos cerveaux, car la religion a bel et bien été le tremplin de notre plus haute imagination et de la grandeur humaine »…
DATES
1935 Naissance à Berne, de parents neuchâtelois.
1954 Apprentissage de libraire à Lausanne
1956-64. Libraire à Zurich, Londres (Foyles) et Genève. Voyage au Moyen-Orient avec Jean-Jacques Langendorf.
1961-62 Attentat anarchiste contre le consulat d’Espagne à Genève. Procès et prison.
1962-64 Libraire à Paris, au Palimugre.
1967 Le lustre du grand théâtre, premier roman, paraît au Seuil. Dix livres, romans et essais, suivront, tous à L’Age d’Homme.
1965-68 Reprend la librairie Rieben à Lausanne.
1979 Naissance de Sylvain, suivi de Marc en 1981.
1996 Parution de L’Homme seul, essai. Prix Lipp 1997.
1968-2001 Editeur avec Vladimir Dimitrijevic, à L’Âge d’Homme.
Avec Le bel obèse, Claude Delarue signe un livre à la fois captivant, cinglant, amusant, émouvant, profond sans jamais peser.
 Qui fut vraiment Marlon Brando ? L’un des plus grands acteurs du XXe siècle ? Certes, mais encore ? Un mufle odieux à ses heures ? Sans doute. Un mégalo dépressif chronique ? Sûrement. Un interprète génial crachant sur le cinéma ? Un tombeur de femmes crachant sur le sexe ? Un boulimique à jamais inassouvi ? Un rustre capable de respect humain ? Un révolté sincère mais incompris ? Un extravagant ascète à sa façon ? Tout cela et bien plus, autant dire la complexité tordue faite homme, immense comédien et mec perdu : monstre fragile.
Qui fut vraiment Marlon Brando ? L’un des plus grands acteurs du XXe siècle ? Certes, mais encore ? Un mufle odieux à ses heures ? Sans doute. Un mégalo dépressif chronique ? Sûrement. Un interprète génial crachant sur le cinéma ? Un tombeur de femmes crachant sur le sexe ? Un boulimique à jamais inassouvi ? Un rustre capable de respect humain ? Un révolté sincère mais incompris ? Un extravagant ascète à sa façon ? Tout cela et bien plus, autant dire la complexité tordue faite homme, immense comédien et mec perdu : monstre fragile.
Or son autobiographie en dit-elle beaucoup plus que la douzaine de bios qui lui ont été consacrées jusque-là ? Et que peut nous en apprendre un roman ? La réponse est dans Le bel obèse, le plus extraverti (en apparence) et le plus puissant des romans de l’écrivain genevois de Paris, qui « sculpte » un grand fauve humain, aussi attachant qu’indomptable, dans la masse mouvante d’une destinée «inventée» mais toujours plausible, entre deux femmes et un ami constituant eux aussi de magnifiques figures romanesques.
 Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…
Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…
S’il a les ingrédients d’un thriller, avec des « scènes à faire » carabinées, Le bel obèse impressionne pour d’autres raisons que l’« efficacité » : c’est que tout y sonne humainement vrai, jusqu’au grotesque spectaculaire qui va si bien à Brandès-Brando (son « vrai nom », issu de l’alsacien Brandeau…) et au tragi-comique grinçant dans lequel baignent quatre personnages hors norme en quête d’eux-mêmes et en proie aux mêmes démons : la solitude, le manque d’amour, le vieillissement, le besoin compulsif de créer, la maladie et la mort qui font les folles sur le carrousel du Happy End.
Il n’y a actuellement, parmi les romanciers suisses, que Martin Suter (notamment dans le splendide Small World) pour combiner, avec autant de maestria, un scénario si captivant et un « sous-texte » si riche, des personnages si fouillés et une masse d’observations si pénétrantes sur l’époque, la « vraie vie » et ses illusions, la comédie humaine et les à-pics qui la cernent, l’émotion pure enfin d’un dénouement à chialer. Solidement ancré sur ce rivage nordique où Rabelais broute des fraises sauvages avec des moutons menacés de tremblante, riche d’évocations lyriques, tour à tour grinçant et poignant, scabreux parfois mais avec une sorte d’élégance, le sourire du désespoir aux lèvres, Le bel obèse, sans peser, a le poids des grands livres…

Cet article a paru dans l’édition de 24Heures du 15 avril 2008.


La couverture provocatrice de L'Obs de la semaine passée posait en susbstance la question: faut-il réécrire la Bible et le Coran?, relançant pour la énième fois le débat sur le contenu de certains textes dits sacrés et supposés intouchables par d’aucuns, et par exemple sur ce qu’on pourrait dire des apologies de la violence, notamment dans certaines sourates du Coran ou dans le Livre de Josué de l’Ancien Testament.
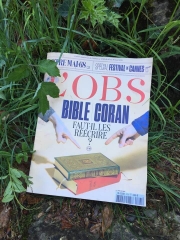
Même si l’on relance ce débat qui n’a rien de nouveau pour des motifs le plus souvent liés à des querelles idéologico-politiques momentanées, le fond de la question – qui a trait à l’interprétation et à la relecture critique des textes anciens ou plus récents, jusqu’au fameux pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline –, n’en demeure pas moins digne d’attention et de discussion bien au-delà des seuls cercles de spécialistes.
C’est du moins ce que je me disais en lisant le dernier livre d’Anne Soupa, après Les pieds dans le bénitier et Dieu aime-t-il les femmes?, consacré au personnage maudit par excellence que représente Judas dans la tradition chrétienne, qui implique d’abord la «construction» d’un personnage à sa source évangélique, immédiatement diabolisé par l’apôtre Jean – alors que Paul de Tarse, témoin plus proche du Christ, l’ignore complètement – et devenant ensuite l’image par excellence du traître et du Juif cupide, pour ne pas dire la figure emblématique à nez crochu du peuple déicide.

Dans la Divine comédie de Dante, qui représente le sommet de la pensée catholique à la bascule du Moyen âge et de la Renaissance, Judas brûle dans les glaces de l’Enfer, condamné à être dévoré à perpète par Satan. Or faut-il prendre les visions du poète florentin à la lettre? Ou faut-il réécrire la chant de l’Enfer dans lequel Mahomet, coupable selon Dante d’avoir semé la zizanie sur le pourtour de la Méditerranée, apparaît comme un démon schismatique, au chant XXVIII de L’Enfer, fendu en deux, bonnement «crevé du col jusqu’au trou d’où l’on pète»?
À ce taux-là, il faudrait réécrire non seulement la Bible et le Coran, mais aussi Tintin au Congo et tous les textes «inappropriés» selon les termes des censeurs actuels impatients de tout ramener au même dénominateur commun d’on ne sait quelle morale mondiale zoophile et gay friendly, ouverte au développement personnel et à la permaculture...
 Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.
Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Blague à part, ce livre constitue la base d’une réflexion très fertile, nourrie par une véritable enquête, sur les avatars d’un personnage-clef. Dans l’imaginaire collectif, Judas est le salaud par excellence. Le méchant du western. Le Mal. Un terme le caractérise: traître. Or Judas a-t-il vraiment trahi? N’a-t-il pas fait que livrer? C’est la première mise au point à laquelle se livre Anne Soupa. Vous ne voyez pas la différence? Elle est pourtant notable. Elle marque la nuance entre un homme faux qui renierait son ami – et l’apôtre Pierre, fondateur de l’Eglise, n’y manquera pas par trois fois! - et un disciple qui agirait sous l’impulsion d’une force supérieure avant de se suicider sous l’effet du repentir.
Selon certains, Judas pensait que Jésus triompherait de ses adversaires et même de la mort, et c’est pourquoi il l’aurait «livré». L’évangile de Jean, cependant, lance la première flèche contre un Judas supposé diabolique. Jean est-il cependant à prendre au pied de la lettre? On ne va certes pas «réécrire» son évangile, mais le problème est que la question de l’identité du, ou des rédacteurs du quatrième évangile reste incertaine, la probabilité d’une école johannique genre atelier d’écriture étant aujourd’hui reconnue par de nombreux exégètes, qui alimente l’hypothèse d’une «fabrication» a posteriori du personnage maudit.

Ce qui est sûr, c’est que la figure du traître, auquel a été assimilé le peuple juif non convaincu de la messianité de Jésus, a connu la plus formidable expansion à travers certains textes des Pères de l’Eglise, à commencer par les invectives de Saint-Jean Chrysostome (au IVe siècle de notre ère) dans son Discours contre les juifs. Pour mémoire, on peut alors rappeler qu’il aura fallu attendre les conclusions du concile Vatican II pour mettre un terme officiel à des siècles d’opprobre frappant les coreligionnaires, explicitement déclarés «perfides», de Judas. Mais est-ce à dire que les chrétiens puissent donner aujourd’hui des leçons de vertu aux musulmans antisémites?
Exiger qu’on réécrive aujourd’hui la Bible ou le Coran, et tous les textes anciens qui ne seraient pas conformes à l’idéologiquement correct selon nos codes humanitaires, revient à faire l’impasse sur la relecture critique constante des textes en question et leur réinterprétation. À cet égard, Anne Soupa a le mérite de rappeler les multiples approches, parfois très contradictoires, qui ont été faites du personnage de Judas.
Avant que le nationaliste français Maurice Barrès relance la figure du félon en la personne de l’officier juif Alfred Dreyfus, dans La Parade de Judas datant de 1902, Ernest Renan, dans sa Vie de Jésus, en 1863, avait remis en question le processus de diabolisation, mais c’est dès 1853 déjà que Thomas de Quinecy, fumeur d’opium notoire et grand esprit, avait «fait de son héros un impatient en attente d’une libération de type politique».

 Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.
Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Entre autres interprétations contemporaines, non citée par Anne Soupa, on pourrait retenir aussi celle de l’écrivain russe Leonid Andreev, qui en fait, dans Judas Iscariote, un homme plus intelligent et brillant que les autres disciples, type du zélateur orgueilleux et fanatique jusqu’à l’hystérie, qui aimerait faire du Christ un roi régnant. Quant à Amos Oz, dans son roman éponyme, il fait carrément de Judas le plus chrétien des apôtres, qui pensait lui aussi que Jésus allait régner sur un monde pacifié…


Autre approche non conformiste citée par l’auteur de Judas, le coupable idéal, reprenant la théorie mimétique de René Girard: celle d’un double sacrificiel, sombre certes, mais sans lequel l’autre bouc émissaire que deviendrait Jésus n’aurait pu accomplir son destin présumé divin.

De la même façon, de belles âmes en ont appelé, en Italie, à l’interdiction de lire la Commedia de Dante en classe, sous prétexte que l’homophobie y voisine avec l’islamophobie. Mais là encore, une relecture attentive suffirait à montrer que Dante, condamnant doctrinalement la sodomie et l’hérésie de l’islam, rend le plus bel hommage aux grands esprits musulmans (Averroès et Avicenne, notamment) et pleure sincèrement de ne pouvoir serrer dans ses bras ses nombreux amis homos casés dans le septième cercle de l’Enfer, à commencer par Brunetto Latini qui fut son cher mentor. Ô complexité humaine!

Il fut un temps où un Index catholique et apostolique frappait certains écrits d’interdiction. À travers les siècles, les flammes des livres brûlés se sont mêlées à la fumée des bûchers cramant les hérétiques. Quinze siècles après le feu à la bibliothèque d’Alexandrie bouté par les iconoclastes chrétiens, les nazis ne furent pas en reste, et l’on ne compte plus aujourd’hui les fatwas lancées contre les auteurs non alignés de l’Oumma.

Salman Rushdie et ses Versets sataniques, Abdelwahab Meddeb et ses Contre-prêches,Kamel Daoud et ses Indépendances, Boualem Sansal et son pendable 2084? Tous de Judas!
Or le livre ne serait-il pas lui-même, en fin de compte, un coupable idéal? Peut-être faudrait-il alors, plutôt que de le réécrire, le limiter aux 144 signes de Twitter ou aux émoticôns de Facebook? S’agissant enfin de Judas, on aurait le choix une fois pour toutes: Bonus ou Malus, j’m ou j’m pas, point barre, terminé bâton!
Dessins de Matthias Rihs. ©Rihs/Bon Pour La Tête.
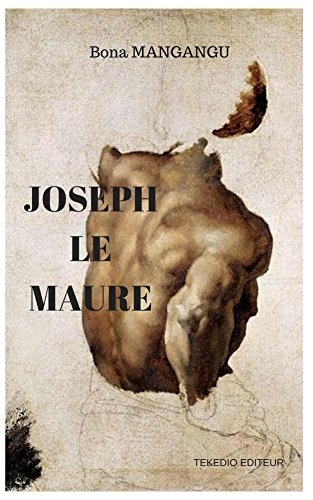
 Entretien d'Hélène Combis avec Bona Mangangu
Entretien d'Hélène Combis avec Bona Mangangu
Il surplombe le légendaire tableau de Géricault, mais qui a déjà remarqué la couleur de sa peau ? L'homme qui a permis à Géricault d'incarner ce personnage s'appelait Joseph, et était Haïtien. C'est l'un des rares modèles noirs de cette époque dont subsistent quelques traces biographiques.

Aviez-vous déjà remarqué que la figure conquérante et optimiste qui surplombe le légendaire tableau du Radeau de la Méduse, et qui tranche avec les autres naufragés prostrés et capitulards, était un Noir ?
Nous non plus... et alors que le Musée d'Orsay propose jusqu'au 21 juillet une exposition sur le modèle noir, nous avons voulu en savoir plus long sur celui qui a posé sous l’œil de Géricault pour incarner cette victorieuse figure de proue : il s'agit du "Nègre Joseph" (tel qu'on le baptisait à l'époque), venu de Saint-Domingue, et dont la petite histoire s'inscrit dans la grande sur fond de prémices abolitionnistes découragés par Napoléon, et de révolution haïtienne.
Nous avons donc rencontré l'écrivain Bona Mangangu qui, en 2016, a publié chez le Tiers Livre un texte poétique inspiré de la vie de Joseph, sur laquelle il s'était largement documenté. Entretien.
Qui était « Joseph le Maure », auquel vous avez consacré un texte littéraire ? D’où venait-il, quel a été son parcours de vie, et qu’est-ce qui l’a conduit à Paris, puis dans l’atelier des peintres romantiques du XIXe siècle, à commencer par celui de Géricault ?
Bona Mangangu. Que sait-on vraiment de lui ? Pas grand-chose. Peu d’indices biographiques nous sont parvenus. Nous savons par Emile de la Bédollierre, dans son livre Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du dix-neuvième siècle paru en 1840, qu’au début de la Restauration, il débarque à Marseille, après la libération d'Haïti en janvier 1804. De Marseille, il gagne Paris où il vit de petits boulots et d’expédients. Il se fait engager dans la troupe acrobate de Madame Saqui, née Marguerite-Antoinette Lalanne, danseuse de corde, pour jouer les Africains. Son succès au sein de cette troupe le conduit au petit cénacle des artistes de la rue des Martyrs. Par quelle voie a-t-il rencontré et trouvé les faveurs de Géricault ? Je l’ignore. En tout cas, grâce à ce dernier, il fréquente de nombreux ateliers de peintres de l’époque romantique. A quel âge est-il arrivé en France ? Est-il resté en France ? Quels genre de petits boulots faisait-il ? La peinture avait-elle beaucoup d’importance dans sa vie ? Où vivait-il ? De quelle manière est-il mort ? A ma connaissance, on l'ignore.
Pour quels autres peintres a-t-il posé, et pour quels sujets ?
Il a servi de modèle au peintre Adolphe Brune, élève de David, pour une toile intitulée Joseph, le nègre, visible au musée de Cahors. Une Etude de Nègre peinte en 1838, huile sur toile commandée au jeune Théodore Chassériau par Ingres, se trouve au musée Ingres à Montauban. Ingres forma le projet de réaliser une oeuvre à partir de cette étude mais ce projet ne vit jamais le jour. Il existe quelques dessins préparatoires au musée. Il rencontra Delacroix chez Géricault. Je me demande si la tête du Nègre vu en buste, la tête coiffée d'un turban rouge de Delacroix, qui date de 1826, ne serait pas celle de Joseph.

Pourquoi connut-il un tel succès, en tant que modèle ?
Son physique est proche de statues antiques. Mais ce n’est pas pour cela qu’il a les faveurs du peintre du Radeau. Dans le volume VI du livre de La Bédollierre (Émile de La Bédollière, écrivain et journaliste, NDR) l’auteur affirme que Joseph s'attire les préférences par son charisme. Il est vrai qu’il est très beau, possède des épaules larges, des dents très blanches et un torse effilé, et qu’il sait séduire n’importe qui par son bagout, son charme et son sens de la répartie. Ce qui amène un tel succès à Joseph ? C’est plutôt le Naufrage de la Méduse. C’est une toile immense. Aucun amateur de peinture, aucun peintre n’échappe à ce corps, cette "éminence" noire au sommet d’une pyramide humaine. À partir de-là, les propositions se multiplient.

- Dans Le Modèle, en 1840, Émile de La Bédollière écrit : "Pensez-vous que l’Haïtien, brûlé par le soleil des tropiques, va demeurer tranquille dans sa pose comme Napoléon sur la Colonne ? Non : vous voyez tout à coup sa figure s’épanouir, ses grosses lèvres s’ouvrir, ses dents blanches étinceler ; il se parle à lui-même, il se conte des histoires, il rit à gorge déployée ; il songe à son pays natal ; réchauffé par la chaleur du poêle, il rêve le climat des Antilles ; au milieu des émanations de la tôle rougie et de la couleur à l’huile, il respire le parfum des orangers. O illusions !" Qu’est-ce que cette vision de l’homme noir reflète de l’époque ?
Il y a une donnée simple, à peu près partagée par le commun des mortels de l’époque : le Noir est de race inférieure, c’est un esclave. S’il est toutefois parmi nous, il n’est pas des nôtres, il ne se comporte pas comme nous. Comme vous le notez, certains clichés et stéréotypes perdurent. De la Bédollière ne fait que mettre en relief certains préjugés. Joseph est renvoyé à sa singularité nègre, telle que perçue par l’homme occidental. On dirait un extrait du Traité de physiognomonie, une science antique méconnue où l’individu est soumis à un examen sur son apparence physique, ses mœurs et ses origines. De grands esprits, comme Buffon, quelques années plus tôt, avaient rapproché l’intelligence du Noir à celle des animaux. Le Noir est d’intelligence inférieure, il est cannibale. On pointe du doigt sa "différence" pour mieux nier son altérité et son appartenance à la communauté des hommes. En 1848, les députés, à leur tête Victor Schoelcher, finiront par abolir cette cruauté rétablie par Napoléon en 1804.
Justement, que dit ce succès de Joseph (et plus largement celui des modèles noirs) des réflexions de l’époque sur l’esclavage?
Il est vrai qu’on note une certaine présence des Noirs, venus des Antilles, à Paris au début du XIXe siècle, dans la rue et dans l’iconographie de l’époque. Sont-ils admis auprès des cercles d’artistes à cause de la récente abolition de l’esclavage – que Napoléon rétablit aussitôt après – et de la libération de Haïti ? Suscitent-ils de la sympathie, ou une forme de reconnaissance, en tant qu’individus et figures de l’autre ? Je ne pourrais établir un lien de cause à effet. Modèles, "héros muets", ils ne font que coopérer à la mise en forme des tableaux et des sculptures. Ils font cela pour survivre.
Une chose est certaine : le succès de Joseph n’est qu’auprès des peintres ou des sculpteurs, surtout les proches de son ami Géricault, et auprès des amateurs d’art. Les uns le choisissent comme modèle par nécessité intérieure, connue d’eux seuls. Les autres parce qu’il ressemble à un dieu grec par sa corpulence – l’époque est sans doute à une résurgence des modèles antiques, musculeux, puissants, divinement beaux. Son visage est extraordinaire. Géricault l’a pris en affection. C’est son ami. Les raisons de toute amitié sont inexprimables. Le grand public l’ignore, ignore son identité, tout comme il ignore celle d’autres modèles africains, italiens ou juifs. "Vil métier", diront certains, car le modèle est payé trois francs par séance, une misère. Ça ne nourrit pas correctement son homme. Docile, il pose. Sans bruit. Il ne réclamera à l’artiste aucune part de sa gloire.
- La représentation de modèles noirs dans la peinture, a-t-elle eu une incidence sur la perception des Noirs par la société française ?
Sur le plan iconographique, c’est vrai que l’époque romantique vient de se débarrasser du grotesque que le style Rococo a exalté. Les têtes de nègre grotesque, en vogue dans la décoration de l’époque, ont disparu. Ignacy Sachs souligne dans son essai que l'“on accorde au nègre individuel des traits humains voire sympathiques”. Les artistes qui épousent la cause abolitionniste veulent rendre aux Noirs leur dignité. Par militantisme, ils dénoncent la traite négrière et luttent, pinceaux en main, pour réhabiliter leur condition humaine. Je pense à Géricault et son Radeau. Le bouleversant portrait de Jean-Baptiste Belley, esclave affranchi, devenu député noir de Saint Dominique à la convention par Anne Louis Girodet Trioson (1797), frappe également les esprits. Quant au peintre Marie-Guillemine Benoist, elle a peint magistralement sa Négresse (1800) comme une madone nourricière. “Sa peau rendue avec un soin particulier” nourrit, si je puis dire, l’imaginaire du spectateur. Selon Luce-Marie Albigès, "assise dans un fauteuil à médaillon drapé d’un riche tissu, elle occupe la place traditionnelle d’une femme blanche."
Ce succès des modèles noirs témoignent-ils des débuts d'une affirmation de l’identité noire ?
C’est aller vite en besogne. Le monde noir est vaste. Les royaumes africains seront peu à peu réduits au silence par la ruse et la brutalité des puissances occidentales. Les seuls qui se soulèvent, jusqu’ici, ce sont les Haïtiens. Toussaint Louverture chasse les Anglais de Saint-Domingue en 1795 puis les Espagnols en 1798. Mais la Révolution française conserve sa colonie. En Guadeloupe, les officiers Delgrès et Ignace tentent une résistance, ils sont écrasés par les troupes de Napoléon qui rétablit l’esclavage en 1802. Il faut attendre 1804 pour parler de débuts de la vraie affirmation de l’identité noire aux Antilles. En effet, Toussaint Louverture ayant réussi à écarter ses rivaux blancs et mulâtres, s’empare du pouvoir et proclame l’indépendance en janvier 1804. La première république noire est née : Haïti. On connaît la suite… la cellule du Fort de Joux dans le Jura etc.
Dans votre texte, vous semblez dire que pour Géricault, peindre Joseph au centre de son Radeau de la Méduse était un acte d’émancipation… Pouvez-vous revenir sur cette représentation, et sa force symbolique ? Pour le peintre, était-ce réellement un choix politique ?

Je crois que c’est un choix politique. J’ai appris qu’il aimait se faire conter les exploits héroïques d’insurgés haïtiens. Le rétablissement de l’esclavage par Napoléon aux Antilles françaises l’avait sans doute révulsé.
C’est la fin de l’Empire. Nul, au sein de son entourage proche ( le colonel Bro, Dedreux-Dorcy, Horace Vernet, Jamar...) n’ignore ses sympathies pour la cause abolitionniste. Ils aspirent tous à des changements politiques, surtout artistiques. Géricault peint Le Radeau en six mois. Entre 1818 et 1819. Vu sa dimension, on ne peut que s’émerveiller devant une telle force, une telle rapidité d’autant qu’il n’use pas de brosses. Pour les rôles héroïques, dans ses tableaux, il choisit plutôt les Africains. Le personnage de Joseph est bien placé, au centre du Radeau. Son corps, c’est la matière première mise en oeuvre par le peintre, la figure de proue "élue" par celui-ci pour envoyer des signaux au bateau l’Argus venu à la rescousse. C’est un corps noir, puissant, en bonne santé, qui s’élève au-dessus des corps blancs, survivants du radeau affaiblis par la maladie et la fatigue. Le symbole est très fort.
Que peut-on trouver comme documents biographiques sur Joseph, aujourd'hui ? Pourquoi l'histoire n'a-t-elle retenu que son prénom ?
Pas grand-chose. Emile de La Bédollière fournit quelques indices dans son livre. Ils sont malheureusement maigres. Adrien Goetz dans son roman La Dormeuse de Naples lui donne un rôle assez prépondérant. Il le fait admettre dans un cercle philosophico-artistique appelé "la société Antonine" dont font partie de nombreux peintres célèbres de l’époque. Il le fait invraisemblablement voyager à Rome et Naples en compagnie de Géricault et Ingres.
Mais sinon... une biographie uniquement pour celui qui exerce un "vil métier", que le grand public ignore ? Allons donc ! Il n’est ni soldat de l’Empire, ni général aux cotés de Delgrès, de Dessalines ou de Toussaint. On ne passe pas du jour au lendemain de la troupe acrobate, de l’atelier de la rue des Martyrs au Fort de Joux dans le Jura. Non. Il demeure tranquille dans sa pose pour trois francs la séance, le jour, et amuseur le soir au troquet. Pourquoi l’histoire n’a-t-elle retenu que son prénom ? Qui connaît Cadamour, le roi des modèles, ? Qui connaît Brzozomvsky, le doyen des modèles, et Dubose, modèle de formes irréprochables, et Céveau le beau dentelé, le favori d'Ingres ? Que sait-on de la Femme noire du célèbre tableau de Marie-Guillemine Benoist au Louvre? Et le nom de la servante aux fleurs dans l’Olympia de Manet, qui le connaît ? On prétend que la mode est à l’anonymat pour les modèles...
https://www.franceculture.fr/peinture/qui-etait-joseph-modele-noir-du-radeau-de-la-meduse
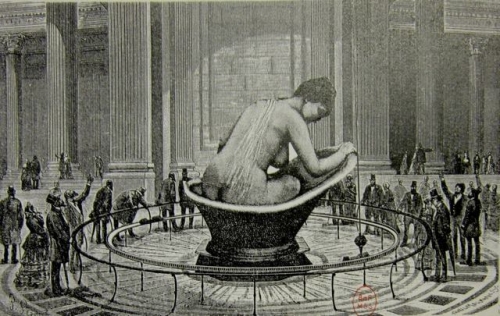 Celui qui rote pour défier la sœur visitante / Celle qui fait assaut de petite vertu / Ceux qui jettent de la poudre aux vieux / Celui qui dit tout haut qu’il ne supporte pas la couleur de rôti brûlé du tablier de la jardinière d’enfants / Celle qui accueille le compliment de Monsieur Palamède par un horion et des lazzis / Ceux qui mettent leur doigt dans le nez de leurs voisins de dortoir / Celui qui se vante d’avoir vu Catherine Deneuve en culotte de cheval et sans rien dessus / Celle qui se la joue cynique genre jeune écrivain très con / Ceux qui injurient les jurés du Prix du plus mauvais poème qui les ont félicités sans autre / Celui qui louche sur le potage de sa voisine guindée / Ceux qui ont le courage de leur anonymat pour écrire dans le courié des lecteur ce qu'ils pansent des femmes / Celui qui s’est assis sur la politesse de tout son poids de mufle de juste trente ans signant son premier roman juste magnifique écrit-il sur Twitter / Celle qui glapit genre Virginie Despentes indisposée par un fumeur de cigare dans le vestiaire des nubiles / Ceux qui l’ouvrent pour montrer leurs dents cariées par la mauvaise humeur / Celui qui recommande plus de décence à sa grand-mère soixante-huitarde sur le retour libidinal / Celle qui se jette sur le poitrinaire supposé avoir quelque argent à gauche / Ceux qui préfèrent les buffles et les nèfles au bluff des mufles, etc.
Celui qui rote pour défier la sœur visitante / Celle qui fait assaut de petite vertu / Ceux qui jettent de la poudre aux vieux / Celui qui dit tout haut qu’il ne supporte pas la couleur de rôti brûlé du tablier de la jardinière d’enfants / Celle qui accueille le compliment de Monsieur Palamède par un horion et des lazzis / Ceux qui mettent leur doigt dans le nez de leurs voisins de dortoir / Celui qui se vante d’avoir vu Catherine Deneuve en culotte de cheval et sans rien dessus / Celle qui se la joue cynique genre jeune écrivain très con / Ceux qui injurient les jurés du Prix du plus mauvais poème qui les ont félicités sans autre / Celui qui louche sur le potage de sa voisine guindée / Ceux qui ont le courage de leur anonymat pour écrire dans le courié des lecteur ce qu'ils pansent des femmes / Celui qui s’est assis sur la politesse de tout son poids de mufle de juste trente ans signant son premier roman juste magnifique écrit-il sur Twitter / Celle qui glapit genre Virginie Despentes indisposée par un fumeur de cigare dans le vestiaire des nubiles / Ceux qui l’ouvrent pour montrer leurs dents cariées par la mauvaise humeur / Celui qui recommande plus de décence à sa grand-mère soixante-huitarde sur le retour libidinal / Celle qui se jette sur le poitrinaire supposé avoir quelque argent à gauche / Ceux qui préfèrent les buffles et les nèfles au bluff des mufles, etc.


Sans l’enfance et la folie, entre autres composantes non formatées, la poésie ne serait rien qu’une enjolivure verbale creuse, une espèce de jouet de luxe ou de babiole décorative, bref une façon flatteuse de dorer la pilule - et dire que la poésie est partout, autant que dire que nous sommes tous poètes ne fait qu’alimenter le dégobillage de vers creux dont les réseaux sociaux sont noyés par les temps qui courent.

Est-ce dire que la poésie est rare ? Oui. Réservée à une élite ? Absolument, mais pas du tout celle qu’on croit, car l'aristocratie de la sensibilité traverse les strates sociales et les races. Doit-elle être accessible à tous ? Pas forcément. Hermétique alors ? Le moins possible, mais peut-être secrète et mystérieuse. Populaire ? Et pourquoi pas ? Des foules vibrent aux vers d'Adonis ou de Mahmoud Darwich et des classes entières à ceux de Rimbaud ou de Prévert qu'il faut être un Houellebecq mal luné pour trouver con.
Définissable la poésie ? Peut-être par approximations.
Explicable ? Sûrement pas plus que ce qu’on éprouve au tréfonds du chagrin ou au pic de la joie, dans l’effusion amoureuse ou dans la mélancolie du temps qui passe.
Alors qu’en dire ? Y aller mollo, si possible en toute subjectivité et avec des exemples chantés.
Une citation pour la route? Volontiers : du poète en prose velocipédiste Charle-Albert Cingria à propos du poète en vers Pétrarque: «Quand Rossignol tombe, un ver le perce et mange son cœur. Mais tout ce qu’il a chanté s’est duréfié en verbe de cristal dans les étoiles; et c’est cela qui, quand un cri de la terre est trop déchirant, choit, en fine poussière, sur le visage épanoui de ceux qui aiment»…

La poésie vue alors comme une cristallisation, pour dire en peu de mots, et le plus souvent avec d'autres vocables que ceux qui font poétique. Ce qui n’exclut pas, cela va sans dire, que Rossignol se prenne les ailes dans les barbelés de Gaza, ni la poésie désespérée de Paul Celan ou de Sylvia Plath.
Y aurait-il donc un noyau sensible commun à tous les poètes ? J’en suis, pour ma part, convaincu, mais là encore les exemples sont requis, qui me font rapprocher aussitôt, entre cent autres, deux jeunes poètes morts à la fleur de l’âge, comme on dit: le Belge Odilon-Jean Périer et le Japonais Ishikawa Takuboku.

Odilon-Jean Périer (1901-1928), dont la pureté limpide de la poésie réduit à l’état de vidures d’évier les injures démentes de Baudelaire adressées aux Belges, écrivait ceci dans son Histoire d’une amitié: «Le sable et les arbres jouaient / À m’égarer / Le vent et les oiseaux jouaient au plus léger / Plaisir des dunes / Une canne de jonc / Une cravate Un papillon / Écume de mer Pipe d’écume / Avec l’amitié pour enjeu / ces jeunes gens ne sont pas sérieux»…
Et le mélancolique Ishikawa Takuboku (1886-1912) d’évoquer lui aussi l’amitié dans les tercets des tankas de Ceux que l’on oublie difficilement : «Mon ami venait m’emprunter quelques sous / il s’en retourne / les épaules couvertes de neige».
Ou encore : «Cet ami avec qui / je peux parler sans feinte / je voudrais commencer à lui parler de toi»…
Ou pour mettre tout le monde à l’aise, on pourrait rapprocher aussi ces vers exquis de Serge Gainsbourg, dans Initials B.B. : «À chaque mouvement / On entendait / Les clochettes d’argent / De ses poignets », et ce vers de Dante que Jorge Luis Borges considérait comme le plus beau de La Divine comédie: «Douce couleur du saphir oriental / un nouveau jour se lève », etc. L’enfance poétique ressent plus qu’elle n’explique…
Le noyau de la poésie est évidemment émotionnel, lié au premier cri et au premier chant du primate «augmenté» que nous sommes peu ou prou; il est tellurique et céleste, musical dans sa modulation, à la fois candide et de plus en plus savant à travers les siècles au point de susciter des traités à n’en plus finir dont le moindre, récemment, n’est pas Le sexe des rimes d'Alain Chevrier, qui nous apprend que l’alternance des rimes masculines et féminines est un de fondamentaux de la versification française. Or les règles non écrites de l’harmonie se retrouvent, yes sir, chez certains (rares) slameurs de nos jours...

Ladite harmonie et ses lois, écrites ou non, ont longtemps régné sur la poésie française, puis tout a éclaté, mais Rimbaud savait le latin avant de l’envoyer valdinguer et bien étrangement, aujourd’hui, c’est un mouvement contraire qui se dessine chez certains, par delà la déstructuration formelle voire le n’importe quoi - retour par exemple au sonnet ou à l’alexandrin, comme chez Sylvoisal et William Cliff. L’extravagant Sylvoisal ! L’anachronique énergumène, qui vous apprend comme ça, mine de rien, que la poésie est une affaire d’enfance, avant l’adolescence des philosophes, à savoir : la sensation première avant l’explication.
 Or Sylvoisal, dans ses Poèmes à moi-même, déroge à tout infantilisme dans une remarquable suite poétique qui se pense et se ressent et s’écoute puisque c’est de la musique verbale bonne pour la tête et les entrailles - à ce recueil s’ajoutant la non moins folle liste de La Forêt silencieuse, que l’auteur français (établi à Lausanne depuis les années 60) a publié en même temps ces jours à Vevey, chez les éditeurs–imprimeurs-artisans-artistes du Cadratin.
Or Sylvoisal, dans ses Poèmes à moi-même, déroge à tout infantilisme dans une remarquable suite poétique qui se pense et se ressent et s’écoute puisque c’est de la musique verbale bonne pour la tête et les entrailles - à ce recueil s’ajoutant la non moins folle liste de La Forêt silencieuse, que l’auteur français (établi à Lausanne depuis les années 60) a publié en même temps ces jours à Vevey, chez les éditeurs–imprimeurs-artisans-artistes du Cadratin.
Poèmes à moi-même de Sylvoisal, alias Gérard Joulié, est un recueil en forme de tryptique (La vieillesse d'Œdipe, Les enfants prodigues et Pour avoir préféré) d’une qualité sensible et d’une puissance d’expression qui stupéfient chez un être d’aussi frêle apparence. De fait, Gérard Joulié est une sorte de vieil ange septuagénaire tout à fait étranger au train du monde, traducteur de l’anglais au long cours (G.K. Chesterton, Ivy Compton-Burnett, John Cowper Powys, Ronald Firbank, Gore Vidal, etc.) et ne vivant que par et pour la littérature, comme un honnête homme du XVIIe siècle (il ressemble un peu à Pascal de profil) ou un Jésuite en poste à la cour de l’Empereur de Chine.
Le début de La vieillesse d’Œdipe est d’emblée très plastique et charnu: «Je suis le grand Oedipe innocent et coupable / Sans fille auprès de lui pour lui servir à table / Pour refaire son lit et le regarder nu, / Pour lui masser le gland et lui torcher le cul». Après quoi c’est une vie qui défile et se résume, ample et magnifiquement dérisoire comme nos existences à tous.
Puis ce sont Les enfants prodigues et cela donne ça : «Nous sommes des enfants enragés de plaisirs / Dont le cœur est gonflé d’insatiables désirs. / Le blâme, l’infamie, la tragédie, le drame / Occupent notre ennui et captivent nos âmes». Et Sylvoisal baudelairise ensuite: «Pour aimer une morte et rallumer sa cendre/ Nous serions descendus dans la cave nous pendre / Tant nous aimons souffrir puisqu’aimer c’est souffrir/ Aussi bien que mourir aux cimes du plaisir». Et le recueil s’achève en incantation à la fois élégiaque et franciscaine, tout en humble douceur.
Quant à La Forêt silencieuse, c’est une seule phrase de plus de deux cents pages, comme un inventaire de la vie ressaisi par une liste inouïe, où la musique des mots et l’enchaîné des images se font pure poésie.
 Pendant ce temps le vagabond errait…
Pendant ce temps le vagabond errait…
De Baudelaire à Rimbaud, ou de François Villon à Jean Genet, le couple opposé, et plus ou moins kitsch, du dandy (Baudelaire) et du voyou (Rimbaud), du messager des dieux ou du clochard céleste à semelles de vent n’en finit pas d’alimenter une mythologie relancée au féminin entre fées et sorcières, veilleuses attentives ou filles du feu, etc.
On peut certes trouver ces clichés éculés, sinon débiles, mais il me plaît au contraire de les recycler pour faire image, surtout s’agissant de vrais personnages du genre de Sylvoisal et William Cliff.
Âpre et lestée de douleur existentielle, hypersensible et sensuelle à la flamande, d’un réalisme à fleur de terre et de chair, la poésie de William Cliff est à la fois d'un savant artisan de la langue et d'un vagabond. Né André Imberechts à Gembloux, en 1940, Belge comme Odilon-Jean Périer, William Cliff me semble l'un des poètes francophones les plus marquants des temps qui tanguent, tant par la profondeur vibrante de sa perception du monde que par son effort de transfigurer le quotidien le plus trivial en matière chantante et pensante.
Grand voyageur mais sans jamais sacrifier au genre à la mode, chez lui partout et nulle part, William Cliff voit et dit les choses, voit et dit les gens, avec une sorte de probité émotionnelle sans faille. La France lui a décerné le prix Goncourt de la poésie : c’est bien. Mais c’est encore mieux de le lire, et son dernier recueil tissé de 217 sonnets en huit liasses, Matières fermées, dont le titre est emprunté à son premier mentor catalan, Gabriel Ferrater, est lui aussi l’ouvrage d’un enfant prodigue développant, en alexandrins, une espèce de roman-bilan familial et mondial d’une bouleversante attention aux êtres et aux choses perdues et retrouvées, où il est de nouveau question d’enfance et d’errances, de rencontres et de marchés de la poésie fleurant la frime, du terrible poids du monde et du chant du monde.
On croirait entendre du Villon en lisant d’abord ça : « Me voilà déjeté, misérable séquelle, / méprisé, conspué, honni de tout le monde, / regardant cette pluie du ciel continuelle /où pataugent les girls avec leur rire immonde ».
Toute la vie en alexandrins, mais sans que jamais on ne sente la machine à coudre du rythme mécanique. Le grand art ne se voit pas. De Jean-Sébastien Bach à Thelonius Monk on se la joue pied-léger.
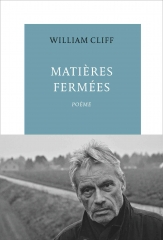
Retour donc en douce au pays natal et dans la foulée de Baudelaire injuriant les Belges : «Quand partons-nous pour le bonheur ?», sur quoi voilà le jeune amant de beaux corps de naguère, voire de jadis, en vieux prodigue revivant à Venise ou ailleurs l’invitation au Voyage, lisant Oberman de Senancour dans la foulée, suppliant Dieu de garder à l’enfant son regard si émouvant, enfin remerciant ses mère et père de l’avoir jeté «dans ce pays de malheur» où demain peut-être il sera encore aimé de quelqu’un: « Me voilà écrivant, misérable poète / grâce à vous, oui j’écris ces vers alexandrins / par lesquels je voudrais déjouer ma défaite / sous le poids de ce soir qui me crève les reins »…
Sylvoisal. Poèmes à moi-même et La Forêt silencieuse. Le Cadratin, Vevey, 2017.
William Cliff. Matières fermées. La Table ronde, 2018.
Dessin ci-dessus: Matthias Rihs. ©Rihs/BPLT.

Lire et relire Cendrars...
En 1992, Anne-Marie Jaton, mondialement connue sous le surnom de la Professorella, publiait un livre magnifiquement illustré, consacré à Blaise Cendrars. Actuellement encore, cet ouvrage reste l'introduction la plus attrayante, et la plus chaleureuse, à la vie et aux œuvres du formidable écrivain.
Le nom de Cendrars évoque à tout coup l'image d'un bourlingueur au long cours parti en son adolescence de La Chaux-de- Fonds pour le bout du monde, via le Transsibérien et l'Amazonie grouillante d'Indiens bleus, la bohème parisienne où il fut de toutes les avant-gardes, la Grande Guerre qui lui coûta sa main droite, et trente-six mille épisodes légendaires dont on disait parfois que la moitié relevait de l'affabulation, sans que le prestige du conteur n'en fût d'ailleurs entamé.
 Or plus on revient à Cendrars, après avoir brûlé de juvénile ferveur pour Moravagine ou pour ses récits des quatre vents, et plus on s'aperçoit qu'au mythe —fondé, mais insuffisant — du grand voyageur et du «personnage», s'ajoutent les multiples facettes d'un individu complexe et tourmenté, romantique et violent, sensuel et mystique, certes mille fois plus ouvert au monde que la plupart des hommes de lettres, mais passant autant de temps dans les livres qu'à l'Université de la rue, et vivant l'écriture comme une seconde respiration.
Or plus on revient à Cendrars, après avoir brûlé de juvénile ferveur pour Moravagine ou pour ses récits des quatre vents, et plus on s'aperçoit qu'au mythe —fondé, mais insuffisant — du grand voyageur et du «personnage», s'ajoutent les multiples facettes d'un individu complexe et tourmenté, romantique et violent, sensuel et mystique, certes mille fois plus ouvert au monde que la plupart des hommes de lettres, mais passant autant de temps dans les livres qu'à l'Université de la rue, et vivant l'écriture comme une seconde respiration.
De ce Cendrars en vérité, sa fille Miriam a dévoilé l'essentiel dans la biographie qu'elle publia en 1984 chez Balland. Or à celle-ci s'ajoute désormais, pour le public non spécialisé autant que pour le lecteur ferré en cendrarsologie surfine, ce qu'on pourrait dire l'introduction idéale à l'homme et à l'Œuvre, en cela que l'ouvrage d'Anne-Marie Jaton a le triple mérite de raconter la vie de Freddy Sauser (que l'état civil de La Chaux-de-Fonds fait naître «du 29juillet au 4 août 1887»...), littéralement enluminée par une profusion d'images combien évocatrices; de retracer parallèlement la saga du poète, de ses premiers tâtons aux chefs-d'œuvre de la cinquantaine; enfin de commenter lesdites œuvres avec autant d'enthousiasme communicatif que de pertinence dans l'aperçu critique et la synthèse.
À lecture de Vol àvoile, plus d'un lecteur s'est imaginé le jeune Cendrars se carapatant de chez lui pour aller courir le vaste monde à la manière d'un beatnik avant la lettre. Or il va de soi que l'histoire de son émancipation est plus compliquée,même si Cendrars s'est choisi précocement un destin «tout autre» et si le thème de l'errance (mais en famille...) s'inscrivit très tôt dans son existence.

De la nature antinomique de Cendrars, Anne-Marie Jaton déchiffre d'ailleurs les traits à visage ouvert, si l'on peut dire, en appliquant la lecture physiognomonique de Lavater — auquel il faut préciser qu'elle a consacré un autre volume des Grands Suisses. Ainsi note-t-elle chez Cendrars l'opposition d'«une intense spiritualité dans les traits tourmentés» et d'«une sensualité trouble et douloureuse dans les lèvres épaisses qui veulent gober le monde», puis «la violence dans les sourcils, la générosité indulgente dans le nez épaté, la mélancolie, la recherche de l'âme et de la profondeur dans le dessin du front, la concentration enfin, l'ardeur et le feu dans l'ensemble du visage».
Parallèlement, le rapport graphologique de Julien Dunilac, étudiant l'évolution de l'écriture de Cendrars «de la main droite à la main gauche», n'est pas moins éclairant et significatif...
A ce portrait de l'homme, l'auteur ajoute en outre, nous l'avons dit, un commentaire sur l'œuvre visant à en ressaisir l'unité profonde. Par-delà son apparente dispersion, l'on voit aussi bien cristalliser un grand dessein poétique. Abeille faisant son miel de toutes les manifestations de lavie — des saveurs les plus immédiates aux spéculations les plus élevées —,Cendrars travaille sans cesse à la transfiguration verbale du cosmos. «On nepeut faire l'analyse d'un grain de blé sans démonter l'univers», écrit-il.
Frère poétique de Nerval mais aussi du feuilletoniste Gustave Le Rouge, Cendrars vit dans sa parole même l'opposition d'une espèce de sauvagerie bouillonnante et du besoin civilisateur de tout filtrer dans les arcanes du symbole et du signe.
 Grand lecteur du monde, dont il s'est appliqué à ressaisir le mystère et les merveilles dans sa grande tétralogie (amorcée avec L'homme foudroyé, poursuivie dans La main coupée et Bourlinguer, puis conclue sur Le lotissement du ciel), Biaise Cendrars nous convie à partager son émerveillement et ses angoisses d'enfant, ses révoltes d'adolescent éternel et son amour, les cendres de la vie et le feu de l'art.
Grand lecteur du monde, dont il s'est appliqué à ressaisir le mystère et les merveilles dans sa grande tétralogie (amorcée avec L'homme foudroyé, poursuivie dans La main coupée et Bourlinguer, puis conclue sur Le lotissement du ciel), Biaise Cendrars nous convie à partager son émerveillement et ses angoisses d'enfant, ses révoltes d'adolescent éternel et son amour, les cendres de la vie et le feu de l'art.
Anne-Marie Jaton, Cendrars. Collection Les Grands Suisses, Editions Slatkine, 160 p.

Aperçu de la fonction apaisante de la bouquinerie Les Fruits d’or : Palliant le froid social de l’époque, certains lieux étaient devenus, dans les villes de moyenne et grande taille, des îlots d’humanité où les gens pouvaient se retrouver sans être assaillis par le bruit ou l’agitation.
Ainsi la bouquinerie Les Fruits d’or, avec son mélange de très jeunes gens très curieux de tout et de veuves lettrées, d’érudits ferrés en langues anciennes et autres beaux vivants de toute sorte, représentait-ellel’une de ces clairières existentielles indispensables à la survie de la Personne en milieu hostile.
À préciser que l’arrière-boutique des Fruits d’or était réservée à l’appréciation des préparations culinaires de la Maréchale et aux réunions du Shadow Cabinet, aux projections de diapositives vintage et à l’exercice du racontar.
La simple conversation y était très vive et fluide et de temps à autre un bon blues-rap déchirant ou une cantate finlandaise y trouvaient libre cours.
Le silence de bunker des âmes asservies et collectivisées, sur fond d’individualisme accroupi, y était défié de la première à la dernière heure du jour.
(Extrait du roman La Vie des gens, inspiré par le souvenir de la librairie La Proue, aux escaliers du Marché, dans le vieux quartier de Lausanne, sous la cathédrale, à gauche en montant. Après une période de purgatoire chrétien, La Proue va renaître en décembre 2015.)

Ghislaine Heger l'a vécu malgré ses hautes qualifications, elle a connu la honte qui a frappé les siens et a voulu en savoir plus sur les galères des autres, pas toujours ceux qu'on croit. Il en résulte un livre où des rencontres, parfois très poignantes, illustrent (par des entretiens personnels et de beaux portraits photographiques) les multiples cas de figures de l'aide sociale, quitte à fracasser divers préjugés lourdement accusateurs...
En tout cas moi ça m'arrivera jamais, vous exclamerez-vous peut-être !? Moi j'ai toujours travaillé et je comprends pas qu'on aide tous ces profiteurs qui se tournent les pouces, la plupart des étrangers! D'ailleurs on peut très bien vivre avec 2000 francs en se serrant la ceinture! Et puis il y en a des qui sont au social et qui roulent en Mercedes avec des lunettes Ray-ban! Et puis tous ces pauvres qui font trop d'enfants, non mais!
Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, et sûr que vous n'y croiriez pas, vous qui ne vivez pas dans un de ces quartiers « mal habités » , si l'on vous disait que la petite Ghislaine que vous croisiez à l'époque dans les escaliers de votre immeuble de l'avenue de Rumine, à Lausanne, donc le beau quartier par excellence, oui, la petite des Heger, s'y est bel et bien retrouvée un jour, « au social », avec son père dont l'affaire avait périclité et qui fermait les yeux sur ses dettes, et malgré les hautes études dont elle est sortie diplômée - mais si vous n'y croyez pas lisez donc ce livre, même s'il est préfacé par ce « communiste » de Pierre-Yves Maillard!
 Laurence, Jimmy, Nelly, Carlos et les autres, solitaires et solidaires
Laurence, Jimmy, Nelly, Carlos et les autres, solitaires et solidaires
Ghislaine Heger nous propose donc ces Itinéraires entrecoupés, rassemblant les témoignages de 23 personnes dont 19 sont de nationalité suisse (on note en passant qu’environ 50 % des bénéficiaires de l'aide sociale sont des Suisses), à quoi s'ajoutent les réflexions de sept personnalités en vue des médias romands (à savoir Amandine, Sergei Aschwanden, Pierrick Destraz, Jonas Schneiter, Anne Carrard, Jean-Philippe Rapp et Isabelle Moncada) manifestant leur solidarité à leurs semblables souvent solitaires qu'on pourrait dire les intermittents de la poisse vu que , le plus souvent, on ne fait que passer «au social».
Sauf que, parfois, la mouise est encore plus tenace que vos meilleurs efforts d'en sortir. Comme c'est arrivé à Laurence, première à témoigner ici et qui a subi tous les coups durs possibles, de jobs perdus pour liquidations économiques en tabassages conjugaux, fuite du désastreux conjoint pillant toute la famille et se retrouvant évidemment, lui aussi, «au social».
Vous croyez qu'il n'y a pas de hasard dans la faute a pas de chance? Bon, c'est vrai que Jimmy, 24 ans au compteur, fils de Chilienne et de père suisse, tous deux alcoolos et toxicos, avait sa voie toute tracée: l’alcool et la dope. Père à seize ans, l’enfant du couple placé en foyer, il s’est retrouvé au plus bas comme son père qui a perdu toute la famille. «Parce que l’alcool et la drogue, c’est un truc pour rester seul». Et pourtant le filet social et ses propres efforts l’ont ramené vers les autres: le petit gars à l'air au bout du tunnel, avec son fiston auquel il espère épargner ce qu’il a vécu.
Vous avez les larmes aux yeux? C'est signe que vous êtes en train de les ouvrir, et ce ne sera pas de trop pour les surprises de la suite.
Avec Nelly, vous pourriez ainsi tomber des nues: Nelly qui a un CV long comme ça dans le médical et l’humanitaire, repartie à 59 ans en Afrique à la rescousse des réfugiés à la frontière camerounaise, donc la vraie mère courage qui a élevé seule ses trois filles et se retrouve soudain foudroyée dans sa santé par un anévrisme de l’aorte qui l’oblige à un arrêt maladie non payé de six mois, avant de recourir «au social».
Or, le parcours de Nelly a quelque chose d’exemplaire, sinon de significatif. Il y a certes des cas plus dramatiques que le sien, comme en témoignent d’autres interlocuteurs de Ghislaine Heger. Mais autant que Nelly, avec un divorce ou les aléas de missions stressantes, une casse de santé ou les obstacles liés à l’âge, chacun est exposé à l’éventualité d’un recours «au social» et à l’humiliation («Vous avez 60 ans et vous devez quémander, c’est blessant et humiliant…»), qui vous ramènent aux réponses stéréotypées des services sociaux vous serinant leur «il faut»!
De belles et bonnes gens…
Vous vous attendez à voir défiler des vaincus aux mines désolées et aux discours paumés? Votre bonne vieille morale de citoyen équilibré qui-a-bossé-toute-sa-vie vous garde de jeter la pierre aux miséreux («pauvreté n’est pas vice», vous a-t-on appris au catéchisme), mais vous trouveriez en somme normal que les requérants du social baissent le nez, d’autant que nombre d’entre eux n’ont pas su résister à l’alcool ou aux paradis artificiels. «Il ne fallait pas», etc.

Et les voici à visages découverts! Ghislaine Heger les a protégés en évitant d’accoler portraits photographiques et témoignages, pour mieux suggérer que les parcours s’entrecoupent. Mais Géraldine Chollet, la belle danseuse, a réclamé cette double identification et, comme celui de Nelly, son discours est éclairant, qui débouche sur une perspective politique.
D’autres, une fois, encore, sont plus mal lotis, mais une exigence revient à l’unisson: le respect de leur dignité.

La galerie de portraits de Ghislaine Heger ne dore pas la pilule pour autant. Des difficultés des uns et des autres rien n’est montré comme une norme: des deux jeunes Sarah (la Suissesse et l’Espagnole) ou de Carlos le Portugais revenu d’Angola et s’épanouissant dans la peinture, de Martial le musicien arraché à l’héroïne et se faisant taper sur les doigts parce qu’il file au Sénégal avec l’argent du social (!), ou de Marie ne demandant qu’à travailler à 22 ans alors qu’elle est «au social» depuis sa majorité…
Or ce qu’on se dit finalement, que confirment les voix solidaires des sept belles personnes s’ajoutant aux vingt-trois autres, c’est que l’aide sociale ne se borne pas aux institutions variées (bien présentes, il faut le relever, et recensées dans le livre de Ghislaine Heger) mais requiert notre attention bienveillante à tous.
Ghislaine Heger. Itinéraires entrecoupés. Préface de Pierre-Yves Maillard. Réalités sociales, Tokyo/Moon, 2017, 207p.

Chroniques de la Desirade (2)
Où la chronique devient un genre majeur, à la fois quête de sens et de style. Et comment faire pièce au double matraquage de la Fatwa Valley et de la Silicon Valley...
Dans son introduction au choix de chroniques (un peu moins de 200 sur les 2000 qu'il a rédigées dans l'urgence en vingt ans) de Mes indépendances, Kamel Daoud évoque la pratique de ce genre devenu très populaire en Algérie, dans les sanglantes années 90, en insistant sur l'aspect vital de cette frénétique quête de sens quotidienne (il lui arrivait de composer jusqu’à cinq chroniques par jour sous divers pseudos) et d'échapper à la jactance précipitée par un style personnel.

C'est essentiellement celui-ci, dès les années 60 (j'avais entre 14 et 16 ans), qui m'a attaché aux chroniques de deux maîtres du genre, dans le Canard enchaîné, aux noms de Morvan Lebesque et de Jérôme Gauthier, le premier figurant l'anar humaniste et le second le pacifiste à tout crin.
Mai 68, pour le meilleur et parfois le pire, aura marqué le pic saillant d'une prise de parole libératrice dont les innombrables publications répondaient à une nécessité du moment, peut-être moins vitale qu'en Algérie dans les années de la guerre civile mais non moins réelle. Mais quoi de durable dans ce magma ? Quelle pensée, quelle parole pour tenir l'épreuve du temps et rester vivace aujourd’hui ? Kamel Daoud se pose la question en relisant ses chroniques souvent limitées à l'actualité et à son public algérien, et la réponse d’un style - bien au-delà des belles tournures et de la rhétorique plus ou moins ronflante - se distingue décidément de la profusion des opinions, avec le sceau du sens.
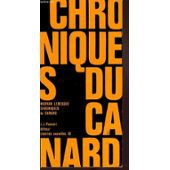
Or qu'est-ce au juste qu'un style ? C'est une pensée et une voix sans pareilles, une façon de parler unique découlant d'une expérience personnelle, mais dans laquelle peuvent se reconnaître d'innombrables “prochains”. Le style de Kamel Daoud m'en impose peut-être moins que celui de Pascal, Bossuet ou Céline, mais ce nivellement par le haut, si j'ose dire, me dit bien moins que ce que le chroniqueur algérien, ce frère humain qui aurait l'âge d'être mon fils, me dit de sa quête de sens, dans l'ici mondialisé et le maintenant de tous, sous le ciel du Dieu muet de Pascal et dans le non-sens et le néant de tous les simulacres.

Donner du sens à sa vie ne relève pas du politique ou de la religion, pour autant que les religieux et le pouvoir politique ne m'imposent pas leur sens unique. Or ce que nous rappellent les chroniques d'un Kamel Daoud, comme “en creux “, c'est que la dépendance à de multiples visages.
Dans sa chronique intitulée L'Arabie saoudite, un Daesh qui a réussi, parue en novembre 2016 dans le New York Times, Daoud décrit l'industrie de persuasion émanant de ce qu'il appelle la Fatwa Valley : “Il faut vivre dans le monde musulman pour comprendre l'immense pouvoir de transformation des chaînes de TV religieuses sur la société par le biais de ses maillons faibles: les ménages, les femmes, les milieux ruraux. La culture islamiste est aujourd'hui généralisée dans beaucoup de pays - Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Mali, Mauritanie. On y retrouve des milliers de journaux et des chaînes de télévision islamistes (comme Echourouk et Iqra), ainsi que des clergés qui imposent leur vision unique du monde, de la tradition et des vêtements à la fois dans l'espace public, sur les textes de lois et sur les rites d'une société qu'ils considèrent comme contaminée”.

Or qu'avons-nous à opposer au sens unique proposé par la propagande théologico-politique de la Fatwa Valley ? Je me le demandais récemment, en Californie, en assistant au matraquage publicitaires des chaînes de télé américaines. Je me suis demandé aussi comment résister à la persuasion clandestine véhiculée par les big data de la Silicon Valley et consorts, aux vérités falsifiées des médias et de leur contempteur présidentiel plus menteur qu'eux, et je me suis répondu une fois de plus que la base de mes indépendances à moi, depuis que jeune garçon je lisais le Canard enchaîné, et ensuite de livres en rencontres, à l'école de la vie et des erreurs, au contact quotidien d'hommes et de femmes plus ou moins sensés - , la seule perception du manque de sens me poussait à en donner un à ce que je vis au jour le jour et que je partage avec celles et ceux, y compris le bougnoule Daoud (pour le dire à la façon des Trump, Le Pen et autres prophètes souverainistes du Grand Remplacement) qui sont du voyage.

A San Diego, nous sommes allés voir, avec le conjoint légitime de notre fille aînée, le film intitulé Le Cercle, tiré du roman éponyme de Dave Eggers, constituant une fable contre-utopique cinglante opposée aux visées sectaires “transhumanistes” de la Silicon Valley. Dans les grandes largeurs du roman faisant pièce à l’idéologie islamiste opposée de la Fatwa Valley, Boualem Sansal a répondu à sa façon dans son magistral 2084.
Autant dire que, du temps bref de la chronique au roman de plus longue durée, la quête de sens est plus que jamais notre affaire.
Kamel Daoud. Mes indépendances. Chroniques 2000-2016. Préface de Sid Ahmed Semiane. Actes Sud, 463p.
Morvan Lebesque, Chroniques du canard, Pauvert, 1960. Reprises (en partie) dans la collection Libertés.
Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015.

Ce jeudi 1er juin. – Composé ce matin la cinquième de mes Chroniques de La Désirade, consacrée à une Défense de la critique, où je dis pas mal de choses que je pense, mais certes pas tout. Cependant qui fait, aujourd’hui, la critique de la critique ? Je ne parle pas des sempiternels râleurs confus, mais de ceux qui, dans le sillage d’un Philippe Muray, diraient ce qu’il y a à dire comme je m’y emploie parfois, bien seul dans mon coin il me semble…
°°°
Je serais à même de dire, je crois, comment la forme, en lumière, la forme et la beauté qui en émane naissent du chaos. Il y a le travail, c’est entendu, mais plus encore : il y a le refus d’expliquer et même de chercher à comprendre.
°°°
Je ne dis pas tout, et de moins en moins. Ou plus précisément : si je dis de plus en plus, tout n’est pas à publier.
°°°
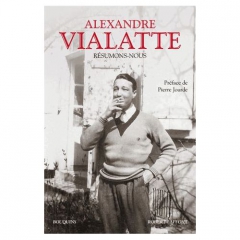 Je suis très intéressé, et non moins impressionné, en lisant le troisième volume, dans la collection Bouquins, des chroniques de Vialatte, consacré (notamment) à ses débuts de rédacteur à la Revue rhénane, en Allemagne, puis à ses articles littéraires parus (notamment) dans Spectacle du monde où il parle (notamment) de Kafka et Buzzati, ou du dernier livre d’Audiberti (Dimanche m’attend), par l’expression immédiate de son génie, et cela aussi dans les lettres qu’il envoie à ses amis de jeunesse, dont un Henri Pourrat, et autant par son exceptionnelle pertinence de critique littéraire que par la lucidité de son observation.
Je suis très intéressé, et non moins impressionné, en lisant le troisième volume, dans la collection Bouquins, des chroniques de Vialatte, consacré (notamment) à ses débuts de rédacteur à la Revue rhénane, en Allemagne, puis à ses articles littéraires parus (notamment) dans Spectacle du monde où il parle (notamment) de Kafka et Buzzati, ou du dernier livre d’Audiberti (Dimanche m’attend), par l’expression immédiate de son génie, et cela aussi dans les lettres qu’il envoie à ses amis de jeunesse, dont un Henri Pourrat, et autant par son exceptionnelle pertinence de critique littéraire que par la lucidité de son observation.

On pourrait dire, évidemment, qu’Alexandre Vialatte, sur le même rang qu’un Henri Calet ou qu’un Charles-Albert Cingria, n’est qu’un « petit maître », mais cette distinction, fondée si l’on songe aux œuvres monumentales des Grands Romanciers et des Grands Poètes de la même époque, n’ôte rien à la qualité spécifique de leur génie, et d’ailleurs aucun de ces trois-là ne me donne envie de lui donner du « maître », alors même que je reste plus profondément attaché à eux qu’à un Montherlant, un Jules Romains, un Gide ou un Claudel.
°°°
Lorsque, maintes fois, j’ai fait allusion, devant des écrivains français de ma génération, au déclin de la littérature française actuelle, ou plus précisément à ce qu’on pourrait dire ses « eaux basses », tous ou presque faisaient les étonnés ou se réfugiaient dans l’argument selon lequel on ne peut juger du temps présent faute de recul, etc.

Alors je me faisais plus insistant, quitte à paraître rasant, en rappelant simplement les sommaires de la NRF entre les années 20 et 50, avec les frontons occupés par les grands auteurs de l’entre-deux-guerres (les Bernanos, Gide, Martin du Gard, Jules Romains, Mauriac, etc.) et, en pied, les auteurs supposés de moindre importance tels que Jacques Audiberti, André Suarès, Charles-Albert Cingria, Henri Calet et bien d’autres dont on ne trouve guère d’équivalent par les temps qui courent. Alors mes interlocuteurs de chercher un ou deux noms garants de qualité littéraire indiscutable, et deux fois sur trois on me sortait le nom de Pierre Michon, et j’étais censé acquiescer d’un air entendu, etc.
°°°
Ce qui m’importe de plus en plus, et de plus en plus exclusivement, sans attention à rien d’autre : l’objet poème et l’objet peinture. Tout le reste, sauf notre vie proche, est secondaire.

Respirer
Très peu de poèmes me parlent vraiment. J’ai lu des quantités de poèmes qui comptent sans doute aux yeux de leurs auteurs ou des lecteurs de poèmes, qui ne suscitent en moi aucun écho même si je trouve que ce sont objectivement de bons ou même de beaux poèmes.
°°°
Mon réalisme instinctif me dit que leur compte est bon. Lire le Zibaldone et pour le Gros Animal: foutez-moi la paix. Aucun salamalec aux courtisans. Sus aux faiseurs. Plus une concession aux raseurs.
°°°
Mes chroniques sont pour moi une façon de lien social, que je pratique depuis des décennies mais de façon plutôt sporadique, selon l’occasion, comme j’en eus à la Gazette de Lausanne et à 24 heures, principalement. Je n’ai pas bien su les concevoir comme une pratique suivie, faute aussi de support et d’attention extérieure. Or, en lisant Mes indépendances de Kamel Daoud, qui a été très stimulé par le milieu et les circonstances politico-historiques propre à l’Algérie, faisant de ses chroniques une urgence, je me dis que c’est celle-ci qu’il faut invoquer même en état de paix, voire de léthargie…

Ce mercredi 14 juin. - Septante ans aujourd’hui. Que je ressens à la marche, réellement de plus en plus pénible voire douloureuse, mais pas dans ma tête, mon cœur (malgré le souffle court et la toujours proche embolie possible, les articulations grinçantes et l’oreille interne en déglingue) ni surtout mon esprit, vif et de plus en plus délié, littérairement productif comme jamais.
Excellent repas d’anniversaire ce midi, avec L. Carpaccio de saumon en entrée, filet de daurade et conclusion en île flottante. Régal. Petite Arvine pour l’entrée et pinot noir ensuite, à rebours de l'usage et tant mieux.
°°°
Avec Annie Dillard je suis meilleur que moi, ou disons que je vais au-delà. Je dois donc la lire tous les jours, comme un viatique.
°°°
Je fais toutes les expériences possibles, en tâchant d’en tirer quelque chose. Eviter cependant la répétition stérile et le parasite.
°°°
Je suis le personnage le plus libre que je connaisse, mais je le garde pour moi. Je serai de plus en plus mesuré dans mes proclamations publiques, mais de plus en plus terrible dans mes observations privées en ces carnets sous leur forme posthume...
°°°
De nouvelles fonctionnalités, apprend-on. Et pour faire quoi ? Je me pose la question, alors que la fonction majeure, qui est de simple communication réciproque, n'est pas employée ou sous-employée dans la plupart des cas.
°°°
Le poète peut-il sacrifier au chic social ou intellectuel ? Je pense que non, ou disons que je demande à voir. C'est cela: l'expérience est à vivre.
°°°
Un poète de ma connaissance vient de participer, à Boston , à un congrès universitaire de poésie. J'ai sursauté en l'apprenant, car ces deux entités, l'université et la poésie, me semblent a priori incompatibles, ou disons qu'imaginer leur rencontre, à Boston, heurte ce qui n'est peut-être qu'un préjugé de ma part. Manque d'ouverture alors ? Je ne l'exclus pas. Je me fais peut-être une idée trop romantique de la poésie (« dans ma soupente / on a la gueule en pente »), et de l'université une représentation trop rigide.
Après tout, l'un de mes poètes européens préférés, le polonais Adam Zagajewski, est un universitaire reconnu « à l'international », et le poète de ma connaissance revenu de Boston est lui même prof de poésie dans la fac de lettres de Lausanne-City, où se tiendra d'ailleurs la prochaine édition du congrès inauguré sur la Côte est, et je vois en lui l'un des rares poètes romands vivants qui me parlent.
Alors pourquoi frémir en apprenant l'existence d'un Congrès universitaire de poésie ? Pourquoi pas une chaire de slam ou de rap ? Pourquoi pas une danse du ventre de Sylviane Dupuis (poétesse romande prisée des universitaires) au prochain Congrès de poésie universitaire de Lausanne ?
J'ai l'air de railler, alors que je m'interroge plutôt en toute bonne foi (si,si) sur la compatibilité du poétique et de l'académique. Façon sauvage, en somme, d'interroger mes préjugés et ceux de la plupart des lectrices et lecteurs de poésie autant que des poétesses et des poètes.
Ma conviction profonde est que le poétique, comme l'Eros énergumène (titre d'un recueil plus ou moins mémorable de feu le poète Denis Roche), va partout, comme le plus clair soleil à travers les salons de massage en enfilade ou les cellules de nonnes taiseuses, de même qu'il y a partout du faux et du chic chiqué, de la rhétorique de cour ou de basse-cour à dindes et dindons, du mâchefer ou du diamant prompt.

Je dois avouer, moi qui me suis mortellement ennuyé à l'université (mais c'est ma faute, j'étais un sale gamin, je l'admets, ne prenant mes vrais cours qu'à l'écart ), que l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie m'ennuie pareillement, dont seules quelques voix proches me parlent, ou « à l'international » un Adam Zagajewski ou un Cees Nooteboom, un Adonis ou un Mahmoud Darwich, une Sylviane Plath qui n'est plus de ce monde mais survit mieux que tant de prétendus intervenants du spectacle ou une Annie Dillard dont la poésie ne se donne qu'en prose, comme celle de Proust, et dix ou cent autres mais guère plus...
« Car la poésie est l'essentiel " pontifiaitt Ramuz le sédentaire terrien, sur quoi Cingria le céleste vélocipédiste ajoutait: … ça a beau être immense, comme on dit : on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue ». Ce jeudi 22 juin. – Ma bonne amie fête ses 69 ans aujourd’hui. Notre petit séjour à Chamonix s’est achevé à merveille ce matin ; même si elle était un peu patraque hier soir, nous avons passé deux belles journées en ces lieux magnifiques, et G. et moi avons particulièrement apprécié notre virée à l’Aiguille du Midi et jusqu’à la pointe Helbronner, que mon cher beau-fils découvrait à vrai dire…
Ce jeudi 22 juin. – Ma bonne amie fête ses 69 ans aujourd’hui. Notre petit séjour à Chamonix s’est achevé à merveille ce matin ; même si elle était un peu patraque hier soir, nous avons passé deux belles journées en ces lieux magnifiques, et G. et moi avons particulièrement apprécié notre virée à l’Aiguille du Midi et jusqu’à la pointe Helbronner, que mon cher beau-fils découvrait à vrai dire…
°°°
Ne plus chercher d’assentiment, de qui que ce soit. Ne se fier qu’à soi.
 À La Désirade, ce vendredi 30 juin. – Nous fêterons ce soir nos 35 ans de mariage, à Grindelwald, où j’ai tant de beaux souvenirs d’enfance du côté de Mühlebach, dans les prairies ensoleillées surmontées de créneaux de pierre et de glaciers aux séracs bleutés comme suspendus à l’aplomb des roches rincées, du Wetterhorn à l’Eiger.
À La Désirade, ce vendredi 30 juin. – Nous fêterons ce soir nos 35 ans de mariage, à Grindelwald, où j’ai tant de beaux souvenirs d’enfance du côté de Mühlebach, dans les prairies ensoleillées surmontées de créneaux de pierre et de glaciers aux séracs bleutés comme suspendus à l’aplomb des roches rincées, du Wetterhorn à l’Eiger.
Il a fait ce matin une belle lumière sculptant les montagnes d’en face, aiguisant leur découpe et accentuant leur relief comme sous une loupe cristalline, que j’ai saluée avec reconnaissance en poursuivant la lecture de l’étonnante Histoire de douze heures, dont chaque page me touche au cœur. Je me lamente souvent à propos de l’effrayante dispersion d’attention et d’énergie qui s’observe sur le réseau des réseaux, et plus largement dans la dis(société) qui nous entoure, et puis c’est le miracle : un inconnu lecteur de mes Carnets de JLK qui m’envoie un livre méconnu qu’il vient de tirer de l’oubli, et cette découverte renversante d’une pensée et d’un style « vieux » d’un siècle, dans un livre écrit en captivité par un prisonnier français, dont le manuscrit fut confisqué par les Allemands et que son auteur, François Bonjean, a réécrit tout entier de mémoire en 1918. Or j’ignorais qui était cet auteur et le découvre grâce à ce David Aimé qui anime les éditions Banyan, spécialisées en littérature orientale et que j’ai retrouvé sur Facebook que d’aucuns réduisent à une poubelle. Or tout n’est-il pas poubelle aujourd’hui dans le chaos du monde, et n’est-ce pas dans ce fatras que nous avons à frayer notre infime chemin avec nos loupiotes ?
Donc nous sommes sur le départ direction l’Oberland par le Pays d’Enhaut, alors que mon vieil ami le tout jeune Maveric m’apprend à l’instant, sur Messenger, qu’il part lundi pour l’Inde et se désole de ne trouver point de Cingria dans les librairies parisiennes pour en emporter au Bengale. Avoir vingt ans en 2017 et manquer de Cingria ! Encore une grâce, caramba ! Et de m’inviter, le lascar, à lui rendre bientôt visite là-bas où il va faire ses armes de candidat à la Carrière et se mettre un peu sérieusement à l’écriture. Sacré Maveric qui m’écrivait en russe à 16 ans, sur Facebook. Sacrée poubelle !
°°°
 L’événement du jour, c’est pour moi de découvrir, ce matin , le magnifique papier que le compère Jean-François Duval a consacré à La Fée Valse. Je me plains souvent de n’être pas lu ou mal, mais une telle approche m’est comme une justification et un rare bonheur.
L’événement du jour, c’est pour moi de découvrir, ce matin , le magnifique papier que le compère Jean-François Duval a consacré à La Fée Valse. Je me plains souvent de n’être pas lu ou mal, mais une telle approche m’est comme une justification et un rare bonheur.
Or ce papier, le voici : « On ouvre le livre, on lit quelques pages, et tout de suite naît cette impression qu’à chacune d’elles les mots sont essentiellement là pour prendre tout leur bonheur, sous une multiplicité d’éclats. Et tout aussi vite l’on se dit « Mais qu’est-ce que c’est ? De quoi s’agit-il ? A quoi a-t-on affaire ici ? ». D’entrée de jeu (littéralement, car les mot sont bien là pour jouer), on éprouve ce plaisir si particulier d’entrer en déroute.
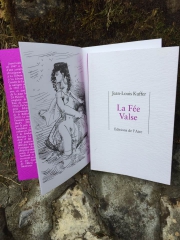
Si La Fée Valse est composé de plus d’une centaine de textes, la quasi totalité parvient à se tenir sur une seule page, comme si cette seule et unique page leur suffisait comme place de jeu. Comme si cet espace relativement réduit, à ne pas dépasser (par quelques imaginaires contraintes oulipiennes), justifiait et servait d’autant mieux leur profusion et leur éclatement.
À quel genre ce livre appartient-il ? Est-ce de la prose poétique ? De petits textes en prose ? Plus intrigant encore : où donc JLK trouve-t-il ses sujets, ses motifs ? – car tous relèvent du jamais vu, le lecteur s’en avise très vite. Oui, où les trouve-t-il, cet écrivain-là ? Impossible à dire justement (sinon adieu la féerie vers laquelle pointe déjà le titre de l’ouvrage) tant la trame elle-même du recueil repose sur l’exigence d’une surprise, toute fraîche et toute neuve en ses mouvements, dans laquelle croquer – chaque fragment possédant sa saveur propre. « Maudite fantaisie ! », s’écrient d’ailleurs certains (dans le morceau intitulé Petit Nobel). La fantaisie ? « L’ennemi à abattre », poursuivent-ils. Tant pis pour ces mauvais esprits, bataille perdue : ce n’est certes pas dans La Fée Valse que pareil assassinat se laissera commettre. Ici la fantaisie n’est pas à renverser, elle est reine.
Bref, voilà un livre selon mon goût. Car aujourd’hui – et c’est l’un de mes désespoirs –, la situation de la littérature est telle que j’aime que l’on ne puisse rattacher une œuvre à aucun genre bien défini. Je suis contre les genres (même si je lis parfois des romans par un banal souci de distraction comme je regarderais une série télévisée, ce qui n’a rien à voir avec la littérature). S’écarter des genres établis, ne serait-ce pas encore la meilleure façon de ne pas reproduire les schèmes et formes convenues du passé, que perpétue le 90% des livres empilés sur les tables de libraires ? Mieux ! On fait d’une pierre deux coups : non seulement on s’écarte des chemins rebattus, mais le moyen est aussi idéal pour laisser libre cours à l’esprit d’invention. Voilà donc ce qu’on peut d’emblée poser à propos de La Fée Valse : ce livre est de ceux qui appartiennent à une essence différente, comme disent les botanistes.

« Qu’est-ce que c’est ? » Essayons tout de même d’aller un peu plus loin dans cette question. JLK (ou son narrateur) nous en fait l’aveu page 90 : « Quand j’étais môme, je voyais le monde comme ça : j’avais cassé le vitrail de la chapelle avec ma fronde et j’ai ramassé et recollé les morceaux comme ça, tout à fait comme ça, j’te dis, et c’est comme ça, depuis ce temps-là, que je le vois, le monde. » Qu’importe évidemment si la péripétie est véridique ou non. Ce qu’il vaut en revanche de noter, c’est ceci : tout l’art de JLK, en tant qu’écrivain, relève exactement du même genre d’entreprise.
Ce vitrail cassé d’un coup de fronde et dont on recolle les morceaux, c’est exactement le même vitrail qu’ambitionne d’être La Fée Valse (en quoi le livre est bien à sa place dans la nouvelle et très belle collection « métaphores » créée aux éditions de L’Aire). Le livre de JLK est ainsi fait de morceaux, et l’on peut dire à son propos ce que dit l’un des textes à propos des tableaux de Munch : « Les couleurs ne sont jamais attendues et classables, chaque cri retentit avec la sienne …»
Voilà. La Fée Valse tient du vitrail brisé et recomposé. C’est un ensemble de morceaux. Et qui dit ensemble dit aussi exigence d’harmonie. Une exigence qui, notons-le au passage, nous vient du fond des âges et des traditions. Dans le judaïsme par exemple, la kabbale n’a pas d’autre fonction : à dessein, Dieu a brisé sa création comme il l’aurait fait d’un vase, et c’est à l’homme de recoller les morceaux, de recréer le monde. C’est aussi le travail de l’artiste véritable. Ecrivain, sculpteur, compositeur, peintre… Rien d’un hasard si La Fée Valse fait parfois référence à quelques-uns des peintres préférés de l’auteur (JLK ne pratique-t-il pas l’art de l’aquarelle, du moins si j’ai bien compris ?). Surviennent donc ici et là les noms de Munch, Soutter, Valloton, Rouault, Van Gogh, Soutine…

Ce qui confirme notre sentiment : La Fée Valse est bien une histoire d’œil, un recueil composé de regards éclatés – mais pas seulement éclatés, répétons-le, puisque leur fonction est de recomposer le réel autrement, d’une façon d’autant plus lumineuse (la lumière du vitrail) qu’elle est poïétique.
On ne recompose pas non plus un vitrail sans que cela tienne de la quête. Et la quête, d’ordre fantasmagorique, est bien présente dans ce livre : ce peut être par exemple celle de la bague d’or de notre enfance, à propos de laquelle le narrateur (l’un des narrateurs car il faut y insister, La Fée Valse tient dans un bouquet de voix) déclare : « Je n’ai pas fini de lui courir après… », avec cette conséquence qui laisse toute sa place aux jeux de l’amour et du hasard : «… au jeu de la bague d’or, déjà, ce n’était jamais celle que je voulais à laquelle il fallait que je me prenne un baiser-vous-l’aurez. » Ce livre se donne comme une poursuite. Et une poursuite joueuse, le jeu avec la langue n’étant pas l’un des moindres plaisirs qui soit ici délivré au lecteur.
S’il fallait trouver un dénominateur commun à ces morceaux, on dira que le principal est précisément celui-ci : le jeu avec la langue, charnelle, vivante, orale, riche de tours et d’expressions, enracinée aussi dans son propre passé, langue française vieille d’un millénaire, et pourtant toujours à se chercher, à se réinventer au travers de quelque trouvaille (JLK est très à l’écoute de la langue qui se parle aujourd’hui). On peut gager que l’ouvrage se prête très bien à la lecture en public.
Car c’est un bouquet de voix, il faut y insister : La Fée Valse ne se contente pas de mettre en scène un seul narrateur. Non ! Multiples sont les voix qui se font ici entendre : les narrateurs sont plusieurs, tantôt masculins, tantôt féminins, tantôt singuliers, tantôt pluriels. Ce peut être « Je » mais ce peut aussi être « On », « Il », « Vous », « Nous » ou « Moi ». Qui parle ? (L’oralité tient une grande place dans ce livre). Eh bien, c’est la langue elle-même, dans sa diversité.
Une langue qui jamais ne se laisse prendre au piège d’une fermeture sur soi qui la figerait, mais qui se veut toujours en mouvement, autant qu’il est possible, à force d’explorations et d’inventivité. Ce qu’on sent là, c’est un goût de la faire fuser en expressions diverses, en tours de phrases surprenants… Reprenons la métaphore : c’est comme si l’écrivain s’amusait, page après page, à composer un bouquet à partir de fleurs choisies (les mots) dont tirer des assemblages neufs, originaux, frais, déconcertants.
On ne s’étonnera donc pas, comme il est normal devant un bouquet, que le plaisir soit non seulement verbal, musical, mais aussi visuel. Si bien que l’on va de page en page un peu comme on avancerait dans une riche galerie d’art, s’arrêtant et s’attardant devant chaque tableau pour le laisser infuser et pénétrer pleinement en soi. Que les amateurs de lectures rapides passent leur chemin !
Pour en revenir un instant à la question du genre : a-t-on jamais vu de la satire sociale dans la prose poétique (moi jamais, mais je ne sais pas tout) ? J’y vois une preuve de plus que La Fée Valse s’écarte de ce genre-là, car de la satire sociale, il y a en bien, ici ! Ainsi lorsque, en ironiques Majuscules, il est question d’un tout jeune nouveau comptable du Service Contentieux de l’Entreprise. Ou de la personne préposée aux Ressources Humaines (curieuse expression qu’on n’entendait jamais dans les années 60).
Le livre de JLK ne manque pas de moquer ainsi, par un effet de contraste, toute la distance qui sépare le monde de l’art de celui dont une certaine novlangue nous fait vainement miroiter les facettes, en dépit de son grand Vide. Passons.
Il y a un dernier point : La Fée Valse se garde d’être explicite (où serait le mystère ? quel espace serait encore réservé à la fantaisie ?). Non, ces morceaux de féerie précisément ne visent pas à épuiser ce que la langue peut dire : en tout, le livre préserve la part de l’imaginaire, et finalement de l’incompréhensible. L’auteur sait très bien cela : pas plus que le fameux « Traité uniquement réservés aux fous » du Loup des steppes de Hermann Hesse ne s’adresse à tous (Hesse a soin de nous en prévenir), La Fée Valse ne se laisse saisir par ce qu’il est convenu d’appeler le « lectorat », sorte d’entité vague composées d’amateurs de lectures faciles, digestibles à souhait, fourguées comme des plats pré-préparés pour le plus grand nombre possible. Non, La Fée Valse, on l’aura compris, est à placer au rayon des livres rares ».
Putain ce que ça fait du bien !!!
°°°
S’il y a écho, il y a possibilité de bonheur, mais ne nous en tenons pas aux retours flatteurs. Je ne serai jamais dupe du flacon ou de la publicité tapageuse, et tels sont les réseaux sociaux : de la pub et du tapage. Seules les voix sont à distinguer, j’entends : les voix personnelles.
°°°
Règle sage à méditer tous les jours : ne rien attendre de qui n’a rien à donner.
°°°
 Je suis, depuis quelque temps, très préoccupé par la question de l’âge, mais pas du tout au sens où on l’entend à l’ordinaire sous l’effet de la crainte de vieillir et de décliner, mais au contraire avec la sensation de me trouver en décalage constant, mentalement et intellectuellement parlant, avec mon corps effectivement fatigué et déclinant, aux articulations grinçantes et aux muscles douloureux, au souffle en déficit et de plus en plus dur de la feuille, alors que je me sens intérieurement débordant de curiosité et d’énergie; de fait je vis et vibre plus vigoureusement qu’en mes jeunes années, je deviens de plus en plus poreux et curieux de tout et mes travaux s’en ressentent à tous égards avec un bonheur et des réussites que je n’ai jamais connues avec autant d’allant et d’intensité.
Je suis, depuis quelque temps, très préoccupé par la question de l’âge, mais pas du tout au sens où on l’entend à l’ordinaire sous l’effet de la crainte de vieillir et de décliner, mais au contraire avec la sensation de me trouver en décalage constant, mentalement et intellectuellement parlant, avec mon corps effectivement fatigué et déclinant, aux articulations grinçantes et aux muscles douloureux, au souffle en déficit et de plus en plus dur de la feuille, alors que je me sens intérieurement débordant de curiosité et d’énergie; de fait je vis et vibre plus vigoureusement qu’en mes jeunes années, je deviens de plus en plus poreux et curieux de tout et mes travaux s’en ressentent à tous égards avec un bonheur et des réussites que je n’ai jamais connues avec autant d’allant et d’intensité.
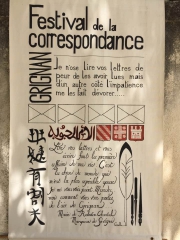
Ce vendredi 7 juillet. – C'était donc reparti pour un tour de manège et pas moyen d'y échapper: il fallait y aller, l'invitation avait été acceptée et ç'eût été malpoli et inamical de se défiler, une amie perdue de vue depuis des siècles et retrouvée m'avait proposé de participer à ce Festival de littérature alors que je m'étais promis de fuir désormais les salons et signatures et lectures et débats à tourner en rond - bravo mais sans moi, toute forme d'attroupement me terrifie et m'assomme, vive l'agora mais pas à plus de trois ou de sept ou de douze a la rigueur extrême, et la probabilité de cuire dans ce four achevait de m'accabler, mais je souriais en même temps, ma bonne nature me rappelait tant de belles surprises en pochettes, et L. s'encourageait elle aussi malgré son peu de goût partagé pour les conglomérations culturelles en touffeur caniculaire, donc c'était parti mais pian piano, tout en détours et dérogations, par l'ubac du lac, escale café glacé à Thonon-les-Bains, routes secondaires à n'en plus finir avant de rallier l'autopiste a poids lourds intempestifs où la lecture pallierait l'insupportable...
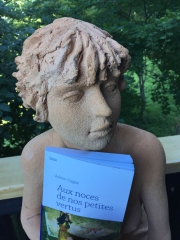
Or le meilleur aura été, du vallon de Villard à Valence, la lecture de l'épatante évocation de la rencontre de la Marylou de Kerouac, par Jean-Francois Duval, dans la dernière longue et belle chronique de son recueil intitulé Et vous, faites-vous semblant d’exister ?, où il retrouve in vivo la blonde protagoniste du roman-culte Sur la route, et, en alternance, la suite du premier roman du jeune Romand Adrien Gygax, Aux noces de nos petites vertus, très étonnant et détonnant récit des frasques festivesd'une poignée d'adorables personnages se démantibulant à cœurs et corps déliés entre un trou de Macédoine et la sublime porte d'Istanbul...
°°°
Le rêveur Duval distingue excellemment la double nature du pigeon, selon qu'il conchie votre balcon ou qu'il illustre l'indépendance libertaire d'un être picorant et indifférent aux fluctuations du cours du baril, stoïque comme Sénèque et n'en faisant qu'à son caprice sauvage. L'observation des canards incline aux mêmes conclusions philosophiques en plus fluidement gracieux, vu que le canard flotte.
Ce samedi 8 juillet. - De ricanants raseurs n'en finissent pas de conclure à la fin de tout: que ces festivals estivaux ne sont que de l'écume touristique pour babas & bobos, que la littérature et les arts ne sont plus ce qu'ils étaient, que l'hyperfestif à tout nivelé et qu'il n'y a plus qu'à tirer l'échelle.

Or dès notre arrivée dans la grande arche aux murs safran couverts de lierre des Deux-Terres, dès la première vision des chats somnolents et de la chambre d'écriture dans la lumière ocellée du sous-bois, dès l'accueil ensuite tout cordial et débonnaire de l'hôte André et de tout un joyeux essaim d'amies; dès notre montée ensuite par les escaliers et les ruelles aux éventaires couverts de livres, jusqu'à la petite esplanade couverte de toiles blanches sous lesquelles j'étais censé participer au café littéraire de midi, toute ma prévention s'est dissipée et la suite n'a été que de bons échanges jusqu'à la lecture et au souper du soir à la longue table amicale.

Il est vrai que les moins de 33 ans se comptaient sur les doigts d'une main, voire moins, dans le parterre de têtes blanches venues écouter l'Helvète de passage, mais la jeune animatrice, Catherine Pont-Humbert ne m'a pas moins gratifié d'un accueil chaleureux et compétent, fondé sur une lecture attentive de mon Enfant prodigue et me laissant improviser très librement sur ses thèmes proposés. Et ensuite, que d'aimables demandes de dédicaces flattant ma vanité naturelle et ma joie surnaturelle !
°°°
« J'écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie ». Signé Henri Michaux dans Passages.
°°°
 Le roman d’Adrien Gygax, Aux noces de nos petites vertus, m’étonne par son mélange d’ingénuité et de pénétration, de naïveté primesautière parfois, avec ses images et ses métaphores à la limite de la gourderie et qui sonnent pourtant juste - comme tout le livre quasi sans faille mais qui défrisera les puristes et les pédants – sa formidable énergie et sa plasticité sans pareille dans sa façon d’évoquer les lieux (la Grèce, la Macédoine, puis Istanbul) et plus encore dans sa capacité de faire vivre des personnages, à commencer par ses deux fringants jeunes protagonistes se partageant la craquante Gaïa.
Le roman d’Adrien Gygax, Aux noces de nos petites vertus, m’étonne par son mélange d’ingénuité et de pénétration, de naïveté primesautière parfois, avec ses images et ses métaphores à la limite de la gourderie et qui sonnent pourtant juste - comme tout le livre quasi sans faille mais qui défrisera les puristes et les pédants – sa formidable énergie et sa plasticité sans pareille dans sa façon d’évoquer les lieux (la Grèce, la Macédoine, puis Istanbul) et plus encore dans sa capacité de faire vivre des personnages, à commencer par ses deux fringants jeunes protagonistes se partageant la craquante Gaïa.
Surtout il y a là-dedans un ton unique, une originalité de vue tout à fait rare, quelque chose de l’ahurissement walsérien et une propension sentencieuse qui rappelle parfois les formules définitives du Voyage au bout de la nuit, mais dans une tonalité souvent burlesque et sans qu’il y ait probablement de filiation directe – en tout cas pour Walser.
Le roman tient à la fois du « film » épique genre road-story, avec une narration déconstruite à la Fellini ou à la Kusturica, du conte (notamment pour le motif du double en rivalité érotique sublimant joyeusement le scabreux de la situation) et du tableau de mœurs d’une époque et d’une génération.
Ma première lecture à haute voix, sur la route de Valence à la Désirade, a passé par de véritables pics d’intensité, et ma deuxième lecture, stylo-scalpel en main, ne fait que confirmer cette première impression tout à fait saisissante.
Bref ce sera, après le deuxième roman de Quentin Mouron, Notre-Dame-de-la-Merci, le livre d’un jeune écrivain qui m’aura fait la plus forte impression, avec Les oies de l’ile Rousseau de Xochitl Borel, très au-dessus de la production, souvent talentueuse au demeurant, des auteurs romands de moins de 33 ans - et j’y reviendrai de manière bien plus détaillée à sa parution prochaine, au rang des premiers romans constituant, et c’est rarissime, une véritable découverte…
°°°
À de certains moments, il semble que la physiologie, autant que la convention sociale, poussent le jeune à rappeler au vieux ce qu’il est: à savoir un croulant bientôt bon à jeter, rares étant ceux qui échappent à cet automatisme grossier. Or il me semble qu’A. déroge à cette règle, au vu de ses courriels naturellement respectueux, mais c’est à vérifier.
°°°
Couper court à toute forme de distraction. Seul comptant l’objet. Les beaux messieurs à souliers pointus et les dames civiles – la civilité invoquée par le poète universitaire -, ne m’en imposent pas plus que les ordonnances de pharmaciens. Je suis libre et je danse – à ma façon. Modestie et bienveillance pour armure douce. Lire Dante et Dillard. Surtout : peindre en laissant la couleur monter avec le temps. Et pour aller vers le portrait : dessiner…
L’éclair de Satan tombant du ciel (on se demande de quel ciel…) est à mes yeux le parasite par excellence de la distraction au sens fort, que Pascal appelait le divertissement. Le diable disperse et défait. Diabolo de la diablerie dilatoire, apéro débilitant.
°°°
L’attention est une modulation de ce que l’on peut dire l’amour.
°°°
La pratique du mot pour un autre me semble une caractéristique de la poésie, tout au moins de la poésie qui me touche.
°°°
L’ennui avec le journalisme, et toute forme de bavardage, c’est qu’ils ne sautent jamais une phrase sur deux ni ne prennent jamais un mot pour un autre, force au contraire de la poésie.
°°°
Quelqu’un entend ce que je dis : miracle, non du tout de vanité mais d’entente avérée et de possibilité d’une île Littérature.
°°°
Malgré mes plus de 4000 « amis » sur Facebook, j’ai plus que jamais l’impression de ne communiquer vraiment qu’avec une douzaine de personnes dont un tout jeune homme depuis qu’il était puceau, un ami libraire, une sizaine de plus ou moins retraitées férues lectrices et bonnes vivantes - entre la rue de l’Ale lausannoise et les hautes Pyrénées, la Picardie et le Brabant ou les abords d’Yverdon-les Bains -, plus deux ou trois compères écrivains, à part quoi c’est la jactance de la meute et le picorage distrait, le frétillement des followers et les « j’aime » qui ne signifient rien, la solitude innombrable et le déballage des opinions et des postures, bref tout l’opposite de la communication vivante et vivifiante.

Le sommeil conseille à la nuit de se confier au rêve.
°°°
Revenir à Michaux peut s’imposer en cas d’attaque de sérieux ou d’excessives statistiques. La potion du Dr Vialatte est également recommandée à quiconque broie du noir.
°°°
 Adrien Gygax me parle de source pure à propos de La Fée Valse. Il se prétend dénué de toute compétence critique, mais ce qu’il m’en dit, par le détail et à sa façon inouïe, est tellement plus que ceux qui n’en disent rien…
Adrien Gygax me parle de source pure à propos de La Fée Valse. Il se prétend dénué de toute compétence critique, mais ce qu’il m’en dit, par le détail et à sa façon inouïe, est tellement plus que ceux qui n’en disent rien…
°°°
On ne comprend rien à la littérature en se figurant que c’est pour faire joli ou juste pour s’évader, alors qu’elle n’est qu’invasion.
°°°
Tout à coup je me rappelle, je ne sais pourquoi, les éphèbes qui tournaient autour de Leonor Fini, dans son monastère corse, et le très bel androgyne blond représenté sur une de ses toiles et qui peignait ses fonds.

Ce mercredi 19 juillet. – Je constate que je parle très peu de nos filles dans ces carnets. Or ce n’est pas faute d’intérêt ou d’affection, tout au contraire : c’est par crainte d’épingler le papillon, de trahir sa beauté avec mes pauvres mots et d’attenter à la liberté de son vol, entre autres égards qu’inspirent le respect et la pudeur.
°°°
L'idée de Foucault, consistant à penser contre soi-même, me paraît excellente et tout a fait d'actualité ces jours.
°°°
 J'ai (re)commencé ce soir de lire Walden de Thoreau, après y être entré quelques fois mais jamais comme ce soir à minuit. Nous marions demain notre fille et Walden est exactement le livre qu'il me fallait à l'instant.
J'ai (re)commencé ce soir de lire Walden de Thoreau, après y être entré quelques fois mais jamais comme ce soir à minuit. Nous marions demain notre fille et Walden est exactement le livre qu'il me fallait à l'instant.
Au début du chapitre Économie, Thoreau affirme que les vieux ne sont pas de meilleur conseil que soi-même et je trouve ça juste et bien, propre à nous libérer d'un préjugé tenace. Quand je pense aux conseils que m'ont donné les vieux, à part nos parents qui n'en donnaient guère, je me dis qu'aucun, à commencer par Dimitri qui avait des conseils à donner à tout le monde sans en suivre lui-même aucun, ne m'a été d'aucune aide par ses belles paroles, ni le pauvre Haldas ni le très vieux Robert Poulet qui m'a enjoint, lorsque je lui ai rendu visite à Marly-le-Roy, au début de 1982, de ne pas entrer dans le XXIe siècle, en clair: de ne pas faire d'enfant. Or Sophie était déjà en route, comme on dit, et je n'ai eu qu'une réponse en tête face au vieux fasciste dont je savais que la fille s'était suicidée à cause de lui: allez vous faire voir…

Je vais faire de Walden ma lecture continue de ces prochains temps. J'y entrevois la source, ou l'une des sources, de la pensée d'Annie Dillard, et j'y retrouve mon propre sentiment du monde de 7 à 7O ans, relevant d'une sorte d'anarchisme candide. Je suis seul devant la Nature, qui me parle mieux que les gens ou, plus précisément, que les institutrices et les pasteurs, etc.
Ce vendredi 21 juillet, jour de noces. - Beau temps ce matin et belle humeur, qu'on va tâcher de garder jusqu'à minuit. Grand jour pour J., dont la sœur, couturière à ses heures, refait ce matin la voilette après qu'elle a oublié hier la première au restaurant où ces dames se préparaient à l'événement.

Ce samedi 22 juillet. – L’événement familial et social d’hier serait à décrire par le détail et de bout en bout, depuis l’apparition de la mariée dans la Grand-Rue de Morges, enceinte jusqu’aux yeux et triomphante dans sa robe de mariée blanche, et ensuite la cérémonie à l’Hôtel de Ville , l’officière de l’Etat-Civil toute pétulante d’humour et non moins dignement officielle, s’inquiétant d’abord de savoir si mon petit discours annoncé aurait des connotations religieuses puis découvrant que les deux conjoints annoncés seraient à vrai dire trois avec l’enfant, et la promesse, les petites larmes, la congratulation générale et les photos de tous par tous, enfin la procession disloquée sous la pluie jusqu’à l’hôtel de charme, et les heures, jusqu’à point d’heure pour certains, passées à picorer et picoler dans la bonne humeur, sans la moindre fausse note - oui tout ça serait à décrire sous la forme d’une nouvelle affectueusement ironique ou par un épisode de série télé, mais à l’instant je suis un peu fatigué et me contente d’en sourire en tendre complicité, etc.
°°°
Spectacle désolant de l’atomisation, chacun replié sur son petit écran, tous connectés en apparence et dissociés pour l’essentiel, sans aucune curiosité réelle sauf pour le déjà vu et recuit. On consomme et on profite, on dit qu’on échange et puis quoi – et puis rien !

La meute en même temps
glapit-adore-ignore,
élit, élude, abhorre,
déglutit et vomit.
L’œil enregistre tout.
Jamais il n’a été
si fermé à l’ouvert.
Quand tout et son contraire,
le voyant, le violeur,
le suave arrogant
et la mère sans secours,
à jamais diffondus,
confondent au plus confus
l’encore et le toujours.
Morts digitalisé
ou peut-être vivants –
qui voit le différent
dans le pareil au même
sans mémoire et sans rêves ?
Pourtant le verbe aussi,
le verbe vert et vif,
passe tous les dénis.

Rilke l’a recommandé en émiettant un biscuit de marbre dans sa tisane : « Tu dois changer ta vie ! », et c’était en mémoire du torse d’Apollon de Rodin. Mais tous les jours je m’en tiens à l’injonction de Michaux : « Le matin, quand on est abeille, pas d’histoire, faut aller butiner ». Leçon aussi du milieu : sans les siens que serait-on ? Et le chien, qu’a-t-il à dire ? Les petites filles instruites par une louve, de retour forcé en milieu protestant, dépérissent : c’est prouvé. Et cette autre leçon de ce matin : trouver le sentiment porteur. Pourtant je dirais plutôt en mon for intérieur : le noyau.

À l’enseigne des Éditions Noir sur Blanc paraissent les deux premiers volumes de la série de rééditions slaves et «étrangères» de L’Âge d’Homme. Le grand éditeur y eût-il vu une captation indésirable, voire une trahison ? La démarche généreuse de Véra Michalski illustre au contraire la devise du passeur, «on continue !» et lui fait honneur autant qu’à celles et ceux qui l’ont secondé ou soutenu…
La bibliothèque de Dimitri ? Mais je l’ai sous la main ! Rien qu’à la tendre je pêche tel ou tel livre fétiche de mes jeunes années, que ce soit un des dix-huit volumes à couleur safran des Œuvres de Cingria rassemblées par mon vieil ami Pierre-Olivier Walzer et la cantatrice Gisèle Peyron fan folle de Charles-Albert, ou Feuilles tombées de Vassily Rozanov dont un soir, dans la maison sous les arbres de Vennes, au coin de sa bibliothèque à lui, Dimitri me dit que c’était un livre «fait pour moi»; ou la nouvelle traduction (par Luba Jurgenson) de l’adorable Oblomov d’Ivan Gontcharov avec lequel il fait bon cosser au coin du feu; ou le génial Kotik Letaev d’Andrei Biély qui sonde les abîmes de la première enfance en poète-psychologue un peu toqué; ou le pavé bleu tendre de L’Ange exilé de Thomas Wolfe qui a enchanté la jeunesse yougoslave de Vladimir; ou les douze volumes du Journal intime d’Amiel qui a piqué la première curiosité du Dimitri de vingt ans débarquant dans une librairie de Neuchâtel, ou encore L’Inassouvissement de Stanislaw Ignacy Witkiewicz qui fut, avec Cingria, son contraire en tout, l’un des dieux littéraires de notre jeunesse – j’en passe et des milliers d’autres titres publiés par L’Âge d’Homme qui m’ont accompagné cinquante ans durant, avec une tendresse particulière pour le petit recueil d’entretiens que nous avons publié de concert chez un concurrent (horreur et délices !) du nom de Pierre-Marcel Favre, en 1986, sous le titre ô combien juste et précis de Personne déplacée,incluant une suite de libres propos sous cet autre titre redoutable de Carnets du barbare…
Les fondateur sont des tyrans irremplaçables
En écoutant Vladimir Dimitrijevic me raconter sa vie de Tsigane toujours errant mais en pantoufles ces soirs-là, dont il me reste vingt-cinq cassettes enregistrées parfois entrecoupées de longs silences ou de sanglots ravalés – quand il me parlait des rues de Belgrade de son enfance aux cadavres couverts de fleurs, ou de ses visites à son père emprisonné -, puis improvisant sur les thèmes que je lui proposais ou qui lui venaient spontanément à l’esprit (de l’animal, de la musique, morale d’Helvète, Simenon, de la maladresse, ours et Tsiganes, du cinéma, de la transfiguration, etc.), j’ai découvert ce qu’on peut dire un homme inspiré, une sorte de poète oral qui semblait parfois vaticiner, et les 4000 livres de son catalogue le prouvent aujourd’hui : un immense passeur de l’édition francophone que Claude Frochaux son bras droit, aussi dévoué à la cause commune de L’Âge d’Homme que résolument opposé à toutes ses idées en matière religieuse ou politique, a qualifié de «génie».
Or il ne s’agit pas de céder à je ne sais quel culte de la personnalité, même si Dimitri, à l’hybris surdéveloppée, aimait à cultiver sa propre légende, mais le fait est que L’Âge d’Homme, sans la folie constructive et la tête de pioche du fondateur, n’aurait jamais existé, et que L’Âge d’Homme d’après celui-ci ne pouvait lui survivre qu’autrement, la tête de pioche bis de sa fille creusant son propre sillon…
Évoquer le nom d’Andonia Dimitrijevic, alors, qui fut, avec la douce et courageuse Genevève, sa mère admirable, dans le retrait discret et l’ombre du souvent ombrageux Titan, de celles et ceux qui ont assuré à la base la survie matérielle et administrative de la grande petite maison, doit nous rappeler, précisément, que la bibliothèque de Dimitri est aussi celle de toute une communauté de bonnes volontés et de passions partagées.
Du petit cercle familial intime baigné par la lumière du sourire en coin et de la présence de Geneviève , tellement accueillant pendant une vingtaine d’années aux tout proches durant l’enfance de Marko et d’Andonia (dont un Gérard Joulié l’infatigable traducteur, Richard Aeschlimann l’artiste passeur d’artistes, Jil Silberstein le poète et futur grand voyageur), aux piliers et soutiens professionnels de L’Âge d’Homme, tels, déjà cités, Claude Frochaux et Pierre-Olivier Walzer, et les grands slavistes Georges Nivat et Jacques Catteau dès le tout début, ou Freddy Buache passeur de cinéma et directeur de collection, et Dominique de Roux à Paris dès la première heure aussi, ou Alain Van Crugten le traducteur belge de Witkiewicz, la bibliothèque de Dimitri n’a cessé de croître et de se multiplier au service d’auteurs aussi différents les uns des autres qu’un Georges Haldas et un Pierre Gripari, un Etienne Barilier et un Hugo Claus, un Gore Vidal et un Alexandre Zinoviev, un Alexandre Tisma et un Vidosav Stevanovic anti-Milosevic et un Dobritsa Tchossitch cautionnant celui-ci avant de se faire virer du pouvoir, etc. Mais l’on touche ici à la guerre, et ce fut une autre histoire…
Les Michalski, grands passeurs de l’Autre Europe…
Il y a quelques décennies, donc avant la chute du Mur et du Rideau de fer, marquant l’effondrement du régime communiste que Vladimir Dimitrijevic a fui à vingt ans, l’on parlait des pays de l’Est comme de l’ «autre Europe», dont la littérature est extrêmement présente dans la bibliothèque de Dimitri, mais pas seulement: aux rayons russes de «ma» bibliothèque de Dimitri, et plus précisément aux centaines de volumes ocre des fameux Classiques slaves, se mêlent pas mal de couvertures noires des traductions du russe publiées par Jan et Vera Michalski à l’enseigne de Noir sur Blanc, alors que l’inverse se produit sur le rayon polonais où la dominante noire ou rouge (les œuvres complètes de Slawomir Mrozek) laisse moins de place aux traductions polonaises de L’Âge d’Homme, où Witkiewicz tient la première place.
Mais c’est bel et bien à l’enseigne de Noir sur blanc que je trouve le merveilleux Proust contre la déchéance de Joseph Czapski, et que vois-je là caramba : Les Aïeux de l’immense Adam Mickiewicz en deux traduction « concurrentes », aux i de L’Âge d’Homme et chez Noir sur blanc, l’un à côté de l’autre !
Tout cela pour dire que le blanc pur des couvertures de la nouvelle collection intitulée La Bibliothèque de Dimitri va faire la somme des diverses couleurs, et qu’avec les mânes du passeur on reprendra sa formule préférée : « On continue… ».
Dans les Carnets du passeur, florilège de pensées qui émaillent la dernière partie de Personne déplacée, Dimitri, sous le titre de Question, se demandait ceci : « Je me pose toujours cette question: que feront les gens lundi prochain ? Cesseront-ils d’acheter des livres, ou cesseront-ils d’acheter des choses superflues ? »
Autant dire que, lundi prochain, vous vous pointerez en librairie pour vous jeter sur L’Inassouvissement de Witkiewicz, fabuleuse plongée dans l’avenir de l’auteur (qui s’est suicidé en 1939 devant l’agression conjointe de la Pologne par les armées allemandes et soviétiques, comme il l’avait prévu) devenu notre présent à de multiples égards; et qu’en bonus vous vous offrirez La colombe d’argent d’Andréi Biély, satire d’une secte folle comme il en a proliféré depuis le début du XXe siècle - et ce n’est pas fini ! Parce que La bibliothèque de Dimitri n’en est qu’à ses débuts sous la direction du dernier bras droit du grand passeur, en la personne de Marko Despot qui connaît la musique et le refrain : « On continue ! »
Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. Entretiens avec Jean-Louis Kuffer. L’Âge d’homme collection Poche Suisse, 224p. 2008.
Andréi Biély. La colombe d’argent. Traduit du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton, postface de Georges Nivat. Éditions Noir sur Blanc, La Bibliothèque de Dimitri, 449p. 2019.
Stanislaw Ignacy Witkiewicz, L’Inassouvissement. Avant- propos et traduction du polonais revue par Alain van Crugten. Editions Noir sur Blanc, La Bibliothèque de Dimitri, 608p.
Dessin : Matthias Rihs.

Je n'aime pas, le soir,
te savoir loin de moi.
Les voyelles se meurent
quand l'amour est trop loin
de ce qu'on dit le coeur,
qui devient alors HERZ,
pour ne pas dire SCHMERZ ,
dans ce pays fermé.
Vienne n'est pas ce soir
une ville amoureuse:
il y a dans l'escalier noir
un Hitler à la voix
de sinistre mémoire,
criant comme une mitrailleuse.
Et tout est si suave
dans les salons de thé
VERBOTEN à tout étranger.
Le monde m'ennuie, amie,
quand tu es loin de moi.
(À Vienne sans L., en 1995, avec visa renouvelé en février 2019)


Ce qu'écrit Isabelle Roche sur son blog, à propos des Jardins suspendus.
Je disais donc...
je crois d'ailleurs savoir où j'irai en premier...
En écrivant cela je pensais à une page très précise d'un cahier bien particulier, où le soin que j'ai mis à ne pas laisser mes phrases déborder dans la marge contraste avec l'écriture hâtée, fébrile, fortement raturée et, en bien des points, quasi illisible tant les lettres sont déformées. Écrire si mal, de manière si peu lisible, témoigne moins d'une fébrilité à capter une pensée insaisissable que d'une conviction obscure et profonde, sans doute agissante tandis que j'écrivais, que cela ne vaut rien – n'a pas en tout cas la valeur, la signifiance que je lui ai vue sous le coup de l'embrasement scriptural. La meilleure preuve est qu'en à peine quelques jours ce que je croyais avoir amené à se mouvoir dans le texte ne m'est plus perceptible. Mais en réécrivant, en retouchant, peut-être quelque chose sortira-t-il de ce chaos...
J'ai inscrit une date en haut de la page – j'entendais ainsi marquer que le surgissement était consécutif au travail que j'effectuais alors: la lecture-correction des épreuves d'un recueil de textes de Jean-Louis Kuffer, Les Jardins suspendus* – mais elle est erronée: j'ai noté «semaine du 17/09» quand la période correspondant à ce travail est cette même semaine mais du mois suivant. Un lapsus révélateur de mon rapport au temps. Deux pages plus loin, ce fouillis au crayon, toujours issu de la lecture des Jardins suspendus:
La présence = «arrêt sur être» que seul l’art peut rendre manifeste.
Présence: un mot stable où se meut imperceptiblement un perpétuel flux d’être à régime variable.
Et sur mon bureau numérique, contemporain de cette page de cahier mi-ordonnée mi-chaotique, un fichier-texte sauvegardé sous le titre BROUILLON:
C'est bien souvent sous les mots des autres – quand on est lecteur goûteur de mots et que ces «autres» sont d'authentiques écrivains – que l'on découvre quelques clés menant à l'une ou l'autre de ses propres vérités. Ainsi ai-je tout juste – juste avant de consentir à taper, ici, ces lignes, pour une fois cédant à la pulsion brute de «filer la phrase» à défaut de métaphores pour donner forme à l'un, au moins, de ces innombrables afflux discursifs qui sans cesse me traversent – tout juste compris, donc, à travers de savoureuses phrases de Jean-Louis Kuffer le concernant lui ou d'autres écrivains dont il dit si bien l'art, de quelle nature pouvait être ce mystérieux embrasement d'où naissent tant de sublimités textuelles.
La littérature – c'est-à-dire cet usage non ustensilaire de la langue qui fait proliférer confluences et ambiguïtés sémantiques, jeux sonores, interpolations lexicales... toutes choses qui fondent la littérarité – a ce pouvoir unique...
Quel pouvoir? Bien vite mon élan a été coupé, ne restent que ces points de suspension par lesquels je me signifiais qu'il y aurait une suite à écrire. Je crois qu'elle est là, sur la page de cahier – oui, en effet:
La littérature a ce pouvoir unique de faire vibrer entre les mots, les phrases, une ineffable présence, un «au-delà de ce qui est écrit» peignant à l’horizon de la lecture un vague paysage qui donne à celle-ci sens et relief – un vague paysage propre à chaque lecteur et dont l’auteur ne saura jamais rien. Le vrai critique, le critique lumineux, est celui qui sera capable de rendre justice à la littérarité d’autrui non pas seulement en citant de larges extraits – car ce faisant il reste en surface, dans une monstration qui n’amène pas le lecteur dans les profondeurs bouleversantes de l’écriture dont il est question – mais en faisant à son tour advenir dans ses phrases une littérarité singulière, en suscitant à son tour un «vague paysage». Celui qui saura aussi, en même temps, faire entrevoir au lecteur ce «paysage» qu’il a lui-même entrevu en lisant, et souligner comment l’écrivain dont il parle parvient à rendre manifeste la présence mystérieuse.
Jean-Louis Kuffer est de cette confrérie des critiques lumineux.
Mais avant que d'avoir extrait de la note broussailleuse ce qui précède, quelque peu désordonnée et pressée surtout d'attraper un peu de sens quand des phrases avenantes se présentent qui paraissent le servir, j'avais ajouté au bas de ce BROUILLON :
Un livre admirable, où en toute page se révèle la langue d'un orfèvre-joaillier – non pas «langue de poète», une expression si figée qu'elle me semble rapetisser le «poète», et l'auteur de Jardins suspendus, poète assurément, ne mérite en aucune façon pareil sort – qui excelle à faire rutiler l'écriture des autres mais aussi, taillant à facettes ses propres mots et rythmes, les émerveillements qui tiennent son âme en éveil, qu'ils soient suscités par les livres ou par les innombrables percepts offerts à tout moment par le monde environnant.
Donnant irrésistiblement envie de lire les livres dont il parle, d’aller à son tour, par les chemins littéraires, à la rencontre des écrivains auxquels il prête l’oreille, Jean-Louis Kuffer s’avère un passeur majuscule pour cette autre raison qu’en ces délectables «jardins suspendus» il fait advenir ce miracle rare: à travers des expériences profondément intimes dont il transfigure par son écriture la singularité, l’irréductibilité, il tend à qui le lit de ces mêmes clefs de vie, de ces mêmes clefs d'être qu'il a trouvées au creux des livres. Ainsi dit-il, par exemple, de la lecture: Avant de commencer à écrire, entre seize et vingt ans, j’ai d’abord vécu les mots, si l’on peut dire: j’ai vécu ce rapport parfois vertigineux qu’on peut éprouver devant l’étrangeté mystérieuse des mots qui découle de l’énigme insondable de notre présence au monde.
… Voulant rapiécer toutes ces bribes à seules fins introscopiques – car sous les mots de Jean-Louis Kuffer, je crois bien avoir ramassé deux ou trois clefs d’or, dont il me faut maintenant apprendre à me servir – je me suis aperçue que je retouchais et réécrivais non pas tant pour cerner de plus près quelles jouissives lumières m’avaient apportées ce livre mais pour, au bout du compte, tâcher de rendre hommage à un auteur que je lisais pour la première fois. Mais alors il me faut rajouter deux ou trois petites choses à propos du livre.
À l’évidence compilation de textes déjà publiés c’est avant tout une totalité qui se tient par elle-même et pensée comme telle, où chaque pièce a été subtilement retaillée pour prendre place à l’intérieur d’une architecture extrêmement précise.
Outre que se glissent ici et là des poèmes, de petites fugues autobiographiques, on voit que les interviews, les articles critiques ont été habilement pérennisés, non pas coupés artificiellement de leur époque d’écriture (certains sont explicitement datés) mais revus de telle manière que celle-ci en relève la saveur dans notre présent en dépit des années écoulées. L’on a ainsi un recueil exceptionnel, qui mérite d’être lu comme un ensemble mais dont on peut, aussi, goûter chaque texte isolément, dans l’ordre que l’on veut – et quel que soit le mode de lecture adopté, le plaisir sera pareillement intense.
Pour toutes les richesses que contient le livre dont je ne laisse rien paraître, des points de suspension suffiront qui vaudront invite à visiter sans attendre ces Jardins…
Jean-Louis Kuffer, Les Jardins suspendus, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2018. 416 p. - 27,00 €.
Ce texte est extrait du blog: http://terres-nykthes.over-blog.com
Portrait de JLK: Philip Seelen.
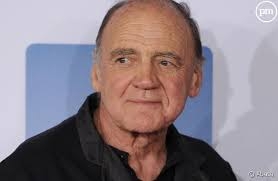
Le plus grand comédien suisse de ces dernières décennies vient de nous quitter, à l'âge de 77 ans. Au tournant de sa 70 année, le Festival de Locarno l'avait honoré.
Ma correspondance dans le quotidien 24 Heures, en 2011.
Septuagénaire cette année, Bruno Ganz fête aussi un demi-siècle de présence continue sur la scène internationale. On peut rappeler alors qu’avant ses débuts au théâtre, Bruno Ganz fut un petit Suisse comme les autres, ou presque.
Né en 1941 à Zurich dans un milieu d’Helvètes moyens, il eut d’abord à affronter un père qui ne voyait pas d’un bon œil cette lubie de comédien, à moins de l’être «à côté » d’un métier digne de ce nom. Son paternel lui trouva donc une place d’apprentissage de peintre en bâtiment… à laquelle il ne se présenta jamais, préférant rejoindre les comédiens allemands souvent fameux que la capitale alémanique avait accueillis pendant la guerre.
Dès ses vingt ans, ensuite, le jeune acteur se retrouva à Berlin où il allait participer, avec Peter Stein, à l’aventure de la Berliner Schaubühne. Dix ans plus tard, il était sacré acteur de l’année pour son rôle dans une pièce de Thomas Bernhard.
Quant au cinéma, ce fut en 1967 qu’il y vint dans Haut les mains de Jerzy Skolimovksi, prélude à une carrière marquée par le non conformisme et la recherche de qualité.
Avant-gardiste alors ? Pas exactement. En tout cas pas intello sectaire ! Disons plutôt que rien de ce qui est humain n’est étranger à Bruno Ganz, qui fut l’ange Damiel dans Les ailes du désir de Wim Wenders, et le démoniaque Adolf Hitler dans La chute d’Olivier Hirschbiegel.

Avec autant de puissance que de maîtrise intelligente, ce comédien venu du théâtre est de ceux qui n’ont pas besoin de «surjouer» pour imposer leur présence tout en se coulant dans les personnages les plus divers.
Au Festival de Locarno, en 2006, on le découvrit ainsi en grand-père anarchisant dans Vitus, de Fredi M. Murer, puis on le retrouva l’an dernier en vieil amant émouvant dans La Disparition de Giulia de Christoph Schaub.
L’ensemble de sa filmographie associe en outre son nom à ceux des plus authentiques créateurs du 7e art, d’Eric Rohmer (La Marquise d’O) à Théo Angelopoulos (L’éternité Et un jour) en passant par Alain Tanner (Dans la ville blanche), Francis Ford Coppola (L’Homme sans âge) ou Volker Schlöndorff (Le faussaire). Son honnêteté intellectuelle l’a amené à refuser, en 1993, d’incarner Oskar Schindler dans la fameuse Liste de Schindler de Spielberg, alors qu’il a accepté de se mettre dans la peau d’Hitler pour une interprétation dénuée de toute complaisance.

Si le comédien a été gratifié des plus hautes distinctions, l’homme Bruno Ganz est resté aussi simple qu’ironiquement débonnaire, tel qu’il apparaissait d’ailleurs dans Vitus. Autant dire qu’on se réjouit particulièrement de voir ce très grand Monsieur du cinéma d’auteur monter sur la scène de la Piazza Grande, le 11 août prochain, pour recevoir un léopard « à la carrière » avant la projection en première mondiale de Sport de filles de Patricia Mazuy, film français dans lequel on le retrouve en entraîneur équestre de légende.
Enfin, nous retrouverons Bruno Ganz dans d’autres films projetés cette année à Locarno, à commencer par La provinciale de Claude Goretta, gratifié pour sa part d’un léopard d’honneur, mais également La Marquise d’O de Rohmer, La Chute déjà citée et Le couteau dans le tête de Reinhard Hauf, illustrant autant d’aspects de l’immense talent d’un véritable médium-interprète.
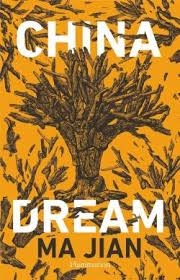
Que se passait-il dans la tête du président Xi Jinping lorsque, le 17 janvier 2017, au Forum économique mondial de Davos, ce pur et dur communiste chinois fit l’éloge du libre échange devant un parterre de capitalistes durs et purs qui s’en trouvèrent apparemment épatés ?
Se poser la question revient à se demander ce qui se passait dans la tête de l’actuel président de la Confédération helvétique Ueli Maurer quand, en visite à Pékin en 2013, au titre de ministre des affaires étrangères, il affirma crânement que, s’agissant du massacre de Tian’anmen, en 1989, donc il y avait plus de vingt ans de ça, il était temps de «tirer un trait» sur cette page «tournée depuis longtemps». Et l’on imagine, passant en battant de ses deux ailes, l’ange Win-Win invoqué in petto par les deux présidents.
Dans la foulée, je me rappelle que le boss du parti suisse majoritaire UDC (Union Démocratique du Centre) auquel est affilé le ministre Maurer, le milliardaire suisse Christoph Blocher, n’avait pas attendu ces années de prescription pour «tirer un trait» sur les pages des plus sombres années du maoïsme, ayant été l’un des premiers industriels suisses à composer commercialement avec la Chine communiste sous le même battement d’ailes de l’ange Win-Win.

Or voici ce qu’écrivait Simon Leys il y a juste dix ans de ça, dans sa préface à la réédition du livre qui fut l’un des premiers témoignage lucides et honnêtes sur la meurtrière Révolution culturelle chinoise célébrée par tant d’idiots utiles occidentaux, de Jean-Luc Godard à Philippe Sollers, et jusque, tout à l’heure, par l’impayable Alain Badiou :
« La Chine a connu ces dernières années de prodigieuses transformations. Elle est en passe de devenir une super-puissance – sinon la super-Puissance. Dans ce cas, elle sera – chose inouïe – une super-puissance amnésique. Car, jusqu’à présent, sa miraculeuse métamorphose s’effectue sans mettre en question l’absolu monopole que le Parti communiste continue à exercer sur le pouvoir politique, et sans toucher à l’image tutélaire du président Mao, symbole et clé-de-voûte du régime. Et le corollaire de ces deux impératifs est la nécessité de censurer la vérité historique de la République Populaire depuis sa fondation : interdiction absolue de faire l’Histoire du maoïsme en action – les purges sanglantes des années cinquante, la gigantesque famine créée par Mao (dans un accès de délire idéologique) au débit des années soixante, et enfin le monstrueux désastre de la « Révolution culturelle » (1966-1976). Treize ans après la mort du despote, le massacre de Tian’anmen (4 juin 1989) est encore survenu comme un post scriptum ajouté par les héritiers, pour marquer leur fidélité au testament laissé par l’ancêtre-fondateur. Mais ces quarante années de tragédies historiques (1949-1989) ont été englouties dans une « trou de mémoire » orwellien: les Chinois qui ont vingt ans aujourd’hui ne disposant d’aucun accès à ces informations-là – il leur est plus facile de découvrir l’histoire moderne de l’Europe ou de l’Amérique, que celle de leur propre pays. »

Au terme de la même préface, Simon Leys écrivait encore, par rapport à l’effort de certains de pallier l’amnésie chinoise, au risque de ne pas « tirer un trait » sur la tragédie de Tian’anmen, entre tant d'autres
: «La métaphore la plus éloquente de la situation présente est encore ce Coma de Pékin évoqué par Ma Jian : le protagoniste du roman (la plus puissante création produite à ce jour par la littérature chinoise contemporaine) est un jeune manifestant décervelé par une balle perdue de Tian’anmen, qui flotte, paralysé, muet, sourd et aveugle, dans un coma sans fin »…
C’était il y a dix ans. Depuis lors, le seul nom de Ma Jian, auteur de plusieurs livres tous interdits en Chine, a été condamné pour « pollution spirituelle » et vit en exil à Londres où a paru China Dream, le Rêve Chinois, satire dévastatrice des hautes sphères du pouvoir chinois actuel, disponible aujourd’hui en traduction français sous le titre de … China Dream, un tableau satirique formidablement vivant et non moins émouvant par son regard sur la Chine des Chinois réels dont le pouvoir aimerait extirper les rêves personnels pour leur imposer un seul Rêve Chinois sous contrôle et, à terme, implanté en chacun par le truchement d’une puce numérique.
Dédié à la mémoire d’Orwell, ce roman saisissant, qui rappelle à certains égards la satire antisoviétique d’un Alexandre Zinoviev dans Les hauteurs béantes, nous est balancé comme en miroir vu que ce rêve « chinois » amnésique et hyper-consumériste est aussi le nôtre avec sa fuite en avant, son clinquant hideux, sa société inégalitaire, ses ville flottantes de luxe et ses terres spoliées, etc.
Or je reviendrai, beaucoup plus en détail, sur ce roman qui nous défie de tirer aucun trait sur la réalité telle qu'elle est, fût-elle désobligeante voire carrément inappropriée...
Ma Jian, China Dream. Flammarion, 2019. Egalement disponible en version numérique sur Kindle.
Dans la foulée de Dickens ou de Poil de carotte, l’enfance blessée n’en finit pas d’inspirer des livres qui sont parfois de terribles réquisitoires, comme « Le Prince d’Aquitaine » de Christopher Gérard, ou des remémorations plus amples et nuancées à la manière de « François, roman », récit autobiographique de François Taillandier. Deux ouvrages également remarquables par leur très belle écriture et leur pouvoir d’évocation, voire d'identification.
L’exergue du Prologue du Prince d’Aquitaine du romancier et essayiste belge Christopher Gérard, dont le titre fait allusion au fameux poème El Desdichado de Nerval («Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l’Inconsolé / Le prince d’Aquitaine à la Tour abolie : / Ma seule étoile est morte et mon luth constellé / Porte le soleil noir de la Mélancolie»), introduit parfaitement ce roman qu’on pourrait dire l’exorcisme littéraire d’une enfance et d’une adolescence bafouées par un père incarnant le parfait pervers narcissique : «Et là où le désordre conduit à la souffrance, et la souffrance à la plainte muette, là fleurit la poésie», citation tirée de Neiges d’antan de Gregor von Rezzori.
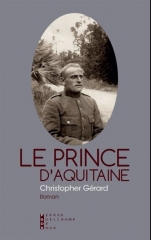
S’agit-il vraiment d’un roman, dont les personnages relèveraient de la pure fiction ? Je n’en crois rien mais ne ferai pas un début d’enquête à ce propos, car je tends à prendre pour «vérité vécue» les tribulations du narrateur qui dit JE avec une immédiate véhémence et dit TU à son père qui ne l’a pas tout à fait tué.
De fait, Le Prince d’Aquitaine transforme le schéma œdipien classique du fils supposé tuer papa pour se taper maman, en un scénario non moins fréquent dans certaines familles dignes d’être haïes, où le père s’acharne à rabaisser sa progéniture et, si c’est un garçon trop brillant, à le «tuer» d’une façon ou de l’autre. En l’occurrence, ce sera avec une mesquinerie et une bassesse rares. Qui plus est, le père en question, incapable de transmettre quoi que ce soit à son fils, s’est ingénié à effacer, après sa mort, toute trace de son père à lui, héros de la Grande Guerre, blessé en septembre 1914 par une salve d’artillerie sous les remparts d’Anvers, immobilisé pendant des années et voué finalement à «la pitié de femmes», à commencer par la Grand-Mère en laquelle son fils trouvera un recours récurrent à ses folles dépenses et autres malversations, et le petit-fils un soutien affectif introuvable auprès de ses parents.
La bascule des Golden sixties
Je ne sais pas vous, mais nous autres, mes sœurs et notre frère aîné, avons eu la chance d’être entourés, aimés, encouragés par des parents soucieux de notre présent et de notre futur, avec le soutien de grands-parents également attentifs et bienveillants, dans un milieu plutôt modeste encore contraint d’«économiser», au lendemain d’une guerre qui avait épargné notre pays.

Or curieusement, je trouve, dans Le Prince d’Aquitaine, de multiples échos à ce que nous avons certes vécu tout autrement mais avec les mêmes «couleurs» d’époque, Christopher Gérard marquant admirablement la transition d’un monde qu’on pourrait dire d’«avant» à celui qui suivrait les « golden sixties ».
Son instituteur Cornet aux rituels quasi militaires, je l'ai connu sous les traits d'un Monsieur Besson sévère mais juste, et même si elles nous ont été épargnées, les «colonies» pas toujours jolies où son père s’empressait de «caser» son fils durant les mois d’été, aux ambiances de petites casernes plus ou moins religieuses à réfectoires sinistres et moniteurs à l’avenant, évoquent tout un univers fleurant encore les années 50.
À l'opposé, le papa flambeur et joueur, fonçant en Alfa Roméo ou en Porsche entre sa jeune épouse américaine humiliée et sa maîtresse allemande, ses potes de ribotes et autres putes, ses dettes accumulées et ses petites arnaques (jusqu’à piller son propre fiston) annonce le monde d’ «après» que nous connaissons, de l’égoïsme cynique et du chacun pour soi matérialiste et vulgaire, auquel le garçon, traité avec mépris de «petit intellectuel» par son tyran alcoolique, va s’opposer dans son quant à soi immunitaire, passionné qu’il est de sciences naturelles ou d’archéologie, puis de littérature, jusqu’au jour lointain où il rencontrera l’âme sœur qu’il appelle «l’Aimée».
Si Le Prince d’Aquitaine relève de l’exorcisme, et même d’une certaine revanche posthume, c’est par le brassage de la vie et par l’exceptionnel relief de ses observations, traduites par une écriture claire et cinglante, bien accordée au défi de l’ «Inconsolé», que ce livre nous atteint et nous touche. On se rappelle ce que Balzac a fait de sa cousine Bette, pas vraiment un modèle «sympa» elle non plus. Et plus puant que le père indigne du Prince d’Aquitaine, on ne saurait l’imaginer. Mais quel personnage !
 Le regard intransigeant de notre ange gardien
Le regard intransigeant de notre ange gardien
Passé le tournant de la soixantaine, quelque vingt-cinq livres à son actif, reconnu du public et de ses pairs, candidat à l’Académie française, François Taillandier se retrouve face à un garçon de sept ans dont nous découvrons le portrait en pied au début de son nouveau «roman», petit bonhomme à l’air grave, «petit mais intraitable, avec son blouson et sa frange, et son regard déterminé à ne céder à rien», et l’écrivain de se demander : «Mais qui est-il ? Qui est-on ? Il l’ignore lui-même. L’enfant sort de la nuit, de l’inconscience, de l’ignorance».
Ce qui revient à se demander, et nous avec : mais que suis-je donc devenu, que sommes-nous tant d’années après au regard de cet enfant que nous avons été, devenu parfois un étranger, parfois un fantôme oublié, parfois encore – et ce sera le cas ici – une sorte d’ange gardien ?
À ces questions, et à tant d’autres qui concernent toute une génération et le monde en mutation qu'il a vu évoluer, François Taillandier répond par un récit autobiographique qu’il sous-intitule «roman» pour le distinguer, peut-être, d’un «récit de vie» comme il en pullule par les temps qui courent, mais en somme aussi peu «roman» que le Pedigree de Georges Simenon, et néanmoins aussi «romanesque» que celui-ci par la traversée du temps retravaillée qu’il représente, et par ses climats divers – entre Auvergne profonde et quartiers parisiens -, ses personnages bien silhouettés et la chronique opposant là aussi un «avant» provincial et un «après» mondialisé, une culture séculaire marquée par la religion et un nouvel univers «pluriel» et souvent perdu…
La contrée et ses gens
La première partie du récit, intitulée La contrée, s’ouvre sur une phrase marquant d’emblée le passage d’un monde à l’autre (« … Moi en tout cas je n’étais pas né sur une « planète »), opposant, à notre vision actuelle de terriens soucieux de «sauver la planète», celle d’une Création présentée à ses élèves par une certaine demoiselle Marthet, institutrice à l’école Saint-Gabriel, à Clermont Ferrand, qui dispensait ses leçons de catéchisme, au début des années 60, avec « la même méthode élémentaire et implacable dont elle usait pour nous inculquer le kilogramme, le multiplicande ou la conjugaison des verbes du deuxième groupe ».
Et le styliste charnu de s’en donner illico à cœur joie : «Mademoiselle Marthet était une de ces raseuses vieilles taupes, emphytéotiquement confites dans une virginité mielleuse à la fois et miaulante, que les parents appréciaient parce que, paraît-il, elle aimait les enfants…Je ne dis pas le contraire. J’ai su bien plus tard qu’elle se souvenait, devenue une très vieille dame, de chacune de ses classes, et du nom de chacun des gamins qui s’y trouvaient».
Tout un monde ! Et qui a existé à Lausanne aussi, dans le quartier de Chailly où, derrière le vieux collège, une demoiselle Chambovey nous fit tirer un portrait de classe, à l’automne 54, où je me reconnais le même air «dans la lune» que le jeune François...
Comme le disait volontiers ce cher Alexandre Vialatte, l’Auvergne remonte à la plus haute Antiquité, et c’est dans ce monde de volcans et de pneus Michelin (le père de François, d’abord ouvrier à l’usine, y était devenu cadre supérieur), de campagnes montueuses et de rues tortueuses (Clermont la ville représentant la première «nature» élue par le garçon), évoquant le passé Gallo-Romain par un arrière-grand-père mythique et la pacification chrétienne par une grand-mère mystique sur les bords, dans cette contrée d’innocence biblique (même le péché originel était alors innocent» à sa façon) et de truculence tribale que nous emmène Taillandier, comme dans un grand village d’Astérix où voisinent des tantes pittoresques et des figures, tel Raquet le boucher vieux garçon, bon type sauf quand il a trop bu au point de noyer le chien de La Chose, laquelle ne le cède en rien à la Louloune, fille du quincailler Lotiron, sans parler du redoutable Tâton, «personnage d’ombre dont on était menacé de la visite si l’on chipotait sur sa soupe ou refusait d’aller au lit ». Bref, ça ne se raconte pas : ça se lit !
La bonne vie d’hier et d’aujourd’ui, et foin d'idéologies…
François Taillandier, romancier très attaché à la perception et à l’interprétation du réel, tout en revisitant sa contrée natale avec les yeux d’un enfant solitaire aux yeux bien ouverts, n’en fait pas un Eden pour autant mais arpente une France des contrées qui rappelle un peu la Creuse de Jouhandeau ou la Corrèze de Richard Millet, avec une tendresse qui n’exclut pas un coup de gueule en passant, contre un prof de gym sadique qui lui fait subir en ricanant le supplice connu de la poutre, entre autres humiliations dont l’écrivain se venge en nommant le sale type (lui aussi nous l’avons connu !) par son nom et en se jurant, au dam de toute mansuétude chrétienne, de ne jamais lui pardonner.
Et l’écrivain de se déchaîner derechef : « Moi j’ai vécu, m’entendez-vous, et j’ai levé le nez sur l’horizon. Ma vie belle surplombe de haut votre vie de minable. Chaque livre que j’ai lu, Grenier, chaque ville où j’ai volontairement perdu mes pas, chaque rivage respire, chaque nuit d’ivresse ou de rire m’aura vengé de vous en secret ».
Puis il y aura la découverte, après les comptines, de la poésie, avec trois vers de Marie Noël ou trois strophes de Victor Hugo, et le chant plus immédiat dans les chansons (de Jean Ferrat, notamment) et ensuite les tirades de Cyrano, et plus tard Aragon; et les filles, d’abord tout timidement et ensuite en Don Juan.

Entretemps on aura passé de la contrée à Paris via Le fleuve et le train de la deuxième partie, et ce sera mai 68 et le remplacement du catholicisme par le catéchisme freudien, pas mal de pas de côté voire d’égarements dans l’oubli de l’ange gardien François, et des retours, d’autres avancées, et la mise en garde du petit garçon à son «rejeton» plus âgé: «Tu te campes dans tes décombres, François, et tu regardes ce que tu peux faire. N’aie crainte : François t’aidera. ».
De François à François, de lui à vous, de vous à toi au miroir, devant ce que nous avons été enfant et qui reste en nous, telle est la retrouvaille : «Il ressortait de l’ombre et de l’exil dans lesquels je l’avais relégué».
Et toi ? Et vous ? Pourriez-vous dire comme François Taillandier : « François m’avait retrouvé, et il me prenait par la main (…) Depuis, je crois que nous ne sommes plus jamais lâchés ».
Pour moi c'est tout vu, à l'approche de mes 73 balais consommant la retombée extra-lucide, et c’est tout le bien que je vous souhaite à vous aussi...
Christopher Gérard. Le Prince d’Aquitaine. Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 157p. 2018
François Taillandier. François, roman. Editions Stock,262p. 2019.

…Ce qui nous a branchés, et cela nous est sans doute resté de nos interminables entretiens philosophiques dans les sous- bois de notre université buissonnière, c’est l’arborescence de tout ça, dans la turbulence nébuleuse des cosmologies restées à l’état de conjectures, l’arbre des curiosités sous nos doigts de gamins, le grand jeu princier de la poursuite prétendue triviale soudain accessible à tous, l’encyclopédie feuilletée dans le cliquetis insonore et tout qui s’allume sur la Toile comme un vitrail quand le jour se lève…
Image: Philip Seelen.

L’argentique reste ce qu’il fut comme le noir et blanc du cinéma le plus pur, mais une nouvelle modulation de la nuit américaine redonna, par l’usage approprié des computeurs de pointe, du mordant mélancolique à ces moments d’effarement solitaire où tout à coup tout semble sculpté au ciseau d’obsidienne.
Image: Philip Seelen.
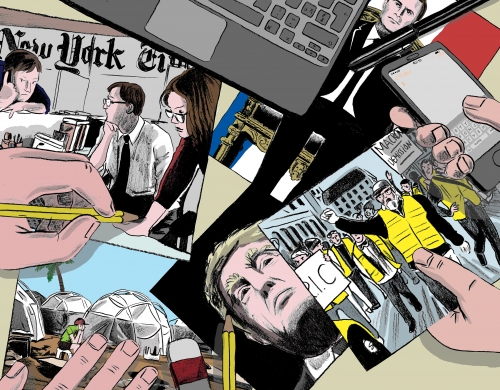
Après le «Que faire» russe du début du XXe siècle, Emmanuel Todd se demande: «Où en sommes-nous?» La question implique la nouvelle complexité du réel mondialisé, défiant les explications binaires, et nous porte à grappiller les éléments de réponse un peu partout, dans la trame de nos vies et sur la Toile, en restant plus que jamais attentifs à l’élément humain…
En ma qualité particulière, voire générale, de 72e chronique des compères JLK et Matthias Rihs, j’émerge ce matin de mon puits virtuel comme Vénus à l’aube ou comme la vérité toute nue (avec un V majuscule comme Vamp ou Vanité), et ce n’est pas qu’une métaphore bidon puisque le sieur JLK a commencé de me bricoler dans la rubrique NOTES de son smartphone, immergé jusqu’au cou dans son bain nordique chauffé à 38° avec vue intégrale sur le lac Léman à peine voilé d’un pudique stratus.
Or, hier soir encore, ledit chroniqueur ne savait pas trop ce qu’il allait me faire dire, tenté d’évoquer les beaux et bons livres (signés Dino Buzzati, François Taillandier, Christopher Gerard , Bruno Lafourcade ou Daniel Rondeau, notamment) qu’il a lus durant les quinze jours qu’il venait de passer en Bretagne, ou peut-être de la France périphérique qu’il avait traversée avec sa Lady L. en communion de pensée avec les gilets jaunes et les protagonistes du dernier Houellebecq, ou encore du formidable reportage consacré à une année de confrontation entre les journalistes du New York Times et Donald Trump, quand, se fiant à la recommandation d’un ami, le voilà qui tombe, via YOUTUBE, sur un entretien avec Emmanuel Todd à propos de son dernier essai intitulé Où en sommes-nous? et cristallisant plus précisément, et plus urgemment surtout, LE sujet du moment d’ailleurs relié à plusieurs de ses «envies» possiblement bonnes pour la tête…

Quand Emmanuel Todd plaide pour l’«humain»…
Celles et ceux qui connaissent le sociologue-anthropologue-historien-chercheur-polémiste Emmanuel Todd, fils unique du grand reporter Olivier Todd (remarquable biographe, lui, d’Albert Camus et de Jacques Brel), savent qu’Emmanuel Todd ne pratique pas la langue de bois des idéologues et que sa façon de critiquer très sévèrement la politique butée du président Macron en rapport avec la crise majeure des gilets jaunes, de pointer même son incapacité psychologique voire intellectuelle à inventer un règlement du conflit dont les gilets jaunes eux-mêmes n’ont qu’une idée confuse, ou sa façon de parler sans mépris de ce qu’on appelle le populisme et de la perception anglo-saxonne de la réalité, ne sont pas d’un démagogue provocateur mais d’un observateur de bonne volonté, qui explique tranquillement qu’Emmanuel Macron ne peut pas faire grand chose dans une Europe soumise à la restriction obsessionnelle de l’euro, qu’un coup d’Etat de sa part serait aussi dommageable pour tous que son «dégagement», qu’il vaudrait mieux faire confiance aux députés de la République en marche, si tant est que ceux-ci s’en montrent dignes, qu’il ne suffit pas de cracher sur Donald Trump et de sa base pour expliquer le désarroi de celle-ci et le retour au protectionnisme de celui-là, enfin et surtout que dans toutes ces questions l’élément humain (l’humanité des gilets jaunes et des «petits Blancs» américains, etc.) est trop souvent négligé ou simplement ignoré des «élites».
Or, c’est aussi ce que «raconte» le très remarquable récit autobiographique de François Taillandier, intitulé François, roman (Stock, 2019) et retraçant un demi-siècle d’évolution, dans la vie des Français «périphériques» autant que dans nos propres parcours, marquées par une transformation profonde, enthousiasmante à beaucoup d’égards et non moins déstabilisante – mais de ce livre JLK ne parlera que dans sa 73e chronique…
 Et si l’on «faisait avec» le numérique?
Et si l’on «faisait avec» le numérique?
Mon rôle de deuxième paragraphe de la 72e chronique des compères JLK et Matthias, rédigé sur le grand écran d’un E-Mac jouxtant la fenêtre de l’antre de JLK par laquelle se découvre, à l’altitude 1111 m, le plus beau panorama du monde dont les montagnes bleues à créneaux étincelants de neige plus pure que de la coke, sommant le plus grand lac d’Europe, nous rappellent que nous ne sommes rien que des plantigrades augmentés, à cela près que l’accession au Verbe nous distingue de la roche muette autant que du lagopède.
Revenant de sa contemplation matinale panoramique, le sieur JLK s’est alors rappelé diverses observations faites ces derniers temps sur INTERNET, et notamment via la plateforme de NETFLIX et le site de la RTS, sur lequel il a visionné les quatre épisodes d’un documentaire passionnant consacré aux relations hautement tendues du New York Times et du président Donald Trump.
De la saga de celui-ci, un excellent aperçu a déjà été donné sur NETFLIX, où l’on découvre les tenants familiaux et sociaux du chasseur d’apparts «fils de» devenu Bête médiatique et mentor milliardaire des Blancs mal lotis, longtemps méprisé par les «élites» et prenant une revanche dans l’ovale de son salon où lui seul cause et «tweete». Quant au reportage filmé en temps réel dans les open spaces du NYT, à New York et à Washington, il a le double mérite d’illustrer, en temps réel, l’immense travail d’investigation quotidienne accompli sous pression par l’équipe du boss noir Dean Baquet, régulièrement insultée par un président qu’a toujours fasciné (!) le journal en question, et aussi de montrer la montée en puissance de l’outil numérique utilisé 24h/24 par les journalistes autant que par le serial tweeter en chef, et le passage inexorable du papier au numérique.
Or, que nous dit ce reportage de l’«humain», pour en revenir à la question d’Emmanuel Todd? Beaucoup de choses que le troisième paragraphe de cette chronique ne fera qu’esquisser…
De la course au fric et de l’appel au sens commun
Dans ma 71e chronique publiée sur le «média indocile» Bon Pour La Tête, j’évoquais l’universelle connerie et le nouveau cliché qui fait d’un Donald Trump le «connard absolu». Or, il va de soi que le personnage, si grossier voire grotesque qu’il nous paraisse, montre une intelligence pratique, une perception pragmatique de la réalité, une compréhension des «gens simples» sans doute supérieures à celles des «élites», et plus précisément de l’intelligentsia «libérale» qu’il ne cesse de défier, notamment incarnée par les «gauchistes» du New York Times.
Sa conquête du pouvoir est passée par la télévision et les réseaux sociaux qu’il a su manipuler en expliquant aux gens comment devenir aussi riche que lui, tandis qu’un Steve Bannon ou un Rush Limbaugh, ses célèbres acolytes, usaient eux aussi du petit écran, de la radio et d’Internet pour diffuser leur idéologie plus agressivement raciste et nationaliste – plus «intellectuelle» que la sienne.
Réduire Donald Trump aux dimensions d’un fou dangereux ou d’un débile inculte revient en somme à une double erreur: ne pas voir l’humain chez lui – plus retors et malin tu meurs –,et surtout esquiver la réalité paradoxale qu’il représente, d’une partie de la société flouée qui en bave, dégoûtée par une autre partie de la même société qui «fait le show». À cet égard, il vaut la peine de voir, sur NETFLIX, le film intitulé Le festival qui n’a jamais existé, qui documente la mise sur pied, notamment par le truchement d’Internet et des réseaux sociaux, de ce qui devait être le plus grand festival du monde, aux Bahamas, drainant le nec plus des stars de la mode et de la musique, et qui s’est soldé par un flop géant et des millions de dollars jetés dans le vide. Mais peut-on dire alors que Donald Trump est le symbole de cette course au fric, comme on a dit d’Emmanuel qu’il était le «président des riches»? Et si tout était plus complexe, plus enchevêtré, moins binaire, plus intéressant à démêler?
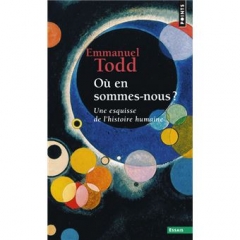 C’est ce que je me dis en lisant Où en sommes-nous? d’Emmanuel Todd, dont les études sur la famille, le territoire ou l’interaction entre niveau d’éducation et options politiques échappent à l’approche binaire de la réalité. Montrant comment, à un moment donné l’éducation méritocratique produit une classe qui, se croyant supérieure, se braque dans un repliement intellectuel coupé de la réalité des gens (on pense alors à Macron et non à Trump), Emmanuel Todd propose un retour à ce que Montaigne appelait le «milieu juste» dépassant les antagonismes sociaux exacerbés par la démagogie (on pense alors à Trump plus qu’à Macron), et substituant, aux éructations affolées de la meute – entre autres emballements médiatico-numériques –, le verbe humain propre à la conversation et à l’apaisement négocié: «Le bon sens nous indique qu’aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l’égalitarisme, qui résulte de l’instruction primaire, et l’inégalitarisme, qui découle de l’enseignement supérieur, et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d’en bas et celles des gens d’en haut, la sécurité des peuples et l’ouverture au monde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans élites, qui représentent et guident, la dénonciation des élites en tant que telles est tout aussi absurde. L’obstination dans l’affrontement populisme/élitisme, s’il devait se prolonger, ne saurait mener qu’à la désagrégation sociale»…
C’est ce que je me dis en lisant Où en sommes-nous? d’Emmanuel Todd, dont les études sur la famille, le territoire ou l’interaction entre niveau d’éducation et options politiques échappent à l’approche binaire de la réalité. Montrant comment, à un moment donné l’éducation méritocratique produit une classe qui, se croyant supérieure, se braque dans un repliement intellectuel coupé de la réalité des gens (on pense alors à Macron et non à Trump), Emmanuel Todd propose un retour à ce que Montaigne appelait le «milieu juste» dépassant les antagonismes sociaux exacerbés par la démagogie (on pense alors à Trump plus qu’à Macron), et substituant, aux éructations affolées de la meute – entre autres emballements médiatico-numériques –, le verbe humain propre à la conversation et à l’apaisement négocié: «Le bon sens nous indique qu’aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l’égalitarisme, qui résulte de l’instruction primaire, et l’inégalitarisme, qui découle de l’enseignement supérieur, et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d’en bas et celles des gens d’en haut, la sécurité des peuples et l’ouverture au monde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans élites, qui représentent et guident, la dénonciation des élites en tant que telles est tout aussi absurde. L’obstination dans l’affrontement populisme/élitisme, s’il devait se prolonger, ne saurait mener qu’à la désagrégation sociale»…

(Dessin de Matthias Rihs. Cette chronique a paru ce matin sur le site indocile de BON POUR LA TÊTE. Abonnez-vous. Et si vos ennemis le détestent, abonnez-les de force !)
En 1990, après la parution de son Intermède marocain, j’avais rencontré l’écrivain genevois septuagénaire dont les propos trouvent aujourd’hui une nouvelle résonance…
Où en sommes-nous de nos rapports avec ceux que nos ancêtres appelaient les «infidèles»? L'antiracisme qu'affichent nos discours est-il réellement vécu? Comprenons-nous vraiment nos frères humains du monde arabo-islamique, ou ne faisons-nous que nous rassurer en célébrant leur «différence»? Et d'abord, connaissons-nous les tenants historiques, culturels et religieux de cet abîme qui nous sépare à l'évidence?
À ces questions, Georges Haldas nous confronte par de multiples exemples vécus, dans son Intermède marocain, chronique de voyage évoquant deux séjours au Maroc. Sans tricher, Haldas fait état de son allégresse à la découverte, mais aussi de ses réticences, voire de ses coups de gueule.
En plein Genève, à deux pas de l'Arve torrentueuse, il est un petit établissement algérien tenu par un monsieur très digne, Saïd de son nom, où Georges Haldas se retrouve tous les matins, dès l'aube, pour y écrire jusqu'à midi. C'est là que nous l'avons rencontré.
—A quoi votre intérêt pour le monde arabo-islamique tient-il?
—D'abord au fait que nos racines y plongent. Ensuite, il y a longtemps que je suis préoccupé par ce paradoxe douloureux: que le berceau des trois religions monothéistes soit aujourd'hui l'arène du meurtre, avec la tragédie qui oppose Israël aux Palestiniens et la mosaïque sanglante du Liban. Et puis il en va de notre avenir, par rapport à la formidable poussée du monde musulman.
— Pourquoi parlez-vous si peu, dans ce livre, de l'aspect politique des relations Occident-islam? Crainte de prendre position?
—Je raconte un premier contact avec le monde arabo-islamique, comme pourrait le vivre n'importe quel quidam. J'ai fait table rase de tout ce que je savais par mes rencontres et mes lectures, pour être plus perméable au décor, aux êtres et aux choses. Je n'ai pasvoulu faire une enquête socio-politique. Quand on fait une enquête, on a souvent une arrière-pensée: l'hypothèse qu'on veut vérifier. Mais la réalité est toujours plus riche, plus complexe que ce qu'on pense: Tenez, il m'aurait été facile de faire un baroud démagogique sur la perfidie de Hassan, et tutti quanti. Ou parler de l'intégrisme islamique: dire que c'est, à mes yeux, le nazisme de l'islam! Applaudissements assurés! Et l'au- rai-je expliqué pour autant? D'ailleurs est-ce tout l'islam? Voyons! Bref: plus qu'assener des convictions, je voulais dire mes réactions brutes, spontanées, et poser des questions. Je crois que ce sont les questions qui retient les hommes, plus que les réponses. En outre, le seul moyen d'entrer en vraie relation c'est d'affirmer d'abord ses différences. Voilà pourquoi je n'ai pas camouflé mes réactions parfois violentes.
—Quel a été votre impression dominante?
 — La distance qui nous sépare. A la fois physique et psychique. Et dans l'avion déjà, ce steward marocain toisant un brave touriste vaudois qui l'apostrophait en arabe: un gouffre. Mais comment l'expliquer? En remontant aux sources. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une plus grande distance entre le croyant musulman et Allah qu'entre un juif et Yahvé, ou que dans le rapport liant le chrétien au Christ. Moncef Marzouki, dans Arabes, si vous parliez, un livre plein d'auto-ironie, de cœur et de courage, dit que l'islam est une civilisation du non-dit. La relation d'Allah et du croyant est plus proche de la relation maître-serviteur que de la relation père-fils qui domine chez les juifs et les chrétiens. Ce non-dialogue avec Allah, remplacé par une obéissance inconditionnelle, fait qu'il y a un non-dialogue avec soi-même. Donc peu d'autocritique. Peu d'aveux personnels. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficulté au niveau du dialogue démocratique. Tout se tient!
— La distance qui nous sépare. A la fois physique et psychique. Et dans l'avion déjà, ce steward marocain toisant un brave touriste vaudois qui l'apostrophait en arabe: un gouffre. Mais comment l'expliquer? En remontant aux sources. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une plus grande distance entre le croyant musulman et Allah qu'entre un juif et Yahvé, ou que dans le rapport liant le chrétien au Christ. Moncef Marzouki, dans Arabes, si vous parliez, un livre plein d'auto-ironie, de cœur et de courage, dit que l'islam est une civilisation du non-dit. La relation d'Allah et du croyant est plus proche de la relation maître-serviteur que de la relation père-fils qui domine chez les juifs et les chrétiens. Ce non-dialogue avec Allah, remplacé par une obéissance inconditionnelle, fait qu'il y a un non-dialogue avec soi-même. Donc peu d'autocritique. Peu d'aveux personnels. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficulté au niveau du dialogue démocratique. Tout se tient!
— Le ressentiment que vous avez souvent senti vous-même, de la part des musulmans, ne découle donc pas que du colonialisme?
—Sûr que non! Car il ne faut pas oublier un autre choc, bien plus ancien. Le fabuleux rayonnement du monde arabo-musulman s'est arrêté au XIIIe siècle. Cela a créé un traumatisme. Depuis très longtemps, les musulmans ont un double complexe. Complexe d'infériorité, parce qu'ils regardent l'Occident comme le foyer du progrès et de la prospérité. Et en même temps mépris de l'Occidental pour toutes ses perversions. Vous le ressentez encore dans le. regard des gens, d'ailleurs tissé de mille nuances contradictoires. Une certaine jalousie. De la curiosité. Le rejet. La crainte. Ou le désir de mieux connaître. Un élan de chaleur. Et puis il y a tant de reT gards différents, jusqu'au non-regard des femmes, qui débouche sur un autre abîme encore...

—Pas toujours. Avec celui que j'appelle Ali, une relation de confiance s'est établie. Ce garçon, en rupture avec son milieu, est venu spontanément vers moi et m'a fait la confession de sa vie perdue. Il m'a dit le Maroc sans espoir, où la jeunesse n'a pas d'avenir. A cause du marasme économique, de l'arbitraire du pouvoir, de la corruption. Il y avait quelque chose en lui de vaincu et de transparent. Il disait qu'il y a un Dieu pour tous: énormité pour un musulman! La famille ne buvait pas de vin; il est allé m'en acheter lui-même et en a bu avec moi! C'était l'homme du malheur, du dénuement. Et c'est le seul qui s'est confessé.
—Autre impression marquante?
—Le rapport avec le temps. Dès le premier jour aussi, avec l'épisode des passeports (ah, les emmerdeurs!), j'ai constaté ce fait qui détermine toute une vision du monde. Chez les juifs, le temps est conditionné par l'attente d'un messie. Pour les chrétiens, le temps est ponctué par l'avant et l'après. Chez les musulmans, l'heure du jugement arrivera quand elle arrivera: seul Allah la connaît. Par conséquent, il n'y a pas une durée continue, mais chaque moment est tangent avec l'éternité. Conséquence terrestre: si vous demandez à un musulman à quelle heure part l'autobus, il dira que ça dépend de Dieu, s'il le veut bien! Quelle leçon pour nous, soit dit en passant. Du point de vue politique, la chose explique l'aspect sporadique des révoltes dans ces pays. Ce sont des explosions dans l'instant, sans suite durable.
—Sauf pour les Palestiniens...
—Mais les Palestiniens se réclament du socialisme. Ils ont un projet qui est en rupture avec leur culture séculaire. Cela dit, ce n'est pas un hasard si les idéologies d'importation européenne ont finalement foiré dans les pays arabo-islamiques...
—Qu'espérez-vous pour l'avenir?
—Ce que.je souhaiterais, c'est que, par-delà ces énormes différences qu'il y a entre Occidentaux et Arabes, on trouve un modus vivendi qui permette aux différences de n'être pas meurtrières. Marzouki pense que la seule issue pour ces pays réside dans la démocratie, tout en affirmant qu'elle est aussi improbable que la floraison du jasmin sur un iceberg! Selon lui, la réaction des musulmans inspirés par l'Occident, socialisme compris, a été un désastre. Mais l'intégrisme, qui se réfère au «véritable islam», repose lui aussi sur un mythe funeste. En ce qui me concerne, je suis heureux que s'écroule, actuellement, le système de références antinomiques et réductrices qui réduit l'homme à un animal politique. Je suis content de voir voler en éclats certains des schémas auxquels j'ai moi-même souscrit. Non, la réalité n'est pas si simple: vous le voyez dans une goutte d'eau, et vous l'éprouvez à la première rencontre, qui contient en germe toutes les autres.
Georges Haldas, Intermède marocain. Editions L'Age d'Homme, 1989.

Celui qui ne juge que sur pièce / Celle qui ne se croit pas obligée de se prononcer sur tout / Ceux qui constituent des dossiers qu’ils consultent de temps à autre sans se décider à les utiliser dans le procès qu’ils sont légitimés à intenter à la vie en général et à ses particuliers inscrits ou non au Parti multiple / Celui qui croit se sentir mieux après avoir affirmé sur Facebook que Michel-Ange était une pédale comme Charles Trenet et la plupart des coiffeurs et des animateurs de radio / Celle que les influenceurs essaient en vain d’influencer sans deviner qu’elle est à la fois sourde et affiliée à l’Église des Derniers Jours / Ceux qui ont à cœur de ne jamais avoir le dernier mot / Celui qui fixe insolemment les jeunes femmes décidées qui font usage de l’expression point barre traduite en allemand par l’expression punkt schluss et en québécois terminé bâton / Celle qui a remarqué que les jeunes cadres à souliers très pointus avaient la même façon de conclure qu’y a pas de souci quand elle leur soumettait un Problème / Ceux qui ont compris qu’avec les cours de littérature d’Eric-Emmanuel Schmitt ils seraient capable d’écrire des phrases qui leur permettraient de recouvrer l’estime de soi nécessaire à torcher un bouquin genre d’Ormesson ou Nothomb pour les meufs / Celui qui lance un logiciel permettant d’écrire des livres à la manière d’Eric-Emmanuel Schmitt en mieux / Celle qui achète un chapeau à sa fille Kelly qui pourrait très bien écrire des romans elle aussi d’après ce qu’elle a vu chez Ruquier et même sans coucher / Ceux qui scandalisent leur entourage en affirmant qu’ils n’iront jamais chez Ruquier même si on les paie / Celui qui se drape dans sa toge immaculée de moraliste à l’ancienne refusant absolument de poser sur Instagram / Celle qui se promet de tout dire au Festival du Rien / Ceux qui annoncent que finalement ils vont rester sur Facebook ou ils ont deux trois mille amis (et amies d’un certain âge) qui partagent leur ressenti au niveau du quotidien,etc.
Image JLK, Down and out in San Diego.