
Cet étrange sourire

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

À propos d'un classique méconnu, ou plutôt mal connu, du XXe siècle...
C’est l’histoire de cinq fils de millionnaires, de la catégorie « multi », qui s’acoquinent avec une rejeton d’ouvrier pour lancer une revue. Comme ces lascars sont jeunes, la revue sera « contre ». Et comme leurs pères sont tous furieusement révolutionnaires (déjà la « gauche caviar »), leur organe sera partisan de la Réaction avec, pour devises, « aimons les riches ! » ou « Grand Capital nous voilà ! », et pour titre : En arrière. Comme bien l’on pense, la parution de la revue jette un tel froid dans les bureaux immenses des pères que ceux-ci menacent leur fils de leur compter leur argent de poche, à quoi l’un des petits malheureux répond : « A bas Aragon ! »
Merveilleuse jeunesse pleine d’idéal ! Et merveilleux Marcel Aymé, dans l’onde fraîche de la prose duquel on aime à se retremper et se « ressourcer », comme disent aujourd’hui les veuves de milliardaires adeptes du développement personnel.
La veine satirique de Marcel Aymé, illustrant la pensée non alignée de l’auteur du Confort intellectuel, se déploie surtout dans ses nouvelles, du Nain à Derrière chez Martin. A propos de ce dernier recueil, et pour rassurer au passage ceux qui poseraient l’inévitable question du jour : « Et les droits de l’Homme là-dedans ? », notons que, précisément, Derrière chez Martin contient une nouvelle « fraternelle », selon la terminologie politiquement correcte, intitulée Rue de l’Evangile et présentant amicalement un « pauvre Arabe » du nom d’Abd el Martin…
Cela noté, il faut insister sur le fait que l’humour passe l’ironie chez Marcel Aymé, et que, bien au-delà du gag ou du trait d’esprit, se manifeste chez lui le sourire de l’homme désillusionné. Sa philosophie serait cependant injustement assimilée à un désabusement plus ou moins cynique, comme on a trop souvent limité la talent de l’écrivain au conte moral (ou amoral) à la manière d’un La Fontaine contemporain.
Or tout était à revoir dans la façon de classer cet auteur et surtout d’évaluer sa juste mesure, à quoi le professeur Michel Lécureur a contribuée pour beaucoup depuis une vingtaine d’années, à commencer par un essai très substantiel, La comédie humaine de Marcel Aymé, et une biographie plus récente, sous le titre d’Un honnête homme.
La parution du deuxième volume des œuvres romanesques complètes, dans la Bibliothèque de La Pléiade, nous a fait retrouver à la fois le nouvelliste et le romancier, avec deux titres comptant sûrement au nombre des meilleurs ouvrages de l’auteur : Maison basse et Le moulin de la Sourdine.
Ces deux romans illustrent, avec un fort contraste, la part provinciale et la part citadine de l’œuvre de Marcel Aymé. On oublie parfois les racines jurassiennes de l’auteur (né à Joigny en 1902) de Travelingue ou de La Traversée de Paris, qui fut d’abord celui de Brûlebois, premier roman terrien accueilli par Jean Paulhan à la NRF en 1926.
Dans Maison basse, le romancier s’intéresse à quelques habitants d’un locatif urbain, zappant entre diverses existences simultanées un peu comme s’y applique Jules Romains dans son labyrinthe unanimiste, tandis que Le moulin de la Sourdine nous transporte à Dole, ou plus exactement au cœur du cœur humain, avec cet épisode éminemment troublant d’un adulte s’employant à corrompre un enfant.
Marcel Aymé n’était pas ce qu’on appelle un croyant, en religion pas plus qu’en politique. Il n’en avait pas moins une intelligence profonde du mal, qu’il ne localisait ni dans telle classe ni chez telle race, pas plus qu’il ne voyait le bien à droite ou à gauche, le salut au ciel ni la perdition dans les bras d’une femme, fût-elle vouivre sur les bords. Il était par ailleurs capable de tendresse et de compassion autant qu’un simple paroissien, mais sans trace de l’ostentation des belles âmes. L’écrivain, surtout, dans la langue la plus claire et la plus fluide, souvent nimbée de mélancolie aussi, ne craignait pas d’exprimer tranquillement ce qu’il avait observé de façon clinique, style médecin de famille, comme un Tchekhov dans la Russie du tournant du siècle. De ce regard net et un peu triste témoigne le mieux le noir Uranus. Dans cette optique, on ne peut que donner raison à Michel Lécureur de parler de « comédie humaine » à son propos, sans le grand souffle, les plongées vertigineuses ni la poésie de Balzac. On ne voyait trop souvent de lui que le charme acidulé des Contes du chat perché ou la gouaille gauloise de La jument verte. Or, comme on a découvert la saisissante richesse « sociologique » ou « anthropologique » des observations de Tchekhov sur la déliquescence de la Russie prérévolutionnaire, on peut s’aviser aujourd’hui de la non moins impressionnante variété des types et des traits humains tissant la fresque française de Marcel Aymé.
Une certaine critique « moderne », confinée dans ses préjugés et ses grilles d’interprétation, continue de snober les écrivains à la Marcel Aymé, lequel eut en outre le tort de plaire à tous les publics. Or plus le temps passe et plus cet auteur déjà placé très haut par quelques-uns, s’impose comme l’un des vrais « classiques » du XXe siècle sans avoir pris une ride quarante ans après sa disparition.
Marcel Aymé. Œuvres romanesque complètes I et II. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade.
Michel Lécureur. La Comédie humaine de Marcel Aymé, La Manufacture, 1985. Marcel Aymé, un Honnête homme, Les Belles lettres, 1997.



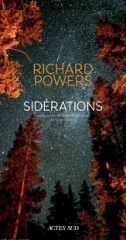
…J’aurais aimé peindre ce soir le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme.
Ce fut d’abord une espèce de haut décor immobile au camaïeu gris bleuté, style opéra des spectres sous la cendre, que surmontaient de gros rouleaux de velours noir accrochés aux cintres des montagnes de Savoie. Toute vide et désolée, la scène avait une majesté funèbre de sanctuaire à l’abandon. Cependant, imperceptiblement, le décor se modifiait à vue d’un moment à l’autre, les masses suspendues semblant tout à l’heure des frontons devenaient des toiles déchiquetées pendues en plans superposés et délimitant de nouveaux lointains, entre lesquels filtraient ça et là d’obliques rayons comme liquéfiés dans le vent tiède.
Quelques instants plus tard, tout n’était plus que lambeaux de grisaille tombant en colonnes verticales sur les pentes boisées paraissant exhaler maintenant des bouffées de brume, et voici que la pluie se voyait là-bas le long des pentes et bien avant de nous tremper le front de ses premières grosses gouttes huileuses, puis il n’y eut plus du lac au ciel qu’un pan de pur chiffon sur lequel d’invisibles mains jouaient avec l’eau et l’encre, c’était à la fois sinistre et splendide, et tout se refermait enfin dans la pluie, il pleuvait partout, tout n’était plus que ciel en pluie mais cela ne saurait se dépeindre: il n’y a pas d’instruments pour cela ni d’art assez direct, c’est une trop ancienne sensation, il n’y aurait que la danse, mais la danse immobile, la danse de l’angoisse enfin levée, la pure danse jamais apprise du premier homme assoiffé, les mains ouvertes à la céleste onction…

Au libraire écrivain dit Le Greco
Ce petit livre acheté 300 francs anciens
rue de la Huchette à Paris,
m'aura suivi partout,
perdu et retrouvé;
il est trempé d'eau de pluie
et salé par les embruns,
il a vu les sept péchés et les huit splendeurs,
et des auteurs qui me sont chers
le citent volontiers.
Je l'ai perdu maintes fois à travers les années,
et retrouvé entre deux fièvres et trois délires;
c'est une main amie maintes fois lâchée
et retrouvée au hasard des chemins;
c'est un recours en grâce souvent oublié,
mais l'adverbe souvent s'efface,
et demain se fait plus proche:
se rapproche la menace.
À chaque fois que je reprends
la lecture de ce petit livre
qui dit tout et plus encore
de ce que tous nous sommes -
à jamais nous croyant
innocents éternels -
à chaque fois ce petit livre racheté l'autre jour,
pour 3 francs actuels, chez Molly & Bloom,
me trouve plus vivant.
(1966-2016, en relisant Ascèse de Nikos Kazantzaki)

« A une époque nous avons tous été des étoiles »
(Lim Chul-woo)
On n’est pas vivant très longtemps
sur la terre légère
qui roule là-bas sous le vent
des espaces contraires...
Vu du ciel comme on l’appelle
on a l’air de flotter,
alors qu’on a les pieds liés
aux chaînes et nécessités
du moment à passer...
La relativité partielle
dont se rient les gazelles
en sautant à travers le temps
ne nous empêche pas
de souffrir de tout ce savoir
qui nous donne des ailes,
alors que le temps d’un soupir
s’est comme évanoui
le temps a peine de s’éveiller...
Malgré tous nos fous rires
et nos tendres sourires
d’innocents venus et passés,
nous ne pouvons plus oublier
ce que nous faisions là:
nous sommes attachés,
et l’idée seule qu’on nous arrache
à nos jouets nous fâche -
nous aimerions nous attarder...
De là je vois mon endormie
rêver au lent voyage
dans cet autre pays
sans âge où toutes les étoiles
se promènent et surnagent,
et je bénis le ciel
comme l’appellent les enfants
et les sages aussi,
dans le frémissement de voiles
des jours et des nuits
de protéger sa bonne étoile...
Peinture: Vassily Kandinsky






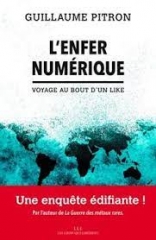

Pauline au bal est si légère
qu’elle a l’air d’une balle
jetée là-bas de bras en bras,
comme de salle en salle,
grisée par les regards glissés
sur ses épaules dénudées
qui tournoient dans le ciel.
Pauline et sa jambe de bois
marquent bien les syncopes
de la valse ou du cha-cha-cha;
son cigare étincelle
à sa main qui n’a que trois doigts,
et pas une de celles
qui lui dénient son charme exquis
ne sait boiter comme elle.
Pauline est ces jours à l’hosto:
il faut bien réparer
les beaux restes de ses vieux os
qui déjà s’impatientent
de tâcher de ses talons hauts
à remonter la pente.
Pauline danse au bord du ciel
en pure silhouette,
nous rappelant toutes les fêtes
de nos plaisirs véniels,
quand de nos pieds de pélicans,
palmés et juvéniles,
nous faisions la pige à Satan.
Lors Pauline indocile,
au milieu de tant de liesse
marquait déjà le pas,
le tempo et le mouvement,
le déhanché de chaque fesse,
au bal des débutants.


Celui qui se fait sauter dans un jardin enfants pour prouver l'existence de Dieu / Celle qui présentait ce soir-là sa tournée de Dangerous Woman et qui n'est pour rien dans un massacre qui la poursuivra toute sa vie / Ceux qui bombardent les écoles syriennes pleines de terroristes en puissance / Celui qui décapite la chienne d’infidèle au motif qu’elle l’a regardé sans baisser les yeux et que cela déplaît à l'Unique/ Celle qui a donné son fils unique au Dieu qui l’a laissé se faire crucifier entre deux terroristes dits aussi zélotes à l’époque / Ceux qui se rappellent que la guerre civile déclenchée par les zélotes issus de l’essénisme a provoqué la mort d’un million cent mille juifs ainsi que le rapporte Flavius Josèphe / Celui qui vers 1485 ramena à Mexico vingt mille Mixtèques enchaînés et tous massacrés ensuite au nom de l’empereur incarnant le Dieu local / Celle qui vierge et belle fut éventrée au nom d’un autre Dieu local dans un autre pays et un autre siècle / Ceux qui estiment que le sacrifice de Jésus par son père consubstantiel relève du suicide de Celui-ci mais ça se discute /  Celui qui affirme que la Sainte Inquisition (d’environ1231 à 1834, ) ne saurait être critiquée du fait qu’elle était sainte et que ses victimes iraient de toute façon en enfer / Celle qui affirme que le génocide des Cananéens ordonné par Yahweh dans l’Ancien Testament n’est qu’une métaphore / Ceux qui se rappellent que le dieu Athée a légitimé des millions d’assassinats en sainte Russie sous le règne du séminariste Iosip Djougatchvili dit Staline avant de justifier les millions de morts imputables au Président Mao vénéré à Saint Germain-des-Prés et à l'Elysée puis de cautionner le génocide du peuple cambodgien par ses propres fanatiques / Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait /
Celui qui affirme que la Sainte Inquisition (d’environ1231 à 1834, ) ne saurait être critiquée du fait qu’elle était sainte et que ses victimes iraient de toute façon en enfer / Celle qui affirme que le génocide des Cananéens ordonné par Yahweh dans l’Ancien Testament n’est qu’une métaphore / Ceux qui se rappellent que le dieu Athée a légitimé des millions d’assassinats en sainte Russie sous le règne du séminariste Iosip Djougatchvili dit Staline avant de justifier les millions de morts imputables au Président Mao vénéré à Saint Germain-des-Prés et à l'Elysée puis de cautionner le génocide du peuple cambodgien par ses propres fanatiques / Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui sont prêts à couper les mains des chiens d’infidèles au scandale de ceux qui ont décapité leur roi et leurs frères de sang bleu / Celui qui sous le nom de Ramuz a fait l'éloge du major illuminé démocrate avant l'heure que les djihadistes bernois ont décapité sur la pelouse lausannoise actuellement réservée aux barbecues / Celle qui se refuse à Conan dont la secte cannibale est en désaccord avec celle de son père plutôt anthropophage / Ceux qui invoquent God en flinguant tout ce qui s’oppose à l’Axe du Bien / Celui qui aime lire Pascal en écoutant The Smiths / Celle qui jouit de se confesser au père Anselme /
Ceux qui sont prêts à couper les mains des chiens d’infidèles au scandale de ceux qui ont décapité leur roi et leurs frères de sang bleu / Celui qui sous le nom de Ramuz a fait l'éloge du major illuminé démocrate avant l'heure que les djihadistes bernois ont décapité sur la pelouse lausannoise actuellement réservée aux barbecues / Celle qui se refuse à Conan dont la secte cannibale est en désaccord avec celle de son père plutôt anthropophage / Ceux qui invoquent God en flinguant tout ce qui s’oppose à l’Axe du Bien / Celui qui aime lire Pascal en écoutant The Smiths / Celle qui jouit de se confesser au père Anselme /  Ceux qui se retiennent de lâcher un vent soufi pendant l’homélie intégriste/ Celui qui se dit rempli du nom de Dieu /Celle qui a perdu ses deux fils au Bataclan mais ne veut pas entendre parler de guerre / Ceux qui ont peur de leurs fils croyants / Celui qui oblige sa famille à prier debout sinon je te tue / Celle qui a vendu son silence après que l’archevêque polonais a violé ses deux fistons / Ceux qui pensent que la mort de Dieu est un fait accompli /
Ceux qui se retiennent de lâcher un vent soufi pendant l’homélie intégriste/ Celui qui se dit rempli du nom de Dieu /Celle qui a perdu ses deux fils au Bataclan mais ne veut pas entendre parler de guerre / Ceux qui ont peur de leurs fils croyants / Celui qui oblige sa famille à prier debout sinon je te tue / Celle qui a vendu son silence après que l’archevêque polonais a violé ses deux fistons / Ceux qui pensent que la mort de Dieu est un fait accompli /  Celui qui se fait traiter d'antisémite pour avoir osé critiquer l'apologie tribale de la violence faite dans l'Ancien Testament / Celle qui rappelle aux intéressés que le dieu Yahweh avait une femme aux fourneaux / Ceux qui incriminent le wahhabisme au déplaisir des exportateurs suisses qui n'ont pas d'états d'âme et de Donald Trump qui a des armes de destructions massive à fourguer / Celui qui incrimine essentiellement le Coran et les hadiths mais un Palestinien islamophobe a peu de chance de passer à la télé / Ceux que le monothéisme a toujours insupportés par son manque d'imagination poétique / Celui qui fait la tournée de la paroisse en vélosolex avant d’aller boire un verre avec le Père Claude ce bon gars accueillant de migrants dans sa cambuse / Celle qui n'est pas dupe des principes moraux affichés par les adorateurs du Dollar / Ceux qui pensent que la Shoah reste à parachever / Celui qui n’ose plus dire à la télé que Dieu lui dicte ses livres / Celle que l’excision a détourné des siens / Ceux qui parlent aux oiseaux du bon Dieu dont on a déformé les propos, etc.
Celui qui se fait traiter d'antisémite pour avoir osé critiquer l'apologie tribale de la violence faite dans l'Ancien Testament / Celle qui rappelle aux intéressés que le dieu Yahweh avait une femme aux fourneaux / Ceux qui incriminent le wahhabisme au déplaisir des exportateurs suisses qui n'ont pas d'états d'âme et de Donald Trump qui a des armes de destructions massive à fourguer / Celui qui incrimine essentiellement le Coran et les hadiths mais un Palestinien islamophobe a peu de chance de passer à la télé / Ceux que le monothéisme a toujours insupportés par son manque d'imagination poétique / Celui qui fait la tournée de la paroisse en vélosolex avant d’aller boire un verre avec le Père Claude ce bon gars accueillant de migrants dans sa cambuse / Celle qui n'est pas dupe des principes moraux affichés par les adorateurs du Dollar / Ceux qui pensent que la Shoah reste à parachever / Celui qui n’ose plus dire à la télé que Dieu lui dicte ses livres / Celle que l’excision a détourné des siens / Ceux qui parlent aux oiseaux du bon Dieu dont on a déformé les propos, etc.
L'auteur de cette liste peu exhaustive recommande, aux amnésiques, la lecture de l'Histoire générale de Dieu, de Gérald Messadié, de La Folie de Dieu, de Peter Sloterdijk, et du Livre noir de l'Inquisition, entre autres reflets d'une férocité millénaire imputée à diverses divinités femelles (au début) et de plus en plus mâles.


 Publie.net accueille les listes de JLK. François Bon présente l'ouvrage.
Publie.net accueille les listes de JLK. François Bon présente l'ouvrage.
L’énumération est un fondement de la littérature : qu’on aille dans la Bible, avec l’inventaire du temple dans Exode, ou les généalogies, et qu’on aille chercher de quelles civilisations, de quels textes hérités. Et quel bonheur et quel émerveillement nous prend encore à Seî Shonagon et ses Notes de chevet, la capacité du coup d’entrer dans l’an 1000 du vieux Japon, et de s’y trouver comme en plein voisinage avec le médecin ivrogne, les ponts qui sont beaux et ceux qui le sont moins, les bons usages et les choses qui vous mettent en colère, comme ce crissement du cheveu pris dans la pierre à encre.
L’énumération est toujours resté une marge active de la littérature. Parce que c’est ce que nous faisons dans nos cahiers, dans notre documentation du monde. C’est la première construction de langage pour construire et déplacer le regard. Il y en a chez Novarina, chez Perec et Roubaud, des poètes comme Bernard Bretonnière.
Maintenant, Jean-Louis Kuffer. Que je n’ai jamais rencontré. Au départ, juste la curiosité d’un blog de critique littéraire tenu en Suisse, donc un écart, des découvertes, une attention à des auteurs qui comptent, Nicolas Bouvier le premier, évidemment, ou la découverte de Popescu, sa Symphonie du Loup.
Mais nous tous, côté blogs, à mesure qu’on découvre l’outil et la force d’Internet, on évolue. La critique s’ouvre à la photographie, aux scènes du quotidien, aux réactions d’humeur. Le blog de Jean-Louis Kuffer a gagné en arborescence, en étalement : on parle d’une musique, d’un ciel. On y développe des correspondances.
Et puis ses Ceux qui. Au début, un exercice un peu discret, de fond de blog. On survolait. Je m’y suis pris vraiment lorsque j’ai lu celui qui s’est intitulé Ceux qui se prennent pour des artistes. Tout d’un coup, un malaise : on reconnaît toutes les postures. La phrase est incisive, contrainte. Elle va de saut en saut dans toutes les postures du rapport qu’on a chacun à notre discipline.
Celui qui, celle qui, ceux qui, dans mes ateliers d’écriture, je me sers fréquemment d’un texte de Saint-John Perse (le chapitre IV d’Exil) qui fonctionne sur ce principe, en l’appliquant à la généalogie de chacun, mais une généalogie sans noms propres ni chronologie. Les résultats toujours sont impressionnants : la peau du monde, les silhouettes qui le portent.
Avec des effets connexes : peu importe, dans Saint-John Perse, qu’on comprenne ou pas. Ainsi, dans les énumérations de JLK, la phrase Celui qui a rencontré Dalida au temps où elle devint Miss Egypte devient signifiante même sans rien savoir de la protagoniste. Ainsi, et là c’est déjà dans Seî Shonagon, la juxtaposition d’éléments forts, de haute gravité, ou à teneur politique, voire subversive, et d’éléments qui tout d’un coup provoquent le rire, ou la seule légèreté (Ceux qui vivaient aux oiseaux en 1957).
J’ai donc demandé et obtenu de Jean-Louis Kuffer qu’on développe ici ses Ceux qui. La preuve qu’une énumération tient, c’est quand sa propre table des matières devient elle aussi une prouesse de langage. Voir l’extrait feuilletable. Mais Dans une idée d’oeuvre ouverte, et la volonté de la questionner sur publie.net : à mesure que JLK continuera son écriture, on réactualise le texte initial, et vous disposez toujours de la dernière version dans votre bibliothèque personnelle. Mais aussi, que le texte édité (pour contrer le principe d’enfouissement du blog, ce que j’ai nommé fosse à bitume), renvoie en étoile aux archives du blogs non reprises dans la sélection de l’auteur (30 chapitres, quand même) ou à celles qui s’y ajouteront...
Et bonne visite du site en développement infini de Jean-Louis Kuffer, la rubrique de ses Celui qui, celle qui, ceux qui (mais attention, il y en a de dissimulés ailleurs dans le site). Et qu’une lecture aussi vigoureusement salutaire nous arrive des ciels suisses n’est pas neutre : on s’en réjouit ici.
François Bon
Ceux qui songent avant l’aube l’énumération comme arme pour dire le monde 2008-10-29 80 5,50 euros publienet_KUFFER01 publie.net. http://www.publie.net




Il est de bon ton, par les temps qui courent, de dauber sur les idées et les images qui ont cimenté, à un moment donné, l'identité de la Suisse, notamment en exaltant, au XIX e siècle, les valeurs de la tradition alpestre comme patrimoine commun aux campagnes et aux villes. Malgré toutes les « prises de conscience » et autres démythifications, reste une histoire qui nous est propre, et surtout un héritage culturel qui ne se réduit pas à des clichés. Une nouvelle preuve nous en est donnée par un superbe ouvrage que vient de publier Françoise Jaunin, irremplaçable vestale de la chronique artistique de 24 heures, dont l'érudition jamais pédante, les curiosités historico-sociologiques et le goût avéré s' associent heureusement dans cette traversée de cinq siècles de peinture (elle s' en est tenue à ce médium sous la menace de son éditeur, malgré sa démangeaison fébrile d'évoquer telle « installation » sur les hauts gazons ou telle vidéo sondant les entrailles utérines de la Jungfrau …) illustrés par cinquante reproductions d'œuvres majeures, connues ou à découvrir. Sous la jaquette dévolue au flamboyant Hodler (une exposition récente à Genève en a illustré la fascinante trajectoire, jusqu' aux confins de l'abstraction), voici défiler Caspar Wolf et un Calame sublime évoquant le romantique allemand Caspar David Friedrich, un autre paysage saisissant de Böcklin et une vision symboliste de Segantini, de fortes visions « métaphysiques » de Turner et de Cuno Amiet ou d'Albert Trachsel, de Luigi Rossi, des fusions expressionnistes signées Jawlensky, Kirchner ou Kokoschka, entre autres auteurs contemporains plus cérébraux, de Maya Andersson à Daniel Spoerri, ou de Rolf Iseli à Markus Raetz.

Ainsi que le rappelle justement Françoise Jaunin, les Suisses n'ont pas découvert les beautés prestigieuses de la montagne à l'époque des Confédérés. Longtemps, les monts chaotiques ne furent le berceau que de démons menaçants, bombardant les alpages comme le rappelle la quille du Diable des Alpes vaudoises. A l'époque où Madame de Sévigné, lorgnant à sa fenêtre les aimables rochers de la Drôme, rêvait d'un peintre qui pût représenter les « épouvantables beautés » de la montagne, c'étaient les Anglais qui fourbissaient leurs pinceaux et non les Suisses.
Les Anglais et l'Europe cultivée du XVIIII e, intégrant la Suisse dans le classique Grand Tour, puis un poème best-seller international datant de 1729 (Les Alpes d'Albrecht von Haller, traduit dans toutes les langues européennes), un autre livre culte signé Rousseau et publié en 1761 sous le titre de La Nouvelle Héloïse, enfin les travaux du naturaliste genevois Horace Bénédict de Saussure préludant à la conquête du Mont-Blanc en 1787, furent quelques étapes décisives de la glorification internationale des Alpes, dont la peinture, puis la photographie ont tiré tous les partis, du cliché industriel au chef-d'œuvre.
Pour justifier le titre de son livre en lequel les fâcheux seuls verront une touche nationaliste, Françoise Jaunin souligne « qu' aucun pays n'a associé aussi étroitement le spectacle de sa nature avec l'image de sa patrie ». Et d'enchaîner avec ce constat qui ne saurait évidemment borner la culture helvétique dans le champ clos des représentations alpestres, pas plus que la culture nord-américaine ne se limite au Far West: « Les temps ont eu beau changer, le monde se transformer, les perceptions de la montagne varier au gré des mutations de la société et des modifications du paysage, les symboles se déplacer ou changer de nature et de sens, rien n'y fait. Pas davantage que l'ébranlement des mythes, leur remise en question ou leur caricature. Célébrées ou parodiées, instrumentalisées par les discours utopistes, antimodernistes, patriotiques ou écologiques, revisitées par les regards, les traitements stylistiques et les technologies propres à chaque époque, les Alpes ont traversé toute l'histoire de l'art depuis le XVII e siècle avec une constance inébranlable. »
Mais regardez plutôt à la fenêtre: elles sont là, elles sont belles, elle s' en foutent — elles défient toute peinture …
Françoise Jaunin, Les Alpes suisses. 500 ans de peinture . Ed. Mondo, 107 pp.

De la croix .- Vie et destin et tout est dit de la croisée de vos chemins à lentes foulées de pieds sarclant le temps de vos pensers profonds, ou dansant parfois, rampant ou vous tordant cloués sur vos lits de douleur - et c’est pourtant de tout cœur et l’âme sereine que vous l’inscrirez enfin: vie et destin...
Des vies conjuguées.- Comment allez-vous, ont-ils commencé de vous demander comme si vous n’étiez qu’un, et au sortir du cinéma : comment l’avez-vous trouvé, sans supposer que l’avis de l’un puisse différer du jugement de l’autre, et de fait l’illusion parfaite vous convenait sans vous contenir tout à fait, trop occupés tous deux à voir au-delà de ce que voyaient vos regards conjugués...
De la théopoésie.- Hélas nous autres bohèmes n’avons jamais été de trop fins théologiens, trop impatients ou trop librement emportés alors que vous argumentiez avant de manger du corps de l’Absolu comme s’il fût plus qu’une symbolique idée, et tant de mots latins pour en imposer quand la poésie le disait les yeux fermés dans la langue du tout humain...
Des marteaux et des marées.- La Raison m’était trop froide, et le seul sentiment trop tiède, te diras-tu in petto en te rappelant leurs chicanes de fauves intelligents mâles et femelles se jetant à la gueule l’argument entre cafés et chapelles, et c’est ce manque de plus tendre collaboration que tu déplores aujourd’hui dans le tintamarre et la confusion des principes, entre jactance hagarde et robotique...
Des doublures .- La séparation des genres et des âges ne les a jamais occupés ni préoccupés, elle dans le cambouis et lui troquant le bracelet de force pour les vocalises imitées de l’oiseau Soprane, elle et lui se complétant sans ignorer la compétence inusitée de l’autre ou son envie d’en tâter (la subite attirance d’Ophélie pour la conduite motorisée à tombeau ouvert), et pourquoi ne pas ignorer les frontières ou brouiller les critères si ceux-ci ou celles-là réfrènent nos élans conjugués...
Du trouble-fête.- Celui que vous avez rejeté était peut-être un Veilleur, mais on n’en est pas sûr: on n’est sûr de rien dans votre semblant de fête où veiller ne peut qu’être suspect...
Des motifs oubliés. - Nous ne savons pas qui étaient les millions d’affamés de toutes les terres où sévirent les affameurs, nous sommes en vie sans être sûrs de notre droit à l’être, nous ignorons ce qu’aurait été la vie de millions de suicidés aux motifs obscurs ou occultés, nous croyons savoir qui nous sommes sans en être sûrs...
Des illuminés.- Distinguer les porteurs de lumière des imposteurs n’est pas donné à qui n’a pas reconnu la lumière en lui, et conclure à la folie des lumineux relève trop souvent de la crainte de la découvrir...
De l’abnégation.- Celui qui se croit rejeté, ou celle qui l’est en effet, ceux qu’on ignore ou qu’on écarte ont la chance d’être rendus à eux-mêmes où il leur sera donné de renaître s’ils ne se rejettent pas...
De l’évidence.- Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m’était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d’être révélé en pleine lumière...
De la vanité.- À se reprocher dans ses écrits le néant de ceux -ci, et d’y insister sans répit, il ne faisait qu’y ajouter avec l’amère volupté de qui n’a rien à dire et fait comme s’il le savait...
De la confiance .- Nous n’avons pas eu besoin de nous confier beaucoup pour nous fier l’un à l’autre, sans trop le seriner aux autres vu que ceux-ci le voyaient assez: que nous étions confiés l’un à l’autre...
De la bonté gratuite.- Qu’une bonne pensée, un beau geste, et toutes les formes de l’attention bienveillante fussent l’objet d’une rétribution, et donc d’une sorte de commerce, nous révulsait également, nous qui n’étions pas ce qu’on peut dire des gens bien de naissance ni n’étions sûrs d’être bons par nature, juste convaincus de la beauté sans prix de la bonté...

De la distance.- Nous nous étions éloignés des événements. Nous avons continué de participer, mais de loin. Le Mal ne nous laissait plus de choix: il fallait se replier. Ce n’était plus la situation générale et le confinement obligé pour tous mais l’attaque personnelle, à la fois sournoise et brutale. Pour le dire vraiment : nous étions dépassés. Et cependant nous avons refusé de céder au Mal, et c’est pourquoi nous l’avons affronté de loin sans en parler...
Des conditions objectives.- C’est entendu: le Mal est en chacun (entendons : chacune et chacun) et tous y ont part plus ou moins active selon les moments et les pulsions, les défenses intégrées ou les impulsions du milieu - on connaît, mais ce qui saisit à la gorge est l’effet de surprise, à commencer par les malformations de naissance ou la première idée de meurtre...
De ce qui est à faire.- Vous croyez que tout est fait dès l’origine et que tout est donné, que tout est parfait et à consommer ou que vous êtes refait à la base alors que le Job, pour le dire comme vous parlez, est à venir et tous les jours que le Job requiert d’attention et de bienveillance, de sérieux et de persévérance, d’aspiration enragée à la sainteté de chacun (entendons : chacune et chacun) et à la justice pour tous - tout ça pour le Job...
De l’inconnaissable.- Ceux-là ricaneraient de l’astronome porté à la mystique ou du mathématicien fidèle au temple de quartier, forts de leur ignorance du mécanisme stellaire ou des improbabilités calculées, alors qu’à s’enfoncer dans le trou noir on y voit plus clairement la beauté des choses ...
De la direction.- Y a-t-il quelque chose de plus haut que le surnommé Plus-Haut des sermons et des menaces, se demandent les doux hérétiques infoutus d’admettre que le Très-Haut ait signé le bon à tirer des calamités naturelles et des malfaisants, posant la question de l’intention initiale : qu’ils fussent eux-mêmes le résultat d’une intention - et cela leur plaît en effet: qu’au-dessus du Plus-Haut se pose la question sans réponse qui leur sourit…
Du scandale .- Quant au Mal je ne m’y ferai jamais, lance l’innocent au Commandeur des prières, pas plus qu’au Bien que vous bénissez pareillement en fermant les yeux à moitié...
Des façons de s’élever .- La conclusion des ricanants me déplaît, me disais-tu toute rayonnante de ta lumière de mécréante apparente, en cela qu’elle n’est que grimace, et je trouve ça bien laid, au contraire des évangiles de l’enfance qui sont de si beaux récits qu’ils font du bien, et que veut-on de plus que ce qui nous fait être meilleurs que ce que nous croyons...
De la possession.- De la société de convoitise que vous avez conçue, nous nous sommes éloignés en privant nos enfants de tout superflu, et s’ils nous en avaient voulu nous en eussions été d’autant plus contents: poil aux dents...
De ton odeur.- Que tu fusses la sœur des fleurs, c’était prouvé par ta façon de signifier le bouquet de ton seul parfum secret…
Des mots de trop.- Quant à nommer ce qui ne peut l’être : mettre un autre nom que le mot LOVE dont nous usions sans penser jamais à ce qu’il signifiait, nommer le bien partagé que nous était l’éveil partagé après le sommeil, nommer ce lien ou la simple présence et les éloignements quotidiens, mettre des noms à tout moment et jusqu’aux dissonances -, nous lui aurons toujours préféré regards et silences...
Du simple chant .- À celui-là qui évoque en mots la lumière et qui plus est, les yeux au ciel : la lumière de la lumière, je suggère plutôt de le chanter...
De la rivière.- En remontant plus tard le cours du temps, devant cette mer brassant vos heures vous vous rappellerez cette lumière de l’eau de source descendue des hauteurs entre les herbes de la terre, et les arbres, les visages et les maisons, le fil de l’eau et tout ce vert...
Peinture: Stéphane Zaech.

