
L’exergue de Virgile au nouveau recueil d’Yves Leclair, Cours, s’il pleut, me tient lieu ce matin de bon conseil: « Facile de descendre ; la porte du dieu sombre reste ouverte jour et nuit ; Mais revenir sur ses pas et regagner le grand air, Telle est l’œuvre, telle est la tâche ».
°°°
Cap d’Agde, ce mardi 3 juin 2014. – Achevé ce matin la lecture d’Un bon fils de Pascal Bruckner. Vraiment très bien. Très forte évocation d’une certaine France et d’une certaine difficulté de celle-ci à se sortir de sa vieille culpabilité.Très honnête rapport aussi d’une émancipation, loin d’un paternel écrasant et d’une mère couveuse. Très bonne chronique enfin des mutations d’une époque et, plus précisément, de l’évolution de toute une génération – la nôtre.
°°°
Dire à l’occasion ce que sont réellement les poèmes de Michel Houellebecq : résidus de morve de déprimé avec, ici et là, deux ou trois vers meilleurs. Mais sans le nom de l’auteur, on dirait : petit branle d’ado mal dans sa peau.
°°°
 La poésie est une musique. C’est la pensée qui me vient immédiatement en lisant les poèmes de jeunesse de Pasolini, que la version bilingue me permet aussi d’entendre commeil le faut évidemment.
La poésie est une musique. C’est la pensée qui me vient immédiatement en lisant les poèmes de jeunesse de Pasolini, que la version bilingue me permet aussi d’entendre commeil le faut évidemment.
°°°
Dès que j’ai commencé de lire le récit des dernières années de Proust, telles que les raconte Céleste Albaret, j’ai été touché, charmé par le ton, la finesse sous la naïveté, l’élégance sous le naturel de cette « femme du peuple » doublée d’une « fille de la campagne » qui, à vingt-deux vingt-trois ans, a appris les plus délicates manières auprès de l’adorable despote, à commencer par la préparation du café, et l’a ensuite veillé huit ans durant, vivant la nuit comme une chauve-souris à l’instar de La Prisonnière, mais sans se plaindre jamais, au contraire : incessamment ravie…
°°°
 Un haut-le-cœur m’a secoué en lisant un « tous ménages » dévolu à la SUISSE GARANTIE et sous-titré : Plaisir et santé, où il n’est question que de bouffe et de bien-être, sous l’égide de ce label Suisse garantie. Or j’ai beau n’être pas contre la défense de la culture et de l’agriculture helvétiques : cette rhétorique me révulse et m’impatiente de ferrailler contre cette nouvelle Suisse auto-satisfaite et se repliant de plus en plus sur elle-même. Je vais donc continuer d’attaquer cette SUISSEGARANTIE, comme je m’y emploie depuis que j’écris. Contre la consommation. Contre la folie gastro. Contre la folie déco. Contre toute cette acclimatation qui fait obstacle et plus encore : offense à l’esprit. Et ceux là que je vais combattre plus que jamais : les éteignoirs de l’esprit.
Un haut-le-cœur m’a secoué en lisant un « tous ménages » dévolu à la SUISSE GARANTIE et sous-titré : Plaisir et santé, où il n’est question que de bouffe et de bien-être, sous l’égide de ce label Suisse garantie. Or j’ai beau n’être pas contre la défense de la culture et de l’agriculture helvétiques : cette rhétorique me révulse et m’impatiente de ferrailler contre cette nouvelle Suisse auto-satisfaite et se repliant de plus en plus sur elle-même. Je vais donc continuer d’attaquer cette SUISSEGARANTIE, comme je m’y emploie depuis que j’écris. Contre la consommation. Contre la folie gastro. Contre la folie déco. Contre toute cette acclimatation qui fait obstacle et plus encore : offense à l’esprit. Et ceux là que je vais combattre plus que jamais : les éteignoirs de l’esprit.
°°°
À la note poétique qui m’est venue hier, que j’ai intitulée L’échappée, j’ai ajouté ce matin une sorte de codicille ou retouche annonçant un autre poème possible, formulée en ces termes : « Et pourtant / la vie sans toi / est d’un ennui /mortel »…
°°°
 À travers les années, essai de contrepoint.
À travers les années, essai de contrepoint.
Retombant sur une tranche de mes carnets de l’année 2003, je me livre à un essai de contrepoint qui devrait prolonger, à tout coup, l’exercice de la notation journalière et son approche critique…
1er novembre 2003. - Dans le train, j’observe le manège d’un père et de ses deux enfants. Sans doute un père divorcé qui les a eus “sur le dos”ce début de week-end et les ramène à leur mère, ou peut-être est-il allé les chercher à Berne et les ramène-t-il à Fribourg ce soir pour les subir ce soir et les ramener demain ? Ce qui est sûr est qu’il n’a pas l’air content, le regard verrouillé et l’air de s’ennuyer ferme, repoussant la petite visiblement très en manque de lui, tandis que le garçon n’en finit pas d’aller et de venir d’un compartiment à l’autre sans tenir compte de ses reproches. Triste vision.
Contrepoint en juin 2014. – De telles scènes me resteront toujours en mémoire, je ne sais pourquoi, peut-être pour me rappeler que la douleur existe ?
°°°
 Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.
Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.
Contrepoint. - Il y eut L’été Volkoff, en 1979, durant lequel j’ai lu LesHumeurs de la mer sur tapuscrit, avant Dimitri et Bernard de Fallois. J’en garde 60 pages de notes dactylographiées. Le trio m’en avait été très reconnaissant et ce fut une formidable découverte. Je me figurais l’auteur en immense type à la Robertson Davies. Je rencontrai un personnage court sur pattes cambré comme un militaire de parade, Franco-russe à bouc tchékhovien. Je lui ai rendu visite à Macon (Georgia) en 1981 et l’ai battu à plates coutures au tir au pistolet. Je me rappelle sa mère parlant du roman de son fils comme « notre livre - quand nous écrivions notre livre… ». Angelo Rinaldi parla des Egouts de la mer et perdit le procès qui lui fut fait sans mériter, selon moi, cet honneur.
°°°
Jedem Tierchen sein Plaisirchen. Le populaire dit simplement: prendre son pied. Mais sa vie durant Amiel en fera tout un plat. Quant à moi je verrais plutôt la chose en stoïcien. Déjouer l’obsession par une bonne séance, etc.
Contrepoint. - Cette espèce d’hygiénisme sexuel ne me ressemble pas du tout, et d’ailleurs je suis incapable de « parler sexualité » froidement, autant que de « parler religion ». J’ai par ailleurs horreur de la littérature dite érotique, alors que je crois possible un nouvel érotisme littéraire, pas du tout du côté de Sade mais du côté de Restif ou de Morand, ici et là de Jouve, de Jean Genet et de Michaux pour le comique onirique que j’essaie de recycler à ma façon dans La Fée Valse.
°°°
 A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.
A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.
Contrepoint. – J’ai l’air, là, de m’indigner moralement, mais c’est autre chose que je visais dans l’évocation de ce nouveau « format » du fantasme collectif. À seize ans déjà, le phénomène de la « vie par procuration », au début de la télé, me paraissait une menace. Mais on peut voir les choses autrement, et l’expérience y aide. N’empêche : dans la baise par procuration, sur Webcamworld.com, des individus, des couples, des groupes, des familles entières même s’astiquent et s’enfilent par tous les trous pour de l’argent. On peut y voir une nouvelle forme de prostitution, ou un exutoire. De toute façon : le fait charrie des millions de dollars et c’est à considérer attentivement.
En 3D, nous aurons retrouvé en mai les branleurs et autres niqueurs de plage en leur avatar « libertin » de Cap d’Agde, bidochons de la middle class européenne se la jouant Satiricon en relançant tous les codes de conformisme collectif sous latex et monoï - nouveaux maîtres minables des lieux parce qu’y faisant pisser l’euro…
°°°
Je me rappelle que, vers l’âge de 17 ans, je me suis soudain affranchi de la foi chrétienne, au chagrin de ma mère. Mais sa façon de me dire sa peine m’aurait plutôt poussé à en rajouter, comme si je devais résister à un chantage. Le même problème avec la mère américaine ou la mère juive, ces mantes religieuses suaves et tenaces Mais pourquoi ce rejet de ma part à ce moment-là, et pourquoi le retour plus tard à la religion avec le besoin d’une forme plus rigide, telle que l’offre le catholicisme ? Mon virage à droite vers la vingtaine, par réaction au conformisme gauchiste, était-il plus fondé et réel que mon retour ultérieur à la gauche ?
Contrepoint. – J’ai pourtant beaucoup de tendresse pour mes petits parents protestants de paroisse, qui allaient «pousser les lits » à l’hôpital, des chambres à la chapelle. Mais s’affranchir du Surmoi s’impose à certain âge, et la lecture de Zorba et de Camus, les chansons de Brassens et de Brel ou Ferré, composaient un début de culture. Ensuite l’inquisition du groupe progressiste, et le côté bon clan des prétendus non conformistes de droite, m’ont également rebuté.
°°°
Béla Grunberger cite cette croyance selon laquelle le Dieu le plus ancien était un être d’une méchanceté sans bornes. A ce propos, revenir à l’Histoire du méchant Dieu de Pierre Gripari. Pour ma part la conviction que Dieu n’aura jamais été que la projection des hantises, des peurs et des besoins, puis des aspirations les plus hautes de la misérable et « divine » humanité. Celle-ci en est en effet devenue plus « divine » à certains égards, et plus misérable que jamais.
 Contrepoint. – J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique.Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la « folie de Dieu ».
Contrepoint. – J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique.Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la « folie de Dieu ».
L’Eternel a brouillé les cartes du langage pour faire pièce à la volonté de puissance unanime des hommes.
Contrepoint. – Littérature quand tu nous tiens. Comme si Babel relevait de la volonté d’un seul Dieu alors que le mythe procède d’une division antérieure et d’une recomposition aléatoire
°°°
L’image de la Vierge ne m’a jamais inspiré. Qui plus est immaculée de conception. Autrement dit: la femme niée jusqu’à l’état d’ectoplasme. Et je me demande aujourd’hui: qui croit vraiment réellement, sincèrement à cela ? Sûrement pas moi. Autant dire que je reste protestant à cet égard. Aucun goût pour le Saint Esprit non plus, ou plus exactement: plus du tout aujourd’hui. Le nom de Dieu m’apparaît plutôt comme un chiffre, à la manière juive, par conséquent imprononçable.
 Contrepoint. - Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le Saint Esprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésil trop concret. Ainsi de suite…
Contrepoint. - Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le Saint Esprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésil trop concret. Ainsi de suite…
°°°
Le nom de fanatique vient, étymologiquement, de l’expression: serviteur du temple.
Contrepoint. - Les étymologies peuvent éclairer, mais elles ont souvent bon dos.
°°°
Le judaïsme est fondé sur le principe de réalité, auquel s’opposent le christianisme et l’islam. Plus qu’une religion le judaïsme est une morale. Règne et pivot de la Loi. Le judaïsme est oedipien-pragmatique, tandis que le christianisme vise à la sublimation et à la pureté. Pas d’au-delà juif: pas de ciel. L’interprétation divergente du mythe édénique est significative à cet égard. Pour les juifs, l’Arbre de la connaissance symbolise le privilège exclusif de Dieu, alors que le péché originel des chrétiens est d’ordre pulsionnel. Le serpent assimilé à un symbole phallique. (en lisant Narcissisme Christianisme Antisémétisme de Béla Grunberger)
Contrepoint. - Il y a quelque chose du terrorisme dans certains discours psychanalytiques, et j’ai ressenti la lecture de ce livre de Béla Grunberger comme une espèce de vengeance, tout en reconnaissant maintes vérités là-dedans, comme dans l’anti-christianisme de Rozanov reprochant, non loin de Nietzsche, la face sombre de cette religion anti-pulsionnelle et plombée par le goût de la douleur. Côté narcissisme, l’adoration du jeune homme se retrouve (notamment) dans la peinture italienne, et je me rappelle cette observation faite, par de ne sais plus qui, à propos du culte homosexuel voué par un Marcel Jouhandeau à la figure du Christ. À voir aussi les Saint Sébastien crevant pour ainsi dire de jouissance trouble. Philippe Sollers, pour sa part, parle d’ « athées sexuel » à propos du Christ...
°°°
 Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Charles-Albert Cingria ou par un Vassily Rozanov, un Chesterton ou un Chestov, une Annie Dillard ou une Maria Zambrano, après Simone Weil évidemment.
Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Charles-Albert Cingria ou par un Vassily Rozanov, un Chesterton ou un Chestov, une Annie Dillard ou une Maria Zambrano, après Simone Weil évidemment.
Contrepoint. – J’entends le terme d’écrivain sans aucune résonance sociale de prestige, juste en fonction d’un certain lien, quasi charnel, avec la langue et les mots, tel que l’évoquait Audiberti. On pourrait dire aussi : poète. Ou chercheur de sens à travers les mots et les images. Godard est philosophe à sa façon, mais aussi poète et ami du chien. DansFilm socialisme, il imagine un enfant devenu ministre. Dans son entretien récent avec Le Monde, il propose à Hollande de prendre Marine Le Pen pour premier ministre. Il a pleinement raison. De même devrions-nous arrêter Ueli Maurer, l’ancien Président de la Confédération suisse, après ses déclarations relatives à Tien’Anmen, comme quoi ce serait le moment de « tourner la page ». Va-t-on, avec cet « ami » de Poutine (il l’a aussi faite !), « tourner la page » du Goulag ? La politique doit tenir compte des faits, c’est sûr. Donc : Marine à Matignon, et Maurer en prison !
°°°
Les souvenirs d’Anne Atik sur Beckett, intitulés Comment c’était, me surprennent et me passionnent. On y découvre un homme extrêmement attentif à la poésie, et dans toutes les langues, doublé d’un être attachant, bon et généreux. Egalement emballé par la relecture deLa panne, de Dürrenmatt, dont le climat restitue merveilleusement le ton de la Suisse moyenne. Et ce ne sont que deux livres parmi la foison de meslectures de ces jours, où les essais de Mallarmé voisinent avec les Remarques mêlées de Wittgenstein et le pavé de Béla Grunberger sur le narcissisme.
 Contrepoint. - Notre bibliothèque est comme un corps nombreux. Le souci bibliophilique m’est étranger, mais je parcours mes rayons comme une abeille les siens. L’abeille est membre du rucher, et moi je sais que tel livre fait partie de mon corps, quitte à le racheter plus tard si je m’en suis défait par erreur. Nous devons voir à peu près 15.000 livres à la Désirade, et je commence à en filtrer les départs direction la librairie de La Pensée sauvage où j’ai dû en solder à peu près 5000. À l’isba, je vais atteindre les3000, et à l’Atelier de Vevey se regroupent tout Gallimard, la philo et lesAnglo-Saxons, vers les 5000 encore, dont je me délesterai sans risquer l’atrophie. En somme, comme Godard travaille à ses montages polymorphes, je travaille ma bibliothèque virtuelle et plus que réelle « au corps », grappillant et faisant mon miel.
Contrepoint. - Notre bibliothèque est comme un corps nombreux. Le souci bibliophilique m’est étranger, mais je parcours mes rayons comme une abeille les siens. L’abeille est membre du rucher, et moi je sais que tel livre fait partie de mon corps, quitte à le racheter plus tard si je m’en suis défait par erreur. Nous devons voir à peu près 15.000 livres à la Désirade, et je commence à en filtrer les départs direction la librairie de La Pensée sauvage où j’ai dû en solder à peu près 5000. À l’isba, je vais atteindre les3000, et à l’Atelier de Vevey se regroupent tout Gallimard, la philo et lesAnglo-Saxons, vers les 5000 encore, dont je me délesterai sans risquer l’atrophie. En somme, comme Godard travaille à ses montages polymorphes, je travaille ma bibliothèque virtuelle et plus que réelle « au corps », grappillant et faisant mon miel.
°°°
Ne pas se laisser gagner par la morosité ambiante. Jamais. La lecture de Comment c’était, évoquant la vie de Beckett, m’est ces jours précieuse. Présence constante de la poésie dans cette vie, et son manque dans la mienne. Pas assez acharné à défendre et à illustrer le chant du monde. Cela que je dois relancer dans Les passions partagées et sans discontinuer - cela qui m’a toujours tenu ensemble et ramené à lajoie.
Contrepoint. - Charles-Albert Cingria est à mes yeux l’écrivain par excellence du chant du monde.
°°°
Pas mal de délire russe et d’époque (sur l’Eglise et la Révolution) dans les Feuilles tombéesde Rozanov, mais l’essentiel qui m’importe est ailleurs: dans l’intimité et dans la beauté de l’aveu. Or je vois mieux à présent ce qu’il y a, là-dedans, de péniblement idéologique, et ce qui s’en dégage en chant d’amour, et notamment grâce à laprésence de celle qu’il appelle “maman” ou “l’amie”, et que moi j’appelle “ma bonne amie”.
Contrepoint. - Cette dualité du génie dostoïevskien, nocturne et lumineux à la fois, méchant comme un pope et doux comme un starets, je l’ai retrouvée chezDimitri, le premier à me révéler Rozanov.
°°°
Je me disais ce matin que j’aurais besoin d’un exergue pour Les Passions partagées, sur quoi je prends un livre au hasard, En vivant en écrivant d’Annie Dillard, je l’ouvre et voici la première phrase que je lis: « Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ? » Et cet après-midi, après avoir dormi (très fatigué que j’étais par les deux bouteilles de Corbières d’hier soir), j’ai repris Comment c’était, le livre d’Anne Atik évoquant le souvenir de Samuel Beckett et j’ai pensé que l’exclamation initiale de Fin de partie, “Encore une journée divine !”, ferait également un exergue possible (il m’en faudra trois) pour Les passions partagées.
Contrepoint. - Godard partage mon goût prononcé pour les citations. Cingria disait que l’art de la critique passait par l’art de la citation. Le lecteur-blogueur Francis Richard en est la parfaite illustration.
°°°
Le sentiment que l’Eternel est injuste est trèsprésent dans l’Ancien Testament. “Le chemin du Seigneur n’est pas équitable”,dit Ezéchiel (18, 25). Et ceci de parlant: “Les pères ont mangé du raisin vertet ce sont les enfants qui ont les dents rongées”.
Contrepoint. - Pierre Gripari, dans un entretien que je lui avais proposé, traitait le Dieu de l’Ancien Testament d’ordure nazie, et le Christ de fiole sentimentale. Ces propos n’ont pas passé dans l’hebdo Construire où ils devaient paraître, et j’ai consenti à leur censure. Pierre m’en a voulu, mais je lui ai reversé la moitié de ma pige.
°°°
L’idée de la rétribution concerne la nation (Israël, peuple élu) dans l’Ancien Testament et devientensuite un enjeu personnel. Pari de Pascal, etc.
Contrepoint. - Horreur de cela depuis toujours. La seule idée d’un marché,en la matière, me semble indigne. Abomination des deals entre les croyants et la divinité, qui récompenserait parcequ’on n’a pas copulé (ou pas assez) ou qu’on est mort pour elle. Par ailleurs, les notions de peuple élu, deChrist des nations (la Pologne) ou de Fille aînée de l’Eglise (la France) merévulsent autant que la croyance selon laquelle Dieu aurait protégé la Suisse,lors des deux guerres mondiales, pour cause de bonne conduite.
°°°
Toute conversation sur Dieu sonne de travers à mes oreilles. Comme si l’on parlait toujours d’autre chose. Je pourrais dire avec Flaubert que ceux qui veulent prouver Dieu me sont aussi étrangers que ceux qui le nient.
Contrepoint. - Cela ne concernant ni les enfants et les vieilles personnes, ni les poèmes quand ils me parlent de Dieu entre les lignes. D’ailleurs j’ai rituellement posé la question aux écrivains que j’estimais le plus, dont pas mal d’agnostiques ou d’athées: que répondriez-vousà un enfant qui vous demanderait qui est Dieu ?
Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini.« Je sens que je serais capable de traverser un mur », dit-il ainsi à son maître. Et lui: « Alors vas-y ». Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hubris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: « Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des oppositions ». Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.
Contrepoint.- Après sa première grande exposition à Lausanne, mise sur pied à la prestigieuse Galerie Pauli après l’article très élogieux que j’avais publié dans 24 Heures, et son entrée dans le gotha du marché de l’art, Fabienne Verdier m’avait gentiment grondé par téléphone en m’appelant l’ « ours des alpages », au motif que je m’étais inquiété, entre les lignes, de l’avenir d’une artiste passant de l’« ascèse de création » au statut de figure d’adulation. Ai-je été indélicat ? Ce que je sais, c’est que la femme de Braque m’avait précédé sur cette voie en mettant en garde Nicolas de Staël « menacé » par la gloire et l’argent…
°°°
À La Désirade, ce samedi 14 juin. – Soixante-sept ans aujourd’hui. Ce que je ressens par mes jambes et mon souffle, ou par mes angoisses lucides du premier éveil, mais guère dans ma tête, où j’ai toujours entre dix-huit ou vingt-cinq ans… sur quoi ma bonne amie me souhaite bon anniversaire, bientôt suivie de Julie et Sophie par SMS...

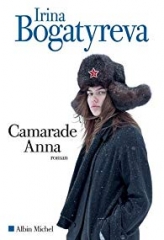




 La poésie est une musique. C’est la pensée qui me vient immédiatement en lisant les poèmes de jeunesse de Pasolini, que la version bilingue me permet aussi d’entendre commeil le faut évidemment.
La poésie est une musique. C’est la pensée qui me vient immédiatement en lisant les poèmes de jeunesse de Pasolini, que la version bilingue me permet aussi d’entendre commeil le faut évidemment. Un haut-le-cœur m’a secoué en lisant un « tous ménages » dévolu à la SUISSE GARANTIE et sous-titré : Plaisir et santé, où il n’est question que de bouffe et de bien-être, sous l’égide de ce label Suisse garantie. Or j’ai beau n’être pas contre la défense de la culture et de l’agriculture helvétiques : cette rhétorique me révulse et m’impatiente de ferrailler contre cette nouvelle Suisse auto-satisfaite et se repliant de plus en plus sur elle-même. Je vais donc continuer d’attaquer cette SUISSEGARANTIE, comme je m’y emploie depuis que j’écris. Contre la consommation. Contre la folie gastro. Contre la folie déco. Contre toute cette acclimatation qui fait obstacle et plus encore : offense à l’esprit. Et ceux là que je vais combattre plus que jamais : les éteignoirs de l’esprit.
Un haut-le-cœur m’a secoué en lisant un « tous ménages » dévolu à la SUISSE GARANTIE et sous-titré : Plaisir et santé, où il n’est question que de bouffe et de bien-être, sous l’égide de ce label Suisse garantie. Or j’ai beau n’être pas contre la défense de la culture et de l’agriculture helvétiques : cette rhétorique me révulse et m’impatiente de ferrailler contre cette nouvelle Suisse auto-satisfaite et se repliant de plus en plus sur elle-même. Je vais donc continuer d’attaquer cette SUISSEGARANTIE, comme je m’y emploie depuis que j’écris. Contre la consommation. Contre la folie gastro. Contre la folie déco. Contre toute cette acclimatation qui fait obstacle et plus encore : offense à l’esprit. Et ceux là que je vais combattre plus que jamais : les éteignoirs de l’esprit. À travers les années, essai de contrepoint.
À travers les années, essai de contrepoint. Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.
Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie. A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.
A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter. Contrepoint. – J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique.Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la « folie de Dieu ».
Contrepoint. – J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique.Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la « folie de Dieu ». Contrepoint. - Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le Saint Esprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésil trop concret. Ainsi de suite…
Contrepoint. - Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le Saint Esprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésil trop concret. Ainsi de suite… Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Charles-Albert Cingria ou par un Vassily Rozanov, un Chesterton ou un Chestov, une Annie Dillard ou une Maria Zambrano, après Simone Weil évidemment.
Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Charles-Albert Cingria ou par un Vassily Rozanov, un Chesterton ou un Chestov, une Annie Dillard ou une Maria Zambrano, après Simone Weil évidemment. Contrepoint. - Notre bibliothèque est comme un corps nombreux. Le souci bibliophilique m’est étranger, mais je parcours mes rayons comme une abeille les siens. L’abeille est membre du rucher, et moi je sais que tel livre fait partie de mon corps, quitte à le racheter plus tard si je m’en suis défait par erreur. Nous devons voir à peu près 15.000 livres à la Désirade, et je commence à en filtrer les départs direction la librairie de La Pensée sauvage où j’ai dû en solder à peu près 5000. À l’isba, je vais atteindre les3000, et à l’Atelier de Vevey se regroupent tout Gallimard, la philo et lesAnglo-Saxons, vers les 5000 encore, dont je me délesterai sans risquer l’atrophie. En somme, comme Godard travaille à ses montages polymorphes, je travaille ma bibliothèque virtuelle et plus que réelle « au corps », grappillant et faisant mon miel.
Contrepoint. - Notre bibliothèque est comme un corps nombreux. Le souci bibliophilique m’est étranger, mais je parcours mes rayons comme une abeille les siens. L’abeille est membre du rucher, et moi je sais que tel livre fait partie de mon corps, quitte à le racheter plus tard si je m’en suis défait par erreur. Nous devons voir à peu près 15.000 livres à la Désirade, et je commence à en filtrer les départs direction la librairie de La Pensée sauvage où j’ai dû en solder à peu près 5000. À l’isba, je vais atteindre les3000, et à l’Atelier de Vevey se regroupent tout Gallimard, la philo et lesAnglo-Saxons, vers les 5000 encore, dont je me délesterai sans risquer l’atrophie. En somme, comme Godard travaille à ses montages polymorphes, je travaille ma bibliothèque virtuelle et plus que réelle « au corps », grappillant et faisant mon miel.























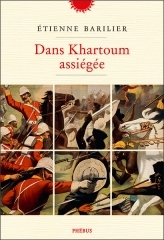



 Les diableries de l’histoire humaine
Les diableries de l’histoire humaine 
 «Aujourd’hui on ne sait plus parler, parce qu’on ne sait plus écouter. Rien ne sert de parler bien : il faut parler vite, afin d’arriver avant la réponse, on n’arrive jamais. On peut dire n’importe quoi n’importe comment : c’est toujours coupé. La conversation est un jeu de sécateur, où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu’elle pousse». (Jules Renard, Journal, 29 janvier 1893.)
«Aujourd’hui on ne sait plus parler, parce qu’on ne sait plus écouter. Rien ne sert de parler bien : il faut parler vite, afin d’arriver avant la réponse, on n’arrive jamais. On peut dire n’importe quoi n’importe comment : c’est toujours coupé. La conversation est un jeu de sécateur, où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu’elle pousse». (Jules Renard, Journal, 29 janvier 1893.)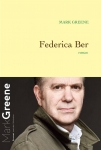

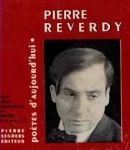
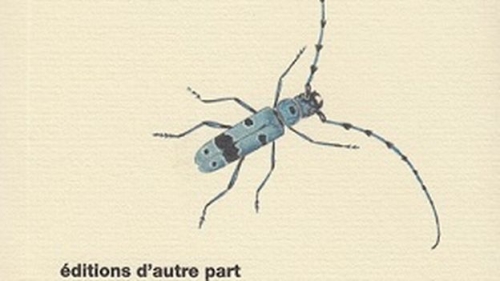
 Précipités de la lenteur
Précipités de la lenteur Y a d’la joie dans les pépites de Milhit...
Y a d’la joie dans les pépites de Milhit...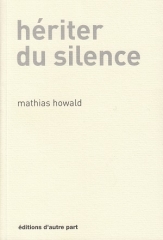 D’amour et d’eau profonde
D’amour et d’eau profonde

