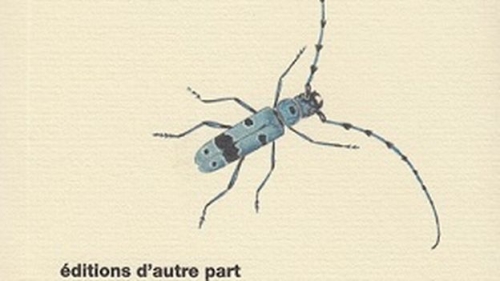
Trois livres récemment parus à la même enseigne, respectivement signés Odile Cornuz, Pierre-André Milhit et Mathias Howald, illustrent, chacun à sa façon, les vertus libératrices de la mise en mots, entre exorcisme poétique, fantaisie débridée et récit de vie vibrant d’émotion.
D’autre part on est content que ça existe, j’veux dire: les éditions d’autre part...
Les esprits chagrins prétendent qu’y a plus rien, plus d’art qui vaille ni de littérature dans l’océan de l’insignifiance bavarde, mais d’autre part il y a des îles, j’veux dire des voix personnelles dans la confusion des pseudos, des fenêtres de parole dans les murs de silence, et trois petits livres le prouvent à l’enseigne des éditions d’autre part: trois passerelles fines et solides à la fois jetées au-dessus du vide et qui constituent autant de liens de parole.
Et c’est Odile Cornuz renouant avec le verbe plus ou moins délirant et détonant du génial Henri Michaux. Ou c’est Pierre-André Milhit défiant à sa façon la platitude et la morne jactance en trouvère éclatant de fantaisie. Ou c’est Mathias Howald faisant parler son père taiseux par delà les eaux sombres.
 Précipités de la lenteur
Précipités de la lenteurOn sait, d’autre part, ce qu’est en chimie un précipité, à savoir un corps insoluble formé par réaction entre deux ou plusieurs substances en solution. Or l’expérience vaut aussi en poésie, quand l’image cristallise sous l’effet conjugué d’un sentiment diffus et d’une idée claire, d’une émotion et d’une fulgurances verbale. La poésie de Michaux procède de cette chimie verbale qui associe précipitation et lenteur, et très explicitement dans le poème en prose intitulé La ralentie, entre autres exemples à foison.
On lit ceci et c’est un précipité tout de lenteur: «Il lui tranche la tête avec un sabre d’eau, puis plaide non coupable et le crime disparaît avec l’arme qui s’écoule ». Ou bien, sur le ton de la parodie comique des sentences graves, si fréquente chez Michaux: «Qui sait raser le rasoir saura effacer la gomme». Ou se la jouant moraliste: « Les jeunes consciences ont le plumage raide et le vol bruyant». Ou cet autre précipité à lents effets: «Qui laisse une trace laisse une plaie»...
Le comique profond de Michaux ne se retrouve guère, à vrai dire, dans Ma ralentie d’Odile Cornuz, qui se met plutôt à l’école de lucidité du génial explorateur des gouffres mentaux en enfant du siècle luttant contre les platitudes du quotidien et les injonctions de la multitude: «On en prend plein la figure, encore. C’est la sensibilité, paraît-il. Ça se développe, ça se cultive, ça devient une maladie. On ne sait pas quelles formes ça prend. C’est imprévisible. Ça dépend des humeurs, des hormones, de la force du vent ».
La force aussi, ou disons le peu de force qui fait pièce à la déprime ou à certain désabusement, Odile Cornuz le trouve alors dans les mots, ceux de La ralentie «pour la route » et les siens pour pallier le poids du monde: «Finie la fatigue ! On n’est plus fatiguée ! Ralentie peut-être mais avec joie», etc.
 Y a d’la joie dans les pépites de Milhit...
Y a d’la joie dans les pépites de Milhit...De la joie il y en a, d’autre part, plein les pages de La couleuvre qui se mordait la queue de Pierre-Andre Milhit, mais pas ça d’euphorie à la petite semaine genre je-positive-au-niveau-du-ressenti : plutôt de la malice et parfois grave, de l’allégresse fusant du gosier de ce drôle d’oiseau binoclard à moustache, avec un ton unique quoique très Valais de bois dans l’intonation et les vignettes gravées au fin couteau, pas loin de l’immense Chappaz en plus gouailleur ou jazzy, mais la terre soleilleuse et rude est bien là, la terre et ses gens, ses sucs et ses magies: «Le miroir a traversé la chambre sans saluer / le traquet et l’alouette ont sifflé des remontrances (...) l’étoile orpheline a repris des couleurs / elle m’attend pour la pâque ou pour le solstice», etc.
Il y a du conteur et du sourcier de verbe vif chez Pierre -André Milhit qui, d’autre part me semble un auteur bien typique des éditions de Pascal et Jasmine (Jasmine Liardet et son bon ami Pascal Rebetez) dont on sait qu’ils ont un pied à Genève, un autre dans le val d’Entremont et de vibratiles antennes au Jura et aux trois autres coins du pays romand - l’auteur typiquement atypique de la petite maison me semblant inclassable quoique reconnaissable à sa papatte, de Corinne Desarzens à Jean-Pierre Rochat ou à François Beuchat, etc.
Il y a comme un furet d’amour dans le bois joli de La couleuvre qui se mordait la queue, dont la trace se fait très légère au début des strophes comme jetées en désordre (brassée de feuilles numérotées sans suite que le lecteur ramasse à son gré vu que « l’abracadabra de la fontaine a mélangé ses formules») et qui trace pourtant un chemin à valeur de carnet de bord de cantonnier lyrique aux yeux bien ouverts sur ses frères humains et autres belles-sœurs.
Si la mélancolie pointe ici et là, ou la rage ou le bourdon, tout est sauvé-sublimé par la vigueur et la verdeur de vif-argent du poète faisant pouët-pouët tralala: «J’ai mangé du fauve pour mon quatre heures / la feuille couleur caramel / les aiguilles de mélèze crème vanille / j’ai roté un cœur d’écureuil aux épices», etc.
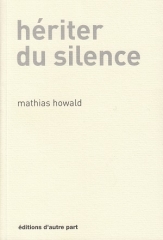 D’amour et d’eau profonde
D’amour et d’eau profondeLe premier roman de l’enseignant lausannois Matthias Howald, dédié à son père et qu’on suppose tout proche d’un récit de vie lesté du vécu de l’auteur, touche par la vibrante émotion qui s’en dégage aussitôt, la limpidité de son expression et sa construction temporelle non linéaire, faisant alterner les épisodes au gré des tâtons de mémoire relevant explicitement du travail de deuil.
Le penseur russe Léon Chestov parlait des «révélations de la mort», et l’expression est bien appropriée, en l’occurrence, à la démarche de l’auteur - fils de photographe évoquant immédiatement le labo privé de son père, propriétaire d’un magasin lausannois à l’enseigne de Temps de pose – qui se sert de l’écriture comme d’un révélateur alors même qu’il fait « parler » les photos de famille prises par son père en reconstituant bel et bien un roman familial avec ses figures ressuscitées sans complaisance, ses ombres et ses non-dits, jusqu’au trou noir occulté d’un secret douloureux, mais aussi le lien filial et la complicité père-fils qui permet au romancier de recomposer (notamment) le portrait du prénommé Pierre, aussi attachant que taiseux, et de la prénommée Murielle, grand-mère paternelle de Mathieu le narrateur.
À fines touches, bien ancré dans un décor lausannois qui n’a rien pour autant d’anecdotique, captant ici et là des expressions locales qui rendent par exemple les échanges gênés voire obscurs d’une réunion de famille à grand renfort de «c’est clair !», Mathias Howald nous touche par la minutieuse précision de son récit, et l’émotion qui s’en dégage en dépit de sa retenue, et plus encore : nous implique, car la façon de Mathieu de multiplier les arrêts sur images des albums de sa famille ne laisse de nous renvoyer à nos propres souvenirs, bonheurs et frustrations mêlés.
Ayant un jour reçu La vie mode d’emploi des mains de son père, sans un mot d’explication, le narrateur d’Hériter du silence évoque le livre de Georges Perec à la fin de son récit, et notamment la liste des manies de l’écrivain qui lui rappelle celles de son paternel quelques jours avant sa mort, comme de compter les fenêtres qu’il voyait du canapé de son salon («C’est con, hein, de faire ça ?», lui disait-il), dans ce qu’on pourrait dire un geste de transmission fondant le sens et la valeur de ce beau premier roman.
Odile Cornuz. Ma ralentie. Editions d’autre part, 154p.
Pierre-André Milhit. La couleuvre qui se mordait la queue. éditions d’autre part, 119p.
Mathias Howald, Hériter du silence. éditions d’autre part, 183p.