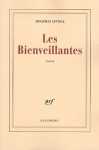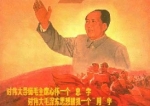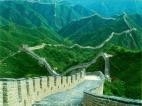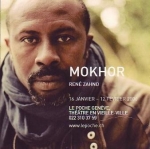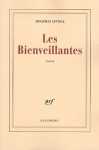
LITTELL Jonathan Les Bienveillantes. Gallimard, 904p.
Toccata
- Première invocation au début de cette Toccata : « Frères humains ! Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s’est passé. »
- Un personnage qui cherche aussitôt à s’inscrire sous le signe de la banalité. Du nom de Max Aue. Double nationalité. Bilingue.
- Il dit écrire pour lui-même.
- Pas pour se justifier, mais pour clarifier le chaos de ses pensées et de ses souvenirs.
- Pour s’occuper aussi. Pour passer le temps.
- Alors même que c’est un homme occupé. Patron d’usine.
- Il se dit une « usine à souvenirs ».
- Se dit constipé chronique.
- Sa raison d’être : manger, boire, déféquer et chercher la vérité.
- Il se défie cependant de trop de pensée.
- N’éprouve aucune culpabilité, dit-il à ce point.
- Il va vomir de temps en temps.
- Ecrit dans le bureau de son usine de dentelles.
- Description précise des machines et du travail, de ses rapports avec les ouvriers. Qui ne l’aiment pas. Et que lui n’aime pas non plus.
- Il est docteur en droit.
- Mais aurait préféré étudier la littérature ou la philo.
- D’éducation française.
- Mais il a fait son droit en Allemagne, avant de s’engager dans la SS.
- Est revenu d’Allemagne, en 1945, sous un uniforme volé à un ouvrier français du STO.
- Se dit « tombé en bourgeoisie » en se refaisant une vie honorable, marié avec une femme qu’il n’aime pas.
- Dit avoir vu « plus de souffrance que la plupart », mais le dit froidement, avant d’ajouter que les gens s’y font.
- Commence à parler chiffres, très importants à ses yeux.
- Commente les chiffres comparatifs des pertes humaines pendant la 2e Guerre mondiale.
- Met en parallèle les pertes allemandes, les pertes russes, les pertes juives et les pertes françaises en Algérie…
- La pensée de la mort le hante tous les jours.
- Lance à son interlocuteur (le lecteur) : « Si jamais vous arriviez à me plaire pleurer, mes larmes vous vitrioleraient le visage ».
- Cite Sophocle : « Ce que tu dois préférer à tout,c’est de n’être pas né ».
- Un nihiliste, mais refusant le suicide.
- Persuadé de vivre dans le pire des mondes possibles.
- Dans lequel tout peut se répéter.
- Ne prétend pas avoir agi par soumission aveugle aux ordres, mais par sens du devoir.
- « Le génocide moderne est un processus infligé aux masses, par les masses, pour les masses ».
- Un processus « segmenté par les exigences des méthodes industrielles ».
- Prétend que ce qu’il a fait, tout homme l’aurait fait.
- Pensent que les brutes et les psychopathes, les sadiques et les fous ne sont pas les plus dangereux dans un système totalitaire.
- « Le vrai danger, our l’homme, c’est moi, c’est vous ».
- Il n’a pas demandé à devenir un assassin.
- Il rêvait d’être pianiste.
- Mais le talent lui a manqué.
- Et sa mère ne l’aimait pas.
- Aurait peut-être préféré être une femme.
- N’en a vraiment aimé qu’une sa vie durant : sa sœur jumelle Una.
- Il dit avoir été « au cœur de choses affreuses ».
- La guerre n’a pas été pour lui une solution mais une question. Cependant elle a contribué à la révéler à lui-même.
- Se prétend une fois encore un homme comme les autres.
Allemandes I et II
- On le retrouve sur le front de l’Est, en pleine confusion.
- Les SS sont envoyés en appui de la Wehrmacht pour le « nettoyage ».
- Se trouve au milieu d’une mêlée de gradés qui attendent un nouveau chef, après qu’un certain Blobel a pété les plombs.
- Un ancien flic de Düsseldorf à tête de vautour, brutal et grossier, que Max n’aime pas.
- Dans le château de Lutsk, on retrouve 1000 cadavres de Polonais et d’Ukrainiens exécutés par le NKVD. Les nazis disent : et les Juifs.
- Le Sonderkommando commence à agir.
- Problèmes pratiques. Les chefs n’aiment pas la méthide russe, consistant à viser la tête à bout portant. Trop éprouvant pour les hommes.
- Blobel affirme qu’il faut « labourer les Juifs ».
- Ordre est donné de liquider 1000 Juifs.
- Mais l’ordre provoque des remous chez les officiers.
- Pour trouver les Juifs, on les convoque en prétextant le travail obligatoire.
- Max Aue trouve ça une « belle saloperie ».
- Se refuse, à ce point, d’agir en automate.
- Le récit est rapide et tendu, très vivant, saturé de dialogues enchâssés dans les paragraphes.
- Max évoque ensuite les humiliations infligées aux Juifs.
- Traversée de Lamberg.
- Visite le musée des religions d’une église uniate, où la tradition juive reste très présente.
- Raconte ensuite comment son ami Thomas l’a aidé à s’engager sur le front de l’Est, après une mission en France dont il est revenu avec un rapport jugé « trop honnête »…
- Il est allé étudier le degré de combattivité des pro-nazis français et a rencontré les idéologues fascistes Brasillach et Rebatet.
- A conclu que le doute français n’était pas favorable à la guerre sur le front Est. On n’apprécie pas ses conclusions.
- C’était un mois avant l’invasion de la Pologne, en août 1939.
- Evoque l’opportunisme cynique de Thomas.
- Qui le persuade de le suivre en Pologne où on « va s’amuser »…
- Il rit en constatant que c’est « ainsi que le diable élargit son domaine ».
- « Quel homme sain d’esprit aurait jamais pu s’imaginer qu’on sélectionnerait des juristes pour assassiner des gens sans procès ? »
- Thomas est l’homme fort, le mentor, le jouisseur sans scrupule, l’arriviste de toutes les entreprises.
- Max est plus statique, observateur, curieux.
- Il a postulé à la SS pendant ses études pour économiser les frais d’inscription à l’Université…
- A Berlin, Max a partagé sa passion entre Kant et les jeunes prolétaires.
- Un soir, il est appréhendé dans un parc de Berlin, lieu de rencontre pour homosexuels.
- Scène de l’arrestation (p.71)
- Thomas lui sauve la mise, une première fois.
- Il entre au SD « le cul encore plein de sperme ».
- Puis il se retrouve avec l’armée du front de l’Est.
- On arrive dans les plaines ukrainiennes.
- Les peuples sont tiraillés entre Russes, Magyars et Allemands.
- Les prisonniers juifs croient encore que les Allemands vont les libérer.
- On lui propose d’assister à une Action.
- « Fermer les yeux, ce n’est jamais une réponse ».
- Mais il a encore des doutes, comme beaucoup.
- Il observe les Ukrainiens, contraint de tirer sur les Juifs.
- Se demande comment ils en sont arrivés là.
- Scène de boucherie- pagaille épouvantable.
- Cela le dégoûte, mais il souffre surtout de s’être planté une écharde.
- Déplore l’amateurisme de ces exécutions.
- Mais celui-ci sera corrigé.
- Il assiste à une exécution. On appelle ça Exekution-Turismus.
- Il note : « Depuis mon enfance, j’étais hanté par la passion de l’absolu et du dépassement des limites ; maintenant, cette passion m’avait amené au bord des fosses communes de l’Ukraine ».
- Toujours se rappeler que le récit de Max Aue se passe des années après les faits et que c’est une reconstruction, adressée à un auditeur sans visage.
- Pour Max, le nazisme doit être une Loi vivante.
- Il refuse de considérer les Russes comme des sous-hommes.
- Il ressent « comme une haine triste ».
- On l’informe à propos du Führervernichtungsbefehl. L’ordre du Führer portant sur l’élimination.
- On lui propose d’être muté ailleurs.
- Mais il refuse.
- Il rencontre Yakov, petit pianiste juif virtuose. Avec lequel il parle de Bach, Couperin et Rameau.
- L’ambiance du Kommando se dégrade. Les hommes craquent.
- On développe la méthode du Sardinenpackung pour l’entassement des cadavres dans les fosses.
- Il classe ses collègues en « voluptueux », « dégoûtés » et « obéissants ».
- Il ne cesse de les observer et de s’observer lui-même, « avec effroi ».
- Observe ce jeune père soldat qu’un Juif supplie de fusiller ses enfants « proprement ».
- Lui-même ressent de la colère contre une petite fille qu’on va tuer. Cette réaction est typique : l’horreur ressentie pousse à la précipiter et l’amplifier.
- Il fait de plus en plus de cachemars.
- Le récit clinique, évoquant un rapport objectif, alterne avec des plongées dans les rêves de Max ou dans les épisodes de son passé proche ou lointain.
- On approche de Kiev.
- Son travail est de pure bureaucratie. Des chiffres.
- Kiev abrite environ 150.000 Juifs.
- Un officier supérieur propose d’en fusiller 50.000.
- On aménage les Grands Ravins.
- La Grande Action va se dérouler, dont Max ne sait pas qui l’a ordonnée.
- Lorsqu’il va y assister, il se reproche d’avoir oublié son pull-over. Il le regrettera ( !)
- Il se rappelle « une grande transgression qu’il a commise » et un horrible pensionnat dans lequel on l’a casé pour le punir, où il a été humilié.
- Il participe à la Grande Action. D’effrayantes pages (p.124-125).
- Il en est dégoûté. Se rappelle les latrines et les cafards.
- Retourne sa pitié en férocité sauvage en achevant une belle jeune fille (126).
- Porte alors un jugement sur ce que le nazisme a inventé.
- Page importante à cet égard (p.127)
- Max constate qu’on peut tuer ou ne pas tuer, au nom de l’Etat nazi, sans encourir forcément de blâme. Chacun sa place.
- L’Etat utilise chacun selon ses compétences, sachant que le réservoir des tueurs est sans fond.
- L’utopie d’Himmler, première version.
- Le soldat-cultivateur allemand et ses esclaves. Une vision futuriste proche des visions d’E.R. Burroughs.
- Le kitsch de tout ça.
- Max pourrait donc quitter le Sonderkommando.
- Mais il reste.
- Cite Chesterton à propos de mauvaises fées.
- « C’était donc cela, la guerre, un pays de fées perverti, le terrain de jeus d’un enfant dément qui casse ses jouets en hurlant de rire »
- Après la Grande Action, Max prépare un Album rassemblant les photos de massacre.
- Blobel s’extasie. Le voit comme un trophée.
- Tandis que Max le considère comme un « rappel solennel »…
- Il rencontre l’ingénieur-officier Osnabrugge, bâtisseur de ponts et imbu de la mission « culturelle » de ceux-ci.
- On rebaptise les rues de Kiev.
- Max va être promu à un grade supérieur pour son album, qui a plu à Himmler.
- Il fête son anniversaire avec Thomas.
- Thomas sur la Grande Action, qui a coûté la vie à 100.000 Juifs : « C’était vraiment très dur, très désagréable, mais c’était nécessaire. »
- Mac évoque sa sœur jumelle, qu’il n’a plus revue depuis sept ans.
- Thomas est optimiste sur la conquête : se voit bientôt à Moscou.
- Max est plus sceptique.
- Pense que les soldats n’ont pas assez de vêtements d’hiver…
- Il est entrain de lire une chronique da la campagne napoléonienne en Russie.
- Affirme par ailleurs (p.137) que « le meurtre des Juifs ne sert à rien », que c’est « du gaspillage ».
- Pense que ce « sacrifice définitif » oblige le Reich à gagner…
- Sur quoi le besoin de vomir le reprend.
- Thomas lui recommande de ne pas afficher ses opinions, puis le sonde sur ses rapports avec les femmes.
- Max évoque son amour d’Una à mots couverts.
- Fait toujours petit garçon à côté de Thomas le mec cynique.
- La Grande Action a provoqué des remous dans la Wehrmacht. Nombre de soldats sont perturbés.
- Himmler répond par un sévère rappel à l’ordre, invoquant le danger bolchévique et juif.
- Max rencontre Eichmann qu’il a connu à Berlin (p.139)
- Pour la première fois, Max entend parler de l’évacuation totale des Juifs d’Allemagne.
- Eichmann parle déjà « d’autres méthodes ».
- Eichmann, mélomane, lui a transmis un paquet de partitions de Couperin et Rameau, que Max veut donner au jeune Juif Yakov, pianiste prodige, et qui sera bientôt tué.
- Revient aux sentiments qu’il a observés chez les bourreaux de la Grande Action, dont la conscience des souffrances qu’ils infligent retourne soudain la pitié en fureur meurtrière (p.142)
- On commence à utiliser les camions Saurer.
- Le gaz est jugé moyen « plus élégant ».
- Grand rêve de Max, qui se voit en Dieu-calmar.
- Inspecte ensuite les commandos SS pour évaluer leurs besoins.
- Les partisans pullulent.
- Scène atroce de la jeune fille enceinte qu’un SS massacre avant qu’un autre sauve l’enfant, fracassé par un troisième… (149-150)
- Max est gratifié du jeune Hanika, comme ordonnance.
- Les pendus de Kharkov lui remémorent le suicide d’un de ses condisciples, abusé dans l’horrible internat où on l’a casé en son adolescence.
- Blobel débarque à Kharkov, fou de rage qu’on ne fasse pas plus de « chiffre » dans les exécutions.
- Cette obsession de la rentabilité sera déterminante.
- Une nouvelle Grande Action est mise sur pied pour Noël.
- Max y assiste pour étudier les hommes qui tirent.
- Constate qu’il s’habitue à ces horreurs.
- Episode de la jeune fille pendue à Kharkov (170-171), où l’on glisse du réalisme le plus noir à une sorte de fantasmagorie baroque, où Max se sent prendre feu
- Cette scène renvoie à la photo de la jeune martyre soviétique qui a servi de déclencheur aux Bienveillantes.
- Rage folle de Blobel, soudard de 14-18, à qui l’on demande de ménager les officiers en les tenant loin des massacres. Son ressentiments envers les Junkers. Met toute la faute sur Himmler et le Führer.
- Hanika, l’ordonnance de Max, est tué dans la rue.
- On envoie Max se reposer en Crimée.
- Les Boches ont perdu 12 divisions à cause du froid et des maladies.
- Max rencontre le médecin-officier Hohenegg, qu’on retrouvera souvent.
- Type de toubib philosophe très intéressant.
- Max se retrouve à Yalta où il lit Tchekhov en allemand.
- Rencontre le jeune lieutenant Willi Partenau, avec lequel il se lie.
- Lui raconte un peu de son enfance de mal aimé.
- En pince visiblement pour Willi.
- Pense qu’on est homo par occasion plus que par nature (c’est son cas) et que Partenau lui cédera.
- A La SS, le Führer a ordonné l’exécution des coupables de tout fait d’homosexualité.
- Mais le décret et peu connu.
- Max fait la morale aux jeunes officiers qui se compromettent avec des filles des races inférieures de la région.
- Son discours vise à impressionner Willi.
- Célèbre l’amour fraternel et le caractère pré-fasciste de Platon (p.187) dont il évoque Le Banquet.
- Ils vont nager.
- Willi remarque que Max est circoncis. Affaire d’hygiène, lui répond Max.
- Qui décrit précisément son érotisme particulier après que Willi a « fait le pas ».
- Ensuite se rappelle son amour d’Una.
- Dont sa mère l’a séparé après les avoir surpris, le traitant de cochon et de dégénéré.
- Il a connu, avec Una, « l’amour, doux-amer, jusqu’à la mort ».
- A l’internat, il a été battu et soumis par un plus grand.
- Depuis lors l’habitude est prise.
- Il aspire au sexe pur, à la baise dure, sans amour ni affect.
- Willi sera tué l’année suivante.
- A Yalta, il visite la maison de Tchekhov.
- Retrouve Ohlendorf, nazi intelligent qui partage sa Weltanschaung.
- Ohlendorf le veut à ses côtés.
- Max rejoint donc Simferopol.
- Sa mission est de recueillir des informations sur les minorités ethniques du Caucase.
- Rencontre le jeune linguiste Voss, spécialiste des langues caucasiques (p.199)
- Beau personnage d’érudit passionné.
- Lui explique que le Caucase est la « montagne des langues ».
- Exposé intéressant, où il est question de Dumézil.
- Aborde les divers systèmes de conquêtes, par rapport à la langue.
- La soviétique lui semble la meilleure : une nationalité, égale un territoire plus une langue.
- Voss vante aussi les campagnes d’alphabétisation soviétiques.
- Max est fasciné par le savoir vivant de Voss (p.205)
- Ils multiplient balades et discussions.
- Max interroge Ohlendorf à propos de la destruction des Juifs. On lui répond que c’est une erreur « nécessaire »
- L’ordre d’extermination du Führer est comparé, par Ohlendorf, à une prescription biblique.
- « Maintenant va, frappe Amalek, tue hommes et femmes, enfants et nourrissons ! » (Livre de Samuel)
- En tant que commandant, Ohlendorf proscrit la cruauté gratuite, tout en exécutant les ordres.
- Arrive un nouveau chef. Bierkamp.
- Le Vorkommando gaze un asile d’aliénés (p.217)
- Max rencontre le lieutenant belge Lippert, de la Légion Wallonie.
- Raconte la piètre conduite de Léon Degrelle.
- Max observe les nouveaux opportunistes, prêts à exterminer sans états d’âme.
- Lui fait figure d’ « intellectuel un peu compliqué ».
- Débarque à Piatigorsk.
- On continue à liquider partisans, tsiganes et reprise de justice.
- Lors d’une Action, un professeur juif, tenant un petit enfant à la main, lance à Max : « J’espère que vous serez incapable de regarder vos enfants sans voir les autres que vous avez assassinés » (228).
- Max intervient contre Turek, en train d’achever un Juif à coups de pelle.
- Retrouve ensuite Voss.
- On approche des régions caucasiennes des Bergjuden (Juifs des montagnes)
- Voss prétend que ce ne sont pas de vrais Juifs.
- Certains officiers sont pour les épargner afin d’éviter des rebellions dans les montagnes.
- L’Ostpolitik devrait accueillir les victimes de Staline.
- Mais la tradition coloniale allemande est inexistante.
- Discussion sur l’origine des langues.
- Pendant qu’on envahit et massacre, Max fait ses rapports sur les langues du Caucase. Plus tard, au milieu de l’enfer d’Auschwitz, il fera ses rapports sur les rations insuffisantes des Juifs envoyés dans les usines d’armement, alors que l’Allemagne s’écroule. C’est cela Max Aue : un faiseur de rapports.
- On amène un vieux Juif tchétchène à Max. Qui lui dit qu’il sait où on doit l’enterrer. Un soldat les escorte sur une colline.
- Episode insoutenable, le plus fort du roman (261-265)
- Ensuite Max va se laver aux bains et retrouve Hohenegg au casino : « J’ai eu une journée curieuse ».
- Philosophent à propos des attitudes de chacun devant la mort.
- Turek a insulté Max, évoquant ses mœurs (à cause de Voss).
- Max le provoque en duel.
- Qui n’aura pas lieu.
- Une réunion de spécialistes se prépare, où sera débattu le sort des Bergjuden (6000 à 7000 individus).
- Max a une grande discussion avec Voss, qui met en pièces les arguments « scientifiques » du racisme. (p.281)
- Voss attaque les bases mêmes de l’extermination (p.283).
- Max le met en garde contre ces déclarations, mais il pense lui aussi que le racisme et le nazisme sont affaire de foi plus que de science.
- Les Soviétiques lancent une contre-offensive à Stalingrad,
- Rommel a été battu par les Alliés.
- Une spécialiste, type de l’idéologue pseudo-scientifique, débarque de Berlin. Portrait carabiné (p.293).
- Des Bergjuden présentent leur folklore, leurs musiques et leurs chants.
- La Frau Doktor conclut à la « ruse de Juifs ».
- Coup de théâtre : Voss, qui a séduit une jeune indigène, se fait tirer dessus par le père de celle-ci.
- Max assiste à l’agonie de son ami. (p.295)
- Puis c’est la grande assemblée, durant laquelle les thèses de Voss défendues par Max, concluant à la protection des Bergjuden, prévalent. En réalité, c’est la rivalité entre la SS et la Wehrmacht qui fait la décision.
- Le supérieur de Max, Bierkamp, qui se réjouissait de « faire du chiffre » avec un nouveau massacre, se venge en envoyant Max Aue à Stalingrad, dans le chaudron du Diable. (302)
- « Finita la commedia »