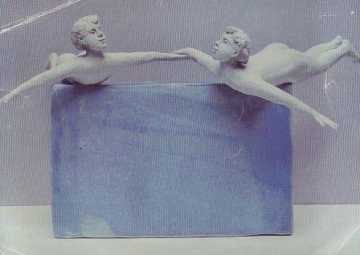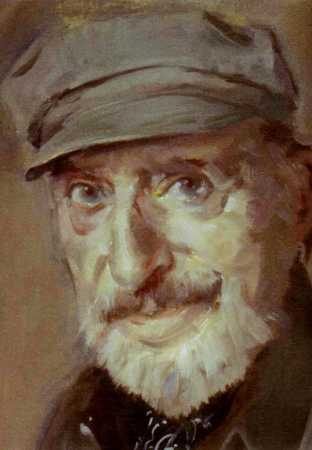AUTOFICTIONS Trois auteurs romands, Alain Bagnoud, Guy Poitry et Germano Zullo, revisitent leurs souvenirs d’enfance.
Les auteurs français contemporains souffriraient de nombrilisme, à en croire le récent pamphlet de Tzvetan Todorov intitulé La littérature en péril, et ce même reproche a souvent été adressé aux écrivains romands, tous fourrés dans le même sac qu’un Amiel dont le monumental Journal intime fait figure d’emblème du repli sur soi. Or s’il y a du vrai dans ces observations, celles-ci risquent de devenir un cliché mortifère et un oreiller de paresse pour ceux qui jugent d’avance sans y aller voir, alors que la réalité détaillée et nuancée est évidemment bien plus intéressante, riche et variée que cela.
A preuve : les trois récits récents du Valaisan Alain Bagnoud (né en 1959), du Genevois Guy Poitry (né en 1956) et de l’Italo-Suisse Germano Zullo (né en1966), qui évoquent leurs jeunes années pour mieux se définir par rapport à leur « tribu » familiale et à tout un monde en mutation. Loin de se borner à de stériles ruminations, ces livres répondent au contraire au besoin légitime, dans un monde qui se dépersonnalise, de se situer dans son rapport avec le monde environnant.
Avec son sixième ouvrage, après un portrait retouché de Saint Farinet qui rompait avec certaines idées reçues, Alain Bagnoud donne ce qui, de toute évidence, est son meilleur livre à ce jour, sous un titre qui annonce à la fois sa forme symbolique et son contenu: La Lecon de choses en un jour. A travers la journée symbolique d’un 19 mars de son enfance, sous le patronage de saint Joseph, Alain Bagnoud revit, en alternant les temps du présent des verts paradis et l’imparfait du ressouvenir, son entrée solennelle dans ce que son grand-père appelle « l’âge de rijôn », où va enfin commencer « la vraie vie ». Si le garçon rêve d’une « ordination officielle » à la façon des tribus archaïques, et s’il lui semble que son père et le père de son père, ce matin-là, le considèrent plus sérieusement que la veille, son initiation n’en sera pas moins tâtonnante et tiraillée. Ainsi, son désir d’hériter des secrets du vieux Milon, qui est un peu le sorcier du village, est-il contrarié par l’idéologie dominante du catholicisme de Monsieur le curé, des mères et de l’institutrice Augustine impatiente de former des ingénieurs, traquant le vice baveux des garçons que menace un avenir de « blousons noirs » ou de « socialistes », et considérant que les étrangers doivent être matés et que les Juifs ont été justement punis pour avoir crucifié Notre Seigneur…
Au mitan des années 60, le Valais que Bagnoud décrit par le menu, au fil d’une véritable fresque ethno-littéraire qui rappelle Le village dans la montagne de Ramuz, est le lieu d’une mutation brutale dont ont déjà témoigné Maurice Chappaz ou Germain Clavien, entre croyances ancestrales et réfrigérateurs « trois étoiles », conservatisme verrouillé et fuite en avant dans la nouvelle économie que symbolisent les investissement d’une station de ski. Or le grand intérêt de ce récit tient à son mélange de candeur naïve, sous le regard du gosse qui rapporte ce qu’il voit avec une précision malicieuse pure de tout préjugé, et de lucidité critique quoique nuancée d’empathie par l’auteur approchant la cinquantaine.
A la somme d’observations cristallisées par le truchement de personnages superbement dessinés s’ajoute, avec l’insertion de termes patoisants, une approche de la réalité à travers le parler des gens qui donne au livre sa pâte et sa vivacité proprement théâtrale. Autant dire qu’on est loin, très loin du nombrilisme décrié dans ce livre à l’écriture non peaufinée et bruissant de bonne vie.
 Amarcord Italo-helvète
Amarcord Italo-helvète
Le nom de Germano Zullo est déjà connu par les albums pour enfants que l’auteur co-signe avec la dessinatrice Albertine, lumière de ses jours dont on apprend, dans la constellation de ses souvenirs, comment elle a relayé la « lampe » maternelle. Imprégné de tendresse et d’humour, voici donc l’autoportrait kaléidoscopique de celui qui n’en finit pas, depuis ses tendres années, de rêver d’écrire un roman intitulé Des monstres sur Mars, qu’il lui faudra au moins deux cents pour achever… Quant au présent récit, plus à fleur de terre, il nous enchante par l’observation d’une allègre tribu italienne issue du village au nom prédestiné de Gioia (la joie…) où l’on parle le « gioiese » et dont la frise des personnages a son pendant italo-suisse à Genève, à commencer par une dame D. qui enseigne la musique avec la Méthode rose au risque d’enquiquiner le piano enfermé dans sa boîte comme un cheval triste…
On pense au savoureux Amarcord de Fellini en assistant au « film » des souvenirs de Germano Zullo, égrenés dans une langue claire et nette, jusqu’à l’âge de pianoter sur de douces chairs en écoutant Let’s spend the night together des Stones. C’est frais et revigorant, à la fois très personnel et grand ouvert au monde.
 De différence en ressemblance
De différence en ressemblance
Grandir sous le signe de Corydon quand on a une mère née à Croydon qui n’en finit pas de « lutter contre les hommes » fait figure, sinon de destinée : au moins de problématique programme existentiel, dont Guy Poitry détaille les tribulations avec autant de lucidité douloureuse que de souci d’émancipation et, dans un récit à subtil contrepoint, de juste distance. Quand on est né dans une « petite famille », à tous les sens du terme, qui ressemble terriblement à un million de petites familles d’un petit pays attaché à ses conventions sociales et morales, se découvrir « différent », parce que sensible, poreux, rêveur, et bientôt porté à raconter des histoires (donc forcément songe-creux et menteur pour les gens qui ont les pieds sur terre et le cataplasme pour panacée médicale), et de plus en plus décalé, et finalement confronté à un désir réputé « la honte », nourrit autant de souffrance secrète que de possibilités de liberté. Si le temps n’est plus celui de Gustave Roud ou de Jacques Mercanton, où l’homosexualité relevait du secret, excluant le « coming out », la préférence que Guy Poitry se découvre et finit par affirmer n’en est pas moins vécue dans la difficulté, exacerbée par la vindicte maternelle. Or ce récit vaut aussi, surtout même, par tout ce qui porte à la ressemblance humaine : la poésie et le musique, l’amitié et l’amour quel qu’il soit ; enfin la justesse d’une voix frémissante de sincérité.
Alain Bagnoud, La leçon de choses en un jour. L’Aire, 292p.
Germano Zullo. Quelques années de moins que la lune. La Joie de Lire, 97p.
Guy POITRY. Comme un autre. La Joie de lire, 224p.
Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 13 mars 2007.




 Amarcord Italo-helvète
Amarcord Italo-helvète De différence en ressemblance
De différence en ressemblance